La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques.
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré
- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques
La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques
Cet article de Hillary Chute, publié en 2008 dans la revue de la Modern Language Association of America 1, a marqué un tournant dans les rapports entre bande dessinée et études littéraires sur le nouveau continent. Chute propose non seulement une définition de ce média, en insistant sur les spécificités sémiotiques de cette forme d’expression plurimodale, mais elle propose également de retracer brièvement son histoire et de réfléchir sur la littérarité de ce qu’elle rebaptise le « récit graphique », en s’attardant notamment sur les œuvres d’Art Spiegelman et de Joe Sacco. Nous sommes reconnaissants à Hillary Chute et à l’éditeur de nous avoir autorisés à republier cet article, qui a été traduit par Raphaël Baroni et Sébastien Graber.
La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques. Pour ceux qui adoptent le point de vue des études littéraires, la manœuvre est évidente: soit on justifie l’intérêt de la bande dessinée en s’appuyant sur une défense de la culture populaire, soit on la rattache à la riche tradition des recherches sur les rapports entre textes et images, qui nous renvoie aux manuscrits enluminés du Moyen Âge. Mais la bande dessinée pose des problèmes que nous essayons encore de résoudre ; le terme n’entre pas facilement dans notre grammaire et la nomenclature qui l’entoure reste compliquée et controversée2. Le domaine des études littéraires n'a pas encore saisi les contours de cet objet fuyant, ni défini clairement son projet le concernant. Pour explorer les bandes dessinées contemporaines, nous devons dépasser certaines classifications antérieures : nous devons réexaminer les catégories de fiction, de narration et d’historicité. Les bourses d'études consacrées aux bandes dessinées – et plus particulièrement à ce que j'appelle les récits graphiques – sont en augmentation dans les sciences humaines. La bande dessinée peut être définie comme une forme hybride combinant des mots et des images, dans laquelle deux cheminements narratifs, l'un verbal et l'autre visuel, construisent une temporalité à l’intérieur d’un espace. La bande dessinée progresse temporellement en cheminant dans l'espace de la page, en s’appuyant sur une alternance de présences et d’absences, les cases saturées d’informations (aussi appelées vignettes ou cadres) alternant avec les gouttières (des espaces vides entre les cases). Extrêmement structurée dans sa construction narrative, la bande dessinée ne se contente pas de mélanger le visuel et le verbal – ni même d'illustrer l'un par l'autre – mais elle est plutôt encline à présenter les deux éléments de manière asynchrone : un lecteur de bande dessinée ne remplit pas seulement les blancs entre les cases, mais il opère aussi des allers-retours entre lecture et recherche visuelle du sens. Dans cet article, je traiterai la bande dessinée (comics) comme un média3, et non comme un genre populaire, telle qu’on l’entend habituellement4. Par ailleurs, je conclurai en attirant l’attention sur un genre particulièrement prégnant au sein de ce domaine : la bande dessinée non fictionnelle.
Je m’intéresserai particulièrement à la manière dont la bande dessinée met en jeu le problème de la représentation de l'histoire, car mon propre travail s'est concentré sur ce que cette forme rendait possible pour le récit non fictionnel, en particulier du fait de sa capacité de juxtaposer spatialement sur la page (et de faire se superposer) des moments passés, présents et futurs. Je m'intéresserai aussi à la manière dont la bande dessinée élargit les modes d'expression de soi et de l’histoire, tout en s'inscrivant dans la culture populaire5. Comment les bandes dessinées contemporaines s’y prennent-elles pour raconter des histoires collectives épouvantables ? Pourquoi les artistes féminines brouillent-elles la distinction entre histoires « privées » et histoires « publiques » ? L'impact esthétique et narratif des bandes dessinées à dimension historique est un élément central de MetaMaus, un livre d'Art Spiegelman à l'édition duquel je participe actuellement6 et qui portera sur les treize années qu'a duré le processus de fabrication de son livre, Maus : l'histoire d'un survivant, qui a été couronné par le prix Pulitzer.
Tour d’horizon
À l’heure actuelle7, trois revues scientifiques ont consacré des numéros spéciaux au récit graphique. Art Spiegelman a récemment donné un séminaire à l'Université de Columbia intitulé « Bandes dessinées : entrer dans le canon », et la Norton Anthology of Postmodern American Fiction intègre depuis peu des bandes dessinées. En dehors du monde académique, le récit graphique occupe l'avant-scène de la critique littéraire et des conversations culturelles : le magazine Time, baromètre du grand public, a nommé comme meilleur livre de 2006 le récit graphique d'Alison Bechdel : Fun Home. A Family Tragicomic. La même année, la maison d’édition Houghton Mifflin, qui publie The Best American Series, inaugurait le premier volume du Best American Comics. On pouvait même lire, en juillet 2004, dans un article de couverture du New York Times Magazine, que cette « nouvelle forme littéraire » rejoint « ce que le roman était autrefois – une forme accessible, vernaculaire [et] ayant un attrait massif » (McGrath 2004 : 24).
Le terme de roman graphique est un terme beaucoup plus commun et facilement identifiable que celui de récit graphique8. Mais ce qui était à l’origine un terme marketing doit aujourd’hui être replacé dans son contexte historique, celui de la seconde moitié du XXe siècle. L'impulsion est venue en partie d’une communauté éditoriale très active issue du milieu underground, qui souhaitait produire des œuvres liées au média de la bande dessinée, mais possédant un impact plus important : le premier usage public attesté de cette expression, par Richard Kyle, apparaît dans un bulletin de 1964 distribué aux membres de l'Amateur Press Association, et le terme fut ensuite emprunté par Bill Spicer dans son fanzine Graphic Story World. Beaucoup pensent que Will Eisneraurait inventé le terme parce qu'il l'a utilisé dans un contexte plus commercial, pour vendre à des éditeurs A Contract with God (1978). Composé d'une série de quatre histoires sérieuses, liées entre elles et racontant les conditions de vie sordides et les désirs d'assimilation de migrants vivant dans un immeuble du Bronx dans les années 1930, A Contract with God fut le premier livre commercialisé en tant que « roman graphique9 ».
Des dizaines d'années plus tard, on retrouve des sections « roman graphique » dans de nombreuses librairies. Pourtant, ce terme semble souvent impropre pour désigner les objets rangés dans ces rayons. De nombreuses œuvres fascinantes regroupées sous cette étiquette – y compris Maus de Spiegelman, qui a contribué à populariser le terme – ne sont pas du tout des romans : ce sont de riches œuvres non fictionnelles, ce qui explique l’accent que je mettrai ici sur le terme plus large de récit. En effet, cette forme remet en question l’idée reçue qui voudrait que, par défaut, le dessin en tant que système serait intrinsèquement plus fictionnel que la prose. Elle donne aussi une nouvelle image de ce que nous considérons comme de la fiction ou de la non-fiction. Dans ce que nous désignons par récit graphique, la longueur substantielle à laquelle faisait référence le terme roman peut être préservée, mais cette expression plus neutre suppose l’existence d'autres modes que celui de la fiction. Un récit graphique est un ouvrage de la longueur d'un livre qui se rattache au média de la bande dessinée10.
Il existe de nombreux formats pour la bande dessinée qui sont tous porteurs d'un bagage culturel unique. Aux Ėtats-Unis11, le comic strip a émergé avant le début du XXe siècle et possède une extension qui varie de moins d'une page à plusieurs pages ou même davantage. Il s'agit d’une séquence qui forme une unité minimale et s’apparente à ce que l’on pourrait désigner comme une histoire courte. Le comic book, qui a vu le jour dans les années 1930, compte généralement trente-deux pages et se présente soit comme un recueil de comic strips, soit comme une histoire continue, souvent sous la forme d’un épisode qui se rattache à une série12. La bande dessinée se décline ainsi en toutes sortes de formats et dans différents contextes sériels, des strips quotidiens ou hebdomadaires aux comic books publiés mensuellement, en passant par les personnages sériels représentés dans tous ces formats. J’ai soutenu ailleurs que la planche de bande dessinée est elle-même un matériau dans lequel s’inscrit une forme de sérialité. En effet, il s’agit d’une architecture narrative fondée sur l'établissement d’intervalles réguliers au sein de l'espace et sur des déviations de cette régularité. Formellement, la bande dessinée diffère du dessin animé (en anglais : cartoon), car ces derniers présentent une succession d’images formées d’une seule case. Alors que ces deux formes utilisent souvent des dispositifs visuels et verbaux similaires, les bandes dessinées, qui se déploient généralement sur plusieurs cases, ont une dynamique narrative qui diffère des dessins animés. Pourtant, les auteurs de bandes dessinées sont encore couramment appelés en anglais cartoonists. Cela s’explique par le fait que la définition historique du cartoon trouve une résonnance chez des auteurs impliqués dans la reproduction de masse d’images dessinées – un aspect de cette forme qui empêche la bande dessinée d'être rattachée aux « beaux-arts ». Cartoon vient du mot italien cartone, qui signifie carton, et désigne un support pour une image ou un motif destiné historiquement à être transféré sur des tapisseries ou des fresques (Harrison 1981 ; Janson 1991 ; Harvey 2001 ; 2005). Pourtant, comme le souligne Randall Harrison, « avec l'arrivée de l’imprimerie, le "cartoon" a pris un autre sens. Il s’agissait d’une esquisse qui pouvait être reproduite en série. C'était une image qui pouvait être largement diffusée13 » (1981 : 16).
Mais comment définir la forme de la bande dessinée, quelles sont ses propriétés, son extension et ses capacités expressives ? Les amateurs de bandes dessinées pourraient en fait dire, comme l'a fait le juge Potter Stewart au sujet de la pornographie : il suffit d’en voir pour savoir ce que c’en est14. La bande dessinée est une forme créative en perpétuelle évolution, toujours soumise aux contraintes des formats imposés par des entreprises commerciales, contrairement au livre d'artiste, qui a connu une histoire parallèle au cours du XXe siècle15. Une partie de la critique s’est occupée de ce que Scott McCloud a appelé les « descriptions fonctionnelles » de la bande dessinée et, dans la plupart des cas, ces travaux négligent joyeusement les méthodologies institutionnelles les mieux établies. Understanding Comics de McCloud (1993a), le premier livre à théoriser la bande dessinée à travers sa propre forme médiatique, en propose une définition délibérément large et provisoire16. Son analyse de la forme intègre, mais sans s'y limiter, le contexte des supports imprimés, paramètre que de nombreux praticiens et critiques considèrent comme essentiel (p. ex. Kunzle 1973 ; Dowd & Reinert 2004).
McCloud définit la bande dessinée comme des « images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquences, destinées à transmettre des informations et / ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur17 » (2007 : 17). McCloud ajoute qu’avant sa projection, la pellicule d'un film « s’apparente à une bande dessinée observée au ralenti » (1999 : 5). Cet accent mis sur la séquence permet à McCloud de rattacher à la préhistoire de ce média des manuscrits d'images précolombiennes, la tapisserie de Bayeux et les Tortures de Saint-Erasme (1460), parmi d'autres antécédents culturels tout aussi improbables. En 2001, Robert Harvey a rejeté la conception de McCloud selon laquelle les bandes dessinées n'auraient pas besoin de contenir des mots pour être identifiées en tant que telles. C’est le cas également de Smolderen (2007), qui réfute l’idée que la séquence serait la propriété définitoire de la bande dessinée en analysant un « effet d'essaimage » à partir d’images uniques tirées de Bibles illustrées, de Bosch et de Brueghel, ainsi que de livres pour enfants. Harvey soulève quant à lui cette objection : « il me semble que la caractéristique essentielle de la bande dessinée – ce qui la distingue des autres types de récits picturaux – est l'incorporation de contenu verbal. […] Et l'histoire de la bande dessinée me semble mieux soutenir ma thèse que la sienne » (2001 : 75-76). Selon Harvey, l’histoire de la bande dessinée remonterait au XVIIIe siècle et débuterait dans les images produites par Hogarth, Gillray, Rowlandson et Goya (voir aussi Katz 2006 et Sabin 1993).
Les positions de McCloud et Harvey ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le penser. La bande dessinée dépend toujours de la manière dont la temporalité peut être construite en empruntant des chemins complexes, et souvent non linéaires, à travers l'espace de la page ; pour l'essentiel, cette forme s’appuie à la fois sur des mots et des images, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire. Comme le suggère Spiegelman, les œuvres en bande dessinée « chorégraphient et donnent forme au temps » (2005 : 4). Et bien que cette fonction puisse être remplie par de nombreuses formes d’expression, c'est dans la manière spécifique dont la bande dessinée accomplit cette opération que l'on peut trouver ce qui constitue souvent l’aspect formel le plus intéressant de ce média. McCloud désigne les cases comme « l’élément iconique le plus important » de la bande dessinée (2007 : 106), car elles nous indiquent, de manière très générale, « que nous sommes face à une division de l’espace et du temps » (2007 : 107) et sont à la base de la grammaire de la bande dessinée. En effet, ainsi que l’affirme McCloud, les cases « fragmentent à la fois l’espace et le temps, proposant un rythme haché des instants qui ne sont pas enchaînés » (2007 : 75). Par cette succession de cases en alternance avec des espaces vides, une page de bande dessinée offre une riche carte temporelle, configurée autant par ce qui est dessiné que par ce qui ne l'est pas ; ce média est très conscient de l'artificialité de ses frontières sélectives, qui organisent la planche sous la forme d’un diagramme de moments encapsulés. McCloud soutient que l'espace vide, appelé la gouttière, « recèle beaucoup du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée » (2007 : 74), et il ajoute que « ce qui se situe entre les cases constitue le seul élément de la bande dessinée qui ne peut pas être imité par un autre média » (1993b : 13).
À travers les travaux de ces chercheurs et critiques, une histoire de la bande dessinée est en train de se constituer et de faire émerger une riche tradition liée à l’histoire des formes, nourrissant ainsi un engouement contemporain pour la narration graphique. La brève histoire que je retracerai dans ces lignes fait référence à plusieurs personnages et événements clés – j’évoquerai ici le contexte des œuvres américaines, mais sans mettre l’accent sur le développement de l’industrie de la bande dessinée commerciale, qui est dominée par deux éditeurs, Marvel et DC, spécialisés dans les histoires de superhéros. Même si McCloud et Harvey sont en désaccord, ils affirment l’un comme l’autre l'importance de Hogarth pour la bande dessinée (McCloud 2007 : 24 ; Harvey 2001 : 77). Dans Modern Fiction Studies, Marianne DeKoven et moi-même avons affirmé à propos d’une œuvre comme La Carrière d’une prostituée –comme dans une bande dessinée, cette œuvre représente des moments ponctuels encadrés qui s’inscrivent dans la progression d’un récit– que l’on peut « comprendre l'influence de Hogarth en lisant son œuvre comme une extension de l’ut pictura poesis, qui fait passer cette dernière de la poésie au genre du roman moderne. Il a introduit une structure séquentielle et romanesque dans une forme picturale » (2006 : 769). Plus tard, au XIXe siècle, Rodolphe Töpffer (1799-1846) – un enseignant suisse considéré comme l'inventeur de la bande dessinée moderne – établit les conventions de cette forme narrative, qu'il définit comme un « langage pictural18 » et qu’il décrit comme un style concis reposant sur l’apparition du cadre des cases dans la page ; il ajoute qu’il se fonde sur deux formes préexistantes : le roman et les histoires en estampe de Hogarth (Kunzle 1990 ; Willems 2007). En 1832, faisant l'éloge de l'œuvre de Töpffer, Goethe vante le potentiel pour la culture de masse de ce qui finira par être baptisé« romans en estampes19 ».
Même dans cette incarnation précoce, la bande dessinée était considérée comme une forme d'art antiélitiste. Néanmoins, les comic strips américains se sont distingués des formes européennes antérieures –lesquelles n'ont jamais été produites en masse de la même manière– par leur usage de personnages récurrents et leur publication dans des journaux à grande diffusion (cf. Gordon 1998). Il est communément admis qu'en Amérique, la bande dessinée a été inventée en 1895 – l’année même où les frères Lumière inventaient le film narratif à Paris – dans le journal de Joseph Pulitzer, le New York World, avec The Yellow Kid de Richard Fenton Outcault, qui mettait en scène des migrants urbains de cette époque, ainsi qu'un enfant attachant et odieux habitant un immeuble de l’East Side20. Pulitzer s'est rapidement rendu compte que la bande dessinée était un moyen d’augmenter la diffusion de son journal. La lutte qui s’ensuivit dans la presse à sensations entre William Randolph Hearst et Pulitzer au sujet du Yellow Kid aurait donné naissance au terme yellow journalism21, et trouverait son origine dans la couleur caractéristique de la robe de chambre du gamin.
Contrairement à la littérature moderniste, qui s'est développée à peu près à la même époque, le média de la bande dessinée a été marqué dès le début par son statut de marchandise. Cependant, on ignore encore souvent le fait que la bande dessinée des premières décennies du XXe siècle était à la fois un produit de la culture de masse et une forme qui influençait et était influencée par les pratiques de l'avant-garde, notamment celles se rattachant au dadaïsme et au surréalisme (Gopnik et Varnedoe 1990 ; Inge 1990). On ignore aussi souvent le fait qu'à la fin des années 1930, alors que les comic books commençaient leur ascension, portés par les épaules de Superman, les premiers récits graphiques modernes, appelés « romans sans paroles », avaient déjà fait leur apparition : il s’agissait d’œuvres gravées sur bois au rendu magnifique – dans certains cas vendues comme des romans classiques – qui servaient presque entièrement un agenda socialiste et incorporaient des pratiques expérimentales largement associées au modernisme littéraire (Joseph 2003). Ces « romans sans paroles », en dépit de leur désignation, comprenaient souvent du texte, mais pas sous la forme de cartouches ou de bulles (Beronä 2001 ; voir aussi Cohen 1977). Bien que ces œuvres n'aient pas toujours été associées à l'histoire de la bande dessinée, certains chercheurs ont commencé à les inclure dans le développement du récit graphique, ce qui leur a permis de montrer comment ce média, au début de son histoire moderne, a pu inclure des expérimentations formelles sans perdre son attrait pour la consommation de masse, ce qui représente un développement crucial pour l'impact de la forme actuelle22. En montrant les tensions entre, d'une part, une production éditoriale de masse et des pratiques artisanales, et, d'autre part, entre convention et expérimentation, ces œuvres montrent comment les premières versions des récits graphiques ont pu répondre aux enjeux de la culture contemporaine tout en anticipant l’émergence de genres marqués par un mélange entre la culture élitiste et populaire, que l'on identifie comme typiques de la littérature contemporaine23.
Dans les années 1950, 1960 et 1970, les bandes dessinées reflètent les bouleversements que l’on observe durant ces décennies dans la culture américaine, souvent en lien avec la Deuxième Guerre mondiale : elles créent un point de jonction entre la culture populaire américaine de masse et les expérimentations que l’on trouve dans les modernismes littéraires et artistiques. Fondée par le caricaturiste Harvey Kurtzman en 1952, la revue Mad Comics: Humor in a Jugular Vein (qui deviendra plus tard le magazine MAD) se présentait comme un comic book sérieusement autoréflexif et profondément préoccupé par l'esthétique de la bande dessinée. Avec Mad, Kurtzman établissait le projet d’une bande dessinée servant de critique pour les valeurs américaines dominantes, en particulier celles véhiculées par les médias, et pour cette raison, ce magazine a constitué une source d’inspiration pour la bande dessinée underground (souvent appelée comix) qui se développera à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
Comme la littérature des années 1960, la bande dessinée de cette période est dominée par des oppositions. Les dernières années de la décennie sont marquées par la révolution des comix undergrounds, ce mouvement revendiquant explicitement son rattachement à l’avant-garde. En réaction aux codes de la censure, qui étouffaient l'industrie mainstream, la bande dessinée underground est devenue un support culturel influent, à la fois frappant et déstabilisant, parce qu'il se fondait sur la transgression des tabous. Rejetant les grands éditeurs, les représentants de la scène underground auto-publiaient des œuvres qui expérimentaient, hors des contraintes commerciales, les capacités formelles de la bande dessinée. C'est de cette culture que sont issus les récits graphiques les plus durables : des œuvres sérieuses et imaginatives explorant les réalités sociales et politiques en repoussant les limites d'un média historiquement inscrit dans la culture de masse. L'autobiographie, sans doute le mode dominant des récits graphiques actuels, a d'abord pris son essor dans cette culture underground.
Spiegelman en est l’exemple éloquent. Ses bandes dessinées expérimentales et ses récits autobiographiques, qui incluent le prototype que constitue Maus, ainsi que ses deux magazines Arcade (1975-1976) et RAW (1980-1991), transposent l’esthétique antinarrative de l'avant-garde dans le média populaire, et même populiste, qu’est la bande dessinée. À l’origine, Spiegelman détournait les attentes du public liées au développement de l’histoire, en travaillant à se démarquer des bandes dessinées de «divertissement». Plus tard, dans le magazine RAW, où Maus a été publié pour la première fois sous la forme d’une série, il a élargi cette pratique.À travers ces expérimentations, nous voyons que l’énonciation historique se construit de manière éclatée, à travers des espaces paradoxaux et des temporalités mouvantes : la bande dessinée – en tant que forme qui s'appuie sur l'espace pour représenter le temps – apparaît alors structurellement équipée pour remettre en question les modes dominants de la narration et de l’historiographie.
Maus, qui a remporté un prix Pulitzer « spécial » et qui a fait découvrir la sophistication de la bande dessinée au monde académique, dépeint les Juifs comme des souris et les Allemands comme des chats. Ce récit raconte, en faisant des allers-retours entre la Pologne de la Seconde Guerre mondiale et le New York des années 1970 et 1980, l'histoire d'un auteur de bande dessinée, nommé Art Spiegelman et de son père, Vladek, un survivant de l'Holocauste. Maus a été largement commenté24. C'est une histoire captivante, un portrait émouvant d'une famille imparfaite. C'est aussi une œuvre dont la complexité esthétique et politique est liée aux spécificités de la bande dessinée. Marianne Hirsch souligne des aspects de l’œuvre de Spiegelman que l’on pourrait généraliser de manière à éclairer les potentialités du récit graphique. Selon elle, l'utilisation par Spiegelman de photographies dans un texte dessiné à la main
fait émerger non seulement la question de savoir comment, quarante ans après la sentence d'Adorno, l'Holocauste peut être représenté, mais aussi comment différents médias – la bande dessinée, la photographie, le récit, le témoignage – peuvent interagir les uns avec les autres pour produire un texte plus perméable et multiple, capable de refonder le problème de la représentation de l’Holocauste et de supprimer définitivement la séparation nette entre les domaines du documentaire et de l’esthétique. (1992-1993 : 11)
Spiegelman s'est battu publiquement, et avec succès, contre le New York Times pour faire passer son livre du classement des best-sellers appartenant au genre de la fiction à celui des œuvres non fictionnelles. En faisant s’entrechoquer dans la bande dessinée des couches narratives asynchrones ou concurrentes, il crée un niveau intense d'autoréflexivité (voir fig. 1). De plus, dans le récit graphique, le corps de l’auteur demeure présent dans le texte à travers le geste de la main visible dans le dessin25. Cette absence de transparence inscrit le récit déployé à la surface de la page dans le registre de la subjectivité, ce qui permet aux œuvres de bande dessinée d'être productivement conscientes de la façon dont elles «matérialisent» l'histoire – ce terme frappant étant utilisé par Spiegelman (Brown 1988 : 98). Concernant la place occupée par Maus dans la recherche académique, lors d’une interview donnée en 2003, Marianne Hirsch a affirmé que « dans le monde universitaire... c'est plus qu'une acceptation. Tout le monde se précipite pour écrire sur Maus » (2005).
Contextes
L'étude d'un texte de référence tel que Maus est en train de donner naissance à un domaine de recherche dont l’objectif est d’étudier plus largement le potentiel de cette forme d’expression. Dans un commentaire à propos de son œuvre, Spiegelman affirme que « la surface stylistique [de la page] était un problème à résoudre » (1994), ce qui caractérise bien la manière dont le récit graphique appréhende le style et la forme : il s’agit d’articuler les histoires à travers une esthétique spatiale liée aux cases, aux gaufriers26, aux gouttières et aux strips. Le récit graphique attire donc l'attention sur ce qui a été désigné par Mitchell comme un formalisme politique reconfiguré27. Selon lui, ce média nous confronterait aujourd’hui à un « nouveau type de formalisme », alors que le « moment moderniste de la forme […] est peut-être derrière nous28 » (2003 : 324). La narration graphique offre en particulier des exemples convaincants et diversifiés d’œuvres mobilisant différents styles, méthodes et modes pour traiter le problème de la représentation historique. Une conscience des limites de la représentation – qui est non seulement un problème spécifique à l’expression d’un traumatisme mais aussi une« condition sine qua non de toute représentation » (Kunow 1997 : 252) – fait partie intégrante du langage de la bande dessinée, du fait de sa forme architecturée, consciente d’elle-même et bimodale. Et simultanément, c’est pourtant à travers une visualisation à la fois saisissante, émouvante et directe des circonstances historiques, que la BD aspire à un engagement éthique.
Certains des livres les plus fascinants – ceux qui suscitent l’intérêt des critiques littéraires29 – représentent souvent des réalités historiques dramatiques. Par exemple, trois des auteurs de bande dessinée parmi les plus acclamés aujourd'hui, Art Spiegelman, Joe Sacco et Marjane Satrapi, travaillent dans un mode non fictionnel. Spiegelman s’est penché sur la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre, Sacco sur la Palestine et la Bosnie, Satrapi sur la révolution islamique en Iran et la guerre en Irak. Ce n'est pas une coïncidence. À travers sa manière congénitalement formaliste de raconter des histoires, à travers ses expérimentations avec les contraintes artificielles de son propre langage, la bande dessinée attire notre attention sur ce que Shoshana Felman et Dori Laub appellent la f«textualisation du contexte » :
le contenu empirique ne doit pas seulement être connu, mais doit être lu […]. L’exigence fondamentale et légitime de contextualisation du texte doit elle-même être complétée, simultanément, par le travail moins familier, et pourtant nécessaire, de textualisation du contexte. (Felman & Laub 1992 : xv)
Le récit graphique accomplit ce travail en rendant manifestes ses propres artifices et en attirant l’attention sur ses raccords. Sa grammaire formelle rejette la transparence et rend la textualisation visible, inscrivant le contexte dans la présentation graphique. Dans Maus, par exemple, le contexte du récit, sa nature de production culturelle sur l'Holocauste renonçant délibérément à la maîtrise esthétique, est affiché de manière extra-sémantique dans l’apparence de ses lignes au tracé hésitant. Lorsque nous lisons ce texte, nous percevons la texture granuleuse de ses lignes et nous constatons de ce fait le rejet des tropes nazis de la maîtrise.
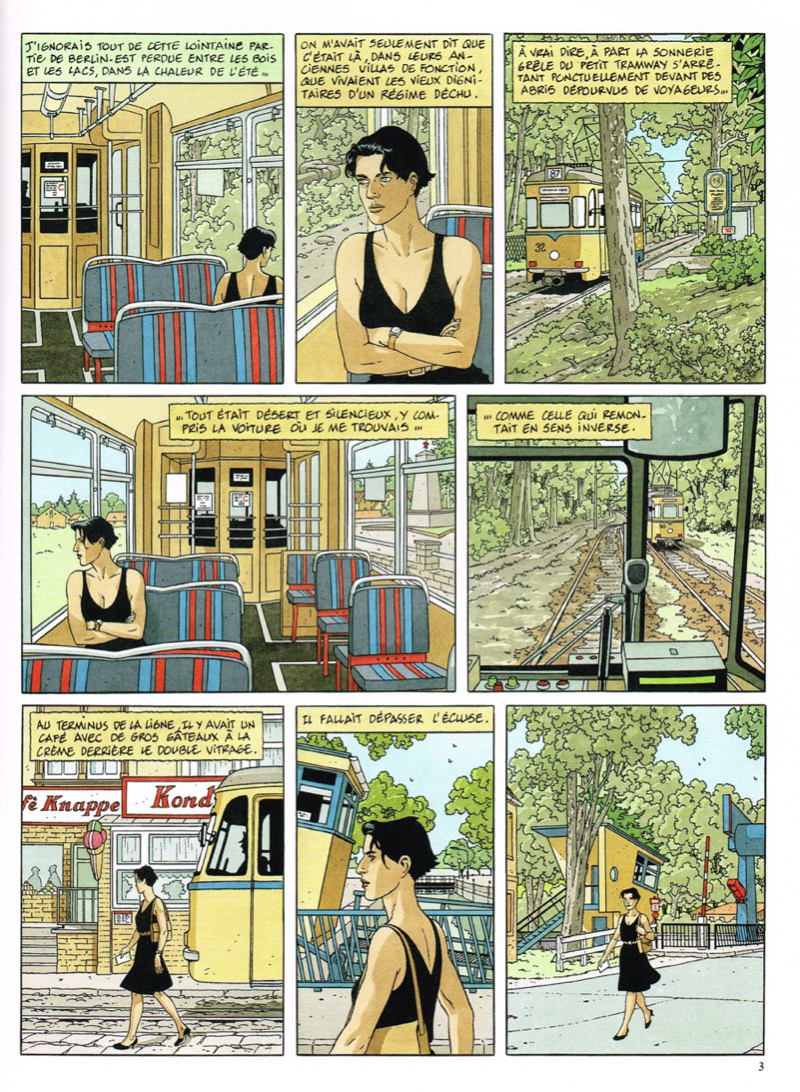 Figure 1 : Art Spiegelman, Maus II: A Survivor’s Tale, p. 41.
Figure 1 : Art Spiegelman, Maus II: A Survivor’s Tale, p. 41.
Reproduit avec la permission de l’auteur.
Les récits graphiques les plus importants explorent les limites incertaines de ce qui peut être dit et de ce qui peut être montré, à l'intersection entre l’histoire collective et les histoires vécues30. Des auteurs comme Spiegelman et Sacco, aux prises avec un horizon historique, dépeignent la torture et le massacre sur un mode formel complexe, qui ne se détourne pas du traumatisme et qui ne cherche pas à l'atténuer. En fait, ils démontrent comment le fait de retracer visuellement ce traumatisme peut se révéler à la fois éthique et productif. Il y a aussi un riche éventail d'œuvres d'écrivaines qui explorent l'enfance et le corps – des préoccupations généralement reléguées au silence et à l'invisibilité de la sphère privée. Le récit de Satrapi sur sa jeunesse en Iran, Persepolis, ainsi que des œuvres d'autrices américaines comme Lynda Barry, Alison Bechdel, Phoebe Gloeckner et Aline Kominski-Crumb illustrent comment le récit graphique peut dépeindre la réalité quotidienne de la vie des femmes ; et cette réalité, tout en étant enracinée dans une individualité, apparaît investie et intriquée dans la collectivité, au-delà des modèles prescriptifs de l’altérité et de la différence sexuelle. Dans tous les cas, de l’échelle la plus large à l'échelle locale, le récit graphique met en scène l’aspect traumatique de l'histoire, mais tous ces auteurs et toutes ces autrices refusent de montrer cet aspect à travers le prisme de l'indicible ou de l'invisible ; à l’inverse ils ou elles transcrivent plutôt sa difficulté à travers des procédés textuels inventifs et variés.
On ne devrait pas conclure de cet enthousiasme engendré par les productions non fictionnelles que des œuvres puissantes ne pourraient pas relever de la fiction. Des auteurs comme Charles Burns (Black Hole), Daniel Clowes (Ghost World) et Chris Ware (Jimmy Corrigan : The Smartest Kid on Earth) ont rehaussé le niveau de la bande dessinée littéraire en racontant des histoires à la fois sérieuses dans leur portée et denses stylistiquement. Il s’agit cependant d’affirmer que la combinaison des mots et des images crée de nouvelles possibilités pour l'écriture de l'histoire en proposant des expérimentations formelles, tout en conservant l’attrait du texte pour un public de masse. La narration graphique suggère ainsi que l'exactitude historique n'est pas le contraire de l'invention créative, car la problématique de la distinction entre fait et fiction est rendue visible par le dessin. En effet, structurellement parlant, la bande dessinée est un média double et stratifié, qui peut juxtaposer différents moments historiques sur une même planche, ainsi qu’on peut le constater dans la dernière case de la figure 1, dans laquelle Spiegelman montre des cadavres de camps de concentration qui envahissent silencieusement son studio de SoHo.
Pour présenter certains travaux prometteurs sur ces questions, je reviendrai brièvement sur Mitchell, car sa manière de montrer comment les horizons formel et politique peuvent s'entrelacer est particulièrement pertinente pour réfléchir sur les récits graphiques non fictionnels. Mitchell s’est intéressé à After the Last Sky: Palestinian Lives, une œuvre d’Edward Said produite en collaboration avec le photographe Jean Mohr, dont le texte mélange des mots et des images. Dans son commentaire, Mitchell met en évidence l’importance de ce qu’il définit comme une « esthétique spatiale » (2003 : 324). Dans l'introduction du livre, Said écrit d’ailleurs : « Je crois que pour nous représenter, nous devrions utiliser essentiellement des formes d'expression non conventionnelles, hybrides et fragmentaires. […] Une double vision donne forme à mon texte » (2003 : 6).
Publié en 1986, la même année que l’œuvre charnière de Spiegelman, l'appel de Said au mélange des genres, des disciplines et des médias, explique son enthousiasme pour la bande dessinée, qu'il détaille dans l'admirable introduction qu’il a rédigée en 2001 pour le récit graphique de Sacco sur la Palestine, un exemple de ce que l'on appelle aujourd’hui le «journalisme en bande dessinée31». Selon lui, la bande dessinée offre une vision double en raison de son hybridité structurelle, par cette combinaison narrative de mots et d'images qui ne forment pas une synthèse. Dans une case de bande dessinée, les images et les mots peuvent signifier différemment, et de cette manière, l'œuvre peut véhiculer des récits ou des sens à double codage.
Le travail de Sacco, par la densité de ses détails, attire l'attention sur le rythme – un aspect formel que Said considère comme étant peut-être « la plus importantes de ses réussites » (Sacco 2015 : n.p.). Faisant l'éloge de Palestine, Naseer Aruri va jusqu’à écrire que « chaque page équivaut à un essai », une appréciation de la densité du récit qui ne se limite pas à la prose du texte, mais qui indique plutôt comment l'épaisseur de la forme iconotextuelle, telle qu’elle est travaillée par Sacco, transmet ce qui apparaît comme un surplus d'information ou de plénitude32. Peu de récits narratifs résistent mieux à la consommation facile que ceux de Sacco : le formalisme de ses pages constitue une jungle exigeant un intense travail de « décodage ». Ce terme, qui connote une difficulté, est utilisé conjointement par Spiegelman et par Said pour parler de la bande dessinée (Said 2001 : ii ; 2015 : np ; Spiegelman 1995 : 61). Les œuvres de Sacco s’appuient effectivement sur un va-et-vient disjonctif entre la contemplation de l’image et la lecture du texte, et ce rythme – souvent compliqué et coûteux en temps – fait partie de leur pouvoir de «captation», selon la formulation de Said, ce qui est particulièrement pertinent pour traiter un sujet aussi politisé et éthiquement compliqué que le conflit israélo-palestinien33. Said loue la façon dont Sacco associe bizarrement une forme d’accélération (les pages sautent aux yeux avec une sorte d’urgence) et de décélération (chaque page doit être arpentée de long en large pour être décodée), et il en conclut que ses « bandes dessinées offrent aux lecteurs un séjour raisonnablement long auprès d’un peuple » rarement représenté avec autant de complexité et de rigueur (2001 : v ; 2015 : np). Une planche de bande dessinée, à la différence d'un film ou d'un récit en prose traditionnel, est capable de maintenir ce flux contradictoire en tension, car le développement narratif est retardé, rétracté ou rendu récursif par la profondeur et le volume de la structure graphique.
Pour aborder la question de la littératie liée à l'idée d’un « décodage » de la bande dessinée, on pourrait s'inspirer de l’explication que donne Spiegelman de ce terme. Ses commentaires associent à la bande dessinée une littératie spécifique et active, ainsi qu’en témoigne la déclaration suivante, publiée en 1995 dans le Comics Journal :
Il me semble que la bande dessinée est déjà passée du statut d'icône de l'analphabétisme à celui de l'un des derniers bastions de la littératie. […] Si [ce média] a un problème aujourd’hui, c'est que le public actuel n'a plus la patience de décoder les bandes dessinées. […] Je ne sais pas si nous sommes à l'avant-garde d'une culture différente ou si nous sommes plutôt les derniers artisans d’une culture passée. (1995 : 61)
Ce commentaire s'écarte de l’image que beaucoup se font encore du média. Ainsi que l’écrivait Will Eisner dans Graphic Storytelling : « la bande dessinée en tant que forme de lecture a toujours été considérée comme une menace pour la littératie » (1996 : 3). Fredric Wertham, auteur en 1954 de l'incendiaire Seduction of the Innocent, un livre qui a contribué à introduire la censure dans le champ de la bande dessinée, désignait la consommation des récits graphiques comme « une dérobade à la lecture, et presque son contraire » (cité dans Schmitt 1992 : 157). Pourtant, en présentant des moments ponctuels encadrés qui alternent avec les espaces vides des gouttières au sein desquels il faut projeter une causalité, certains commentateurs (par exemple McCloud 1993a : 66-93, 106 ; Carrier 2000 : 51) soulignent que la bande dessinée exige une participation substantielle du lecteur pour construire le récit, allant jusqu’à favoriser une sorte d’«intimité interprétative» avec celui-ci (Mc Cloud 1993a : 69). Et même à l’intérieur de ses cases, le récit graphique, comme le suggère mon bref commentaire sur l’œuvre de Sacco, peut nécessiter un ralentissement, la forme pouvant devenir très exigeante mentalement. Étant donné que la construction spatiale de la page peut encourager les relectures et brouiller délibérément la linéarité narrative (en bande dessinée, la lecture peut se faire dans toutes les directions), la reconstruction du récit de base exige ainsi un degré élevé d'engagement cognitif34. Dans Goražde, Sacco spatialise le style elliptique de sa prose, que l’on pourrait rattacher à celui d’un écrivain de l’avant-garde littéraire comme Louis-Ferdinand Céline, en fragmentant le texte dans des cartouches flottant à la surface des images. Spatialiser le récit verbal pour dramatiser ou bousculer les fils du récit visuel, revient à introduire des ellipses dans la grammaire d'un support déjà caractérisé par la structure elliptique de la séquence case-gouttière-case. On peut voir un exemple de ce type dans l'une des pages les plus troublantes de Goražde, dans laquelle Sacco illustre le témoignage d’Edin, son ami bosniaque, qui est aussi traducteur. Cette image montre les cadavres des amis d’Edin, quatre hommes morts le premier jour de la première attaque serbe sur Goražde en mai 1992 (fig. 2).
La réaction négative suscitée par la bande dessinée « littéraire » en tant qu’objet de recherche, que l’on peut observer chez beaucoup d’universitaires, met en évidence l’anxiété engendrée par la dimension visuelle de la culture, en lien avec ce que Mitchell a identifié comme le «tournant visuel» (pictorial turn) des années 1990. Cette réaction montre aussi une suspicion envers une forme esthétique profondément marquée par son histoire populaire. Dans un éditorial publié en 2004 intitulé «Dommages collatéraux», Hirsch souligne la crainte de notre profession «qu'à l'ère médiatique contemporaine, nos étudiants (sans parler de nos représentants politiques) aient perdu leur littératie verbale et se soient abandonnés à une visualité dominante et incontrôlable qui altère la pensée». Mais elle écrit aussi – en introduisant les contributions à ce numéro de la revue PMLA portant sur les rapports entre études littéraires et arts visuels, qui comprend quatre prises de position sur la visualité dans The Changing Profession – que ces travaux «révèlent que notre domaine a déjà dépassé cette anxiété» (Hirsch 2004 : 1210).
En effet, le moment est venu d’élargir notre expertise scientifique et notre intérêt pour la bande dessinée. « Quel type de littératie visuelle et verbale sera en mesure de répondre aux besoins du moment présent ? » se demande Hirsch (2004 : 1212). Je parie – tout comme elle, qui analyse ensuite le dernier livre de Spiegelman In the Shadow of No Tower – que les récits graphiques embrassent certaines des questions les plus pressantes posées à la littérature contemporaine : quelle sont les structures narratives les plus pertinentes pour produire une représentation éthique de l’histoire ? Quels sont les enjeux actuels liés au droit de montrer et de raconter l'histoire ? Quels sont les risques de la représentation ? Comment les gens comprennent-ils leur vie en concevant des récits et parviennent-ils à rendre intelligible la difficulté du processus de remémoration ? Les récits graphiques font écho et prolongent les inventions formelles de la littérature, depuis les attitudes sociales et les pratiques esthétiques du modernisme jusqu’à la transition postmoderniste vers une démocratisation des formes populaires. Dans le récit graphique, nous voyons qu’une prise en compte de la reproductibilité et de la circulation de masse peut se conjuguer avec une attention rigoureuse et expérimentale à la forme comme mode d'intervention politique. Les approches critiques de la littérature, comme elles commencent à le faire, doivent porter une attention plus soutenue à cette forme en développement – une forme qui exige de repenser le récit, le genre et, pour reprendre l'expression de James Joyce, la «modalité du visible» (1948 : 39).
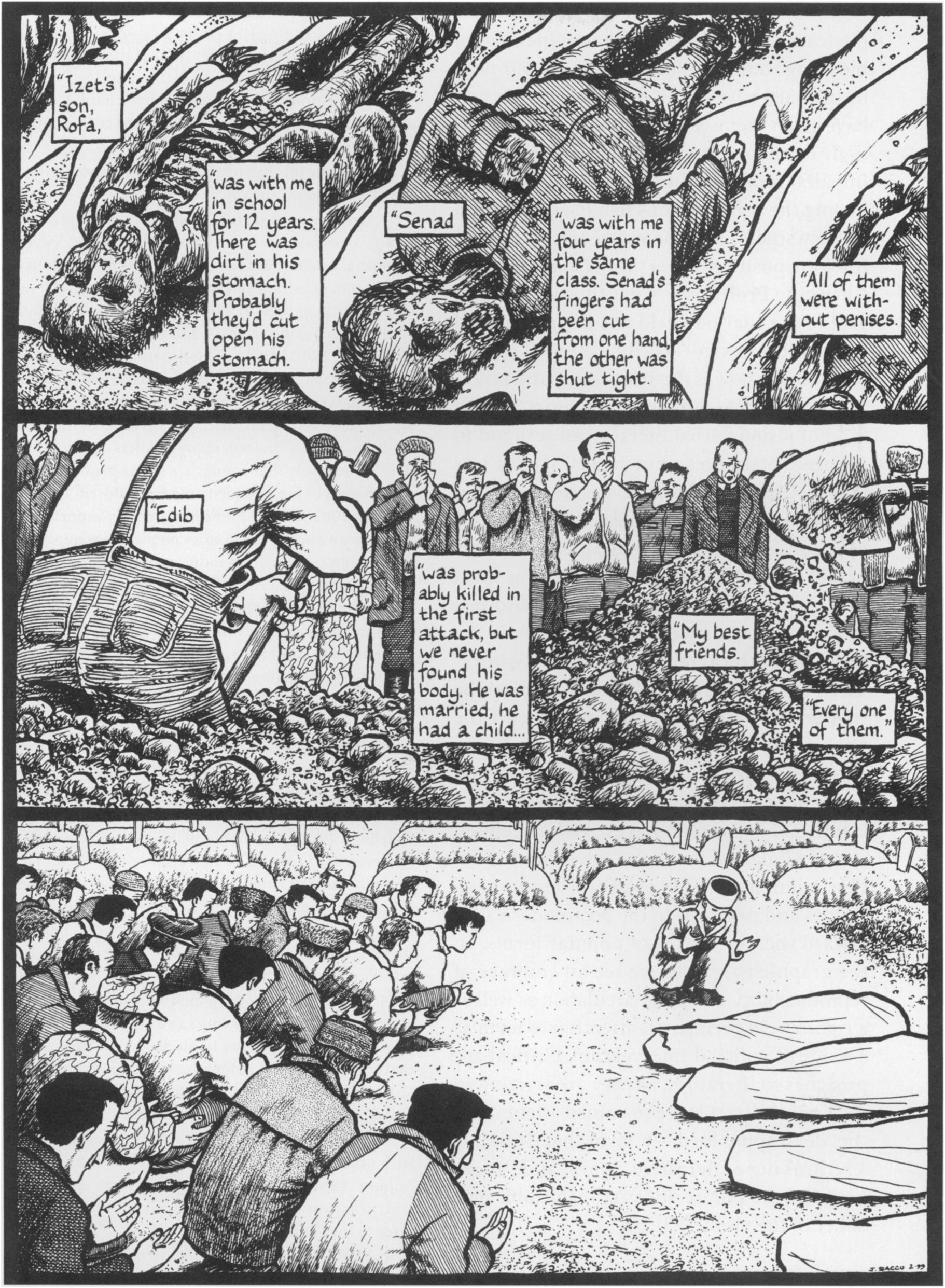 Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.
Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.
Reproduit avec la permission de l’auteur.
Bibliographie
Arnold, Andrew (21 novembre 2003), « A graphic literature library », Time. URL[1] : http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,547796,00.html 35
Baker, Steve (1993), Picturing the Beast: Animals, Identity and Representation, Manchester, Manchester University Press.
Beronä, David A. (2001), « Pictures speak in comics without words: pictorial principles in the work of Milt Gross, Hendrik Dorgathen, Eric Drooker, and Peter Kuper », in The Language of Comics : Words and Image, R. Varnum & C. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississipi, p. 19-39.
Bosmajian, Hamida (1998), « The orphaned voice in Art Spiegelman’s Maus I and II », Literature and Psychology, n° 44 (1-2), p. 1-22.
Brown, Joshua (1988), « Of mice and memory », Oral History Review, n° 16 (1), p. 91-109.
Burns, Charles (2005), Black Hole, New York, Pantheon.
Carrier, David (2000), The Aesthetics of Comics, University Park, University Park, Penn State University Press.
Chute, Hillary (2008), « Ragtime, Kavalier and Clay, and the Framing of Comics », Modern Fiction Studies, n° 54 (2), p. 268-301. URL : https://muse.jhu.edu/article/240720/pdf
Chute, Hillary & Marianne DeKoven (2006), « Introduction: Graphic Narrative », Modern Fiction Studies, n° 52, p. 767-787.
Clowes, Daniel (1998), Ghost World, Seattle, Fantagraphics.
Cohen, Martin S. (1977), « The Novel in Woodcuts: A Handbook », Journal of Modern Literature, n° 6, p. 171-195.
Dowd, D. B., & Melanie Reinert (2004), « A Chronology of Comics and the Graphic Arts », in Strips, Toons, and Bluesies, T Hignite & D. B. Dowd (dir.), New York, Princeton Architectural.
Drucker, Johanna (1995), A Century of Artists' Books, New York, Granary.
Eisner, Will (1996), Graphic Storytelling and Visual Narrative, Tamarac, Poorhouse.
Eisner, Will (1978), A Contract with God: A Graphic Novel by Will Eisner, New York, DC Comics.
Elmwood, Victoria (2004), « "Happy, happy ever after?": The transformation of trauma between generations in Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale », Biography, n° 27, p. 691-720.
Ewert, Jeanne C. (2000), « Reading visual narrative: Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 8, p. 87-103.
Felman, Shoshana & Dori Laub (1992), « Foreword », in Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York, Routledge, p. xiii-xx.
Gardner, Jared (10 septembre 2004), « Reading out of the gutter: early comics, film, and the serial pleasures of modernity », Repetition, conférence à l'English Institute of Harvard University de Cambridge.
Geis, Deborah R. (dir.) (2003), Considering Maus: Approaches to Art Spiegelman’s "Survivor’s Tale" of the Holocaust, Tuscaloosa, University of Alabama Press.
Gopnik, Adam & Kirk Varnedoe (1990), High and Low: Modern Art, Popular Culture, New York, Museum of Modern Art & Harry N. Abrams.
Gordon, Ian (1998), Comic Strips and Consumer Culture, 1890–1945, Washington, Smithsonian Institute.
Harrison, Randall (1981), The Cartoon: Communication to the Quick, Beverly Hills, Sage.
Harvey, Robert C. (2005), « Describing and discarding "comics" as an impotent act of philosophical rigor », in Comics as Philosophy, J. McLaughlin (dir.), Jackson, University press of Mississippi, p. 14-26.
Harvey, Robert C. (2001), « Comedy at the juncture of word and image: the emergence of the modern magazine gag cartoon reveals the vital blend », in The Language of Comics: Word and Image, R. Varnum and C. T. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississippi, p. 75–96.
Heer, Jeet & Kent Worcester (dir.) (2004), Arguing Comics: Literary Masters on a Popular Medium. Jackson, University Press of Mississippi.
Hirsch, Marianne (hiver 2006) « Marianne Hirsch on Maus », entretien avec M. Kuhlman, Indy Magazine.
Hirsch, Marianne (2004), « Collateral damage », PMLA, n°119, p. 1209-1215.
Hirsch, Marianne (1992-1993), « Family pictures: Maus, mourning, and post-memory », Discourse, n°15 (2), p. 3-30.
Hungerford, Amy (2003), The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification, Chicago, University of Chicago Press.
Hutcheon, Linda (1997), « Postmodern provocation: history and "graphic" literature », La Torre, n° 2, p. 299-308.
Huyssen, Andreas (2000), « Of Mice and mimesis: reading Spiegelman with Adorno », New German Critique, n° 81, p. 65-83.
Iadonisi, Rick (1994), « Bleeding history and owning his [father’s] story: Maus and collaborative autobiography », CEA Critic, n° 57 (1), p. 41-56.
Inge, M. Thomas (1990), Comics as Culture, Jackson, University Press of Mississippi.
Janson, Horst Waldemar (1991), « Glossary: cartoon », History of Art, New York, Prentice & Abrams, p. 828.
Joseph, Michael (2003), « Vertigo: a graphic novel of the great depression – an exhibition of the original woodblocks and wood engravings by Lynd Ward », Introduction, exposition organisée par M. Joseph, Special Collections and University Archives, Rutgers University.
Joyce, James (1986 [1922]), Ulysses, New York, Vintage.
Katz, Harry (2006), « A brief history of American cartooning », in Cartoon America: Comic Art in the Library of Congress, New York, Abrams, p. 28-109.
Koch, Gertrude (1997), « "Against all odds"; or, the will to survive: moral conclusions from narrative closure », History and Memory, n° 9 (1), p. 393-408.
Kunow, Rüdiger (1997), « "Emotion in tranquility?" Representing the Holocaust in fiction », Emotion in Postmodernism, G. Hoffmann & A. Hornung (dir.), Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, p. 247-270.
Kunzle, David (2007), Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of Mississippi.
Kunzle, David (1990), The Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, vol. 2 « The history of the comic strip ».
Kunzle, David (1973), The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c.1450 to 1825, Berkeley, University of California Press, vol. 1 « The history of the comic strip ».
LaCapra, Dominick (1998), History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press.
Landsberg, Alison (1997), « America, the Holocaust, and the mass culture of memory: toward a radical politics of empathy », New German Critique, n° 71, p. 63-86.
Lefèvre, Pascal (2000), « The Importance of being "published": a comparative study of different comics formats », Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics, A. Magnussen & H. C. Christianson (dir.), Copenhagen, Museum Tusculanum & University of Copenhagen, p. 91-106.
Levine, Michael G. (2002), « Necessary stains: Spiegelman’s Maus and the bleeding of history », American Imago, n° 59 (3), p. 317-338.
Liss, Andrea (1998), Trespassing through Shadows: Memory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Macdonald, Heidi (17 janvier 2003), « New BISAC category for graphic novels/comics », Publishers Weekly.
McCloud, Scott (mars 2007), « Interview with Hillary Chute », Believer, p. 80-86.
McCloud Scott (1993a), Understanding Comics: The Invisible Art. New York, Harper.
McCloud, Scott (1993b), « Scott McCloud: Understanding Comics », in Comic Book Rebels: Conversations with the Creators of New Comics, S. Wiater & S. R. Bissette (dir.), New York, Fine, p. 3-16.
McGlothlin, Erin (2003), « No time like the present: narrative and time in Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 11 (2), p. 177-198.
McGrath, Charles (11 juillet 2004), « Not Funnies », New York Times Magazine, p. 24+.
Miller, Nancy K. (1992), « Cartoons of the self: portrait of the artist as a young murderer », M/E/A/N/I/N/G, n°12, p. 43-54.
Mitchell, William John Thomas (2003), « The commitment to form; or, Still crazy after all these years », PMLA, n° 118, p. 321-325.
Orvell, Miles (1992), « Writing post historically: Krazy Kat, Maus, and the contemporary fiction cartoon », American Literary History, n° 4, p. 110-128.
Reid, Calvin (23 décembre 2002), « D&Q Heads BISAC, Bookseller Efforts », Publishers Weekly. URL : https://www.publishersweekly.com/pw/print/20021223/19013-d-amp-q-heads-bisac-bookseller-efforts.html
Rosen, Alan (1995), « "The language of survival: English as metaphor on Art Spiegelman’s Maus », Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, n° 15, p. 249-262.
Rothberg, Michael (1994), « "We were talking Jewish": Art Spiegelman’s Maus as "Holocaust" Production », Contemporary Literature, n° 35, p. 661-687.
Sabin, Roger (1993), Adult comics: an introduction, New York, Routledge.
Sacco, Joe (2001), Palestine, Seattle, Fantagraphics.
Sacco, Joe (2000), Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia, 1992–95, Seattle, Fantagraphics.
Said, Edward (2001), « Homage to Joe Sacco », in Palestine, J. Sacco, Seattle, Fantagraphics, p. i-v.
Said, Edward (1985), After the Last Sky: Palestinian Lives, Photographies par J. Mohr, New York, Pantheon.
Satrapi, Majane (2002), Persepolis: The story of a childhood, New York, Pantheon.
Schmitt, Ronald (1992), « Deconstructive Comics », Journal of Popular Culture, n° 25 (4), p. 153-161.
Smolderen, Thierry (6 décembre 2007), « Why the brownies are important», Coconino World.
Spiegelman, Art (1994), The Complete Maus, CD-ROM, New York, Voyager.
Spiegelman, Art (automne 2005), « Ephemera vs. the Apocalypse », Indy Magazine. URL : http://web.archive.org/web/20080615145704/http://64.23.98.142/indy/autumn_2004/spiegelman_ephemera/index.html
Spiegelman, Art (1995), « Interview with Gary Groth », Comics Journal, n°180, p. 52-106.
Spiegelman, Art (1991), Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began, New York, Pantheon.
Spiegelman, Art (1986), Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History, New York, Pantheon.
Staub, Michael E . (1995), « The Shoah goes on and on: remembrance and representation in art Spiegelman’s Maus », MELUS, n° 20 (3), p. 33-46.
Varnum, Robin & Christina T. Gibbons (dir.) (2001), The Language of Comics: Word and Image, Jackson, University press of Mississippi.
Ware, Chris (2000), Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, New York, Pantheon.
Wertham, Fredric (1954), Seduction of the Innocent, New York, Rinehart.
Wheeler, Doug, Robert L . Beerbohm & Leonardo De Sá (2003), « Töpffer in America », Comic Art, n° 3, p. 28-47.
White, Hayden (1992), « Historical emplotment and the problem of truth », in Probing the Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution", S. Friedlander (dir.), Cambridge, Harvard University Press, p. 37-53.
Willems, Philippe (2007), « Form(ul)ation of a novel narrative form: nineteenth-century pedagogues and the comics », Word and Image, n° 24, p. 1-14.
Young, James E. (1998), « The Holocaust as vicarious past: Art Spiegelman’s Maus and the afterimages of history », Critical Inquiry, n° 24, p. 666-699.
Références additionnelles pour la version française
Baetens, Jan (1998), Formes et politique de la bande dessinée, Bruxelles, Peeters.
Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.
Baroni, Raphaël (2018) « Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne : une segmentation précaire », Cahiers de narratologie, n° 34.
URL : http://journals.openedition.org/narratologie/8594
Burns, Charles (2006), Black Hole, Paris, Delcourt.
Clowes, Daniel (1999), Ghost World, Paris, Vertige Graphic.
Eisner, Will (2004 [1978]), Un Pacte avec Dieu, Paris, Delcourt.
Joyce, James (1948 [1922]), Ulysse, Paris, Gallimard.
Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), « A Bilingual Lexicon for a Functional Analysis of Basic Elements of Comic’s Language / Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée », Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107.
URL : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305
Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.
Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée. Les éditeurs franco-belges et l'album, Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB.
Marion, Philippe (2018), « Les stratégies du chapitre en BD reportage », Cahiers de narratologie, n° 34. URL : https://journals.openedition.org/narratologie/9085
Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée), Louvain-la-Neuve, Academia.
McCloud, Scott (2008), L’Art invisible, Paris, Delcourt.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Robert, Pascal (2018), La Bande dessinée, une intelligence subversive, Villeurbanne, Presses de l’Enssib.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des Humanités, Grenoble, UGA Grenoble.
Sacco, Joe (2015), Palestine, Paris, Rackham.
Sacco, Joe (2004), Goražde : la guerre en Bosnie orientale (1993-1995), Paris, Rackham.
Satrapi, Majane (2007), Persepolis, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette ».
Spiegelman, Art (2012 [2011]), MetaMaus, Paris, Flammarion.
Tabachnick, Stephen E. (dir.) (2009), Teaching the Graphic Novel, New York, The Modern Langage Association of America.
Töpffer, Rodolphe (1845), Essai de physiognomonie, Reproduit par Project Gutenberg Canada, n° 957. URL : https://www.gutenberg.ca/ebooks/toeppferr-physiognomonie/toeppferr-physiognomonie-00-t.txt
Ware, Chris (2002), Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth, Paris, Delcourt.
Pour citer l'article
Hillary Chute , "La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques ", Transpositio, Traductions, 2020http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques
Voir également :
Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020
Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle{{Voir par exemple: Gustave Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément – D’après l’édition de 1851, éditions 2024, 2013; Gustave Doré, Les Travaux d’Hercule, éditions 2024, 2018; George Herriman, Intégrale Krazy Kat, tome 1 (1925-1934), tome 2 (1935-1944), 2018, éd. Les Rêveurs}}, constituent des marqueurs élitaires forts.
Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020
1. Introduction
Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle1, constituent des marqueurs élitaires forts. Le passage au numérique, qui s’est accéléré à partir de 2009-2010 (Baudry 2012), a généré une interactivité nouvelle à travers les blogs BD, tandis que le turbomédia2 transforme les contours sémiotiques d’un mode d’expression qui se réinvente avec une plasticité et des propositions multimodales inédites (Robert 2016).
L’ensemble de ces transformations a conduit la recherche sur la bande dessinée à réinterroger ses catégories et ses paradigmes d’analyse. Je souhaiterais ainsi revenir sur trois tournants théoriques importants survenus dans la décennie 2010-2020. Le premier concerne un changement de conception dans la sociologie des champs culturels, avec le passage d’une théorie de la légitimation à celle d’une culture post-légitime de la BD. Le second tournant concerne la sémiologie et l’histoire du médium, à travers le passage d’une théorie de la BD comme littérature séquentielle à la conception élargie d’une généalogie polygraphique du médium. Enfin le troisième tournant concerne la réflexion pédagogique et didactique sur la bande dessinée. La légitimation culturelle de la bande dessinée, ainsi que son intégration scolaire ne se sont pas accompagnées d’une théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe. Après avoir assigné à la BD, dans les années 1970 et 1980, un rôle de démocratisation de la lecture, voire un rôle de remédiation aux difficultés pour lire et écrire (sans véritablement questionner ce présupposé), on s’est ponctuellement avisé des difficultés spécifiques et des malentendus sociocognitifs qui pouvaient accompagner son étude. Au début des années 2010, la réflexion s’est surtout développée dans une perspective programmatique et ingéniérique, alors que manquait encore une description précise et compréhensive des pratiques effectives. Dans les situations ordinaires de classe, quelles finalités chaque discipline scolaire assigne-t-elle au médium? Comment ce dernier est-il reconfiguré comme objet disciplinaire? Ce chaînon manquant d’une didactique descriptive semble désormais en passe de se combler pour la discipline du français. Or cette évolution intervient au moment même où les tournants théoriques dans la compréhension culturelle, sémiotique et historique de l’objet BD pourraient bien rebattre les cartes.
2. Du paradigme de la légitimation au paradigme de la culture post-légitime
L’histoire de la reconnaissance socio-culturelle et socio-institutionnelle de la bande dessinée a été en premier lieu décrite et analysée par les spécialistes comme un processus de légitimation prenant naissance dans les années 1960. En 1975, dans un article intitulé «La Constitution du champ de la bande dessinée», le sociologue Luc Boltanski décrit un phénomène d’autonomisation, «sur le modèle des champs de la culture savante», selon un processus à quatre niveaux: changement dans les caractéristiques des producteurs, conquête d’un nouveau public, apparition d’un nouveau rapport avec les œuvres débouchant sur des instances de médiation et de célébration, enfin double polarisation entre grande production et production restreinte, conservateurs et novateurs. Les faits semblent donner raison à cette théorie classique de la légitimité culturelle d’inspiration bourdieusienne (1979; 1992), qui voit la création d’un centre d’intérêt commun se transformer en champ, à travers un transfert de légitimité et d’habitus académique par les producteurs majeurs et les intellectuels. Les grandes étapes en ont été largement décrites pour la sphère francophone (Groensteen 2006; Ory et al. 2012; Heinich 2017; Raux 2019): créations en 1962 d’un club de collectionneurs, d’une revue spécialisée, ainsi que d’un «Centre d’étude des littératures graphiques» animé par le journaliste Francis Lacassin, le cinéaste Alain Resnais et la sociologue Evelyne Sullerot; classification de la BD comme neuvième art en 1964 par le critique de cinéma Claude Beylie; première anthologie des Chefs d’œuvre de la bande dessinée et première exposition au musée des arts décoratifs en 1967; apparition d’une génération d’avant-garde (souvent issue du journal Pilote) revendiquant des ambitions artistiques, et création d’une édition indépendante (L’Echo des savanes en 1972, Futuropolis en 1974, Métal Hurlant en 1975); création en 1974 du salon d’Angoulême et de la collection «les maîtres de la bande dessinée» chez Hachette; apparition en 1978 du Mensuel A suivre, ambitionnant de faire concurrence à la littérature à travers de grands romans graphiques en noir et blanc. Durant la décennie 1970, la bande dessinée francophone européenne se recompose ainsi complètement dans ses styles, ses genres, ses supports, ses formats et ses publics. Elle ne s’adresse plus exclusivement à la jeunesse et s’affranchit progressivement de la presse pour devenir un phénomène de librairie à destination d’un public de connaisseurs plus adultes. La polarisation du champ analysée par Boltanski semble se vérifier avec l’apparition d’un «modèle de lecture savante et distanciée» (Lesage 2019): l’année 1984 en marque sans doute la date symbolique avec la création des Cahiers de la bande dessinée (sur le modèle des Cahiers du cinéma) et celle de l’ACBD, l’association des critiques de bandes dessinées, regroupant journalistes et essayistes spécialisés. Différentes enquêtes sur les pratiques culturelles des français (BPI & DEPS 20113) mettent non seulement en évidence le fait que les lecteurs de BD sont aussi des lecteurs de littérature en général, mais associent également cette pratique au capital culturel des classes moyennes et supérieures (Evans 2015; Maigret 2015). La dernière étape du processus de légitimation est l’entrée dans les musées (l’exposition d’Hugo Pratt au Grand Palais en 1986 ouvrant la voie à la multiplication des expositions dans les années 2000 et 2010), l’intégration de la BD par l’art contemporain (FIAC 2009) et la cotation sans cesse à la hausse des auteurs de référence sur le marché de l’art. Pour Nathalie Heinich (2017), il ne s’agit plus d’une simple ascension linéaire dans la hiérarchie des genres, mais d’un changement profond, qu’elle nomme «artification».
Ce paradigme interprétatif d’un processus continu de légitimation a pu être nuancé et complété. Harry Morgan (2003; 2012) a montré comment une première théorie du médium s’est en réalité construite en négatif dans les discours de réaction, dès le début du XXe siècle, et situe dans le courant des années 1950 les toutes premières analyses légitimantes en ce qui concerne la France. Matteo Stefanelli, dans son archéologie internationale des discours sur la BD (2012), rappelle que le médium devient un objet de discours intellectuel et scientifique dès les années 1920 aux États-Unis et que la sédimentation s’est interrompue dans les années 1950 à cause de la psychiatrisation des discours de réaction.
Cependant ce paradigme bourdieusien de la légitimation fait désormais l’objet de critiques de la part des historiens et des sociologues, en ce qu’il constitue un cadre limité voire contre-productif pour appréhender le phénomène social et culturel de la bande dessinée. Éric Maigret et Matteo Stefanelli (2012) constatent qu’il a engendré une critique «légitimiste» qui s’est enferrée dans un discours essentialiste, excessivement sémio-centré, sur la BD «en soi» et ses caractéristiques. Ce sont les débats sur son statut «séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), son appartenance à la littérature (Morgan 2003), sa multimodalité (Frezza 1999; Boutin 2012), ou les discours sur son «ontologie visuelle» (Lefèvre 2007). Éric Maigret constate de surcroît que cette quête d’un langage BD s’est doublée de la recherche historique d’un point de départ originel (Töpffer chez Thierry Groensteen et chez Benoît Peeters), pour définir et légitimer «un quasi-invariant» sémiotique (2012: 7).
Une seconde critique porte sur les effets d’exclusion de la critique «légitimiste». Nathalie Heinich (2017) note que la reconnaissance pleine et entière de la BD au titre d’art est ralentie voire bloquée par deux facteurs: le maintien d’un large secteur destiné à la jeunesse et d’autre part un mode de production et de diffusion industriel. Chaque étape de la consécration d’une certaine bande dessinée adulte novatrice s’accompagne alors de la reconduction de discours de dévalorisation à l’égard de productions émanant du pôle opposé du marché éditorial, celui de l’industrie culturelle. Éric Maigret invite à ne jamais sous-estimer cette «stratégie de minoration» (Maigret 2012b: 143), la plus spectaculaire ayant été les discours de condamnation des mangas durant les années 1990, dans des polémiques, note Sylvain Lesage, «qui ne sont pas sans rappeler celles des années 1940» sur l’encadrement des lectures pour la jeunesse (2018: 20). A l’autre bout de l’échelle, la valorisation éditoriale du «roman graphique» procède elle aussi d’une pure logique de distinction, afin de considérer inversement une certaine bande dessinée comme de la littérature à part entière (Groensteen 2012: 12). Pour l’historien Sylvain Lesage, ces mécanismes de sélection et de distinction de la critique ont conduit à fabriquer un canon qui finit par déformer la connaissance historique du neuvième art, en déniant l’intérêt de certaines productions: par exemple les publications «trop communistes» comme Vaillant, ou «trop populaires» comme Le Journal de Mickey, ou les «petits formats» type Comics pocket (2018: 14).
Plusieurs auteurs montrent du reste que la réalité du champ contredit en partie cette vision classique d’un processus linéaire de légitimation, où la BD serait appelée au sein de la hiérarchie des arts, à rejoindre les champs dominants. Thierry Groensteen (2006; 2017), pointe des déficiences persistantes en médiation, qu’elles soient institutionnelles ou culturelles, en particulier dans le domaine scolaire. Jean-Matthieu Méon (2015) montre que la légitimation médiatique de la BD consiste encore à la défendre pour ce qu’elle n’est pas, en lui prêtant les qualités de la littérature, du cinéma ou de la peinture, c’est à dire en important les critères de domaines artistiques plus légitimes. Eric Maigret pointe les «retours de bâtons» violents dont elle fait l’objet de la part de fractions culturelles qui se sentent menacées par la montée d’un nouveau régime multiculturel. Il montre aussi comment la réalité contredit les hiérarchisations au sein du champ: des chefs de file de l’avant-garde, à l’instar d’Art Spiegelman, sapent délibérément les effets d’hermétisme du schéma distinctif classique et revendiquent l’héritage de la bande dessinée populaire; réciproquement des séries jeunesse grand public (Astérix, Titeuf, Le Petit Spirou) subvertissent certains discours idéologiques, que ces derniers portent sur l’enfance, l’identité nationale ou le choc des civilisations.
Le sociologue propose ainsi de revisiter l’histoire socio-culturelle et socio institutionnelle de la BD à l’aune d’un second paradigme, celui de la post-légitimité, pensé sur le mode des théories postcoloniales. Pour lui l’émancipation des nouveaux arts ne peut être qu’en «demi-teinte», dans un monde ou l’enjeu de légitimité culturelle est moins central. Car les sociétés occidentales contemporaines ne croient plus entièrement au mythe moderniste du XIXe siècle fondé sur le grand partage entre «Haute Culture» et «culture de masse». Le nouveau régime multiculturel ne signifie pas pour autant un abandon de la hiérarchisation, mais «sa translation progressive vers une distinction intra-genre […] reposant sur une pluralité des ordres culturels» (Maigret 2012b: 140). Il prône ainsi un «travail de défense des multiples cultures» qui composent la culture de la BD, «notamment celles qu’on labellise comme "populaires", "juvéniles", "féminines", voire "étrangères", en distinguant non plus seulement des valeurs, mais des mondes et des échelles.» (Maigret 2012b: 146-147)
Une seconde recommandation de Maigret, qui s’adresse aux comics studies, est de cesser de «réclamer l’instauration d’un champ autonome, sur le mode dur, dix-neuviémiste», mais d’accepter au contraire «l’incomplétude, l’impossibilité de se délimiter, d’être un Art, c’est-à-dire une entité quasi-métaphysique» (2012b: 146). Car une conséquence paradoxale du nouveau régime multiculturel est que si la reconnaissance des ex-cultures populaires se généralise, elle ne peut advenir que partiellement, en l’absence d’une clé de voûte unique à la légitimation. Si le champ de la BD doit faire le deuil d’une complète légitimité, il y gagne en retour une transitivité nouvelle pour être pensé comme processus vivant de l’échange culturel. Éric Maigret prend ainsi acte du passage à la BD numérique, de la culture participative qu’elle entraîne, brouillant les frontières de la création et de la réception, ainsi que du décloisonnement des activités artistiques qui touche tous les ensembles historiquement constitués. De même Matteo Stefanelli considère la marginalité de la BD comme une ressource stratégique pour son développement en tant que «cas paradigmatique de la culture de la participation» (2012: 256). La finalité dernière du champ, dans le paradigme d’une culture post-légitime, c’est-à-dire ayant dépassé le stade premier du différentialisme, étant de «permettre à un nombre toujours croissant d’individus, de vivre mieux et de s’accepter» (Maigret 2012b: 147).
Le paradigme de la post-légitimité place ainsi au centre des considérations la plasticité culturelle de la BD, plutôt que sa plastique propre et son rapport aux arts légitimes. Ce déplacement théorique, qui est intervenu dans le courant des années 2010, s’est accompagné d’une autre modification d’importance dans la compréhension de sa nature médiatique. Afin d’en cerner toute la portée, il convient de retracer les différentes approches des liens entre BD et littérature.
3. La BD, une littérature dessinée? De la paralittérature à la culture polygraphique
Les travaux théoriques qui envisagent les relations de la bande dessinée et de la littérature peuvent être résumés autour de quatre orientations principales.
La première est de considérer la BD comme une production littéraire de masse. C’est dans ce cadre qu’elle est abordée en 1967 dans le colloque de Cerisy dirigé par Noël Arnaud, ou encore en 1992 dans l’ouvrage de Daniel Couégnas sur la paralittérature. Selon cette catégorisation, la BD serait le vecteur de formes textuelles dégradées ainsi que d’un imaginaire moins domestiqué. La classification comme «littérature populaire» accrédite l’idée d’une hiérarchisation entre une lecture «dominante» distanciée, celle du public cultivé, et une lecture «dominée», celle du grand public, conçue comme un délassement sans recul critique. Elle ne prend pas en compte la bande dessinée élitaire de production restreinte ni ne permet de s’intéresser au fonctionnement spécifique du média considéré. Pour sortir de cette impasse, les recherches sur la littérature de grande diffusion4, dans les années 1990, ont repensé l’approche du champ littéraire en l’élargissant à la notion de «culture médiatique». Il s’agit de considérer que l’imaginaire narratif d’une collectivité s’inscrit autant dans les fictions de masse que dans la production restreinte de la littérature légitimée, en puisant dans un répertoire commun de pratiques symboliques, d’événements culturels, historiques, politiques, sociaux, appréhendé selon des schèmes spécifiques (Quéfellec-Dumasy 1997). De nombreuses études ont ainsi donné une résonance nouvelle aux récits en bande dessinée, pour en montrer la portée inédite dans des champs aussi variés que la psychanalyse (Tisseron 2000; Rouvière 2014), la sociologie historique (Gabilliet 2005) ou l’anthropologie politique (Rouvière 2006). Parallèlement, le développement d’œuvres exigeantes, de même que l’apparition de genres nouveaux (autobiographie, romans graphiques, BD-reportage, essais) ont définitivement sorti la BD du cadre conceptuel des paralittératures.
La seconde approche, essentiellement sémiotique, est de considérer la BD comme une forme de langage médiatique visuel, successivement appréhendé comme une grammaire dérivée de modèles linguistiques (Eco 1964; 1972; Fresnault-Deruelle 1972), comme un «art séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), comme un «système» narratif spatialisé (Groensteen 1999) ou comme une «littérature dessinée» (Morgan 2003). La longue histoire de ces recherches sémiotiques a bien été résumée par Stefanelli et Maigret (2012), avec ses premières impasses (rechercher des unités élémentaires de l’image qui relèveraient d’une double articulation, comme dans la langue) et ses différents concepts (arthrologie, spatio-topie, multicadre, site, graphiation, récitant, monstrateur, etc.). S’appuyant sur les travaux de Groensteen, Harry Morgan définit ainsi la bande dessinée selon les caractéristiques suivantes:
- - la présence d’un dispositif spatio-topique, comme une distribution de vignettes en bandeaux, ou une page compartimentée distribuant texte et images, impliquant un travail de mise en page spécifique et surtout un ancrage permanent de la lecture par l’image (contrairement à la littérature illustrée où l’ancrage demeure le texte écrit);
- - le caractère volontiers narratif des images, lorsque celles-ci induisent en elles-mêmes un avant et un après, un lien de causalité et de consécution;
- - enfin la séquentialité, c’est à dire la présence de ce même lien de causalité et de consécution dans une séquence d’au moins trois images par page. La triade constituée par la vignette en train d’être lue, celle qui précède et celle qui suit, constitue une micro-chaîne qui se déplace tout au long de la lecture. C’est un plan de signifiance à part entière, au même titre que la vignette isolée et le dispositif spatio-topique à l’échelle de la page ou de la double-page.
Cette définition minimale, qui écarte les notions de bulle, de case ainsi que les rapports texte-image, considérés comme non définitoires, a le mérite d’ouvrir les représentations du médium en intégrant une très grande variété de dispositifs graphiques. Elle donne toute sa place au pilotage par l’image et rompt avec l’influence des théories du cinéma, pour affirmer clairement que la maîtrise du temps par le récepteur place la BD dans le monde de la lecture. C’est à ce titre que le médium bande dessinée est considéré comme l’une des branches des « littératures dessinées », au côté des cycles de dessins ou de gravures, auxquels on peut ajouter les albums pour enfant (Rouvière 2008a).
La troisième façon d’envisager les liens entre BD et littérature se développe à travers une approche comparative, fondée sur l’idée que les deux arts ont en commun le fait de raconter une histoire (Groensteen 1999; 2010) et qu’ils partagent des liens intertextuels. L’étude de l’adaptation occupe alors une place privilégiée (Gaudreault & Groensteen 1998; Rouvière 2008; Baetens 2009; Mitaine et al. 2015). Plusieurs auteurs s’inquiètent d’un usage «marchepied» de la BD, au service de la compréhension du texte source. Jean-Paul Meyer (2012) s’affranchit du débat sur la fidélité des adaptations, pour montrer combien l’intérêt d’une transposition en bande dessinée est de «donner à voir», littéralement, les particularités sémiotiques, narratives et énonciatives selon lesquelles une BD raconte une histoire. De même, Jan Baetens (2009) invite à analyser les œuvres adaptées en elles-mêmes pour juger de l’utilisation qu’elles font du langage BD et de ses potentialités «médiagéniques» (Gaudreault et Marion, 2013). C’est alors que peuvent s’éclairer comparativement, dans un second temps, les ressources propres à chaque médium. Une sémiotique comparative peut faire apparaître par exemple une plus grande polyphonie de l’instance énonciative en bande dessinée (qui se partage entre récitant, monstrateur et narrateur fondamental) que dans le texte littéraire d’origine. Sur le plan axiologique, cette polyphonie peut conduire à créer des contrastes, voire des renversements de système de valeurs par rapport à l’œuvre source (Rouvière 2008b; Garric 2014). Enfin, dans une perspective métaculturelle, la bande dessinée peut en profiter aussi pour dire quelque chose de sa position dans le champ artistique à l’égard de la littérature et développer un discours ironique et critique sur son statut d’œuvre seconde (Garric 2014).
Cependant, comme le regrette Hélène Raux, «une certaine inféodation de la bande dessinée à la littérature semble toujours à l’œuvre dans le domaine des études littéraires» (2019: 22). Elle critique ainsi le fait que l’essai de Jacques Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature (2013), soit structuré autour d’intitulés trahissant un dialogue asymétrique entre les deux arts: «être ou ne pas être de la littérature», «s’emparer de la littérature», «représenter la littérature», «rivaliser avec la littérature». Plus problématique encore, l’auteur cèderait selon elle à une logique de segmentation au sein du champ de la BD, usant du qualificatif de «littéraire» comme d’une marque de distinction plutôt que comme une véritable catégorie d’analyse.
La quatrième façon d’envisager les liens entre BD et littérature est de réinscrire la BD dans une généalogie culturelle croisée. Cette approche, qui est celle de Thierry Smolderen (2010), rompt avec la vision de David Kunzle (1990), Benoît Peeters et Thierry Groensteen (1994), selon laquelle Rodolphe Töpffer, dans les années 1830, serait l’inventeur de la bande dessinée, parce qu’il aurait créé à la fois l’album autographié, le dispositif spatial de la planche et le héros graphique moderne. Pour Peeters, les «histoires en estampes» de Töpffer s’affranchiraient ainsi de la prééminence du littéraire, en ce que l’histoire naîtrait entièrement de la logique propre engendrée par le dessin. Pour Smolderen (2012) il s’agit là d’une vision rétrospective qui procède d’une définition contemporaine purement axiomatique de la BD comme art séquentiel. Elle empêche de comprendre le rapport de la bande dessinée avec le très riche passé des histoires en images au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour lui, la croyance dans une essence ontologique du médium conduit à un contresens sur le projet de Töpffer, qui n’est pas de promouvoir l’art séquentiel, mais au contraire de critiquer les théories de Lessing prétendant refonder la poésie comme description d’une action progressive. Töpffer s’emploie à donner une traduction graphique caricaturale de ces principes, en s’appuyant sur les illustrations des manuels de gestualité dramatique, qu’il parodie et enchaîne. Il invente cette forme pour se moquer de la mécanique stupide à laquelle aboutirait la rhétorique du progrès. En s’inspirant des écrits de Bakhtine sur la polyphonie et le dialogisme, Smolderen montre comment le dispositif de Töpffer s’inscrit dans une culture polygraphique antérieure beaucoup plus vaste, contemporaine du caricaturiste William Hogarth et des romans d’avant-garde anglais humoristiques du XVIIIe siècle. Hogarth, dans ses cycles narratifs de gravures, détourne et télescope des diagrammes visuels appartenant à différents registres, populaires ou archaïsants. Il s’inscrit dans une veine parallèle au «roman arabesque», dont le Tristram Shandy de Laurence Sterne est emblématique. Le novel humoristique anglais et la caricature procèderaient ainsi du même creuset culturel fondé sur l’hybridation stylistique, la parodie d’idiomes préexistants, l’ironie, la mise en abyme. Pour les contemporains de Töpffer, comme Goethe, ou pour ses successeurs comme Cham ou Gustave Doré, les récits séquentiels du Genevois relèvent à l’évidence des dispositifs ironiques du roman excentrique, à la fois polyphonique et polygraphe.
A travers le prisme de la culture polygraphique proposé par Smolderen, c’est soudain une généalogie de la BD beaucoup plus complexe qui apparaît, où la linéarité visuelle de la bande n’est pas première. Ce dispositif séquentiel ne trouve de postérité, dans les décennies suivantes, qu’à la faveur du support presse et d’autres gestes polygraphiques, comme la transposition de scripts sociaux, la schématisation inspirée des recherches chronophotographiques sur la décomposition du mouvement, le détournement de la fonction emblématique du phylactère (détournement concomitant à l’invention du phonographe), l’attraction de l’affiche publicitaire, ou encore la reprise de la culture foraine des images déformantes. Le travail d’historien de Smolderen, en rompant avec un «cycle essentialiste» sémio-centré (Stefanelli, 2012) au profit d’une approche culturaliste, a entraîné dans son sillage un déplacement prometteur des questions théoriques au sein des recherches sur la BD.
Le premier est porté par Henri Garric (2013) et concerne «l’engendrement des images en bande dessinée». Il s’agit de réfléchir aux moyens par lesquels une BD se constitue à partir de la seule répétition et métamorphose des formes et des objets, selon un jeu libre de l’image avec elle-même. Toute bande dessinée illustre une «plasticité métamorphique des images» (Garric 2013: 44), des jeux de genèse et de combinaisons des dessins, selon un bricolage qui se nourrit aux sources les plus éclectiques. Ce processus «déborde» la séquentialité chronologique des cases, pour s’exercer à l’échelle de la planche, de l’album, voire d’un genre tout entier. Il s’exerce également dans la BD numérique, à travers le déroulement vertical et la circulation hypertextuelle. Henri Garric fait ainsi une relecture des gags de Gaston Lagaffe à l’aune de l’opposition entre raideur et souplesse, entre trait rectiligne et ligne serpentine, diagrammes mécaniques et jeux d’arabesques (2013b). Il montre comment ces formes sont frappées de valeurs (la raideur mécanique et productiviste d’un côté, la liberté subjectivante du vivant de l’autre), dans un jeu d’échange dialectique qui engendre littéralement le scénario du gag. Cet axe de lecture permet de saisir simultanément, dans le mouvement de naissance de l’image, l’imaginaire particulier de l’auteur qui le porte, mais aussi le pouvoir de perturbation critique du dessin, «ouvrant à partir de n’importe quel prémice, n’importe quelle situation narrative, un récit qui vient défaire la cohérence et la linéarité temporelles» (Garric 2013b: 14-15). On toucherait là un noyau central de l’expression en bande dessinée, au point que «l’engendrement des images est ce qui reste de la BD quand elle tente une radicalisation et une concentration expérimentale de ses moyens», et constituerait pour certains un «idéal créatif» (Garric 2013b: 14).
Cette attention au jeu des auteurs sur l’apparition des images, en particulier à partir du creuset que constituent la mémoire, les rêves et les fantasmes (Rostam 2013), trouve son pendant dans un questionnement renouvelé sur les images que se forme le lecteur. Ce déplacement vers la réception est déjà présent dans la théorie de l’art invisible de Mc Cloud (1993), qui s’intéresse au jeu mental du lecteur avec l’espace inter-iconique (le blanc entre les cases), mais dans un paradigme où l’activité imageante du récepteur est prédéterminée, par les effets de cadrage, d’ellipse et de temporalité du récit. De même, les différentes théories sémio-structurales qui s’intéressent à la navigation du regard, traitent la page comme un objet statique en relation avec la théorie de la narration (Taylor 2004; Nakazawa 2005; Ingulsrud & Allen 2009), où l’ordonnancement est supposé introduire un balisage du sens de lecture. Or, si l’on considère que le processus d’engendrement des images fuit, déborde ou échappe en réalité à cet ordonnancement, leur puissance de surgissement invite à considérer autrement l’expérience lectorale. Eric Maigret, qui se dit particulièrement attaché aux principes d’autonomie de la réception, refuse de réduire les cheminements internes du lecteur au seul décodage ou pré-cadrage d’un parcours du regard. Il invite au contraire à considérer que les assemblages de sens effectués par le lecteur peuvent être «décentrés, faiblement cohérents, non hiérarchiques, sans but narratif ultime, partager des frontières floues avec d’autres formes d’expression» (2012a: 57). Matteo Stefanelli (2011; 2012) questionne quant à lui les relations entre réception et corporalité. Tout d’abord l’énonciation graphique, définie comme «graphiation» par Philippe Marion (1993: 31) est une trace idiosyncrasique, une empreinte-signature qui entraîne une relation subjective, fantasmatique du lecteur avec un corps-dessinant. Cette corporéité permet d’embrasser sur un plan idéel et mental le regard de l’artiste comme corps visionnaire. D’autre part, l’interface matérielle de la page et des écrans dépasse la modalité de la simple vision et appelle à prendre en compte l’engagement corporel du lecteur dans l’expérience de lecture. La matérialité de cette expérience immersive est du reste également prise en compte par les études sociologiques qui s’intéressent aux usages sociaux des comics ou des mangas, comme le cosplay 5 ou le scanlation6. La BD s’insère alors dans la vie quotidienne comme ressource identitaire, à travers un réseau de pratiques performatives et de communautés online, comme le montrent les recherches sur la dimension participative des médiacultures (Jenkins 2006; Ito 2008; Lunning, 2010).
Enfin les premières recherches sur la bande dessinée numérique remettent en cause le partage établi par Harry Morgan (2003) entre les arts qui pilotent la durée et qui l’imposent au récepteur (en particulier les arts audiovisuels), et les arts de la lecture qui laissent le récepteur gérer le temps (peinture, gravure, dessins, littérature dessinée). Anthony Rageul (2014) propose le concept de «lectacture» pour indiquer que la modalité de réception n’est plus seulement la lecture:
«lire» une bande dessinée numérique, c’est lire et agir ou lire et visionner. La lecture et l’action ou la lecture et le visionnage peuvent apparaître alternativement (ex: bande dessinée entrecoupée de passages jouables ou animés) ou se faire en même temps et ne faire qu’une (ex: explorer l’image avec la souris ou l’écran tactile). C’est une nouvelle modalité que j’appelle lectacture, en détournant la notion de Weissberg. En bande dessinée numérique, il y a deux axes, un qui va chercher du côté de l’animation, l’autre du côté du jeu vidéo. (cité dans Baudry 2015)
Rageul reprend le concept de «narrateur-arbitre» issu des recherches de Dominique Arsenault sur le jeu vidéo (2006), pour concilier une approche narratologique et une approche ludologique. Il établit ainsi un embryon de narratologie de la bande dessinée numérique qui tient compte de la participation du «lectacteur». Pour lui l'expérience de l'œuvre se joue sur le mode du gameplay et cela a des répercussions sur la narration, qui doit intégrer ces modalités particulières. Le récit ne reposerait plus seulement sur les mécanismes de la narration. Il exhiberait toute sa matérialité au lectacteur et reposerait en grande partie sur des mécanismes d'ordre poétique.
L’état des lieux qui précède sur les réflexions et les connaissances au sein des comics studies, dessine un objet culturel complexe et permet de mieux cerner les spécificités et les décalages avec la situation scolaire du médium dans les classes de français, telle qu’en rend compte la littérature pédagogique et didactique.
4. La reconfiguration scolaire de la BD
4.1. Un processus parallèle à celui de la légitimation culturelle
L’intégration scolaire de la BD s’est développée en parallèle de son intégration sociale, de façon assez autonome et sans recouper tout à fait cette dernière. Plusieurs synthèses historiques (Rouvière 2012; Raux 2019) en ont retracé en France les étapes successives, qui ont abouti à une forme de normalisation dans le courant des années 2000. À partir des programmes de 1972 pour l’école primaire, l’intégration de la BD se fait de façon d’abord résignée et méfiante. La volonté de valoriser les intérêts des élèves coexiste avec un discours de réprobation des mauvaises lectures, ce qui reflète les tensions qui entourent la rénovation de la discipline et plus largement de l’école. La BD reste alors en marge de ce qui est pleinement considéré comme lecture. Par la suite un deuxième mouvement se fait à la croisée des disciplines, par la lecture de l’image dans les programmes de collège de 1985 puis de 1996. De même, dans les programmes de 2008, la BD est évoquée au titre de l’histoire des arts (sans toutefois que les objectifs d’apprentissage soient clairement définis dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire). Le troisième mouvement est celui d’une intégration progressive aux lectures scolaires à partir des programmes de 1996 pour le collège. On passe d’une perspective d’exploitation instrumentale au service de la maîtrise de la langue et des discours (1996) à la reconnaissance de la BD comme support de la lecture interprétative, en particulier grâce au saut décisif des programmes de 2002 pour l’étude de la littérature jeunesse à l’école primaire. On note à ce titre la diversification croissante, depuis 1996, des œuvres conseillées pour l’école et le collège, sur le plan des genres, des styles, des univers fictionnels et des auteurs.
Ce processus n’est pas linéaire. Ainsi, les programmes de français de 2008 pour le collège tendent à évacuer la BD en recentrant la lecture sur la littérature classique et patrimoniale. De même, le réaménagement en 2018 des programmes de 2015 retire la BD de la liste des «genres» pour la compétence «comprendre un texte littéraire» en fin de cycle 3. Par ailleurs l’intégration de la BD reste segmentée selon les niveaux de classe et les filières. Comme le rappelle Hélène Raux, alors que la référence au médium dans les programmes de français du lycée professionnel est continue depuis 1987, celle-ci reste extrêmement marginale dans ceux du lycée général et technologique (malgré l’ouverture qu’avaient constitué les programmes de 1970 et 1981). Pour la chercheuse, c’est le signe que l’institution scolaire continue de conférer à la BD un rôle de remédiation ou de marchepied vers la lecture. Plusieurs auteurs pointent ainsi les limites du processus d’intégration, évoquant une forme de «trompe-l’oeil» (Rouvière 2012), de «réversibilité» (Aquatias 2017), ou de «décalage» avec les pratiques (Depaire 2019). Plusieurs enquêtes tendent à montrer que l’on n’étudie pas de BD en œuvre intégrale à l’école et au collège (Louichon 2008; Massol & Plissonneau 2009; Bonnéry et al. 2015). Pour Hélène Raux (2019), les usages scolaires de la bande dessinée restent minoritaires, périphériques et possiblement sujets à des malentendus sociocognitifs, tandis que manque une véritable théorisation didactique du médium.
Ce paradoxe pourrait s’expliquer selon le paradigme de la culture post-légitime développé par Eric Maigret (1994): à l’image de ce qui se produit en dehors de la sphère scolaire, l’intégration de la BD serait vouée à demeurer partielle et contradictoire, l’école reproduisant en interne, dans le choix et l’étude des corpus, des logiques de distinction extérieures. Cependant, les travaux sur l’histoire de l’enseignement (Chervel 1998) et la scolarisation des genres (Denizot 2013) offrent un autre modèle explicatif: en effet, la culture scolaire a la particularité de reconfigurer ses objets de façon autonome pour ses besoins propres.
Hélène Raux (2019) en fait la démonstration pour la bande dessinée à travers l’étude historico-didactique de 120 articles mentionnant la BD, qui ont été publiés entre 1968 et 2018 dans trois revues didactiques de référence (Repères, Pratiques, Le français aujourd’hui) ainsi que dans une revue professionnelle plus ancrée sur les pratiques enseignantes (la Nouvelle Revue Pédagogique). Durant la période de rénovation de l’enseignement et jusqu’au milieu des années quatre-vingt, la BD est appréhendée comme mass média, étant donné que, dans une logique communicationnelle, tout est discours parmi les langages présents dans l’environnement social. De façon inattendue, certains discours hostiles à la BD émanent alors de rénovateurs de l’enseignement, pour des raisons essentiellement idéologiques: en tant que production de masse, la BD est soupçonnée de diffuser les valeurs de la classe dominante et de véhiculer des stéréotypes sociaux. S’il faut l’étudier, c’est alors comme support propédeutique pour développer l’esprit critique face aux médias. Lorsque la BD est appréhendée de façon complètement positive par les rénovateurs, c’est cette fois-ci au détriment de sa spécificité médiatique, le plus souvent comme support d’une analyse structurale du récit. Dans les deux cas, Raux pointe le risque de renforcer les hiérarchies culturelles et les effets d’exclusion à l’égard de la culture privée qu’on prétend intégrer.
À partir de la fin des années 1980, Raux décrit une période marquée par une transition vers la reconnaissance de la BD comme lecture à part entière. Avant les années 1990, le support est pensé comme facilitateur pour la lecture, puis reconnu comme art complexe après les années 2000. De la paralittérature (Reuter 1986) à la lecture littéraire, la chercheuse retrouve les logiques de distinction qui conduisent à prendre en considération surtout des œuvres éloignées des lectures prisées des élèves (Bruno 1995), voire de minorer la complexité de ces lectures. L’ouverture aux lectures privées est toujours ambivalente, avec la volonté de leur faire prendre une distance critique par rapport aux productions qu’ils plébiscitent et de valoriser des œuvres fortement mises à distance des productions les plus populaires. Par ailleurs, la lecture de BD évolue, d’une lecture narratologique à une lecture sémiotique, via la lecture de l’image, jusqu’à esquisser une lecture didacticienne de productions d’élèves, par le travail sur l’adaptation. Raux montre surtout à quel point la didactisation de la BD est quasiment absente des articles. La présence de la BD reste incidente au profit d’objectifs variés. Elle n’est pas interrogée comme objet disciplinaire et son rôle supposé de remédiation n’est guère questionné. Rares sont les articles qui mettent en garde contre une sous-estimation de sa complexité (Huyhn 1991; Bautier et al. 2012). On s’en tient à des esquisses de pistes pédagogiques possibles (Bomel-Rainelli & Demarco 2011), tandis que l’analyse de productions d’élèves reste l’exception (Hesse-Weber 2017). Par ailleurs, la production de planches n’est pas mise en relation avec la lecture d’œuvre. Pour expliquer ce déficit, la chercheuse évoque la position «satellitaire» du médium par rapport à la littérature et fait le constat plus général d’un retard de la réflexion didactique sur l’image. Dans ce domaine, elle pointe les limites d’une approche qui est restée formaliste et elle critique un isomorphisme supposé entre image et texte (Raux 2019: 109-113).
4.2. Lever des présupposés non questionnés: d’une didactique programmatique à une didactique descriptive et compréhensive
Lorsqu’en 2010 est organisé à Grenoble le colloque international «Lire et produire des bandes dessinées à l’école», il s’est agi d’impulser dans le champ de la didactique de la littérature une réflexion pédagogique qui, depuis la fin des années 1970 et le colloque de la Roque d’Anthéron «Bande dessinée et éducation» (1977), ne s’était poursuivie de loin en loin que dans le champ disciplinaire de l’histoire. Les actes Bande dessinée et enseignement des humanités, publiés en 2012, proposent ainsi un état des lieux et une perspective programmatique pour envisager comment la BD pourrait contribuer à la construction de compétences de lecture. Ces actes incluent aussi des récits d’expériences de classe, principalement orientés vers l’ingénierie. Rétrospectivement, en 2020, apparaissent les limites de certains discours fondés sur des présupposés non toujours démontrés. Certains reposent sur des déclarations d’intention qui n’ont pas été suivis par des expérimentations attendues; d’autres prônent des mises en œuvre, qui n’ont pas été suivies de recueils et d’analyses de données suffisants, sur la situation scolaire du médium et la représentation comme objet disciplinaire que s’en font les acteurs institutionnels. D’autres enfin relèvent d’une praxéologie empirique, sans que l’on puisse véritablement tirer de conclusion générale sur les effets de cette dernière.
Les études qui se sont poursuivies dans la décennie 2010-2020 se sont appuyées sur une méthodologie et des données plus conséquentes pour lever un certain nombre de méprises sur la lecture de BD en classe. Tout d’abord, l’étude de Beaudoin et al. (2015), qui porte sur l’enseignement explicite de stratégies de compréhension en lecture, tend à montrer qu’il n’y a pas d’effet significatif du recours à la BD sur l’habileté à produire des inférences ou à développer la conscience métacognitive. Par ailleurs, le postulat selon lequel la bande dessinée serait facile d’accès est battu en brèche par plusieurs recherches. Sur des supports aussi variés que la BD historique ou le roman graphique, Virginie Martel et Jean-François Boutin (2015), ainsi que Nathalie Lacelle (2015), montrent que la prise d’information visuelle fait souvent défaut, en articulation avec la modalité textuelle, pour produire une interprétation générale. Les auteurs plaident donc pour une formation spécifique des élèves aux compétences de lecture multimodale. La bande dessinée peut même nuire aux apprentissages, lorsque les difficultés de réception du médium sont sous-estimées, comme le montrent Bautier et al. (2012) dans une séance de lecture en CP, à partir d’une planche présentant une pluralité de codes sémiotiques. Polo et Rouvière (2019) montrent qu’en classe de Première Sciences économiques et sociales, le choix d’un récit biographique de sept planches, donné comme support d’évaluation sans travail préalable sur les compétences spécifiques de lecture, suscite des erreurs de compréhension imputables au médium choisi, quel que soit le ressenti positif ou négatif des élèves. Le décalage qu’ils pointent entre l’effet subjectif plutôt positif du médium sur les élèves et les effets objectifs sur leur compréhension recoupe sur ce plan les analyses de Beaudoin et al. (2015).
Par ailleurs, loin de faciliter la compréhension et les apprentissages, la persistance de malentendus peut réduire l’étude de la bande dessinée à un simple vecteur de motivation. Hélène Raux (2019), qui a mené une étude sur les pratiques ordinaires des enseignants, incluant une série d’entretiens avec les praticiens, montre que la BD est essentiellement perçue comme une lecture plaisir, susceptible de raccrocher les petits lecteurs, a fortiori dans des démarches de projet supposées créer de la motivation et bonifier le climat de classe. La méconnaissance du domaine BD par les enseignants surdétermine le choix de corpus connus au graphisme accessible. Hélène Raux montre par ailleurs le décalage entre les premières représentations des professeurs et les fragilités qu’ils éprouvent ensuite face à l’objet. Ils disent leur manque d’outils pour travailler la BD dans le champ de la littérature. De fait, l’étude par la chercheuse de vingt-six séquences de français au sein du réseau «communauté des profs blogueurs» montre une très faible didactisation du médium dans la discipline. En l’absence d’une approche interdisciplinaire qui articule texte et image dans une démarche interprétative, l’usage de la BD oscille d’une part entre un outillage technique sur les codes sémiotiques, sans mise en relation avec l’effet de sens, et d’autre part une focalisation sur le texte et les enjeux globaux du récit, au détriment de la dimension visuelle.
Hélène Raux montre malgré tout que certaines pratiques «ordinaires» qu’elle a observées mettent en œuvre, avec la BD, des modalités de lecture interprétative et de questionnement ouvert, à partir d’éléments «résistants» dans des compositions visuelles polysémiques. Le cadre de l’observation, qui est celui du projet TALC (Du texte à la classe), est cependant spécifique7. Il s’agit d’enseignants volontaires sollicités à l’occasion d’une formation consacrée à l’enseignement de la littérature, tandis que le choix de la BD a été imposé. De façon significative, elle met cependant en évidence des embarras liés à l’intégration du médium, par exemple le besoin de faire un cadrage liminaire sur les codes de la BD, ou encore des logiques centrifuges symptomatiques à travers des activités de langue extérieures aux activités de lecture. Comparativement aux autres «genres» proposés dans le projet TALC, les enseignants demandent surtout très peu aux élèves de justifier leur lecture par des prises d’indices dans la BD.
Il en va différemment lorsque l’expérimentation en classe vise à tester un scénario pédagogique spécialement conçu par un didacticien pour embrasser les différentes composantes du médium et mettre les élèves en situation de questionnement (Rouvière 2012b; 2013). A travers la mise en évidence d’analogies de composition, les élèves peuvent parvenir à quitter le simple niveau de la fiction pour passer à l’examen plus distancié de procédés narratifs «littéralement visibles». Ils découvrent alors que le pilotage du récit par l’image est lourd d'effets implicites, ouvrant la voie à une lecture symbolique.
Il est à noter dans les recherches de Raux et Rouvière que ce sont les planches ou les scènes muettes qui donnent lieu à un travail interprétatif mobilisant l’analyse de compositions visuelles «résistantes». Cela rejoint le paradoxe pointé par Baetens (2012) à propos du roman graphique: le rapprochement avec la lecture dite «littéraire» serait plus grand lorsque le pilotage du récit n’est pas d’abord textuel.
Alors qu’un déplacement vers la question de la réception subjective s’amorce dans les comics studies et que les théories du sujet-lecteur informent depuis 2004 les réflexions en didactique de la littérature, il est à noter qu’aucune recherche d’envergure n’a été menée sur ce plan avec la BD, contrairement à d’autres genres et médium (album pour enfants, poésie, théâtre, genres narratifs).
4.3. La production de planches de BD en classe: de l’observation de pratiques «ordinaires» à l’expérimentation d’un dispositif spécifique
On doit à nouveau à Hélène Raux (2019) d’avoir mené un travail descriptif et compréhensif des pratiques ordinaires de production de BD en classe. La chercheuse a ainsi observé différents ateliers en CE2 et en classe de sixième dans le cadre d’une pédagogie de projet assortie, dans l’un des cas, de l’intervention d’une artiste. Son analyse s’appuie sur un ensemble de productions d’élèves des différentes classes et des entretiens menés avec chacune des enseignantes. La chercheuse retrouve dans les modalités de travail inspirées de la pédagogie de projet un certain nombre de limites déjà pointées par des sociologues de l’apprentissage comme Bonnéry (2007) ou Bautier et Rochex (2007): un investissement variable des élèves, des phénomènes de division du travail, une finalisation étroite des activités, une réduction chez certains élèves de la compréhension des enjeux de la tâche. L’atelier BD est valorisé par les enseignants au nom d’une pédagogie de la réussite supposée restaurer l’estime de soi, selon le présupposé d’un pouvoir remédiant du médium ou des vertus mêmes du détour. Mais cette réalité ne vaut que pour une poignée d’élèves, tandis que la démobilisation des autres est acceptée par les professeurs au nom de l’inédit, l’essentiel étant de sortir des sentiers battus de la discipline.
Les enjeux cognitifs passant au second plan, non seulement les résultats décevants entretiennent les difficultés, mais paradoxalement, l’activité s’avère surtout porteuse pour les bons élèves. Sur un plan plus technique, la chercheuse constate que la capacité à créer un enchaînement narratif visuel n’est pas enseignée comme une compétence. Le découpage du récit en images est pensé comme naturel et allant de soi. Pour y parvenir, les élèves sentent qu’il serait possible de faire un découpage dessiné, mais comme il leur est demandé de faire un découpage écrit, l’activité se mue au mieux en une segmentation de texte à illustrer, où le dessin ne pilote pas le récit. Hélène Raux montre le flou des représentations enseignantes sur la notion de scénario, elle montre comment une partie des élèves dessine malgré tout et insère du texte transformé, enfin comment le découpage scénaristique peut se trouver délégué à un intervenant extérieur, annihilant l’intérêt pédagogique de l’activité pour les élèves.
De fait, si l’écriture d’un synopsis mobilise des compétences d’écriture scolaires traditionnelles, le découpage, en revanche, suppose que les élèves aient la capacité spécifique de pré-visualiser ce qu’ils racontent et mettent en scène: le site, la taille et la forme des cases, les types de plans, le contenu figuratif, etc. Or, cette compétence particulière, qui consiste véritablement à «penser en images» devrait faire l’objet d’un apprentissage préalable. Ainsi, des élèves performants dans l’écriture du synopsis peuvent-ils se trouver démunis lorsqu’il s’agit de passer à l’étape suivante. C’est pour remédier à ce problème qu’a été inventé le dispositif collaboratif de «l’écriture post-it», qui a été expérimenté avec succès (Rouvière 2015; 2017). Le principe «1 post-it = 1 action» permet de créer une histoire pré-découpée selon l’équivalence implicite «1 post-it = 1 case». A quoi s’ajoute ensuite deux autres couches de post-it de deux couleurs différentes, l’une pour le texte, l’autre pour décrire le visuel. Le synopsis s’invente ainsi ou se réinvente en même temps que le scénario s’écrit, case après case. Planification, mise en texte et révision ne sont plus des étapes chronologiques, mais se fondent dans un seul et même processus dynamique. Ainsi certains élèves en difficulté dans des productions écrites traditionnelles se découvrent une capacité à pré-visualiser et mettre en scène avec ces petits papiers ce qu’ils veulent raconter.
4.4. L’étude des adaptations: une porte d’entrée incontournable de la BD en classe?
Dans son étude historico-didactique, Hélène Raux (2019) montre que l’étude de l’adaptation en BD des classiques de la littérature se situe à un point d’équilibre des tensions culturelles qui entourent la légitimation du médium et, à ce titre, constitue une porte d’entrée possible pour une didactique de la BD en classe. C’est ce que pourrait laisser espérer l’article de Hesse-Weber (2017), qui s’appuie sur l’analyse de productions d’élèves pour étudier les enjeux de l’adaptation d’une pièce de théâtre en bande dessinée. La place donnée à la BD reste cependant celle d’un «satellite gravitant autour des œuvres littéraires» (Raux 2019: 107). D’autres études confirment que la production en classe d’adaptation en BD reste subordonnée pour le professeur à des objectifs d’appropriation subjective, de compréhension et d’interprétation du texte littéraire (Lacelle & Lebrun 2015). Il en ressort tout de même que l’adaptation par les élèves peut donner une réelle impulsion à l’exploration du texte source pour construire la compréhension (Rouvière 2015). Elle oblige les élèves à plonger dans le texte, à le découper, à distinguer les différentes factures de discours et les instances énonciatives, à séquencer les actions, les dialogues ou les passages descriptifs. Le processus engage par ailleurs chez les élèves un effort d'élucidation lexicale et de représentation mentale pour se forger des images. Effort qui est souvent étayé par des recherches documentaires pour enrichir la lecture et nourrir le projet.
Cependant, en ce qui concerne la lecture proprement littéraire, le bénéfice pour l’interprétation du texte source semble limité. Dans une expérimentation que j’ai pu mener (Rouvière 2017), il est apparu qu’une fois que les élèves ont dégagé une note d’intention, le texte source servait de réservoir utile à d'autres fins qu'à sa propre lecture, dans le sens d’'une réduction et d'une simplification. Lors de la présentation ultérieure des planches, le travail comparatif s’est avéré également assez pauvre et n'a pas enrichi véritablement la lecture littéraire. Les élèves ont vu le texte original à travers le prisme de leur propre adaptation, pour étayer leur projet. L'activité fictionnalisante du lecteur (Langlade 2004) a certes été mise en mouvement, mais en amont du processus de l’adaptation lui-même, après la lecture-découverte, lorsqu’était suscité par exemple un jeu d’images associatives. La transmodalisation a apporté en aval peu de gain supplémentaire sur ce plan. Par contre l'analyse que les élèves ont faite de leur planche a montré le plus souvent une articulation explicite entre une intention signifiante, des procédés de composition et des effets de sens (même s’il s’agissait d’un discours reconstruit). La BD m’apparaît comme un médium particulièrement propice à l'adoption de cette posture, pour peu que l’on exerce le regard des élèves sur quelques procédés (choix d’un multicadre, taille, forme et site des vignettes, jeux d’échelle sur l’échelle des plans ou sur les angles de vue, etc.). Ce résultat peut du reste être obtenu en lui-même, sans le détour par l’adaptation d’un texte littéraire.
En ce qui concerne la lecture en classe de bandes dessinées adaptées d’œuvres littéraires, la réflexion didactique, quoi qu’elle en dise, parvient également difficilement à s’affranchir d’une approche «marche-pied», car l’objectif est de contribuer à la formation d’une lecture littéraire de l’œuvre source. Les adaptations BD sont envisagées comme des «textes de lecteurs», et à ce titre, fournissent l’exemple de lectures subjectives (Fourtanier 2012) et sensibles (Ahr 2012). Cependant Brigitte Louichon (2012) montre que l’étude de la reproduction intégrale du texte source peut aussi avoir pour effet de questionner les particularités sémiotiques du langage BD et s’avère une modalité porteuse pour problématiser la lecture.
4.5. Vers une didactique de la culture polygraphique?
Le paradigme de la culture polygraphique proposé par Thierry Smolderen (2009; 2012) pour cerner le creuset où prend naissance et se réinvente la bande dessinée, invite sans doute à élargir les perspectives pour une didactique du médium.
Cela concerne d’abord les frontières d’une acculturation générale au média: ouvrir les représentations des élèves à la diversité des univers de fiction, des genres, des styles graphiques et des esthétiques semble une nécessité, de même que les ouvrir au processus de création, à l’histoire du médium et à ses différentes sphères culturelles à travers le monde. Mais il semblerait fructueux également de questionner en classe les frontières sémiotiques du médium avec d’autres formes d’expression: le dessin de presse, les caricatures séquentielles, le roman-photo, la peinture d’images itératives (profanes ou religieuses), les albums pour enfants, les recueils d’illustrations ou de caricatures, l’art de l’affiche, du vitrail ou de la fresque, dans une approche véritablement interdisciplinaire avec les arts plastiques.
Lorsqu’il s’agit d’étudier le «langage» de la BD, le concept de culture polygraphique invite également à décloisonner l’approche des codes formels. Rencontrer un même procédé (cadre, site, plan, angle de vue…) dans des contextes stylistiques et compositionnels diversifiés éviterait de figer les représentations sur les effets induits, tout en développant la culture du regard et la sensibilité.
En ce qui concerne la production de planches par les élèves, l’intégration d’éléments composites (photogrammes, détails grossis ou inversés de reproductions de tableaux, diagrammes divers) apparaît comme une pratique légitime, de même que le détournement, le collage et l’invention patchwork de planches à partir d’emprunts à d’autres BD ou différentes banques d’images disponibles (Rouvière 2015; 2017). A ce titre, les directions de recherche impulsées depuis 2016 par l’association Stimuli et le laboratoire de didactique André-Revuz de l’Université Denis-Diderot, dans le champ de la didactique des sciences, s’avèrent tout à fait prometteuses. Les enseignants et les chercheurs qui utilisent les arts narratifs et visuels pour faire vivre la science dans leur classe ou médiatiser leurs recherches en laboratoire, utilisent des dispositifs icono-textuels qui s’inspirent de la BD autant qu’ils la nourrissent: par exemple certains organisent la page comme un champ panoptique et insèrent des photogrammes qu’ils traitent comme des vignettes de BD (avec récitatifs et bulles), en les recadrant, en estompant les éléments non discutés, en épurant les éléments importants avec des dessins aux lignes claires, et en les complétant d’annotations graphiques (Goujon 2020); d’autres font produire aux élèves des narrations graphiques codées à partir d’albums pour enfant (Moulin & Hache 2020) et des cartes dites «sensibles» (Gaujal 2020), pour favoriser l’appropriation de savoirs disciplinaires en cours d’acquisition8.Thierry Smolderen (2012) rappelle à quel point toute forme de modélisation théorique peut se révéler stimulante pour l’imagination d’un dessinateur polygraphique. Il y voit l’une des clés du dynamisme de la bande dessinée, qui trouve historiquement sa source dans un imaginaire diagrammatique et spéculatif. Ce propos est confirmé par différentes expériences universitaires récentes, qui invitent les jeunes chercheurs à transposer leur recherche en BD9.
Sur le plan de la lecture, la notion de culture polygraphique invite par ailleurs à sortir d’une approche strictement séquentielle du médium. En contrepoint d’une approche scénaristique de la BD (telle qu’induite par exemple par la narratologie ou le dispositif de l’écriture post-it), il est sans doute possible de promouvoir une approche non linéaire axée sur l’engendrement des images. A la suite des approches tracées par Marion Rostam et Henri Garric à propos des œuvres de David B. et de Franquin, il s’agirait par exemple de rechercher avec les élèves, parmi le flux et l’entrelacement des formes et des figures au sein de certaines œuvres graphiques, un possible dispositif dialectique. Tout se passe parfois comme si la tension entre certaines formes ou certains motifs (la droite vs la courbe, le contour vs le détour, le noir vs le blanc, le vide vs le plein, le texte vs l’image, le figuratif vs l’emblématique) recouvrait un conflit de valeurs et se prêtait à des jeux de combinaison réversibles.
Une autre source d’engendrement des images est l’imaginaire linguistique. Roland Barthes (1982) l’avait montré à propos de l’art du peintre Arcimboldo fondé sur un jeu de métaphores, de métonymies et d’expressions langagières transposés dans une composition visuelle. On retrouve cette direction dans une proposition de Tatiana Blanco Cordon (2012), en classe d’espagnol langue étrangère, qui consiste à effectuer une lecture «littérale» de certains motifs, pour en déduire des expressions linguistiques. Cette méthode semble approcher d’assez près le nœud d’imaginaire où la création iconique parfois s’origine. Il est possible en effet que l’image ait sa source dans un «texte souterrain», qu’elle procède de certaines expressions de la langue qui la parle à l’avance (Rouvière 2012a: 373). On sait par exemple qu’il s’agit chez René Goscinny de l’un des ressorts de l’invention du gag visuel (Kaufmann 1983) ou du cryptage symbolique (le sang-lier). On aboutit alors à des énoncés littéraux, une «lettre» de l’image qui redonne toute leur profondeur aux mises en scène par la bande.
Enfin, au regard de l’hybridation stylistique et de la distanciation ironique partagées par le roman comique et la culture polygraphique, les travaux de Thierry Smolderen légitimeraient d’inscrire dans les programmes de Lycée la culture du roman arabesque et du récit excentrique, au XVIIIe et au XIXe siècle, en incluant les œuvres de Töpffer, Cham ou Doré. Ce serait là le signe d’un saut véritablement «post-légitime» dans l’appréhension du médium BD.
5. Conclusion
Les trois champs théoriques qui ont été mis en regard peuvent sembler relativement hermétiques les uns vis-à-vis des autres, en particulier celui de la recherche en éducation. Intuitivement, on pourrait penser à l’inverse qu’il existe socialement une logique descendante, qui va de la légitimation culturelle du médium à la connaissance savante de son langage et de son histoire, pour aboutir à son intégration scolaire. Mais en raison de logiques de scolarisation propres à la discipline (Chervel 1998; Denizot 2013; Raux 2019), la trajectoire scolaire de l’objet BD tend à se développer en parallèle de son histoire sociale, sans la recouper totalement. Par ailleurs, alors que l’on semble progresser vers une théorisation didactique du médium, jamais la plasticité culturelle de ce dernier n’est apparue aussi grande, du roman arabesque au jeu vidéo, bouleversant les catégories préexistantes à travers lesquelles l’objet était pensé. La notion de culture polygraphique ou encore de dispositif d’images en flux, pourrait à moyen terme faire apparaître comme daté le dispositif de la bande dessinée tel qu’il s’est stabilisé au XXe siècle sur support papier. A moins que cette muséification progressive soit précisément l’une des conditions culturelles et institutionnelles d’une intégration scolaire à venir plus forte encore. L’inscription d’une bande dessinée au programme de Lettres du baccalauréat constituerait sans doute une étape majeure en ce sens. Mais la recherche en didactique sur l’étude de la BD doit encore progresser, en s’intéressant en particulier à la lecture subjective, pour répondre aux besoins qui se feraient jour et accompagner favorablement les pratiques de classe.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bandes dessinées: sacrilège ou tremplin?», in Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. De Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 197-208.
Aquatias, Sylvain (2017), «La bande dessinée à l’école hier et aujourd’hui», Deuxièmes rencontres nationales de la bande dessinée, Angoulême. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.etatsgenerauxbd.org/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/2017_rencontres_nationales_bd_02_v00c2.pdf
Arsenault, Dominic (2006), Jeux et enjeux du récit vidéoludique: la narration dans le jeu vidéo, mémoire, Université de Montréal. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.le-ludophile.com/Files/Dominic%20Arsenault%20-%20Memoire.pdf
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n° 16. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/narratologie/974
Barthes, Roland (1982) «Arcimboldo ou Rhétoriqueur et Magicien», in L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil.
Baudry, Julien (2015), «Entretien jeune recherche en bande dessinée: Antony Rageul», Phylacterium. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.phylacterium.fr/?p=2162
Baudry, Julien (2012), Cases Pixels. Une histoire de la bande dessinée numérique en France, Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Bautier, Elisabeth, Jacques Crinon, Catherine Delarue-Breton & Brigitte Marin (2012), «Les textes composites: des exigences de travail peu enseignées?», Repères, n° 45, p. 63-79.
Bautier, Elisabeth & Jean-Yves Rochex (2007), «Apprendre: des malentendus qui font la différence», in Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, J. Deauvieau & J.-P. Terrail (dir.), Paris, La Dispute, p. 227-241.
Beaudoin, Isabelle, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Nathalie Lemieux, Martin Gendron (2015), «Consolider ses compétences de compréhension en lecture par la BD», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/consolider-ses-competences-de-comprehension-en-lecture-par-la-bd
Blanchard Marianne, Hélène Raux (dir.) (2019), «Usages didactiques de la bande dessinée», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 1er novembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/trema/4803
Boltanski, Luc, (1975), «La Constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, p. 37-59. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2448
Bomell-Rainelli, Béatrice & Alain Demarco (2011), «La BD au collège depuis 1995: entre instrumentalisation et reconnaissance d’un art», Le Français aujourd’hui, n° 172, p. 81-92.
Bonnéry, Stéphane (2007), Comprendre l’échec scolaire, Paris, La Dispute.
Bourdieu, Pierre (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, éditions de Minuit.
Bourdieu, Pierre (1992), Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littérature médiatique multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec.
Bruno, Pierre (1995), «La culture jeune», Le Français aujourd’hui, n° 111, p. 19-28.
Chervel, André (1998), La Culture scolaire: une approche historique, Paris, Belin.
Couégnas, Daniel (1992), Introduction à la paralittérature, Paris, Seuil.
Dacheux, Eric (2009), «La bande dessinée, art reconnu, média méconnu», Hermès, n° 54, p. 11-17.
Dardaillon, Sylvie (2009), «Quelle place pour l’iconotexte dans les pratiques des enseignants du cycle 3?» in La Littérature en corpus. Corpus implicites, explicites, virtuels, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Dijon, Scéren-CRDP de Bourgogne, p. 85-95.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires 1802-2010, Bruxelles, Bern & Berlin, Peter Lang.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: la place de la bande dessinée dans l’enseignement, Syndicat national de l’édition. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL:https://www.sne.fr/app/uploads/2019/02/SNE-PictureThis_etat-des-lieux-BD-ecole_janv2019_2.pdf
Queffélec-Dumasy, Lise (1997), «De quelques problèmes méthodologiques concernant l’étude du roman populaire», in Problèmes de l’écriture populaire au XIXe siècle, R.Bellet & Ph. Régnier, Limoges, Pulim, p. 229-266.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Garnier.
Eco, Umberto (1972), La Structure absente, Paris, Mercure de France.
Eco, Umberto (1970), «Sémiologie des messages visuels», Communications, n° 15, p. 11-51.
Eco, Umberto (1964), Apocaliticci e integrati. Communicazioni di massa e theori della cultura di massa, Milan, Bompiani.
Eisner, Will (1985), Comics and Sequential Art, Tamarac, FL, Poorhouse Press.
Evans, Christophe (2015), «Profils de lecteurs, profils de lecture », in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, éditions de la Bibliothèque publique d’information, p. 17-44.
Fourtanier, Marie-José (2013), «Lire et faire lire des œuvres littéraires adaptées en BD: "ravauder" le patrimoine ou l’inventer?», in Les Patrimoines littéraires à l’école, S. Ahr & N. Denizot (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 33-50.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1972), La Bande dessinée. Essai d’analyse sémiotique, Paris, Hachette.
Frezza, Gino (1999), Fumetti, anime del visibile, Roma, Meltemi.
Gabilliet, Jean-Paul (2005), Des Comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États-Unis, Nantes, éd. du Temps.
Garric, Henri (dir.) (2013), L’Engendrement des images, Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Garric, Henri (2014), «Ce que la bande dessinée pense de la littérature: à propos de gemma Bovery de Posy Simonds», Neuvième Art 2.0. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article806
Gaudreault, André & Thierry Groensteen (dir.) (1998), La transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip, Quebec & Angoulême, Editions Nota Bene / CNBDI.
Gaujal, Sophie (2020), «Géo-graphier», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 111-118.
Goujon, Catherine (2020), «La bande dessinée dans les écrits scientifiques en sciences de l’éducation, un cas en didactique des sciences», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 26-31.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (2006), La bande dessinée, un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Hache, Christophe & Marianne Moulin (2020), «Codage d’album et activité mathématique?», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 82-85.
Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 10-15.
Hesse-Weber, Armelle (2017), «Du théâtre à la bande dessinée », Pratiques, n° 175-176. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/pratiques.3617
Huynh, Jeanne-Antide (1991), «La synthèse de documents», Le Français aujourd’hui, n° 96, p. 26-35.
Ingulsrud, John E. & Kate Allen (2009), Reading Japan Cool. Patterns of Manga Literacy and Discourse, Lanham, Lexington Books.
Ito, Mizuko (2008), «Mobilizing the Imagination in Everyday Play: The Case of Japanese Media Mixes», in International Handbook of Children, Media and Culture, D. Livingstone & K. Drotner (dir.), New York, Sage. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.itofisher.com/mito/publications/mobilizing_the.html
Kaufmann, Judith (1983), «Astérix, humour pictural et verbal», Cahier comique et communication, n°1, p. 67-109.
Kunzle David (1990), History of the comic strip, vol. 2, The ninetheenth century, Berkeley, University of California Press.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec, p. 125-140.
Lacelle, Nathalie & Monique Lebrun (2015), «L’écriture transmédiatique dans le processus s’appropriation d’univers narratifs», in Les Formes plurielles des écritures de la réception, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 237-257.
Langlade, Gérard (2004), «Le sujet lecteur auteur de la singularité de l’œuvre», in Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, A. Rouxel & G. Langlade (dir.), Rennes, PUR, p. 81-91.
Louichon, Brigitte (2012) «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.
Lunning, Frenchy (dir.) (2010), Fanthropologies, Minneapolis, University of Minessota Press.
Jenkins, Henry (2006), Convergence culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press.
Lefèvre, Pascal (2007), «Incompatible Visual Ontologies: The Problematic Adapatation of Drawn Images», in Film and Comic Books, I. Gordon, M. Jancovitch & M. McAllister (dir.), Jackson, University Press of Mississippi.
Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée: les éditeurs franco-belges et l’album, 1950-1990, Lyon, Presses de l’Enssib.
Lesage Sylvain (2019), «Une bande dessinée adulte? Usages et mésusages de la légitimation», Belphégor, n° 17 (1). En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http: //journals.openedition.org/belphegor/1607
Louichon, Brigitte (2012), «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.
Louichon, Brigitte (2008), «Enquête sur le rapport des enseignants aux programmes de 2002 et les pratiques d’enseignement de la littérature au cycle 3», Repères, n°37, p. 51-68. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.420
McCloud, Scott (1993), Understanding Comics. The Invisible Art, Northampton, Tundra Publishing.
Maigret, Eric (2015), «La bande dessinée dans le régime du divertissement: reconnaissance et banalisation d’une culture», in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Editions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://books.openedition.org/bibpompidou/1677
Maigret Eric (2012a), «Théories des bandes débordées», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 50-70.
Maigret Eric (2012b), «bande dessinée et postlégitimité», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 130-148.
Maigret, Eric (1994), «La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée», Réseaux, n° 67, p. 113-140. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1994_num_12_67_2742
Maigret Eric, Matteo Stefanelli (dir.) (2012), La Bande dessinée: une médiaculture, Paris, Armand Colin.
Marion, Philippe (1993), Traces en cases, Louvain-la-Neuve, Académia.
Martel, Virginie & Jean-François Boutin (2015), «Intégrer la lecture multimodale et critique en classe d’histoire: étude de cas exploratoire», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2015-v1-rechercheslmm03759/1047801ar.pdf
Massol, Jean-François & Gersende Plissonneau (2008), «La littérature lue en 6e et 5e: continuités et progressions», Repères, n° 37, p. 69-103. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.422
Méon, Jean-Matthieu (2015), «Bande dessinée: une légitimité sous condition», Informations Sociales, n° 190 (4), p. 84-91.
Mitaine Benoît, David Roche & Isabelle Schmitt-Pitiot (dir.) (2015), Bande dessinée et adaptation (littérature, cinéma, TV), Clermont-Ferrand. Presses universitaires Blaise Pascal.
Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Éditions de l’An 2.
Morgan, Harry (2012), «De l’éradication de "l’illustré gangster" à l’analyse de bandes dessinées en classe (1929-2009): ruptures et continuité», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 55-77.
Nakazawa, Jun (2005), «Development of manga (Comic Book) Literacy in Children », in Applied Developmental Psychology. Theory, Practice and Research from Japan, D, W. Schwalb, J. Nakazawa & B. Schwalb (dir.), Charlotte, Information Age Publishing.
Ory, Pascal, Laurent Martin, Jean-Pierre Mercier & Sylvain Venayre (2012), L’Art de la bande dessinée, Paris, Citadelle & Mazenod.
Polo, Claire & Rouvière, Nicolas (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51, p. 166-190.
Rageul, Anthony (2014), La bande dessinée saisie par le numérique: formes et enjeux du récit reconfiguré par l’interactivité, thèse de doctorat, Université Rennes 2.
Raux, Hélène (2019), La Bande dessinée en classe de français: un objet disciplinaire non identifié, thèse de doctorat, Université de Montpellier.
Reuter, Yves (1986), «Les Paralittératures: problèmes théoriques et pédagogiques», Pratiques, n° 50, p. 3-21.
Robert, Pascal (2016), Bande dessinée et numérique, Paris, CNRS éditions.
Rostam, Marion (2013), «Naissance d’un imaginaire graphique dans L’Ascension du Haut Mal de David B.», in L’Engendrement des images, Garric H. (dir.), Tours, Presses Universitaires François Rabelais, p. 19-41.
Rouvière, Nicolas (2017), «Adapter en classe des extraits de roman sous forme de BD: quels apports pour la lecture littéraire?», Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale, n° 6. En ligne, consukté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/adapter-en-classe-des-extraits-de-roman-sous-forme-de-bd-quels-apports-pour-la-lecture-litteraire
Rouvière, Nicolas (2015), «Produire des planches pour apprendre à lire la BD: quelques dispositifs et leurs effets dans des classes de cycle 3», Revue de Recherches En Littératie Médiatique Multimodale, n° 1. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.7202/1047792ar
Rouvière, Nicolas (2014), Le Complexe d’Obélix, Paris, PUF.
Rouvière Nicolas (dir.) (2012a), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, Ellug,
Rouvière Nicolas (2012b), «Étudier une œuvre intégrale en bande dessinée au cycle 3: quelles spécificités didactiques?», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 103-121.
Rouvière, Nicolas (2008a), «L’influence de la bande dessinée sur les albums pour enfants: histoire, esthétique et thématiques», Modernités, n° 28, p. 17-28.
Rouvière, Nicolas (2008b), «Adapter les classiques. Présentation de la collection "les grandes aventures racontées aux enfants"», Les Cahiers de Lire écrire à l’Ecole, n° 2, p. 45-65.
Rouvière, Nicolas (2006), Astérix ou les lumières de la civilisation, Paris, PUF.
Stefanelli, Matteo (2012), «Un siècle de recherches sur la bande dessinée», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 17-49.
Smolderen, Thierry (2009), Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à Winsor McCay, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
Smolderen, Thierry (2012), «Histoire de la bande dessinée: questions de méthodologie», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 71-90.
Taylor, Laurie (2004), «Compromised Divisions, Thresholds in Comic Books and Video Games», ImageText, n°1 (1). En ligne, consulté le 28 août 2021, URL: http://www.english.ufl.edu/imagetext/
Tisseron, Serge (2000), Psychanalyse de la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Tisseron, Serge (1993), Tintin et le secret de Hergé, Paris, Hors collection.
Pour citer l'article
Nicolas Rouvière, "Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021http://www.transpositio.org/articles/view/quelle-didactique-pour-la-bande-dessinee-retour-sur-trois-tournants-theoriques-de-la-decennie-2010-2020
Voir également :
Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
Si la reconnaissance de la valeur culturelle de la bande dessinée, durement conquise au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui acquise{{Rappelons, au niveau de la reconnaissance institutionnelle, que le ministère de la culture en France a décrété l’année 2020 «année de la bande dessinée». Sur cette phase de «post-légitimation», voir notamment (Berthou 2017; Heinich 2019). Notons néanmoins qu’en dépit de ces honneurs, de nombreux·ses auteur·e·s et éditeurs·trices insistent sur le fait que leur profession est menacée de paupérisation, notamment en raison d’une surproduction saturant le marché et du manque de soutien institutionnel, ce qui a récemment conduit Lewis Trondheim à renvoyer au ministère la médaille de chevalier des arts et lettres qui lui avait été attribuée en 2005.}}, sa place au sein des programmes scolaires reste malgré tout fragile, ce qui a amené récemment Flore Steyaert et Jean-Louis Tilleul (2017: 233) à conclure que l’école restait «un caillou dans le soulier de la légitimation» de ce médium{{Cette publication est liée au projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique: "Pour une théorie du récit au service de l'enseignement" (Projet FNS n° 100019_197612 / 1).}}.
Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
Enseigner la bande dessinée dans un monde qui avance
Si la reconnaissance de la valeur culturelle de la bande dessinée, durement conquise au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui acquise1, sa place au sein des programmes scolaires reste malgré tout fragile, ce qui a amené récemment Flore Steyaert et Jean-Louis Tilleul (2017: 233) à conclure que l’école restait «un caillou dans le soulier de la légitimation» de ce médium2. Pour envisager le type de résistance que peut rencontrer la bande dessinée quand il s’agit de l’étudier en classe, il peut être intéressant d’envisager les choses sous l’angle, non pas des prescripteurs et des enseignant·e·s, mais sous celui des auteur·es et des représentations des élèves. Dans son dernier album –que l’on peut qualifier de roman graphique ou d’autofiction en bande dessinée– l’auteur genevois Frederik Peeters met en scène son avatar, Oleg, lors d’une intervention en classe qui, précise-t-il, est le «moyen qu’il a trouvé pour rester connecté avec le monde qui avance» (Peeters 2021: n.p.).
 Image 1: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 1: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Lorsque l’enseignante demande aux élèves si quelqu’un a une question à lui poser, Oleg se heurte d’abord à un mur de silence. L’enseignante recadre un élève endormi, qui explique, pour justifier son état comateux, avoir «regardé la nouvelle saison de "Titans"» la nuit précédente3. La plupart des questions posées à l’auteur concernent ensuite la longueur du labeur aboutissant à la création d’un album et le profit qui se dégage de cette activité. Lorsqu’Oleg répond que la réalisation de son album lui a pris à peu près une année, une élève réagit en disant «c’est trooop looong». Oleg répond qu’il pense être, au contraire, plutôt rapide et demande à l’élève combien de temps il lui a fallu pour lire son album. Elle répond «quinze minutes», expliquant qu’elle n’a lu en réalité que les premières pages, et Oleg découvre ainsi que seulement deux élèves de la classe ont lu son œuvre dans son intégralité.
 Image 2: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 2: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Cette confrontation avec le «monde qui avance» souligne plusieurs aspects de l’évolution récente de la bande dessinée et de ses rapports à l’enseignement. Premièrement, la posture d’Oleg et son décalage vis-à-vis des représentations de plusieurs élèves soulève la question d’une polarisation de la production qui s’est opérée au sein du champ de la bande dessinée à partir de la fin des années 19604 et de ses effets sur la manière de lire les récits graphiques dans et hors de la classe. Le premier pôle renvoie à l’autonomie créative d’un artiste publiant ses œuvres chez des éditeurs indépendants ou issus du champ littéraire. Peeters est par exemple édité chez Gallimard, à l’Association ou chez Atrabile, éditeur indépendant genevois dont il est cofondateur, et il dispose ainsi d’un contrôle étendu sur la thématique, le style et le format de ses récits graphiques. Il faut relever par ailleurs qu’il n’est plus irréaliste d’imaginer qu’un auteur correspondant au profil de Frederick Peeters / Oleg puisse être invité dans une classe de français pour parler de son œuvre, à l’instar d’un écrivain. En l’occurrence, quand l’enseignante présente l’auteur, elle évoque un «prix BD des écoles5», ce qui témoigne également du gain de légitimité au sein des institutions scolaires. Cette liberté implique en revanche un mode de production artisanal et très chronophage, dans lequel un auteur «complet» réalise peu ou prou toutes les tâches, ce qui lui assure un revenu instable essentiellement lié à la gestion de ses droits6.
Le second pôle renvoie aux industries culturelles visant une accélération de la production fondées sur une standardisation des produits et sur la division du travail et l’anonymisation des créateurs, lesquels ne disposent plus que d’une liberté très limitée7. Aujourd’hui, le type de bandes dessinées le plus largement diffusé parmi les jeunes sont des produits émanant de grands groupes industriels, à l’instar de Disney, de Sony ou de Média Participations, qui intègrent différents supports médiatiques et coordonnent les activités de milliers d’employés. Et évidemment, au sommet de ces empires médiatiques, certains auteurs historiques, comme Hergé, Zep ou Stan Lee, peuvent accumuler des fortunes considérables. Bounthavy Suvilay et Edith Taddei (2019) rappellent par ailleurs que les bandes dessinées les plus largement consommées par les jeunes se rattachent aujourd’hui au genre importé du manga, qui a connu ces dernières années un essor phénoménal, soutenu par la diffusion sur les chaines en streaming d’adaptations sous forme d’anime.
Si la bande dessinée dans son ensemble a donc visiblement conquis ses lettres de noblesse, les œuvres valorisées par le monde de l’éducation semblent ainsi de plus en plus déconnectées des œuvres appartenant pleinement à la culture «juvénile» (Mitrovic 2019), ici incarnée par une série télévisée adaptée d’un univers créé par DC comics. La réaction de l’élève quant à l’état du compte en banque d’Oleg est prise par ce dernier comme peu pertinente, parce qu’à ses yeux, l’élève se trompe de pôle, confondant un auteur appartenant au champ de production restreinte avec un créateur travaillant à une échelle industrielle. Mais au-delà de la méprise, voire du mépris que l’on serait tenté d’adopter devant une question si triviale, se cache une réalité socioculturelle dont l’élève se fait ici le témoin précieux: le fait que lui, comme vraisemblablement la majorité de ses camarades, n’est exposé qu’au second de ces deux pôles et qu’il n’envisage pas l’existence d’une culture autonome, centrée sur l’individu producteur et héritée du XIXe siècle. Il n’a finalement en face de lui qu’un adulte actif parmi d’autres, au sein d’une société où la réussite individuelle se mesure à l’argent que l’on gagne.
En somme, la scolarisation de la bande dessinée est évidemment liée à «l’artificationde la bande dessinée» (Heinich 2017), mais la «légitimité culturelle» (Berthou 2017) dont jouit une partie de la production éloigne d’autant les corpus enseignés des représentations ordinaires que se font les élèves du médium, ce qui ne manque pas de produire des malentendus et des difficultés dans l’émergence d’une lecture de la bande dessinée que l’on pourrait qualifier de littéraire, au sens que les didacticiens donnent de ce terme (Dufays, Gemenne & Ledur 2005; Ronveaux & Schneuwly 2018). Ce que montrent les réactions de la plupart des élèves dans cet extrait, c’est que ces derniers assimilent la bande dessinée à une forme de culture populaire – à l’instar des mangas et des comics qui peuplent leur bibliothèque intérieure – et que cela induit des questionnements orientés sur des enjeux essentiellement économiques ou professionnels, au lieu d’adopter des gestes de lecture qui se seraient sédimentés dans la pratique scolaire du commentaire des textes littéraires. Ce faisant, l’entrée de la bande dessinée dans la classe de français, d’une part, ne produit pas forcément un rapprochement entre lectures scolaires et lectures privées (Norton 2003; Mitrovic 2019; Suvilay & Taddei 2019) et d’autre part, ne débouche pas nécessairement sur la pratique d’une lecture susceptible de renforcer le développement d’une littératie médiatique multimodale (Boutin 2012).
Le rappel de cette dualité explique que, face à cette forme d’expression que Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019) définissent – à la suite de Thierry Groensteen (2006) – comme un «objet didactique mal identifié», les angles interprétatifs peuvent diverger sensiblement en fonction du statut qui est accordé à l’œuvre commentée. L’entrée de la bande dessinée dans la classe de français ne pose donc pas seulement la question de son identité médiatique, mais également celle de son statut culturel et des angles de lecture qui en découlent. Peut-on considérer la bande dessinée comme une forme de littérature? Ces questions, inlassablement posées depuis une vingtaine d’années (Morgan 2003; Chute 2008; Meskin 2009; Baetens 2009; Dürrenmatt 2013) ne doivent donc pas être comprises uniquement en termes généraux et médiatiques mais également en termes locaux et critiques. Pour rendre les enjeux plus explicites, il faudrait commencer par poser les questions suivantes: peut-on lire en classe certaines bandes dessinées comme on lirait des romans ou des pièces de théâtre? peut-on poser aux récits graphiques le même genre de questions que l’on poserait à des œuvres littéraires? peut-on étudier ces compositions de textes et d’images selon des procédures similaires à celles que l’on mobilise face à la représentation verbale ou scénique d’une histoire?
Il s’agirait ensuite d’anticiper une éventuelle réponse positive à ces questions pour qu’apparaisse une problématique secondaire: si cette lecture est possible, c’est probablement parce que l’on se refuse encore à envisager l’institutionnalisation de la bande dessinée dans le cadre scolaire sous un angle qui engloberait le caractère industriel et commercial d’une partie non négligeable de ses manifestations. Et qu’un tel refus risque de reconduire une forme sociologiquement induite d’inégalité parmi les élèves, en particulier en termes de cadrage des activités (Rochex & Crinon 2014), dont la séquence d’enseignement reproduite ici par Peeters semble relativement dépourvue. Oleg ou l’enseignante auraient pourtant pu profiter de cette question, qui n’est impertinente qu’en apparence, pour mentionner l’existence de différents types de produits culturels rattachables au média «bande dessinée» et expliciter les différences de nature existant entre ces produits en ce qui regarde la liberté dont disposent les créateurs, laquelle ne garantit nullement la qualité finale de l’objet. Cela aurait aussi permis de signaler l’existence d’œuvres populaires nées d’un compromis entre les contraintes d’une production industrielle plus ou moins formatée et la réputation de génies qui s’attache à certains auteurs formant un panthéon historique, à l’instar d’Osamu Tezuka, de Jack Kirby, d’Hergé ou de la paire René Goscinny et Albert Uderzo, qui a enfanté une œuvre pharaonique: 380 millions d’albums vendus dans le monde, plusieurs blockbusters cinématographiques, un parc d’attraction, etc.
Les conditions matérielles de production ne devraient ainsi jamais être complètement évacuée d’un enseignement centré sur l’histoire et l’esthétique de la bande dessinée, l’émergence et l’évolution de ce média relativement jeune étant consubstantiellement liées à l’essor de la presse imprimée et des logiques sérielles qui en découlent et sous-tendent encore la plupart des productions, même les plus auteuristes. Même les auteur·e·s indépendant·e·s ne peuvent survivre en se privant totalement des circuits de production et de diffusions traditionnels, et le positionnement de leurs œuvres ne peut se comprendre qu’en lien étroit avec les formes et les thèmes développés par les industries culturelles, ainsi qu’en témoigne la récurrence des motifs superhéroïques dans les œuvres de Chris Ware ou de Daniel Clowes.
Oleg se montre néanmoins reconnaissant lorsqu’une élève lui adresse enfin une question qu’elle aurait très bien pu poser à Flaubert, à Maupassant… ou à Houellebecq: quelle place donnez-vous à l’actualité du monde dans votre travail? Est-ce que vous hésitez entre faire des histoires intemporelles et des histoires réalistes? La question suppose évidemment que l’auteur dispose de suffisamment d’autonomie pour envisager ces différentes options et choisir celle qui correspond le mieux à son projet artistique. Le roman graphique de Frederik Peeters est enfin abordé sous l’angle de sa littérarité et non sous l’angle unique de son statut d’objet culturel rattaché à l’industrie des loisirs. S’ouvre alors la possibilité d’une véritable disciplination de la bande dessinée par son rattachement à la pratique de la lecture littéraire telle qu’elle s’est sédimentée dans les pratiques scolaires (Ronveaux & Scheuwly 2018).
 Image 3: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 3: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
La bande dessinée d’auteur et sa lecture scolaire
Jan Baetens avance que «la rencontre des domaines longtemps séparés de la littérature et de la bande dessinée» s’impose aujourd’hui «comme une évidence» (2009: §1), ce dont témoigne, entre autres, l’explosion des adaptations de classiques en bande dessinée, mais aussi l’émergence d’un genre identifié comme «roman graphique» et son accession à des prix littéraires prestigieux. Toutefois, Baetens souligne le risque de confondre cette rencontre avec une forme de fusion ou d’hybridation:
Une chose est l’explosion des croisements entre littérature et bande dessinée, autre chose est le bien-fondé ou la solidité de cette nouvelle hybridité, qui ne manque pas de soulever plus d’une question essentielle sur notre conception même du récit. (Baetens 2009: §1)
Si l’on exclut les adaptations ne servant que de marchepied pour accéder aux œuvres vraiment littéraires, les bandes dessinées enseignées dans les classes de français comme de la littérature sont plutôt rares et les mêmes titres ne cessent de revenir dans les discours des chercheur·euse·s, didacticien·ne·s, enseignant·e·s: Maus, Persepolis, Pilules bleues, Fun Home… Ce retour inlassable d’un corpus d’œuvres restreint témoigne d’une part de la difficulté d’établir un périmètre élargi de récits graphiques dignes d’être enseignés en classe comme de la littérature. La patrimonialisation des œuvres passant généralement par leur inscription dans les corpus scolaires, pour le meilleur ou pour le pire, on peut dès lors considérer que l’école n’a pas encore joué son rôle de sélection des œuvres supposément légitimes, le choix des enseignant·e·s se repliant sur la bibliothèque intérieure correspondant à leurs lectures privées liées à l’enfance et à l’adolescence8 (donc souvent liées à des œuvres populaires) ou sur quelques succès critiques validés par des prix ou des récompenses, avec le fameux Pulitzer pour Art Spiegelman, bien sûr, mais aussi le prix du jury du Festival de Cannes pour l’adaptation cinématographique de l’œuvre de Marjane Satrapi. On peut donc anticiper sur cette sélection en considérant la possibilité qu’elle se calque sur une légitimité dont elle emprunte les caractéristiques sociologiques à la littérature, sans tenir compte des spécificités médiatiques du champ de production de la bande dessinée.
Par ailleurs, si le statut culturel acquis par certaines œuvres font de la bande dessinée un objet certes mal identifié mais au moins potentiellement enseignable, il ne faut pas négliger les problèmes inhérents à la disciplination des gestes de lecture spécifiques, aussi bien du côté de l’enseignant que de celui des élèves9, ce qui passe par l’intégration de pratiques compatibles avec la conception que l’on peut se faire d’un enseignement de la littérature, mais aussi par l’établissement de procédures nouvelles, adossées aux caractéristiques sémiotiques du support. Outre le problème du rattachement des œuvres à un média populaire, qui complexifie le cadrage interprétatif des enseignant·e·s et des apprenant·e·s, le mélange de textes et d’images dessinées pose ainsi un problème qui se reflète dans les hésitations des plans d’étude: faut-il rattacher la bande dessinée à l’histoire de l’art ou à la classe de français? Comment traiter à la fois le style graphique des dessins, la composition de la case et celle de la planche, le découpage de l’action, les effets de cadrage, le contrastes des couleurs, tout en liant ces aspects au développement du récit, aux jeux sur la focalisation et le point de vue, aux dialogues et aux récitatifs, alors que la formation initiale des enseignant·e·s de français ne les a généralement guère préparé·e·s à traiter ces aspects simultanément.
Ainsi que l’ont montré Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), le chemin est encore long pour former les enseignant·e·s à des gestes interprétatifs susceptibles d’intégrer ces différentes dimensions, sans pour autant tomber dans un répertoire de notions techniques déconnectées des enjeux esthétiques ou éthiques soulevés par la lecture de l’œuvre, et sans se méprendre sur la complexité inhérente à un médium à la fois textuel et graphique. L’objectif de ce numéro est précisément de contribuer à développer des pistes de réflexions relatives à l’ensemble de ces aspects, d’abord en lien avec l’histoire du médium et de sa scolarisation, puis orienté sur différentes propositions didactiques et observations en classe.
La première partie, qui s’inscrit dans une perspective historique, s’ouvre sur un article de Nicolas Rouvière exposant la situation actuelle de la bande dessinée, qui est entrée depuis une dizaine d’années dans une phase que l’on peut définir comme celle d’une «post-légitimation». Si cette nouvelle manière d’envisager le média devrait lui ouvrir les portes de l’enseignement aux différents niveaux de la scolarité, elle pousse aussi Rouvière à dresser le constat d’un déficit de «théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe», ce qui souligne l’importance de renforcer la recherche dans ce domaine. Cette théorisation apparait d’autant plus importante que les matérialisations médiatiques des récits graphiques ne cessent de se complexifier dans la culture numérique contemporaine, brouillant les frontières entre bande dessinée, jeu vidéo, dessin animé ou série télévisée.
L’article suivant offre un survol historique beaucoup plus large des relations tumultueuses entre la bande dessinée et les institutions scolaires, en suivant la piste des instructions officielles en France de manière à mettre en lumière, depuis les années 1960, la place réservée aux récits graphiques dans les programmes scolaires. Sophie Béguin illustre cette trajectoire scolaire qui, en effet, semble en partie déconnectée des enjeux entourant la légitimation culturelle du médium. Les hésitations portent non seulement sur les titres ou le nombre d’œuvres préconisés par les instructions officielles, mais également sur le rattachement disciplinaire de l’étude de la bande dessinée. Enfin, si la scolarisation du médium ressemble à une série de rendez-vous manqués, Béguin montre que c’est aussi en raison d’une certaine méfiance émanant des milieux de la bande dessinée, certain·e·s de ses représentant·e·s craignant les effets de la scolarisation d’un objet qu’ils·elles préfèrent ranger dans le domaine de la contre-culture et de la subversion.
Le troisième article de cette partie historique envisage la place de la bande dessinée vis-à-vis de l’enseignement du français langue étrangère, à travers l’analyse d’un corpus de manuels publiés entre 1919 et 2020. Son auteure, Anick Giroud, soulève un intéressant paradoxe: alors que le potentiel didactique des images narratives pour l’enseignement des langues est très tôt reconnu, avec l’émergence des méthodes directes au début du XXe siècle, puis, de manière encore plus marquée, avec l’éclosion des méthodes audio-visuelles, communicatives et actionnelles, la place de la bande dessinée en tant que document authentique est restée très modeste. La grande majorité des récits graphiques insérés dans les manuels demeure donc le travail d’illustrateurs·trices, produisant des objets sur mesure, adaptés aux objectifs de la leçon, mais dépourvus de valeur culturelle. Face à ces documents forgés, les modalités d’une lecture littéraire apparaissent impossibles, et la valeur culturelle du médium singulièrement diminuée.
La partie suivante réunit trois propositions didactiques adossées à des œuvres dont la réputation littéraire est fortement établie, du Maus d’Art Spiegelman au Persepolis de Marjane Satrapi, en passant par l’incontournable Fun Home d’Alison Bechdel. Si le choix de ces œuvres oriente naturellement l’exploitation didactique vers un horizon esthétique et culturel, les trois articles mettent également en évidence les spécificités d’une littérature dessinée et montrent comment exploiter cette dimension graphique.
La proposition de Violeta Mitrovic articule la lecture de trois «mémoires graphiques» (Fun Home, Persepolis et Wonderland de Tirabosco) dans la perspective de leur enseignement au post-obligatoire. En insistant sur la richesse et l’épaisseur des possibilités interprétatives de ces œuvres, elle se sert de leur caractère profondément multimodal pour convoquer la possibilité effective d’une lecture littéraire, au sens élargi de ce terme, dans lequel elle rassemble et interroge les notions de participation et de distanciation, de littératie, de lectures «ordinaire» et «savante», sans oublier de faire valoir la spécificité du médium comme vecteur d’acquisition de compétences nouvelles.
Gaspard Turin, dans une contribution portant sur la didactisation de Maus, propose une approche pragmatique face à une œuvre à la fortune critique si importante qu’elle pourrait en paraître hors de portée pour de jeunes lecteurs. En cherchant à rendre à l’œuvre une forme de simplicité, induite par le traitement zoomorphique de ses personnages, il n’en oublie pas moins que cette simplicité ne sert qu’à dialoguer avec la complexité d’une œuvre grave et dont l’enjeu de lecture devient dès lors celui d’un questionnement à étages multiples. Faire lire Maus à des adolescent·e·s revient-il à les forcer dans un monde adulte? Ou plutôt à envisager un dialogue avec les modalités d’appréhension du monde propres à l’enfance?
Enfin Camille Schaer s’attache, elle aussi, à assigner à la lecture de la bande dessinée en classe des enjeux portant sur la littératie et sur les compétences qui lui sont associées. Elle choisit pour sa part d’insister sur les spécificités du médium par rapport à la littérature ordinairement enseignée à l’école, afin de faire reconnaître une «tension entre linéarité et mise en réseau des informations». Cette mise en réseau l’incite à porter un regard neuf sur le livre en tant qu’objet, comme en témoigne son attention au paratexte. Il s’agit enfin, pour elle, par le biais des œuvres sélectionnées (Persepolis d’une part et Les Coquelicots d’Irak, de Findakly et Trondheim, de l’autre) d’ouvrir les élèves aux subtilités de l’autobiographie dessinée.
La dernière partie envisage l’enseignement de la bande dessinée sous un angle plus empirique, informé par des observations en classe, de sorte que les articles éclairent les vertus, mais aussi les obstacles inhérents à une lecture littéraire de la bande dessinée dans différents degrés de la scolarité.
Dans sa contribution, Hélène Raux interroge le «présupposé de facilité» qui accompagne le traitement scolaire de la bande dessinée pour montrer que la lisibilité du médium ne va pas de soi et qu’il doit s’accompagner d’un étayage en classe, fondé sur l’enseignement des codes propres à la lecture des récits graphiques. Des exemples de terrain suggèrent que la compréhension des logiques présidant à l’enchaînement des cases n’a rien d’un acquis pour les élèves observés, et que le déficit de compréhension ou de reformulation se présente plus volontiers dans le cadre de la lecture des images que de celle du texte. L’accent est mis, en conclusion, sur la nécessité de renforcer des approches didactiques orientées sur ces aspects et de réorienter le regard des élèves face à un médium souvent considéré par eux, a priori, comme destiné aux enfants.
L’article de Jean-François Boutin et Virginie Martel s’intéresse quant à lui aux modalités de la lecture de bandes dessinées historiques, en suivant treize parcours de lecture d’élèves du secondaire et du primaire. Les auteurs s’attachent à creuser en particulier la question des rapports entre le passé et sa reconfiguration par les récits graphiques, tout en tenant compte de la multimodalité du support. Pour poser les bases d’une lecture dialectique, permettant de rendre compte de «l’historisation de la fiction et [de] la fictionnalisation de l’histoire» (Gallego 2015: 5), les auteur·e·s préconisent de porter l’attention des lecteurs·trices sur la dimension multimodale et les stéréotypes propres au champ de la bande dessinée.
Si la bande dessinée demande encore à être enseignée, elle demande aussi, plus vivement peut-être, à être didactisée. Mais au-delà de ces questions, elle demande aussi à être interrogée dans ses rapports à l’institution scolaire et aux rapports que cette institution entretient avec ce «monde qui avance», ou qui semble parfois stagner, voire reculer… et dont, malgré ses richesses, la bande dessinée n’est encore qu’une manifestation marginale. Il suffit de courir le risque d’ouvrir ce champ culturel à des élèves pour réaliser à quel point son objet reste «non identifié», ou indexé à des codes culturels, économiques et sociétaux auxquels la bande dessinée «comme littérature» peine encore à se confronter. Tout reste à faire donc, dans ce champ. Les travaux réunis ici cherchent à en proposer une exploration que l’on espère enthousiasmante, mais ils ne pourront en aucun cas se substituer aux pratiques d’enseignement, informées ou improvisées, que nous engageons nos lecteurs·trices à tenter, à poursuivre et à partager.
Bibliographie
Aquatias, Sylvain (2015), «Le goût de la bande dessinée: acquisitions, transmissions, renforcements et abandons», in La bande dessinée: quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 24 septembre 2021, DOI: 10.4000/books.bibpompidou.1675
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n°16, en ligne, consulté le 28 août 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.974
Berthou, Benoît (2017), «Une nouvelle légitimité culturelle. Le cas de la bande dessinée», in Le Statut culturel de la bande dessinée, Ahmed Maaheen, Stéphanie Delneste & Jean-Louis Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 221-232.
Blanchard, Marianne & Hélène Raux (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 6 août 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818
Boltanski, Luc (1975), «La constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1 (1), p. 37-59.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littératie multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 33-44.
Chute, Hillary (2008), «Comics as Literature? Reading Graphic Narrative», PMLA, n° 123, p. 452-465.
Chute, Hillary (2020 [2008]), «La bande dessinée est-elle de la littérature? Lire les récits graphiques», Transpositio. En ligne, consulté le 20 août 2021, URL: http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2005), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier.
Gallego, Julie (dir.) (2015), La bande dessinée historique. Colloque international - Premier cycle: l’Antiquité, Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Ardour.
Groensteen, Thierry (2006), Un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.
Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 5-9.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (2014), «Disciplinarisation et disciplination consubstantiellement liées. Deux exemples prototypiques sous la loupe: les sciences de l’éducation et les didactiques des disciplines», in Disziplin - Discipline, Balz Engler (dir.), Fribourg, Academic Press, p. 27-46.
Lacassin, Francis (1971), Pour un neuvième art, la bande dessinée, Paris, Union générale d’édition.
Meskin, Aaron (2009), «Comics as Literature?», The British Journal of Aesthetics, n° 49, p. 219-239.
Mitrovic, Violeta (2019), «Se rapprocher de la culture juvénile par l’usage du roman graphique autobiographique au lycée», Le français aujourd’hui, n° 207, p. 67-77. En ligne, consulté le 17 février 2020. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2019-4-page-67.htm
Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Editions de l'an 2.
Norton, Bonnie (2003), «The Motivating Power of Comic Books: Insights from Archie Comic Readers», The Reading Teacher, n° 57 (2), p. 140-147.
Peeters, Frederik (2021), Oleg, Genève, Atrabile.
Rochex, Jean-Yves & Jacques Crinon (dir.) (2014), La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs d’enseignement, Rennes, PUR «Paideia».
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (dir.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Roux, Antoine (1970), La bande dessinée peut être éducative, Paris, Éditions de l’École.
Steyaert, Florie & Jean-Louis Tilleul (2017), «La bande dessinée à l’école. Un caillou dans le soulier de la légitimation», in Le Statut culturel de la bande dessinée, Ahmed Maaheen, Stéphanie Delneste & Jean-Louis Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 233-268.
Suvilay, Bounthavy & Edith Taddei (2019), «Les mangas: faire entrer les lectures privées à l’école et les constituer en objets littéraires», Le français aujourd’hui, n° 207, p. 79-91. En ligne, consulté le 17 février 2020.
URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2019-4-page-79.htm
Pour citer l'article
Raphaël Baroni & Gaspard Turin, "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021http://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-4-enseigner-la-bande-dessinee-comme-de-la-litterature
Voir également :
Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page
Sur la base de l’analyse de l’organisation des planches que l’on rencontre au fil de l’album Le Long Voyage de Léna de Pierre Christin et André Juillard, cet article visera à montrer comment il est possible de décrire et d’interpréter l’architecture des planches d’un récit graphique{{Cette réflexion a été développée dans le cadre du projet Sinergia «Reconfiguring Comics in our Digital Era», financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS: CRSII5_180359).
Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page
La dimension tabulaire de la bande dessinée: de la théorie à l’enseignement… et retour
Sur la base de l’analyse de l’organisation des planches que l’on rencontre au fil de l’album Le Long Voyage de Léna de Pierre Christin et André Juillard, cet article visera à montrer comment il est possible de décrire et d’interpréter l’architecture des planches d’un récit graphique1. Je commencerai par souligner l’importance, pour la didactique de la bande dessinée, de disposer d’un outillage conceptuel permettant d’identifier différents prototypes de mise en page, tout en soulignant les lacunes observables en ce domaine. Je mettrai aussi en lumière un certain nombre de problèmes liés à l’ergonomie des principaux modèles théoriques, ce qui justifie selon moi leur reconfiguration dans l’optique d’une transposition didactique des typologies existantes. Cela m’amènera à proposer un modèle original, que je mettrai à l’épreuve par ma lecture de l’album de Christin et Juillard.
Philippe Sohet, dans son effort de didactisation d’une bande dessinée d’Edmond Baudoin, commente de la manière suivante une planche caractérisée par des effets de symétrie:
Ces ajustements graphiques nous rappellent qu’une planche ne se réduit pas à une succession de cases, elle est surtout un espace où cohabitent des vignettes. Si la «lecture» d’une bande dessinée est séquentielle, case par case, il ne faut pas perdre de vue que son appréhension visuelle est d’abord globalisante, l’œil percevant la planche dans son ensemble. Cette réalité correspond à la dimension «tabulaire» de la planche. Il est donc possible de penser cette cohabitation, de l’organiser en fonction de certaines fins. (Sohet 2010: 66)
Pour les enseignants soucieux de mettre en avant les spécificités du langage de la bande dessinée, il est en effet difficile de faire l’impasse sur l’un des aspects les plus saillants de ce médium, à savoir le fait que la séquence de cases est projetée à la surface de son support, ce qui entraine l’émergence d’effets liés à la coprésence des images. Pourtant, en dépit de la reconnaissance de cette «dimension tabulaire», où se joue en partie le sens du récit, de nombreux manuels se caractérisent par une carence d’outils permettant de traiter cet aspect. L’ouvrage de Sohet, par exemple, possède des sections intitulées «La planche comme composition» (2010: 63-67), «La panopticité» (2010: 68-73) et «La stratégie du site» (2010: 73-80), mais, fidèle à une approche dont l’objectif est surtout de dégager la spécificité de l’œuvre de Baudoin, il ne propose aucun principe général de «composition» ou d’organisation de cette «panopticité», ce qui réduit considérablement la transférabilité de cette lecture vers d’autres contextes. Plus récemment, dans les manuels publiés par Marie-Hélène Marcoux, pourtant très systématiques dans leur approche du langage de la bande dessinée, la description de la dimension tabulaire est totalement absente du manuel destiné aux niveaux primaires (2018), alors que pour le niveau secondaire, les mises en page régulières sont érigées en matrices pour toutes les autres formes de composition, ce qui l’amène à leur attribuer une valeur esthétique que l’on peut juger excessive:
Le gaufrier sert de modèle pour disposer les cases de façon harmonieuse et visuellement attrayante. Il est normal que certaines scènes importantes ne puissent pas correspondre au format plus contraignant de six ou neuf cases. Le bédéiste a parfois besoin de plus de cases […] pour illustrer une scène d’action rapide. Il choisira donc de varier, selon ses besoins, le gaufrier classique. (Marcoux 2016: 30)
À côté du «gaufrier», il existe pourtant bien d’autres types d’organisation de l’espace paginal, que l’on peut qualifier, selon les auteurs, de mises en page «semi-régulière», «irrégulière», «rhétorique», «décorative» ou «productrice» (Chavanne 2010 ; Groensteen 1999 ; Peeters 2003). Renaud Chavanne rappelle en outre que «contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, les compositions régulières ne sont pas nécessairement les plus anciennes attestées de la bande dessinée» (2010: 57). La question se pose donc de savoir si, pour construire un savoir scolaire sur la «panopticité» ou la «planche comme composition», il suffit de renvoyer à ces typologies savantes et aux terminologies qui en découlent. Et si c’est le cas, quel modèle choisir?
Jusqu’à récemment, je m’appuyais dans mes cours2 sur les modèles élaborés par Benoît Peeters (1991) et Thierry Groensteen (1999), qui sont les plus fréquemment cités dans la recherche francophone3. Si les types dégagés par ces deux auteurs sont relativement faciles à expliquer et à illustrer avec des exemples choisis4, en revanche, le passage à un usage empirique se révèle beaucoup moins aisé. Mon expérience m’a notamment permis de constater l’existence de difficultés persistantes, pour un grand nombre d’étudiants, quand il s’agissait de classer certaines mises en page d’apparence plutôt banale, mais qui se situaient en dehors des catégories, ou plutôt qui cumulaient des traits contradictoires invitant à les classer dans plusieurs catégories simultanément. Ces modèles ont pour eux la simplicité des critères qui sont au fondement des catégorisations, mais l’analyse d’œuvres singulières ne cesse de mettre en évidence l’existence de cas indécidables. Au début, je suggérais de sélectionner la typologie correspondant le mieux à l’objet étudié, voire de nommer différentes classifications possibles, en mettant en évidence les traits qui les rapprochent de tel ou tel type, ce qui n’était au fond guère satisfaisant. Au lieu d’offrir un levier pour l’interprétation, les typologies finissaient par devenir des obstacles bloquant l’analyse dans sa phase descriptive, au lieu de l’orienter vers une réflexion sur la fonction du dispositif.
En contexte scolaire, quand on présente une planche et que l’on porte la discussion sur sa dimension tabulaire, il est pourtant difficile d’échapper à la question de savoir comment décrire telle ou telle mise en page et à l’interrogation qui découle de cette difficulté: pourquoi tel ou tel dispositif ne se laisse pas facilement classer? Si cela concerne une œuvre expérimentale, on pourra en conclure que la valeur de l’objet se fonde, en partie du moins, sur son écart créatif vis-à-vis des principes de compositions habituels. Mais si l’on rencontre le même problème à la lecture d’un album d’André Juillard et de Pierre Christin, qui s’inscrit dans la droite ligne de la tradition franco-belge, alors il faudra en conclure que l’outil mobilisé pour l’analyse souffre d’un défaut d’ergonomie.
La théorisation de la mise en page en bande dessinée est marquée par un déficit chronique de mises à l’épreuve empiriques et la réflexion portant sur la transposition didactique des modèles pourrait être l’occasion de remédier à ce problème. Dans le domaine de la didactique de la bande dessinée, Nicolas Rouvière, à la suite de Jean-Paul Meyer (2019: 164, n. 19), dénonce également les «limites des typologies actuelles» (2019: 372), tout en insistant sur le rôle que pourrait jouer la didactique dans la théorisation de la bande dessinée:
Il est enfin un dernier argument, sans doute le plus décisif, pour reconsidérer sans mépris aucun l’apport que peut représenter la sphère éducative pour une meilleure connaissance de la bande dessinée. En effet, les difficultés à caractère didactique que rencontrent les enseignants quand il s’agit de faire étudier la BD en classe correspondent très souvent à des nœuds épistémologiques qui se trouvent au cœur de la spécificité du médium. Ainsi en va-t-il de la notion d’hypercadre, qui a constitué l’une des difficultés les plus importantes pour la théorisation sémiotique de la bande dessinée. (Rouvière 2016: 372)
L’objectif de cet article sera précisément de tenter d’améliorer l’ergonomie des typologies existantes en élaborant un modèle en partie original, qui soit à la fois plus facile à enseigner, plus souple et plus efficace pour décrire l’organisation tabulaire des planches. On pourrait contester l’intérêt d’un tel outil en arguant que l’interprétation des effets découlant de l’organisation spatiale des récits graphiques pourrait se passer d’une description standardisée, ainsi que l’illustre l’approche du récit graphique de Boudoin par Sohet. D’ailleurs, les didacticiens dénoncent souvent les dérives d’un enseignement qui se contenterait de transmettre une terminologie ou un bagage technique au lieu de s’attacher à dégager le sens de l’œuvre:
Enseigner la bande dessinée est un défi que l’enseignement scolaire doit relever, en particulier pour établir des liens entre la littératie traditionnelle et les nouvelles formes de culture médiatique. Mais il ne s’agit pas seulement de former des lecteurs experts et critiques, aussi bien à l’aise dans le monde des lettres que celui des représentations figuratives, pour démêler des productions discursives combinant des codes variés. Il s’agit aussi de former des lecteur sensibles, impliqués, entrant en résonnance symbolique avec les œuvres, pour s’accomplir à part entière comme sujets-interprètes. (Missiou 2019: 98)
J’essaierai de montrer, en m’appuyant sur la lecture du Long Voyage de Léna, que le fait de discuter de la mise en page des planches en se fondant sur une grille d’analyse permet de sensibiliser les apprenants à une dimension souvent négligée lors de la lecture, tout en élargissant le champ de leur expérience esthétique. Ainsi que l’affirme Elizabeth Rosen, l’étude de leur dimension tabulaire souligne que les bandes dessinées «remettent en question la plupart des façons dont nous avons appris à lire: de gauche à droite, de haut en bas, de façon linéaire et progressive» (2009: 58). Jesse Cohn insiste quant à lui sur le fait que de nombreux lecteurs, habitués à cette lecture linéaire, négligent les effets qui se construisent à l’échelle de la page, ce qui réduit considérablement leur horizon esthétique et les amène à lire les bandes dessinées comme des romans ordinaires5:
Parfois, en lisant un roman graphique, nous pouvons perdre de vue le fait que nous regardons une page. En effet, pour la plupart de nos élèves, habitués à considérer la bande dessinée comme une lecture facile, leur regard passe assez rapidement sur les pages, qui sont généralement conçues pour ne pas interrompre cette fluidité ; ils voient des personnages agissant dans le temps, et non un dessin étendu dans l'espace. (Cohn 2009: 44)
Cohn confesse avoir rencontré des résistances quand il s’agissait d’attirer l’attention de ses étudiants sur l’aspect proprement graphique des récits en bande dessinée. Il ajoute que si cette dimension devient évidente lorsqu’il confronte sa classe à des œuvres expérimentales, à l’instar des romans graphiques de Chris Ware, la grande majorité des bandes dessinées exigent de disposer d’un cadre interprétatif permettant d’identifier les procédures standardisées à travers lesquelles les récits «occupent l’espace» (2009: 44). Il s’agit par conséquent de découvrir des principes généraux de composition, que Cohn compare avec l’art du montage hollywoodien enseigné dans les cursus d’études cinématographiques6. Il ne s’agit pas de confondre le découpage filmique avec l'organisation tabulaire du récit, qui sont des opérations totalement différentes, mais d’insister sur l’importance d’objectiver les logiques sous-jacentes au montage cinématographique et à la mise en page de la bande dessinée pour que ces configurations narratives soient perçues au-delà des automatismes culturels qui les invisibilisent.
Par ailleurs, outiller les apprenants avec une typologie de techniques narratives permet de discuter de phénomènes qui transcendent le cas particulier, posant par exemple la question des parentés et des filiations entre les œuvres, tout en permettant de mettre au jour des procédures standardisées qui donnent forme aux productions sérielles de la culture médiatique7. Mobiliser de tels cadres interprétatifs permettrait par conséquent sans nul doute de renforcer la littératie médiatique des apprenants (cf. Lebrun, Lacelle & Boutin 2012).
Tabularité des récits graphiques et typologies des mises en page
Dans un article pionnier, Pierre Fresnault-Deruelle (1976) définit la bande dessinée comme un produit culturel écartelé entre la linéarité du strip et la tabularité de la planche. Cette double dimension a amené Thierry Groensteen à souligner l’existence de deux modes d’appréhension des rapports entre les images dessinées. Dans une terminologie qu’il emprunte à Jean Ricardou (1978), il évoque une arthrologie restreinte et une arthrologie généralisée. L’arthrologie, en médecine, consiste en l’étude des articulations entre différents membres du corps humain. En bande dessinée, cette double logique articulatoire souligne que les cases – qui constituent l’unité fondamentale de la bande dessinée – ne font pas que se succéder linéairement, comme une suite de mots, mais forment également un réseau entre des éléments occupant différents lieux disséminés dans l’espace graphique. L’étude des relations qui se tissent au sein de cet espace consiste, toujours selon la terminologie de Groensteen, à mettre en lumière un «tressage iconique», c’est-à-dire un réseau qui se déploie dans une dimension tabulaire et plus seulement linéaire. A priori, ce tressage peut se déployer à n’importe quelle échelle de l’œuvre imprimée, Groensteen insistant sur le fait que les images facilitent une saisie rapide du sens, ce qui invite, davantage que dans d’autres genres d’imprimés, à naviguer librement à la surface des pages et au feuilletage des albums:
La bande dessinée est fondamentalement une littérature qui ne dissimule rien, qui s’offre à une possession entière et sans reste: on la découvre rien qu’à la feuilleter, on navigue à sa surface sans oblitérer ce qui précède et en ayant déjà un œil sur ce qui arrive. (Groensteen 2011: 82)
Au sein de ce système, qualifié de «spatio-topique», se pose en particulier la question de l’étalement des images à la surface des planches et des effets qui découlent de leur configuration paginale. Comme l’explique Groensteen:
Parmi les diverses opérations qui assurent l’intégration des composantes d’une bande dessinée, celle qui a le plus particulièrement pour fonction de régir les paramètres spatio-topiques est communément désignée sous le terme de «mise en page». (1999: 107)
Benoît Peeters est probablement l’un des premiers auteurs à avoir proposé une typologie des mises en page8. Selon son approche, deux critères sont retenus pour classer la composition des planches: d’une part, l’interdépendance ou l’autonomie entre le tableau et le récit ; d’autre part, le rapport de domination, respectivement de la fonction narrative ou de la tabularité. En croisant ces critères, Peeters (2003: 49) obtient un tableau à double entrée définissant quatre types de composition, qui renvoient respectivement à une utilisation rhétorique, conventionnelle, productrice ou décorative de la mise en page.
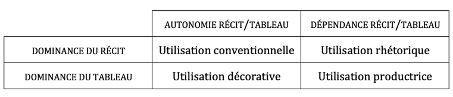
Tableau 1: Typologie des mises en page selon Benoît Peeters.
Les mises en page rhétorique et conventionnelle sont donc dominées par la fonction narrative, mais elles s’opposent sur le plan de la variabilité des cases. Dans la mise en page rhétorique, le format s’adapte au contenu tandis que dans le dispositif conventionnel, il n’y a pas d’interdépendance, le format adoptant une grille régulière, aussi appelée «gaufrier» (Peeters 2003: 51). Au sujet de la mise en page conventionnelle, Peeters affirme par ailleurs qu’il s’agit d’un «système fortement codifié, où la disposition des cases dans la planche, à force de se répéter, tend à devenir transparente» (2003: 52). Les mises en page décorative et productrice se caractérisent quant à elles par une dominance du tableau, mais la première est exploitée à des fins purement esthétiques, tandis que la seconde engendre des effets qui modifient l’appréhension du récit.
Si les mises en page dites rhétoriques ou conventionnelles sont relativement faciles à identifier, il est plus difficile de différencier concrètement les utilisations décoratives ou productrices. L’appréciation de la fonction du dispositif et la détermination du point de bascule à partir duquel on peut considérer que la dimension tabulaire devient dominante reposent en effet sur des critères subjectifs. Jan Baetens et Pascal Lefèvre ont d’ailleurs montré que ces qualificatifs pouvaient très bien s’utiliser en relation avec le «gaufrier», que Peeters range pourtant dans la catégorie des usages conventionnels. Par exemple, de nombreuses pages de Watchmen exploitent des effets de symétrie ou des compositions en damier jouant sur le contraste des couleurs, ce qui renforce l’une ou l’autre de ces fonctions:
Ce qui fait la force de l’album, sous l’angle du cadrage, c’est l’utilisation du principe conventionnel selon des logiques en fait contradictoires. Ainsi la plus neutre de toutes les mises en page – la fragmentation de la planche en neuf vignette analogues – connaît aussi un emploi producteur. La symétrie du modèle de base pousse à doter un chapitre entier d’une structure symétrique globale et de faire miroiter les successives pages de la première partie de cette section dans les planches équivalentes de la seconde moitié. Par ailleurs de nombreuses planches de Watchmen revêtent sûrement, en premier lieu par la distribution réglée, souvent en damier, des contrastes chromatiques, un aspect décoratif et ne peuvent pas ne pas être déchiffrées comme un espace plastique. (Baetens & Lefèvre 1993: 60)
Groensteen propose quant à lui une typologie un peu différente, ce qui l’autorise à envisager l’existence de gaufriers productifs ou décoratifs. Reprenant l’exemple de Watchmen discuté par Baetens et Lefèvre, il est conduit à critiquer le qualificatif de conventionnel pour définir le gaufrier, car cette mise en page exacerberait les correspondances non linéaires qui peuvent être tressées entre des cases isomorphes:
La mise en page régulière est donc aussi celle qui exalte certains effets de tressage parce qu’elle leur permet de produire les agencements les plus simples et prégnants du point de vue perceptif, et parce qu’elle renforce les correspondances entre lieux prédéterminés. (Groensteen 1999: 114)
Le principe retenu par Groensteen pour analyser une mise en page repose sur les réponses données à deux questions, apparemment très simples:
a / Est-elle régulière ou irrégulière?
b / Est-elle discrète ou ostentatoire? (Groensteen 1999: 114)
En croisant ces deux critères, Groensteen reconstruit une typologie à quatre termes:
- régulière et discrète ;
- régulière et ostentatoire ;
- irrégulière et discrète (ce qui correspond à la mise en page «rhétorique» classique) ;
- irrégulière et ostentatoire. (Groensteen 1999: 115)
Le problème découlant de ce modèle, c’est qu’il ne précise pas quel degré de régularité correspond au juste l’expression «mise en page régulière» et il n’indique pas davantage selon quel critère il est possible de décider que telle ou telle composition devient ostentatoire. En effet, Groensteen mentionne la possibilité de rencontrer, au sein d’une mise en page régulière, des rupture saillantes, sans que cette modification du gaufrier ne fasse basculer ce dernier du côté des organisations irrégulières:
[La mise en page régulière] possède enfin cette ultime vertu, de ménager la possibilité de ruptures soudaines et spectaculaires avec la norme posée d’abord. Dans un album dont les pages sont régulières, une page qui se distingue soudain par une configuration spéciale obtiendra un impact très fort […]. Au lieu que, quand toutes les vignettes sont discriminées par des formats différents – comme le propose l’option rhétorique –, il est plus difficile d’en faire vraiment ressortir aucune. (Groensteen 1999: 114-115)
On voit ainsi que l’opposition la plus élémentaire, à savoir celle entre régularité et irrégularité, pose la question du seuil à partir duquel on passe d’un prototype à l’autre, puisque Groensteen – comme Peeters9, d’ailleurs – suggère que des variations locales du gaufrier ne remettent pas en cause le type de base auquel se rattache la composition. Quant à la fonction de ces ruptures, Groensteen considère qu’elles peuvent renforcer le caractère ostentatoire de la mise en page, faisant basculer une mise en page conventionnelle dans un registre décoratif ou productif, ou qu’elles peuvent tout aussi bien répondre à la simple nécessité d’adapter le format de la case à son contenu narratif, ce qui la rapprocherait d’un usage rhétorique.
Cette possibilité de considérer que certaines planches irrégulières ne représenteraient que des variations du gaufrier pose non seulement la question du seuil à partir duquel une irrégularité peut être jugée pour elle-même, mais également de l’échelle à partir de laquelle caractériser une mise en page. Faut-il considérer l’ensemble de l’œuvre, que l’on classerait dans l’une ou l’autre de ces catégories de base – régulière ou irrégulière pour Groensteen, conventionnelle ou rhétorique pour Peeters – et définir ensuite, sur cette base, des passages qui offriraient des variations de cette matrice, ou vaut-il mieux s’attacher à décrire chaque planche dans sa relative autonomie vis-à-vis de l’œuvre globale? La question est d’autant plus actuelle que de nombreux romans graphiques contemporains jouent sur une forte hétérogénéité de registres, accentuée par l’esthétique discontinue du chapitrage et des compositions paginales10. On comprend mieux sur cette base la perplexité des étudiants confrontés à des mises en page irrégulières, que l’on devrait définir comme des variantes, ostentatoires ou discrètes, d’une mise en page régulière, dont la fonction pourrait être aussi bien productrice que décorative ou rhétorique.
Avant de proposer une alternative, je mentionnerai un dernier cadre théorique, un peu moins connu, mais qui a le mérite d’être fondé sur une base empirique, à savoir l’étude systématique des mises en page d’Edgar P. Jacobs par Renaud Chavanne (2005). Dans une tentative de généralisation ultérieure de son modèle, Chavanne réarrange les typologies de Peeters et Groensteen en proposant un modèle simplifié à trois pôles:
Poursuivant, développant et approfondissant l’analyse de nos prédécesseurs, nous identifions trois grands principes de composition susceptibles de s’appliquer aux œuvres organisées par bandes: le principe de régularité, le principe de semi-régularité et le principe rhétorique. (2010: 27)
Chavanne reprend donc de Peeters le «principe rhétorique» et emprunte à Groensteeen le «principe de régularité», mais il introduit un pôle intermédiaire, qu’il appelle «principe de semi-régularité11», qui règle en quelque sorte la question du seuil entre les deux dispositifs. Outre l’introduction de cette catégorie, l’une des innovations majeures apportée par Chavanne consiste à souligner, davantage que ne le font Peeters et Groensteen, le fait que ces trois prototypes ne sont que des pôles et que leur concrétisation au sein d’une œuvre procède d’une logique combinatoire, débouchant sur un «mélange de ces principes»:
[O]n pourrait venir à penser de ce qui précède qu’il existe une séparation étanche entre ce qui procède de la rhétorique et ce qui appartient à la régularité, et, dans un moindre degré, entre la semi-régularité et la rhétorique. Il n’en va pas ainsi. Bien sûr les définitions de ces principes de composition sont suffisamment fortes pour qu’elles permettent de distinguer des constructions effectivement différentes, et que cette distinction se conforme à l’observation […]. Mais rien ne justifie l’impossibilité d’une combinatoire, d’un mélange des principes. (Chavanne 2010: 153).
Au lieu de penser les rapports sous forme de choix binaire ou de tableau à double entrée, il faudrait ainsi se représenter les types de mises en page possible comme des pôles se répartissant sur un spectre allant de la mise en page rhétorique à la mise en page régulière en passant par différents stades intermédiaires. On peut aussi retenir du modèle de Chavanne la notion de matrice, qui désigne une configuration de base présidant à la construction de l’œuvre, laquelle se distingue des concrétisations locales et plus ou moins divergentes de telle ou telle planche dans son état publié:
Lorsqu’il s’engage dans la création d’une bande dessinée, le dessinateur s’astreint presque systématiquement à un certain nombre de contraintes de composition. Ces contraintes peuvent lui être imposées, ou il peut les choisir de lui-même. Ce choix peut être fait en pleine connaissance de cause, comme il peut résulter d’une habitude, d’une tradition que l’on reproduit sans même s’en apercevoir. Il s’agira par exemple du format de la bande dessinée (une page? de quelles dimensions? une partie d’une page plus grande occupée par d’autres éléments que la bande dessinée?), du nombre de vignettes par bande (fixe, variable, dans quelles proportions?), du nombre de bandes se succédant sur l’espace de composition (fixe? variable?), de la hauteur de ces bandes (toujours semblable ou fluctuante?), de la régularité ou non de la dimension des cases, et ainsi de suite. L’ensemble de ces contraintes de composition, nous les appellerons la matrice de l’œuvre. (Chavanne 2010: 15)
Il faut donc souligner l’intérêt de la notion de matrice et du principe de gradualité introduits par Chavanne, mais on peut regretter la disparition de la dimension ostentatoire ou de ce que Peeters définissait comme des mises en page où le tableau domine. Plus exactement, les mises en page les plus ostentatoires sont bien envisagées dans les derniers chapitres de l’ouvrage, mais libérées de leur dépendance envers la linéarité de la bande, elles font l’objet d’une nomenclature de plus en plus foisonnante, ce qui complexifie son usage12. En outre, la catégorie «semi-régulière» apparait, comme son nom l’indique, comme une dérivation de la mise en page régulière, plus que comme une véritable catégorie intermédiaire, ainsi qu’en témoigne cette citation:
[L]a régularité de composition peut se transformer en une contrainte terrible voire paralysante. C’est probablement alors qu’apparaissent les avantages des compositions semi-régulières. […] Une composition semi-régulière dérive directement d’une composition régulière, dont elle est en quelque sorte une altération. De la composition régulière, la semi-régulière retient le principe d’invariance des dimensions des bandes et des vignettes. La matrice élémentaire qui sous-tend de manière simple et sans aucune équivoque les compositions régulières, est toujours immédiatement perceptible dans une composition semi-régulière. Pour parler autrement, on peut dire que la grille de base, que le gaufrier de la composition régulière apparaît immédiatement et sans difficulté sous une composition semi-régulière. (Chavanne 2010: 49)
Chavanne n’envisage donc pas le cas où une mise en page semi-régulière serait dérivée d’une matrice rhétorique, ce qui est pourtant fréquent dans l’œuvre de Hergé, par exemple quand ce dernier met en scène le récit de Tchang dans Tintin au Tibet, qui prend la forme, au sein d’une mise en page globalement rhétorique, d’un montage régulier de cases isomorphes montrant en alternance le narrateur et des fragments de son récit et produisant un effet de damier qui préfigure les compositions décoratives que l’on rencontre dans Watchmen. On peut citer également une double page célèbre rattachée au flashback du Secret de la licorne dans laquelle Hergé joue sur des effets de symétrie entre deux grandes cases spectaculaires montrant des navires et un combat entre des marins et des pirates, qui contrastent avec une séquence de petites cases de format identique, où l’on peut suivre les mésaventures burlesques du capitaine Haddock mimant l’événement.
L’idée que la mise en page semi-régulière serait la dérivation d’une composition régulière et qu’en outre elle aurait pour fonction essentielle d’assouplir une contrainte de production conduit Chavanne à négliger les cas, pourtant nombreux, où un mélange de régularité et d’irrégularité confère à la planche une valeur ostentatoire ou productrice. Il me semble que ce genre de dispositif, que j’appellerai pour ma part mise en page architecturée, est susceptible de se rencontrer aussi bien dans une œuvre dominée par une matrice rhétorique que fondée sur le principe du gaufrier. J’ajouterai que ce dispositif peut même devenir une matrice en soi dans des récits graphiques exploitant pleinement la dimension tabulaire de la bande dessinée. Cette catégorie a aussi l’intérêt d’offrir une base pour regrouper la très grande diversité des compositions occupant l’espace paginal d’une manière que l’on pourrait qualifier de créative.
Typologie circulaire et mise en page architecturée
On peut retenir plusieurs principes dérivés des modèles élaborés par Peeters, Groensteen et Chavanne en vue de leur réarticulation au sein d’un modèle que je tenterai de rendre plus souple et plus efficace pour un usage scolaire. Tout d’abord, on peut considérer que la mise en page rhétorique et le gaufrier ne posent pas de problème de repérage particulier, dans la mesure où ils renvoient à des standards historiquement attestés, qui continuent de structurer une partie importante de la production actuelle. Les termes eux-mêmes sont devenus courants dans le langage des spécialistes de la bande dessinée, à tel point qu’ils ne nécessitent plus de définition particulière dans leurs travaux. Quand il s’agira d’expliquer la nature de ces prototypes à des apprenants, on se contentera de rappeler que le gaufrier consiste en un découpage régulier de la page, qui forme une grille, alors que la mise en page rhétorique consiste à adapter le format des cases au contenu représenté, ce qui induit un principe de variation plus ou moins aléatoire. On retiendra également le principe défini par Peeters, à savoir que le gaufrier est fondé sur une autonomie de l’organisation tabulaire, alors que la mise en page rhétorique adapte la mise en page aux contraintes de l’histoire représentée.
La clarté de cette opposition repose également sur un principe d’engendrement qui en constitue la raison d’être. Le gaufrier propose une organisation tabulaire standardisée, qui simplifie la mise en page, mais il complexifie le «cadrage» de l’action. À l’inverse, la mise en page rhétorique offre plus de souplesse pour mettre en scène le contenu narratif dans chaque case, mais elle complexifie l’agencement de ces cases dans l’espace du support. Dans un cas comme dans l’autre, on associera ces dispositifs à des matrices fondées sur un principe de production standardisée, ce qui explique que le dispositif tende généralement à s’invisibiliser au profit de la progression linéaire dans le récit et de l’immersion dans le plan de l’histoire.
En ce qui concerne les mises en page ostentatoires, c’est-à-dire celles dans lesquelles la dimension tabulaire devient plus saillante, on évitera de différencier les usages décoratif ou productif, car leur interprétation repose sur des critères trop subjectifs. Il me semble par contre que la catégorie introduite par Chavanne, qui consiste à proposer un pôle intermédiaire entre la régularité du gaufrier et l’irrégularité de la mise en page rhétorique offre une piste intéressante. Mais plutôt que d’en faire une simple dérivation de la mise en page régulière, il serait plus productif de lui conférer un statut propre et d’expliquer en quoi une irrégularité régulière ou une régularité irrégulière, est susceptible de renforcer la saillance de la dimension tabulaire de la planche. Pour ce troisième pôle, je propose d’utiliser l’expression de mise en page architecturée.
Ainsi que l’explique Catherine Labio, l'architecture «occupe depuis longtemps une place prépondérante dans la bande dessinée» (2015: 312). Elle explique qu’il ne s’agit pas seulement d’un sujet «médiagénique13» pour les récits graphiques, mais que cette thématique constitue également une mise en abîme du dispositif, car «la dimension architecturale de la page est une caractéristique essentielle du genre» (2015: 315, n. 7). Labio va plus loin en associant les déformations productrices que l’on peut observer dans les mises en page de Winsor McCay aux principes esthétiques de l’art nouveau, qui dominaient son époque. Dans le même registre, Alain Boillat, à la suite de Vincent Amiel, souligne qu’au sein d’une série comme Les Cités obscures – scénarisée par Benoît Peeters et dessinée par François Schuiten, lui-même fils d’architecte – on peut observer une «convergence entre l’architecture de la ville et celle de la planche» (2018: 143). Boillat rapproche cette conception ostensiblement architecturée du modèle de la mise en page productrice, que Peeters valorise dans ses travaux théoriques:
Dans un art de l’espace comme la bande dessinée où la disposition des cases sur la planche appelle un niveau de lecture tabulaire (facultativement subsumé en partie par la lecture linéaire), la démarche à l’œuvre dans les Cités obscures constitue intrinsèquement un renvoi aux conditions fondamentales de la création/réception de la BD. […] À travers les exemples qu’il convoque (Winsor McCay, Régis Frank et Fred) pour illustrer sa typologie, on comprend bien que c’est une utilisation dite «productrice» (par opposition à celles respectivement qualifiées de «conventionnelle», «décorative» et «rhétorique») qu’il entend valoriser dans la production contemporaine (et par conséquent dans la sienne propre), c’est-à-dire une mise en page obéissant au principe selon lequel «c’est l’organisation de la planche qui semble dicter le récit» (Peeters 1998: 68). (Boillat 2018: 143)
En résumé, même si n’importe quelle mise en page peut être considérée comme une forme d’architecture graphique, on pourrait utiliser l’étiquetage mise en page architecturée pour renvoyer plus spécifiquement à une configuration que l’on qualifierait, dans une autre terminologie, de productrice ou d’ostentatoire. Ce troisième pôle pourra également être défini formellement comme une composition au sein de laquelle des irrégularités locales s’inscrivent dans une configuration de rang supérieur, ce phénomène correspondant par exemple aux effets de symétrie, de contraste ou de hiérarchie qui relient des éléments hétérogènes au sein de la page. Parmi les cas typiques de compositions architecturées, on pourra mentionner par exemple les cases en médaillon placées au milieu de la planche, que l’on trouve parfois chez Jacobs, ou ces grandes cases qui viennent rompre la régularité d’un gaufrier en occupant toute la largeur d’un strip, qui sont fréquentes chez Frederik Peeters. On inclura également les compositions jouant sur des contrastes de couleur ou des correspondances graphiques non linéaires, qui abondent dans les compositions de Watchmen. Il faut rappeler en effet que l’architecture de la page ne passe pas nécessairement par des variations affectant la forme des cases: ainsi que l’ont montré Baetens et Lefèvre (1993: 60), les contrastes de couleurs au sein d’un gaufrier ou d’une mise en page rhétorique peuvent très bien créer des effets saillants à l’échelle de la planche ou de la double planche.
Enfin, il faut noter que les principes de composition peuvent varier au fil d’une œuvre, et que même à l’échelle d’une planche, on peut observer localement différents principes qui se combinent en se superposant les uns aux autres. Ces métissages, qui font parfois glisser une mise en page d’une matrice vers un pôle différent, tout en conservant certains traits inhérents au dispositif de base, soulignent l’importance de disposer d’une typologie suffisamment souple pour ménager des lieux intermédiaires, situés à une plus ou moins grande distance d’un pôle ou de l’autre.
De manière à conserver ces nuances tout en échappant à la question souvent insoluble des «seuils» qui font basculer une mise en page d’une catégorie à une autre, je propose de réarticuler ces trois prototypes (rhétorique, gaufrier, architecturé) au sein d’un continuum, lui-même structuré par les oppositions mises en évidence par Groensteen. Cette articulation serait impossible dans une modélisation sous la forme d’un tableau à double entrée, mais elle peut néanmoins être envisagée dans le cadre d’un typologie circulaire inspirée des travaux du narratologue allemand Franz Karl Stanzel (1955). Dans ce genre d’approche, les prototypes de mises en page s’articulent au sein d’un espace polarisé par deux axes: régularité/irrégularité, discret/ostentatoire. Suivant le modèle de Groensteen et de Peeters, la mise en page rhétorique correspond à un pôle situé dans le quart «irrégulier/discret» alors que le gaufrier se situe du côté «régulier/discret». Enfin, le pôle de la mise en page architecturée se situe sur le versant ostentatoire, mais à l’entrecroisement entre régularité et irrégularité.
Ce modèle possède la caractéristique de ménager des lieux intermédiaires, que l’on peut considérer comme des sous-types dérivant des trois pôles principaux. On peut ainsi mentionner les mises en page semi-régulières de Chavanne, qui partagent la discrétion des pôles rhétorique et du gaufrier tout en se situant à mi-chemin entre les deux dispositifs sur le plan de leur régularité. On peut aussi situer dans ces espaces intermédiaires des mises en page rhétoriques ou dérivant d’un gaufrier, mais qui partagent certains traits du pôle architecturé. Ce schéma circulaire permet enfin de décrire des variations observables localement au sein d’une même œuvre entre des mises en page susceptibles de s’écarter de manière plus ou moins ostensiblement de la matrice dont elles dérivent.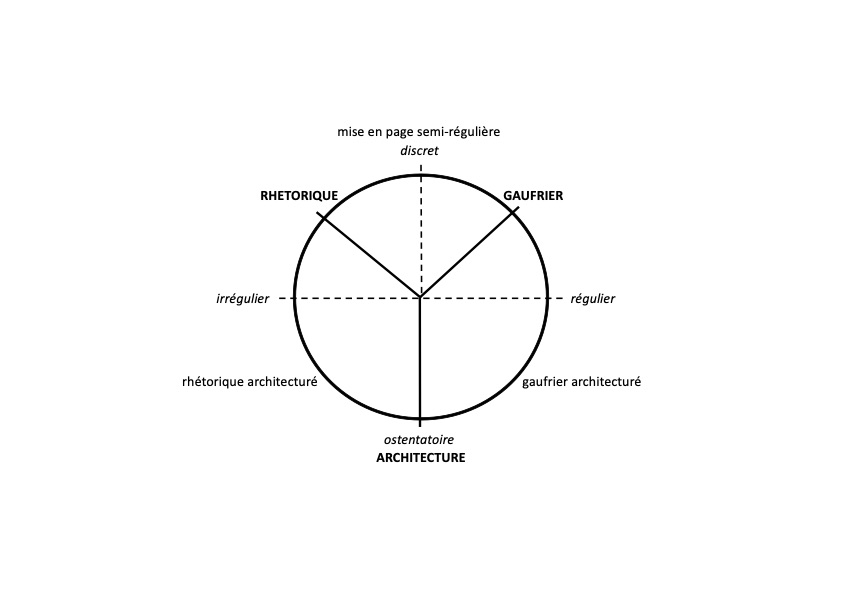 Schéma 1: Typologie circulaire des mises en page
Schéma 1: Typologie circulaire des mises en page
Notons malgré tout que quelques types de composition échappent à cette typologie, laquelle repose fondamentalement sur la possibilité de définir l’agencement d’une séquence d’information (généralement narrative) au sein d’une unité graphique de rang supérieur. Les bandes dessinées qui adoptent une mise en page flottante, c’est-à-dire dépourvue de cadres facilitant le repérage de l’agencement des cases dans l’espace de la planche, mais aussi les dispositions en ruban continu ou suivant une logique de diaporama – qui sont en train de devenir majoritaires dans le domaine de la production numérique14 – échappent à cette logique, car un tel mode de présentation, ainsi que l’explique Groensteen, «déterritorialise chaque image, masquant ou ruinant l'ensemble des liens tissés à la surface de la page» (2011: 72). Ces limites admises, nous allons voir comment l’analyse des mises en page dans un album tel que Le Long Voyage de Léna est susceptible de bénéficier de notre typologie. L’objectif ne sera pas, dans ce cas précis, de rattacher l’ensemble de l’œuvre à un pôle ou à un autre, mais plutôt de dessiner les contours d’une matrice permettant de souligner comment, localement, telle ou telle mise en page investit la dimension tabulaire de l’album en vue de produire tel ou tel effet ou de s’adapter à telle ou telle contrainte. La valeur essentielle de cette approche sera d’objectiver différentes manières d’occuper l’espace et de rendre ainsi possible l’interprétation de la valeur de chacune des compositions.
Mettre en page Léna
Déterminer la matrice à laquelle se rattache l’œuvre de Christin et Juillard n’est pas chose aisée dans la mesure où cette bande dessinée offre une grande diversité de mises en page. Un regard distant pourrait en conclure que l’irrégularité évidente de ces compositions renvoie à une matrice rhétorique, exemplifiée dès l’incipit. Dans cette première planche (qui correspond à la page trois de l’album imprimé), l’irrégularité apparente se révèle beaucoup plus complexe quand on l’analyse de manière plus détaillée en se penchant sur sa genèse.
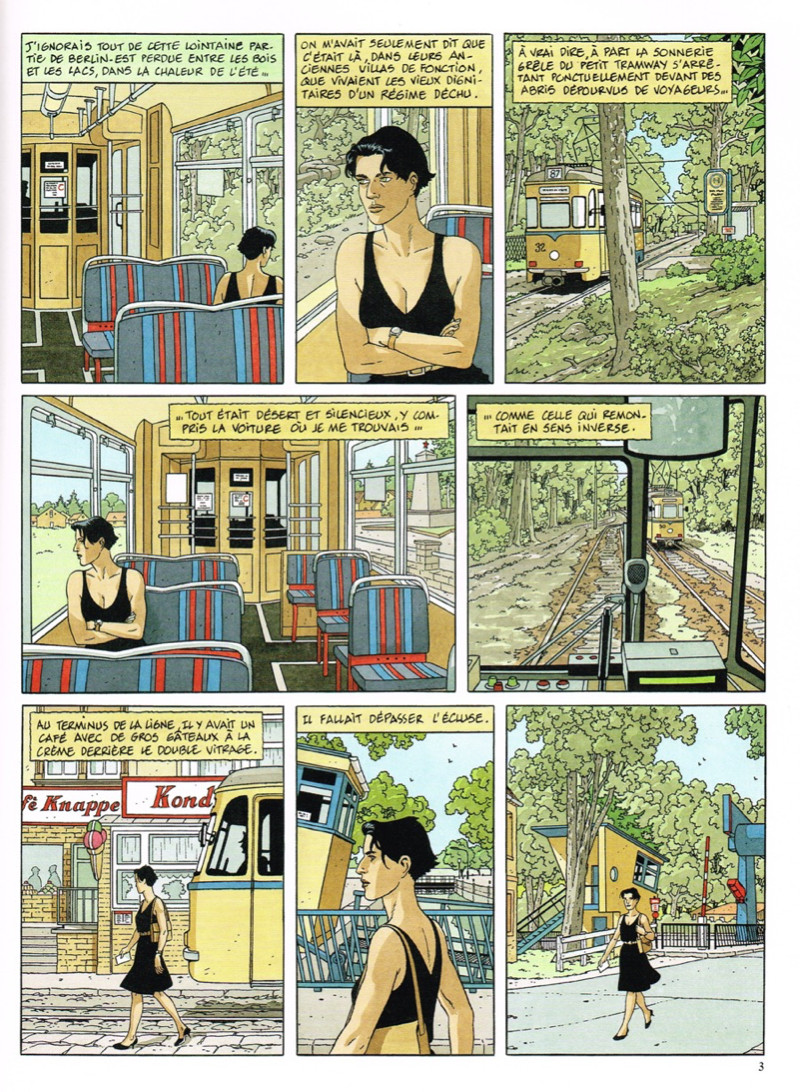 Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 3 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 3 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007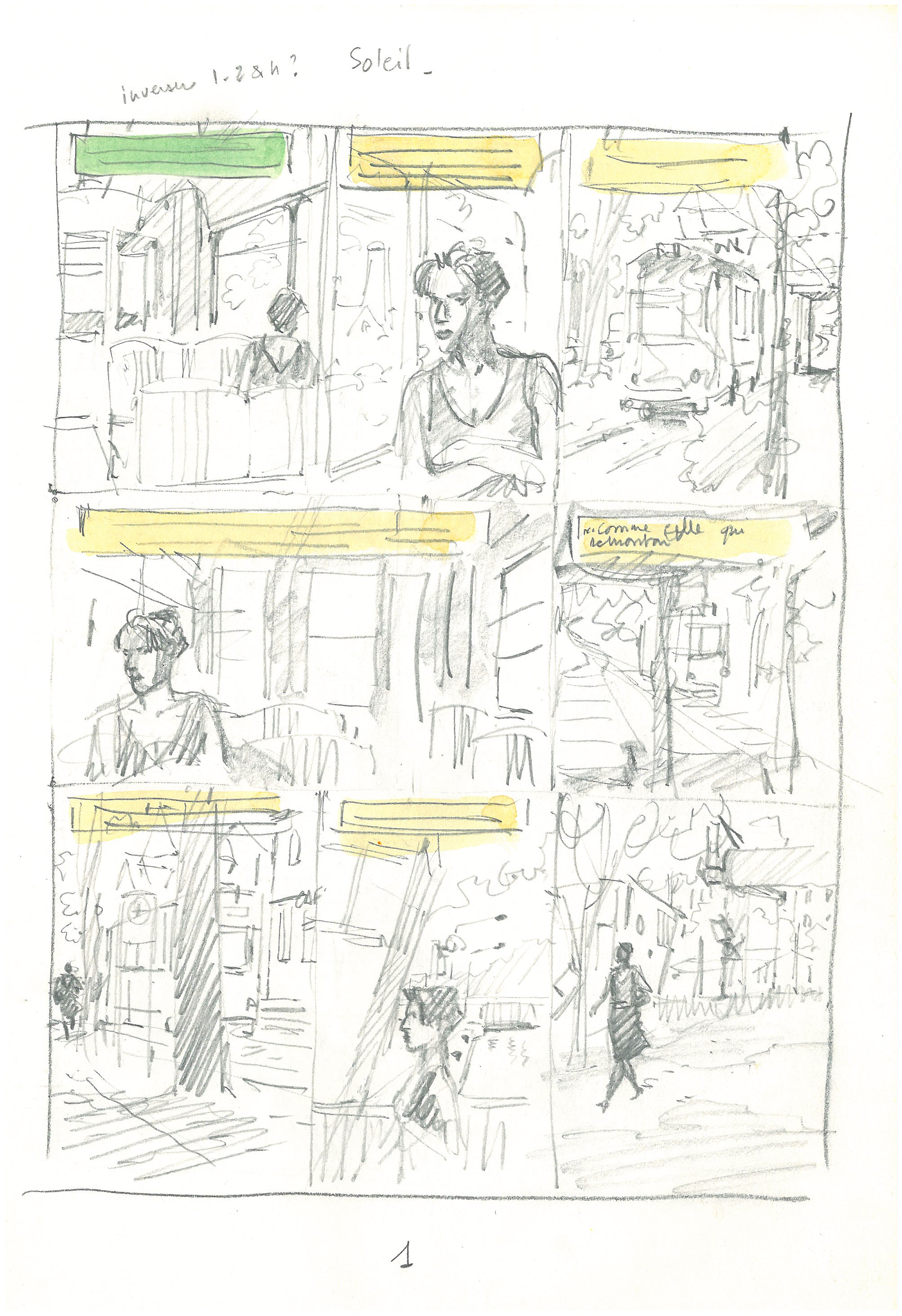
Image 2: Storyboard, planche 1 © André Juillard & Pierre Christin 2005
On constate que le storyboard, contrairement à la planche finale, présente une structure plus régulière, car on n’y trouve pas de variations au sein des cases du premier et du troisième strip. Dans ce travail préparatoire, on voit néanmoins que le gaufrier de base est modifié pour signifier graphiquement que Léna se trouve seule dans le tramway, l’élargissement du cadre permettant de montrer les sièges vides qui l’entourent. Ce procédé fait passer le strip d’un régime régulier de trois cases à une disposition en deux cases de formats différents. Si l’on observe la version finale, on constate que Juillard introduit une seconde variation dans le format des vignettes du premier strip et du troisième strip: les cases centrales montrant la protagoniste cadrée en «plan taille» apparaissent plus étroites que les cases situées sur les bords, qui sont davantage orientées sur la monstration du décor («plan moyen» ou «plan pied»). Cette irrégularité et ces correspondances thématiques produisent une symétrie axiale verticale et, pour les deux strips extérieurs, également horizontale, ainsi qu’une symétrie centrale entre les quatre coins opposés de la page. Ces cases isomorphes et solidaires accentuent ainsi légèrement la visibilité de la dimension tabulaire, ce qui rapproche la configuration du pôle architecturé. On voit ainsi comment deux phases d’élaboration d’une même planche, en dépit de variations que l’on pourrait juger quasi imperceptibles, peuvent néanmoins se situer différemment par rapport à différents pôles de notre typologie, laquelle contribue ainsi à visibiliser le travail graphique du dessinateur: dans un premier état, un gaufrier devient semi-régulier par la fusion de deux cases, ce qui le rapproche du pôle rhétorique, puis dans la mise en page finale, on observe un glissement vers le pôle archtiecturé par un jeu de correspondances formelles et thématiques construisant des effets de symétrie au sein de l’irrégularité du dispositif.
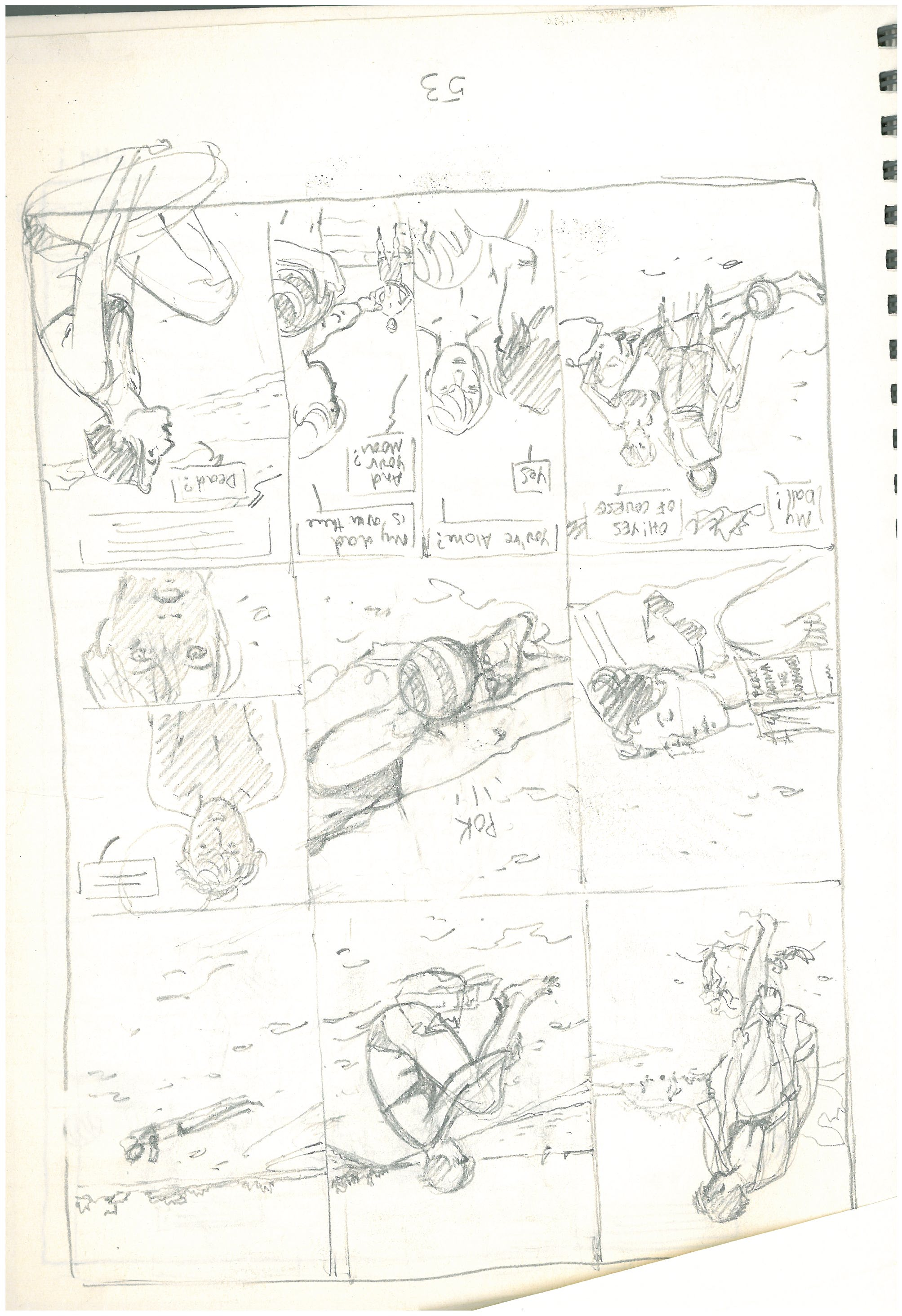
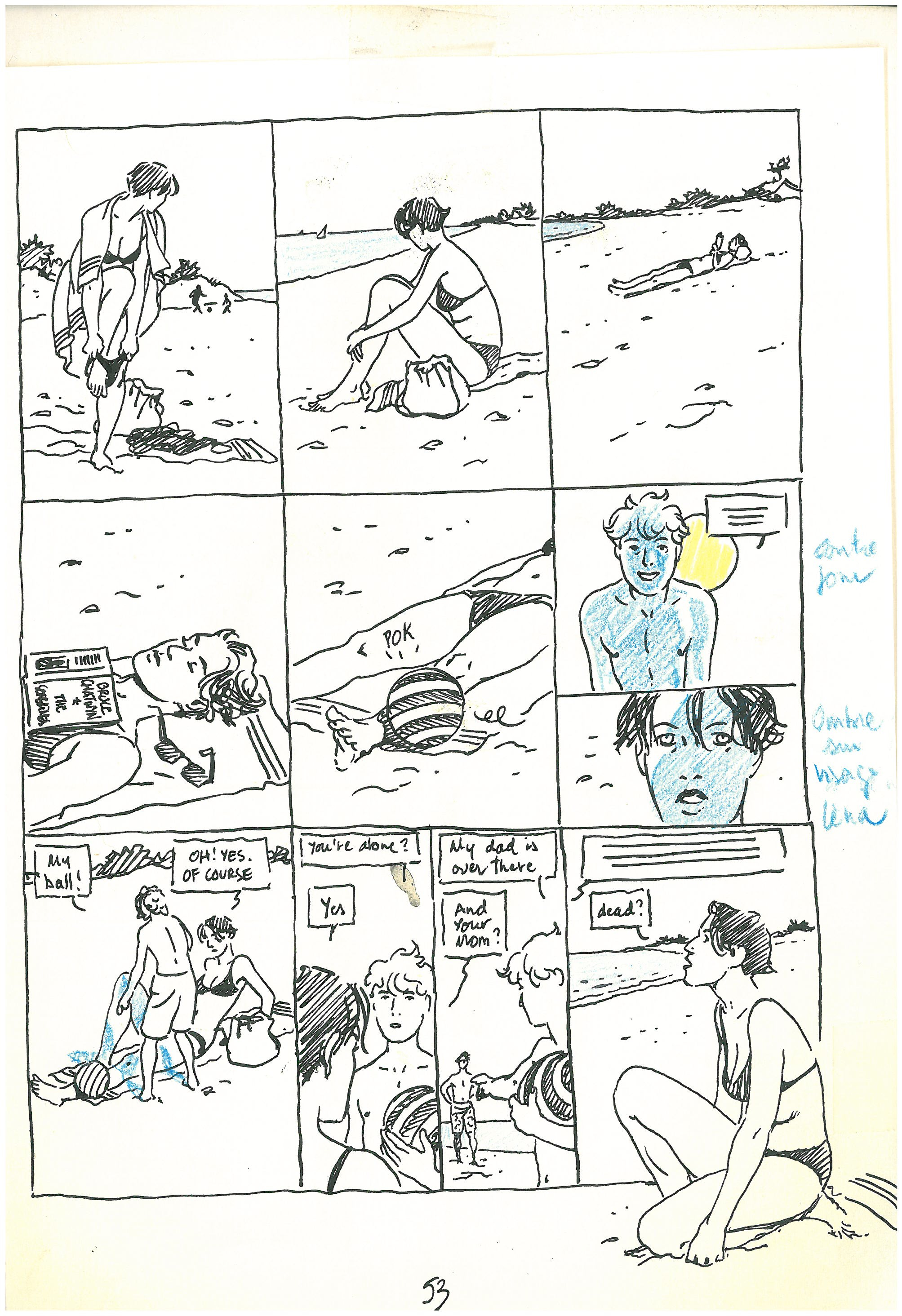
Images 3 et 4: Storyboard, planches 53 et 53bis
© André Juillard & Pierre Christin 2005
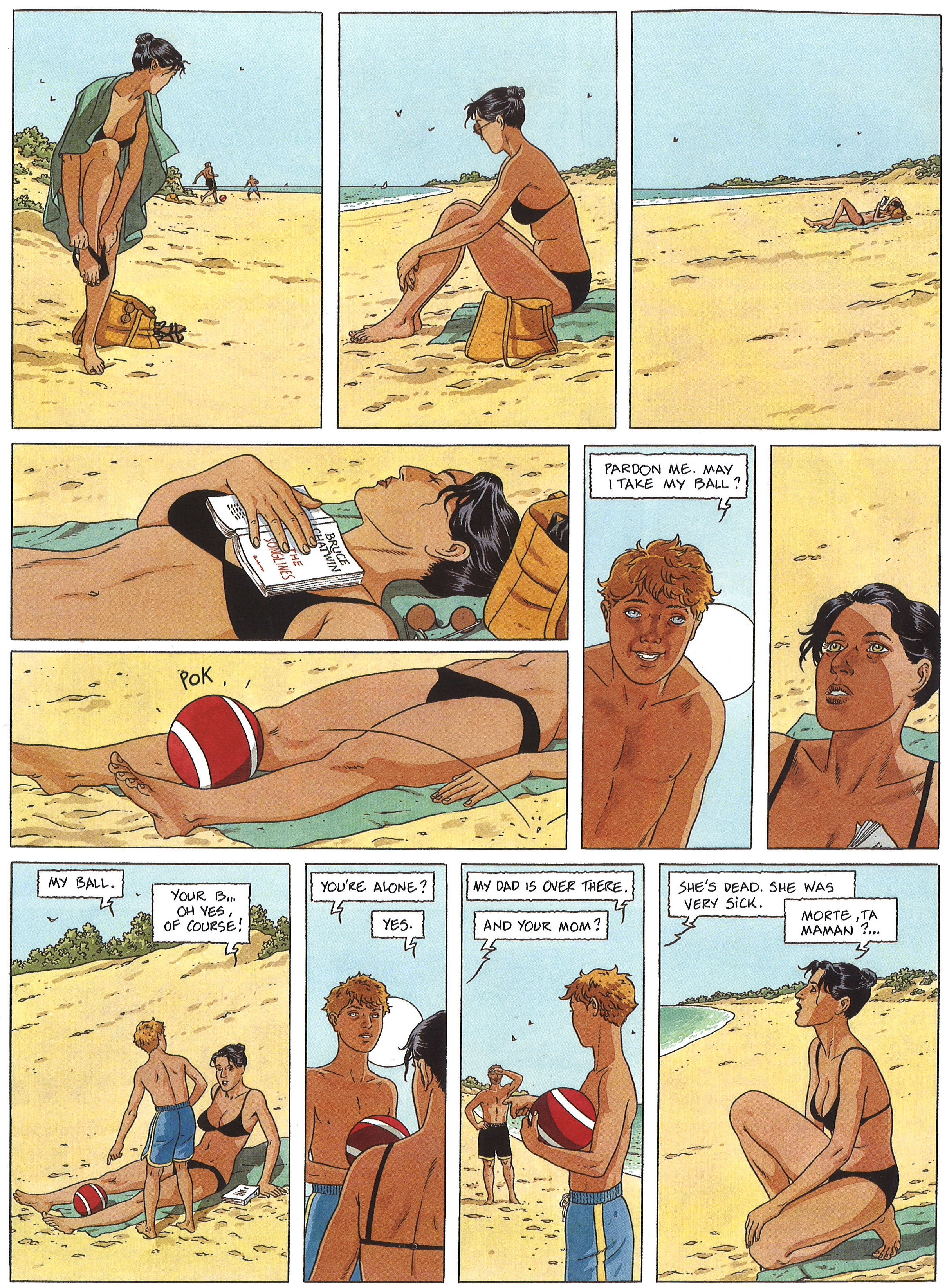
Image 5: Le Long Voyage de Léna, p. 55
© Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
On observe la même tendance à s’écarter du gaufrier dans les planches finales de l’album, l’effet étant particulièrement visible dans la version «encrée» du storyboard, car le tracé du stylo rend le cadre des cases plus ostentatoire15. À cette étape, on perçoit encore clairement la présence du gaufrier, qui a évolué par fragmentation horizontale et verticale pour s’adapter au contenu du scénario. On constate en outre, dans la dernière case, que le corps de Léna déborde du cadre au lieu que celui-ci s’adapte à son contenu. D’un côté, ce débordement crée un effet architectural dans le storyboard en créant un contraste ostentatoire avec le reste de la page, mais d’un autre côté, cela montre que nous sommes encore très éloignés du pôle rhétorique, puisque la case ne s’adapte pas à son contenu, l’auteur devant se résoudre à réduire le corps de Léna dans la version ultérieure pour la «recadrer».
En dépit de cette contrainte, évidemment plus forte sur la dernière case de la planche, la régularité matricielle du gaufrier finit par disparaitre presque complètement dans la version finale, qui offre une beaucoup plus grande hétérogénéité compositionnelle. On constate notamment, dans les cases 4 et 5, que le corps de Léna, qui est allongée sur le sable, impose une reconfiguration débouchant sur une superposition verticale de vignettes au format oblong, qui s’adaptent à leur sujet tout en s’écartant de la grille de départ, qui n’est plus perceptible que dans le premier strip. Dans les versions encrée et crayonnée, le découpage vertical et horizontal ne faisait pas «déborder» les cases du gaufrier, alors que dans la version finale, le strip du milieu présente une variation importante puisque les cases horizontales sont plus courtes que la somme de deux cases, ce qui laisse plus de place pour élargir les deux cases verticales de la fin du strip, qui peuvent ainsi déborder d’une simple case coupée en deux.
En amont du travail de composition auquel procède André Juillard, le scénario rédigé par Pierre Christin propose également un découpage qui témoigne déjà d’une réflexion sur la mise en espace du récit. Alors que le synopsis se présentait sous la forme d’un texte continu, organisé en paragraphes et en lignes de dialogues, le scénario est quant à lui segmenté en cases et en pages. Il est frappant de constater que les planches sont comptées par paires16 (2-3, 4-5, 6-7, etc.), ce qui montre que le scénariste pense d’emblée le récit en fonction des unités graphiques du produit final17. Pour chaque double page, Christin segmente ensuite le contenu en une quinzaine de cases adoptant une numérotation continue, laissant au dessinateur le choix de déterminer le lieu de l’articulation entre les deux planches. On constate d’ailleurs que les annotations manuscrites de Juillard induisent un redécoupage du scénario à partir du travail sur le storyboard: le dessinateur détermine d’abord la charnière entre les planches et procède ensuite à une renumérotation des cases pour la page de droite. 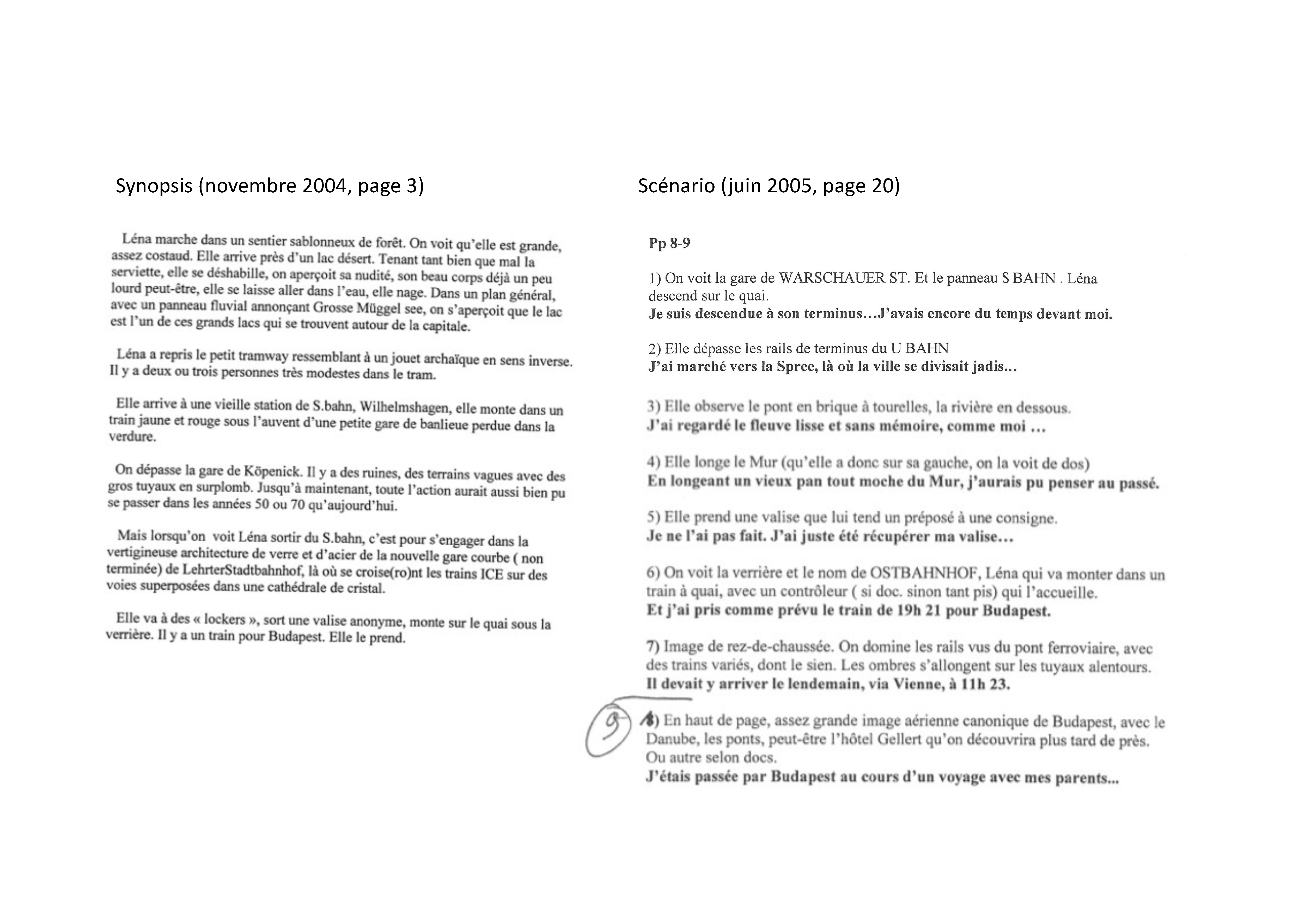
Image 6: synopsis et scénario
© André Juillard & Pierre Christin
Quant au choix de Christin de segmenter les doubles pages en une quinzaine de cases, il se fonde probablement sur un principe d’approximation. Ainsi que l’a précisé Juillard dans un entretien, ce scénario a été écrit sur mesure pour un dessinateur dont les œuvres les plus connues – par exemple sa série Les sept vies de l’épervier ou Le Cahier Bleu, qui lui a valu en 1995 le prix de l’Alph-Art au festival d’Angoulême – s’organisent généralement selon un format assez caractéristique: une mise en page en trois strips, que l’on peut qualifier d’aérée et qui met en valeur le dessin de Juillard, lequel apprécie de représenter des corps aux proportions réalistes dans des décors détaillés, ce qui exige de disposer de plus d’espace que ce que pourrait offrir un découpage sur quatre strips, pourtant assez répandu dans la bande dessinée franco-belge. En cela, Juillard apparait bien comme l’héritier d’Edgar P. Jacobs – dont il a d’ailleurs repris la série Blake et Mortimer – et non comme un continuateur du style d’Hergé, qui avait une approche beaucoup plus rhétorique18. Pour Juillard, une double page canonique consiste donc en une composition articulant deux grilles construites sur une matrice de trois bandeaux de trois cases, soit environ dix-huit cases, qui lui permettent ensuite de moduler des effets, soit à des fins rhétoriques, soit pour architecturer l’espace, souvent en jouant sur des effets de symétrie. Ce qui explique la raison pour laquelle Christin propose généralement trois ou quatre cases de moins que les dix-huit du gaufrier matriciel, c’est qu’il a conscience que le scénario, notamment quand il inclut de longs dialogues ou des récitatifs, exige un étalement de la matière narrative. Cet étalement peut impliquer une fragmentation du contenu en plusieurs «moments» (ce qui conduit à une augmentation du nombre de cases prévues par le scénario) ou une dilatation de la case (ce qui réduit le nombre de cases par rapport à la grille de départ). Par ailleurs, Christin compose avec le fait que le dessinateur doit conserver la liberté d’insérer des cases supplémentaires, fondées sur ce que l’on pourrait appeler des idées graphiques, auxquelles le scénariste n’aurait pas pensé mais qui peuvent surgir au moment de la création du storyboard ou lors de sa reconfiguration lors de l’élaboration de la planche finale.
Si l’on observe le passage du scénario (image 6) au storyboard (image 7), puis à la mise en page finale (image 8), la huitième planche passe ainsi de sept segments à neuf, puis dix cases. On voit notamment que la cinquième vignette est fragmentée in extremis pour isoler la monstration d’un pan du mur de Berlin, dont la nudité coïncide avec le récitatif «Je ne l’ai pas fait». Cette segmentation renforce à la fois l’effet de «virgule» au sein du récitatif, mettant la phrase en saillance, tout en invitant à associer la nudité du mur avec la présence silencieuse d’une pensée refoulée.
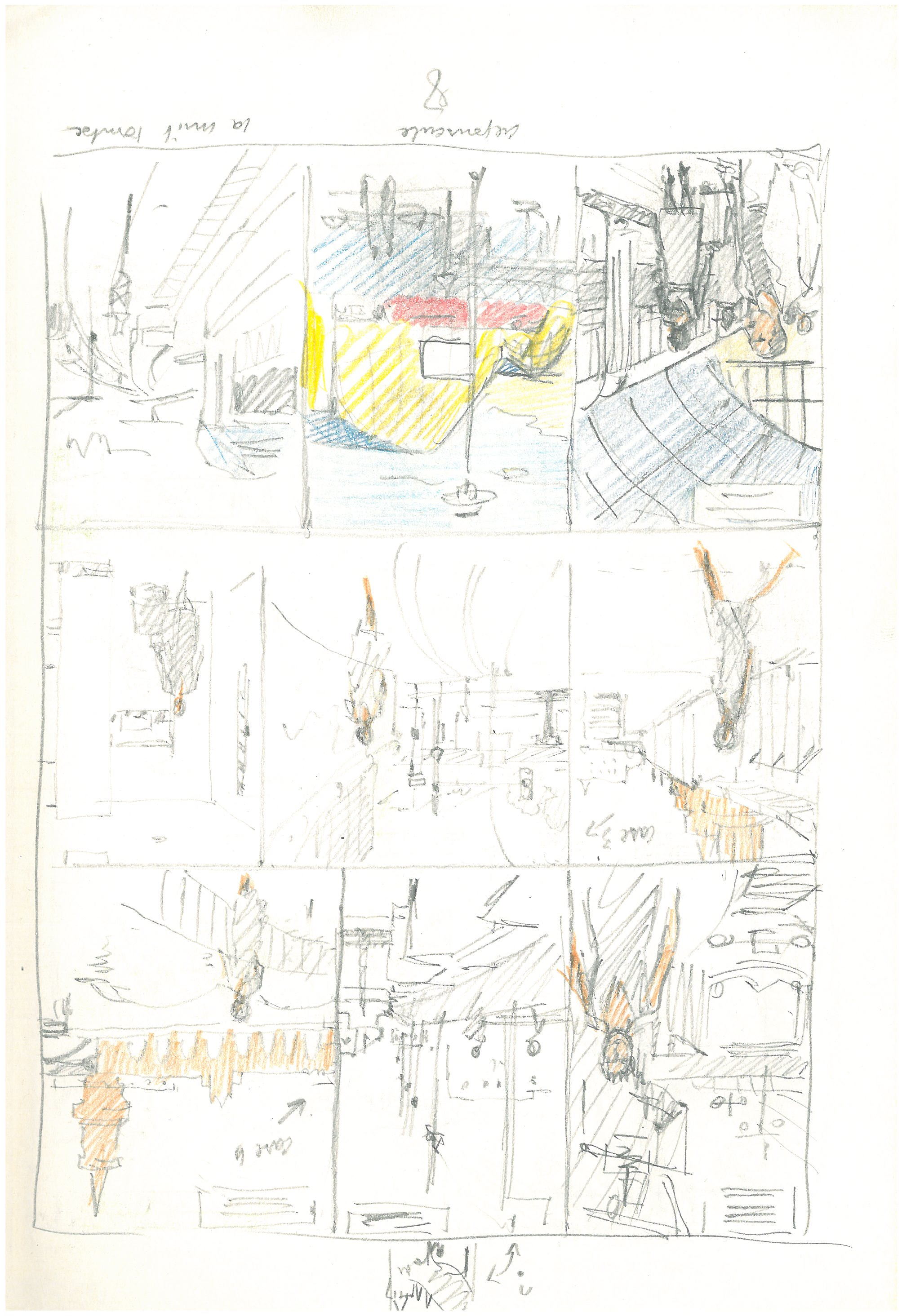
Image 7: Storyboard, planche 8 © André Juillard & Pierre Christin 2005
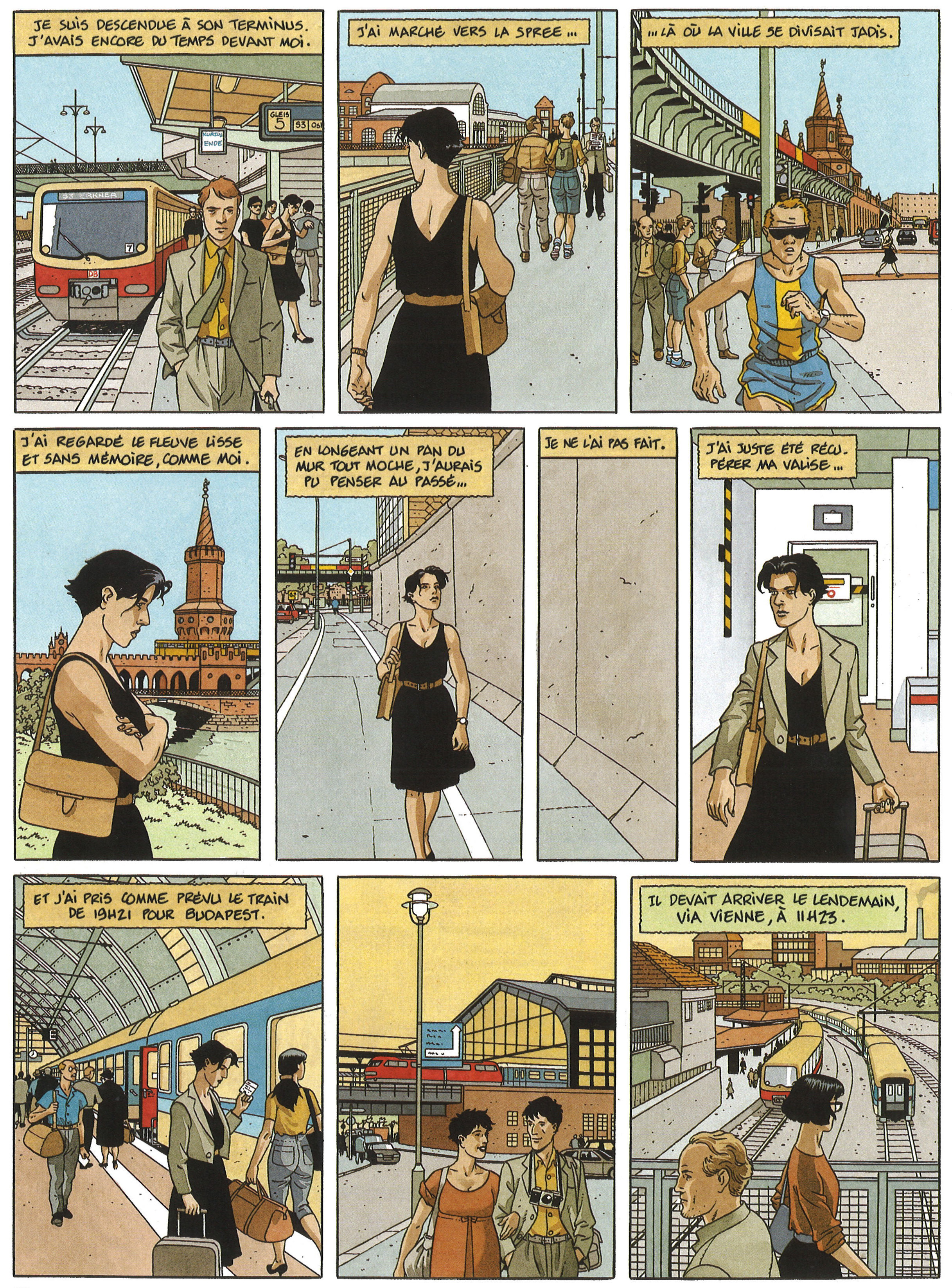
Image 8: Le Long Voyage de Léna, p. 10 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
On constate ainsi que les notions de matrice et de mise en page régulière et semi-régulière s’avèrent particulièrement opératoires pour définir le processus de création de l’œuvre, même si, dans la version publiée, l’album se situe davantage sur le rhétorique ou architecturé. L’espace graphique se construit progressivement sur la base d’un gaufrier de neuf cases, réparties en trois bandes, qui correspond à une sorte de modèle par défaut sur lequel se fondent aussi bien le dessinateur que le scénariste pour déployer la matière de leur récit. Ajoutons que cette matrice confère une sorte rôle hiérarchique par défaut à la cinquième case, du fait de sa position centrale dans la page, et cet effet est souvent accentué graphiquement ou exploité narrativement lors du passage du scénario à la mise en page finale. L’existence de cette matrice facilite indéniablement la coordination entre les deux auteurs et l’engendrement du récit graphique. On peut aller jusqu’à avancer que cette matrice rythme l’imaginaire de Juillard, comme elle organise l’univers graphique des références dont il s’inspire, sous la figure tutélaire de Jacobs. À partir de cette grille de départ, l’auteur peut procéder à divers ajustements pour occuper de manière optimale l’espace dont il dispose, ce qui oriente – suivant les options choisies – sa mise en page vers les pôles rhétoriques ou architecturés. Si ce gaufrier matriciel est parfois bien visible dans le storyboard, le second niveau de configuration, rattachable à la planche finale, opérera presque invariablement un glissement vers d’autres pôles19.
Si j’ai insisté dans un premier temps sur les ajustements de nature rhétorique que l’on observe non seulement dans l’incipit et l’excipit, mais également dans presque toutes les planches bavardes, qui doivent composer avec un espace saturé de textes, Juillard ne manque pas d’explorer des configurations paginales nettement plus ostentatoires. C’est le cas en particulier dans les planches les plus silencieuses de l’album, qui sont presque toutes fortement architecturées. Pour construire ces planches, Juillard exploite notamment des effets de symétrie centrale ou axiale produits par la variation des cases ou par des contrastes visuels ou thématiques, mais il exploite aussi souvent la valeur hiérarchique de l’image située au milieu de la planche.
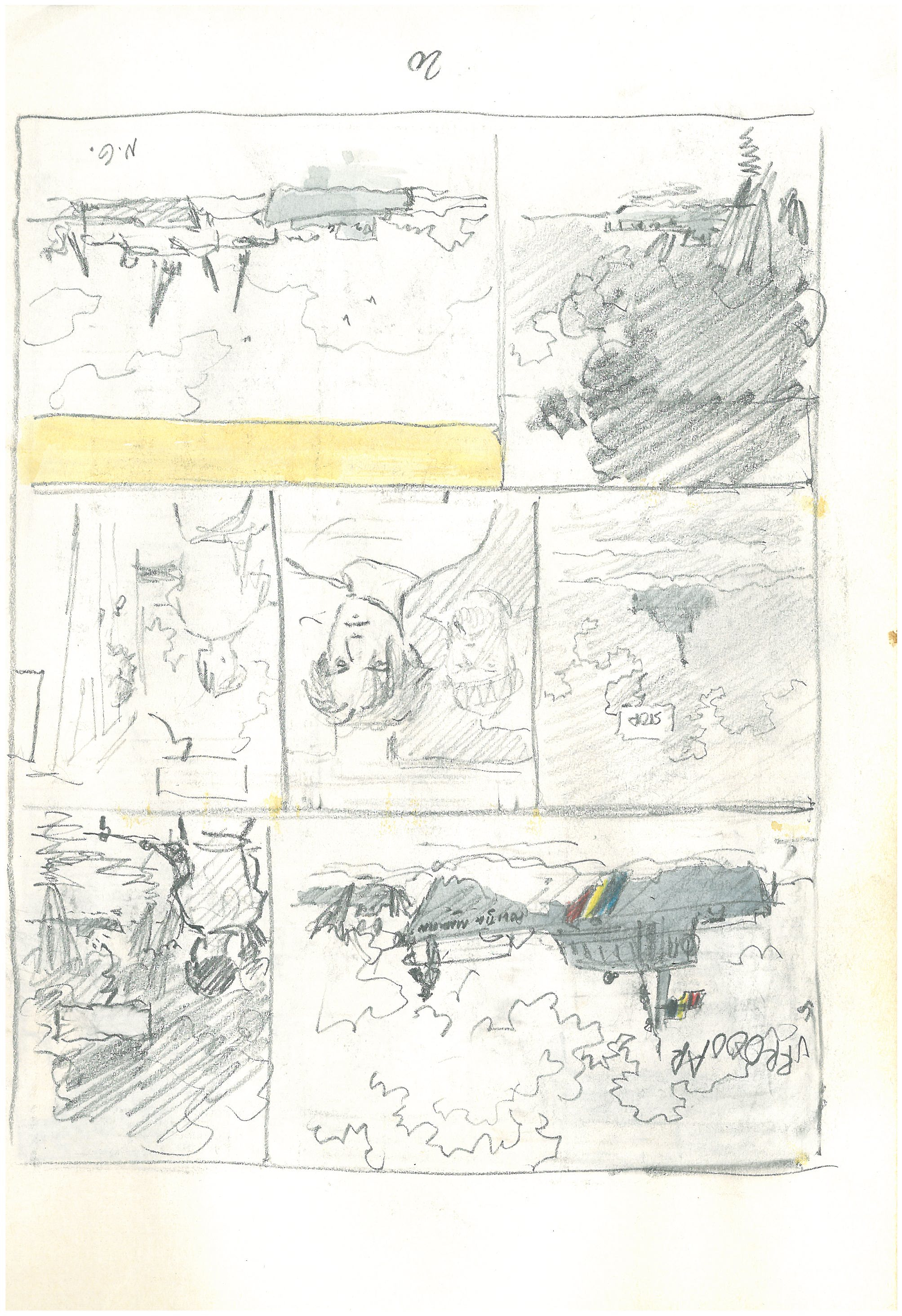
Image 9: Storyboard, planche 20 © André Juillard & Pierre Christin 2005
Ces effets sont exploités dans la vingtième planche, où Juillard joue sur un allongement de la première et de la dernière case pour insérer le dessin détaillé de navires associés à un paysage maritime. Cette déformation construit un effet de symétrie centrale, invitant à contempler la structuration globale de la planche, dont le cœur est occupé stratégiquement par une représentation de l’héroïne. Même si l’isomorphisme du premier et du dernier strip n’est pas parfait, la proximité thématique du contenu des cases renforce la correspondance entre deux segments éloignés du récit qui cadrent la séquence. On remarque aussi, dans la diagonale opposée, un rapprochement entre les arbres de la mangrove, qui se répondent et dont la verticalité contraste avec l’horizontalité des navires. Cette planche montre également que l’effet d’achitecturation de l’espace est davantage prégnant dans ces pages en raison de leur thématique, dans la mesure ou le récit, très silencieux, invite davantage à une contemplation du monde représenté qu’à une lecture linéaire des événements de l’histoire.
Ce procédé va se généraliser vers la fin de l’album, en particulier dans les pages 46 à 54 (qui correspondent aux planches 44 à 52 dans le scénario). Ces pages, pratiquement muettes, se composent selon un principe presque invariant: la construction d’une symétrie axiale verticale à l’échelle globale de la planche (à deux ou trois exceptions près, notamment, pour des raisons clairement rhétoriques, dans le troisième strip de la page 48) et un portrait de Léna, dans une case étroite située centre de la planche, dont le format ne varie jamais, renforçant un effet de tressage iconique entre les pages. Cette architecture est particulièrement visible aux pages 46, 47, 52 et 54, dans la mesure où elle est renforcée par l’isomorphisme des strips 1 et 3 et par le caractère totalement silencieux des images, qui favorise un régime de lecture moins linéaire.
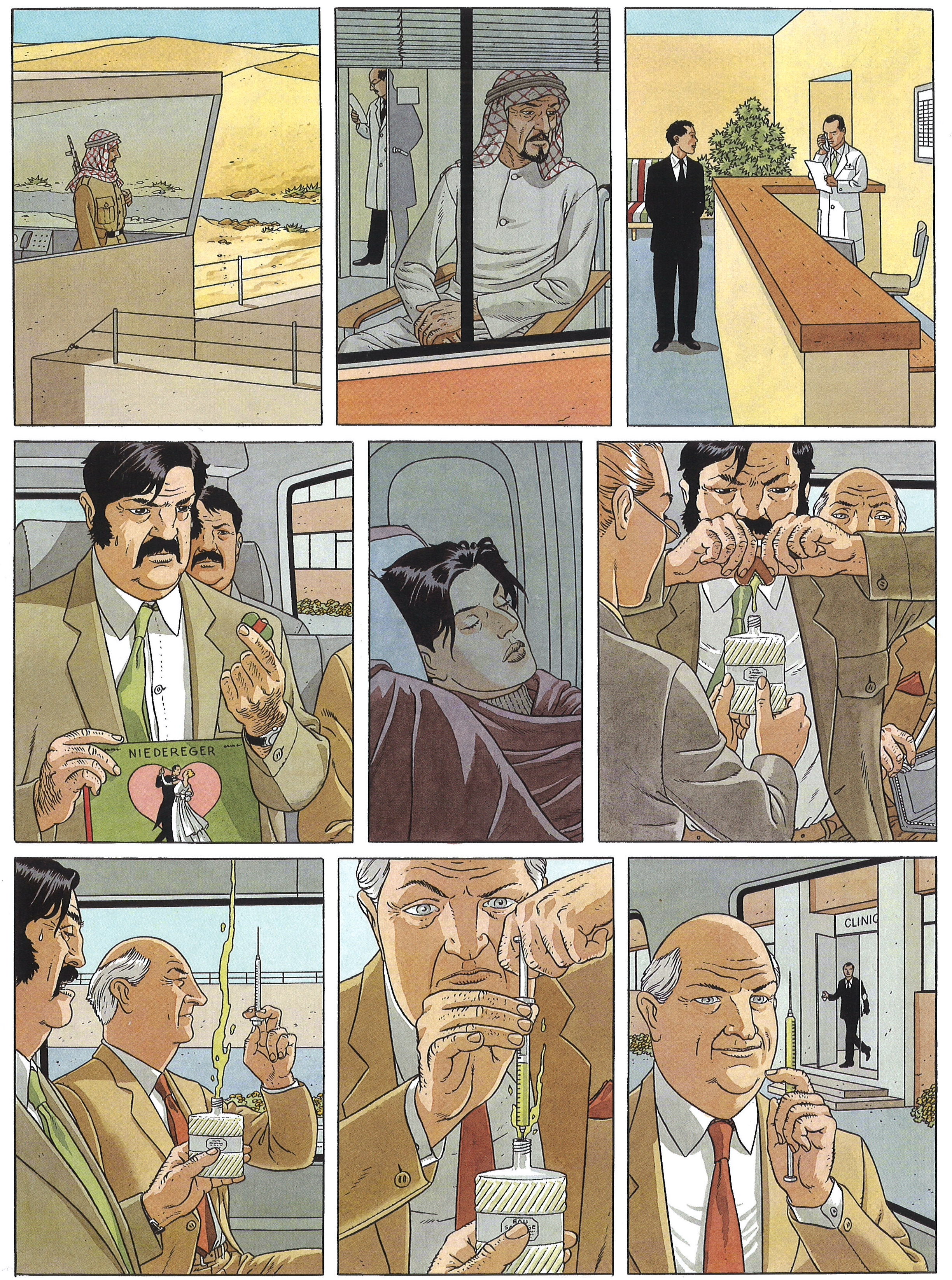
Image 10: Le Long Voyage de Léna, p. 52 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Dans les pages 48 à 53, cette case centrale fonctionne sur le modèle du montage alterné au cinéma: elle insère une référence au voyage en avion de l’héroïne au cœur de la scène focalisée sur les terroristes, quand bien même ces deux évènements ne se déroulent pas dans le même chronotope. Dans ce cas, on peut ajouter que le caractère architecturé de l’espace est renforcé par l’apparence de la vignette centrale, dont l’étroitesse et l’ambiance nocturne du voyage en avion de Léna contraste avec le contexte diurne et très lumineux des cases plus larges qui représentent l’action des terroristes. On peut également signaler l’effet découlant de la récurrence du procédé dans le degré de saillance de la configuration paginale.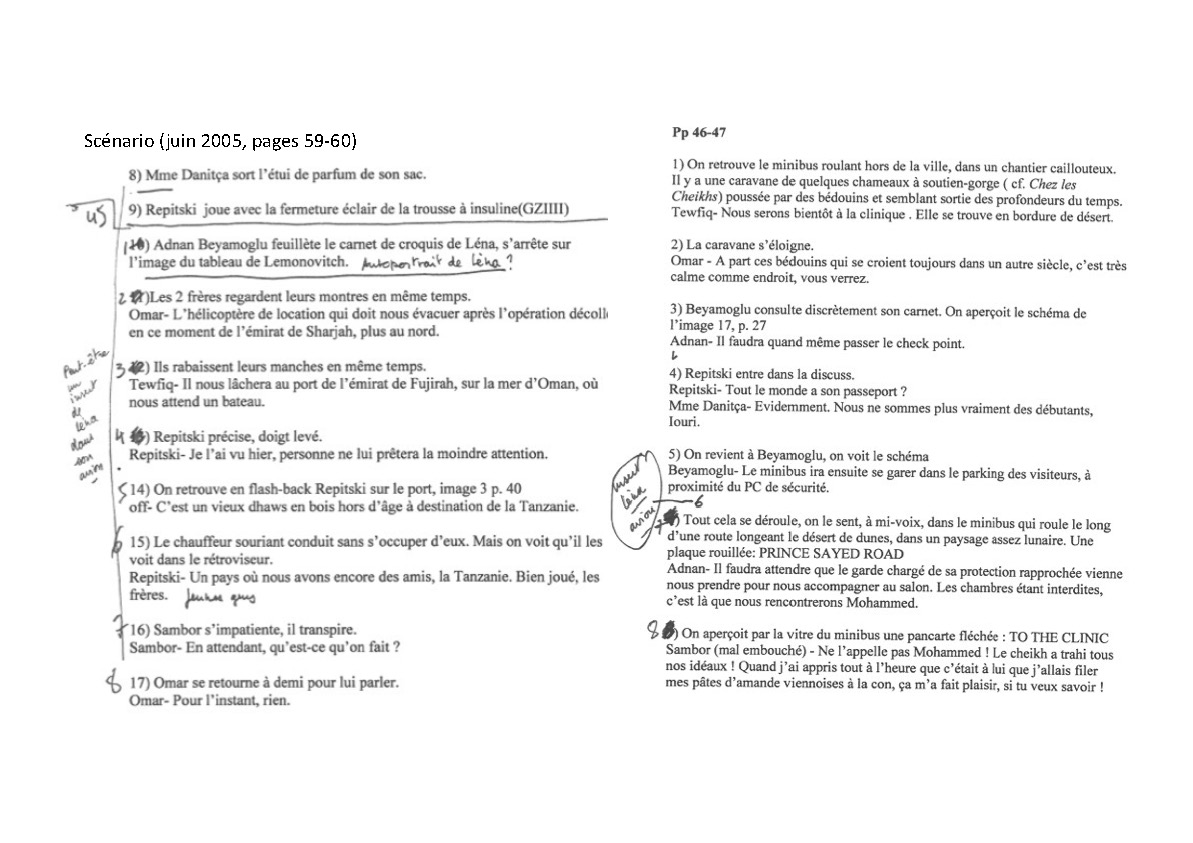
Image 11: scénario du Long Voyage de Léna © André Juillard & Pierre Christin
Il est frappant de constater que cette idée, que l’on pourrait qualifier d’éminemment graphique, est trouvée par Juillard, qui est alors amené à transformer le scénario de Christin pour ajouter ces «inserts» de Léna. Lors d’un entretien qu’il nous a accordé, le dessinateur assume d’ailleurs la paternité de cette idée et en explique l’intérêt narratif:
Cela ne vient pas de Pierre Christin. Ce n’était pas dans le scénario. Cela vient de moi qui avais envie que Léna reste présente. […]C’était une façon de montrer que sa mission continuait bien qu’elle ne soit pas là.
La première occurrence est assez subtile, dans la mesure où Juillard suggère de remplacer un dessin de Lénine par un autoportrait de Léna, de sorte que la contemplation en surcadrage de ses croquis conduise à la replacer au cœur de la planche20, avant que le «montage alterné» se mette en place. L’effet est renforcé par un tressage iconique à l’échelle de la double page: dans la case correspondante de la page précédente, on trouve en effet un autre portrait de Léna, qui la montre installée dans son avion et située au lieu stratégique où le récit bascule d’un régime de focalisation exclusivement centré sur elle, à une perspective qui suivra ensuite le déroulement de l’action des terroristes. Dès la page suivante, Juillard introduit donc systématiquement, au sein du découpage proposé par Christin, une case supplémentaire avec la mention «insert Léna avion», tout en s’arrangeant pour la situer au milieu de la planche et pour l’inscrire dans une série de cases centrales isomorphes. Cet insert est d’ailleurs souligné graphiquement dans le storyboard par l’usage d’une couleur bleue, ajoutée à l’aquarelle, qui vient mettre en évidence la case ou le «dessin21» montrant Léna dans une section du récit où elle est paradoxalement absente ou passive.
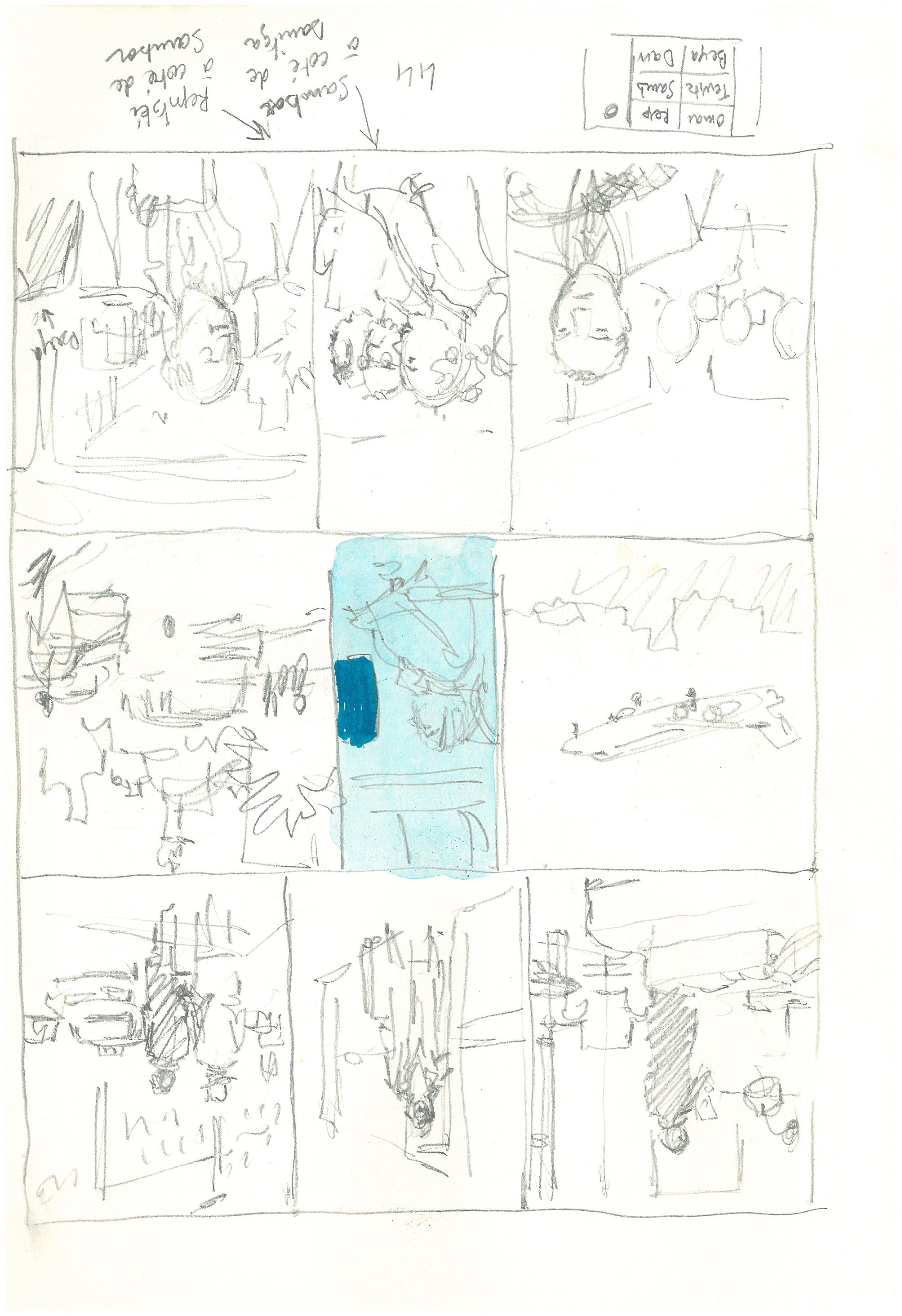
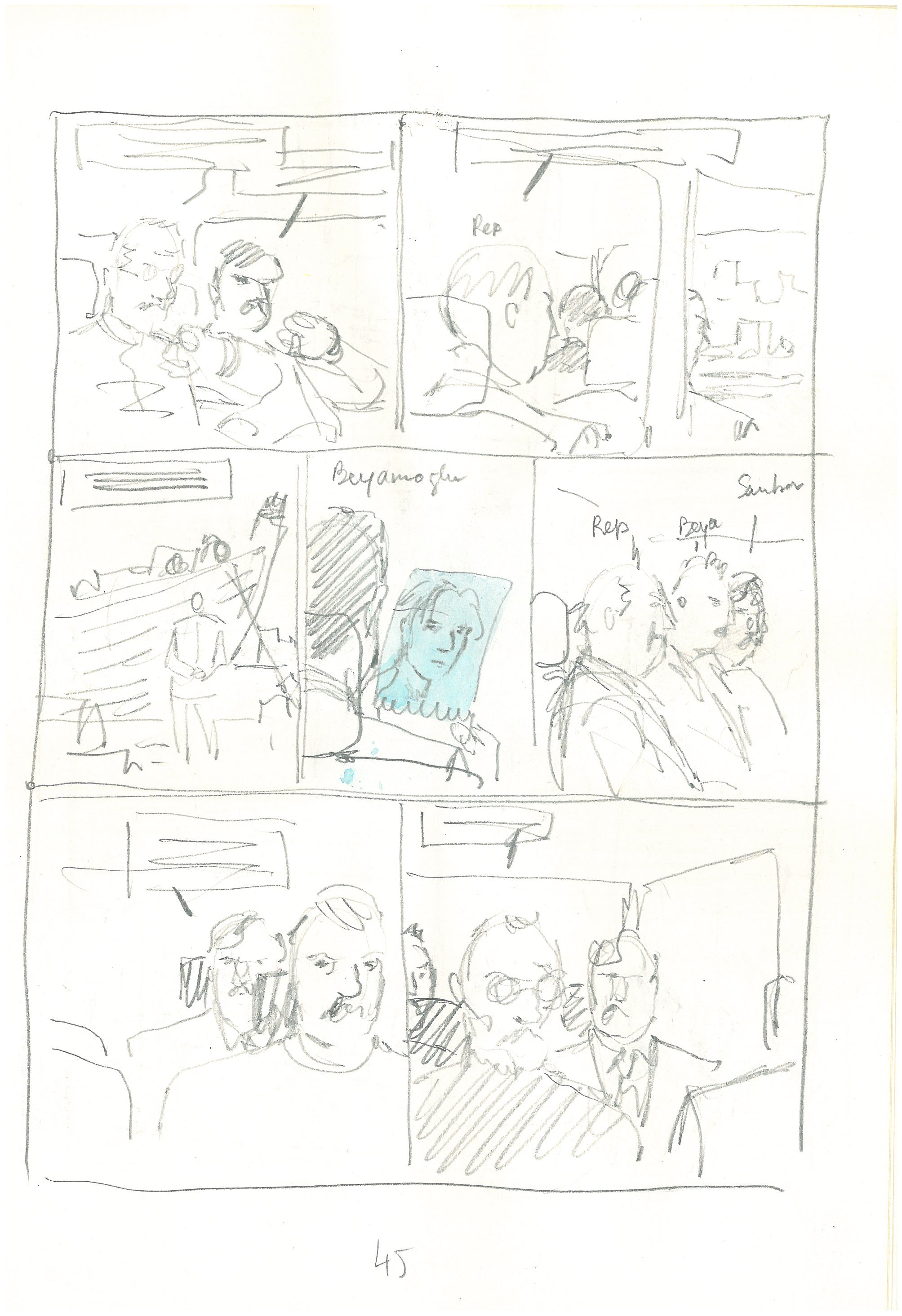
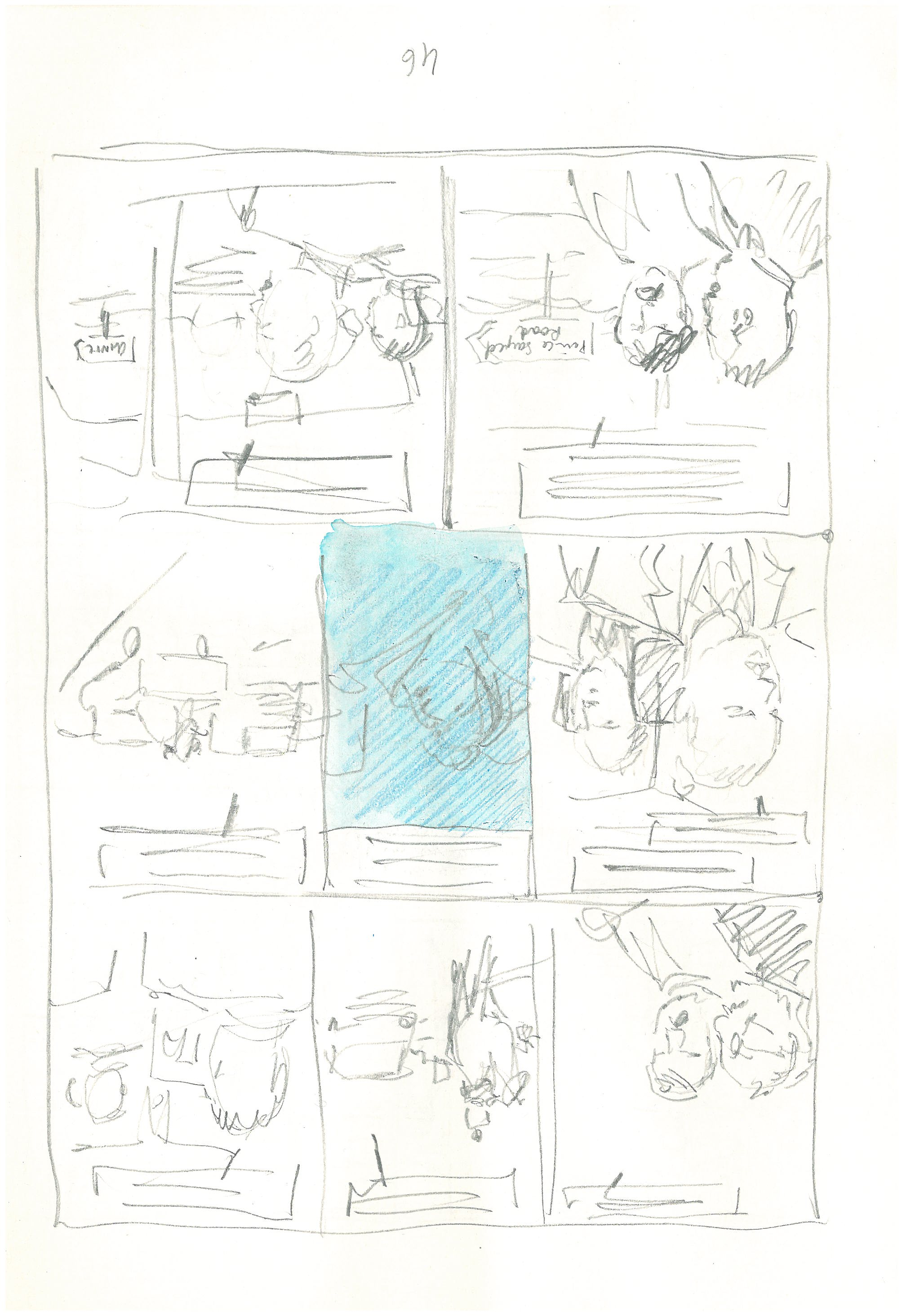
Images 12, 13, 14: Storyboard des planches 44 à 46 © André Juillard & Pierre Christin 2005
On peut enfin mentionner la manière très intéressante dont Juillard exploite localement le gaufrier, qui passe du statut de matrice occultée au rôle de dispositif ostentatoire. Ici, la composition régulière devient saillante, en partie en raison du contexte dans lequel elle s’insère: au sein de l’album, le gaufrier, qui s’étale brusquement sur une double page, tranche avec les compositions antérieures, et cet épisode se distingue aussi par sa fonction dans l’intrigue. De nombreux mystères sont dénoués: Léna décline sa véritable identité, explique ses motivations et finit par révéler l’identité des personnages figurant sur la photo de la case 6, qui avait été montrée comme un leitmotiv aux pages 15, 20, 27 et 32.
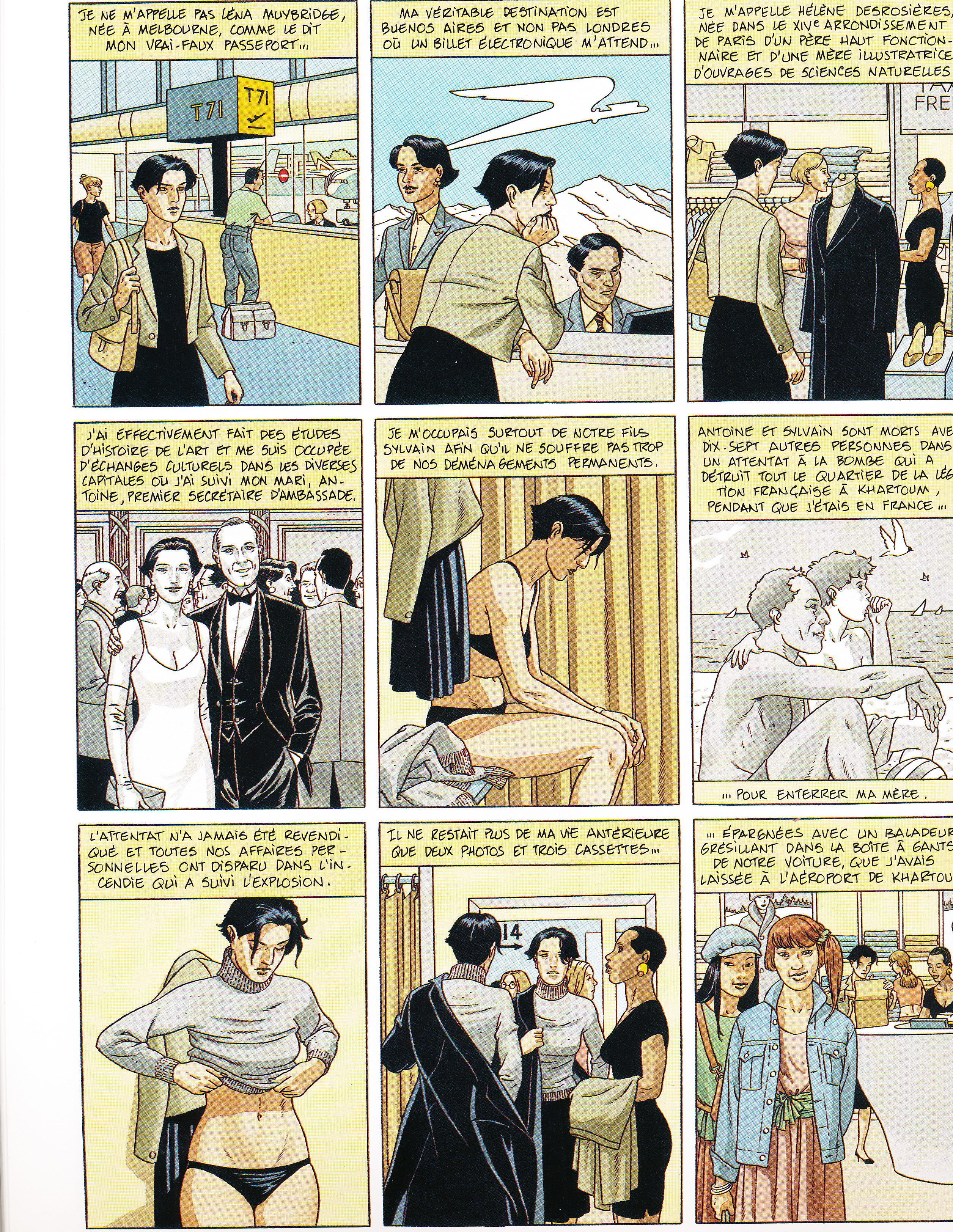
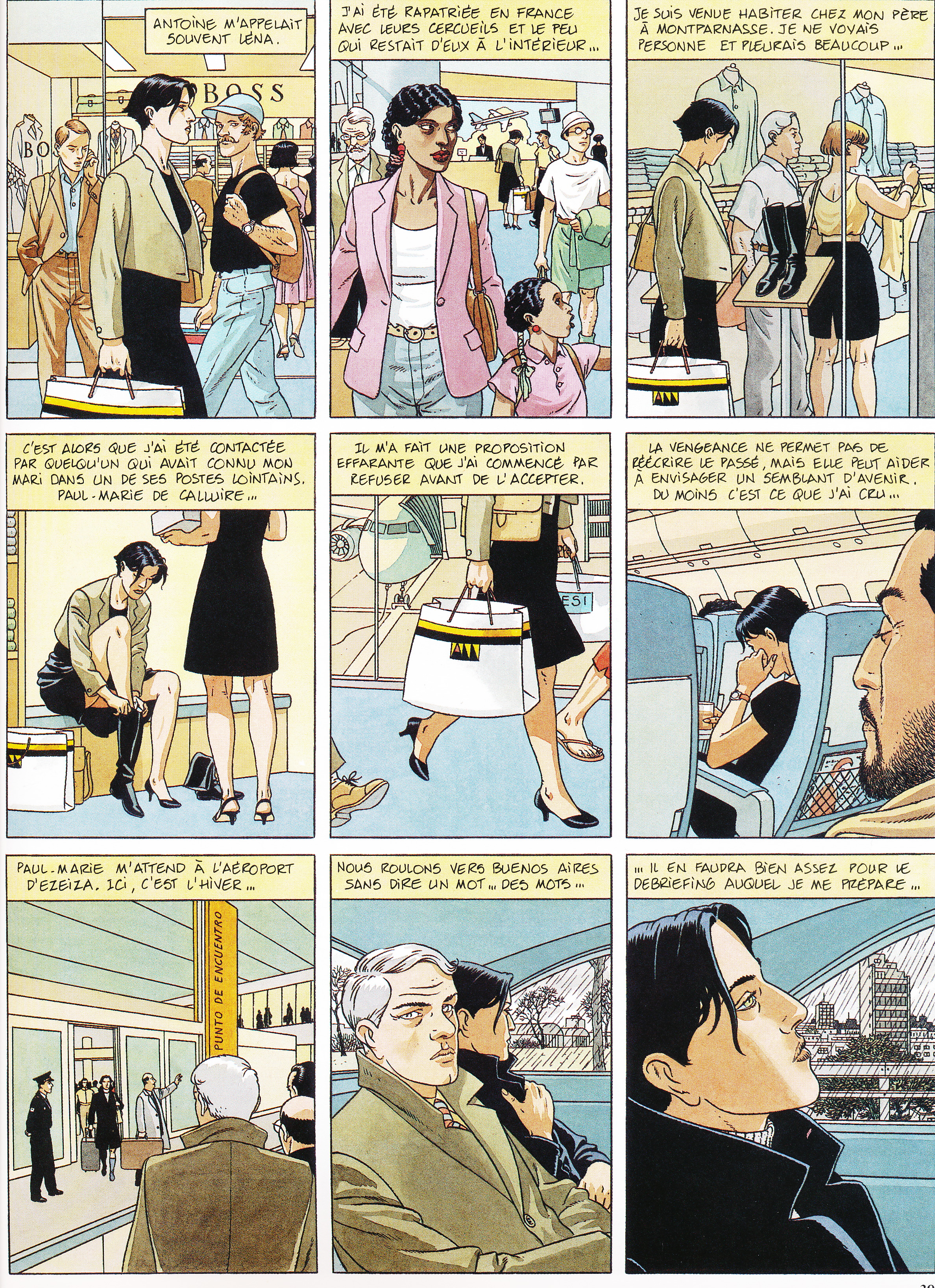
Images 15 et 16: Le Long Voyage de Léna, p. 38-39 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Les pages 38 et 39 sont donc les seules de l’album à adopter ce plan strict du gaufrier et elles tranchent aussi formellement par l’usage systématique du récitatif et l’absence de dialogues. On voit comment Juillard met à profit la valeur expressive du gaufrier, au lieu de le déformer pour l’adapter aux contraintes de son récit. L’absence de variation dans la dimension des cases donne l’impression que les images ne sont pas vraiment coordonnées, qu’elles ne s'imbriquent pas dans la structure organique de la page, ce qui renforce l’effet d’un rythme régulier et dépourvu de relief. Les images deviennent illustratives (quand elles montrent les photos de l’époux ou du fils de Léna) ou anecdotiques (quand elles montrent Léna achetant des vêtements et prenant l’avion). Ce que l’on peut considérer comme un sommaire graphique se subordonne à la voix l’héroïne, sur laquelle repose entièrement la progression narrative. Léna semble perdue dans ses pensées: on la montre méditative, se laissant porter par l’accomplissement d’actions routinières, désormais dépourvues d’importance. L’intrigue est déjà dénouée pour elle. La composition graphique de cette séquence semble ainsi renforcer la perspective distanciée d’une voix over fatiguée, qui peut enfin libérer des pensées réprimées et laisser derrière elle les tensions inhérentes à l’accomplissement de sa mission.
Conclusion
Le modèle que je propose d’introduire pour l’analyse de la mise en page apparait finalement davantage comme un perfectionnement ou une réarticulation des modèles antérieurs que comme une véritable rupture avec ces derniers. La typologie circulaire intègre en particulier les critères dégagés par Groensteen, à savoir le caractère plus ou moins régulier ou ostentatoire du dispositif, tout en reprenant les catégories rhétorique, régulière et semi-régulière de Peeters et Chavanne, ainsi que la notion de matrice introduite par ce dernier. Enfin, ce qui est peut-être encore plus important, ce modèle se fonde sur un principe qui se trouve au cœur de l’approche de Peeters, à savoir que la déformation d’une case au sein d’un système fondé sur la répétition produit une irrégularité qui peut s’expliquer de deux manières différentes: soit elle répond à la nécessité d’adapter le cadre de l’image au contenu représenté (ce qui correspond au pôle rhétorique), soit elle vise à accentuer la dimension tabulaire de la planche en produisant des effets que l’on peut qualifier de décoratifs ou de productifs (ce qui la fait basculer du côté de l’architecture).
La principale innovation, déjà suggérée par Chavanne, tient au caractère progressif des catégories retenues, qui sont redéfinies comme des pôles au sein d’un continuum plutôt que comme des unités discrètes formant un tableau à double entrée. La seconde innovation repose sur l’introduction d’un nouveau prototype, que j’ai appelé mise en page architecturée. En soi, ce pôle n’est pas entièrement original car il découle de la fusion des types décoratif et productif, que je place sur le versant ostentatoire des compositions semi-régulières. En outre, il dérive des nombreuses études ayant souligné la parenté entre architecture et mise en page dans un médium tel que la bande dessinée. L’usage du qualificatif architecturé vise avant tout à définir un principe formel qui se trouve au fondement des mises en page ostentatoires. Ce principe repose sur la possibilité de déceler la présence d’une régularité au sein de l’irrégularité en changeant d’échelle, ce qui revient à décrire une configuration créative de la planche, qui s’écarte peu ou prou des structures conventionnelles, c’est-à-dire de la régularité du gaufrier ou du caractère apparemment aléatoire (car lié à des contraintes locales) des variations de la mise en page rhétorique.
Pour devenir pleinement opératoire, ce modèle devra probablement évoluer, être clarifié et simplifié. D’un point de vue terminologique, on pourra par exemple regretter que les trois pôles soient labellisés avec des termes qui n’appartiennent pas au même paradigme. Peut-être vaudrait-il mieux substituer au substantif gaufrier l’adjectif régulier. Avec le recul, l’adjectif rhétorique n’est peut-être pas si transparent, en dépit de son usage courant chez les spécialistes, car il suggère la présence d’un effet sur le lecteur, ce qui le placerait sur un versant plus ostentatoire. Pour aller plus loin dans la transposition didactique, on pourrait aussi s’émanciper davantage des principes dont dérive le modèle, par exemple en abandonnant la mention des axes de la régularité et de l’ostentation, au profit d’une description plus empirique des trois prototypes et des compositions intermédiaires.
À ce stade, la valeur que l’on peut reconnaitre à ce modèle en devenir est d’offrir un outil suffisamment souple pour dépasser l’impression que la mise en page d’un album tel que Le Long Voyage de Léna serait uniforme ou simplement rhétorique. Il permet au contraire de saisir les nuances locales qui font glisser le dispositif vers tel ou tel pôle, tout en montrant comment les pages dérivent d’une matrice plus ou moins identifiable. Il n’est évidemment pas toujours possible de disposer de documents génétiques permettant de remonter à cette matrice, mais dans de nombreux cas, il est possible d’en déduire les contours en repérant au fil des pages des invariances sur lesquelles repose l’imaginaire graphique de l’auteur. Toutefois, même si l’analyse des planches ne permet pas de définir un principe génétique sous-jacent, ce modèle permet de classer chaque mise en page à une plus ou moins grande distance de tel ou tel pôle, ce qui permet à la fois d’objectiver les éléments formels caractérisant la composition, tout en réfléchissant aux effets produits par ce dispositif. Pour rendre le cercle typologique plus lisible – à l’instar du cercle des situations narratives de Stanzel –, on pourrait en proposer des déclinaisons illustrées en disposant différents types de planches à une plus ou moins grande distance des trois pôles fondamentaux, dont le sens s’éclairerait de manière plus empirique que théorique.
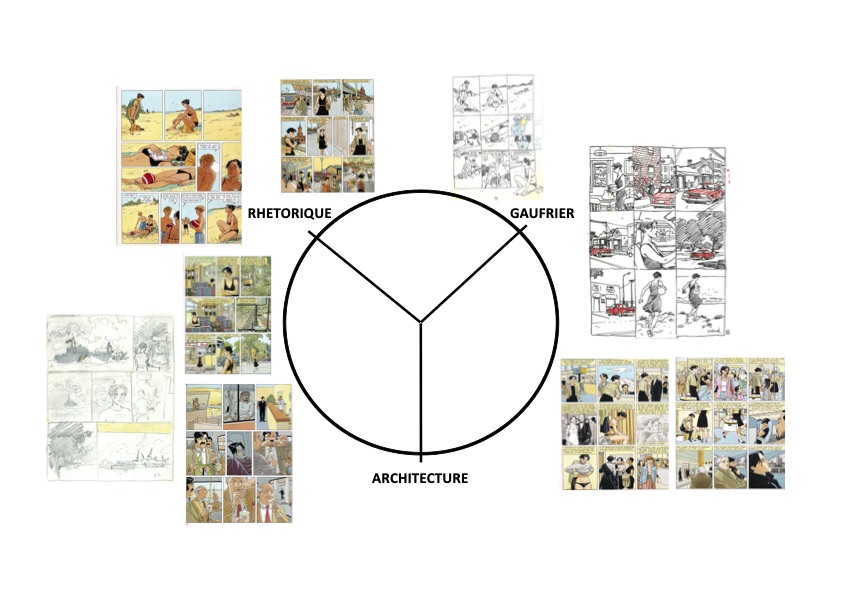
Schéma 2: Classement des planches dans un cercle typologique simplifié
En lien avec l’imaginaire graphique de Juillard, lui-même en partie dérivé des mises en page de Jacobs, j’ai beaucoup insisté sur les effets de symétrie architecturant la planche, mais il y a bien d’autres manières de produire des effets similaires, en jouant sur les contrastes entre les cases ou sur leur contenu graphique. Il faut ajouter qu’il y peut y avoir, sur le pôle des mises en page architecturées, d’importantes variations en termes de degré de visibilité et de complexité des structures, les cas les plus expérimentaux et les plus inextricables étant certainement incarnés par les compositions de Chris Ware. À l’opposé de cette esthétique du scriptible, Juillard déploie au contraire beaucoup d’efforts pour que les variations du gaufrier demeurent toujours très lisibles et même plus ou moins invisibles. L’architecture de la page doit ainsi accomplir ses effets sans nuire à l’immersion ou briser le rythme de la lecture et, en cela, elle reste assez conventionnelle. Ses compositions aérées et plus ou moins architecturées induisent néanmoins un rythme que l’on pourrait qualifier de contemplatif22, à l’instar du long voyage de Léna, qui apprécie de prendre son temps dans ses déambulations. Cette dernière commente son itinérance en ces termes: «Aller où je dois aller, même si c’est lent…» (p. 19). Les déplacements de l’héroïne à pied, à la nage, en train, en bus, en tram, en navire ou dans de vieilles voitures se situent ainsi aux antipodes de la passion hergéenne pour la vitesse mécanique23, mais ils sont au diapason de cette manière très personnelle dont André Juillard occupe l’espace de son médium et construit la lecture de ses albums.
Références
Amiel, Vincent (1986), «Bande dessinée et architecture: l’espace encadré», Les Cahiers de la bande dessinée, n° 69, p. 24-25.
Baetens, Jan (2016), «La question du rythme entre texte et bande dessinée: l’exemple de "Boule de Suif" dans Maupassant. Contes et nouvelles de guerre (Battaglia)», French Forum, n°14 (3), p. 289-301.
Baetens, Jan (2006), «Hergé, auteur à contraintes? Une relecture de L'Affaire», French Forum, n° 31 (1), p. 99-111.
Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.
Baetens, Jan & Kathryn Hume (2006), «Speed, Rhythm, Movement: A Dialogue on K. Hume’s Article "Narrative speed"», Narrative, n° 14 (3), p. 349–355.
Baetens, Jan & Pascal Lefèvre (1993), Pour une lecture moderne de la bande dessinée, Bruxelles, Centre Belge de la Bande Dessinée.
Baroni, Raphaël (2021), «Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée», Lettre de l’AIRDF, n° 68, p. 49-54.
Baroni, Raphaël (2018), «Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne: une segmentation précaire», Cahiers de narratologie, n° 34. En ligne, consulté le 12 août 2021, URL: http://journals.openedition.org/narratologie/8594
Baroni, Raphaël, Gaëlle Kovaliv & Olivier Stucky (2021), «La transition numérique de la bande dessinée. Une mutation impossible?», Belphégor, n° 19 (2). En ligne, consulté le 16 août 2021, URL: https://journals.openedition.org/belphegor/3948
Boillat Alain (2018), «Reflets des cités: les mondes en miroir (sans tain) de Schuiten
et Peeters», Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry, n° 38 (1-2), p. 141–162.
Chavanne, Renaud (2010), Composition de la bande dessinée, Montrouge, PLG.
Chavanne, Renaud (2005), Edgar P. Jacobs et le secret de l’explosion, Montrouge, PLG.
Chiss, Jean-Louis (2003), «La littératie: quelques enjeux d’une réception dans le contexte éducatif et culturel français», in La littéracie: conceptions théoriques et pratiques d'enseignement, p. 43-52.
Christin, Pierre & André Juillard (2006), Le Long Voyage de Léna, Paris, Dargaud, coll. «Long Courier».
Cohn, Jesse (2009), «Mise-en-Page: A Vocabulary of Page Layouts», in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 44-57.
Dufays, Jean-Louis (2017), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n° 45. En ligne, URL: http://trema.revues.org/3486
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2015), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 3e édition.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1976), «Du linéaire au tabulaire», Communications, n° 24, p. 7-23.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (2001), «Le réseau et le lieu: pour une analyse des procédures de tressage iconique», in Time, Narrative & the Fixed Image. Temps, narration & image fixe, J. Baetens & M. Ribière (dir.), Amsterdam, Rodopi, p. 117-129.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration. Système de la bande dessinée 2, Paris, PUF.
Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), «Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée», Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107. En ligne, consulté le 14 août 2021, URL: http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305/1807
Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.
Kukkonen, Karin (2020), «The Speed of Plot. Narrative Acceleration and Deceleration», Orbis Litterarum, n° 75 (2), p. 73-85.
Labio, Catherine (2015), «The Architecture of Comics», Critical Inquiry, n° 41 p. 312-343.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La littératie médiatique multimodale, Québec, Presses Universitaires du Québec.
Lefèvre, Pascal (2009), «The Conquest of Space: Evolution of Panel Arrangements and Page Layouts in Early Comics Published in Belgium (1880–1929)», European Comic Art, n° 2 (2), p. 227-252.
Letourneux, Matthieu (2017), Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil.
Marcoux, Marie-Hélène (2015), La BD au secondaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.
Marcoux, Marie-Hélène (2018), La BD au primaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.
Marion, Philippe (1997), «Narratologie médiatique et médiagénie des récits», Recherches en communication, n°7 p. 61-88.
Meyer, Jean-Paul (2019 [2012]), «À propos des albums de BD adaptés de romans: de la transposition littéraire à la transposition didactique», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, p. 157-170.
Missiou, Marianna (2019 [2012]), «Un médium à la croisée des théories éducatives: bande dessinée et enjeux d’enseignement», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Editions, p. 79-98.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Peeters, Benoît (1991), Case, planche, récit: comment lire une bande dessinée, Paris, Casterman.
Ricardou, Jean (1978), Nouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil.
Rosen, Elizabeth (2009), «The narrative intersection of image and text: teaching panel frames in comics», in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 58-66.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2019 [2012]), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, UGA Éditions.
Sohet, Philippe (2010), Pédagogie de la bande dessinée. Lecture d’un récit d’Edmond Baudoin, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Stanzel, Franz Karl (1955), Die Typischen Erzählsituationen im Roman, Wien, Braumüller.
Stucky, Olivier (2021), «La planche de bande dessinée comme interface: déplacer les rapports texte-image», Arkhaï, n° 16, p. 127-148.
Pour citer l'article
Raphaël Baroni, "Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022http://www.transpositio.org/articles/view/decrire-et-interpreter-l-architecture-graphique-des-bandes-dessinees-lena-mise-en-page
Voir également :
Enseigner Proust illustré
Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même.
Enseigner Proust illustré
Quel Proust?
Enseigner Proust commence par une question simple mais fondamentale: qu’est-ce qu’on peut entendre par «Proust»? Quatre réponses au moins, qui ne s’excluent pas les unes les autres, sont possibles: d’abord l’œuvre, puis l’homme et le contexte historique et culturel qui était le sien, ensuite l’histoire matérielle de son travail, et enfin l’histoire matérielle de ses publications. En simplifiant un peu, ces approches correspondent à quatre domaines de la recherche, aux frontières souvent peu étanches: la stylistique (pour l’étude de l’œuvre), l’histoire littéraire (pour l’étude de l’homme et de son époque), la génétique (pour ce qui est des manuscrits) et l’histoire du livre (pour ce qui est des textes publiés). Chacune de ces options soulève toutefois un certain nombre de problèmes didactiques.
S’agissant de l’œuvre, on peut se demander s’il est permis de réduire le travail de Proust à la seule Recherche, puis cette dernière à quelques extraits plus ou moins artificiellement détachés de l’ensemble, comme cela se fait la plupart du temps. Certains de ces fragments peuvent être très longs, comme Un amour de Swann, roman «autonome» enclavé dans la Recherche; d’autres, qu’on retrouve presque inchangés depuis bientôt cent ans, sont très courts, comme la scène de la madeleine ou la mort de Bergotte. Dans l’un et l’autre cas, il convient de se demander si pareille sélection n’est pas une défiguration de l’écriture proustienne. Quelque chose se gagne (c’est sans doute la seule manière possible de commencer à faire lire Proust à l’école), mais inévitablement le parti pris des morceaux choisis fait aussi perdre quelque chose. L’expérience du temps, si essentielle à une véritable expérience de la Recherche, est difficile à faire passer à travers cette approche anthologique (sur cette question fondamentale, voir Kuentz 1972). Mais comme le but de l’enseignement de Proust est aussi de pousser à faire découvrir l’ensemble de l’œuvre au-delà de ces quelques fragments, il peut être recommandé de confronter les élèves dès le début avec l’«autre» Proust, celui de la correspondance ou celui des pastiches, par exemple, et de pointer déjà vers le va-et-vient entre écriture fictionnelle et autres formes d’écriture. Comme pas mal d’autres auteurs de fiction, Proust n’arrête pas de recycler des textes de non-fiction (les siens et d’autres).
Or, le mot «Proust» ne désigne pas seulement le texte de l’auteur, c’est aussi une longue série de commentaires qui ont fini par faire corps avec la création initiale. La valeur d’une grande œuvre est en effet fonction de la qualité des lectures qu’elle est capable d’engendrer et en ce sens on devrait accepter pour Proust ce qu’on considère comme allant de soi pour Shakespeare ou Dante, à savoir que les analyses de l’œuvre ne sont pas de simples greffes ou ajouts, mais une partie essentielle de l’œuvre même. Lire «innocemment», sans connaissance des interprétations déjà existantes, n’est jamais qu’une illusion. Encourager les élèves à lire Proust implique nécessairement – le contraire serait une mutilation – les inciter à prendre connaissance de la réception de Proust à travers le temps. Je me permets d’insister sur la dimension diachronique de ce geste, pour éviter qu’on ne tombe dans les écueils du présentisme: Proust queer, certes, mais pas seulement. Le livre de Pierre Bayard sur Proust et la poétique de la digression (Bayard 1996) peut rendre ici de vrais services, d’autant plus qu’il permet aussi de réfléchir au geste de l’extraction de morceaux et à l’impossibilité de trancher entre narration (le «sujet») et digression (le «hors-sujet»). L’ouvrage de Bayard a l’avantage de privilégier les grandes questions de l’écriture comme de la lecture du texte proustien: comment donner forme à un univers d’une telle ampleur, comment s’y repérer? que faire de la tension entre le désir de tout dire et de tout lire d’une part et la difficulté de donner sa juste place à tout, c’est-à-dire à ne pas se perdre dans trop de détails (pour l’auteur) et ne pas céder à l’envie de sauter certains passages (pour le lecteur)? De plus, Bayard a aussi l’élégance et la sagesse de ne pas éviter le retour sur des morceaux connus, tout en aidant à décrisper l’écart entre le tout et la partie.
En deuxième lieu, enseigner Proust signifie également enseigner l’auteur et son époque. Ici aussi, les questions qui émergent sont immenses. Faut-il séparer l’homme et l’œuvre? La seule idée de pareil clivage paraît un contresens, mais tel n’a pas toujours été de l’avis des critiques. Même aujourd’hui, à l’époque du biographisme triomphant, il est parfaitement légitime, mais pas forcément toujours possible bien entendu, de lire l’œuvre sans trop tenir compte de l’homme. Et que faut-il entendre par contexte? Comment en circonscrire les extensions littéralement infinies? Comme le remarquait judicieusement Jonathan Culler: «Meaning is context bound, but context is boundless» (Culler 1997: 67). Que faire aussi de la notion d’anachronisme, qui est un des nombreux facteurs cassant l’homogénéité d’un contexte? Après tout, la Recherche évoque un monde qui, au moment de la percée de Proust, juste après la Première Guerre Mondiale, n'existait déjà plus, tandis que sa propre écriture et son grand projet romanesque n’ont rien de «moderne» (au sens de «contemporain»): la Recherche achève la tradition des grandes sommes romanesques du 19e plus qu’elle n’annonce Dada ou le surréalisme, mouvement littéraire soit hostile au roman, soit inventant comme sous le manteau de nouvelles formes de roman (Sermier 2022). Les questions liées à la biographie et à l’analyse contextuelle ne peuvent avoir de réponse concluante. Ne pas les poser n’est toutefois guère souhaitable.
Enfin, troisième approche, sur laquelle j’aimerais me concentrer dans les pages qui suivent, le mot «Proust» peut renvoyer aussi à une série d’objets matériels. Il y a d’abord les manuscrits, auxquels s’intéressent non seulement les études génétiques mais aussi les bibliophiles et, de plus en plus, les commissaires d’exposition, parfois dans une logique de «démédiation» de la littérature convertie en objet à voir, c’est-à-dire en création plastique ou sculpturale (Stewart 2010, Baetens et Sánchez-Mesa 2019). À cela s’ajoutent les diverses éditions des textes de Proust, sur lesquels se penchent les spécialistes en histoire du livre, devenue aujourd’hui l’histoire de toute la chaîne du livre (Darnton 1992).
Dans le cas de Proust, l’accent est massivement mis sur les manuscrits et ce dès le début de la diffusion plus large de son travail, avant même que la totalité de la Recherche n’ait vu le jour sous forme de livre (l’écriture de l’œuvre s’étend de 1906 à 1922, sa publication en sept tomes va de 1913 à 1927). En effet, le numéro d’hommage de la Nouvelle Revue française du 1er janvier 1923 consacre déjà l’essentiel de son dossier iconographique à la reproduction en fac-similé des cahiers et carnets de Proust – il est vrai des objets de toute beauté, mais qui prennent curieusement la place des «illustrations», absentes quant à elles. Il n’y a ainsi plus nulle trace des images ayant accompagné l’édition originale du premier livre de Proust, Les Plaisirs et les jours (1896), qui étaient pourtant de la main d’un des modèles de Madame Verdurin, à savoir Madeleine Lemaire.
On ne peut que s’étonner du relatif silence qui pèse sur le versant «imprimé» de l’œuvre proustienne, surtout du côté de la critique génétique, presque exclusivement focalisée sur les manuscrits (mais le regard porté sur les états imprimés du texte est également assez réduit du côté des chercheurs en histoire matérielle du livre). Certains aspects de la vie éditoriale de l’écrivain se voient inlassablement répétés, comme le refus du premier tome de la Recherche, la publication à compte d’auteur, chez Grasset, de ces pages en 1913, les discussions plus récentes, mais finalement pas trop vives, de la nouvelle version de l’œuvre en la Pléiade (aujourd’hui en quatre volumes, et non plus en trois comme au début), ou encore les réactions mi-sceptiques mi-admiratives devant l’édition anniversaire d’Un amour de Swann, «orné» en 2013 par Pierre Alechinsky. Sinon, Proust est étudié dans le texte (les manuscrits), mais «hors livre». La raison en est sans doute le prestige exceptionnel des manuscrits, qui monopolisent l’attention de quiconque s’intéresse à la matérialité de l’écrit proustien, mais la lacune des travaux sur les éditions de l’œuvre n’en est pas moins fort regrettable. La postérité éditoriale de Proust mérite un examen plus attentif, dont les avantages didactiques sont tout sauf négligeables. À cet égard, un aspect singulier se détache: les éditions illustrées de la Recherche.
Premiers écueils, premiers pas méthodologiques
Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, quand bien même il ne peut être question les considérer toutes (en pratique, bien des éditions de luxe à tirage hyper-réduit resteront par définition inaccessibles, tandis que les adaptations en bande dessinée relèvent en partie d’une approche un rien différente). D’abord parce que lire les illustrations prend moins de temps que lire un texte de trois mille pages (notes et variantes non comprises), ce qui est un critère pratique essentiel dans toute forme d’enseignement. Ensuite parce que l’accent mis sur la dimension visuelle de la littérature est plus proche de la culture d’accueil des jeunes, dont beaucoup ont pris le tournant visuel, autorisant ainsi un rapport plus direct et a priori plus empathique avec l’œuvre de départ. Le rapprochement entre sphères a priori non contiguës ne se limite pas à la proximité de cet aspect particulier de l’œuvre de Proust et des nouveaux modes de consommation culturelle. Il aide aussi à inscrire l’enseignement de la Recherche dans le retour en force des études historiques en littérature, après le triomphe des études formelles, pour ne pas dire formalistes, des années 60 et 70 dont les effets se font toujours sentir dans certains modèles pédagogiques. Enfin, la mise en avant des illustrations suit également la tendance de plus en plus «lourde» des arts de l’écriture d’abolir les frontières entre mots et images, hybridation tout à fait intégrée à la pratique des poètes contemporains, notamment au moyen ce qu’on a nommé le «livre de dialogue» entre écrivain, typographe, imprimeur et plasticien (Peyré 2001). Cette co-création est encore relativement rare en prose. En fait, la dernière grande époque d’une visualité foisonnante du livre date déjà des années de grand succès des clubs de livre après la Deuxième Guerre Mondiale (Faucheux, 1978, Massin 1989), alors qu’aujourd’hui la rencontre du visible et du lisible s’effectue d’abord dans le média un peu différent de la bande dessinée. L’exemple de Proust est tout à fait approprié pour rouvrir ce formidable dossier – déjà traité à deux reprises dans cette revue – à l’intérieur de la littérature au sens traditionnel du terme, même si, pour des raisons pratiques, il sera nécessaire de privilégier un seul exemple (celui de Faucheux/Massin, justement), choisi en fonction de son caractère stratégique.
La décision de lire Proust par illustrations interposées fait surgir tout de suite un certain nombre de difficultés. Pour commencer, la quantité d’images illustrant les différentes éditions de Proust est énorme, même si ce pan de l’œuvre reste largement méconnu (pour trois aperçus, voir Tadié 2013, Baetens 2022, Eells et Dezon-James, 2022). Il suffit toutefois de s’intéresser à «Proust illustré» pour que le matériau afflue de toutes parts, car il existe des dizaines d’éditions illustrées de la Recherche. La maîtrise purement matérielle du corpus s’avère ainsi tout aussi difficile que la traversée des textes mêmes. De plus, cette iconographie est tout sauf homogène, à la différence du texte, quand bien même la Recherche témoigne elle aussi de différences stylistiques parfois non négligeables. Ces variations de style sont toutefois nettement moins apparentes que les différences d’une série d’images à l’autre (le corpus des illustrations est un pot-pourri des images les plus conventionnelles et les plus expérimentales). C’est dire déjà que la notion de «culture visuelle» ne peut se penser qu’au pluriel, ce qui constitue une entrave à l’accès supposément direct aux images d’un texte: enseigner l’image, c’est aussi enseigner le passé, souvent un passé plus éloigné de la culture contemporaine que le passé de l’écrit, qui «vieillit» différemment (et surtout moins vite: une image est rapidement plus «datée» qu’un écrit). À cela s’ajoute la méfiance, tant du côté des auteurs que de celui des critiques, à l’égard de l’illustration en général, en tout cas pour ce qui est des fictions en prose. À l’instar de Flaubert, qui est sur ce point tout sauf isolé, beaucoup continuent à s’écrier: «Moi vivant, jamais on m’illustrera», comme si l’ajout d’une image au texte impliquait inéluctablement une dégradation du premier, l’image étant vue soit comme la béquille devant sauver un texte incapable de se défendre lui-même, soit comme une intervention injustifiable des éditeurs soucieux de tromper le client, soit encore comme une traduction, littérale ou métaphorique, dont les effets sur l’imagination du lecteur seraient toujours délétères.
La réalité culturelle, qui est également une réalité économique (l’édition, au même titre que le cinéma, est aussi une industrie), est cependant plus complexe. Dans la première moitié du vingtième siècle – mais la pratique est plus ancienne et elle n’a pas totalement disparu – les éditeurs offraient parfois deux éditions du même livre: une édition grand public, sans illustrations et bon marché, et une édition de luxe, illustrée, à tirage limité, destiné à un lectorat plus fortuné. L’ensemble de cette production parallèle constitue un des continents cachés de la littérature française: des pièces uniques peuvent être savamment commentées (il existe ainsi quelques articles sur l’édition de la Recherche illustrée par le peintre fauve Kees Van Dongen en 1947), mais il est très difficile de faire un surplomb général de la coexistence et peut-être aussi de la distance et de l’ignorance réciproque des versions illustrées et non illustrées des mêmes textes dans l’espace littéraire (les études sur les illustrations de Proust se concentrent souvent sur un seul objet, sans trop se pencher sur le contexte synchronique ou diachronique des images en question).
Dans le cas de Proust, faire l’histoire de ces «doubles» de l’œuvre – et de leur place dans les recherches proustiennes – n’est pas possible sans embrasser la totalité des aventures éditoriales de l’œuvre. Certes, les textes publiés de Proust ont vite fait l’objet de pareilles éditions de luxe, qui restent toutefois peu connues, tant à cause de la cherté de ces livres qu’en raison de la pléthore d’autres images qui se sont greffées ailleurs (par exemple dans les manuels scolaires) sur le texte de Proust. Cela dit, certaines illustrations se retrouvent aussi dans les publications pour le grand public, notamment dans les éditions de poche, et il y a de bonnes raisons (car ces documents sont faciles à trouver et peut-être même déjà connus des élèves) de partir de ces images-là plutôt que de ce qu’on trouve dans les éditions de luxe. En même temps, il importe de ne pas se laisser divertir par les «autres images» qui entourent l’œuvre de Proust: si tant de lecteurs se désintéressent de la question des illustrations, c’est aussi parce que le texte de Proust «hors livre», par exemple dans des catalogues d’exposition ou les coffee table books sur l’auteur et son monde, n’apparaît presque jamais sans images: portraits de l’auteur, photos de famille, tableaux évocateurs des personnages ou du milieu social peint par la Recherche, et ainsi de suite. Or, à l’époque – la nôtre – où la lecture du texte passe de plus en plus par le contact avec l’auteur et que dans le cas des auteurs décédés ce contact passe généralement par l’iconographie de l’auteur – sans appui visuel, il semble difficile aujourd’hui de canoniser ou de patrimonialiser une œuvre littéraire –, il ne faut pas s’étonner que de telles images prolifèrent et que leur seule abondance n’encourage guère à se lancer dans la quête des images plus «rares», comme celles qu’on trouve dans certaines éditions plutôt confidentielles.
Lire «Proust illustré» est ainsi tout sauf une évidence. Plutôt que de chercher à résoudre d’emblée ces premiers écueils, il vaudrait peut-être mieux «reculer pour mieux sauter», c’est-à-dire de prendre un minimum de distance par rapport au seul cas de Marcel Proust et de la Recherche, pour s’interroger sur les questions et les réponses plus générales qu’on peut dégager du caractère problématique de l’objet d’étude, à savoir ces illustrations dont personne ne conteste l’intérêt, sans pour autant trop connaître le corpus.
Questions générales et préparation du chantier
Face à ces difficultés (excitantes du point de vue de l’enseignant, et, plus encore, du concepteur de manuels ou d’autres moyens de documentation, le temps de préparation dont dispose l’enseignant étant fatalement limité !), il importe avant tout de faire un choix. Pour le dire très vite, et sans aborder ici la question épineuse mais autrement générale du copyright, trois grandes options au moins viennent tout de suite à l’esprit, qui du reste ne sont nullement exclusives. Les choix à faire ne seront donc jamais absolus, mais relatifs: c’est par goût mais aussi par manque de temps qu’on se tournera vers telle option plutôt que vers telle autre, tout en sachant qu’aucune analyse ne gagne jamais à rester totalement «pure» jusqu’à la fin.
La première approche, la plus classique sans doute, est celle des rapports concrets entre textes et images. Quand on part de l’image, réelle ou imaginaire, pour analyser sa conversion en objet textuel, la perspective choisie sera celle de l’ekphrasis, dont l’histoire, les thèmes, les figures et les exemples canoniques ont fait de très nombreuses analyses (l’ouvrage de référence reste ici Heffernan 1993). Le principe de l’illustration est à la fois symétrique et inverse: il concerne lui aussi le lien entre le lisible et le visible, mais le point de départ est ici le texte et le point d’arrivée, l’image. L’intérêt de l’œuvre de Proust est de combiner à bien des égards l’un et l’autre de ces mécanismes, ekphrasis et illustration, mais de manière non parallèle.
De son vivant, Proust ne s’est pas toujours opposé à l’illustration (rappelons les images de Madeleine Lemaire dans Les Plaisirs et les jours et quelques autres illustrations dans une revue de grand luxe ayant prépublié certains fragments de l’œuvre en cours), mais il n’est pas faux de penser qu’il s’est rapidement détourné du marché de l’édition restreinte et illustrée pour se tourner vers des types de publication très grand public et sans la moindre illustration. Les premiers volumes de la Recherche sont des exemples typiques de livres «pauvres» (Monnier 1931). Par contre, le rôle de l’ekphrasis y est capital et touche aussi bien à des modèles picturaux que musicaux. Dans la Recherche, le protagoniste a trois grands modèles artistiques (Vinteuil pour la musique, Elstir pour la peinture, Bergotte pour la littérature), qui ont toutefois en commun de s’éclipser devant le projet personnel du narrateur, qui découvre peu à peu sa propre vocation et sa propre manière de faire, c’est-à-dire d’écrire – d’où peut-être la frilosité grandissante de Proust face à l’image, qui «fige» la mobilité aussi bien que la densité et la profondeur temporelle de son travail sur la mémoire. Il importe de tenir compte de ce décalage entre illustration (refusée) et ekphrasis (assumé) au moment d’aborder les images qui accompagnent le texte de Proust et qui sont, à quelques exceptions près, toutes «posthumes». Il ne faut pas conclure de cet écart temporel que les artistes et plasticiens qui acceptent de se mesurer avec le texte de Proust , peuvent dès lors le faire de manière plus «libre»: les contraintes restent nombreuses, qui vont du poids de la tradition (on n’illustre pas Proust sans regarder du côté de ce qui s’est déjà fait, pour s’en distinguer ou pour s’en réclamer) aux exigences des commanditaires (les illustrations font toujours l’objet de commande et les éditeurs ont leur mot à dire dans le «look» des images). L’analyse de ces rapports de force est cependant une excellente introduction à une discussion sur la question plus générale de l’adaptation transmédiatique, continuation logique du travail en classe sur l’illustration.
La seconde approche est moins directement intermédiale, quand bien même il serait absurde de laisser tomber l’interaction entre visible et lisible. Elle analyse la manière dont les illustrations font partie d’un «espace élargi», en l’occurrence celui du livre. Il est utile de distinguer ici entre deux aspects, où les aspects littéraire et économiques se croisent sans arrêt.
D’un côté, le livre est un objet matériel et culturel, dont l’existence, de la première idée au dernier de tous ses usages produit une sphère culturelle à multiples actants: auteurs, éditeurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires, collectionneurs, lecteurs. Grâce aux travaux déjà cités de Darnton et de bien d’autres, dont en France surtout l’historien de la lecture Roger Chartier, nous savons du reste que ladite «chaîne» du livre, qui va en principe de l’auteur au lecteur, en passant par toute une série d’intermédiaires, n’est pas linéaire, mais qu’il y a force interactions créatrices entre nombre d’acteurs à plusieurs moments et à plusieurs endroits de cette chaîne.
De l’autre, le livre n’est pas un objet «homogène». Il existe beaucoup de types de livres et partant beaucoup de «chaînes» de livres, chacune d’elles avec sa propre logique interne. La pratique de l’illustration est directement affectée par ces différences: on n’illustre pas un livre de poche comme on illustre un livre pour bibliophiles, par exemple, tout comme on n’illustre pas de la même manière en France ou en Grande-Bretagne, ni en 1920 ou en 1970. Les illustrations de la Recherche sont un outil magnifique pour montrer ces dissemblances, qui obligent les élèves et étudiants (même si on vise ici un public scolaire, la réflexion méthodologique doit en effet se ménager la possibilité d’élaborer une stratégie en deux temps et à deux niveaux) à se faire sensibles à la rupture entre l’apparente stabilité du texte et la permanente métamorphose de présentation matérielle (même dans les cas, et ils sont très nombreux, où les livres se passent de toute illustration).
La troisième approche, qui prolonge les deux premières, est surtout diachronique. Il peut en effet être passionnant de d’analyser comment la présentation typographique du texte et le travail sur les éléments visuels, s’ils changent tous les deux sans arrêt, ne changent pas toujours au même rythme ni de la même façon. La multiplicité des versions proustiennes facilement accessibles en bibliothèque ou en librairie est un bel outil pour lancer une telle piste de réflexion. L’essentiel, ici, sera de comprendre la manière dont s’articulent les deux autres pistes, celle de l’intermédialité (rapports textes-images) et celle de la matérialité (le texte situé dans le cadre plus large de la chaîne du livre), mais toujours du point de vue synchronique aussi bien que diachronique. Plus spécifiquement, deux types de questions peuvent ici être posées. D’un côté: quels sont les mécanismes qu’on peut observer à quel moment et à quel endroit de la chaîne et quels sont les acteurs les plus directement concernés? De l’autre: quel est le rôle des illustrations? comment et surtout pourquoi est-ce qu’on les voit apparaitre ou disparaître?
Tout cela suppose évidemment que les élèves et étudiants ont réellement accès aux sources, ce qui est loin d’être une évidence en raison du caractère confidentiel de nombreuses publications. Quelques-unes des éditions illustrées, à haute valeur bibliophilique, n’existent même qu’à quelques exemplaires, s’il ne s’agit pas de créations plastiques totalement uniques, délicates à déplacer. De tels objets, si on peut utiliser ce terme un peu terre-à-terre, se trouvent souvent dans des collections privées, difficiles d’accès, alors que d’autres se trouvent dans des archives spécialisées où ils ne peuvent être consultés que sur place et sur rendez-vous. Pour les élèves, il peut être un bon exercice (par exemple en combinaison avec une visite de bibliothèque), en partant des aperçus existants (voir supra), de s’initier à l’heuristique littéraire, au sens très littéral du terme: Où et comment peut-on accéder aux documents originaux? Y a-t-il moyen de le faire en ligne? Quelle est la différence entre le contact avec les originaux et l’utilisation de sources en ligne? Y a-t-il aussi des créations purement numériques? Ou encore: Que faire pour combler les inévitables lacunes des répertoires existants? Quels que soient les obstacles qui surgissent au cours de pareils exercices, il est évident qu’ils aideront les élèves à se faire une idée plus nuancée et plus diversifiée des trois notions de texte, de livre et d’œuvre dont ils auront besoin pour passer ensuite à de nouvelles formes d’interprétation de Proust.
Idéalement, les trois grandes approches devraient pouvoir se combiner et se compléter. En pratique, on ne peut que le répéter, des choix s’imposent. Dans Illustrer Proust, je me suis par exemple concentré sur la troisième de ces pistes, n’étant ni un spécialiste de Proust, ni un spécialiste du livre (c’est peut-être ce qui m’a permis de me lancer dans ce projet, car parfois on est sauvé par sa propre naïveté). D’autres recherches se focalisent plutôt sur la lecture intermédiale, par exemple pour souligner l’apport créateur de certaines illustrations (c’est typiquement l’approche déjà citée de Eells et Dezon-James) ou montent en épingle les questions génétiques épineuses mais fascinantes de la transformation d’un manuscrit (finalement inachevé, c’est-à-dire moins bien relu et corrigé à la fin qu’au début et en ce sens fondamentalement inachevé) en livre (apparemment «fini», comme dans le cas du premier tome paru chez Grasset en 1913, mais immédiatement dénoncé comme «erroné» puisque bourré de coquilles, «incomplet» puisque rien d’autre que la porte d’entrée d’une somme dont l’auteur ne voyait pas encore les frontières, et «mal classé», puisqu’ayant paru chez un éditeur qui n’était pas celui qui allait vraiment faire rayonner l’œuvre de Proust).
Questions particulières et pistes de réflexion
Derrière ces premiers choix se dessine toute une série d’autres chantiers. Leurs enjeux et leur importance sont variables, mais tous reviennent sur la question fondamentale posée au début de ces pages: quel Proust, ou, si l’on préfère, que deviennent Proust et notre idée de Proust à la lumière du texte enrichi par l’illustration?
Cette question conduit au problème de l’«identité» du texte et de l’œuvre. L’intérêt pour les illustrations montre que l’œuvre d’un auteur ne coïncide pas avec le seul texte qu’il a produit. Si les «corps étrangers» qui l’entourent n’en font pas moins partie, on est en droit de s’interroger sur l’identité de l’instance derrière cette conception élargie de l’œuvre. En effet, les illustrations de Proust n’ont pas été «voulues» par Proust, et encore moins «pensées» par lui – à la différence de bien d’autres écrivains qui ont collaboré de leur vivant avec leurs illustrateurs et qui dans certains cas extrêmes comme celui de Raymond Roussel dans ses Nouvelles Impressions d’Afrique ont élaboré un dispositif très complexe pour l’intégration du texte, des images et de l’objet-livre (Busine 1995). Il en résulte que notre perception de l’œuvre, inéluctablement influencée par la présence d’éléments visuels (pas forcément sous la forme d’illustrations: la typographie peut être non moins déterminante), ne sera jamais «pure». L’énonciation d’un texte, du moment qu’il passe du manuscrit au livre, est par définition une énonciation plurielle, où interviennent nombre d’autres instances que le seul auteur. L’éditeur en est une, mais aussi le maquettiste ou l’illustrateur, entre autres (Souchier (2007). On peut toujours essayer de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais en pratique il n’est pas toujours facile de faire la part entre la manière dont on reçoit le texte tel qu’en lui-même (à supposer que ce texte ne relève que d’un seul auteur, ce qui est loin d’être toujours le cas) et celle dont on reçoit le texte tel qu’il est présenté matériellement (et cette présentation, on le sait, est hautement variable; elle se fait aussi très souvent hors de tout contrôle de l’écrivain). Dit autrement: ce que montre l’histoire éditoriale d’une œuvre , en l’occurrence d’un auteur dont le texte supposé immuable a fait l’objet d’une série incessante d’illustrations de styles et de contenus très variables, c’est la difficulté de fixer la voix «authentique» d’un auteur. Cette voix est toujours, non pas impure, mais complexe, plus étagée que celle du texte pris en lui-même.
Pareille idée ne devrait pas surprendre: nous acceptons aujourd’hui que l’interprétation d’un texte sera différente si nous le découvrons en audiolivre ou à travers d’autres formes d’adaptation (inutile de revenir sur l’exemple de la bande dessinée de Stéphane Heuet, pourtant très respectueuse du texte même de Proust, voir Baetens 2020); de la même façon, la critique savante accepte sans le moindre état d’âme qu’il n’est pas possible de lire un texte sans prendre en considération les successives lectures qu’on a pu en faire (quitte, bien sûr, à tenter de dépasser ces lectures en revenant au texte, comme le font les diverses formes de lecture créatrice illustrées par Pierre Bayard (1996) ou Maxime Decout (2021)). L’exemple des éditions illustrées de Proust peut pointer dans la même direction et faire comprendre que le sens d’une œuvre ne dépend jamais du «vouloir dire» d’une instance auctoriale unique. Il est incontestable que Proust a eu un «projet» et une «intention» en écrivant la Recherche, mais l’interprétation de ces éléments, pour autant qu’on les juge pertinents, dépasse toujours l’éventuelle réponse à la question apparemment simple mais finalement sans réponse finale possible: qu’est-ce que l’auteur a voulu dire? Ce débat, qui est ancien, peut paraître dépassé aux yeux de certains, mais il réapparaît à intervalles réguliers dans l’histoire de la critique. De nos jours, où l’on assiste à un retour presque agressif du biographisme et de la primauté de l’homme ou de la femme par rapport à l’œuvre, les questions de sens se posent de nouveau très fortement en référence au vouloir-dire de l’écrivain, de sa «sincérité», de son «engagement», de son «authenticité», de sa capacité à représenter une «communauté», et ainsi de suite (voir Louichon 2015 sur les enjeux de la patrimonialisation).
D’autres questions sont non moins importantes, comme celle de la définition du «corpus» historique de la littérature. Est-il possible de se focaliser sur les seuls textes, ou faut-il inclure dans l’œuvre tous les éléments qui accompagnent la transformation d’un manuscrit en livre? De nos jours, il est généralement admis, dans le sillage des travaux de Genette (1987), qu’il n’est plus possible de séparer les données textuelles et paratextuelles, qui ne sont pas de simples ajouts mais qui font partie intégrante de l’œuvre même (or, nous savons que la majorité de ces unités paratextuelles échappent totalement au contrôle de l’auteur, y compris sur le plan juridique). De la même façon, on estime que les avant-textes, les métatextes, les intertextes et l’architexte, en suivant toujours la terminologie de Gérard Genette dans Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982), font également partie de l’œuvre (il est toutefois intéressant de noter que le livre de Genette laisse de côté la dimension proprement visuelle de cette extension du livre: son travail sur le paratexte tend à mettre entre parenthèses les illustrations, par exemple).
Il faut maintenant faire un pas de plus et se demander dans quelle mesure il convient d’y ajouter aussi le domaine des adaptations (au cinéma, en bande dessinée, en audiolivre, en exposition, voire en parc de loisirs comme c’est aujourd’hui le cas d’Illiers-Combray). La question peut paraître exagérée, mais elle répond à une réalité de plus en plus visible: la littérature ne circule plus seulement sous forme de textes, mais aussi sous forme d’adaptations transmédiatiques, tantôt en complément par rapport à l’œuvre, tantôt en véritable substitut. Les lecteurs de Stéphane Heuet ne liront pas tous la Recherche, par exemple. Les spectateurs de l’adaptation cinématographique d’Un amour de Swann (Volker Schlöndorff, 1984, avec Jeremy Irons et Ornella Muti) ont fort bien pu en rester là dans leur expérience de l’univers de Proust – et il n’y a pas de raison pour leur en faire le reproche).
Le phénomène ne reste pas circonscrit à la production littéraire: il en va de même dans le domaine de la production cinématographique, où bien des films sont mieux connus à travers certaines extensions, imprimées ou numériques, qu’à travers les versions proprement cinématographiques (on connaît les affiches, les novellisations, les résumés de Wikipédia, et ainsi de suite, sans forcément avoir vu les films originaux, surtout pas dans leur totalité).
Bref, le cas en apparence singulier et relativement marginal des éditions illustrées de Proust aide non seulement à penser autrement la question de l’instance auctoriale (qui est responsable, à côté de l’auteur de l’œuvre, du texte mis en livre?) mais aussi la notion de texte et d’œuvre. D’une part leurs limites deviennent floues: quels sont les autres éléments qui se greffent sur le texte de départ? D’autre part le rapport entre œuvre originale et œuvre dérivée cesse également d’être clair: que penser d’une œuvre qu’on ne connaît que par l’intermédiaire de ses adaptations, par exemple, et comment la connaissance des variations transmédiatiques influe-t-elle sur le contact ultérieur avec l’œuvre d’origine? Questions très vastes qu’il est impossible de traiter ici en détail, mais qui soulignent une fois de plus à quel point la notion d’histoire littéraire échappe à la dichotomie élémentaire du moment de la publication initiale et de celui de la réception actuelle.
Une étude de cas: Pierre Faucheux vs Robert Massin et la Recherche dans «Le Livre de poche» vs Folio
Mais trêve de généralités. Il est temps de passer à un exemple concret, abordable pour les élèves en termes de quantité (un corpus modeste, facile d’accès) et de qualité (une intervention représentative et d’importance durable): les couvertures des sept volumes de la Recherche dans l’édition du «Livre de poche» conçue en 1965 par le maquettiste Pierre Faucheux. Ces volumes se trouvent encore facilement chez des bouquinistes, y compris en ligne, et au cas où il serait moins aisé de les réunir tous en classe, on a la certitude de pouvoir les consulter au moins sur internet (via une simple recherche «Google images»). Hautement appréciées par les collectionneurs et les amateurs de Proust, les sept couvertures de cette série, elle-même à la valeur commerciale négligeable, constituent une pièce stratégique dans l’histoire des éditions illustrées de Proust, où elle constitue un véritable tournant.
L’intérêt du travail de Faucheux se situe à deux niveaux. Le premier est externe et touche à la manière dont l’illustration de Proust révèle des mécanismes plus vastes de l’édition littéraire. Le second est interne et concerne la manière dont Faucheux a révolutionné non seulement l’illustration mais le design du livre en général. Pour étudier des divers aspects, il est conseillé d’avoir un minimum de connaissances de l’histoire de l’illustration dans l’édition française ainsi que de la place qu’y occupe le marché du livre de poche (format de publication opposé à ce qu’on appelle le «grand format», soit la première édition courante, à ne pas confondre avec l’éventuelle édition parallèle de luxe, et dont l’avènement n’a pas attendu le lancement du label «Le Livre de poche» en 1953). Sur tous ces points, l’information ne manque pas (on peut recommander par exemples certaines publications d’Olivier Bessard-Banquy, notamment 2012 et 2022) et les élèves peuvent lire avec grand profit quelques fragments des autobiographies richement illustrées des deux grands novateurs que sont Massin (1989) et Faucheux (1978).
Sans trop entrer dans les détails, on peut souligner la continuité éditoriale et culturelle entre, d’une part, les clubs de livre qui se créent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et, d’autre part, les collections de poche, dont le succès décolle avec «Le Livre de poche» en 1953. L’ambition des clubs, soucieux de démocratisation culturelle, est avant tout politique: fonctionnant par abonnement ou souscription, ils se proposent d’offrir à bas prix de «vrais» livres (c’est-à-dire des textes faisant partie du patrimoine littéraire, et non plus les divers avatars de la littérature de genre ou littérature populaire). Mais elle est aussi esthétique. Contrairement à ce qu’on observe en Angleterre, par exemple, le livre français est en règle générale plutôt «laid» (ce qui ne veut pas dire «pauvre», au sens technique que lui donne Adrienne Monnier). Typographie, papier, reliure, impression… n’encouragent pas toujours à la lecture, et l’absence d’illustrations dans les éditions courantes et beaucoup d’éditions de poche (à l’époque uniquement des réimpressions bon marché et en petit format) n’est pas toujours faite pour arranger les choses (pour une approche critique de la situation actuelle du livre français, voir Bessard-Banquy, 2022). Les clubs de livre vont mettre en place une politique typographique audacieuse, qui s’efforce d’améliorer et de moderniser la présentation du livre tout en baissant le prix.
Pour y arriver, les jeunes maquettistes auront recours à deux grandes techniques. D’une part, le recours à l’image et, plus généralement, à des formes de typographie mettant en valeur les aspects visuels de la page. D’autre part, l’invention du «déroulement», c’est-à-dire de la transformation de la zone paratextuelle en séquence visuelle, ce qui a pour effet de modifier de fond en comble l’architecture du livre, qui tend vers le modèle cinématographique. Quelques années plus tard, les collections de poche, où l’on retrouve les grands maquettistes ayant révolutionné le design du livre français, vont prendre le relais des livres de club. C’est la fin des déroulements, mais non de l’importance accrue de l’image (en couverture, la couverture des grands formats restant «blanche» dans le secteur de l’édition générale, dans bien des cas jusqu’à aujourd’hui). Tout à coup, les images envahissent les couvertures (les livres des clubs, soigneusement cartonnés, étaient généralement restés sans illustration de couverture), et leur importance déborde le seul espace du livre. L’omniprésence des couvertures bariolées dans les vitrines et, autre nouveauté, les présentoirs et autres tourniquets de livres, joueront un rôle clé dans les polémiques autour du «Livre de poche» (Baetens 2017).
Pour ce qui est des illustrations, l’intervention de Faucheux est radicalement novatrice, puisqu’il remplace les images traditionnelles qu’il juge vieillottes (dessins, gravures, peintures) par des photographies, si possible de «documents», ce qui a le double avantage d’éluder le tabou qui pèse encore sur l’illustration (dans le cas de Proust, le stéréotype qui revient sans arrêt est qu’ «on n’illustre pas Proust», l’image ne pouvant qu’entrer en conflit avec la nature et le prestige d’une écriture qui a vite accédé au rang de chef-d’œuvre incontesté de la littérature moderne) et de servir d’alibi à une forme d’illustration qui n’a plus besoin de dire son nom (Faucheux lui-même se plaira à dire, sans la moindre ironie, que les photographies ne sont pas des… illustrations, mais des éléments qui contribuent à faire du livre un objet à trois dimensions dont le modèle est l’architecture). Invité par Le Livre de poche à reprendre la maquette de la série des classiques (et aussi des policiers, mais c’est une autre histoire), Faucheux ne dévie pas de son credo esthétique. Son travail sur les sept volumes de la Recherche est reste une démonstration inégalée (Fig. 1).
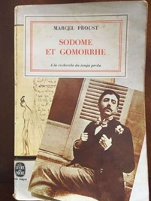
Figure 1: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Le Livre de Poche, 1965.
Cette maquette obéit à quatre grands principes. D’abord, le refus de toute forme d’illustration conventionnelle et son remplacement par des documents photographiques (concrètement, un mélange de photos de famille et de reproduction en fac-similé des manuscrits). Puis, la variation des caractères typographiques de la couverture dont l’esprit s’aligne sur celui de l’image. Ensuite, l’occupation de la totalité de la couverture par une composition unique et homogène (la distinction traditionnelle entre première et quatrième de couverture se trouve dépassée). Enfin, l’élaboration de la série sous forme séquentielle (la suite des sept volumes ne décline pas simplement des variations sur la même idée, mais les photos suivent chronologiquement la vie et l’écriture de Proust). Sur tous ces points, l’influence des clubs de livre est évidente, en dépit des contraintes techniques et commerciales du Livre de poche, qui exige une standardisation aussi poussée que possible de toutes les publications.
La force de ce dispositif, dont l’originalité continue à inspirer de nombreux typographes jusqu’à ce jour, se manifeste également dans les réactions suscitées à l’intérieur du champ de l’édition de poche. Lorsque quelques années plus tard, après la rupture entre Hachette et Gallimard en 1971, l’éditeur de Proust décide de créer son propre système de diffusion et ses proches collections de poche, dont en premier lieu la fameuse collection «Folio», créée en 1972 par un autre pionnier de l’époque des clubs, Robert Massin. L’édition Folio (Fig. 2) prendra soin de se distinguer à tous les niveaux du modèle de Faucheux, comme on le voit clairement dans sa version de la Recherche, également en sept volumes: couverture à fond blanc, présence d’une image «artisanale» (non photographique, non documentaire), séparation des première et quatrième de couverture, uniformisation complète des caractères typographiques (ceux de la série, non ceux de chaque publication indépendante, comme chez Faucheux).
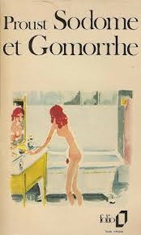
Figure 2: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Folio, 1972.
Pour rapide que soit cette analyse, elle fait bien ressortir que les enjeux de l’illustration dépasse à la fois le travail du seul illustrateur et les rapports entre texte et image. Ce que font aussi bien Pierre Faucheux que Robert Massin est moins déterminé par quelque envie de trouver de nouvelles manières d’ajouter des images à l’écriture proustienne (Faucheux reprend des documents d’archive déjà fort connus, Massin se ressert des aquarelles ayant illustré une édition antérieure), que par le désir stratégique de monter en épingle une collection éditoriale (et il serait injuste de reprocher à l’édition d’être aussi une industrie, car elle l’est, et elle l’a toujours été). Les illustrations de Faucheux tendent à montrer que «Le Livre de poche» est capable d’innover, au moment où sa première ligne graphique était en train de s’essouffler, là où l’intervention de Massin cherche à imposer «Folio» comme la nouvelle référence en matière de poche. Il n’est évidemment pas question de généraliser cet exemple à tout prix, mais la lecture attentive de nombreux livres illustrés ne manquerait pas d’apporter de nouveaux arguments en faveur d’une telle hypothèse: l’étude de l’illustration qui se limite aux seuls rapports texte/image est toujours en danger de passer à côté d’aspects tout autres mais tout aussi importants du travail de l’illustrateur.
Conclusion
Lire Proust à l’aide des éditions illustrées de la Recherche, dont le diptyque Faucheux/Massin a présenté un exemple privilégié, n’a de sens que dans la mesure où l’on établit aussi des rapports avec les autres perspectives rapidement esquissées dans ces pages. La comparaison des illustrations et des fragments ekphrastiques, l’analyse de tout l’éventail de l’énonciation éditoriale, l’examen de la position historique des images insérées (tendent-elles à «actualiser» le texte et l’auteur, à les rendre «intemporels», ou au contraire à les ramener aux années de genèse, celles de la Belle Époque?), mais aussi la réflexion sur les manières dont se constitue l’objet de la lecture (pourquoi Proust dans telle édition plutôt que telle autre, par exemple?), ainsi que le retour sur les questions de l’auteur et de ses intentions, toutes ces pistes se prêtent sans trop de difficultés à une discussion en classe. Pareille discussion n’éloigne nullement du texte, elle le fait relire autrement. Elle aussi l’avantage non négligeable de son caractère générique: ce qui se fait autour de Proust, peut non moins se faire autour d’autres œuvres, voire autour de productions non littéraires comme le cinéma ou la bande dessinée.
Bibliographie
Baetens, Jan (2017), «Les livres de poche, une littérature ‘exposée?», Image & Narrative, 18 (4), p. 55-62, [en ligne].
Baetens, Jan (2020), Adaptation et bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Baetens, Jan (2022), Illustrer Proust. Histoire d’un défi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Baetens, Jan, et Sánchez-Mesa, Domingo (2019), «On ‘demediation’», Leonardo, 52 (3), p. 275-278.
Bayard, Pierre (1997), Le Hors-sujet. Proust et la digression, Paris, Minuit.
Bessard-Banquy, Olivier (2012), L’Industrie des lettres, Paris, Pocket.
Culler, Jonathan (1997), Literary Theory: A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press.
Darnton, Robert (1992), Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob.
Decout, Maxime (2021), Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit.
Eells, Emily, et Dezon-Jones, Élyane (2022), Illustrer Proust. L'art du repeint, Paris, Sorbonne Université Presse.
Faucheux, Pierre (1978), Écrire l'espace, Paris, Robert Laffont.
Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.
Heffernan, James (1993), Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, The University of Chicago Press.
Kuentz, Pierre (1972), «L’Envers du texte», Littérature, n° 7, p. 3-26.
Louichon, Brigitte (2015), «Le patrimoine littéraire: un enjeu de formation», Tréma, n° 43, p. 22-31.
Massin, Robert (1989), L’ABC du métier, Paris, Imprimerie nationale.
Monnier, Adrienne (1931), «Éloge du livre pauvre», Arts et métiers graphiques, n° 25, p. 345-348 (repris plus tard dans Adrienne Monnier, Rue de l’Odéon, Paris, Albin Michel, 1960).
Peyré, Yves (2001), Peinture et poésie, le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard.
Sermier, Émilien (2022), Une saison dans le roman, Paris, Corti.
Souchier, Emmanuël (2007). «Formes et pouvoirs de l’énonciation éditoriale», Communication & Langages, n° 154, p. 23–38.
Stewart, Garrett (2010). “Bookwork as Demediation”, Critical Inquiry, 36 (3), p. 410-457.
Tadié, Jean-Yves (2013), Swann illustré, Paris, plaquette accompagnant, sous coffret, l’édition par Antoine Compagnon de Du côté de chez Swann en Folio classique.
Pour citer l'article
Jan Baetens, "Enseigner Proust illustré", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024http://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-proust-illustre
Voir également :
Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations. Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes. Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature».
Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
Redéfinir le sens: l’intégration des médiations texte/image dans l’enseignement de la littérature
Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations (Demougin, 2002; Delbrassine, 2019). Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes (Peirce, 1978). Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature» (Baroni & Turin 2021).
Cette problématique s’inscrit dans les fondements de la sémiotique, qui a étendu les principes de la linguistique structurale à d’autres formes de signification, comme les publicités (Barthes, 1964; Eco, 1972), les œuvres picturales (Marin, 1969), les bandes dessinées (Peeters, 2009), les films (Metz, 2014) ou encore les images diagrammatiques (Bertin, 2013). Ce cadre a permis de conceptualiser une pluralité de «langages visuels», reflétant la diversité des pratiques médiatiques.
De l’image-illustration à l’image-texte: perspective historique
Dans le cadre scolaire, l’articulation entre texte et image ne va pas de soi, dans la mesure où l’image est un objet à la fois attractif et énigmatique. Attractif, parce que sa lecture est immédiate et joue avec les émotions ; énigmatique, dans le sens où, en tant qu’icône, l’image délivre un message qui n’est pas net et doit être décodé par le lecteur (Peirce, 1978).
Il n’en demeure pas moins que la place et le statut de l’image s’inscrivent dans une longue tradition pédagogique, même si les finalités qui lui ont été assignées ont évolué au fil du temps, comme le montrent Ferran et al. (2017). Ces derniers rappellent que Comenius, au XVIIe, crée des ouvrages qui contiennent des gravures accompagnées de petites légendes, avec l’idée selon laquelle il faut «voir pour savoir». Dès le XVIIIe le nouveau marché de la littérature de jeunesse va recourir à l’illustration pour favoriser sa diffusion. Avec l’instauration de l’école obligatoire pour tous à la fin du XIXe siècle, l’image est introduite dans les manuels, avec l’idée de rendre le savoir accessible à tous les milieux, y compris les plus populaires. Les développements techniques, notamment l’arrivée de la photographie, vont également transformer le statut de l’image. On passe progressivement des planches pédagogiques à la reproduction de documents authentiques qui sont désormais étudiés pour eux-mêmes ou en lien avec un extrait de texte (Ferran et al., 2017).
En Français, l’arrivée des finalités communicationnelles dans les années 1980, en France (Demougin, 2002) comme en Suisse romande (Darme-Xu et al., 2020), fait de l’image un «genre de texte» qu’il s’agit de lire :
Lire c’est prendre connaissance d’un message qu’on a sous les yeux. Ainsi, au sens large, toute communication visuelle suppose de quelque manière une lecture, qu’il s’agisse d’une simple image, d’images avec textes ou de textes proprement dit. (DIP 1980: p. 14 1)
Cette nouvelle manière d’appréhender l’image entraine l’arrivée de nouvelles activités dans lesquelles texte et image, désormais placés sur un pied d’égalité, sont mis en regard l’un de l’autre, comme dans l’exemple ci-dessous tiré des Activités sur les textes pour les élèves de 15 ans (DIPC 1987: p. 132):
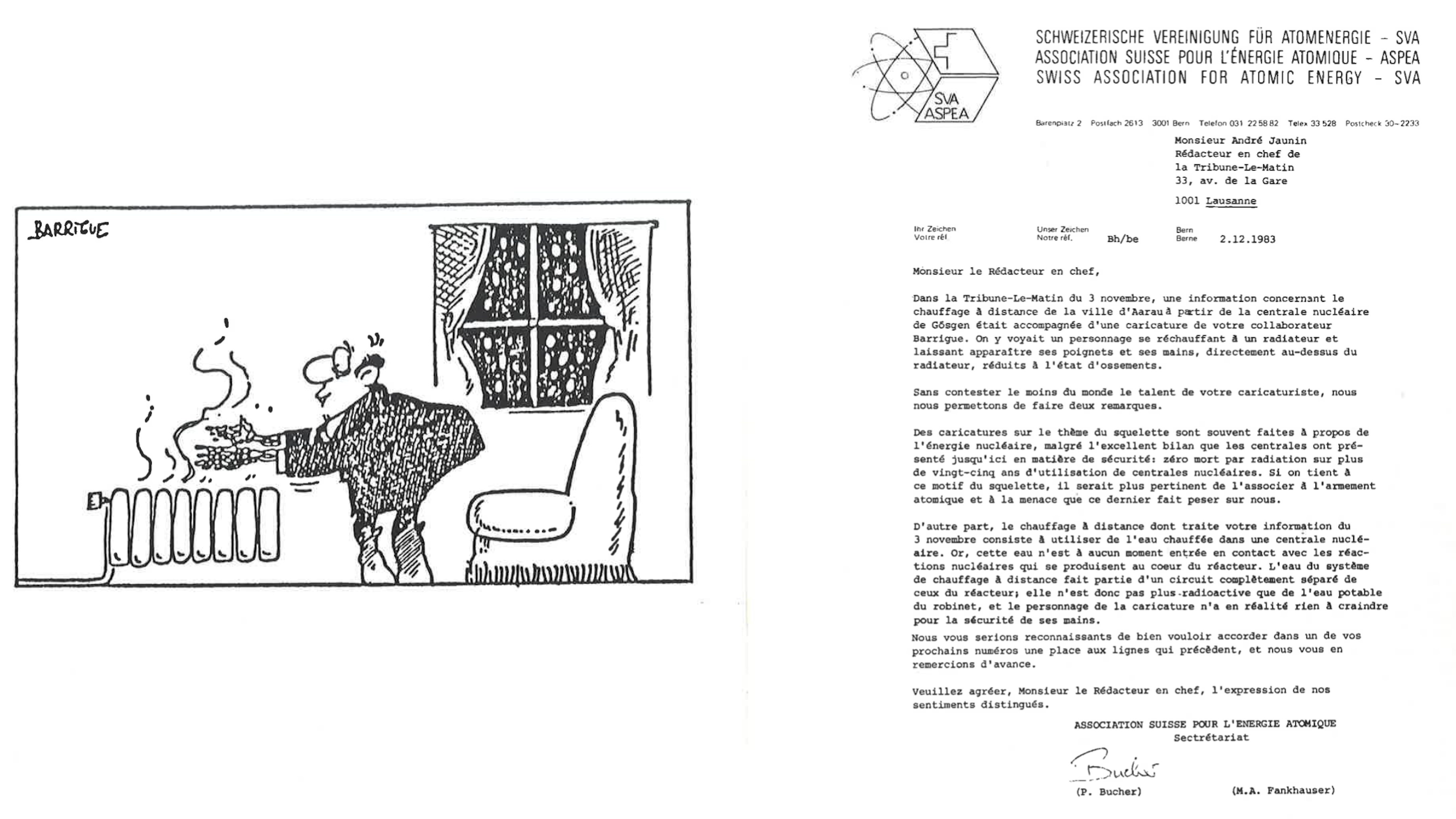
Dans cet atelier destiné à travailler avec les élèves l’argumentation, la caricature du dessinateur humoristique français Barrigue est posée en regard d’une lettre de l’Association suisse pour l’énergie atomique qui conteste l’information parue dans la Tribune-Le-Matin. Le contenu de cette lettre est le suivant:
Monsieur le rédacteur en chef,
Dans la Tribune-Le-Matin du 3 novembre, une information concernant le chauffage à distance de la ville d’Aarau à partir de la centrale nucléaire de Gösgen était accompagnée d’une caricature de votre collaborateur Barrigue. On y voyait un personnage se réchauffant à un radiateur et laissant apparaître ses poignets et ses mains, directement au-dessus du radiateur, réduits à l’état d’ossements.
Sans contester le moins du monde le talent de votre caricaturiste, nous nous permettons de faire deux remarques.
Des caricatures sur le thème du squelette sont souvent faites à propos de l’énergie nucléaire, malgré l’excellent bilan que les centrales ont présenté jusqu’ici en matière de sécurité: zéro mort par radiation sur plus de vingt-cinq ans d’utilisation de centrales nucléaires. Si on tient à ce motif du squelette, il serait plus pertinent de l’associer à l’armement atomique et à la menace que ce dernier fait peser sur nous.
D’autre part, le chauffage à distance dont traite votre information du 3 novembre consiste à utiliser de l’eau chauffée dans une centrale nucléaire. Or, cette eau n’est à aucun moment entrée en contact avec les réactions nucléaires qui se produisent au cœur du réacteur. L’eau du système de chauffage à distance fait partie d’un circuit complètement séparé de ceux du réacteur; elle n’est donc pas plus radioactive que l’eau potable du robinet, et le personnage de la caricature n’a en réalité rien à craindre pour la sécurité de ses mains.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder dans un de vos prochains numéros une place aux lignes qui précèdent, et nous vous en remercions d’avance.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’expression de nos sentiments distingués.
ASSOCIATION SUISSE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE, Secrétariat, (F. Bucher) (M.A. Fankhauser)
Comme on peut le constater ici, c’est moins l’image qui est subordonnée à la compréhension et à l’interprétation du texte que la lettre qui aide à «lire» l’image, dans la mesure où elle décrit précisément ce qu’on voit et donne le contexte.
L’intégration de la littérature comme composante de la langue première dès les premiers degrés de la scolarité au tournant des années 2000 ramène la question des relations entre texte et image au sein de l’enseignement de la littérature.En Suisse romande, ces liens font l’objet de recommandations précises de la part de la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP 2006). La littérature y est définie comme englobant des œuvres telles que les films et bandes dessinées, nécessitant de fait «le développement d’une pédagogie de l’image et des médias» (CIIP 2006, p.40). Il s’agit donc, dès l’entrée dans l’écrit, de mettre l’élève au contact des livres (CIIP 2006, p.23), en l’amenant progressivement à différencier le texte de l’image et à réfléchir aux liens entre ces deux composantes (CIIP 2006, p.38). Ces recommandations se concrétisent dans le plan d’études romand (PER 2010) qui couvre l’ensemble de la scolarité obligatoire, par une attention à porter sur les liens entre texte et image «dans un album, sur une affiche, ...» (PER 2010, L1 15), en vue de donner à l’élève des clés pour apprécier des ouvrages littéraires variés.
Cependant, comme le relève Duvin-Parmentier (2020), force est de constater que les enseignant·es expriment aujourd’hui des difficultés à didactiser la lecture de l’image. Autrement dit, la place, le rôle et la fonction de l’image dans l’enseignement du Français demeurent encore souvent équivoques pour les enseignant·es, qui ne se sentent pas formé·es pour faire découvrir aux élèves la «grammaire de l’image» par l’analyse de formes iconiques variées.
État de la question du point de vue des recherches en didactique de la littérature
Cette intégration de la littérature comme objet d’enseignement dès les premières années de la scolarité, conjuguée à l’essor de la révolution numérique offrant un accès sans précédent à une multitude d’images, a ainsi conduit à un renouvellement des recherches en didactique de la littérature. Ces travaux explorent notamment les frontières médiatiques de la littérature et interrogent l’hétérogénéité des supports mobilisables en classe, au-delà des formes strictement textuelles. Les interactions entre littérature et arts (Chabanne, 2018), l’analyse des albums pour la jeunesse (Lépine, 2012 ; Leclaire-Halté, 2014; Specogna, 2015; Delbrassine, 2019), des œuvres multimodales (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2012) ou encore de la littérature nativement numérique (Acerra, 2017; Brunel, 2021), ainsi que les dynamiques de circulation intermédiatique (Castagnet-Caignec, 2021) sont autant de domaines d’investigation en plein développement. Ces recherches participent à l’élargissement des objets d’étude en littérature, tout en invitant à repenser les objectifs, les méthodes et les corpus mobilisés dans l’enseignement.
En parallèle, les études récentes sur la bande dessinée (Baroni, 2018; Rouvière, 2012; Raux, 2023) offrent des perspectives particulièrement enrichissantes, notamment parce qu’elles conduisent à interroger les limites traditionnelles de la littérature. Cependant, comme l’ont souligné Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), il subsiste un important travail de formation à destination des enseignant·es, visant à leur permettre de développer des gestes interprétatifs adaptés, en prenant en compte la complexité propre à ce médium hybride qui articule dimensions textuelles et graphiques.
Ce numéro a, quant à lui, pour ambition d'examiner différentes perspectives d'analyse, en s'attachant d'abord à retracer l'évolution historique des interactions entre texte et image et leur institutionnalisation dans les pratiques scolaires, avant de mettre l'accent sur des approches didactiques diversifiées, ainsi que sur des observations empiriques effectuées en milieu scolaire. Il apparaît que l'interaction entre texte et image ne compromet pas le sens intrinsèque de l'un ou de l'autre, mais le reconfigure, ou encore le réinterprète, en fonction du contexte inédit dans lequel il s'inscrit.
S’interroger sur les transformations de la relation texte-image à l’heure du numérique (et sur leurs conséquences pour l’enseignement de la littérature) implique de revisiter une histoire complexe, pour reconnaître les héritages et évaluer la nouveauté qui se fait jour dans les pratiques contemporaines.
On se demandera notamment comment la relation texte-image, jusqu’à son renouveau dans les pratiques numériques, peut revivifier l’enseignement de la littérature. Quel rôle peut jouer l’imbrication du texte et de l’image aujourd’hui pour stimuler les productions écrites des élèves ou leur travail de lecture et d’interprétation?
Nous nous proposons d’interroger les relations qu’entretiennent littérature et image selon les axes suivants:
Axe 1. Enjeux pédagogiques et didactiques des éditions illustrées dans l'enseignement
Ce premier axe vise à mettre en avant à la fois les pratiques pédagogiques spécifiques liées aux éditions illustrées et les questionnements didactiques qui en découlent. Pourquoi privilégier, en tant qu’enseignant·e, une édition illustrée d’une œuvre donnée? Quels dispositifs didactiques mettre en œuvre? Avec quels apprentissages potentiels pour les élèves?
Jan Baetens se penche sur cette question en prenant le cas de Proust et des illustrations dont son œuvre a fait l’objet. Il note que, si enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche du temps perdu semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, il n’en est rien: le critique analyse les difficultés sous-jacentes à ce choix pédagogique et les moyens d’y remédier, en prenant notamment en compte l’absence d’homogénéité de cette iconographie et la complexité de la culture visuelle en place.
Partant d’une expérience pratiquée en classe de terminale dans l’enseignement belge, Daniel Delbrassine montre comment l’approche en parallèle de deux genres d’un même récit, produits par le même auteur au même moment, permet de mettre en lumière les spécificités et contraintes de chacun des genres. Cette comparaison représente selon lui une étape indispensable pour préparer l’élève à la transposition de genre, tout en lui permettant d’acquérir des outils clés pour affiner ses compétences d’analyse en vue des lectures ultérieures.
Barbara Hurni-Siegrist, quant à elle, aborde la question de l’articulation entre texte et illustration par le biais d’éditions numérisées des Fables de La Fontaine auprès d’élèves du degré secondaire à Genève. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes permet de mieux appréhender les compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de Français.
Axe 2. Les manuels scolaires à l'ère de l’image : histoire, fonctions et usages pédagogiques
Ce deuxième axe explore la place et la fonction des images dans les manuels scolaires destinés à l’enseignement du Français. Les articles présents se concentrent sur la diversité des images présentes dans ces manuels – allant des photographies aux caricatures en passant par les représentations de tableaux et les bandes dessinées – et leur rôle à la fois dans l’attractivité du matériel pédagogique et dans l’atteinte des objectifs didactiques. Les auteurs analysent aussi bien l’évolution des relations entre texte et image dans les manuels scolaires à travers l’histoire que l’exploitation des adaptations cinématographiques dans les manuels français ou l’usage des images dans le cadre de séquences d’enseignement de fictions historiques pour la jeunesse.
L’article d’Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider et Anouk Darme-Xu retrace les rapports entre texte et image dans les manuels de lecture et les anthologies scolaires édités en Suisse romande entre 1870 et 1970. Il montre comment l’image donne à voir une représentation de la littérature scolarisée qui diffère en fonction des périodes et des publics d’élèves visés.
Hélène Raux porte son attention sur les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels français pour le collège et propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? comment est organisée la mise en relation entre texte et film? et enfin dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre?
Diane Boër analyse deux séquences d’enseignement basées sur des fictions historiques pour la jeunesse. Elle observe que la transposition didactique interne, médiée par l’enseignant·e, ne s’aligne pas toujours sur la transposition didactique externe, proposée par l’édition. Ainsi, en classe, les images sont principalement utilisées pour soutenir la compréhension du texte par les élèves, indépendamment des volontés éditoriales.
AXE 3. Enjeux didactiques de la compréhension visuelle dans l’approche des textes littéraires par les élèves
Ce dernier axe explore l’utilisation de l’image dans l’enseignement de la littérature, en particulier sa fonction dans la compréhension, l’analyse et l’interprétation des textes littéraires, que ce soit dans les genres de l'album illustré, de la littérature jeunesse, du roman ou de la poésie. Il s’agit de comprendre comment les mots et le texte se donnent à voir et comment l’image s’écrit en littérature, en explorant les relations concrètes des textes (notamment poétiques) et de l’image depuis le XIXe siècle jusqu’aux créations contemporaines. L’accent est mis sur les méthodes pédagogiques permettant aux élèves d’intégrer les images dans leur lecture. En s'appuyant sur plusieurs études de cas, cette partie questionne la pertinence et les limites de la lecture d’image en tant que médiation, notamment lorsqu’il s’agit d’œuvres picturales, où les codes visuels diffèrent des structures linguistiques. Il met également en lumière des pratiques pédagogiques concrètes et innovantes, telles que l’utilisation de programmes d’intelligence artificielle pour générer des images à partir de textes littéraires.
Marie-Sylvie Claude traite ici d’un paradoxe inhérent à la lecture de l’image lorsque celle-ci est une œuvre picturale. En effet, les programmes de français du lycée en France encouragent les enseignant·es à utiliser la lecture de l’image comme médiation pour les enseignements en lecture de la littérature. Or l’institutionnalisation scolaire d’une œuvre picturale n’est pas sans poser problème dans la mesure où un tableau ne se «lit»pas – les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits ne faisant pas l’objet d’un encodage de type linguistique. La critique met notamment en garde contre les assimilations hâtives qui appliquent au visuel des termes appartenant à la terminologie linguistique.
L’article de Maud Lebreton Reinhard et Florence Aubert présente un extrait du matériel pédagogique qu’elles ont élaboré à l’attention des enseignant·es du primaire et du secondaire 1 pour travailler l’image au sein d’albums illustrés. Prenant appui sur l’iconotexte Corrida de Yann Fastier, il met en lumière la nécessité de considérer à part égale le rôle du texte et des images dans la production de sens.
L’article de Eleonora Acerra, Sylvain Brehm et Nathalie Lacelle porte sur une expérience dans laquelle les élèves sont invités à générer une image par un programme d’intelligence artificielle à partir d’une citation choisie librement au sein d’un corpus d’œuvres littéraires proposé. L’analyse porte d’une part sur les attentes des élèves, d’autre part sur leur capacité à porter un regard esthétique et critique sur les productions du logiciel.
Conclusion
L’approche adoptée dans ce dossier a consisté à donner la parole aux didacticien·nes ainsi qu’aux expert·es des médias, de la littérature et de l’histoire culturelle, afin qu’ils et elles analysent la relation complexe, à la fois mémorielle, imaginaire et historique, qui unit texte et image. Leurs articles couvrent différents degrés, du primaire à l’université, et différents systèmes éducatifs – la Suisse romande, la Belgique, la France ou le Québec.
Ces articles, chacun à leur manière, mettent en évidence que la signification originale d’un texte ou d’une image n’est pas altérée par l’interaction entre ces deux médiums, mais plutôt ajustée et potentiellement réinterprétée en fonction de son nouveau contexte de diffusion. La manière dont l’ensemble des contributions interrogent cette relation conduit finalement à une réflexion sur ce qu’on met sous le terme de «littérature», tant en tant que pratique sociale qu’en tant qu’objet d’enseignement. Les relations entre objet textuel et objet iconique développées dans ce numéro ouvrent ainsi de nouvelles pistes pour l’enseignement de la littérature.
Bibliographie
Baroni, Raphaël & Turin, Gaspard (2021), "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n° 4, Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, en ligne, consulté le 6 décembre 2024.
Baroni, Raphaël & Goudmand, Anaïs (dir.) (2018), «Les avatars du chapitre dans la bande dessinée», Cahiers de narratologie, n° 34, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.8662)
Barthes, Roland, «Rhétorique de l’image» (1964), Communications, n° 4, p. 40-51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024.
Bertin, Jacques (2013), Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, Éd. de l’EHESS.
Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818)
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2006). Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations. Neuchâtel, CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2010). Plan d’études romand. Neuchâtel, CIIP, en ligne, consulté le 3 décembre 2024, URL : https://portail.ciip.ch/per/domains
Darme-Xu Anouk, Monnier Anne, Schneuwly Bernard & Tinembart Sylvianne (2020), «Émergence de la didactique du français et rénovation de l’enseignement en Suisse romande (1970-1990)», in Diffusion et influences des recherches en didactique du Français, O. Tremblay, E. Falardeau, P. Boyer & I. Gauvin (dir.), Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 203-222.
Delbrassine, Daniel (2019). «L’album pour enfants entre texte et image», Textyles, n° 57, p. 139-156.
Demougin, Françoise (2002), «Littérature et image: d’une lecture à l’autre», Tréma, n° 19, p. 1-11.
Département de l’Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud (1987), Activités sur les textes, Français 9ème, Lausanne, Éd. Loisirs et Pédagogie SA.
Département de l’Instruction publique (DIP) du canton de Genève (1980), Méthodologie de la lecture, 7e, 8e, 9e, Maître I. Genève, DIP.
Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n° 187-188, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.
Eco, Umberto (1972), La structure absente, Paris, Mercure de France.
Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthuyse (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 9-55.
Guillou Marlène & Claudine Dubois (dir.) (2009), Des images pour lire et pour écrire, SCÉRÉN CRDP Nord – Pas de Calais.
Lacelle, Nathalie & Monique Richard (2020), Croiser littératie, art et culture des jeunes, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Lacelle, Nathalie (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Leclaire-Halté, Anne (2014), «Valeurs et rapport texte/image dans l’album de littérature de jeunesse: étude d’un exemple, Le Génie du pousse-pousse», Pratiques, n° 163-164, en ligne, consulté le 22 février 2023.
Marin, Louis (1969), «Éléments pour une sémiologie picturale», Les Sciences humaines et l’œuvre d’art, Bruxelles, Éd. La Connaissance, «Témoins et témoignages», p. 109-142.
Metz, Christian (2014), «Existe-t-il une approche sémiologique de l’esthétique ?», 1895. Revue d'histoire du cinéma, n° 70, p. 154-167.
Peeters, Benoît (2009), Écrire l’image, Bruxelles,Éd. Impressions nouvelles, coll. «Réflexions faites».
Peirce, Charles Sanders (1978), Écrits sur le signe, trad. G. Deledalle, Paris, Seuil.
Specogna, Antonietta (2015), «Relation texte-image: pratiques d’enseignement dans les situations de lecture d’albums au cycle 3». Recherches en éducation, n° 22, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.
Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n° 146, p. 131-146.
Pour citer l'article
Zeina Hakim & Anne Monnier, "Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024http://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-7-le-texte-litteraire-a-l-epreuve-de-l-image
Voir également :
Sur Facebook