Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle{{Voir par exemple: Gustave Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément – D’après l’édition de 1851, éditions 2024, 2013; Gustave Doré, Les Travaux d’Hercule, éditions 2024, 2018; George Herriman, Intégrale Krazy Kat, tome 1 (1925-1934), tome 2 (1935-1944), 2018, éd. Les Rêveurs}}, constituent des marqueurs élitaires forts.
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré
- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020
Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020
1. Introduction
Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle1, constituent des marqueurs élitaires forts. Le passage au numérique, qui s’est accéléré à partir de 2009-2010 (Baudry 2012), a généré une interactivité nouvelle à travers les blogs BD, tandis que le turbomédia2 transforme les contours sémiotiques d’un mode d’expression qui se réinvente avec une plasticité et des propositions multimodales inédites (Robert 2016).
L’ensemble de ces transformations a conduit la recherche sur la bande dessinée à réinterroger ses catégories et ses paradigmes d’analyse. Je souhaiterais ainsi revenir sur trois tournants théoriques importants survenus dans la décennie 2010-2020. Le premier concerne un changement de conception dans la sociologie des champs culturels, avec le passage d’une théorie de la légitimation à celle d’une culture post-légitime de la BD. Le second tournant concerne la sémiologie et l’histoire du médium, à travers le passage d’une théorie de la BD comme littérature séquentielle à la conception élargie d’une généalogie polygraphique du médium. Enfin le troisième tournant concerne la réflexion pédagogique et didactique sur la bande dessinée. La légitimation culturelle de la bande dessinée, ainsi que son intégration scolaire ne se sont pas accompagnées d’une théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe. Après avoir assigné à la BD, dans les années 1970 et 1980, un rôle de démocratisation de la lecture, voire un rôle de remédiation aux difficultés pour lire et écrire (sans véritablement questionner ce présupposé), on s’est ponctuellement avisé des difficultés spécifiques et des malentendus sociocognitifs qui pouvaient accompagner son étude. Au début des années 2010, la réflexion s’est surtout développée dans une perspective programmatique et ingéniérique, alors que manquait encore une description précise et compréhensive des pratiques effectives. Dans les situations ordinaires de classe, quelles finalités chaque discipline scolaire assigne-t-elle au médium? Comment ce dernier est-il reconfiguré comme objet disciplinaire? Ce chaînon manquant d’une didactique descriptive semble désormais en passe de se combler pour la discipline du français. Or cette évolution intervient au moment même où les tournants théoriques dans la compréhension culturelle, sémiotique et historique de l’objet BD pourraient bien rebattre les cartes.
2. Du paradigme de la légitimation au paradigme de la culture post-légitime
L’histoire de la reconnaissance socio-culturelle et socio-institutionnelle de la bande dessinée a été en premier lieu décrite et analysée par les spécialistes comme un processus de légitimation prenant naissance dans les années 1960. En 1975, dans un article intitulé «La Constitution du champ de la bande dessinée», le sociologue Luc Boltanski décrit un phénomène d’autonomisation, «sur le modèle des champs de la culture savante», selon un processus à quatre niveaux: changement dans les caractéristiques des producteurs, conquête d’un nouveau public, apparition d’un nouveau rapport avec les œuvres débouchant sur des instances de médiation et de célébration, enfin double polarisation entre grande production et production restreinte, conservateurs et novateurs. Les faits semblent donner raison à cette théorie classique de la légitimité culturelle d’inspiration bourdieusienne (1979; 1992), qui voit la création d’un centre d’intérêt commun se transformer en champ, à travers un transfert de légitimité et d’habitus académique par les producteurs majeurs et les intellectuels. Les grandes étapes en ont été largement décrites pour la sphère francophone (Groensteen 2006; Ory et al. 2012; Heinich 2017; Raux 2019): créations en 1962 d’un club de collectionneurs, d’une revue spécialisée, ainsi que d’un «Centre d’étude des littératures graphiques» animé par le journaliste Francis Lacassin, le cinéaste Alain Resnais et la sociologue Evelyne Sullerot; classification de la BD comme neuvième art en 1964 par le critique de cinéma Claude Beylie; première anthologie des Chefs d’œuvre de la bande dessinée et première exposition au musée des arts décoratifs en 1967; apparition d’une génération d’avant-garde (souvent issue du journal Pilote) revendiquant des ambitions artistiques, et création d’une édition indépendante (L’Echo des savanes en 1972, Futuropolis en 1974, Métal Hurlant en 1975); création en 1974 du salon d’Angoulême et de la collection «les maîtres de la bande dessinée» chez Hachette; apparition en 1978 du Mensuel A suivre, ambitionnant de faire concurrence à la littérature à travers de grands romans graphiques en noir et blanc. Durant la décennie 1970, la bande dessinée francophone européenne se recompose ainsi complètement dans ses styles, ses genres, ses supports, ses formats et ses publics. Elle ne s’adresse plus exclusivement à la jeunesse et s’affranchit progressivement de la presse pour devenir un phénomène de librairie à destination d’un public de connaisseurs plus adultes. La polarisation du champ analysée par Boltanski semble se vérifier avec l’apparition d’un «modèle de lecture savante et distanciée» (Lesage 2019): l’année 1984 en marque sans doute la date symbolique avec la création des Cahiers de la bande dessinée (sur le modèle des Cahiers du cinéma) et celle de l’ACBD, l’association des critiques de bandes dessinées, regroupant journalistes et essayistes spécialisés. Différentes enquêtes sur les pratiques culturelles des français (BPI & DEPS 20113) mettent non seulement en évidence le fait que les lecteurs de BD sont aussi des lecteurs de littérature en général, mais associent également cette pratique au capital culturel des classes moyennes et supérieures (Evans 2015; Maigret 2015). La dernière étape du processus de légitimation est l’entrée dans les musées (l’exposition d’Hugo Pratt au Grand Palais en 1986 ouvrant la voie à la multiplication des expositions dans les années 2000 et 2010), l’intégration de la BD par l’art contemporain (FIAC 2009) et la cotation sans cesse à la hausse des auteurs de référence sur le marché de l’art. Pour Nathalie Heinich (2017), il ne s’agit plus d’une simple ascension linéaire dans la hiérarchie des genres, mais d’un changement profond, qu’elle nomme «artification».
Ce paradigme interprétatif d’un processus continu de légitimation a pu être nuancé et complété. Harry Morgan (2003; 2012) a montré comment une première théorie du médium s’est en réalité construite en négatif dans les discours de réaction, dès le début du XXe siècle, et situe dans le courant des années 1950 les toutes premières analyses légitimantes en ce qui concerne la France. Matteo Stefanelli, dans son archéologie internationale des discours sur la BD (2012), rappelle que le médium devient un objet de discours intellectuel et scientifique dès les années 1920 aux États-Unis et que la sédimentation s’est interrompue dans les années 1950 à cause de la psychiatrisation des discours de réaction.
Cependant ce paradigme bourdieusien de la légitimation fait désormais l’objet de critiques de la part des historiens et des sociologues, en ce qu’il constitue un cadre limité voire contre-productif pour appréhender le phénomène social et culturel de la bande dessinée. Éric Maigret et Matteo Stefanelli (2012) constatent qu’il a engendré une critique «légitimiste» qui s’est enferrée dans un discours essentialiste, excessivement sémio-centré, sur la BD «en soi» et ses caractéristiques. Ce sont les débats sur son statut «séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), son appartenance à la littérature (Morgan 2003), sa multimodalité (Frezza 1999; Boutin 2012), ou les discours sur son «ontologie visuelle» (Lefèvre 2007). Éric Maigret constate de surcroît que cette quête d’un langage BD s’est doublée de la recherche historique d’un point de départ originel (Töpffer chez Thierry Groensteen et chez Benoît Peeters), pour définir et légitimer «un quasi-invariant» sémiotique (2012: 7).
Une seconde critique porte sur les effets d’exclusion de la critique «légitimiste». Nathalie Heinich (2017) note que la reconnaissance pleine et entière de la BD au titre d’art est ralentie voire bloquée par deux facteurs: le maintien d’un large secteur destiné à la jeunesse et d’autre part un mode de production et de diffusion industriel. Chaque étape de la consécration d’une certaine bande dessinée adulte novatrice s’accompagne alors de la reconduction de discours de dévalorisation à l’égard de productions émanant du pôle opposé du marché éditorial, celui de l’industrie culturelle. Éric Maigret invite à ne jamais sous-estimer cette «stratégie de minoration» (Maigret 2012b: 143), la plus spectaculaire ayant été les discours de condamnation des mangas durant les années 1990, dans des polémiques, note Sylvain Lesage, «qui ne sont pas sans rappeler celles des années 1940» sur l’encadrement des lectures pour la jeunesse (2018: 20). A l’autre bout de l’échelle, la valorisation éditoriale du «roman graphique» procède elle aussi d’une pure logique de distinction, afin de considérer inversement une certaine bande dessinée comme de la littérature à part entière (Groensteen 2012: 12). Pour l’historien Sylvain Lesage, ces mécanismes de sélection et de distinction de la critique ont conduit à fabriquer un canon qui finit par déformer la connaissance historique du neuvième art, en déniant l’intérêt de certaines productions: par exemple les publications «trop communistes» comme Vaillant, ou «trop populaires» comme Le Journal de Mickey, ou les «petits formats» type Comics pocket (2018: 14).
Plusieurs auteurs montrent du reste que la réalité du champ contredit en partie cette vision classique d’un processus linéaire de légitimation, où la BD serait appelée au sein de la hiérarchie des arts, à rejoindre les champs dominants. Thierry Groensteen (2006; 2017), pointe des déficiences persistantes en médiation, qu’elles soient institutionnelles ou culturelles, en particulier dans le domaine scolaire. Jean-Matthieu Méon (2015) montre que la légitimation médiatique de la BD consiste encore à la défendre pour ce qu’elle n’est pas, en lui prêtant les qualités de la littérature, du cinéma ou de la peinture, c’est à dire en important les critères de domaines artistiques plus légitimes. Eric Maigret pointe les «retours de bâtons» violents dont elle fait l’objet de la part de fractions culturelles qui se sentent menacées par la montée d’un nouveau régime multiculturel. Il montre aussi comment la réalité contredit les hiérarchisations au sein du champ: des chefs de file de l’avant-garde, à l’instar d’Art Spiegelman, sapent délibérément les effets d’hermétisme du schéma distinctif classique et revendiquent l’héritage de la bande dessinée populaire; réciproquement des séries jeunesse grand public (Astérix, Titeuf, Le Petit Spirou) subvertissent certains discours idéologiques, que ces derniers portent sur l’enfance, l’identité nationale ou le choc des civilisations.
Le sociologue propose ainsi de revisiter l’histoire socio-culturelle et socio institutionnelle de la BD à l’aune d’un second paradigme, celui de la post-légitimité, pensé sur le mode des théories postcoloniales. Pour lui l’émancipation des nouveaux arts ne peut être qu’en «demi-teinte», dans un monde ou l’enjeu de légitimité culturelle est moins central. Car les sociétés occidentales contemporaines ne croient plus entièrement au mythe moderniste du XIXe siècle fondé sur le grand partage entre «Haute Culture» et «culture de masse». Le nouveau régime multiculturel ne signifie pas pour autant un abandon de la hiérarchisation, mais «sa translation progressive vers une distinction intra-genre […] reposant sur une pluralité des ordres culturels» (Maigret 2012b: 140). Il prône ainsi un «travail de défense des multiples cultures» qui composent la culture de la BD, «notamment celles qu’on labellise comme "populaires", "juvéniles", "féminines", voire "étrangères", en distinguant non plus seulement des valeurs, mais des mondes et des échelles.» (Maigret 2012b: 146-147)
Une seconde recommandation de Maigret, qui s’adresse aux comics studies, est de cesser de «réclamer l’instauration d’un champ autonome, sur le mode dur, dix-neuviémiste», mais d’accepter au contraire «l’incomplétude, l’impossibilité de se délimiter, d’être un Art, c’est-à-dire une entité quasi-métaphysique» (2012b: 146). Car une conséquence paradoxale du nouveau régime multiculturel est que si la reconnaissance des ex-cultures populaires se généralise, elle ne peut advenir que partiellement, en l’absence d’une clé de voûte unique à la légitimation. Si le champ de la BD doit faire le deuil d’une complète légitimité, il y gagne en retour une transitivité nouvelle pour être pensé comme processus vivant de l’échange culturel. Éric Maigret prend ainsi acte du passage à la BD numérique, de la culture participative qu’elle entraîne, brouillant les frontières de la création et de la réception, ainsi que du décloisonnement des activités artistiques qui touche tous les ensembles historiquement constitués. De même Matteo Stefanelli considère la marginalité de la BD comme une ressource stratégique pour son développement en tant que «cas paradigmatique de la culture de la participation» (2012: 256). La finalité dernière du champ, dans le paradigme d’une culture post-légitime, c’est-à-dire ayant dépassé le stade premier du différentialisme, étant de «permettre à un nombre toujours croissant d’individus, de vivre mieux et de s’accepter» (Maigret 2012b: 147).
Le paradigme de la post-légitimité place ainsi au centre des considérations la plasticité culturelle de la BD, plutôt que sa plastique propre et son rapport aux arts légitimes. Ce déplacement théorique, qui est intervenu dans le courant des années 2010, s’est accompagné d’une autre modification d’importance dans la compréhension de sa nature médiatique. Afin d’en cerner toute la portée, il convient de retracer les différentes approches des liens entre BD et littérature.
3. La BD, une littérature dessinée? De la paralittérature à la culture polygraphique
Les travaux théoriques qui envisagent les relations de la bande dessinée et de la littérature peuvent être résumés autour de quatre orientations principales.
La première est de considérer la BD comme une production littéraire de masse. C’est dans ce cadre qu’elle est abordée en 1967 dans le colloque de Cerisy dirigé par Noël Arnaud, ou encore en 1992 dans l’ouvrage de Daniel Couégnas sur la paralittérature. Selon cette catégorisation, la BD serait le vecteur de formes textuelles dégradées ainsi que d’un imaginaire moins domestiqué. La classification comme «littérature populaire» accrédite l’idée d’une hiérarchisation entre une lecture «dominante» distanciée, celle du public cultivé, et une lecture «dominée», celle du grand public, conçue comme un délassement sans recul critique. Elle ne prend pas en compte la bande dessinée élitaire de production restreinte ni ne permet de s’intéresser au fonctionnement spécifique du média considéré. Pour sortir de cette impasse, les recherches sur la littérature de grande diffusion4, dans les années 1990, ont repensé l’approche du champ littéraire en l’élargissant à la notion de «culture médiatique». Il s’agit de considérer que l’imaginaire narratif d’une collectivité s’inscrit autant dans les fictions de masse que dans la production restreinte de la littérature légitimée, en puisant dans un répertoire commun de pratiques symboliques, d’événements culturels, historiques, politiques, sociaux, appréhendé selon des schèmes spécifiques (Quéfellec-Dumasy 1997). De nombreuses études ont ainsi donné une résonance nouvelle aux récits en bande dessinée, pour en montrer la portée inédite dans des champs aussi variés que la psychanalyse (Tisseron 2000; Rouvière 2014), la sociologie historique (Gabilliet 2005) ou l’anthropologie politique (Rouvière 2006). Parallèlement, le développement d’œuvres exigeantes, de même que l’apparition de genres nouveaux (autobiographie, romans graphiques, BD-reportage, essais) ont définitivement sorti la BD du cadre conceptuel des paralittératures.
La seconde approche, essentiellement sémiotique, est de considérer la BD comme une forme de langage médiatique visuel, successivement appréhendé comme une grammaire dérivée de modèles linguistiques (Eco 1964; 1972; Fresnault-Deruelle 1972), comme un «art séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), comme un «système» narratif spatialisé (Groensteen 1999) ou comme une «littérature dessinée» (Morgan 2003). La longue histoire de ces recherches sémiotiques a bien été résumée par Stefanelli et Maigret (2012), avec ses premières impasses (rechercher des unités élémentaires de l’image qui relèveraient d’une double articulation, comme dans la langue) et ses différents concepts (arthrologie, spatio-topie, multicadre, site, graphiation, récitant, monstrateur, etc.). S’appuyant sur les travaux de Groensteen, Harry Morgan définit ainsi la bande dessinée selon les caractéristiques suivantes:
- - la présence d’un dispositif spatio-topique, comme une distribution de vignettes en bandeaux, ou une page compartimentée distribuant texte et images, impliquant un travail de mise en page spécifique et surtout un ancrage permanent de la lecture par l’image (contrairement à la littérature illustrée où l’ancrage demeure le texte écrit);
- - le caractère volontiers narratif des images, lorsque celles-ci induisent en elles-mêmes un avant et un après, un lien de causalité et de consécution;
- - enfin la séquentialité, c’est à dire la présence de ce même lien de causalité et de consécution dans une séquence d’au moins trois images par page. La triade constituée par la vignette en train d’être lue, celle qui précède et celle qui suit, constitue une micro-chaîne qui se déplace tout au long de la lecture. C’est un plan de signifiance à part entière, au même titre que la vignette isolée et le dispositif spatio-topique à l’échelle de la page ou de la double-page.
Cette définition minimale, qui écarte les notions de bulle, de case ainsi que les rapports texte-image, considérés comme non définitoires, a le mérite d’ouvrir les représentations du médium en intégrant une très grande variété de dispositifs graphiques. Elle donne toute sa place au pilotage par l’image et rompt avec l’influence des théories du cinéma, pour affirmer clairement que la maîtrise du temps par le récepteur place la BD dans le monde de la lecture. C’est à ce titre que le médium bande dessinée est considéré comme l’une des branches des « littératures dessinées », au côté des cycles de dessins ou de gravures, auxquels on peut ajouter les albums pour enfant (Rouvière 2008a).
La troisième façon d’envisager les liens entre BD et littérature se développe à travers une approche comparative, fondée sur l’idée que les deux arts ont en commun le fait de raconter une histoire (Groensteen 1999; 2010) et qu’ils partagent des liens intertextuels. L’étude de l’adaptation occupe alors une place privilégiée (Gaudreault & Groensteen 1998; Rouvière 2008; Baetens 2009; Mitaine et al. 2015). Plusieurs auteurs s’inquiètent d’un usage «marchepied» de la BD, au service de la compréhension du texte source. Jean-Paul Meyer (2012) s’affranchit du débat sur la fidélité des adaptations, pour montrer combien l’intérêt d’une transposition en bande dessinée est de «donner à voir», littéralement, les particularités sémiotiques, narratives et énonciatives selon lesquelles une BD raconte une histoire. De même, Jan Baetens (2009) invite à analyser les œuvres adaptées en elles-mêmes pour juger de l’utilisation qu’elles font du langage BD et de ses potentialités «médiagéniques» (Gaudreault et Marion, 2013). C’est alors que peuvent s’éclairer comparativement, dans un second temps, les ressources propres à chaque médium. Une sémiotique comparative peut faire apparaître par exemple une plus grande polyphonie de l’instance énonciative en bande dessinée (qui se partage entre récitant, monstrateur et narrateur fondamental) que dans le texte littéraire d’origine. Sur le plan axiologique, cette polyphonie peut conduire à créer des contrastes, voire des renversements de système de valeurs par rapport à l’œuvre source (Rouvière 2008b; Garric 2014). Enfin, dans une perspective métaculturelle, la bande dessinée peut en profiter aussi pour dire quelque chose de sa position dans le champ artistique à l’égard de la littérature et développer un discours ironique et critique sur son statut d’œuvre seconde (Garric 2014).
Cependant, comme le regrette Hélène Raux, «une certaine inféodation de la bande dessinée à la littérature semble toujours à l’œuvre dans le domaine des études littéraires» (2019: 22). Elle critique ainsi le fait que l’essai de Jacques Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature (2013), soit structuré autour d’intitulés trahissant un dialogue asymétrique entre les deux arts: «être ou ne pas être de la littérature», «s’emparer de la littérature», «représenter la littérature», «rivaliser avec la littérature». Plus problématique encore, l’auteur cèderait selon elle à une logique de segmentation au sein du champ de la BD, usant du qualificatif de «littéraire» comme d’une marque de distinction plutôt que comme une véritable catégorie d’analyse.
La quatrième façon d’envisager les liens entre BD et littérature est de réinscrire la BD dans une généalogie culturelle croisée. Cette approche, qui est celle de Thierry Smolderen (2010), rompt avec la vision de David Kunzle (1990), Benoît Peeters et Thierry Groensteen (1994), selon laquelle Rodolphe Töpffer, dans les années 1830, serait l’inventeur de la bande dessinée, parce qu’il aurait créé à la fois l’album autographié, le dispositif spatial de la planche et le héros graphique moderne. Pour Peeters, les «histoires en estampes» de Töpffer s’affranchiraient ainsi de la prééminence du littéraire, en ce que l’histoire naîtrait entièrement de la logique propre engendrée par le dessin. Pour Smolderen (2012) il s’agit là d’une vision rétrospective qui procède d’une définition contemporaine purement axiomatique de la BD comme art séquentiel. Elle empêche de comprendre le rapport de la bande dessinée avec le très riche passé des histoires en images au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour lui, la croyance dans une essence ontologique du médium conduit à un contresens sur le projet de Töpffer, qui n’est pas de promouvoir l’art séquentiel, mais au contraire de critiquer les théories de Lessing prétendant refonder la poésie comme description d’une action progressive. Töpffer s’emploie à donner une traduction graphique caricaturale de ces principes, en s’appuyant sur les illustrations des manuels de gestualité dramatique, qu’il parodie et enchaîne. Il invente cette forme pour se moquer de la mécanique stupide à laquelle aboutirait la rhétorique du progrès. En s’inspirant des écrits de Bakhtine sur la polyphonie et le dialogisme, Smolderen montre comment le dispositif de Töpffer s’inscrit dans une culture polygraphique antérieure beaucoup plus vaste, contemporaine du caricaturiste William Hogarth et des romans d’avant-garde anglais humoristiques du XVIIIe siècle. Hogarth, dans ses cycles narratifs de gravures, détourne et télescope des diagrammes visuels appartenant à différents registres, populaires ou archaïsants. Il s’inscrit dans une veine parallèle au «roman arabesque», dont le Tristram Shandy de Laurence Sterne est emblématique. Le novel humoristique anglais et la caricature procèderaient ainsi du même creuset culturel fondé sur l’hybridation stylistique, la parodie d’idiomes préexistants, l’ironie, la mise en abyme. Pour les contemporains de Töpffer, comme Goethe, ou pour ses successeurs comme Cham ou Gustave Doré, les récits séquentiels du Genevois relèvent à l’évidence des dispositifs ironiques du roman excentrique, à la fois polyphonique et polygraphe.
A travers le prisme de la culture polygraphique proposé par Smolderen, c’est soudain une généalogie de la BD beaucoup plus complexe qui apparaît, où la linéarité visuelle de la bande n’est pas première. Ce dispositif séquentiel ne trouve de postérité, dans les décennies suivantes, qu’à la faveur du support presse et d’autres gestes polygraphiques, comme la transposition de scripts sociaux, la schématisation inspirée des recherches chronophotographiques sur la décomposition du mouvement, le détournement de la fonction emblématique du phylactère (détournement concomitant à l’invention du phonographe), l’attraction de l’affiche publicitaire, ou encore la reprise de la culture foraine des images déformantes. Le travail d’historien de Smolderen, en rompant avec un «cycle essentialiste» sémio-centré (Stefanelli, 2012) au profit d’une approche culturaliste, a entraîné dans son sillage un déplacement prometteur des questions théoriques au sein des recherches sur la BD.
Le premier est porté par Henri Garric (2013) et concerne «l’engendrement des images en bande dessinée». Il s’agit de réfléchir aux moyens par lesquels une BD se constitue à partir de la seule répétition et métamorphose des formes et des objets, selon un jeu libre de l’image avec elle-même. Toute bande dessinée illustre une «plasticité métamorphique des images» (Garric 2013: 44), des jeux de genèse et de combinaisons des dessins, selon un bricolage qui se nourrit aux sources les plus éclectiques. Ce processus «déborde» la séquentialité chronologique des cases, pour s’exercer à l’échelle de la planche, de l’album, voire d’un genre tout entier. Il s’exerce également dans la BD numérique, à travers le déroulement vertical et la circulation hypertextuelle. Henri Garric fait ainsi une relecture des gags de Gaston Lagaffe à l’aune de l’opposition entre raideur et souplesse, entre trait rectiligne et ligne serpentine, diagrammes mécaniques et jeux d’arabesques (2013b). Il montre comment ces formes sont frappées de valeurs (la raideur mécanique et productiviste d’un côté, la liberté subjectivante du vivant de l’autre), dans un jeu d’échange dialectique qui engendre littéralement le scénario du gag. Cet axe de lecture permet de saisir simultanément, dans le mouvement de naissance de l’image, l’imaginaire particulier de l’auteur qui le porte, mais aussi le pouvoir de perturbation critique du dessin, «ouvrant à partir de n’importe quel prémice, n’importe quelle situation narrative, un récit qui vient défaire la cohérence et la linéarité temporelles» (Garric 2013b: 14-15). On toucherait là un noyau central de l’expression en bande dessinée, au point que «l’engendrement des images est ce qui reste de la BD quand elle tente une radicalisation et une concentration expérimentale de ses moyens», et constituerait pour certains un «idéal créatif» (Garric 2013b: 14).
Cette attention au jeu des auteurs sur l’apparition des images, en particulier à partir du creuset que constituent la mémoire, les rêves et les fantasmes (Rostam 2013), trouve son pendant dans un questionnement renouvelé sur les images que se forme le lecteur. Ce déplacement vers la réception est déjà présent dans la théorie de l’art invisible de Mc Cloud (1993), qui s’intéresse au jeu mental du lecteur avec l’espace inter-iconique (le blanc entre les cases), mais dans un paradigme où l’activité imageante du récepteur est prédéterminée, par les effets de cadrage, d’ellipse et de temporalité du récit. De même, les différentes théories sémio-structurales qui s’intéressent à la navigation du regard, traitent la page comme un objet statique en relation avec la théorie de la narration (Taylor 2004; Nakazawa 2005; Ingulsrud & Allen 2009), où l’ordonnancement est supposé introduire un balisage du sens de lecture. Or, si l’on considère que le processus d’engendrement des images fuit, déborde ou échappe en réalité à cet ordonnancement, leur puissance de surgissement invite à considérer autrement l’expérience lectorale. Eric Maigret, qui se dit particulièrement attaché aux principes d’autonomie de la réception, refuse de réduire les cheminements internes du lecteur au seul décodage ou pré-cadrage d’un parcours du regard. Il invite au contraire à considérer que les assemblages de sens effectués par le lecteur peuvent être «décentrés, faiblement cohérents, non hiérarchiques, sans but narratif ultime, partager des frontières floues avec d’autres formes d’expression» (2012a: 57). Matteo Stefanelli (2011; 2012) questionne quant à lui les relations entre réception et corporalité. Tout d’abord l’énonciation graphique, définie comme «graphiation» par Philippe Marion (1993: 31) est une trace idiosyncrasique, une empreinte-signature qui entraîne une relation subjective, fantasmatique du lecteur avec un corps-dessinant. Cette corporéité permet d’embrasser sur un plan idéel et mental le regard de l’artiste comme corps visionnaire. D’autre part, l’interface matérielle de la page et des écrans dépasse la modalité de la simple vision et appelle à prendre en compte l’engagement corporel du lecteur dans l’expérience de lecture. La matérialité de cette expérience immersive est du reste également prise en compte par les études sociologiques qui s’intéressent aux usages sociaux des comics ou des mangas, comme le cosplay 5 ou le scanlation6. La BD s’insère alors dans la vie quotidienne comme ressource identitaire, à travers un réseau de pratiques performatives et de communautés online, comme le montrent les recherches sur la dimension participative des médiacultures (Jenkins 2006; Ito 2008; Lunning, 2010).
Enfin les premières recherches sur la bande dessinée numérique remettent en cause le partage établi par Harry Morgan (2003) entre les arts qui pilotent la durée et qui l’imposent au récepteur (en particulier les arts audiovisuels), et les arts de la lecture qui laissent le récepteur gérer le temps (peinture, gravure, dessins, littérature dessinée). Anthony Rageul (2014) propose le concept de «lectacture» pour indiquer que la modalité de réception n’est plus seulement la lecture:
«lire» une bande dessinée numérique, c’est lire et agir ou lire et visionner. La lecture et l’action ou la lecture et le visionnage peuvent apparaître alternativement (ex: bande dessinée entrecoupée de passages jouables ou animés) ou se faire en même temps et ne faire qu’une (ex: explorer l’image avec la souris ou l’écran tactile). C’est une nouvelle modalité que j’appelle lectacture, en détournant la notion de Weissberg. En bande dessinée numérique, il y a deux axes, un qui va chercher du côté de l’animation, l’autre du côté du jeu vidéo. (cité dans Baudry 2015)
Rageul reprend le concept de «narrateur-arbitre» issu des recherches de Dominique Arsenault sur le jeu vidéo (2006), pour concilier une approche narratologique et une approche ludologique. Il établit ainsi un embryon de narratologie de la bande dessinée numérique qui tient compte de la participation du «lectacteur». Pour lui l'expérience de l'œuvre se joue sur le mode du gameplay et cela a des répercussions sur la narration, qui doit intégrer ces modalités particulières. Le récit ne reposerait plus seulement sur les mécanismes de la narration. Il exhiberait toute sa matérialité au lectacteur et reposerait en grande partie sur des mécanismes d'ordre poétique.
L’état des lieux qui précède sur les réflexions et les connaissances au sein des comics studies, dessine un objet culturel complexe et permet de mieux cerner les spécificités et les décalages avec la situation scolaire du médium dans les classes de français, telle qu’en rend compte la littérature pédagogique et didactique.
4. La reconfiguration scolaire de la BD
4.1. Un processus parallèle à celui de la légitimation culturelle
L’intégration scolaire de la BD s’est développée en parallèle de son intégration sociale, de façon assez autonome et sans recouper tout à fait cette dernière. Plusieurs synthèses historiques (Rouvière 2012; Raux 2019) en ont retracé en France les étapes successives, qui ont abouti à une forme de normalisation dans le courant des années 2000. À partir des programmes de 1972 pour l’école primaire, l’intégration de la BD se fait de façon d’abord résignée et méfiante. La volonté de valoriser les intérêts des élèves coexiste avec un discours de réprobation des mauvaises lectures, ce qui reflète les tensions qui entourent la rénovation de la discipline et plus largement de l’école. La BD reste alors en marge de ce qui est pleinement considéré comme lecture. Par la suite un deuxième mouvement se fait à la croisée des disciplines, par la lecture de l’image dans les programmes de collège de 1985 puis de 1996. De même, dans les programmes de 2008, la BD est évoquée au titre de l’histoire des arts (sans toutefois que les objectifs d’apprentissage soient clairement définis dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire). Le troisième mouvement est celui d’une intégration progressive aux lectures scolaires à partir des programmes de 1996 pour le collège. On passe d’une perspective d’exploitation instrumentale au service de la maîtrise de la langue et des discours (1996) à la reconnaissance de la BD comme support de la lecture interprétative, en particulier grâce au saut décisif des programmes de 2002 pour l’étude de la littérature jeunesse à l’école primaire. On note à ce titre la diversification croissante, depuis 1996, des œuvres conseillées pour l’école et le collège, sur le plan des genres, des styles, des univers fictionnels et des auteurs.
Ce processus n’est pas linéaire. Ainsi, les programmes de français de 2008 pour le collège tendent à évacuer la BD en recentrant la lecture sur la littérature classique et patrimoniale. De même, le réaménagement en 2018 des programmes de 2015 retire la BD de la liste des «genres» pour la compétence «comprendre un texte littéraire» en fin de cycle 3. Par ailleurs l’intégration de la BD reste segmentée selon les niveaux de classe et les filières. Comme le rappelle Hélène Raux, alors que la référence au médium dans les programmes de français du lycée professionnel est continue depuis 1987, celle-ci reste extrêmement marginale dans ceux du lycée général et technologique (malgré l’ouverture qu’avaient constitué les programmes de 1970 et 1981). Pour la chercheuse, c’est le signe que l’institution scolaire continue de conférer à la BD un rôle de remédiation ou de marchepied vers la lecture. Plusieurs auteurs pointent ainsi les limites du processus d’intégration, évoquant une forme de «trompe-l’oeil» (Rouvière 2012), de «réversibilité» (Aquatias 2017), ou de «décalage» avec les pratiques (Depaire 2019). Plusieurs enquêtes tendent à montrer que l’on n’étudie pas de BD en œuvre intégrale à l’école et au collège (Louichon 2008; Massol & Plissonneau 2009; Bonnéry et al. 2015). Pour Hélène Raux (2019), les usages scolaires de la bande dessinée restent minoritaires, périphériques et possiblement sujets à des malentendus sociocognitifs, tandis que manque une véritable théorisation didactique du médium.
Ce paradoxe pourrait s’expliquer selon le paradigme de la culture post-légitime développé par Eric Maigret (1994): à l’image de ce qui se produit en dehors de la sphère scolaire, l’intégration de la BD serait vouée à demeurer partielle et contradictoire, l’école reproduisant en interne, dans le choix et l’étude des corpus, des logiques de distinction extérieures. Cependant, les travaux sur l’histoire de l’enseignement (Chervel 1998) et la scolarisation des genres (Denizot 2013) offrent un autre modèle explicatif: en effet, la culture scolaire a la particularité de reconfigurer ses objets de façon autonome pour ses besoins propres.
Hélène Raux (2019) en fait la démonstration pour la bande dessinée à travers l’étude historico-didactique de 120 articles mentionnant la BD, qui ont été publiés entre 1968 et 2018 dans trois revues didactiques de référence (Repères, Pratiques, Le français aujourd’hui) ainsi que dans une revue professionnelle plus ancrée sur les pratiques enseignantes (la Nouvelle Revue Pédagogique). Durant la période de rénovation de l’enseignement et jusqu’au milieu des années quatre-vingt, la BD est appréhendée comme mass média, étant donné que, dans une logique communicationnelle, tout est discours parmi les langages présents dans l’environnement social. De façon inattendue, certains discours hostiles à la BD émanent alors de rénovateurs de l’enseignement, pour des raisons essentiellement idéologiques: en tant que production de masse, la BD est soupçonnée de diffuser les valeurs de la classe dominante et de véhiculer des stéréotypes sociaux. S’il faut l’étudier, c’est alors comme support propédeutique pour développer l’esprit critique face aux médias. Lorsque la BD est appréhendée de façon complètement positive par les rénovateurs, c’est cette fois-ci au détriment de sa spécificité médiatique, le plus souvent comme support d’une analyse structurale du récit. Dans les deux cas, Raux pointe le risque de renforcer les hiérarchies culturelles et les effets d’exclusion à l’égard de la culture privée qu’on prétend intégrer.
À partir de la fin des années 1980, Raux décrit une période marquée par une transition vers la reconnaissance de la BD comme lecture à part entière. Avant les années 1990, le support est pensé comme facilitateur pour la lecture, puis reconnu comme art complexe après les années 2000. De la paralittérature (Reuter 1986) à la lecture littéraire, la chercheuse retrouve les logiques de distinction qui conduisent à prendre en considération surtout des œuvres éloignées des lectures prisées des élèves (Bruno 1995), voire de minorer la complexité de ces lectures. L’ouverture aux lectures privées est toujours ambivalente, avec la volonté de leur faire prendre une distance critique par rapport aux productions qu’ils plébiscitent et de valoriser des œuvres fortement mises à distance des productions les plus populaires. Par ailleurs, la lecture de BD évolue, d’une lecture narratologique à une lecture sémiotique, via la lecture de l’image, jusqu’à esquisser une lecture didacticienne de productions d’élèves, par le travail sur l’adaptation. Raux montre surtout à quel point la didactisation de la BD est quasiment absente des articles. La présence de la BD reste incidente au profit d’objectifs variés. Elle n’est pas interrogée comme objet disciplinaire et son rôle supposé de remédiation n’est guère questionné. Rares sont les articles qui mettent en garde contre une sous-estimation de sa complexité (Huyhn 1991; Bautier et al. 2012). On s’en tient à des esquisses de pistes pédagogiques possibles (Bomel-Rainelli & Demarco 2011), tandis que l’analyse de productions d’élèves reste l’exception (Hesse-Weber 2017). Par ailleurs, la production de planches n’est pas mise en relation avec la lecture d’œuvre. Pour expliquer ce déficit, la chercheuse évoque la position «satellitaire» du médium par rapport à la littérature et fait le constat plus général d’un retard de la réflexion didactique sur l’image. Dans ce domaine, elle pointe les limites d’une approche qui est restée formaliste et elle critique un isomorphisme supposé entre image et texte (Raux 2019: 109-113).
4.2. Lever des présupposés non questionnés: d’une didactique programmatique à une didactique descriptive et compréhensive
Lorsqu’en 2010 est organisé à Grenoble le colloque international «Lire et produire des bandes dessinées à l’école», il s’est agi d’impulser dans le champ de la didactique de la littérature une réflexion pédagogique qui, depuis la fin des années 1970 et le colloque de la Roque d’Anthéron «Bande dessinée et éducation» (1977), ne s’était poursuivie de loin en loin que dans le champ disciplinaire de l’histoire. Les actes Bande dessinée et enseignement des humanités, publiés en 2012, proposent ainsi un état des lieux et une perspective programmatique pour envisager comment la BD pourrait contribuer à la construction de compétences de lecture. Ces actes incluent aussi des récits d’expériences de classe, principalement orientés vers l’ingénierie. Rétrospectivement, en 2020, apparaissent les limites de certains discours fondés sur des présupposés non toujours démontrés. Certains reposent sur des déclarations d’intention qui n’ont pas été suivis par des expérimentations attendues; d’autres prônent des mises en œuvre, qui n’ont pas été suivies de recueils et d’analyses de données suffisants, sur la situation scolaire du médium et la représentation comme objet disciplinaire que s’en font les acteurs institutionnels. D’autres enfin relèvent d’une praxéologie empirique, sans que l’on puisse véritablement tirer de conclusion générale sur les effets de cette dernière.
Les études qui se sont poursuivies dans la décennie 2010-2020 se sont appuyées sur une méthodologie et des données plus conséquentes pour lever un certain nombre de méprises sur la lecture de BD en classe. Tout d’abord, l’étude de Beaudoin et al. (2015), qui porte sur l’enseignement explicite de stratégies de compréhension en lecture, tend à montrer qu’il n’y a pas d’effet significatif du recours à la BD sur l’habileté à produire des inférences ou à développer la conscience métacognitive. Par ailleurs, le postulat selon lequel la bande dessinée serait facile d’accès est battu en brèche par plusieurs recherches. Sur des supports aussi variés que la BD historique ou le roman graphique, Virginie Martel et Jean-François Boutin (2015), ainsi que Nathalie Lacelle (2015), montrent que la prise d’information visuelle fait souvent défaut, en articulation avec la modalité textuelle, pour produire une interprétation générale. Les auteurs plaident donc pour une formation spécifique des élèves aux compétences de lecture multimodale. La bande dessinée peut même nuire aux apprentissages, lorsque les difficultés de réception du médium sont sous-estimées, comme le montrent Bautier et al. (2012) dans une séance de lecture en CP, à partir d’une planche présentant une pluralité de codes sémiotiques. Polo et Rouvière (2019) montrent qu’en classe de Première Sciences économiques et sociales, le choix d’un récit biographique de sept planches, donné comme support d’évaluation sans travail préalable sur les compétences spécifiques de lecture, suscite des erreurs de compréhension imputables au médium choisi, quel que soit le ressenti positif ou négatif des élèves. Le décalage qu’ils pointent entre l’effet subjectif plutôt positif du médium sur les élèves et les effets objectifs sur leur compréhension recoupe sur ce plan les analyses de Beaudoin et al. (2015).
Par ailleurs, loin de faciliter la compréhension et les apprentissages, la persistance de malentendus peut réduire l’étude de la bande dessinée à un simple vecteur de motivation. Hélène Raux (2019), qui a mené une étude sur les pratiques ordinaires des enseignants, incluant une série d’entretiens avec les praticiens, montre que la BD est essentiellement perçue comme une lecture plaisir, susceptible de raccrocher les petits lecteurs, a fortiori dans des démarches de projet supposées créer de la motivation et bonifier le climat de classe. La méconnaissance du domaine BD par les enseignants surdétermine le choix de corpus connus au graphisme accessible. Hélène Raux montre par ailleurs le décalage entre les premières représentations des professeurs et les fragilités qu’ils éprouvent ensuite face à l’objet. Ils disent leur manque d’outils pour travailler la BD dans le champ de la littérature. De fait, l’étude par la chercheuse de vingt-six séquences de français au sein du réseau «communauté des profs blogueurs» montre une très faible didactisation du médium dans la discipline. En l’absence d’une approche interdisciplinaire qui articule texte et image dans une démarche interprétative, l’usage de la BD oscille d’une part entre un outillage technique sur les codes sémiotiques, sans mise en relation avec l’effet de sens, et d’autre part une focalisation sur le texte et les enjeux globaux du récit, au détriment de la dimension visuelle.
Hélène Raux montre malgré tout que certaines pratiques «ordinaires» qu’elle a observées mettent en œuvre, avec la BD, des modalités de lecture interprétative et de questionnement ouvert, à partir d’éléments «résistants» dans des compositions visuelles polysémiques. Le cadre de l’observation, qui est celui du projet TALC (Du texte à la classe), est cependant spécifique7. Il s’agit d’enseignants volontaires sollicités à l’occasion d’une formation consacrée à l’enseignement de la littérature, tandis que le choix de la BD a été imposé. De façon significative, elle met cependant en évidence des embarras liés à l’intégration du médium, par exemple le besoin de faire un cadrage liminaire sur les codes de la BD, ou encore des logiques centrifuges symptomatiques à travers des activités de langue extérieures aux activités de lecture. Comparativement aux autres «genres» proposés dans le projet TALC, les enseignants demandent surtout très peu aux élèves de justifier leur lecture par des prises d’indices dans la BD.
Il en va différemment lorsque l’expérimentation en classe vise à tester un scénario pédagogique spécialement conçu par un didacticien pour embrasser les différentes composantes du médium et mettre les élèves en situation de questionnement (Rouvière 2012b; 2013). A travers la mise en évidence d’analogies de composition, les élèves peuvent parvenir à quitter le simple niveau de la fiction pour passer à l’examen plus distancié de procédés narratifs «littéralement visibles». Ils découvrent alors que le pilotage du récit par l’image est lourd d'effets implicites, ouvrant la voie à une lecture symbolique.
Il est à noter dans les recherches de Raux et Rouvière que ce sont les planches ou les scènes muettes qui donnent lieu à un travail interprétatif mobilisant l’analyse de compositions visuelles «résistantes». Cela rejoint le paradoxe pointé par Baetens (2012) à propos du roman graphique: le rapprochement avec la lecture dite «littéraire» serait plus grand lorsque le pilotage du récit n’est pas d’abord textuel.
Alors qu’un déplacement vers la question de la réception subjective s’amorce dans les comics studies et que les théories du sujet-lecteur informent depuis 2004 les réflexions en didactique de la littérature, il est à noter qu’aucune recherche d’envergure n’a été menée sur ce plan avec la BD, contrairement à d’autres genres et médium (album pour enfants, poésie, théâtre, genres narratifs).
4.3. La production de planches de BD en classe: de l’observation de pratiques «ordinaires» à l’expérimentation d’un dispositif spécifique
On doit à nouveau à Hélène Raux (2019) d’avoir mené un travail descriptif et compréhensif des pratiques ordinaires de production de BD en classe. La chercheuse a ainsi observé différents ateliers en CE2 et en classe de sixième dans le cadre d’une pédagogie de projet assortie, dans l’un des cas, de l’intervention d’une artiste. Son analyse s’appuie sur un ensemble de productions d’élèves des différentes classes et des entretiens menés avec chacune des enseignantes. La chercheuse retrouve dans les modalités de travail inspirées de la pédagogie de projet un certain nombre de limites déjà pointées par des sociologues de l’apprentissage comme Bonnéry (2007) ou Bautier et Rochex (2007): un investissement variable des élèves, des phénomènes de division du travail, une finalisation étroite des activités, une réduction chez certains élèves de la compréhension des enjeux de la tâche. L’atelier BD est valorisé par les enseignants au nom d’une pédagogie de la réussite supposée restaurer l’estime de soi, selon le présupposé d’un pouvoir remédiant du médium ou des vertus mêmes du détour. Mais cette réalité ne vaut que pour une poignée d’élèves, tandis que la démobilisation des autres est acceptée par les professeurs au nom de l’inédit, l’essentiel étant de sortir des sentiers battus de la discipline.
Les enjeux cognitifs passant au second plan, non seulement les résultats décevants entretiennent les difficultés, mais paradoxalement, l’activité s’avère surtout porteuse pour les bons élèves. Sur un plan plus technique, la chercheuse constate que la capacité à créer un enchaînement narratif visuel n’est pas enseignée comme une compétence. Le découpage du récit en images est pensé comme naturel et allant de soi. Pour y parvenir, les élèves sentent qu’il serait possible de faire un découpage dessiné, mais comme il leur est demandé de faire un découpage écrit, l’activité se mue au mieux en une segmentation de texte à illustrer, où le dessin ne pilote pas le récit. Hélène Raux montre le flou des représentations enseignantes sur la notion de scénario, elle montre comment une partie des élèves dessine malgré tout et insère du texte transformé, enfin comment le découpage scénaristique peut se trouver délégué à un intervenant extérieur, annihilant l’intérêt pédagogique de l’activité pour les élèves.
De fait, si l’écriture d’un synopsis mobilise des compétences d’écriture scolaires traditionnelles, le découpage, en revanche, suppose que les élèves aient la capacité spécifique de pré-visualiser ce qu’ils racontent et mettent en scène: le site, la taille et la forme des cases, les types de plans, le contenu figuratif, etc. Or, cette compétence particulière, qui consiste véritablement à «penser en images» devrait faire l’objet d’un apprentissage préalable. Ainsi, des élèves performants dans l’écriture du synopsis peuvent-ils se trouver démunis lorsqu’il s’agit de passer à l’étape suivante. C’est pour remédier à ce problème qu’a été inventé le dispositif collaboratif de «l’écriture post-it», qui a été expérimenté avec succès (Rouvière 2015; 2017). Le principe «1 post-it = 1 action» permet de créer une histoire pré-découpée selon l’équivalence implicite «1 post-it = 1 case». A quoi s’ajoute ensuite deux autres couches de post-it de deux couleurs différentes, l’une pour le texte, l’autre pour décrire le visuel. Le synopsis s’invente ainsi ou se réinvente en même temps que le scénario s’écrit, case après case. Planification, mise en texte et révision ne sont plus des étapes chronologiques, mais se fondent dans un seul et même processus dynamique. Ainsi certains élèves en difficulté dans des productions écrites traditionnelles se découvrent une capacité à pré-visualiser et mettre en scène avec ces petits papiers ce qu’ils veulent raconter.
4.4. L’étude des adaptations: une porte d’entrée incontournable de la BD en classe?
Dans son étude historico-didactique, Hélène Raux (2019) montre que l’étude de l’adaptation en BD des classiques de la littérature se situe à un point d’équilibre des tensions culturelles qui entourent la légitimation du médium et, à ce titre, constitue une porte d’entrée possible pour une didactique de la BD en classe. C’est ce que pourrait laisser espérer l’article de Hesse-Weber (2017), qui s’appuie sur l’analyse de productions d’élèves pour étudier les enjeux de l’adaptation d’une pièce de théâtre en bande dessinée. La place donnée à la BD reste cependant celle d’un «satellite gravitant autour des œuvres littéraires» (Raux 2019: 107). D’autres études confirment que la production en classe d’adaptation en BD reste subordonnée pour le professeur à des objectifs d’appropriation subjective, de compréhension et d’interprétation du texte littéraire (Lacelle & Lebrun 2015). Il en ressort tout de même que l’adaptation par les élèves peut donner une réelle impulsion à l’exploration du texte source pour construire la compréhension (Rouvière 2015). Elle oblige les élèves à plonger dans le texte, à le découper, à distinguer les différentes factures de discours et les instances énonciatives, à séquencer les actions, les dialogues ou les passages descriptifs. Le processus engage par ailleurs chez les élèves un effort d'élucidation lexicale et de représentation mentale pour se forger des images. Effort qui est souvent étayé par des recherches documentaires pour enrichir la lecture et nourrir le projet.
Cependant, en ce qui concerne la lecture proprement littéraire, le bénéfice pour l’interprétation du texte source semble limité. Dans une expérimentation que j’ai pu mener (Rouvière 2017), il est apparu qu’une fois que les élèves ont dégagé une note d’intention, le texte source servait de réservoir utile à d'autres fins qu'à sa propre lecture, dans le sens d’'une réduction et d'une simplification. Lors de la présentation ultérieure des planches, le travail comparatif s’est avéré également assez pauvre et n'a pas enrichi véritablement la lecture littéraire. Les élèves ont vu le texte original à travers le prisme de leur propre adaptation, pour étayer leur projet. L'activité fictionnalisante du lecteur (Langlade 2004) a certes été mise en mouvement, mais en amont du processus de l’adaptation lui-même, après la lecture-découverte, lorsqu’était suscité par exemple un jeu d’images associatives. La transmodalisation a apporté en aval peu de gain supplémentaire sur ce plan. Par contre l'analyse que les élèves ont faite de leur planche a montré le plus souvent une articulation explicite entre une intention signifiante, des procédés de composition et des effets de sens (même s’il s’agissait d’un discours reconstruit). La BD m’apparaît comme un médium particulièrement propice à l'adoption de cette posture, pour peu que l’on exerce le regard des élèves sur quelques procédés (choix d’un multicadre, taille, forme et site des vignettes, jeux d’échelle sur l’échelle des plans ou sur les angles de vue, etc.). Ce résultat peut du reste être obtenu en lui-même, sans le détour par l’adaptation d’un texte littéraire.
En ce qui concerne la lecture en classe de bandes dessinées adaptées d’œuvres littéraires, la réflexion didactique, quoi qu’elle en dise, parvient également difficilement à s’affranchir d’une approche «marche-pied», car l’objectif est de contribuer à la formation d’une lecture littéraire de l’œuvre source. Les adaptations BD sont envisagées comme des «textes de lecteurs», et à ce titre, fournissent l’exemple de lectures subjectives (Fourtanier 2012) et sensibles (Ahr 2012). Cependant Brigitte Louichon (2012) montre que l’étude de la reproduction intégrale du texte source peut aussi avoir pour effet de questionner les particularités sémiotiques du langage BD et s’avère une modalité porteuse pour problématiser la lecture.
4.5. Vers une didactique de la culture polygraphique?
Le paradigme de la culture polygraphique proposé par Thierry Smolderen (2009; 2012) pour cerner le creuset où prend naissance et se réinvente la bande dessinée, invite sans doute à élargir les perspectives pour une didactique du médium.
Cela concerne d’abord les frontières d’une acculturation générale au média: ouvrir les représentations des élèves à la diversité des univers de fiction, des genres, des styles graphiques et des esthétiques semble une nécessité, de même que les ouvrir au processus de création, à l’histoire du médium et à ses différentes sphères culturelles à travers le monde. Mais il semblerait fructueux également de questionner en classe les frontières sémiotiques du médium avec d’autres formes d’expression: le dessin de presse, les caricatures séquentielles, le roman-photo, la peinture d’images itératives (profanes ou religieuses), les albums pour enfants, les recueils d’illustrations ou de caricatures, l’art de l’affiche, du vitrail ou de la fresque, dans une approche véritablement interdisciplinaire avec les arts plastiques.
Lorsqu’il s’agit d’étudier le «langage» de la BD, le concept de culture polygraphique invite également à décloisonner l’approche des codes formels. Rencontrer un même procédé (cadre, site, plan, angle de vue…) dans des contextes stylistiques et compositionnels diversifiés éviterait de figer les représentations sur les effets induits, tout en développant la culture du regard et la sensibilité.
En ce qui concerne la production de planches par les élèves, l’intégration d’éléments composites (photogrammes, détails grossis ou inversés de reproductions de tableaux, diagrammes divers) apparaît comme une pratique légitime, de même que le détournement, le collage et l’invention patchwork de planches à partir d’emprunts à d’autres BD ou différentes banques d’images disponibles (Rouvière 2015; 2017). A ce titre, les directions de recherche impulsées depuis 2016 par l’association Stimuli et le laboratoire de didactique André-Revuz de l’Université Denis-Diderot, dans le champ de la didactique des sciences, s’avèrent tout à fait prometteuses. Les enseignants et les chercheurs qui utilisent les arts narratifs et visuels pour faire vivre la science dans leur classe ou médiatiser leurs recherches en laboratoire, utilisent des dispositifs icono-textuels qui s’inspirent de la BD autant qu’ils la nourrissent: par exemple certains organisent la page comme un champ panoptique et insèrent des photogrammes qu’ils traitent comme des vignettes de BD (avec récitatifs et bulles), en les recadrant, en estompant les éléments non discutés, en épurant les éléments importants avec des dessins aux lignes claires, et en les complétant d’annotations graphiques (Goujon 2020); d’autres font produire aux élèves des narrations graphiques codées à partir d’albums pour enfant (Moulin & Hache 2020) et des cartes dites «sensibles» (Gaujal 2020), pour favoriser l’appropriation de savoirs disciplinaires en cours d’acquisition8.Thierry Smolderen (2012) rappelle à quel point toute forme de modélisation théorique peut se révéler stimulante pour l’imagination d’un dessinateur polygraphique. Il y voit l’une des clés du dynamisme de la bande dessinée, qui trouve historiquement sa source dans un imaginaire diagrammatique et spéculatif. Ce propos est confirmé par différentes expériences universitaires récentes, qui invitent les jeunes chercheurs à transposer leur recherche en BD9.
Sur le plan de la lecture, la notion de culture polygraphique invite par ailleurs à sortir d’une approche strictement séquentielle du médium. En contrepoint d’une approche scénaristique de la BD (telle qu’induite par exemple par la narratologie ou le dispositif de l’écriture post-it), il est sans doute possible de promouvoir une approche non linéaire axée sur l’engendrement des images. A la suite des approches tracées par Marion Rostam et Henri Garric à propos des œuvres de David B. et de Franquin, il s’agirait par exemple de rechercher avec les élèves, parmi le flux et l’entrelacement des formes et des figures au sein de certaines œuvres graphiques, un possible dispositif dialectique. Tout se passe parfois comme si la tension entre certaines formes ou certains motifs (la droite vs la courbe, le contour vs le détour, le noir vs le blanc, le vide vs le plein, le texte vs l’image, le figuratif vs l’emblématique) recouvrait un conflit de valeurs et se prêtait à des jeux de combinaison réversibles.
Une autre source d’engendrement des images est l’imaginaire linguistique. Roland Barthes (1982) l’avait montré à propos de l’art du peintre Arcimboldo fondé sur un jeu de métaphores, de métonymies et d’expressions langagières transposés dans une composition visuelle. On retrouve cette direction dans une proposition de Tatiana Blanco Cordon (2012), en classe d’espagnol langue étrangère, qui consiste à effectuer une lecture «littérale» de certains motifs, pour en déduire des expressions linguistiques. Cette méthode semble approcher d’assez près le nœud d’imaginaire où la création iconique parfois s’origine. Il est possible en effet que l’image ait sa source dans un «texte souterrain», qu’elle procède de certaines expressions de la langue qui la parle à l’avance (Rouvière 2012a: 373). On sait par exemple qu’il s’agit chez René Goscinny de l’un des ressorts de l’invention du gag visuel (Kaufmann 1983) ou du cryptage symbolique (le sang-lier). On aboutit alors à des énoncés littéraux, une «lettre» de l’image qui redonne toute leur profondeur aux mises en scène par la bande.
Enfin, au regard de l’hybridation stylistique et de la distanciation ironique partagées par le roman comique et la culture polygraphique, les travaux de Thierry Smolderen légitimeraient d’inscrire dans les programmes de Lycée la culture du roman arabesque et du récit excentrique, au XVIIIe et au XIXe siècle, en incluant les œuvres de Töpffer, Cham ou Doré. Ce serait là le signe d’un saut véritablement «post-légitime» dans l’appréhension du médium BD.
5. Conclusion
Les trois champs théoriques qui ont été mis en regard peuvent sembler relativement hermétiques les uns vis-à-vis des autres, en particulier celui de la recherche en éducation. Intuitivement, on pourrait penser à l’inverse qu’il existe socialement une logique descendante, qui va de la légitimation culturelle du médium à la connaissance savante de son langage et de son histoire, pour aboutir à son intégration scolaire. Mais en raison de logiques de scolarisation propres à la discipline (Chervel 1998; Denizot 2013; Raux 2019), la trajectoire scolaire de l’objet BD tend à se développer en parallèle de son histoire sociale, sans la recouper totalement. Par ailleurs, alors que l’on semble progresser vers une théorisation didactique du médium, jamais la plasticité culturelle de ce dernier n’est apparue aussi grande, du roman arabesque au jeu vidéo, bouleversant les catégories préexistantes à travers lesquelles l’objet était pensé. La notion de culture polygraphique ou encore de dispositif d’images en flux, pourrait à moyen terme faire apparaître comme daté le dispositif de la bande dessinée tel qu’il s’est stabilisé au XXe siècle sur support papier. A moins que cette muséification progressive soit précisément l’une des conditions culturelles et institutionnelles d’une intégration scolaire à venir plus forte encore. L’inscription d’une bande dessinée au programme de Lettres du baccalauréat constituerait sans doute une étape majeure en ce sens. Mais la recherche en didactique sur l’étude de la BD doit encore progresser, en s’intéressant en particulier à la lecture subjective, pour répondre aux besoins qui se feraient jour et accompagner favorablement les pratiques de classe.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bandes dessinées: sacrilège ou tremplin?», in Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. De Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 197-208.
Aquatias, Sylvain (2017), «La bande dessinée à l’école hier et aujourd’hui», Deuxièmes rencontres nationales de la bande dessinée, Angoulême. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.etatsgenerauxbd.org/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/2017_rencontres_nationales_bd_02_v00c2.pdf
Arsenault, Dominic (2006), Jeux et enjeux du récit vidéoludique: la narration dans le jeu vidéo, mémoire, Université de Montréal. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.le-ludophile.com/Files/Dominic%20Arsenault%20-%20Memoire.pdf
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n° 16. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/narratologie/974
Barthes, Roland (1982) «Arcimboldo ou Rhétoriqueur et Magicien», in L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil.
Baudry, Julien (2015), «Entretien jeune recherche en bande dessinée: Antony Rageul», Phylacterium. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.phylacterium.fr/?p=2162
Baudry, Julien (2012), Cases Pixels. Une histoire de la bande dessinée numérique en France, Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Bautier, Elisabeth, Jacques Crinon, Catherine Delarue-Breton & Brigitte Marin (2012), «Les textes composites: des exigences de travail peu enseignées?», Repères, n° 45, p. 63-79.
Bautier, Elisabeth & Jean-Yves Rochex (2007), «Apprendre: des malentendus qui font la différence», in Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, J. Deauvieau & J.-P. Terrail (dir.), Paris, La Dispute, p. 227-241.
Beaudoin, Isabelle, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Nathalie Lemieux, Martin Gendron (2015), «Consolider ses compétences de compréhension en lecture par la BD», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/consolider-ses-competences-de-comprehension-en-lecture-par-la-bd
Blanchard Marianne, Hélène Raux (dir.) (2019), «Usages didactiques de la bande dessinée», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 1er novembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/trema/4803
Boltanski, Luc, (1975), «La Constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, p. 37-59. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2448
Bomell-Rainelli, Béatrice & Alain Demarco (2011), «La BD au collège depuis 1995: entre instrumentalisation et reconnaissance d’un art», Le Français aujourd’hui, n° 172, p. 81-92.
Bonnéry, Stéphane (2007), Comprendre l’échec scolaire, Paris, La Dispute.
Bourdieu, Pierre (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, éditions de Minuit.
Bourdieu, Pierre (1992), Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littérature médiatique multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec.
Bruno, Pierre (1995), «La culture jeune», Le Français aujourd’hui, n° 111, p. 19-28.
Chervel, André (1998), La Culture scolaire: une approche historique, Paris, Belin.
Couégnas, Daniel (1992), Introduction à la paralittérature, Paris, Seuil.
Dacheux, Eric (2009), «La bande dessinée, art reconnu, média méconnu», Hermès, n° 54, p. 11-17.
Dardaillon, Sylvie (2009), «Quelle place pour l’iconotexte dans les pratiques des enseignants du cycle 3?» in La Littérature en corpus. Corpus implicites, explicites, virtuels, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Dijon, Scéren-CRDP de Bourgogne, p. 85-95.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires 1802-2010, Bruxelles, Bern & Berlin, Peter Lang.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: la place de la bande dessinée dans l’enseignement, Syndicat national de l’édition. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL:https://www.sne.fr/app/uploads/2019/02/SNE-PictureThis_etat-des-lieux-BD-ecole_janv2019_2.pdf
Queffélec-Dumasy, Lise (1997), «De quelques problèmes méthodologiques concernant l’étude du roman populaire», in Problèmes de l’écriture populaire au XIXe siècle, R.Bellet & Ph. Régnier, Limoges, Pulim, p. 229-266.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Garnier.
Eco, Umberto (1972), La Structure absente, Paris, Mercure de France.
Eco, Umberto (1970), «Sémiologie des messages visuels», Communications, n° 15, p. 11-51.
Eco, Umberto (1964), Apocaliticci e integrati. Communicazioni di massa e theori della cultura di massa, Milan, Bompiani.
Eisner, Will (1985), Comics and Sequential Art, Tamarac, FL, Poorhouse Press.
Evans, Christophe (2015), «Profils de lecteurs, profils de lecture », in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, éditions de la Bibliothèque publique d’information, p. 17-44.
Fourtanier, Marie-José (2013), «Lire et faire lire des œuvres littéraires adaptées en BD: "ravauder" le patrimoine ou l’inventer?», in Les Patrimoines littéraires à l’école, S. Ahr & N. Denizot (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 33-50.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1972), La Bande dessinée. Essai d’analyse sémiotique, Paris, Hachette.
Frezza, Gino (1999), Fumetti, anime del visibile, Roma, Meltemi.
Gabilliet, Jean-Paul (2005), Des Comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États-Unis, Nantes, éd. du Temps.
Garric, Henri (dir.) (2013), L’Engendrement des images, Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Garric, Henri (2014), «Ce que la bande dessinée pense de la littérature: à propos de gemma Bovery de Posy Simonds», Neuvième Art 2.0. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article806
Gaudreault, André & Thierry Groensteen (dir.) (1998), La transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip, Quebec & Angoulême, Editions Nota Bene / CNBDI.
Gaujal, Sophie (2020), «Géo-graphier», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 111-118.
Goujon, Catherine (2020), «La bande dessinée dans les écrits scientifiques en sciences de l’éducation, un cas en didactique des sciences», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 26-31.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (2006), La bande dessinée, un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Hache, Christophe & Marianne Moulin (2020), «Codage d’album et activité mathématique?», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 82-85.
Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 10-15.
Hesse-Weber, Armelle (2017), «Du théâtre à la bande dessinée », Pratiques, n° 175-176. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/pratiques.3617
Huynh, Jeanne-Antide (1991), «La synthèse de documents», Le Français aujourd’hui, n° 96, p. 26-35.
Ingulsrud, John E. & Kate Allen (2009), Reading Japan Cool. Patterns of Manga Literacy and Discourse, Lanham, Lexington Books.
Ito, Mizuko (2008), «Mobilizing the Imagination in Everyday Play: The Case of Japanese Media Mixes», in International Handbook of Children, Media and Culture, D. Livingstone & K. Drotner (dir.), New York, Sage. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.itofisher.com/mito/publications/mobilizing_the.html
Kaufmann, Judith (1983), «Astérix, humour pictural et verbal», Cahier comique et communication, n°1, p. 67-109.
Kunzle David (1990), History of the comic strip, vol. 2, The ninetheenth century, Berkeley, University of California Press.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec, p. 125-140.
Lacelle, Nathalie & Monique Lebrun (2015), «L’écriture transmédiatique dans le processus s’appropriation d’univers narratifs», in Les Formes plurielles des écritures de la réception, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 237-257.
Langlade, Gérard (2004), «Le sujet lecteur auteur de la singularité de l’œuvre», in Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, A. Rouxel & G. Langlade (dir.), Rennes, PUR, p. 81-91.
Louichon, Brigitte (2012) «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.
Lunning, Frenchy (dir.) (2010), Fanthropologies, Minneapolis, University of Minessota Press.
Jenkins, Henry (2006), Convergence culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press.
Lefèvre, Pascal (2007), «Incompatible Visual Ontologies: The Problematic Adapatation of Drawn Images», in Film and Comic Books, I. Gordon, M. Jancovitch & M. McAllister (dir.), Jackson, University Press of Mississippi.
Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée: les éditeurs franco-belges et l’album, 1950-1990, Lyon, Presses de l’Enssib.
Lesage Sylvain (2019), «Une bande dessinée adulte? Usages et mésusages de la légitimation», Belphégor, n° 17 (1). En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http: //journals.openedition.org/belphegor/1607
Louichon, Brigitte (2012), «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.
Louichon, Brigitte (2008), «Enquête sur le rapport des enseignants aux programmes de 2002 et les pratiques d’enseignement de la littérature au cycle 3», Repères, n°37, p. 51-68. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.420
McCloud, Scott (1993), Understanding Comics. The Invisible Art, Northampton, Tundra Publishing.
Maigret, Eric (2015), «La bande dessinée dans le régime du divertissement: reconnaissance et banalisation d’une culture», in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Editions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://books.openedition.org/bibpompidou/1677
Maigret Eric (2012a), «Théories des bandes débordées», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 50-70.
Maigret Eric (2012b), «bande dessinée et postlégitimité», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 130-148.
Maigret, Eric (1994), «La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée», Réseaux, n° 67, p. 113-140. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1994_num_12_67_2742
Maigret Eric, Matteo Stefanelli (dir.) (2012), La Bande dessinée: une médiaculture, Paris, Armand Colin.
Marion, Philippe (1993), Traces en cases, Louvain-la-Neuve, Académia.
Martel, Virginie & Jean-François Boutin (2015), «Intégrer la lecture multimodale et critique en classe d’histoire: étude de cas exploratoire», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2015-v1-rechercheslmm03759/1047801ar.pdf
Massol, Jean-François & Gersende Plissonneau (2008), «La littérature lue en 6e et 5e: continuités et progressions», Repères, n° 37, p. 69-103. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.422
Méon, Jean-Matthieu (2015), «Bande dessinée: une légitimité sous condition», Informations Sociales, n° 190 (4), p. 84-91.
Mitaine Benoît, David Roche & Isabelle Schmitt-Pitiot (dir.) (2015), Bande dessinée et adaptation (littérature, cinéma, TV), Clermont-Ferrand. Presses universitaires Blaise Pascal.
Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Éditions de l’An 2.
Morgan, Harry (2012), «De l’éradication de "l’illustré gangster" à l’analyse de bandes dessinées en classe (1929-2009): ruptures et continuité», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 55-77.
Nakazawa, Jun (2005), «Development of manga (Comic Book) Literacy in Children », in Applied Developmental Psychology. Theory, Practice and Research from Japan, D, W. Schwalb, J. Nakazawa & B. Schwalb (dir.), Charlotte, Information Age Publishing.
Ory, Pascal, Laurent Martin, Jean-Pierre Mercier & Sylvain Venayre (2012), L’Art de la bande dessinée, Paris, Citadelle & Mazenod.
Polo, Claire & Rouvière, Nicolas (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51, p. 166-190.
Rageul, Anthony (2014), La bande dessinée saisie par le numérique: formes et enjeux du récit reconfiguré par l’interactivité, thèse de doctorat, Université Rennes 2.
Raux, Hélène (2019), La Bande dessinée en classe de français: un objet disciplinaire non identifié, thèse de doctorat, Université de Montpellier.
Reuter, Yves (1986), «Les Paralittératures: problèmes théoriques et pédagogiques», Pratiques, n° 50, p. 3-21.
Robert, Pascal (2016), Bande dessinée et numérique, Paris, CNRS éditions.
Rostam, Marion (2013), «Naissance d’un imaginaire graphique dans L’Ascension du Haut Mal de David B.», in L’Engendrement des images, Garric H. (dir.), Tours, Presses Universitaires François Rabelais, p. 19-41.
Rouvière, Nicolas (2017), «Adapter en classe des extraits de roman sous forme de BD: quels apports pour la lecture littéraire?», Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale, n° 6. En ligne, consukté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/adapter-en-classe-des-extraits-de-roman-sous-forme-de-bd-quels-apports-pour-la-lecture-litteraire
Rouvière, Nicolas (2015), «Produire des planches pour apprendre à lire la BD: quelques dispositifs et leurs effets dans des classes de cycle 3», Revue de Recherches En Littératie Médiatique Multimodale, n° 1. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.7202/1047792ar
Rouvière, Nicolas (2014), Le Complexe d’Obélix, Paris, PUF.
Rouvière Nicolas (dir.) (2012a), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, Ellug,
Rouvière Nicolas (2012b), «Étudier une œuvre intégrale en bande dessinée au cycle 3: quelles spécificités didactiques?», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 103-121.
Rouvière, Nicolas (2008a), «L’influence de la bande dessinée sur les albums pour enfants: histoire, esthétique et thématiques», Modernités, n° 28, p. 17-28.
Rouvière, Nicolas (2008b), «Adapter les classiques. Présentation de la collection "les grandes aventures racontées aux enfants"», Les Cahiers de Lire écrire à l’Ecole, n° 2, p. 45-65.
Rouvière, Nicolas (2006), Astérix ou les lumières de la civilisation, Paris, PUF.
Stefanelli, Matteo (2012), «Un siècle de recherches sur la bande dessinée», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 17-49.
Smolderen, Thierry (2009), Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à Winsor McCay, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
Smolderen, Thierry (2012), «Histoire de la bande dessinée: questions de méthodologie», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 71-90.
Taylor, Laurie (2004), «Compromised Divisions, Thresholds in Comic Books and Video Games», ImageText, n°1 (1). En ligne, consulté le 28 août 2021, URL: http://www.english.ufl.edu/imagetext/
Tisseron, Serge (2000), Psychanalyse de la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Tisseron, Serge (1993), Tintin et le secret de Hergé, Paris, Hors collection.
Pour citer l'article
Nicolas Rouvière, "Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021http://www.transpositio.org/articles/view/quelle-didactique-pour-la-bande-dessinee-retour-sur-trois-tournants-theoriques-de-la-decennie-2010-2020
Voir également :
La bande dessinée dans les manuels de FLE (1919-2020)
Dans ce numéro consacré au rapport entre didactique et bande dessinée, la réflexion que nous allons présenter se situe dans le champ du français langue étrangère (FLE) avec une perspective historique. Nous nous poserons la question de savoir quelle est et quelle a été la place de la BD dans l’enseignement du FLE, et nous nous demanderons en particulier quel(s) rôle(s) elle a joué en relation avec les méthodologies dans lesquelles elle s’insère. Pour répondre à ces questions on cherchera à retrouver dans les manuels de FLE les traces de son exploitation et à étudier son évolution, de manière à se faire une idée des changements de représentations et de pratiques dans le discours méthodologique.
La bande dessinée dans les manuels de FLE (1919-2020)
Dans ce numéro consacré au rapport entre didactique et bande dessinée, la réflexion que nous allons présenter se situe dans le champ du français langue étrangère (FLE) avec une perspective historique. Nous nous poserons la question de savoir quelle est et quelle a été la place de la BD dans l’enseignement du FLE, et nous nous demanderons en particulier quel(s) rôle(s) elle a joué en relation avec les méthodologies dans lesquelles elle s’insère. Pour répondre à ces questions on cherchera à retrouver dans les manuels de FLE les traces de son exploitation et à étudier son évolution, de manière à se faire une idée des changements de représentations et de pratiques dans le discours méthodologique. Des parallèles peuvent être esquissées entre les champs de la didactique du FLE et du français langue dite maternelle (FLM), par exemple sous l’angle historique de la situation de la BD dans l’enseignement au siècle dernier1. Nous en rappellerons quelques-uns sous forme de déficits:
- - la BD est peu présente dans l’enseignement;
- - elle manque de travaux de recherche académique;
- - elle manque d’instruments didactiques pour l’exploitation en classe;
- - elle manque de formation initiale ou continue pour les enseignants;
- - elle souffre encore d’un déficit de légitimité et les corpus enseignés peinent à s’émanciper du cadre étroit de la BD pour enfants;
- - elle est majoritairement instrumentalisée à des fins d’apprentissage pour d’autres savoirs (en particulier linguistique, mais aussi culturels, historiques, etc.).
Mais des nuances importantes doivent être prises en compte, notamment concernant la nature des documents exploités et leur fonction dans l’espace social. L’influence des différents courants méthodologiques dans le domaine de la didactique des langues étrangères joue sans doute un rôle essentiel dans l’intégration de la BD dans les manuels d’enseignement selon les époques. Pour clarifier ces nuances, il convient aussi de préciser une distinction fondamentale dans le champ de la didactique du FLE concernant le type de BD dont il sera question. En effet, il faut rappeler l’importance, dans le champ de la didactique des langues étrangères, depuis les années 1970, du débat sur la distinction entre document authentique (entendu comme objet de discours circulant dans la société-cible) et document fabriqué (entendu comme objet de discours fabriqué pour l’enseignement de la langue).
En général, le document fabriqué s’oppose au document authentique en ce qu’il présente une langue artificielle, et qu’il perd les éléments contextuels, les implicites et tous les éléments susceptibles d’être jugés trop difficiles pour le niveau des apprenants. Il y a donc les pour et les contre et le débat est vif (Boyer & Butzbach 1990). Mais de manière générale, l’utilisation du document authentique est fortement recommandée par les didacticiens des langues depuis les années 1980 et l’arrivée de l’approche communicative (Cuq & Gruca 2003: 392). Ce type de documents va s’imposer dans les manuels et progressivement envahir l’espace visuel dans les méthodes actionnelles des années 2000: publicités, affiches, tracts, brochures, etc. Toutefois, cette profusion de documents authentiques concerne surtout les textes écrits, les documents oraux authentiques étant souvent considérés comme trop difficiles pour l’accès au sens.
Pour ce qui est de la BD, nous utiliserons cette distinction entre BD fabriquée pour l’enseignement de la langue étrangère et BD authentique circulant dans la société-cible (désormais BDF et BDA) pour rendre compte des usages dans les manuels de FLE: jusqu’aux années 1980, la BDA y est absente, puis elle apparait timidement dans les suppléments culturels. Pourtant, Rouvière (2012: 283) mentionnait une «très large présence» de la BD dans les manuels de langue et civilisation depuis les années 1970. Cuq et Gruca (2003) font le même constat2, mais ces affirmations sont contraires aux résultats de notre recherche si l’on prend en compte seulement les BDA, qui s’avèrent rares dans les manuels que nous avons observés. En effet, ces supports graphiques semblent faire l’objet des mêmes résistances que les documents authentiques oraux: ils sont généralement jugées trop difficiles et n’apparaissent que dans les niveaux plus avancés. En revanche, le dessin assimilable à des BDF est massivement exploité sous toutes ses formes, avec une densification dans les premiers niveaux.
Toutefois, la frontière entre BDA et BDF n’est pas toujours claire: les illustrations fabriquées adoptent plus ou moins les caractéristiques spécifiques de la bande dessinée authentique, comme on le verra, selon les objectifs à traiter. Nous en viendrons par la suite à relativiser cette distinction, qui repose surtout sur un critère éditorial. En lien avec cette question d’authenticité, si l’on veut rendre compte de la place de la BD dans les manuels de FLE, on doit également tenir compte de la dimension sérielle et du nombre de cases dessinées, avec plusieurs cas de figure:
- Des BD allant de une à trois vignettes pour illustrer et faire comprendre un contenu: dans ce cas, l’utilisation de dessins fabriqués est omniprésente, mais cette proportion diminue à mesure que l’on progresse dans les niveaux de langue. La BD fonctionne alors comme support et illustration d’un discours autre: celui de la méthode. Les dessins authentiques de ce type, beaucoup plus rares dans notre corpus, s’apparentent au dessin de presse, souvent satirique, mettant l’accent sur la dimension critique ou humoristique.
- Des séquences de BDA tronquées, sous forme de vignettes sorties de leur contexte: dans cette configuration, on peut se demander si l’on est encore en présence d’un document authentique. Les planches complètes sont très rares.
- Une ou deux pages de BDA: ce type d’usage s’observe rarement dans les manuels, la BD étant considérée comme un objet discursif en tant que tel. L’activité est alors rangée dans les objectifs socioculturels des manuels3.
Mais que recouvre exactement le terme de «bande dessinée» quand il est utilisé dans le cadre de la didactique du FLE? Dans une perspective historique, nous avons eu recours aux deux principaux dictionnaires francophones de didactique des langues. Dans celui de Cuq (2003), il n’y a pas d’entrée BD. Dans celui de Galisson & Coste (1976), on trouve une page consacrée à la bande dessinée et deux pages concernant l’image (à l’époque, les méthodes audiovisuelles dominent encore et utilisent systématiquement une certaine forme de BDF, comme on le verra). La définition proposée est la suivante:
Mode d’exposition d’une histoire (encore appelée «figuration narrative») au moyen de dessins accolés en bandes, qui se lisent de gauche à droite et de haut en bas, comme l’écriture, et qui représentent des étapes successives de l’histoire. (Galisson & Coste 1976: 64)
Plus loin, il est fait allusion à la dimension cognitive de la lecture de BD:
Pour rétablir la continuité d’un dessin à l’autre, le lecteur doit mentalement «boucher les trous». Les paroles du personnage qui parle s’inscrivent généralement dans une bulle (appelée "phylactère") reliée à sa bouche et contenu dans l’image. (Galisson & Coste 1976: 64)
Sont mentionnés ensuite rapidement les «procédés graphiques» et les «divers codes» qui expriment «les éléments prosodiques» et «les valeurs affectives du langage». Dans la rubrique Remarques, les auteurs opèrent une distinction (sans employer le terme de «document authentique») entre les BD construites à des fins pédagogiques et les «bandes dessinées du commerce». Pour ces dernières, les auteurs remarquent que leur «utilisation immédiate» est «pratiquement impossible», sans toutefois expliciter les raisons de cette impossibilité. Nous y reviendrons. Notons cependant qu’entre 1976 et aujourd’hui, le statut culturel et didactique de la BDA a beaucoup évolué dans les milieux de l’éducation (cf. Rouvière 2012), en même temps que ses formes d’expression et ses publics se sont diversifiés (Berthou 2017).
L’objet de notre recherche étant ainsi plus ou moins circonscrit, il nous faut maintenant préciser notre méthodologie de recherche. Il s’agissait d’effectuer une analyse qualitative des supports BD dans un corpus de 33 manuels de FLE pour adultes et grands adolescents, de niveau A1 à C1. Le choix des ouvrages visait à offrir un échantillonnage significatif de manuels souvent considérés comme représentatifs de leur époque et couvrant un siècle d’enseignement (1919 à 2020). Pour étudier ce corpus, nous avons envisagé plusieurs questions de recherche: quel est le rôle joué par la BD (BDA et BDF) dans les manuels? comment est-elle utilisée et dans quel but? son usage varie-t-il en fonction de l’époque et des évolutions méthodologiques?
En observant les manuels, on peut ainsi attester, par des exemples concrets, de certains usages différenciés de la BD selon les époques, sans que ce corpus restreint nous autorise à produire une représentation statistique de l’ensemble de ce qui s’est produit dans le monde francophone. Disposant actuellement de peu de publications théoriques sur ce sujet, il demeure ainsi difficile d’avoir une vision d’ensemble du phénomène. La BD, apparemment, a peu intéressé les didacticiens4, soit parce son exploitation a été considérée comme problématique (cf. l’«impossibilité» évoquée par Galisson & Coste), soit à cause de l’influence des représentations que l’on se fait de ce médium (la réputation de manque de sérieux qui s’attache encore à la BD), soit encore pour d’autres raisons, que nous serons amenée à discuter plus loin.
Nous allons présenter les résultats de notre analyse en lien étroit avec l’évolution historique des méthodologies d’enseignement du FLE5. Nous distinguerons deux époques, celle d’avant les années 1980, avec les méthodes directes, mixtes, audiovisuelles et audio-orales, et celle postérieure, avec les méthodes communicatives et actionnelles. Dans la première période, on ne trouve pas de BDA dans les manuels de FLE, mais on constate cependant une évolution de la fonction attribuée à la BDF en fonction des méthodologies.
Avant 1980: dessins fabriqués uniquement
Méthode Directe
Le dessin est présent dans les manuels les plus anciens de notre corpus, qui relèvent de la Méthode Directe. C’est une des caractéristiques importantes de cette méthodologie novatrice apparue à la fin du XIXe siècle. Le dessin devient un élément décisif de la leçon, en permettant un accès «direct» au sens, il évite de passer par la traduction. Il présente des situations, des objets, il sert aussi à l’apprentissage des structures, à travers des activités de description des images et des exercices questions/réponses liés aux dessins.
Dans Le français pour tous (1919), par exemple, on voit pour chaque leçon l’adoption systématique d’un dessin muet qui fonctionne comme décor, mais aussi comme support pour les actions et les interactions dans la classe.

Figure 1 Le français pour tous (1919: 2)
On trouve également dans certains manuels une ébauche de bande dessinée (telle que définie plus haut), sous la forme de dessins alignés sans paroles. Un exemple particulièrement intéressant est reproduit dans Puren (1988), pour un cours d’allemand pour débutants. Les dessins y suggèrent l’idée d’action pour l’enseignement des conjugaisons du présent. L’emploi de la BD souligne ainsi l’aspect performatif des verbes et de la langue (le Faire) et sert de guidage pour les exercices. La dimension dynamique de la langue est suggérée par le mouvement représenté par la succession des images.
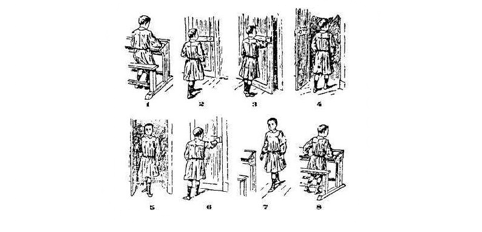
Figure 2 Cours d’allemand. Grands commençants (1923: 49)
Ces exemples relèvent ainsi d’une fonction d’illustration de la situation et des éléments de la leçon. Ils ont pour points communs d’intégrer un contexte, de faciliter l’accès au sens, de mettre l’accent sur le sens et la dynamique de la communication6, en favorisant la dimension praxéologique de la communication: cela permet de travailler l’emploi des verbes, les suites d’actions, le mouvement, le mime, le dialogue.
Méthode mixtes (traditionnelles)
La méthodologie Directe a représenté une rupture dans l’enseignement des langues en Europe, elle fonctionnait sans recours à la langue maternelle, sans explications grammaticales, et d’abord à l’oral. Trop révolutionnaire pour l’époque et abandonnée dès les années 1920-1930, cette option méthodologique a laissé des traces dans les manuels de FLE dits «mixtes» des années suivantes, qui reviennent à une méthodologie plus ancienne, «traditionnelle», en gardant l’influence des méthodes directes: davantage de dessins, pas de traduction, davantage d’oral, etc. On y voit l’apparition de personnages dessinés, très stéréotypés, comme par exemple, dans cette méthode célèbre des années 1950-1980, le Cours de langue et de civilisation françaises,communément appelée le Mauger bleu, où les dialogues sont supposés être tous prononcés par deux familles.
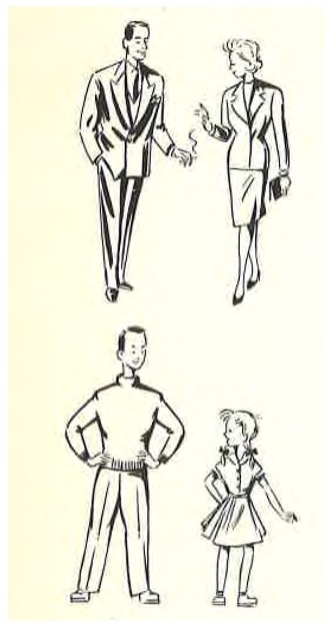
Figure 3 Cours de langue et de civilisation françaises 1 (1957: 72)
Méthodes audiovisuelles et audio-orales
Toutefois, une nouvelle forme de BD apparait dans les années 1950 au sein du courant des méthodes audio-visuelles et audio-orales: la présentation systématique de «bandes dessinées»7 avec des phylactères qui reproduisent les répliques orales (et audio) des personnages. La BD est associée au son comme adjuvant pour la compréhension et la mémorisation «en situation» (en contexte); elle est également un support pour des exercices structuraux.
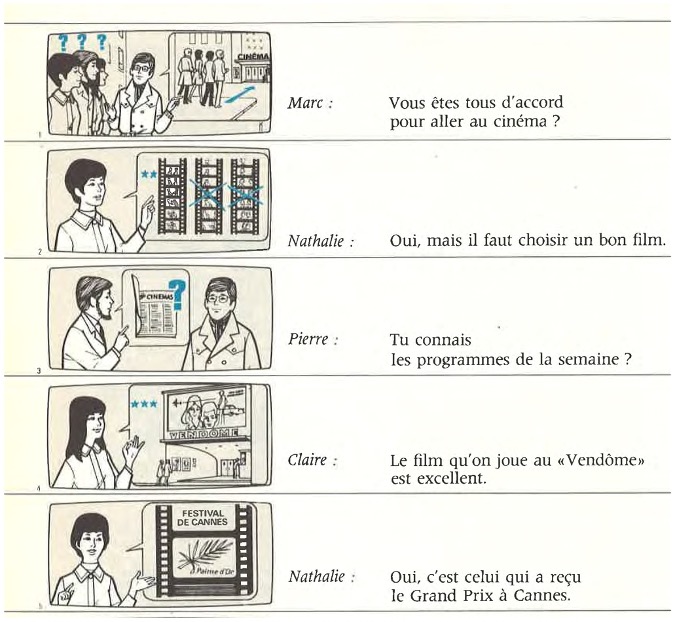
Figure 4 La France en direct (1971: 66).
L’image prend un rôle très important, elle est un objet de débats au sein de la communauté scientifique8 et se caractérise assez vite par des règles strictes:
- Une image pour chaque réplique du dialogue central de la leçon (en cas de passage monologué, les énoncés sont morcelés en petits groupes rythmiques).
- L’image doit apparaitre avant le son (le texte du dialogue n’étant pas visible au début).
- Les phylactères sont souvent représentés par des cercles ou des rectangles pouvant contenir des pictogrammes divers, de nouveaux dessins, des marques de ponctuation et du texte «dessiné».
Ainsi, on plaque une image codée sur un énoncé oral: cela fonctionne sur l’illusion qu’on peut transcoder la langue en segments imagés fixes. De fait, on peut douter que l’image favorise vraiment la compréhension. Cela convient plus ou moins bien pour le niveau débutant avec une langue simplifiée, artificielle et débarrassée des caractéristiques de l’oral authentique. Mais cette médiation crée des problèmes d’interprétation dès que l’énoncé est un peu plus complexe, comme dans l’image suivante.

Figure 5 La France en direct (1971: 66).
Dans le guide méthodologique du manuel, l’image fait l’objet de plusieurs commentaires significatifs: elle «doit communiquer tout le contenu de sens» (1971: 5). Pour ce faire, précisent les auteurs, elle doit obéir à certaines contraintes:
- - il faut privilégier l’image dessinée à la photo, car elle est «plus sélective, plus lisible et plus facile à structurer»;
- - la schématisation du dessin «ne doit cependant pas nuire à l’authenticité culturelle»;
- - la couleur doit remplir un «rôle fonctionnel et non décoratif».
(La France en direct, 1971: 5)
Parmi les conventions, on mentionne les «bulles», qui sont là, nous dit-on, «pour représenter la pensée». On peut trouver curieux d’associer les phylactères à la pensée et non à la langue, et du reste, bien que les images soient surcodées, les problèmes d’interprétation apparaissent inévitables. On constate les mêmes problèmes dans une autre méthode parue la même année, que l’on doit encore à Gaston Mauger. Issue du Mauger bleu (donc d’une méthode mixte, mais influencée cette fois par la méthodologie audiovisuelle), Le Français et la vie (1971) est un manuel utilisé à l’Alliance Française, et dans le passage qui nous intéresse, nous pouvons «lire» un dialogue «de 20 répliques, illustrées chacune par un dessin expressif et simple, où le personnage qui parle est cerné d’un trait gras» (1971: V). On peut apprécier diversement ces qualités dans l’illustration ci-dessous, où l’accès au sens est loin d’être immédiat (M. Roche: Tout cela est très intéressant).

Figure 6 Le Français et la vie (1971: 218)
On voit que ce type d’usage de la BD se heurte aussi à la difficulté de représenter le langage abstrait, même quand l’énoncé est simple du point de vue syntaxique. Le problème est omniprésent dans la méthode et repose sur une deuxième méprise: l’illustration est supposée faciliter l’accès au sens, qui deviendrait transparent et rapidement accessible. On voit dans l’exemple suivant l’impasse que peut représenter a posteriori cette codification iconographique du discours9.
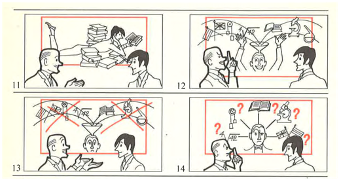
Figure 7 Le Français et la vie (1971: 220)
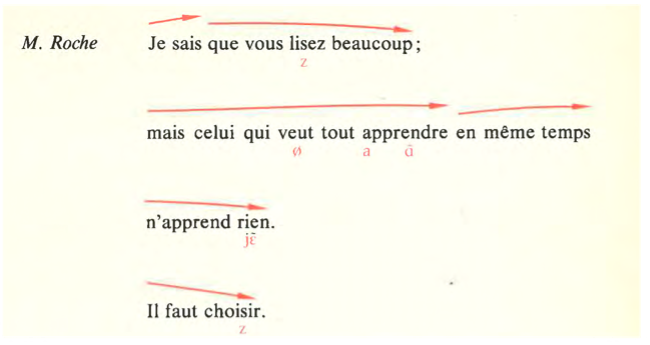
Figure 8 Le Français et la vie (1971: 221)
Au fil du temps, les méthodes audiovisuelles et audio-orales ont évolué dans leur manière de présenter les dialogues. Les BD se modifient progressivement et sont associées à plusieurs répliques, puis à la situation entière (une seule image par dialogue) et vers 1980, elles peuvent renvoyer à une multiplicité de dialogues et de situations, présentées dans chaque unité du manuel. On est là à une charnière importante en didactique du FLE, dont on peut donner deux exemples.
Dans la méthode audio-orale tardive Le Français par objectifs (1980)10, les bulles ont disparu et le texte du dialogue est présenté sous l’image, qui montre les locuteurs en interaction (ou bien représente le contenu illustré de leurs propos). On voit qu’une image peut concerner deux répliques et que la couleur est utilisée de manière réaliste. Surtout, cette méthode présente les premières BDA de notre corpus. C’est là sans doute l’influence de l’époque, qui voit la légitimité culturelle de la BD s’affirmer de plus en plus, en même temps que se renforce la mode des documents authentiques dans le champ de la didactique des langues étrangères. Mais les principes méthodologiques structuralistes de la méthodologie audio-orale restent les mêmes: les documents sont exploités comme supports à des fins linguistiques, notamment par des exercices structuraux. On y trouve par exemple une BD muette de Sempé, complète mais accompagnée d’un dialogue (fabriqué) racontant l’histoire représentée par le support, ainsi que d’un récit écrit, qui serviront de base à toute une série d’activités linguistiques.
Exemple de consignes: «Travaillez à deux. L’un pose les questions avec le livre ouvert et l’autre répond à l’aide des images. Ensuite, changez de rôle. Finalement, refaites l’exercice uniquement avec les images» (Le Français par objectifs, 1980: 174). Les questions à poser servent à vérifier la compréhension du récit fictif qui accompagne la BD. Puis on demande de faire l’exercice par écrit. Il s’agit d’un bon exemple de ce qui se faisait dans les méthodes structuralistes des années 1950-80: la BD est ici considérée comme une série d’images séparées venant illustrer un enregistrement audio et servant de base à l’enseignement, lequel repose sur une série de questions/réponses visant à vérifier la compréhension, sur une transformation syntaxique, sur des changements énonciatifs (de «je» à «il»), etc. La consigne, qui exige parfois de travailler «uniquement à l’aide des images», montre aussi le rôle de l’illustration comme soutien au travail en autonomie en sous-groupe et comme outil de mémorisation. En fin de compte, cette méthode audio-orale tardive pourrait être cataloguée comme une méthode mixte (audio-orale et communicative).
Le deuxième exemple de méthode «charnière» est représenté par Archipel (1982), qui est souvent considérée comme la dernière méthode audiovisuelle et la première méthode communicative pour le FLE. Sa première unité (niveau débutants) commence par une BD pour illustrer une partie d’un dialogue présenté plus tard dans l’unité. On voit dans l’illustration que le contexte a gagné en importance: l’attention est portée sur la situation socioculturelle, les détails sont travaillés, les personnages sont plus réalistes. Les bulles sont remplacées par un encadré présentant la réplique d’un personnage. La mise en page est aussi très différente des anciennes méthodes audiovisuelles, avec un grand phylactère de forme géométrique au milieu de la page, représentant une scène illustrée.
On remarque que le manuel porte une attention toute particulière à l’illustration et qu’il intègre de nombreux documents authentiques, en majorité écrits ou visuels. Dans Archipel 2, paru en 1983, apparaissent les premières BDA : au nombre de cinq, elles sont toutes complètes, non destinées aux enfants, produites par des auteurs célèbres (Bretécher, Sempé, Bosc, Reiser) et sont en majorité classées dans les suppléments aux leçons. L’aspect ludique et culturel est privilégié et aucun travail particulier n’est demandé aux apprenants. Sur cette marginalisation au début des années 1980, nous faisons l’hypothèse d’une influence des recherches en didactique des langues étrangères de l’époque (le Dictionnaire de didactique est publié en 1976), car nous avons vu qu’on y présentait l’exploitation de la BDA comme impossible. On verra en effet qu’elle sera réservée dans un premier temps aux suppléments culturels des manuels.
Pour tirer une synthèse de cette première partie, rappelons que le principe de la BD est de représenter par l’image une suite d’actions d’un même personnage. Les BD sont donc bien présentes dans les manuels, mais elles sont éloignées des productions authentiques. À l’origine de ces illustrations fabriquées pour l’enseignement de la langue étrangère, on trouve une nouvelle méthodologie, la Méthode Directe, qui confère à l’image une fonction illustrative, facilitant l’accès au sens, ainsi qu’une fonction performative, comme déclencheur d’actions langagières et support à la mémorisation. Avec l’arrivée du son, on trouve une nouvelle méthodologie, la méthode audiovisuelle, dotée d’une vision structuraliste du langage, qui a pour effet de découper la langue en petites unités visant à atteindre idéalement (mais, dans les faits, elle y parvient assez rarement) une correspondance univoque entre image, son et bulle. Il faut attendre les années 1980 et l’arrivée de l’approche communicative pour observer l’usage plus récurrent des BDA.
Depuis 1980: dessins fabriqués et authentiques
Approches communicatives
Avec l’émergence des méthodes relevant de l’approche communicative, on observe un engouement pour le document authentique, une ouverture aux genres les plus divers et aux supports multimodaux, qui s’accompagnent d’une mise en avant de la dimension socioculturelle des discours. Concernant la BD, on peut distinguer deux tendances dans cette nouvelle approche. D’un côté, on observe l’introduction timide de la BDA à des fins d’enseignement de la langue et de la culture. D’un autre côté, on constate l’introduction massive de séquences de BD fabriquées pour un usage didactique, à des fins d’enseignement de la langue: vocabulaire, registres de langue, grammaire de l’oral et de l’écrit, grammaire textuelle, actes de parole, production orale et écrite, et surtout, la BDF comme aide à la compréhension.
Dans cette partie, nous limiterons nos commentaires aux BD dites authentiques, tronquées ou non. Nous avons cherché à savoir quelles étaient les fonctions de la BDA dans les manuels post 1980, en nous appuyant sur les données de notre corpus et sur les recherches existantes. Or, à notre connaissance, il existe très peu de publications sur le sujet, à part quelques articles isolés. Le seul ouvrage théorique consacré à la BD dans la classe de FLE et destiné aux enseignants est un livre qui vise à exploiter le dessin de presse satirique. Ce manuel publié en 1987 et rédigé par Annette Runge et Jacqueline Sword est intéressant parce qu’il donne accès aux représentations de l’époque: on y trouve des conseils et des suggestions d’activités représentatives de l’approche communicative. Les autrices proposent ainsi quatre pistes d’utilisation du dessin humoristique (Runge & Sword, 1987: 5):
- - Montrer «simplement» des dessins qui ont un thème proche de celui de la leçon «dans un esprit de détente»: il s’agit là de la fonction «décorative» de la BD que nous avons retrouvée dans les méthodes 1980-90 analysées. Dans ce cas, une seule vignette peut suffir à illustrer le sujet traité, sans consignes.
- - Faire «ressortir les éléments de civilisation» et «analyser les clichés qui en découlent»: cette fonction de supplément culturel est aussi largement présente dans les manuels que nous avons observés, qu’ils relèvent de l’approche communicative ou actionnelle.
- - Faire décrire le «contenu» de la BD, c’est-à-dire produire du discours dans un but linguistique et non pas communicatif: les auteurs précisent que c’est une activité «très artificielle si tous les apprenants ont le dessin sous les yeux». Pourtant, cet usage de la BD est très souvent proposé dans les activités des manuels de notre corpus.
- - Supprimer la légende ou la bulle pour les «faire imaginer» par l’apprenant. À nos yeux, il s’agit là encore d’une réduction de l’exploitation de la BD à une fonction linguistique: le support authentique est modifié pour faire produire un certain type de discours, plus ou moins contraint selon les objectifs de la leçon.
Les autrices proposent un tableau instructif des différentes possibilités de didactisation. De toute évidence, il montre un parti pris d’instrumentalisation de la BD à des fins pédagogiques.
.png)
(Runge & Sword 1987: 9)
En parcourant de manière plus transversale notre corpus, nous sommes parvenue à dégager une typologie des usages de la BDA dans les méthodes communicatives en considérant en particulier le rôle décisif des consignes qui accompagnent les supports visuels, orientent la lecture du document et conditionnent l’activité de l’apprenant. Nous proposons de distinguer ces usages en les corrélant à quatre fonctions différenciées11.
A. Fonction illustrative (ou décorative): la visée est de comprendre;
B. Fonction performative à visée linguistique ou textuelle: la visée est de faire;
C. Fonction informative: le but est de s’informer, de s’acculturer;
D. Fonction créative: le but est d’imaginer et de produire.
A. La fonction illustrative était déjà à l’œuvre dans les manuels d’avant 1980 avec les BD fabriquées. Il s’agit aussi de favoriser l’accès au sens dans des conditions de détente. De la planche complète à la case unique, les BDA accompagnent par exemple le thème de la leçon. Dans la Grammaire des premiers temps 1 (1996; 2014), les autrices utilisent une planche de Reiser pour illustrer, sur un mode comique, la notion de pronoms possessifs. Aucun travail particulier n’est demandé à l’apprenant, il n’y a pas de consignes, la fonction décorative et illustrative est ainsi exploitée systématiquement à chaque début de leçon.
B. La fonction performative à visée linguistique est une des catégories les plus répandues. Il s’agit de faire produire des éléments de la langue. Le manuel L'Exercisier (1980: 154) propose par exemple un travail sur l’acte de parole «proposer12», à partir d’un extrait de deux cases de Pétillon. Les consignes orientent l’apprenant d’abord vers la lecture des bulles: «Observez les vignettes suivantes. De quelle façon les personnages expriment-ils leurs propositions?». Les bulles en question présentent deux réalisations différentes du même échange d’actes: proposer / répondre. Puis l’apprenant est prié de produire oralement des actes de proposition: «À votre tour, faites des suggestions.»
Par ailleurs, les manuels qui exploitent des BD muettes le font tous avec une visée linguistique. Sempé semble être le dessinateur le plus fréquemment mobilisé. On trouve par exemple, dans le manuel précité, une BDA associée à la consigne suivante: «Racontez cette bande dessinée en utilisant le maximum de verbes pronominaux.»
La fonction performative à visée textuelle permet de travailler sur les aspects discursifs des documents, par exemple quand il est demandé de reconstituer l’ordre original des vignettes. On le voit notamment dans le manuel Studio+ (2004: 52) avec des cases de Tintin que l’on demande de mettre dans l’ordre chronologique en justifiant son choix13.
C. Pour la fonction informative, les BDA dans les manuels s’orientent en majorité vers la constitution d’un apport socioculturel pour l’apprenant, qui témoigne du gain de légitimité de cette forme d’expression, en particulier dans le contexte de la langue-cible. Des éléments culturels associés à la BD franco-belge sont ainsi pris en compte dans certains manuels. Par exemple, dans le manuel Rond-Point 2, trois personnages de BDA, dont Gaston Lagaffe, font l’objet d’un éclairage dans le supplément culturel «Regards croisés», qui est présenté dans l’introduction du manuel comme le réservoir «des "échantillons" de culture» (2004: 74-75). Dans ce cas, c’est bien l’aspect socioculturel qui est mis en avant, sans qu’un travail à but linguistique ne soit demandé: la consigne est d’observer les personnages et de dire si on les reconnait (ce qui relève de la compétence socioculturelle).
D. On peut enfin exemplifier la fonction créative en citant le manuel À propos (2005: 133), qui présente une planche de Bretécher où des convives discutent à table. La consigne «Vous avez été acteur de cette scène, racontez» nécessite de la part de l’apprenant l’adoption d’un point de vue différent et nouveau sur la discussion des personnages, ainsi que la production d’un discours narratif; la BD est ici un support pour l’imagination et la recréation, ainsi qu’un moteur de créativité langagière: il faut être «acteur», c’est-à-dire être dans l’Agir14.
Parmi ces différents usages de la BD dans les manuels de FLE post 1980, en lien avec l’évolution des méthodologies d’enseignement, deux hypothèses peuvent être émises. Premièrement, la dimension textuelle spécifique à la BDA nous semble être importante et favorable à l’apprentissage «par les genres». Il s’agit de dégager les effets qui produisent du sens et suscitent des réactions chez les lecteurs (notamment par l’esthétique et la construction de la planche) et de s’interroger sur les différents niveaux de lecture du document. On peut poser, par exemple, la question du «pourquoi est-ce que c’est drôle?» ou interroger les blancs entre les cases, ces questions visant à amener l’apprenant à une observation attentive de la BD. Deuxièmement, ces différentes fonctions peuvent évidemment se combiner dans une approche plus ou moins intégrée, en tenant compte du genre discursif spécifique et de ses caractéristiques propres. Ainsi, la fonction créative, qui agit comme déclencheur de l’imagination, nous semble pouvoir être intégrée avec profit aux autres fonctions.
Afin de montrer plus précisément la manière dont la BDA est didactisée respectivement dans les méthodes communicatives, puis actionnelles, nous allons maintenant reprendre cette catégorisation des fonctions de la BDA pour décrire les manuels de notre corpus. Nous rappelons que l’emploi de ce médium reste rare, parfois absent dans les niveaux destinés aux débutants. Nous relèverons, parmi ses occurrences, les propositions pédagogiques qui nous semblent justifiées par la spécificité de ce genre de discours.
Les fonctions de la BD dans les méthodes communicatives:
- - Fonction illustrative: sur un plan quantitatif, les BDA sont rarement utilisées pour illustrer ou faire comprendre des éléments de la langue, cette place étant prioritairement occupée par les BDF, très nombreuses et quasi-systématiques dans certains manuels.
- - Fonction performative à but linguistique: elle est largement mise à l’œuvre dans les rares BDA des manuels et concerne la production de tous les aspects linguistiques de la communication, mais surtout la grammaire et les actes de parole (représentatifs de l’époque). La BDA est prétexte à la production orale ou écrite, les consignes impliquent de reformuler, raconter et imiter.
- - Fonction performative à but textuel: le souci de traiter la BDA par le genre (discursif) apparait dans les années 1990 dans notre corpus, ce qui coïncide avec l’arrivée de la grammaire textuelle dans l’enseignement du FLE, sous l’influence des recherches sur l’enseignement de la langue maternelle. D’autre part, et sous l’influence également des recherches en didactique du FLM, on assiste dans les années 1970-80 à la naissance de nouveaux modèles en lecture (modèle bottom-up, lecture globale, etc.) avec notamment, en FLE, la lecture «interactive» (voir Cicurel 1991). Dans ce dernier contexte, on considère que le sens se construit dans l’interaction entre le texte et le lecteur, ce qui nous semble d’autant plus vrai pour la BD.
- - Fonction informative: la majorité des BDA rencontrées dans les manuels communicatifs est réservée aux suppléments culturels, en lien avec d’autres documents visuels authentiques.
- - Fonction créative: les BD muettes sont mises à contribution pour stimuler l’imagination et les BD «parlantes» sont souvent transformées (suppression du texte des phylactères, des récitatifs, suppression de vignettes, etc.).
On retrouve dans les BDA des manuels communicatifs les principales pistes de didactisation présentées par Runge & Sword à la même époque. Les activités recensées présentent des points communs et la BDA est non seulement exploitée dans un but linguistique et pragmatique, mais aussi, avec le développement de l’usage des documents authentiques, dans une visée socioculturelle. Il s’agit d’apporter des contenus multimodaux, de travailler sur la lecture d’images dans ses relations avec l’oral et/ou l’écrit.
Méthodes actionnelles
Malgré la profusion de documents authentiques, force est de constater que peu de manuels de FLE s’inscrivant dans le paradigme des approches actionnelles intègrent des activités autour de la BDA. La place du dessin a globalement diminué, pour laisser plus de place aux photos et aux textes, authentiques ou non, et les planches complètes sont rares. Malgré tout, il semble qu’on se dirige vers une légitimation de la BDA dans les manuels. Nous allons en montrer quelques exemples.
Tout d’abord, la BD semble à présent faire partie de la culture officielle. Dans les suppléments culturels ou les espaces «à lire et à découvrir», par exemple, les BDA sont traitées au même titre que les autres genres de documents authentiques. Il s’agit de donner «des informations qui vont vous permettre de mieux connaitre et comprendre les valeurs culturelles» (Rond Point 2, 2004: 5). La BD est ainsi explicitement revendiquée comme une valeur.
Dans le même ordre d’idées, la BD peut, de nos jours, être le sujet d’un article critique ou faire l’objet d’un débat. Dans Défi 4 (2020: 26), par exemple, l’une des deux activités recensées est une lecture présentant deux vignettes tirées d’une BDA ainsi que la photo de la couverture de l’album Mars horizon, comportant une référence bibliographique. Ces documents sont accompagnés d’un texte écrit (argumentatif), qui consiste en une critique positive de l’album en question. Deux consignes sont proposées avant de lire le texte. Elles doivent déclencher un échange sur les genres (mangas et BD d’aventures sont donnés en exemple): «Aimez-vous la bande dessinée? Si oui, quel genre de bande dessinée lisez-vous?», «Observez la couverture et la planche de bande dessinée. De quoi parle la BD?». On remarque aussi un petit encadré qui a pour effet de légitimer la BD comme valeur culturelle et fait de société: «Depuis 1974, le plus grand festival international de la bande dessinée d’Europe a lieu chaque année à Angoulême. Dans les rues, on voit des vignettes de bandes dessinées sur les murs.»
La BD peut aussi être comparée aux autres genres discursifs. Le manuel Tempo 2 (1997: 124) met côte à côte un extrait tiré d’un texte de Beaumarchais et une BD signée portant sur le même thème, la rumeur. La consigne demande à l’apprenant d’établir une comparaison entre les deux genres. Dans le texte littéraire, le cheminement de la rumeur est signifié par une succession de verbes juxtaposés («s’élance, étend son envol, tourbillonne, enveloppe, arrache», etc.), alors que dans la BD, le dessinateur J.-M. Renard représente graphiquement la rumeur dans la succession des cases par l’augmentation du volume des bulles, par la modification du lettrage, l’allongement des syllabes, etc. La consigne renvoie explicitement au médium graphique, en contraste avec le médium littéraire: «Regardez la bande dessinée et dites si elle illustre ou non le texte.» Elle induit un travail en profondeur sur les caractéristiques spécifiques du médium BD15.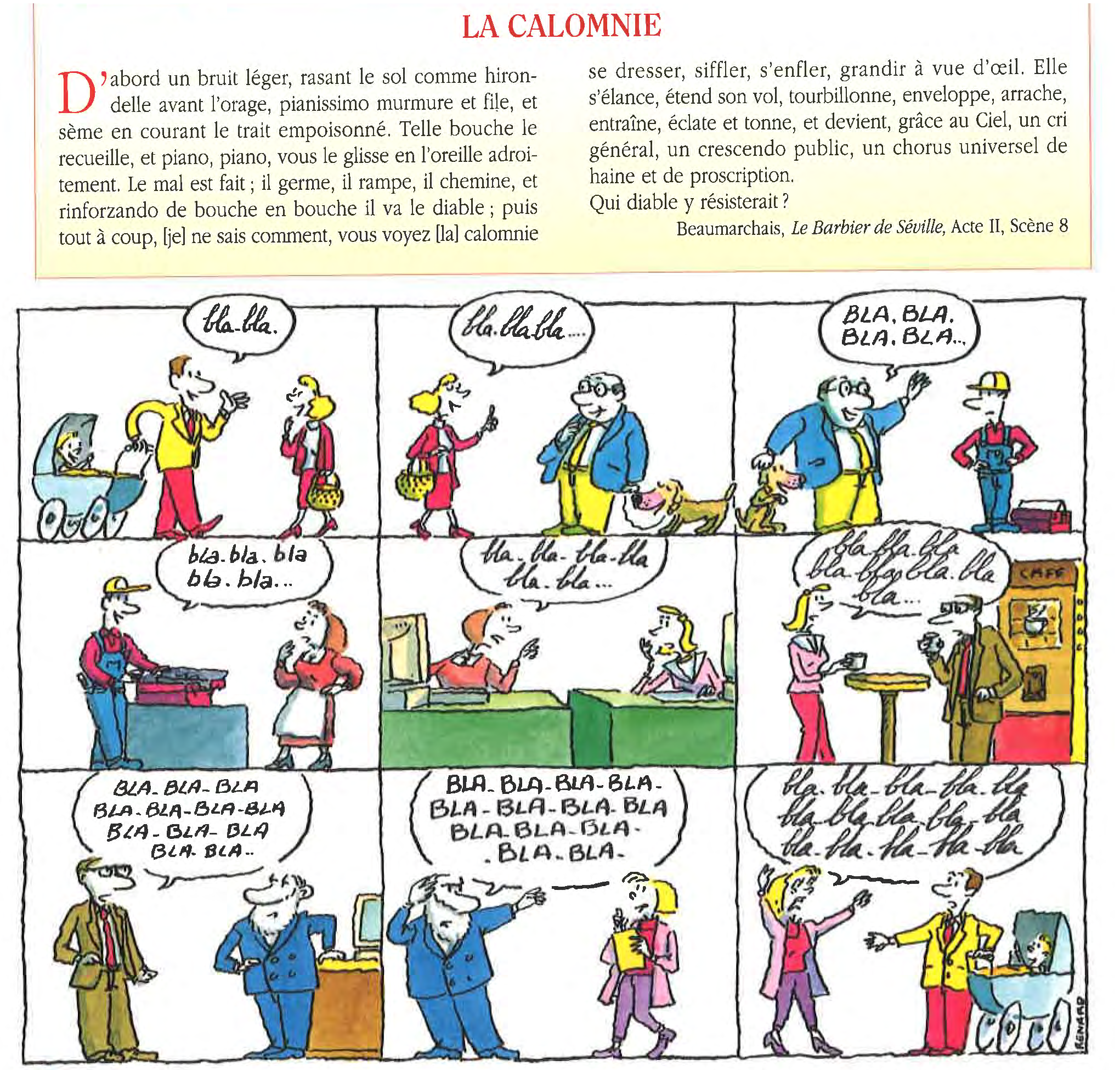
Figure 9 Tempo 2 (1997: 124)
La BD peut même être intégrée à d’autres genres, ce qui constitue un signe supplémentaire de légitimation. On le voit clairement dans une activité du manuel Alter ego 4 (2007: 110), qui intègre un extrait de trois vignettes d’une planche de Bretécher, à l’intérieur d’une séquence visant la production d’une synthèse à partir de cette BD et de deux autres documents écrits. Il est intéressant de noter que dans cette activité de synthèse, le document BD semble présenter la même légitimité que les deux autres, qui sont référencés et datés de la même manière. Le support de la BD est thématisé comme tel dans un tableau à remplir, ce qui le met sur un pied d’égalité avec des articles de la presse écrite. Ainsi, même si le manuel n’exploite pas beaucoup le médium, il participe à sa légitimation progressive dans un travail d’apprentissage du FLE dit «sérieux».
Enfin, on voit apparaitre des BD fabriquées et généralement anonymes, mais qui deviennent pratiquement indifférenciables des BDA. On peut lire paradoxalement, dans l’apparition de ces BD produites à des fins d’enseignement, un signe de légitimation du médium, car les planches se réfèrent ostensiblement aux codes visuels de la BD «du commerce». On remarque d’ailleurs l’usage explicite du mot «bande dessinée» dans les consignes, comme dans le manuel Activités pour le cadre commun B1 (2006: 32): «Observez la bande dessinée. Racontez ce qui s’est passé. Imaginez ce qui a pu se passer ensuite.» Suivent des détails sur la manière de construire son récit, que nous reproduisons ici parce qu’ils sont représentatifs d’un travail sur BD souvent demandé aux apprenants: raconter une BD muette (dans sa forme originale ou bien présentée dans une version où le texte des phylactères a été masqué).
Vous pouvez:
- - situer l’évènement: quand, où, dans quelles circonstances s’est-il produit?
- - décrire le personnage principal,
- - dire comment il vous apparait: inquiet, irréfléchi, courageux …
- - décrire les différentes actions et les réactions –surprenantes, inattendues, exagérées, ou naturelles– qu’elles ont provoquées,
- - imaginer une fin … heureuse?
(Activités pour le cadre commun B1, 2006: 32)
Le but est clairement linguistique, puisqu’il s’agit, comme bien souvent, de faire produire un discours narratif au passé ou au présent. Néanmoins, le médium est maintenant reconnu comme un genre spécifique de document écrit, digne d’intérêt et d’apprentissage, bien que dans ces manuels, les activités ayant comme support des BDA non modifiées restent rares, même aux niveaux avancés. Par ailleurs, nous n’avons observé que deux activités visant à familiariser l’apprenant avec la terminologie spécifique au genre, notamment dans Défi 4 (2020: 97), avec un exercice de vocabulaire («s’approprier les mots»), où la consigne demande de légender une planche de BDF avec les étiquettes appropriées («bulle», «case», etc.). L’objectif est de fournir des outils de base pour travailler avec la BD, ce qui parait essentiel. Pourtant, cette terminologie semble aller de soi dans les autres manuels, où elle n’est jamais explicitée.
En reprenant notre proposition de typologie, voici à présent les résultats pour les méthodes actionnelles de notre corpus.
- - Fonction illustrative: cette fonction semble avoir diminué dans les manuels actionnels et ce sont davantage les photos qui remplissent le rôle d’accès au sens.
- - Fonction performative à but linguistique: cette fonction est toujours majoritaire. Comme on vient de le voir, des BDF imitant les codes des BDA sont apparues à des fins de production de discours, notamment de genre narratif. Tout dépend alors de la qualité de l’imitation: on observe ainsi parfois des activités où la médiocrité du support fait obstacle à son exploitation sur le plan graphique et visuel. Dans le manuel Version originale 3 (2011: 93). par exemple, on trouve une seule apparition explicite d’une «BD» (non signée), manifestement fabriquée pour travailler sur le discours rapporté. Ici, le support BD n’apporte rien, avec peu d’indices contextuels, très peu d’expressivité, un lettrage qui relève des normes de l’écrit imprimé, sur lequel le lecteur se focalise. Cette BD sert seulement à faire produire une narration orientée vers un but grammatical.
- - Fonction performative à but textuel: on voit rarement (moins d’une dizaine d’occurrences dans le corpus de manuels relevant de l’approche actionnelle) l’apparition d’activités prenant en compte les spécificités du langage de la BD. Le manuel Connexions 3 (2005) par exemple, offre quatre ou cinq exploitations de BDA. L’approche est intégrée: les spécificités du médium sont prises en compte (en tant qu’objet discursif, mais aussi linguistique et socioculturel), c’est le cas par exemple, dans une double page autour d’une planche de Cabu, dans la partie Arrêt sur Image (2005: 50-51). L’activité proposée consiste en une série de questions portant sur le support, et elle intègre un travail sur la lecture d’images: lien entre texte et dessins, informations apportées par le dessin, repérages lexicaux dans les bulles, introduction du lexème beauf avec recours au dictionnaire, inférences culturelles, etc. On trouve par exemple les questions suivantes: «Où se trouve le personnage dans chaque image? Quelles sont les informations qui permettent de le savoir?»; «Quelle est l’importance du texte par rapport aux images?»; «Peut-on regarder les images et comprendre l’histoire sans lire le texte? Peut-on lire et comprendre le texte sans regarder les images?»
- - Fonction informative: la BD devient un objet culturel plus légitime, mais il est encore souvent réservé aux suppléments civilisationnels des manuels. Certaines activités prennent pour thème la BD et ses différents genres, mais on se retrouve devant un paradoxe: le médium BD est maintenant reconnu comme un genre spécifique de document écrit, digne d’intérêt et d’apprentissage, mais il est peu utilisé comme outil d’enseignement. Notons que dans le manuel Alter ego 3 (2009), où l’on trouve très peu de dessins et pas de BDA, le genre n’a pas d’entrée dans «l ’abécédaire culturel» du manuel, qui traite néanmoins, à travers l’entrée «caricaturistes», du dessin de presse.
- - Fonction créative: quelques innovations pédagogiques dans les manuels actionnels nous semblent des pistes intéressantes à creuser. Ce sont généralement des activités qui combinent plusieurs des fonctions que nous avons définies dans une approche intégrée. Nous allons terminer notre réflexion sur des exemples relevant de cette optique.
Pistes pour une approche intégrée exploitant la fonction créative de la BD
Créativité lexicale
Les onomatopées peuvent servir de prétexte à l’invention de nouveaux mots, mêlant ainsi la fonction performative à but linguistique et la fonction créative de la BD, comme dans cette activité de vocabulaire du manuel À propos (2005: 79), où l’on présente des vignettes isolées (sans doute fabriquées, comportant toutes des onomatopées en gros plan) regroupées sous un thème commun: on a choisi de présenter non pas une BDA, mais un des traits caractéristiques de la BD (les onomatopées), comme déclencheur d’imagination et de créativité langagière. La consigne précise: «Choisissez une onomatopée, rajoutez un suffixe (Exemple: Tic Tac + eur = tictacteur / Tic Tac + logue = tictacologue») et ajoute: «Il ne vous reste plus qu’à définir cette nouvelle fonction!» On se sert ici d’une caractéristique importante de la BD – les onomatopées – pour inventer des mots et des définitions de ces mots; la BD combine dans ce cas toutes les fonctions, illustrative, performative, informative et créative.
Créativité narrative
Comme on l’a vu, les BDF qui imitent les codes des BDA visent des buts linguistiques et communicationnels, souvent liés à l’activité de «raconter». Dans Latitudes 3 (2010: 12-13), la seule occurrence d’une planche de BD présente une histoire fabriquée mais complète. Elle se rattache au genre de l’enquête policière, l’aspect graphique est soigné, l’ambiance imite un peu le style d’Hergé. L’aspect novateur dans cet exemple se trouve dans la tâche demandée: il s’agit de compléter le carnet du policier (le support inclut le dessin d’un carnet sur lequel on doit indiquer les détails de l’enquête) à partir de la lecture de la BD (travail de repérage et de synthèse des informations importantes pour l’enquête), puis de comparer ses notes avec un autre apprenant et de trouver qui est le voleur. On voit que la lecture d’images est surtout orientée vers la compréhension des phylactères et néglige, au moins au niveau des consignes explicites, les aspects graphiques (liens entre les images, cadrage, dessin, couleurs, etc.), mais cet exemple montre qu’il est possible d’imaginer, dans l’exploitation d’une BD en classe, des tâches interactionnelles de recherche et de partage d’informations, de comparaison et de synthèse, mettant en évidence une fonction créative que l’on peut associer à ce type de document.
Créativité graphique
La méthode actionnelle la plus récente du corpus Défi 4 (2020) présente une approche intégrée dans un dossier À découvrir sur la langue française (2020: 100). Les vignettes ont été séparées puis réalignées en surimpression, mais elles semblent figurer une séquence complète et la source est référencée. Les cases ont la particularité d’être dépourvues de décor (fond blanc) et de laisser une grande place au texte. La lecture du document «Des difficultés d’apprendre le français» est préparée par des «échanges» sur le thème, qui visent à faire émerger des idées qu’il s’agit de «retrouver» dans la BD; il s’agit d’abord de repérer des éléments de contenus. Suivent des questions de compréhension classiques sur le titre, le repérage des étapes, le lexique et son aspect culturel. Mais d’autres consignes présentent à nouveau des aspects spécifiques à la bd. La question 7, par exemple, renvoie au personnage dessiné de la dernière case avec ses spécificités graphiques: «est-ce que vous vous identifiez au personnage?».
La question suivante consiste en une tâche en binôme d’un genre nouveau: après un échange sur les difficultés de leur propre langue, les apprenants sont invités à «faire un dessin pour en illustrer une». On voit ainsi que, dans l’optique actionnelle, les tâches peuvent même aller jusqu’à adopter le code de la BD, non pas pour imiter ce dernier, mais pour exprimer une idée dans un nouveau cadre formel déjà établi. La proposition est courageuse quand on pense aux probables réticences des enseignants et des apprenants devant ce changement d’habitude. Mais n’est-ce pas là une manière d’aller jusqu’au bout de la logique praxéologique de la théorie actionnelle?
Créativité métacognitive
Pour terminer, nous souhaitons mentionner ici les manuels de Cartes sur Table qui occupent une place à part dans les méthodes de FLE. Publiés à la charnière des années 1980, ils relèvent bien de l’approche communicative et sont particulièrement centrés sur l’autonomie de l’apprenant. À plusieurs reprises, les auteurs ont fait appel à l’illustrateur Plantu, devenu célèbre en France en tant que dessinateur du journal Le Monde, où il a officié pendant 50 ans. L’objectif était de conscientiser des stratégies d’apprentissage sur la base d’une réflexion métacognitive autour des dessins.
Dans le manuel 2 pour les débutants, une première planche montre un personnage qui écoute un bulletin d’information météo à la radio sans rien comprendre; il fait des efforts, puis s’énerve, pour finalement saisir un mot-clé (pluie); tout content, il sort en prenant son parapluie. Cette activité sert aux apprenants d’un niveau encore faible à mieux comprendre comment écouter du discours, en portant l’attention sur ce qui est connu plutôt que sur ce qui est inconnu, etc. Les marques graphiques qui signalent l’affectivité sont mises en avant et l’écriture manuscrite dans les phylactères représente le discours de la radio du point de vue de l’apprenant: gribouillis, mots-clé, etc.

Figure 10: Cartes sur table 2 (1983: 36)
Le caractère authentique du document, ajouté au talent de Plantu, donne tout son intérêt à cette activité de réflexion sur les stratégies d’apprentissage, caractéristique de cette méthode plutôt avant-gardiste.
Dans le manuel niveau 2, un autre exemple nous semble encore plus significatif car il utilise aussi l’humour. La planche, qui comprend seulement deux vignettes occupant une page entière du manuel, est accompagnée de la seule consigne: «Regardez.» On peut imaginer une activité de lecture d’images mise en commun et un débat sur le texte et son statut, le changement de destinataire, la tyrannie de l’école, etc. Là encore, les qualités iconographiques du support favorisent un engagement de l’apprenant dans la tâche. Le changement de statut du texte est signifié par le changement de support (d’abord le poème rédigé sur un parchemin, ensuite il est inscrit dans une bulle) et le changement de lettrage, particulièrement expressif dans le phylactère.
Page suivante, une seconde consigne oriente la lecture sur un plan plus personnel: «Et vous? Pour apprendre le français, recherchez ensemble des genres de texte que vous pouvez utiliser "autrement" que dans l’idée de l’auteur.» Cette consigne est suivie d’un tableau à remplir en trois colonnes: «genre de texte» / «texte écrit pour…» / «texte lu pour…» avec un exemple manuscrit qui invite l’apprenant à s’engager personnellement.

Figure 11: Cartes sur table 2 (1983: 60)
L’activité prévue consiste ensuite à réfléchir sur les genres de textes, définis par leur but, mais aussi sur les stratégies d’apprentissage à adopter, à travers une mise en abyme où la situation d’apprentissage est thématisée: les textes sont instrumentalisés dans le but d’apprendre, comme la BD en classe de langue et comme celle de Plantu dans cette méthode particulière.
Avec cet exemple, on constate l’intérêt de recourir à une BD comme facteur de motivation et comme vecteur d’apprentissage langagier. Les personnages, le décor et tous les signes iconographiques contribuent à mettre en scène de manière très efficace les paramètres de la situation de production d’un discours, l’un écrit et l’autre oral, qui conditionnent sa réalisation aussi bien que sa réception.
A y regarder de plus près, on constate que les auteurs de ce manuel attachent beaucoup d’importance à l’illustration et utilisent une dizaine de dessinateurs différents (Plantu est le seul qui soit connu comme dessinateur de presse). Les BD relèvent-elles encore de la distinction entre document authentique et document fabriqué? En fait, la frontière entre BDA et BDF se neutralise. Déjà, Coste en 1970 relativisait la distinction:
«Authentique» – comme «libre» – entre dans la série de ces adjectifs valorisants, trop connotés pour être honnêtes, et parait opposer la pureté native du texte à l’obscure perversion de tout ce qui n’est pas lui. (Coste 1970: 88)
L’exemple de collaboration entre les auteurs de Cartes sur table et le dessinateur Plantu témoigne d’une réflexion approfondie sur ce qu’est l’apprentissage d’une langue dite étrangère. Pour avoir une chance d’intégrer efficacement la BD comme support d’enseignement, les collaborations de ce genre devraient être multipliées. A ce titre, le manuel Bulles de France occupe un espace à part dans notre corpus. En effet, c’est le seul ouvrage entièrement consacré à la BD, avec une orientation socioculturelle revendiquée, la méthode étant sous-titrée «Les stéréotypes et l’interculturel en BD». On y précise en quatrième de couverture que le dessinateur est l’auteur de plusieurs bandes dessinées. Les planches, rangées par thèmes, sont complètes et toutes du même format (une page), donnant lieu à des activités prévues pour les niveaux A1 à C2.
Dans l’introduction, les auteurs commencent par inventorier les différents avantages de la BD pour l’apprentissage des langues, en reprenant l’argument de la facilité de la compréhension: «Grâce à l’image, il [l’apprenant] peut construire sa compréhension par des hypothèses, en dépit des limites de son niveau linguistique.» Mais il est précisé aussi, en caractères gras, signe du débat toujours en cours, que les « planches proposées sont absolument inédites et authentiques », et qu’il «ne s’agit en aucun cas de textes et d’histoires fabriquées à des fins pédagogiques». L’insistance des auteurs à nier le caractère fabriqué des BD renvoie à la citation de Coste: le document fabriqué est utilisé comme repoussoir dans le méta-discours de promotion du manuel.
Force est de constater malgré tout que les planches manquent de variété, même s’il est vrai qu’on peut identifier un style, renvoyant à une forme d’auctorialité. Mais on s’aperçoit vite, à la lecture du manuel, que les aspects iconographiques sont assez peu mis en avant. Dans un premier temps, on demande d’observer rapidement la planche sans lire le texte, ou de lire le titre. Suivent les habituelles questions de compréhension, basées sur les parties écrites et les indices visuels. Une troisième partie «Imaginer / s’exprimer» peut porter sur le thème de l’unité, sur un point spécifique de vocabulaire ou sur la lecture d’une case particulière. Mais d’une manière générale, les consignes orientées vers les aspects iconographiques ou visuels sont minoritaires. Une partie «pour aller plus loin» apporte des informations socioculturelles (sur la société française uniquement) et un encadré lexical termine chaque unité. De fait, la lecture d’images est exploitée plus régulièrement (par exemple observer le geste d’un personnage ou son expression faciale) que dans les autres manuels du corpus. Mais dans un ouvrage dont le support est intégralement lié à la BD, peut-on se contenter de ce maigre rendement? Le manque de réflexion théorique sur la pédagogie de la BD en FLE se fait sentir dans cette tentative d’en faire un support de base de l’enseignement. Pourtant, le principe est exemplaire et mérite d’être approfondi. Des bandes dessinées des méthodes audiovisuelles aux Bulles de France, on mesure le chemin parcouru, même si beaucoup reste à faire.
Conclusion
Premier enseignement de notre recherche, à l’échelle de chacun des ouvrages que nous avons consultés, l’emploi de la BDA est rare, sinon rarissime: généralement une ou deux occurrences, jusqu’à cinq ou six dans certains manuels, sur des centaines d’activités proposées. Souvent tronquées ou modifiées, les planches présentées sont décontextualisées, les aspects graphiques sont négligés au profit d’un intérêt quasi exclusif pour le contenu des phylactères. Mais il arrive aussi que la BD soit présentée comme un objet culturel à part entière et elle est alors généralement rangée dans les suppléments culturels. On peut percevoir néanmoins des changements dans les usages pédagogiques de la BD, notamment dans les consignes et les tâches à effectuer, plusieurs innovations pédagogiques se dégageant au fil du temps et de l’évolution des méthodes. Il semble également clair que les représentations sur la légitimité culturelle de la BD, dans un contexte d’apprentissage scolaire ou universitaire, ont changé et continuent à se modifier: elle peut être non seulement un support à des activités linguistiques ou communicatives, mais elle peut aussi être étudiée (trop rarement) en tant qu’objet culturel ayant ses spécificités sémiotiques et discursives.
Dans le champ du FLE, on a assisté au cours du siècle dernier à une lente évolution qui conduit d’un usage presque exclusif de la BD fabriquée à la lente reconquête de la BD dite authentique. Autrefois utilisée pour l’accès au sens, la construction de schémas syntaxiques et la mémorisation, la BDF sert aujourd’hui surtout à illustrer les manuels. Depuis les années 1980, on utilise la BD issue de la presse satirique comme support à des fins d’apprentissage de la compétence de communication. Elle sert à faire comprendre, à faire produire ou à faire imaginer, en plus de son rôle d’apport civilisationnel. Elle progresse depuis lors avec une légitimation croissante, jusqu’à devenir le support exclusif d’un manuel complet en 2015.
Dans les vingt dernières années, on a vu apparaitre des activités prenant en compte les spécificités du genre, parallèlement au développement des recherches en linguistique textuelle et des approches didactiques par les genres. Il faudrait interroger ce phénomène en lien avec ce qui se passe en FLM dans la période récente16. Maintenant que la BD a gagné sa place dans l’enseignement de la langue / culture, des besoins énormes se font sentir en termes d’appareillage didactique pour l’exploitation en classe et en termes de formation des enseignants.
Nous avons vu que la présence de la BDA reste faible, que ce soit en ce qui concerne son importance socioculturelle dans le cadre de l’enseignement du français ou en tant qu’objet de discours spécifique. Dans le Cadre européen commun de référence (CECR), qui sert de guide à l’élaboration des manuels postérieurs à 2000, aucune mention n’est faite de la BD. Sophie Béguin (ce numéro) fait l’hypothèse que l’importance spécifique de ce médium dans la culture francophone a fait les frais de la normalisation européenne du CECR. De fait, à notre connaissance, dans les portfolios pour adultes, aucun descripteur ne renvoie au genre BD, qui n’est pas considéré comme essentiel à la compétence de communication.
Revenons-en à la sentence publiée dans le Dictionnaire de didactique des langues étrangères que nous avions évoquée dans notre introduction: l’exploitation de la BD «du commerce» serait «pratiquement impossible». Cette affirmation articulée en 1976 semble prophétiser la rareté des BD dans les manuels de FLE d’aujourd’hui. L’adverbe «pratiquement» pourrait renvoyer à deux significations: presque impossible ou concrètement (logistiquement) impossible. Il est vrai que des difficultés concrètes existent et s’avèrent fondamentales pour exploiter la BD en classe de langue. Il faut trouver des documents qui soient adaptés à l’objectif de la leçon et au niveau de langue des apprenants, accessibles à la compréhension et ne présentant pas trop d’implicites culturels. Il convient aussi de dénicher des planches courtes publiables dans un espace restreint. Il est enfin nécessaire de régler la question des droits d’auteur, de négocier des autorisations, ce point étant particulièrement épineux pour un médium relativement récent, dont les œuvres ne sont donc pas tombées dans le domaine public, et qui ne connaît pas le droit automatique de citation17. Par ailleurs, on se rend compte que beaucoup de supports tirés de BDA doivent être écartés car ils ne présentent pas le fameux aspect facilitateur ou motivationnel véhiculé par les représentations communes sur la BD.
Tous ces éléments peuvent expliquer la faible présence de la BDA dans les manuels. Et même lorsque ce médium se trouve au fondement de l’enseignement, comme dans Bulles de France, il lui manque souvent un arrière-plan didactique solide qui pourrait permettre de voir émerger des manières de travailler innovantes, relevant d’une pédagogie spécifique au genre. De ce point de vue, la didactique du FLE aurait tout à gagner à collaborer avec les chercheurs en FLM, à intégrer les avancées en didactique de la lecture et en didactique de la bande dessinée, avec une réflexion théorique approfondie sur le genre BD et son fonctionnement.
Bibliographie
Bannier, Augustin (2014), La bande dessinée en classe de FLE, Master 2, Université d’Angers.
Berthou, Benoît (2017), «Une nouvelle légitimité culturelle. Le cas de la bande dessinée», in Le Statut culturel de la bande dessinée, A. Maaheen, S. Delneste & J.-L. Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 221-232.
Blanchard, Marianne & Hélène Raux (dir.) (2019), «Usages didactiques de la bande dessinée», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 18 septembre 2020.URL: http://journals.openedition.org/trema/4803 DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4803
Butzbach-Rivera, Michèle, Henri Boyer & Michèle Pendanx (1990), Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Paris, CLE International.
Cicurel, Francine (1991), Lectures interactives en langues étrangères, Paris, Hachette.
Coste, Daniel (1970), «Textes et documents authentiques au niveau 2», Le Français dans le monde, n° 73, p. 88-95.
Cuq, Jean-Pierre (dir.) (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International.
Cuq, Jean-Pierre & Isabelle Gruca (2009), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
De Man-De Vriendt, Marie-Jeanne (dir.) (2000), Apprentissage d'une langue étrangère /seconde, Vol. 1. Parcours et procédures de construction du sens, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Galisson, Robert & Daniel Coste (dir.) (1976), Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette, Collection F.
Gilmore, Alex (2007), «Authentic materials and authenticity in foreign language learning», Language teaching, n° 40 (2), p. 97-118.
Germain, Claude (1993), Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire, Paris, CLE International.
Giroud, Anick & Christian Surcouf (2016), «De "Pierre, combien de membres avez-vous?" à "Nous nous appelons Marc et Christian": réflexions autour de l’authenticité dans les documents oraux des manuels de FLE pour débutants», SHS Web of Conferences, n° 27. En ligne, consulté le 24 mai 2021. URL : https://serval.unil.ch/fr/notice/serval:BIB_3E3D334CF7EC
Puren, Christian (1988), Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Paris, CLE International.
Polo, Claire & Nicolas Rouvière (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 14 mai 2021. URL: http://journals.openedition.org/trema/5003, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.5003
Rouvière, Nicolas (2012), «L’étude de la bande dessinée en cours de langue et civilisation», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 281-286.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, Ellug.
Runge, Annette & Jacqueline Sword (1987), La BD, Paris, CLE International, Collection Techniques de classe.
Tabuce, Bernard (2012), «Une urgence iconologique qui dure: l’enseignement de la BD dans les manuels de collège», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug.
Corpus (ordre chronologique)
- Le français pour tous (1919): Dubrule, N. & Pierce, W.H., Boston, Ginn and Company.
- Cours d’allemand. Grands commençants (1923): Meneau, F. & Chabas, P., Paris, Didier.
- Cours de langue et de civilisation françaises I (1953, 1967): Mauger, G., Paris, Hachette.
- La France en direct (1971): Capelle, J. & G., Paris, Hachette.
- Le français et la vie (1971): Mauger, G. & Bruézière, M., Paris, Hachette.
- Le français par objectifs 7-9 (1980): Renié J.-C., Genève, CEEL.
- Archipel 1 (1982): Courtillon, J. & Raillard, S., Paris, Didier.
- Archipel 2 (1983): Courtillon, J. & Raillard, S., Paris, Didier.
- Cartes sur table 1 (1981): Richterich, R. & Suter, B., Paris, Hachette.
- Cartes sur table 2 (1983): Richterich, R. & Suter, B., Paris, Hachette.
- L’Exercisier (1993): Descotes-Genon, C., Morsel, M.-H. & Richou, C., Presses universitaires de Grenoble.
- Tempo 2 (1997): Bérard, E., Canier, Y. & Lavenne, C., Paris, Didier.
- Café-crème 1 (1997): Kaneman-Pougatch, M., Trevisi. S., Beacco di Giora, M. & Jennepin, D., Paris, Hachette Français langue étrangère.
- Rond-Point 1 (2004): Labascoule, J. , Lause, C. & Royer, C., Barcelone, Difusion Français langue étrangère.
- Rond-Point 2 (2004): Flumian, C., Labascoule, J. & Royer, C., Barcelone, Difusion Français langue étrangère.
- Studio + (2004):Bérard, É., Breton, G., Canier, Y & Tagliante, C., Paris, Didier.
- Connexions 1 (2004): Mérieux, R. & Loiseau, Y., Paris. Didier.
- Connexions 3 (2005): Mérieux, J., Loiseau, Y. & Bouvier, B., Paris, Didier.
- Compréhension orale 2 (2005): Barféty, M. & Beaujouin, P., Paris, CLE International.
- À propos B1-B2 (2005): Andant, C. & Chalaron, M.-L., Presses universitaires de Grenoble.
- Alter ego 3 (2006): Dollez, C. & Pons, S., Paris, Hachette.
- Activités pour le cadre européen commun de référence B1 (2006): Parizet, M.-L., Grandet, É. & Corsain, M., Paris, CLE International.
- Alter ego 4 (2007): Dollez, C. & Pons, S., Paris, Hachette.
- Latitudes 3 (2010): Loiseau, Y., Cocton, M.-N., Landier, M. & Dinthilac, A., Paris, Didier.
- Écho B1 (vol.1) (2010): Girardet, J. & Pêcheur, J., Paris, CLE International.
- Écho B1 (vol.2) (2010): Girardet, J. & Pêcheur, J., Paris, CLE International.
- Version originale 3 (2011): Denyer, M., Ollivier, C. & Perrichon, É., Paris, Éditions Maison des langues.
- Alter Ego+ B1 (2013): Dollez, C. & Pons, S., Paris, Hachette Français langue étrangère.
- Zénith 3 (2013): Barthélémy, F., Sousa, S. & Spreriando, C., Paris, CLE international.
- La grammaire des premiers temps (2014): Abry, D. & Chalaron, M.-L., Presses universitaires de Grenoble.
- Bulles de France (2015): Jeffroy, G. & Unter, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
- Défi 3 (2019): Biras, P., Chevrier, A. & Witta, S., Éditions Maison des langues.
- Défi 4 (2020): Biras, P., Chevrier, A., Jade, C. & Witta, S., Éditions Maison des langues.
Pour citer l'article
Anick Giroud, "La bande dessinée dans les manuels de FLE (1919-2020)", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-dans-les-manuels-de-fle-1919-2020
Voir également :
La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser
Parmi les recherches en didactique de la littérature qui se sont développées au cours de la dernière décennie, divers travaux se sont attachés à montrer comment la lecture de bande dessinée peut contribuer pleinement à la formation du lecteur. Rouvière (2012) a notamment souligné qu’une lecture problématisée de bande dessinée mobilise et peut développer les compétences interprétatives en jeu dans la lecture littéraire. Boutin (2012) plaide quant à lui pour une ouverture de la notion de littératie à des supports multimodaux, parmi lesquels la bande dessinée pourrait occuper une place de choix. Ahr (2012) enfin évalue l’intérêt d’adaptations de classiques en bande dessinée à l’aune de la richesse du dialogue interprétatif ouvert par ces créations avec l’œuvre source.
La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser
Introduction
Parmi les recherches en didactique de la littérature qui se sont développées au cours de la dernière décennie, divers travaux se sont attachés à montrer comment la lecture de bande dessinée peut contribuer pleinement à la formation du lecteur. Rouvière (2012) a notamment souligné qu’une lecture problématisée de bande dessinée mobilise et peut développer les compétences interprétatives en jeu dans la lecture littéraire. Boutin (2012) plaide quant à lui pour une ouverture de la notion de littératie à des supports multimodaux, parmi lesquels la bande dessinée pourrait occuper une place de choix. Ahr (2012) enfin évalue l’intérêt d’adaptations de classiques en bande dessinée à l’aune de la richesse du dialogue interprétatif ouvert par ces créations avec l’œuvre source.
Sur le terrain, plusieurs enquêtes font état de l’intérêt manifesté par les enseignant·e·s pour le médium, en même temps que de la rareté de la lecture de bandes dessinées dans les classes (Massol & Plissoneau 2008; Depaire 2019). Plusieurs facteurs concourent certainement à cette situation. L’absence de familiarité professionnelle avec le médium et le manque d’outillage pour aborder en classe des récits largement pilotés par l’image apparait ainsi fréquemment dans les propos des enseignant·e·s (Depaire 2019; Raux 2019). À cette explication, il faut sans doute ajouter l’idée très répandue selon laquelle la bande dessinée constituerait une lecture facile d’accès pour les élèves, susceptible d’«accrocher les petits lecteurs», formule fréquemment lue ou entendue (Raux 2019). Il est probable que l’absence d’outillage et le peu de place faite à la bande dessinée dans les recherches en didactique s’expliquent en partie par cette représentation d’un support facile et motivant, et de fait, les lectures de bandes dessinées proposées à l’école sont pratiquées dans le cadre de la lecture autonome, avec des lectures cursives ou des rallye-lecture, les enseignant·e·s les relayant peu en classe.
Ce présupposé de facilité appelle pourtant des clarifications et devrait être problématisé. On connait en effet bien mal la manière, ou plutôt les manières, dont les jeunes lecteurs lisent, comprennent et interprètent un récit en bande dessinée – il est significatif à cet égard d’avoir pu entendre au cours d’une enquête de terrain deux enseignantes du même établissement affirmer pour l’une que «devant une BD, les enfants ne font pas attention aux images, ils ne lisent que les textes» et pour l’autre que «les jeunes ne regardent que les images dans une BD»… Quelques études de cas s’efforcent d’ouvrir la boite noire des modalités de lecture de bande dessinée et de clarifier les enjeux de cette lecture dans des contextes d’enseignement. Lacelle met ainsi en évidence la diversité des compétences requises au niveau du lycée pour analyser les effets produits par des systèmes sémiotiques combinés dans une œuvre multimodale: en mettant en avant la «variation des niveaux de compétences à la lecture multimodale en fonction de la capacité de chacun à faire la jonction entre les unités de sens visuelles et textuelles» (Lacelle 2012: 138), elle souligne l’importance de prévoir des dispositifs de formation susceptibles de développer les compétences de lecture spécifiques à la bande dessinée pour nourrir les capacités d’interprétation. Polo et Rouvière (2019) montrent quant à eux que le choix de la bande dessinée en tant que document pour une classe de sciences sociales, s’il peut mettre les élèves en confiance en produisant une impression de facilité, n’entraine cependant pas de façon univoque une facilitation de la tâche de lecture.
En partageant des données exploratoires qui mettent en évidence quelques obstacles à la compréhension rencontrés par des élèves du secondaire, le présent article se propose de contribuer à l’«observation fine des pratiques des jeunes lecteurs en situation collective d’apprentissage», identifiée par Baroni (2021) comme un des enjeux de recherche prioritaires en matière d’usages scolaires de la bande dessinée. Deux situations sont analysées successivement: la première dans une classe de cinquième (deuxième année du secondaire) engagée dans la lecture suivie de Groenland Manhattan de Chloé Cruchaudet, où plusieurs travaux écrits ont été recueillis chez un groupe d’élèves pour documenter leur compréhension de différents passages et mécanismes narratifs; la seconde est basée sur un questionnaire soumis à une classe de première (deuxième année du lycée) à la suite de la lecture d’un reportage en bande dessinée en vue de tester la compréhension d’une narration appuyée sur un dessin plus symbolique. Cet échantillonnage modeste, qui correspond à deux expériences de lecture dans des contextes et sur des corpus bien distincts, n’épuise évidemment pas la question, mais se veut une invitation à déployer ce chantier de recherche encore très peu exploré.
Groenland Manhattan en cinquième: une lisibilité qui ne va pas de soi
Pour sa deuxième séquence de travail de l’année, en octobre 2020, une classe de cinquième d’un collège classé en Réseau d’Éducation Prioritaire était engagée dans la lecture de Groenland Manhattan de Chloé Cruchaudet1. Cet album, inspiré par le destin réel de Minik, jeune esquimau amené par l’explorateur Robert Peary à New York au début du XXe siècle, raconte l’enfance et l’adolescence du héros, tourmenté par son tiraillement entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption.
Les premières réactions lors du lancement de cette séquence confirment l’intérêt que peut susciter le choix du support: passée la surprise – «on va lire une BD?» – le fait est que tout au long de la lecture suivie en classe, les élèves rapportaient sans les oublier les exemplaires prêtés pour les temps de lecture à la maison, permettant que les échanges se fassent sans difficulté (l’établissement ne disposait que de quinze exemplaires pour vingt-trois élèves) et l’album était régulièrement tiré des cartables pour le quart d’heure de lecture inscrit dans l’emploi du temps en début d’après-midi. Mais c’est à des enjeux de compréhension et non de motivation que s’attache cet article. Les écrits d’élèves recueillis lors des premières séances mettent en effet en évidence l’importance d’un étayage de la lecture en classe.
Maitrise inégale des caractéristiques énonciatives
Dans un premier temps de la séquence sur l’album, la lecture a été menée en classe. Les deux premières séances, consacrées à la lecture des premières pages, ont eu pour objectif d’expliciter la nature des relations entre l’explorateur et la famille de Minik. Lors de la première séance, les élèves ont été invités à identifier le personnage principal du début du récit et à regrouper les informations données à son propos (pages 2 à 7) – il s’agit d’un «commandant», qui retourne vers New York en emmenant une météorite. Pour le deuxième temps de lecture, portant sur les pages 8 à 16, les élèves ont reçu comme consigne de reformuler ce que les Esquimaux pensent du commandant qu’ils appellent «Puili», et ce que celui-ci pense d’eux.
Ces deux premières séances de lecture ont été l’occasion de clarifier certaines caractéristiques de l’énonciation en bande dessinée, paramètre au sujet duquel des erreurs avaient été commises: plusieurs élèves ont attribué au commandant les noms de «Qisuk» (4 élèves) ou de «Matthew» (2 élèves), qui sont en fait ses interlocuteurs. Une bulle comme «Matthew, demande-leur de revenir demain avec leur famille», clairement reliée au commandant, seul à apparaitre sur la vignette, ne présente pourtant pas d’ambiguïté. La confusion sur le nom de Qisuk peut quant à elle être induite par une particularité énonciative du passage. Le commandant ne s’adresse pas directement aux Esquimaux mais il communique par l’intermédiaire de son interprète, Matthew. Pour figurer ces échanges, les paroles des Esquimaux sont représentées par des boucles indéchiffrables, traduites ensuite par Matthew. L’attribution du nom de Qisuk au commandant provient d’une confusion lors de la lecture de cette vignette:
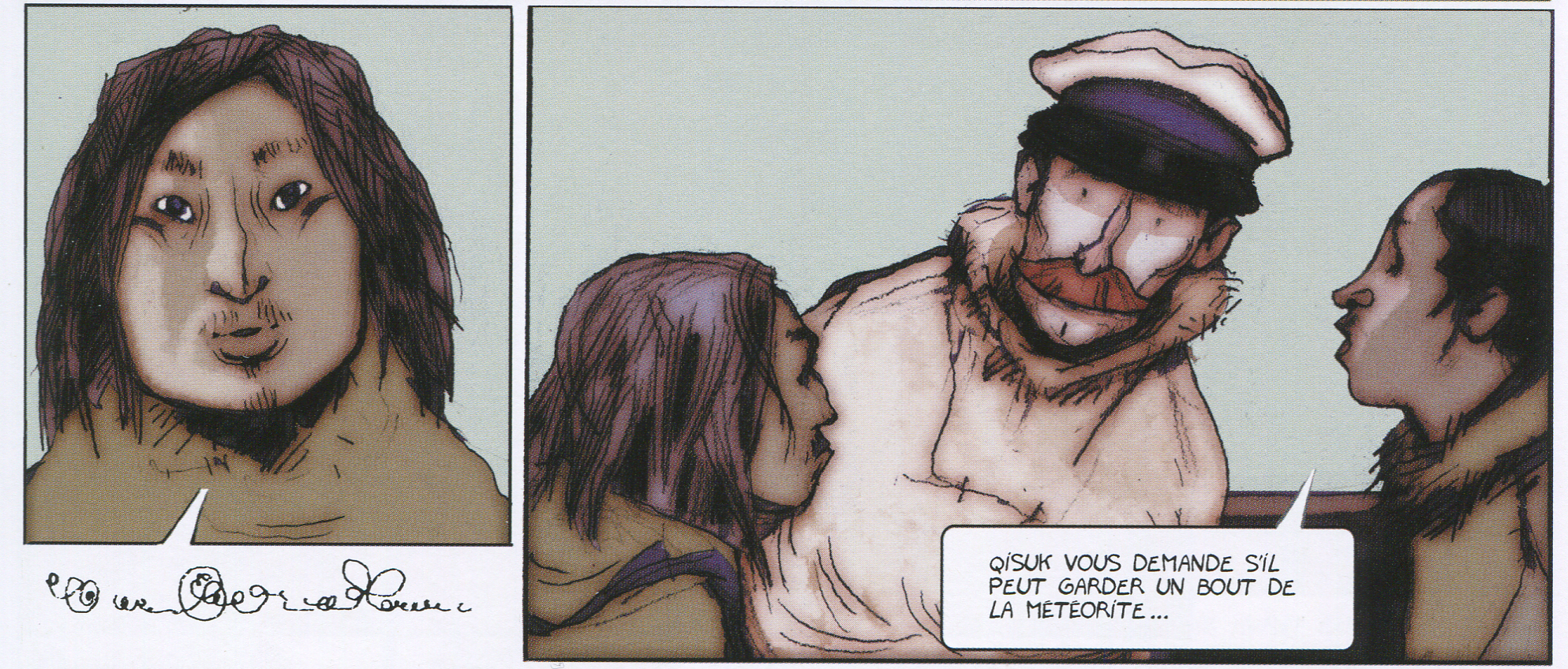
Image 1: Groenland Manhattan
(Cruchaudet 2008: 5), © Éditions Delcourt
Ces erreurs dans l’attribution des noms aux personnages montrent l’importance d’un étayage pour clarifier la situation d’énonciation et ses éventuelles particularités.
Il faut toutefois signaler que toutes les particularités énonciatives ne réclament pas le même accompagnement. Dans les mêmes pages, une planche qui met en jeu un décrochage énonciatif n’a pas posé de problème de compréhension: après qu’un des Esquimaux parlant du commandant déclare que «ça [lui] rappelle la fois où [ils] l’[ont] guidé jusqu’à la première dame de fer», la planche suivante raconte une crise de panique de Puili avec des dessins très schématiques, les contrastes entre le vert clair des dessins et le rouge du texte ou encore l’absence de cadre de la plupart des vignettes contribuant à la distinguer de celles qui précèdent et qui suivent. Ce décrochage énonciatif très marqué et explicitement associé à l’évocation d’un souvenir n’a pas suscité de difficultés de compréhension, seuls deux élèves ne répondant pas à la question «pourquoi les couleurs changent p. 12?», les vingt autres réponses identifiant que cette planche marque un retour en arrière, dans lequel, formule par exemple un élève, «Qisuk raconte une histoire qui s’est passée avec Puili». La fréquence de tels décrochages visuels manifestant un retour en arrière ou le début d’une séquence imaginaire, par exemple dans les fictions audiovisuelles, peut sans doute expliquer l’aisance avec laquelle les jeunes lecteurs ont compris l’enchâssement de ce récit rétrospectif: les compétences de lecture mises en œuvre devant la bande dessinée sont aussi nourries par les expériences audiovisuelles (et peuvent les nourrir en retour).
Difficultés de compréhension d’un récit porté par l’image
Après cette entrée dans l’œuvre fortement étayée, la troisième séance a été l’occasion d’une lecture plus autonome avec un partage du travail, la moitié de la classe lisant le récit du départ de Minik sur le bateau du commandant pendant que l’autre moitié étudiait des documents sur les expéditions polaires de Robert Peary. Pour évaluer la compréhension du passage de l’album, deux questions ont été posées par écrit: on demandait d’abord de légender une vignette muette représentant les Esquimaux sur le pont du bateau de Peary au moment du départ en précisant «qui sont ces Esquimaux, où ils sont, pourquoi, et en indiquant le nom de chacun quand c’est possible»; la deuxième question demandait d’expliquer «ce que fait Minik sur la dernière vignette page 24, et pourquoi». Les différences de précision entre les légendes proposées sont difficiles à interpréter: seul un élève a indiqué les quatre noms donnés dans l’album, la plupart – six sur onze – n’identifiant que Minik et son père, Qisuk, nommés dès les premières pages et identifiés collectivement lors des séances précédentes. Pour être complète, l’information était à chercher non seulement dans l’extrait mais également dans les premières pages, la grande amplitude du passage à consulter a donc pu constituer un obstacle et la dernière information donnée sur la deuxième famille, qui ne donnait pas de nom propre («c’est une chamane»), pouvait être laissée de côté pour satisfaire au mieux à la consigne.
Mais les réponses à la deuxième question montrent quelles difficultés ont pu être rencontrées devant une planche dans laquelle le récit est piloté par l’image, le texte ne l’éclairant que très partiellement. Cette planche, la page 24 de l’album, correspond à la catégorie des récits qualifiés de «lisibles» par Tauveron (1999), dans un travail fondateur sur la lecture littéraire et l’articulation de la compréhension et de l’interprétation:
Les récits qu’on peut dire, avec Barthes, «lisibles» ne posent pas de problèmes de compréhension majeurs (l’intrigue suit la chronologie, les relations entre personnages sont clairement posées, les valeurs des personnages nettement affirmées, leurs motivations explicitées…). (Tauveron 1999: 17-18)
L’organisation de la planche donne en effet nettement à voir ce qui se joue du point de vue de Minik. On le voit jouer avec sa figurine du capitaine Puili, dont il tire le traineau sur le bateau en figurant divers obstacles – les marches d’un escalier deviennent un glacier, «Capitaine Puili, vous êtes bien attaché? Nous montons un glacier!». Quatre vignettes muettes montrent ensuite successivement Minik suivant Puili, se présentant à sa porte, lui adressant un sourire, et recevant en retour la porte que Puili lui claque au nez. Après un dernier gros plan sur le traineau et la figurine, la dernière vignette montre Minik qui le jette par-dessus bord en lui assénant un vigoureux coup de pied. Deux bulles complètent les deux dernières vignettes: «Oh! Attention capitaine Puili…», «… une bourrasque de vent!». Conformément à la définition de la lisibilité mentionnée ci-dessus, l’enchainement est linéaire, les relations entre personnages sont clairement posées ainsi que les motivations et réactions de Minik.

Image 2: Groenland Manhattan
(Cruchaudet 2008: 24), © Éditions Delcourt
Pourtant ces enjeux n’ont manifestement pas été compris par la majorité des onze élèves concernés par ce travail. Si un élève répond avec la plus grande précision que Minik «met un grand coup de pied à capitaine Puili car le commandant lui a fermé la porte au nez», les autres réponses traduisent une compréhension moins assurée. Quatre élèves écrivent qu’«il donne un coup de pied dans Puili» (ou «à Puili»). Le geste est bien compris mais les réponses n’apportent pas d’explication concernant sa motivation. On ne peut exclure que la motivation ait été perçue par ces élèves, et que ce ne soit que la reformulation qui ait posé problème. Mais six élèves, soit la majorité du groupe concerné, ne répondent pas ou passent à côté des enjeux du passage. Outre trois absences de réponses, ce qui constitue un taux important, les trois dernières réponses présentent une certaine confusion ou approximation:
«Il tape sur un des côtés du bateau parce qu’il est énervé.»
«Il boude car les gens n’aiment pas les esquimaux.»
«Il tire un coup de pied pour dire que c’est une bourrasque de vent.»
S’il n’est pas faux qu’il soit «énervé» ou que sa colère soit liée au mépris dont il fait l’objet parce qu’il est Esquimau, la confrontation entre Minik et Peary n’est pas relevée, le fait que le coup soit porté à la figurine de Puili n’est pas mentionné. Tout se passe comme si, dans ce passage, le fait que la lisibilité de la séquence repose exclusivement sur l’image rendait ces enjeux implicites et difficilement interprétables. En l’absence de paroles étayant les images, les élèves semblent avoir de la peine à saisir les enjeux narratifs de la planche, qui sont pourtant présentés explicitement à travers un enchainement d’actions saisies par une suite de postures corporelles stéréotypées, ainsi qu’à travers des changements dans l’expression du visage de Minik, qui affichent son ressenti. Les paroles de Minik se présentent en effet comme un contrepoint à la situation, dans le registre de l’imaginaire, et n’expriment qu’implicitement ses sentiments, que l’image fait cependant apparaitre plus explicitement. Les difficultés rencontrées devant cette articulation invitent à examiner rigoureusement l’épaisseur énonciative des planches pour anticiper les difficultés qu’elles peuvent susciter et former au mieux les élèves à leur lecture.
Ces données sont assurément très partielles: non seulement elles portent sur un petit nombre d’élèves (des aléas organisationnels n’ayant pas permis de procéder au recueil des questionnaires auprès de l’autre moitié de la classe), mais en outre, les réponses écrites ne rendent pas compte de la manière dont les élèves ont procédé, de ce qui a fait obstacle – on ne peut pas écarter l’hypothèse d’un manque d’implication dans l’activité, la curiosité liée à la nouveauté du support s’estompant certainement après deux séances de lecture scolaire2. En dépit des questions laissées en suspens, ces quelques données illustrent toutefois la nécessité de mener des recherches plus approfondies visant à mieux documenter les procédures interprétatives mobilisées par des élèves confrontés à la lecture en classe de bandes dessinées. De telles recherches devraient permettre d’améliorer la didactisation de ce type de support, d’une part en dépassant le préjugé que l’image faciliterait nécessairement la compréhension du récit, d’autre part en tenant compte des difficultés inhérentes liées à la lecture de la bande dessinée.
Un reportage en BD au lycée: former à la lecture de dessins métaphoriques
Le développement du genre du reportage est une tendance forte parmi les évolutions récentes observables dans le champ de la bande dessinée (Groensteen 2017). Une offre éditoriale se structure, y compris pour les jeunes lecteurs Ainsi, la Revue dessinée propose depuis 2016 une variante éditoriale pour la jeunesse: Topo. Cette revue ambitionne de mobiliser les ressources de la narration graphique pour offrir un regard distancié sur l’actualité. Dans ce but, les reportages proposés, réalisés en collaboration entre un journaliste et un auteur de bande dessinée, exploitent un vaste répertoire de stratégies narratives. Régulièrement, des reportages empruntent des voies métaphoriques ou jouent sur le mélange entre différents registres (Raux 2021). La lecture d’un récit graphique de ce type par un groupe de lycéens montre que ce genre est loin d’être transparent et que les compétences pour les décrypter sont, comme le suggèrent Polo et Rouvière (2019), à construire pour une partie des élèves.
L’expérience de lecture a porté sur un sujet paru dans le premier numéro de Topo, abordant la question des armes aux États-Unis (Faure & Adam 2016). Elle a été menée dans une classe de 1ère ES (deuxième année du lycée, de section «économique et sociale») d’un lycée socialement mixte, composée pour moitié d’élèves sélectionnés en section internationale américaine et, pour l’autre moitié, d’élèves considérés comme fragiles par leur professeur principal. Les dix-neuf élèves se sont prêtés à l’expérience, en avril 2017, à la fin du second trimestre. Ils étaient présents à l’occasion d’une heure d’accompagnement personnalisé, et étaient encadrés par leur professeur de sciences économiques et sociales.
Après un premier questionnaire destiné à recueillir les connaissances sur le thème des armes aux États-Unis, qui montrait que les dix-neuf élèves présents savaient que les armes y circulent beaucoup et sont régulièrement l’objet de polémiques autour de fusillades, les élèves ont lu l’article intégralement puis ont répondu (sans avoir l’article à disposition) à des questions plus précises vérifiant la compréhension et l’assimilation des informations diffusées par l’article. À la question «quelle nouvelle loi Barack Obama a-t-il voulu faire passer?», dix-sept réponses signalent l’intention de contrôler davantage la vente d’armes, qui est évoquée plus ou moins précisément à travers les dispositions législatives envisagées. Deux élèves parlent d’un projet d’interdiction du port d’armes, ce qui n’est que partiellement exact – Obama l’aurait souhaité, mais cette disposition n’a pas été retenue dans le cadre de son projet de loi. À la question «quel(s) groupe(s) ou parti(s) politique(s) s’opposent à toute restriction concernant les armes?», à l’exception d’une réponse qui mentionne les démocrates, toutes les autres identifient le parti républicain, et/ou la NRA, et/ou le groupe des «gun lovers». La NRA est le groupe le plus souvent identifié, et il est mentionné dans treize réponses. La restitution des informations principales de l’article atteste donc d’une lecture attentive et d’une bonne compréhension globale des enjeux abordés. La compréhension d’un dessin a ensuite été testée: la dernière question demandait aux élèves quels éléments de l’article ils retrouvaient dans ce dessin, tiré de l’article – dans la vignette originale (image 3), le dessin était accompagné d’un texte, qui n’est pas reproduit pour le questionnaire (image 4). La question portait sur ce dessin car il représente symboliquement un fait répété dans l’article, formulé explicitement dans la vignette originale: ni illustration littérale du texte, ni symbole fonctionnant en autonomie, il présente donc un niveau de difficulté moyen.

Image 3: Pourquoi Barak Obama…
(Faure & Adam 2016), © Topo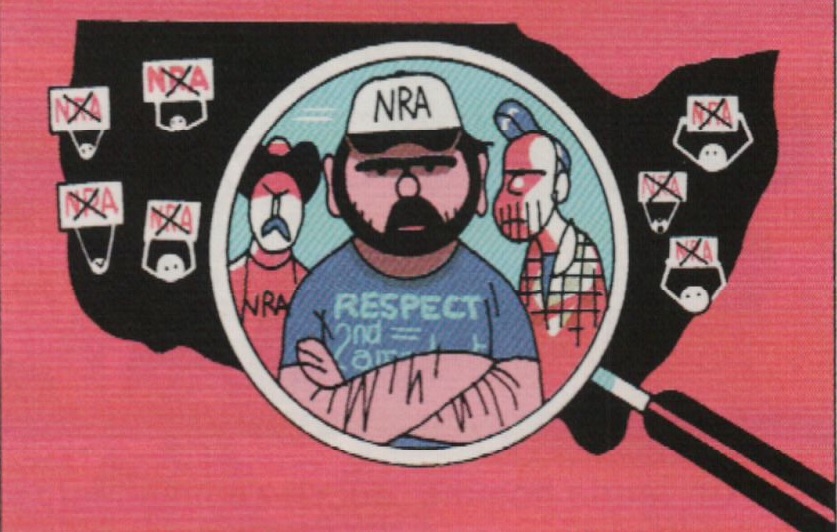
Image 4: Pourquoi Barak Obama…
(Faure & Adam 2016), © Topo
Un tiers des réponses développent l’idée représentée avec concision par le dessin, comme dans l’exemple suivant:
«On nous illustre le lobby intitulé NRA et on nous montre qu’elle n’est pas soutenue partout dans les E-U mais que malgré ça, elle a une grande importance et influence.»
À l’image de cet exemple, cinq réponses articulent le caractère minoritaire de la NRA et son influence. Six autres évoquent l’un ou l’autre de ces aspects, le caractère minoritaire de la NRA ou son influence, sans les mettre en relation. À l’opposé de ces réponses, qui attestent d’une bonne compréhension du dessin, on relève une non réponse et deux interprétations erronées:
«On retrouve la NRA, les États-Unis. À l'arrière il y a un cow-boy, il représente l'époque far-west où il y avait des armes. Peut-être où il y a des croix, ce sont des endroits où il y a eu des victimes.»
«On peut voir la NRA qui est pour le port d'armes. Et la loupe représente plus de contrôle sur les personnes voulant acheter une arme.»
Le plus souvent, sans surprise, l’exactitude et la précision de la réponse sur le dessin sont plus ou moins corrélées avec la qualité des réponses sur les faits et informations présentés dans l’article:
Réponse à la question «quelle nouvelle loi Barack Obama a-t-il voulu faire passer?» | Réponse à la question «quels éléments de l’article retrouvez-vous dans le dessin?» | |
Elève 8 | «Le contrôle d'arme, les vérifications systématiques de l'état mental de l'acheteur ainsi que de son casier judiciaire.» | «Que le peuple américain est en majorité contre les armes ou pour la restriction, mais que la NRA est très influente, plus influente qu'eux malgré leur sous-nombre.» |
Elève 18 | «Obama a voulu interdire le port d'arme et donc l'interdiction d'acheter une arme par n'importe qui.» | «On peut voir la NRA qui est pour le port d'armes. Et la loupe représente plus de contrôle sur les personnes voulant acheter une arme.» |
Mais quelques cas présentent une distorsion entre les réponses, une assimilation correcte des informations allant parfois de pair avec une lecture de l’image erronée:
Réponse à la question «quelle nouvelle loi Barack Obama a-t-il voulu faire passer?» | Réponse à la question «quels éléments de l’article retrouvez-vous dans le dessin?» | |
Elève 1 | «B. Obama a voulu faire passer une loi qui encadre plus les acheteurs. De vérifier l'état mental de la personne, son casier judiciaire. Obama a voulu aussi autoriser certains types d'armes et en interdire d'autres.» | «On retrouve la NRA, les États-Unis. À l'arrière il y a un cow-boy, il représente l'époque far-west où il y avait des armes. Peut-être où il y a des croix, ce sont des endroits où il y a eu des victimes.» |
Elève 10 | «Il a voulu limiter et même éliminer complètement les armes pour ne pas que des innocents meurent chaque année.» | Pas de réponse. |
Cette situation de lecteurs qui ont assimilé des éléments importants de l’article mais peinent à interpréter l’image va à l’encontre de l’idée selon laquelle l’image serait dotée d’un pouvoir facilitateur – et ce, d’autant plus que l’échantillon ne présente pas d’exemple réciproque, d’un lecteur qui aurait peiné à retenir les informations de l’article, mais qui interprèterait correctement l’image. C’est manifestement sur les explications littérales portées par le texte que les lecteurs les plus fragiles s’appuient, plutôt que sur les apports plus symboliques des dessins.
Quatre réponses, situées entre les réponses synthétiques citées plus haut et celles présentant des erreurs manifestes, suggèrent par ailleurs que le contenu de l’image, sans occasionner de difficultés de compréhension, peut néanmoins s’avérer difficile à reformuler. Ces réponses explicitent ce qu’est la NRA mais sans engager d’interprétation du dessin, en particulier sans signaler le processus d’influence mis en relief par le dessin, comme dans cet exemple:
«On retrouve la NRA qui est pour le port d’armes puisqu’ils ont peur et que pour eux c’est le seul moyen d’être en sécurité.»
Les difficultés rencontrées, soit pour décrypter le dessin, soit pour en reformuler la signification, éclairent ainsi certains des «obstacles» constatés par Polo et Rouvière (2019) à l’occasion d’un travail en classe de sciences économiques et sociales portant sur des planches de bandes dessinées au style minimaliste. Le caractère abstrait, schématique ou métaphorique du dessin, en l’occurrence l’association d’un personnage, d’une carte et d’une loupe, joue ainsi un rôle perturbateur dans sa compréhension.
Conclusion
Les deux situations de lecture de bande dessinée observées dans des classes du secondaire montrent que les compétences de lecture mobilisées par la narration graphique requièrent un apprentissage qu’il importe de ne pas sous-estimer. Un des enjeux du travail de conceptualisation que Baroni (2021) appelle de ses vœux concernant l’élaboration d’outils de lecture de la bande dessinée tournés vers l’enseignement serait de faciliter l’identification par les enseignant·e·s de points de vigilance et de formes d’étayage à apporter pour lire les œuvres. Sur le plan de l’investigation des procédures de lecture de bandes dessinées mises en œuvre par les élèves, il est évident que les aperçus présentés ici demanderaient un approfondissement, permettant en particulier d’affiner l’analyse des performances selon le profil des élèves. Il importe aussi de signaler que si le choix a été fait d’insister sur des difficultés de compréhension rencontrées, en raison de la force avec laquelle circule la représentation de la bande dessinée comme un support facile voire facilitateur, il ne faudrait pas négliger a contrario la potentielle mise en confiance des lecteurs offerte par des récits graphiques. Le partage de ces données exploratoires vise donc surtout à encourager l’éclosion d’études de cas plus complètes, qui permettront de discuter et de documenter ces différents aspects.
Le développement de telles enquêtes constitue un enjeu pour la didactique de la littérature en ouvrant deux perspectives. Il s’agit d’une part de clarifier dans quelle mesure et avec quelles limites les compétences de lecture mobilisées par la bande dessinée recoupent et peuvent éventuellement renforcer les compétences de lecture requises par des récits textuels, dans un contexte où la bande dessinée est souvent perçue comme un possible vecteur de remédiation. D’autre part, il en va de la formation des élèves à la diversité des pratiques de lecture: des enquêtes sur les pratiques de lecture font état d’un décrochage de la lecture de bandes dessinées à l’adolescence (Aquatias 2015), ce médium restant associé aux séries d’humour ou d’aventures, très populaires chez les jeunes lecteurs, qui ne passent pas à une production destinée au lectorat adulte, à laquelle l’enseignement de la littérature pourrait bien davantage les initier et les familiariser.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bandes dessinées. Sacrilège ou tremplin ?», in Enseigner les «classiques» aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. de Peretti, I. & B. Ferrier (dir.), Berne, Peter Lang, p. 197-208.
Aquatias, Sylvain (2015), «Le goût de la bande dessinée: acquisitions, transmissions, renforcements et abandons», in La bande dessinée: quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL:
https://books.openedition.org/bibpompidou/1675
Baroni, Raphaël (2021), «Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée», La lettre de l’AIRDF, n°68, p. 49-54.
Beaudoin, Isabelle, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Nathalie Lemieux & Martin Gendron (2015), «Consolider ses compétences de compréhension en lecture par la BD», Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL: https://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/r2-lmm_vol2_beaudoin-al.pdf
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littératie médiatique multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 33-44.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: la place de la Bande dessinée dans l’enseignement, Syndicat national de l’édition. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL: https://www.sne.fr/document/etude-la-place-de-la-bande-dessinee-dans-lenseignement/
Faure, Guillemette & Benjamin Adam (2016), «Pourquoi Barack Obama n’a-t-il pas réussi à interdire les armes aux États-Unis?», Topo, n°1, septembre-octobre.
Groensteen, Thierry (2017), La bande dessinée au tournant, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales: une expérience vécue en classe à partir des bandes dessinées Paul et Persépolis», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec.
Massol, Jean-François & Gersende Plissonneau (2008), «La littérature lue en 6e et 5e : continuités et progressions», Repères, n° 37, p. 69-103. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL: https://journals.openedition.org/reperes/422
Polo, Claire & Nicolas Rouvière (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 8 avril 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.5003
Raux, Hélène (2019), La bande dessinée en classe de français: un objet disciplinaire non identifié, thèse de doctorat, Université de Montpellier. URL: https://biu-montpellier.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=33MON_ALMA51358121230004231&vid=33UM_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=fr_FR&context=L
Raux, Hélène (2021), «Groom et Topo, ou l’actualité racontée à la jeunesse», in Presse et bande dessinée. Une aventure sans fin, A. Lévrier & G. Pinson (dir.), Bruxelles, Les Impressions nouvelles, p. 323-337.
Rouvière, Nicolas (2012), «Étudier une œuvre intégrale en bande dessinée au cycle 3 : quelles spécificités didactiques ?», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, p. 103-121.
Tauveron, Catherine (1999), «Comprendre et interpréter le littéraire à l’école: du texte réticent au texte proliférant», Repères, n° 19, p. 9-38.
Pour citer l'article
Hélène Raux, "La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-en-classe-une-lecture-a-didactiser
Voir également :
Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
Si la reconnaissance de la valeur culturelle de la bande dessinée, durement conquise au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui acquise{{Rappelons, au niveau de la reconnaissance institutionnelle, que le ministère de la culture en France a décrété l’année 2020 «année de la bande dessinée». Sur cette phase de «post-légitimation», voir notamment (Berthou 2017; Heinich 2019). Notons néanmoins qu’en dépit de ces honneurs, de nombreux·ses auteur·e·s et éditeurs·trices insistent sur le fait que leur profession est menacée de paupérisation, notamment en raison d’une surproduction saturant le marché et du manque de soutien institutionnel, ce qui a récemment conduit Lewis Trondheim à renvoyer au ministère la médaille de chevalier des arts et lettres qui lui avait été attribuée en 2005.}}, sa place au sein des programmes scolaires reste malgré tout fragile, ce qui a amené récemment Flore Steyaert et Jean-Louis Tilleul (2017: 233) à conclure que l’école restait «un caillou dans le soulier de la légitimation» de ce médium{{Cette publication est liée au projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique: "Pour une théorie du récit au service de l'enseignement" (Projet FNS n° 100019_197612 / 1).}}.
Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
Enseigner la bande dessinée dans un monde qui avance
Si la reconnaissance de la valeur culturelle de la bande dessinée, durement conquise au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui acquise1, sa place au sein des programmes scolaires reste malgré tout fragile, ce qui a amené récemment Flore Steyaert et Jean-Louis Tilleul (2017: 233) à conclure que l’école restait «un caillou dans le soulier de la légitimation» de ce médium2. Pour envisager le type de résistance que peut rencontrer la bande dessinée quand il s’agit de l’étudier en classe, il peut être intéressant d’envisager les choses sous l’angle, non pas des prescripteurs et des enseignant·e·s, mais sous celui des auteur·es et des représentations des élèves. Dans son dernier album –que l’on peut qualifier de roman graphique ou d’autofiction en bande dessinée– l’auteur genevois Frederik Peeters met en scène son avatar, Oleg, lors d’une intervention en classe qui, précise-t-il, est le «moyen qu’il a trouvé pour rester connecté avec le monde qui avance» (Peeters 2021: n.p.).
 Image 1: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 1: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Lorsque l’enseignante demande aux élèves si quelqu’un a une question à lui poser, Oleg se heurte d’abord à un mur de silence. L’enseignante recadre un élève endormi, qui explique, pour justifier son état comateux, avoir «regardé la nouvelle saison de "Titans"» la nuit précédente3. La plupart des questions posées à l’auteur concernent ensuite la longueur du labeur aboutissant à la création d’un album et le profit qui se dégage de cette activité. Lorsqu’Oleg répond que la réalisation de son album lui a pris à peu près une année, une élève réagit en disant «c’est trooop looong». Oleg répond qu’il pense être, au contraire, plutôt rapide et demande à l’élève combien de temps il lui a fallu pour lire son album. Elle répond «quinze minutes», expliquant qu’elle n’a lu en réalité que les premières pages, et Oleg découvre ainsi que seulement deux élèves de la classe ont lu son œuvre dans son intégralité.
 Image 2: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 2: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Cette confrontation avec le «monde qui avance» souligne plusieurs aspects de l’évolution récente de la bande dessinée et de ses rapports à l’enseignement. Premièrement, la posture d’Oleg et son décalage vis-à-vis des représentations de plusieurs élèves soulève la question d’une polarisation de la production qui s’est opérée au sein du champ de la bande dessinée à partir de la fin des années 19604 et de ses effets sur la manière de lire les récits graphiques dans et hors de la classe. Le premier pôle renvoie à l’autonomie créative d’un artiste publiant ses œuvres chez des éditeurs indépendants ou issus du champ littéraire. Peeters est par exemple édité chez Gallimard, à l’Association ou chez Atrabile, éditeur indépendant genevois dont il est cofondateur, et il dispose ainsi d’un contrôle étendu sur la thématique, le style et le format de ses récits graphiques. Il faut relever par ailleurs qu’il n’est plus irréaliste d’imaginer qu’un auteur correspondant au profil de Frederick Peeters / Oleg puisse être invité dans une classe de français pour parler de son œuvre, à l’instar d’un écrivain. En l’occurrence, quand l’enseignante présente l’auteur, elle évoque un «prix BD des écoles5», ce qui témoigne également du gain de légitimité au sein des institutions scolaires. Cette liberté implique en revanche un mode de production artisanal et très chronophage, dans lequel un auteur «complet» réalise peu ou prou toutes les tâches, ce qui lui assure un revenu instable essentiellement lié à la gestion de ses droits6.
Le second pôle renvoie aux industries culturelles visant une accélération de la production fondées sur une standardisation des produits et sur la division du travail et l’anonymisation des créateurs, lesquels ne disposent plus que d’une liberté très limitée7. Aujourd’hui, le type de bandes dessinées le plus largement diffusé parmi les jeunes sont des produits émanant de grands groupes industriels, à l’instar de Disney, de Sony ou de Média Participations, qui intègrent différents supports médiatiques et coordonnent les activités de milliers d’employés. Et évidemment, au sommet de ces empires médiatiques, certains auteurs historiques, comme Hergé, Zep ou Stan Lee, peuvent accumuler des fortunes considérables. Bounthavy Suvilay et Edith Taddei (2019) rappellent par ailleurs que les bandes dessinées les plus largement consommées par les jeunes se rattachent aujourd’hui au genre importé du manga, qui a connu ces dernières années un essor phénoménal, soutenu par la diffusion sur les chaines en streaming d’adaptations sous forme d’anime.
Si la bande dessinée dans son ensemble a donc visiblement conquis ses lettres de noblesse, les œuvres valorisées par le monde de l’éducation semblent ainsi de plus en plus déconnectées des œuvres appartenant pleinement à la culture «juvénile» (Mitrovic 2019), ici incarnée par une série télévisée adaptée d’un univers créé par DC comics. La réaction de l’élève quant à l’état du compte en banque d’Oleg est prise par ce dernier comme peu pertinente, parce qu’à ses yeux, l’élève se trompe de pôle, confondant un auteur appartenant au champ de production restreinte avec un créateur travaillant à une échelle industrielle. Mais au-delà de la méprise, voire du mépris que l’on serait tenté d’adopter devant une question si triviale, se cache une réalité socioculturelle dont l’élève se fait ici le témoin précieux: le fait que lui, comme vraisemblablement la majorité de ses camarades, n’est exposé qu’au second de ces deux pôles et qu’il n’envisage pas l’existence d’une culture autonome, centrée sur l’individu producteur et héritée du XIXe siècle. Il n’a finalement en face de lui qu’un adulte actif parmi d’autres, au sein d’une société où la réussite individuelle se mesure à l’argent que l’on gagne.
En somme, la scolarisation de la bande dessinée est évidemment liée à «l’artificationde la bande dessinée» (Heinich 2017), mais la «légitimité culturelle» (Berthou 2017) dont jouit une partie de la production éloigne d’autant les corpus enseignés des représentations ordinaires que se font les élèves du médium, ce qui ne manque pas de produire des malentendus et des difficultés dans l’émergence d’une lecture de la bande dessinée que l’on pourrait qualifier de littéraire, au sens que les didacticiens donnent de ce terme (Dufays, Gemenne & Ledur 2005; Ronveaux & Schneuwly 2018). Ce que montrent les réactions de la plupart des élèves dans cet extrait, c’est que ces derniers assimilent la bande dessinée à une forme de culture populaire – à l’instar des mangas et des comics qui peuplent leur bibliothèque intérieure – et que cela induit des questionnements orientés sur des enjeux essentiellement économiques ou professionnels, au lieu d’adopter des gestes de lecture qui se seraient sédimentés dans la pratique scolaire du commentaire des textes littéraires. Ce faisant, l’entrée de la bande dessinée dans la classe de français, d’une part, ne produit pas forcément un rapprochement entre lectures scolaires et lectures privées (Norton 2003; Mitrovic 2019; Suvilay & Taddei 2019) et d’autre part, ne débouche pas nécessairement sur la pratique d’une lecture susceptible de renforcer le développement d’une littératie médiatique multimodale (Boutin 2012).
Le rappel de cette dualité explique que, face à cette forme d’expression que Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019) définissent – à la suite de Thierry Groensteen (2006) – comme un «objet didactique mal identifié», les angles interprétatifs peuvent diverger sensiblement en fonction du statut qui est accordé à l’œuvre commentée. L’entrée de la bande dessinée dans la classe de français ne pose donc pas seulement la question de son identité médiatique, mais également celle de son statut culturel et des angles de lecture qui en découlent. Peut-on considérer la bande dessinée comme une forme de littérature? Ces questions, inlassablement posées depuis une vingtaine d’années (Morgan 2003; Chute 2008; Meskin 2009; Baetens 2009; Dürrenmatt 2013) ne doivent donc pas être comprises uniquement en termes généraux et médiatiques mais également en termes locaux et critiques. Pour rendre les enjeux plus explicites, il faudrait commencer par poser les questions suivantes: peut-on lire en classe certaines bandes dessinées comme on lirait des romans ou des pièces de théâtre? peut-on poser aux récits graphiques le même genre de questions que l’on poserait à des œuvres littéraires? peut-on étudier ces compositions de textes et d’images selon des procédures similaires à celles que l’on mobilise face à la représentation verbale ou scénique d’une histoire?
Il s’agirait ensuite d’anticiper une éventuelle réponse positive à ces questions pour qu’apparaisse une problématique secondaire: si cette lecture est possible, c’est probablement parce que l’on se refuse encore à envisager l’institutionnalisation de la bande dessinée dans le cadre scolaire sous un angle qui engloberait le caractère industriel et commercial d’une partie non négligeable de ses manifestations. Et qu’un tel refus risque de reconduire une forme sociologiquement induite d’inégalité parmi les élèves, en particulier en termes de cadrage des activités (Rochex & Crinon 2014), dont la séquence d’enseignement reproduite ici par Peeters semble relativement dépourvue. Oleg ou l’enseignante auraient pourtant pu profiter de cette question, qui n’est impertinente qu’en apparence, pour mentionner l’existence de différents types de produits culturels rattachables au média «bande dessinée» et expliciter les différences de nature existant entre ces produits en ce qui regarde la liberté dont disposent les créateurs, laquelle ne garantit nullement la qualité finale de l’objet. Cela aurait aussi permis de signaler l’existence d’œuvres populaires nées d’un compromis entre les contraintes d’une production industrielle plus ou moins formatée et la réputation de génies qui s’attache à certains auteurs formant un panthéon historique, à l’instar d’Osamu Tezuka, de Jack Kirby, d’Hergé ou de la paire René Goscinny et Albert Uderzo, qui a enfanté une œuvre pharaonique: 380 millions d’albums vendus dans le monde, plusieurs blockbusters cinématographiques, un parc d’attraction, etc.
Les conditions matérielles de production ne devraient ainsi jamais être complètement évacuée d’un enseignement centré sur l’histoire et l’esthétique de la bande dessinée, l’émergence et l’évolution de ce média relativement jeune étant consubstantiellement liées à l’essor de la presse imprimée et des logiques sérielles qui en découlent et sous-tendent encore la plupart des productions, même les plus auteuristes. Même les auteur·e·s indépendant·e·s ne peuvent survivre en se privant totalement des circuits de production et de diffusions traditionnels, et le positionnement de leurs œuvres ne peut se comprendre qu’en lien étroit avec les formes et les thèmes développés par les industries culturelles, ainsi qu’en témoigne la récurrence des motifs superhéroïques dans les œuvres de Chris Ware ou de Daniel Clowes.
Oleg se montre néanmoins reconnaissant lorsqu’une élève lui adresse enfin une question qu’elle aurait très bien pu poser à Flaubert, à Maupassant… ou à Houellebecq: quelle place donnez-vous à l’actualité du monde dans votre travail? Est-ce que vous hésitez entre faire des histoires intemporelles et des histoires réalistes? La question suppose évidemment que l’auteur dispose de suffisamment d’autonomie pour envisager ces différentes options et choisir celle qui correspond le mieux à son projet artistique. Le roman graphique de Frederik Peeters est enfin abordé sous l’angle de sa littérarité et non sous l’angle unique de son statut d’objet culturel rattaché à l’industrie des loisirs. S’ouvre alors la possibilité d’une véritable disciplination de la bande dessinée par son rattachement à la pratique de la lecture littéraire telle qu’elle s’est sédimentée dans les pratiques scolaires (Ronveaux & Scheuwly 2018).
 Image 3: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 3: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
La bande dessinée d’auteur et sa lecture scolaire
Jan Baetens avance que «la rencontre des domaines longtemps séparés de la littérature et de la bande dessinée» s’impose aujourd’hui «comme une évidence» (2009: §1), ce dont témoigne, entre autres, l’explosion des adaptations de classiques en bande dessinée, mais aussi l’émergence d’un genre identifié comme «roman graphique» et son accession à des prix littéraires prestigieux. Toutefois, Baetens souligne le risque de confondre cette rencontre avec une forme de fusion ou d’hybridation:
Une chose est l’explosion des croisements entre littérature et bande dessinée, autre chose est le bien-fondé ou la solidité de cette nouvelle hybridité, qui ne manque pas de soulever plus d’une question essentielle sur notre conception même du récit. (Baetens 2009: §1)
Si l’on exclut les adaptations ne servant que de marchepied pour accéder aux œuvres vraiment littéraires, les bandes dessinées enseignées dans les classes de français comme de la littérature sont plutôt rares et les mêmes titres ne cessent de revenir dans les discours des chercheur·euse·s, didacticien·ne·s, enseignant·e·s: Maus, Persepolis, Pilules bleues, Fun Home… Ce retour inlassable d’un corpus d’œuvres restreint témoigne d’une part de la difficulté d’établir un périmètre élargi de récits graphiques dignes d’être enseignés en classe comme de la littérature. La patrimonialisation des œuvres passant généralement par leur inscription dans les corpus scolaires, pour le meilleur ou pour le pire, on peut dès lors considérer que l’école n’a pas encore joué son rôle de sélection des œuvres supposément légitimes, le choix des enseignant·e·s se repliant sur la bibliothèque intérieure correspondant à leurs lectures privées liées à l’enfance et à l’adolescence8 (donc souvent liées à des œuvres populaires) ou sur quelques succès critiques validés par des prix ou des récompenses, avec le fameux Pulitzer pour Art Spiegelman, bien sûr, mais aussi le prix du jury du Festival de Cannes pour l’adaptation cinématographique de l’œuvre de Marjane Satrapi. On peut donc anticiper sur cette sélection en considérant la possibilité qu’elle se calque sur une légitimité dont elle emprunte les caractéristiques sociologiques à la littérature, sans tenir compte des spécificités médiatiques du champ de production de la bande dessinée.
Par ailleurs, si le statut culturel acquis par certaines œuvres font de la bande dessinée un objet certes mal identifié mais au moins potentiellement enseignable, il ne faut pas négliger les problèmes inhérents à la disciplination des gestes de lecture spécifiques, aussi bien du côté de l’enseignant que de celui des élèves9, ce qui passe par l’intégration de pratiques compatibles avec la conception que l’on peut se faire d’un enseignement de la littérature, mais aussi par l’établissement de procédures nouvelles, adossées aux caractéristiques sémiotiques du support. Outre le problème du rattachement des œuvres à un média populaire, qui complexifie le cadrage interprétatif des enseignant·e·s et des apprenant·e·s, le mélange de textes et d’images dessinées pose ainsi un problème qui se reflète dans les hésitations des plans d’étude: faut-il rattacher la bande dessinée à l’histoire de l’art ou à la classe de français? Comment traiter à la fois le style graphique des dessins, la composition de la case et celle de la planche, le découpage de l’action, les effets de cadrage, le contrastes des couleurs, tout en liant ces aspects au développement du récit, aux jeux sur la focalisation et le point de vue, aux dialogues et aux récitatifs, alors que la formation initiale des enseignant·e·s de français ne les a généralement guère préparé·e·s à traiter ces aspects simultanément.
Ainsi que l’ont montré Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), le chemin est encore long pour former les enseignant·e·s à des gestes interprétatifs susceptibles d’intégrer ces différentes dimensions, sans pour autant tomber dans un répertoire de notions techniques déconnectées des enjeux esthétiques ou éthiques soulevés par la lecture de l’œuvre, et sans se méprendre sur la complexité inhérente à un médium à la fois textuel et graphique. L’objectif de ce numéro est précisément de contribuer à développer des pistes de réflexions relatives à l’ensemble de ces aspects, d’abord en lien avec l’histoire du médium et de sa scolarisation, puis orienté sur différentes propositions didactiques et observations en classe.
La première partie, qui s’inscrit dans une perspective historique, s’ouvre sur un article de Nicolas Rouvière exposant la situation actuelle de la bande dessinée, qui est entrée depuis une dizaine d’années dans une phase que l’on peut définir comme celle d’une «post-légitimation». Si cette nouvelle manière d’envisager le média devrait lui ouvrir les portes de l’enseignement aux différents niveaux de la scolarité, elle pousse aussi Rouvière à dresser le constat d’un déficit de «théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe», ce qui souligne l’importance de renforcer la recherche dans ce domaine. Cette théorisation apparait d’autant plus importante que les matérialisations médiatiques des récits graphiques ne cessent de se complexifier dans la culture numérique contemporaine, brouillant les frontières entre bande dessinée, jeu vidéo, dessin animé ou série télévisée.
L’article suivant offre un survol historique beaucoup plus large des relations tumultueuses entre la bande dessinée et les institutions scolaires, en suivant la piste des instructions officielles en France de manière à mettre en lumière, depuis les années 1960, la place réservée aux récits graphiques dans les programmes scolaires. Sophie Béguin illustre cette trajectoire scolaire qui, en effet, semble en partie déconnectée des enjeux entourant la légitimation culturelle du médium. Les hésitations portent non seulement sur les titres ou le nombre d’œuvres préconisés par les instructions officielles, mais également sur le rattachement disciplinaire de l’étude de la bande dessinée. Enfin, si la scolarisation du médium ressemble à une série de rendez-vous manqués, Béguin montre que c’est aussi en raison d’une certaine méfiance émanant des milieux de la bande dessinée, certain·e·s de ses représentant·e·s craignant les effets de la scolarisation d’un objet qu’ils·elles préfèrent ranger dans le domaine de la contre-culture et de la subversion.
Le troisième article de cette partie historique envisage la place de la bande dessinée vis-à-vis de l’enseignement du français langue étrangère, à travers l’analyse d’un corpus de manuels publiés entre 1919 et 2020. Son auteure, Anick Giroud, soulève un intéressant paradoxe: alors que le potentiel didactique des images narratives pour l’enseignement des langues est très tôt reconnu, avec l’émergence des méthodes directes au début du XXe siècle, puis, de manière encore plus marquée, avec l’éclosion des méthodes audio-visuelles, communicatives et actionnelles, la place de la bande dessinée en tant que document authentique est restée très modeste. La grande majorité des récits graphiques insérés dans les manuels demeure donc le travail d’illustrateurs·trices, produisant des objets sur mesure, adaptés aux objectifs de la leçon, mais dépourvus de valeur culturelle. Face à ces documents forgés, les modalités d’une lecture littéraire apparaissent impossibles, et la valeur culturelle du médium singulièrement diminuée.
La partie suivante réunit trois propositions didactiques adossées à des œuvres dont la réputation littéraire est fortement établie, du Maus d’Art Spiegelman au Persepolis de Marjane Satrapi, en passant par l’incontournable Fun Home d’Alison Bechdel. Si le choix de ces œuvres oriente naturellement l’exploitation didactique vers un horizon esthétique et culturel, les trois articles mettent également en évidence les spécificités d’une littérature dessinée et montrent comment exploiter cette dimension graphique.
La proposition de Violeta Mitrovic articule la lecture de trois «mémoires graphiques» (Fun Home, Persepolis et Wonderland de Tirabosco) dans la perspective de leur enseignement au post-obligatoire. En insistant sur la richesse et l’épaisseur des possibilités interprétatives de ces œuvres, elle se sert de leur caractère profondément multimodal pour convoquer la possibilité effective d’une lecture littéraire, au sens élargi de ce terme, dans lequel elle rassemble et interroge les notions de participation et de distanciation, de littératie, de lectures «ordinaire» et «savante», sans oublier de faire valoir la spécificité du médium comme vecteur d’acquisition de compétences nouvelles.
Gaspard Turin, dans une contribution portant sur la didactisation de Maus, propose une approche pragmatique face à une œuvre à la fortune critique si importante qu’elle pourrait en paraître hors de portée pour de jeunes lecteurs. En cherchant à rendre à l’œuvre une forme de simplicité, induite par le traitement zoomorphique de ses personnages, il n’en oublie pas moins que cette simplicité ne sert qu’à dialoguer avec la complexité d’une œuvre grave et dont l’enjeu de lecture devient dès lors celui d’un questionnement à étages multiples. Faire lire Maus à des adolescent·e·s revient-il à les forcer dans un monde adulte? Ou plutôt à envisager un dialogue avec les modalités d’appréhension du monde propres à l’enfance?
Enfin Camille Schaer s’attache, elle aussi, à assigner à la lecture de la bande dessinée en classe des enjeux portant sur la littératie et sur les compétences qui lui sont associées. Elle choisit pour sa part d’insister sur les spécificités du médium par rapport à la littérature ordinairement enseignée à l’école, afin de faire reconnaître une «tension entre linéarité et mise en réseau des informations». Cette mise en réseau l’incite à porter un regard neuf sur le livre en tant qu’objet, comme en témoigne son attention au paratexte. Il s’agit enfin, pour elle, par le biais des œuvres sélectionnées (Persepolis d’une part et Les Coquelicots d’Irak, de Findakly et Trondheim, de l’autre) d’ouvrir les élèves aux subtilités de l’autobiographie dessinée.
La dernière partie envisage l’enseignement de la bande dessinée sous un angle plus empirique, informé par des observations en classe, de sorte que les articles éclairent les vertus, mais aussi les obstacles inhérents à une lecture littéraire de la bande dessinée dans différents degrés de la scolarité.
Dans sa contribution, Hélène Raux interroge le «présupposé de facilité» qui accompagne le traitement scolaire de la bande dessinée pour montrer que la lisibilité du médium ne va pas de soi et qu’il doit s’accompagner d’un étayage en classe, fondé sur l’enseignement des codes propres à la lecture des récits graphiques. Des exemples de terrain suggèrent que la compréhension des logiques présidant à l’enchaînement des cases n’a rien d’un acquis pour les élèves observés, et que le déficit de compréhension ou de reformulation se présente plus volontiers dans le cadre de la lecture des images que de celle du texte. L’accent est mis, en conclusion, sur la nécessité de renforcer des approches didactiques orientées sur ces aspects et de réorienter le regard des élèves face à un médium souvent considéré par eux, a priori, comme destiné aux enfants.
L’article de Jean-François Boutin et Virginie Martel s’intéresse quant à lui aux modalités de la lecture de bandes dessinées historiques, en suivant treize parcours de lecture d’élèves du secondaire et du primaire. Les auteurs s’attachent à creuser en particulier la question des rapports entre le passé et sa reconfiguration par les récits graphiques, tout en tenant compte de la multimodalité du support. Pour poser les bases d’une lecture dialectique, permettant de rendre compte de «l’historisation de la fiction et [de] la fictionnalisation de l’histoire» (Gallego 2015: 5), les auteur·e·s préconisent de porter l’attention des lecteurs·trices sur la dimension multimodale et les stéréotypes propres au champ de la bande dessinée.
Si la bande dessinée demande encore à être enseignée, elle demande aussi, plus vivement peut-être, à être didactisée. Mais au-delà de ces questions, elle demande aussi à être interrogée dans ses rapports à l’institution scolaire et aux rapports que cette institution entretient avec ce «monde qui avance», ou qui semble parfois stagner, voire reculer… et dont, malgré ses richesses, la bande dessinée n’est encore qu’une manifestation marginale. Il suffit de courir le risque d’ouvrir ce champ culturel à des élèves pour réaliser à quel point son objet reste «non identifié», ou indexé à des codes culturels, économiques et sociétaux auxquels la bande dessinée «comme littérature» peine encore à se confronter. Tout reste à faire donc, dans ce champ. Les travaux réunis ici cherchent à en proposer une exploration que l’on espère enthousiasmante, mais ils ne pourront en aucun cas se substituer aux pratiques d’enseignement, informées ou improvisées, que nous engageons nos lecteurs·trices à tenter, à poursuivre et à partager.
Bibliographie
Aquatias, Sylvain (2015), «Le goût de la bande dessinée: acquisitions, transmissions, renforcements et abandons», in La bande dessinée: quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 24 septembre 2021, DOI: 10.4000/books.bibpompidou.1675
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n°16, en ligne, consulté le 28 août 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.974
Berthou, Benoît (2017), «Une nouvelle légitimité culturelle. Le cas de la bande dessinée», in Le Statut culturel de la bande dessinée, Ahmed Maaheen, Stéphanie Delneste & Jean-Louis Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 221-232.
Blanchard, Marianne & Hélène Raux (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 6 août 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818
Boltanski, Luc (1975), «La constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1 (1), p. 37-59.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littératie multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 33-44.
Chute, Hillary (2008), «Comics as Literature? Reading Graphic Narrative», PMLA, n° 123, p. 452-465.
Chute, Hillary (2020 [2008]), «La bande dessinée est-elle de la littérature? Lire les récits graphiques», Transpositio. En ligne, consulté le 20 août 2021, URL: http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2005), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier.
Gallego, Julie (dir.) (2015), La bande dessinée historique. Colloque international - Premier cycle: l’Antiquité, Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Ardour.
Groensteen, Thierry (2006), Un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.
Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 5-9.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (2014), «Disciplinarisation et disciplination consubstantiellement liées. Deux exemples prototypiques sous la loupe: les sciences de l’éducation et les didactiques des disciplines», in Disziplin - Discipline, Balz Engler (dir.), Fribourg, Academic Press, p. 27-46.
Lacassin, Francis (1971), Pour un neuvième art, la bande dessinée, Paris, Union générale d’édition.
Meskin, Aaron (2009), «Comics as Literature?», The British Journal of Aesthetics, n° 49, p. 219-239.
Mitrovic, Violeta (2019), «Se rapprocher de la culture juvénile par l’usage du roman graphique autobiographique au lycée», Le français aujourd’hui, n° 207, p. 67-77. En ligne, consulté le 17 février 2020. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2019-4-page-67.htm
Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Editions de l'an 2.
Norton, Bonnie (2003), «The Motivating Power of Comic Books: Insights from Archie Comic Readers», The Reading Teacher, n° 57 (2), p. 140-147.
Peeters, Frederik (2021), Oleg, Genève, Atrabile.
Rochex, Jean-Yves & Jacques Crinon (dir.) (2014), La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs d’enseignement, Rennes, PUR «Paideia».
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (dir.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Roux, Antoine (1970), La bande dessinée peut être éducative, Paris, Éditions de l’École.
Steyaert, Florie & Jean-Louis Tilleul (2017), «La bande dessinée à l’école. Un caillou dans le soulier de la légitimation», in Le Statut culturel de la bande dessinée, Ahmed Maaheen, Stéphanie Delneste & Jean-Louis Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 233-268.
Suvilay, Bounthavy & Edith Taddei (2019), «Les mangas: faire entrer les lectures privées à l’école et les constituer en objets littéraires», Le français aujourd’hui, n° 207, p. 79-91. En ligne, consulté le 17 février 2020.
URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2019-4-page-79.htm
Pour citer l'article
Raphaël Baroni & Gaspard Turin, "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021http://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-4-enseigner-la-bande-dessinee-comme-de-la-litterature
Voir également :
Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page
Sur la base de l’analyse de l’organisation des planches que l’on rencontre au fil de l’album Le Long Voyage de Léna de Pierre Christin et André Juillard, cet article visera à montrer comment il est possible de décrire et d’interpréter l’architecture des planches d’un récit graphique{{Cette réflexion a été développée dans le cadre du projet Sinergia «Reconfiguring Comics in our Digital Era», financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS: CRSII5_180359).
Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page
La dimension tabulaire de la bande dessinée: de la théorie à l’enseignement… et retour
Sur la base de l’analyse de l’organisation des planches que l’on rencontre au fil de l’album Le Long Voyage de Léna de Pierre Christin et André Juillard, cet article visera à montrer comment il est possible de décrire et d’interpréter l’architecture des planches d’un récit graphique1. Je commencerai par souligner l’importance, pour la didactique de la bande dessinée, de disposer d’un outillage conceptuel permettant d’identifier différents prototypes de mise en page, tout en soulignant les lacunes observables en ce domaine. Je mettrai aussi en lumière un certain nombre de problèmes liés à l’ergonomie des principaux modèles théoriques, ce qui justifie selon moi leur reconfiguration dans l’optique d’une transposition didactique des typologies existantes. Cela m’amènera à proposer un modèle original, que je mettrai à l’épreuve par ma lecture de l’album de Christin et Juillard.
Philippe Sohet, dans son effort de didactisation d’une bande dessinée d’Edmond Baudoin, commente de la manière suivante une planche caractérisée par des effets de symétrie:
Ces ajustements graphiques nous rappellent qu’une planche ne se réduit pas à une succession de cases, elle est surtout un espace où cohabitent des vignettes. Si la «lecture» d’une bande dessinée est séquentielle, case par case, il ne faut pas perdre de vue que son appréhension visuelle est d’abord globalisante, l’œil percevant la planche dans son ensemble. Cette réalité correspond à la dimension «tabulaire» de la planche. Il est donc possible de penser cette cohabitation, de l’organiser en fonction de certaines fins. (Sohet 2010: 66)
Pour les enseignants soucieux de mettre en avant les spécificités du langage de la bande dessinée, il est en effet difficile de faire l’impasse sur l’un des aspects les plus saillants de ce médium, à savoir le fait que la séquence de cases est projetée à la surface de son support, ce qui entraine l’émergence d’effets liés à la coprésence des images. Pourtant, en dépit de la reconnaissance de cette «dimension tabulaire», où se joue en partie le sens du récit, de nombreux manuels se caractérisent par une carence d’outils permettant de traiter cet aspect. L’ouvrage de Sohet, par exemple, possède des sections intitulées «La planche comme composition» (2010: 63-67), «La panopticité» (2010: 68-73) et «La stratégie du site» (2010: 73-80), mais, fidèle à une approche dont l’objectif est surtout de dégager la spécificité de l’œuvre de Baudoin, il ne propose aucun principe général de «composition» ou d’organisation de cette «panopticité», ce qui réduit considérablement la transférabilité de cette lecture vers d’autres contextes. Plus récemment, dans les manuels publiés par Marie-Hélène Marcoux, pourtant très systématiques dans leur approche du langage de la bande dessinée, la description de la dimension tabulaire est totalement absente du manuel destiné aux niveaux primaires (2018), alors que pour le niveau secondaire, les mises en page régulières sont érigées en matrices pour toutes les autres formes de composition, ce qui l’amène à leur attribuer une valeur esthétique que l’on peut juger excessive:
Le gaufrier sert de modèle pour disposer les cases de façon harmonieuse et visuellement attrayante. Il est normal que certaines scènes importantes ne puissent pas correspondre au format plus contraignant de six ou neuf cases. Le bédéiste a parfois besoin de plus de cases […] pour illustrer une scène d’action rapide. Il choisira donc de varier, selon ses besoins, le gaufrier classique. (Marcoux 2016: 30)
À côté du «gaufrier», il existe pourtant bien d’autres types d’organisation de l’espace paginal, que l’on peut qualifier, selon les auteurs, de mises en page «semi-régulière», «irrégulière», «rhétorique», «décorative» ou «productrice» (Chavanne 2010 ; Groensteen 1999 ; Peeters 2003). Renaud Chavanne rappelle en outre que «contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, les compositions régulières ne sont pas nécessairement les plus anciennes attestées de la bande dessinée» (2010: 57). La question se pose donc de savoir si, pour construire un savoir scolaire sur la «panopticité» ou la «planche comme composition», il suffit de renvoyer à ces typologies savantes et aux terminologies qui en découlent. Et si c’est le cas, quel modèle choisir?
Jusqu’à récemment, je m’appuyais dans mes cours2 sur les modèles élaborés par Benoît Peeters (1991) et Thierry Groensteen (1999), qui sont les plus fréquemment cités dans la recherche francophone3. Si les types dégagés par ces deux auteurs sont relativement faciles à expliquer et à illustrer avec des exemples choisis4, en revanche, le passage à un usage empirique se révèle beaucoup moins aisé. Mon expérience m’a notamment permis de constater l’existence de difficultés persistantes, pour un grand nombre d’étudiants, quand il s’agissait de classer certaines mises en page d’apparence plutôt banale, mais qui se situaient en dehors des catégories, ou plutôt qui cumulaient des traits contradictoires invitant à les classer dans plusieurs catégories simultanément. Ces modèles ont pour eux la simplicité des critères qui sont au fondement des catégorisations, mais l’analyse d’œuvres singulières ne cesse de mettre en évidence l’existence de cas indécidables. Au début, je suggérais de sélectionner la typologie correspondant le mieux à l’objet étudié, voire de nommer différentes classifications possibles, en mettant en évidence les traits qui les rapprochent de tel ou tel type, ce qui n’était au fond guère satisfaisant. Au lieu d’offrir un levier pour l’interprétation, les typologies finissaient par devenir des obstacles bloquant l’analyse dans sa phase descriptive, au lieu de l’orienter vers une réflexion sur la fonction du dispositif.
En contexte scolaire, quand on présente une planche et que l’on porte la discussion sur sa dimension tabulaire, il est pourtant difficile d’échapper à la question de savoir comment décrire telle ou telle mise en page et à l’interrogation qui découle de cette difficulté: pourquoi tel ou tel dispositif ne se laisse pas facilement classer? Si cela concerne une œuvre expérimentale, on pourra en conclure que la valeur de l’objet se fonde, en partie du moins, sur son écart créatif vis-à-vis des principes de compositions habituels. Mais si l’on rencontre le même problème à la lecture d’un album d’André Juillard et de Pierre Christin, qui s’inscrit dans la droite ligne de la tradition franco-belge, alors il faudra en conclure que l’outil mobilisé pour l’analyse souffre d’un défaut d’ergonomie.
La théorisation de la mise en page en bande dessinée est marquée par un déficit chronique de mises à l’épreuve empiriques et la réflexion portant sur la transposition didactique des modèles pourrait être l’occasion de remédier à ce problème. Dans le domaine de la didactique de la bande dessinée, Nicolas Rouvière, à la suite de Jean-Paul Meyer (2019: 164, n. 19), dénonce également les «limites des typologies actuelles» (2019: 372), tout en insistant sur le rôle que pourrait jouer la didactique dans la théorisation de la bande dessinée:
Il est enfin un dernier argument, sans doute le plus décisif, pour reconsidérer sans mépris aucun l’apport que peut représenter la sphère éducative pour une meilleure connaissance de la bande dessinée. En effet, les difficultés à caractère didactique que rencontrent les enseignants quand il s’agit de faire étudier la BD en classe correspondent très souvent à des nœuds épistémologiques qui se trouvent au cœur de la spécificité du médium. Ainsi en va-t-il de la notion d’hypercadre, qui a constitué l’une des difficultés les plus importantes pour la théorisation sémiotique de la bande dessinée. (Rouvière 2016: 372)
L’objectif de cet article sera précisément de tenter d’améliorer l’ergonomie des typologies existantes en élaborant un modèle en partie original, qui soit à la fois plus facile à enseigner, plus souple et plus efficace pour décrire l’organisation tabulaire des planches. On pourrait contester l’intérêt d’un tel outil en arguant que l’interprétation des effets découlant de l’organisation spatiale des récits graphiques pourrait se passer d’une description standardisée, ainsi que l’illustre l’approche du récit graphique de Boudoin par Sohet. D’ailleurs, les didacticiens dénoncent souvent les dérives d’un enseignement qui se contenterait de transmettre une terminologie ou un bagage technique au lieu de s’attacher à dégager le sens de l’œuvre:
Enseigner la bande dessinée est un défi que l’enseignement scolaire doit relever, en particulier pour établir des liens entre la littératie traditionnelle et les nouvelles formes de culture médiatique. Mais il ne s’agit pas seulement de former des lecteurs experts et critiques, aussi bien à l’aise dans le monde des lettres que celui des représentations figuratives, pour démêler des productions discursives combinant des codes variés. Il s’agit aussi de former des lecteur sensibles, impliqués, entrant en résonnance symbolique avec les œuvres, pour s’accomplir à part entière comme sujets-interprètes. (Missiou 2019: 98)
J’essaierai de montrer, en m’appuyant sur la lecture du Long Voyage de Léna, que le fait de discuter de la mise en page des planches en se fondant sur une grille d’analyse permet de sensibiliser les apprenants à une dimension souvent négligée lors de la lecture, tout en élargissant le champ de leur expérience esthétique. Ainsi que l’affirme Elizabeth Rosen, l’étude de leur dimension tabulaire souligne que les bandes dessinées «remettent en question la plupart des façons dont nous avons appris à lire: de gauche à droite, de haut en bas, de façon linéaire et progressive» (2009: 58). Jesse Cohn insiste quant à lui sur le fait que de nombreux lecteurs, habitués à cette lecture linéaire, négligent les effets qui se construisent à l’échelle de la page, ce qui réduit considérablement leur horizon esthétique et les amène à lire les bandes dessinées comme des romans ordinaires5:
Parfois, en lisant un roman graphique, nous pouvons perdre de vue le fait que nous regardons une page. En effet, pour la plupart de nos élèves, habitués à considérer la bande dessinée comme une lecture facile, leur regard passe assez rapidement sur les pages, qui sont généralement conçues pour ne pas interrompre cette fluidité ; ils voient des personnages agissant dans le temps, et non un dessin étendu dans l'espace. (Cohn 2009: 44)
Cohn confesse avoir rencontré des résistances quand il s’agissait d’attirer l’attention de ses étudiants sur l’aspect proprement graphique des récits en bande dessinée. Il ajoute que si cette dimension devient évidente lorsqu’il confronte sa classe à des œuvres expérimentales, à l’instar des romans graphiques de Chris Ware, la grande majorité des bandes dessinées exigent de disposer d’un cadre interprétatif permettant d’identifier les procédures standardisées à travers lesquelles les récits «occupent l’espace» (2009: 44). Il s’agit par conséquent de découvrir des principes généraux de composition, que Cohn compare avec l’art du montage hollywoodien enseigné dans les cursus d’études cinématographiques6. Il ne s’agit pas de confondre le découpage filmique avec l'organisation tabulaire du récit, qui sont des opérations totalement différentes, mais d’insister sur l’importance d’objectiver les logiques sous-jacentes au montage cinématographique et à la mise en page de la bande dessinée pour que ces configurations narratives soient perçues au-delà des automatismes culturels qui les invisibilisent.
Par ailleurs, outiller les apprenants avec une typologie de techniques narratives permet de discuter de phénomènes qui transcendent le cas particulier, posant par exemple la question des parentés et des filiations entre les œuvres, tout en permettant de mettre au jour des procédures standardisées qui donnent forme aux productions sérielles de la culture médiatique7. Mobiliser de tels cadres interprétatifs permettrait par conséquent sans nul doute de renforcer la littératie médiatique des apprenants (cf. Lebrun, Lacelle & Boutin 2012).
Tabularité des récits graphiques et typologies des mises en page
Dans un article pionnier, Pierre Fresnault-Deruelle (1976) définit la bande dessinée comme un produit culturel écartelé entre la linéarité du strip et la tabularité de la planche. Cette double dimension a amené Thierry Groensteen à souligner l’existence de deux modes d’appréhension des rapports entre les images dessinées. Dans une terminologie qu’il emprunte à Jean Ricardou (1978), il évoque une arthrologie restreinte et une arthrologie généralisée. L’arthrologie, en médecine, consiste en l’étude des articulations entre différents membres du corps humain. En bande dessinée, cette double logique articulatoire souligne que les cases – qui constituent l’unité fondamentale de la bande dessinée – ne font pas que se succéder linéairement, comme une suite de mots, mais forment également un réseau entre des éléments occupant différents lieux disséminés dans l’espace graphique. L’étude des relations qui se tissent au sein de cet espace consiste, toujours selon la terminologie de Groensteen, à mettre en lumière un «tressage iconique», c’est-à-dire un réseau qui se déploie dans une dimension tabulaire et plus seulement linéaire. A priori, ce tressage peut se déployer à n’importe quelle échelle de l’œuvre imprimée, Groensteen insistant sur le fait que les images facilitent une saisie rapide du sens, ce qui invite, davantage que dans d’autres genres d’imprimés, à naviguer librement à la surface des pages et au feuilletage des albums:
La bande dessinée est fondamentalement une littérature qui ne dissimule rien, qui s’offre à une possession entière et sans reste: on la découvre rien qu’à la feuilleter, on navigue à sa surface sans oblitérer ce qui précède et en ayant déjà un œil sur ce qui arrive. (Groensteen 2011: 82)
Au sein de ce système, qualifié de «spatio-topique», se pose en particulier la question de l’étalement des images à la surface des planches et des effets qui découlent de leur configuration paginale. Comme l’explique Groensteen:
Parmi les diverses opérations qui assurent l’intégration des composantes d’une bande dessinée, celle qui a le plus particulièrement pour fonction de régir les paramètres spatio-topiques est communément désignée sous le terme de «mise en page». (1999: 107)
Benoît Peeters est probablement l’un des premiers auteurs à avoir proposé une typologie des mises en page8. Selon son approche, deux critères sont retenus pour classer la composition des planches: d’une part, l’interdépendance ou l’autonomie entre le tableau et le récit ; d’autre part, le rapport de domination, respectivement de la fonction narrative ou de la tabularité. En croisant ces critères, Peeters (2003: 49) obtient un tableau à double entrée définissant quatre types de composition, qui renvoient respectivement à une utilisation rhétorique, conventionnelle, productrice ou décorative de la mise en page.
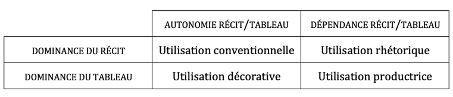
Tableau 1: Typologie des mises en page selon Benoît Peeters.
Les mises en page rhétorique et conventionnelle sont donc dominées par la fonction narrative, mais elles s’opposent sur le plan de la variabilité des cases. Dans la mise en page rhétorique, le format s’adapte au contenu tandis que dans le dispositif conventionnel, il n’y a pas d’interdépendance, le format adoptant une grille régulière, aussi appelée «gaufrier» (Peeters 2003: 51). Au sujet de la mise en page conventionnelle, Peeters affirme par ailleurs qu’il s’agit d’un «système fortement codifié, où la disposition des cases dans la planche, à force de se répéter, tend à devenir transparente» (2003: 52). Les mises en page décorative et productrice se caractérisent quant à elles par une dominance du tableau, mais la première est exploitée à des fins purement esthétiques, tandis que la seconde engendre des effets qui modifient l’appréhension du récit.
Si les mises en page dites rhétoriques ou conventionnelles sont relativement faciles à identifier, il est plus difficile de différencier concrètement les utilisations décoratives ou productrices. L’appréciation de la fonction du dispositif et la détermination du point de bascule à partir duquel on peut considérer que la dimension tabulaire devient dominante reposent en effet sur des critères subjectifs. Jan Baetens et Pascal Lefèvre ont d’ailleurs montré que ces qualificatifs pouvaient très bien s’utiliser en relation avec le «gaufrier», que Peeters range pourtant dans la catégorie des usages conventionnels. Par exemple, de nombreuses pages de Watchmen exploitent des effets de symétrie ou des compositions en damier jouant sur le contraste des couleurs, ce qui renforce l’une ou l’autre de ces fonctions:
Ce qui fait la force de l’album, sous l’angle du cadrage, c’est l’utilisation du principe conventionnel selon des logiques en fait contradictoires. Ainsi la plus neutre de toutes les mises en page – la fragmentation de la planche en neuf vignette analogues – connaît aussi un emploi producteur. La symétrie du modèle de base pousse à doter un chapitre entier d’une structure symétrique globale et de faire miroiter les successives pages de la première partie de cette section dans les planches équivalentes de la seconde moitié. Par ailleurs de nombreuses planches de Watchmen revêtent sûrement, en premier lieu par la distribution réglée, souvent en damier, des contrastes chromatiques, un aspect décoratif et ne peuvent pas ne pas être déchiffrées comme un espace plastique. (Baetens & Lefèvre 1993: 60)
Groensteen propose quant à lui une typologie un peu différente, ce qui l’autorise à envisager l’existence de gaufriers productifs ou décoratifs. Reprenant l’exemple de Watchmen discuté par Baetens et Lefèvre, il est conduit à critiquer le qualificatif de conventionnel pour définir le gaufrier, car cette mise en page exacerberait les correspondances non linéaires qui peuvent être tressées entre des cases isomorphes:
La mise en page régulière est donc aussi celle qui exalte certains effets de tressage parce qu’elle leur permet de produire les agencements les plus simples et prégnants du point de vue perceptif, et parce qu’elle renforce les correspondances entre lieux prédéterminés. (Groensteen 1999: 114)
Le principe retenu par Groensteen pour analyser une mise en page repose sur les réponses données à deux questions, apparemment très simples:
a / Est-elle régulière ou irrégulière?
b / Est-elle discrète ou ostentatoire? (Groensteen 1999: 114)
En croisant ces deux critères, Groensteen reconstruit une typologie à quatre termes:
- régulière et discrète ;
- régulière et ostentatoire ;
- irrégulière et discrète (ce qui correspond à la mise en page «rhétorique» classique) ;
- irrégulière et ostentatoire. (Groensteen 1999: 115)
Le problème découlant de ce modèle, c’est qu’il ne précise pas quel degré de régularité correspond au juste l’expression «mise en page régulière» et il n’indique pas davantage selon quel critère il est possible de décider que telle ou telle composition devient ostentatoire. En effet, Groensteen mentionne la possibilité de rencontrer, au sein d’une mise en page régulière, des rupture saillantes, sans que cette modification du gaufrier ne fasse basculer ce dernier du côté des organisations irrégulières:
[La mise en page régulière] possède enfin cette ultime vertu, de ménager la possibilité de ruptures soudaines et spectaculaires avec la norme posée d’abord. Dans un album dont les pages sont régulières, une page qui se distingue soudain par une configuration spéciale obtiendra un impact très fort […]. Au lieu que, quand toutes les vignettes sont discriminées par des formats différents – comme le propose l’option rhétorique –, il est plus difficile d’en faire vraiment ressortir aucune. (Groensteen 1999: 114-115)
On voit ainsi que l’opposition la plus élémentaire, à savoir celle entre régularité et irrégularité, pose la question du seuil à partir duquel on passe d’un prototype à l’autre, puisque Groensteen – comme Peeters9, d’ailleurs – suggère que des variations locales du gaufrier ne remettent pas en cause le type de base auquel se rattache la composition. Quant à la fonction de ces ruptures, Groensteen considère qu’elles peuvent renforcer le caractère ostentatoire de la mise en page, faisant basculer une mise en page conventionnelle dans un registre décoratif ou productif, ou qu’elles peuvent tout aussi bien répondre à la simple nécessité d’adapter le format de la case à son contenu narratif, ce qui la rapprocherait d’un usage rhétorique.
Cette possibilité de considérer que certaines planches irrégulières ne représenteraient que des variations du gaufrier pose non seulement la question du seuil à partir duquel une irrégularité peut être jugée pour elle-même, mais également de l’échelle à partir de laquelle caractériser une mise en page. Faut-il considérer l’ensemble de l’œuvre, que l’on classerait dans l’une ou l’autre de ces catégories de base – régulière ou irrégulière pour Groensteen, conventionnelle ou rhétorique pour Peeters – et définir ensuite, sur cette base, des passages qui offriraient des variations de cette matrice, ou vaut-il mieux s’attacher à décrire chaque planche dans sa relative autonomie vis-à-vis de l’œuvre globale? La question est d’autant plus actuelle que de nombreux romans graphiques contemporains jouent sur une forte hétérogénéité de registres, accentuée par l’esthétique discontinue du chapitrage et des compositions paginales10. On comprend mieux sur cette base la perplexité des étudiants confrontés à des mises en page irrégulières, que l’on devrait définir comme des variantes, ostentatoires ou discrètes, d’une mise en page régulière, dont la fonction pourrait être aussi bien productrice que décorative ou rhétorique.
Avant de proposer une alternative, je mentionnerai un dernier cadre théorique, un peu moins connu, mais qui a le mérite d’être fondé sur une base empirique, à savoir l’étude systématique des mises en page d’Edgar P. Jacobs par Renaud Chavanne (2005). Dans une tentative de généralisation ultérieure de son modèle, Chavanne réarrange les typologies de Peeters et Groensteen en proposant un modèle simplifié à trois pôles:
Poursuivant, développant et approfondissant l’analyse de nos prédécesseurs, nous identifions trois grands principes de composition susceptibles de s’appliquer aux œuvres organisées par bandes: le principe de régularité, le principe de semi-régularité et le principe rhétorique. (2010: 27)
Chavanne reprend donc de Peeters le «principe rhétorique» et emprunte à Groensteeen le «principe de régularité», mais il introduit un pôle intermédiaire, qu’il appelle «principe de semi-régularité11», qui règle en quelque sorte la question du seuil entre les deux dispositifs. Outre l’introduction de cette catégorie, l’une des innovations majeures apportée par Chavanne consiste à souligner, davantage que ne le font Peeters et Groensteen, le fait que ces trois prototypes ne sont que des pôles et que leur concrétisation au sein d’une œuvre procède d’une logique combinatoire, débouchant sur un «mélange de ces principes»:
[O]n pourrait venir à penser de ce qui précède qu’il existe une séparation étanche entre ce qui procède de la rhétorique et ce qui appartient à la régularité, et, dans un moindre degré, entre la semi-régularité et la rhétorique. Il n’en va pas ainsi. Bien sûr les définitions de ces principes de composition sont suffisamment fortes pour qu’elles permettent de distinguer des constructions effectivement différentes, et que cette distinction se conforme à l’observation […]. Mais rien ne justifie l’impossibilité d’une combinatoire, d’un mélange des principes. (Chavanne 2010: 153).
Au lieu de penser les rapports sous forme de choix binaire ou de tableau à double entrée, il faudrait ainsi se représenter les types de mises en page possible comme des pôles se répartissant sur un spectre allant de la mise en page rhétorique à la mise en page régulière en passant par différents stades intermédiaires. On peut aussi retenir du modèle de Chavanne la notion de matrice, qui désigne une configuration de base présidant à la construction de l’œuvre, laquelle se distingue des concrétisations locales et plus ou moins divergentes de telle ou telle planche dans son état publié:
Lorsqu’il s’engage dans la création d’une bande dessinée, le dessinateur s’astreint presque systématiquement à un certain nombre de contraintes de composition. Ces contraintes peuvent lui être imposées, ou il peut les choisir de lui-même. Ce choix peut être fait en pleine connaissance de cause, comme il peut résulter d’une habitude, d’une tradition que l’on reproduit sans même s’en apercevoir. Il s’agira par exemple du format de la bande dessinée (une page? de quelles dimensions? une partie d’une page plus grande occupée par d’autres éléments que la bande dessinée?), du nombre de vignettes par bande (fixe, variable, dans quelles proportions?), du nombre de bandes se succédant sur l’espace de composition (fixe? variable?), de la hauteur de ces bandes (toujours semblable ou fluctuante?), de la régularité ou non de la dimension des cases, et ainsi de suite. L’ensemble de ces contraintes de composition, nous les appellerons la matrice de l’œuvre. (Chavanne 2010: 15)
Il faut donc souligner l’intérêt de la notion de matrice et du principe de gradualité introduits par Chavanne, mais on peut regretter la disparition de la dimension ostentatoire ou de ce que Peeters définissait comme des mises en page où le tableau domine. Plus exactement, les mises en page les plus ostentatoires sont bien envisagées dans les derniers chapitres de l’ouvrage, mais libérées de leur dépendance envers la linéarité de la bande, elles font l’objet d’une nomenclature de plus en plus foisonnante, ce qui complexifie son usage12. En outre, la catégorie «semi-régulière» apparait, comme son nom l’indique, comme une dérivation de la mise en page régulière, plus que comme une véritable catégorie intermédiaire, ainsi qu’en témoigne cette citation:
[L]a régularité de composition peut se transformer en une contrainte terrible voire paralysante. C’est probablement alors qu’apparaissent les avantages des compositions semi-régulières. […] Une composition semi-régulière dérive directement d’une composition régulière, dont elle est en quelque sorte une altération. De la composition régulière, la semi-régulière retient le principe d’invariance des dimensions des bandes et des vignettes. La matrice élémentaire qui sous-tend de manière simple et sans aucune équivoque les compositions régulières, est toujours immédiatement perceptible dans une composition semi-régulière. Pour parler autrement, on peut dire que la grille de base, que le gaufrier de la composition régulière apparaît immédiatement et sans difficulté sous une composition semi-régulière. (Chavanne 2010: 49)
Chavanne n’envisage donc pas le cas où une mise en page semi-régulière serait dérivée d’une matrice rhétorique, ce qui est pourtant fréquent dans l’œuvre de Hergé, par exemple quand ce dernier met en scène le récit de Tchang dans Tintin au Tibet, qui prend la forme, au sein d’une mise en page globalement rhétorique, d’un montage régulier de cases isomorphes montrant en alternance le narrateur et des fragments de son récit et produisant un effet de damier qui préfigure les compositions décoratives que l’on rencontre dans Watchmen. On peut citer également une double page célèbre rattachée au flashback du Secret de la licorne dans laquelle Hergé joue sur des effets de symétrie entre deux grandes cases spectaculaires montrant des navires et un combat entre des marins et des pirates, qui contrastent avec une séquence de petites cases de format identique, où l’on peut suivre les mésaventures burlesques du capitaine Haddock mimant l’événement.
L’idée que la mise en page semi-régulière serait la dérivation d’une composition régulière et qu’en outre elle aurait pour fonction essentielle d’assouplir une contrainte de production conduit Chavanne à négliger les cas, pourtant nombreux, où un mélange de régularité et d’irrégularité confère à la planche une valeur ostentatoire ou productrice. Il me semble que ce genre de dispositif, que j’appellerai pour ma part mise en page architecturée, est susceptible de se rencontrer aussi bien dans une œuvre dominée par une matrice rhétorique que fondée sur le principe du gaufrier. J’ajouterai que ce dispositif peut même devenir une matrice en soi dans des récits graphiques exploitant pleinement la dimension tabulaire de la bande dessinée. Cette catégorie a aussi l’intérêt d’offrir une base pour regrouper la très grande diversité des compositions occupant l’espace paginal d’une manière que l’on pourrait qualifier de créative.
Typologie circulaire et mise en page architecturée
On peut retenir plusieurs principes dérivés des modèles élaborés par Peeters, Groensteen et Chavanne en vue de leur réarticulation au sein d’un modèle que je tenterai de rendre plus souple et plus efficace pour un usage scolaire. Tout d’abord, on peut considérer que la mise en page rhétorique et le gaufrier ne posent pas de problème de repérage particulier, dans la mesure où ils renvoient à des standards historiquement attestés, qui continuent de structurer une partie importante de la production actuelle. Les termes eux-mêmes sont devenus courants dans le langage des spécialistes de la bande dessinée, à tel point qu’ils ne nécessitent plus de définition particulière dans leurs travaux. Quand il s’agira d’expliquer la nature de ces prototypes à des apprenants, on se contentera de rappeler que le gaufrier consiste en un découpage régulier de la page, qui forme une grille, alors que la mise en page rhétorique consiste à adapter le format des cases au contenu représenté, ce qui induit un principe de variation plus ou moins aléatoire. On retiendra également le principe défini par Peeters, à savoir que le gaufrier est fondé sur une autonomie de l’organisation tabulaire, alors que la mise en page rhétorique adapte la mise en page aux contraintes de l’histoire représentée.
La clarté de cette opposition repose également sur un principe d’engendrement qui en constitue la raison d’être. Le gaufrier propose une organisation tabulaire standardisée, qui simplifie la mise en page, mais il complexifie le «cadrage» de l’action. À l’inverse, la mise en page rhétorique offre plus de souplesse pour mettre en scène le contenu narratif dans chaque case, mais elle complexifie l’agencement de ces cases dans l’espace du support. Dans un cas comme dans l’autre, on associera ces dispositifs à des matrices fondées sur un principe de production standardisée, ce qui explique que le dispositif tende généralement à s’invisibiliser au profit de la progression linéaire dans le récit et de l’immersion dans le plan de l’histoire.
En ce qui concerne les mises en page ostentatoires, c’est-à-dire celles dans lesquelles la dimension tabulaire devient plus saillante, on évitera de différencier les usages décoratif ou productif, car leur interprétation repose sur des critères trop subjectifs. Il me semble par contre que la catégorie introduite par Chavanne, qui consiste à proposer un pôle intermédiaire entre la régularité du gaufrier et l’irrégularité de la mise en page rhétorique offre une piste intéressante. Mais plutôt que d’en faire une simple dérivation de la mise en page régulière, il serait plus productif de lui conférer un statut propre et d’expliquer en quoi une irrégularité régulière ou une régularité irrégulière, est susceptible de renforcer la saillance de la dimension tabulaire de la planche. Pour ce troisième pôle, je propose d’utiliser l’expression de mise en page architecturée.
Ainsi que l’explique Catherine Labio, l'architecture «occupe depuis longtemps une place prépondérante dans la bande dessinée» (2015: 312). Elle explique qu’il ne s’agit pas seulement d’un sujet «médiagénique13» pour les récits graphiques, mais que cette thématique constitue également une mise en abîme du dispositif, car «la dimension architecturale de la page est une caractéristique essentielle du genre» (2015: 315, n. 7). Labio va plus loin en associant les déformations productrices que l’on peut observer dans les mises en page de Winsor McCay aux principes esthétiques de l’art nouveau, qui dominaient son époque. Dans le même registre, Alain Boillat, à la suite de Vincent Amiel, souligne qu’au sein d’une série comme Les Cités obscures – scénarisée par Benoît Peeters et dessinée par François Schuiten, lui-même fils d’architecte – on peut observer une «convergence entre l’architecture de la ville et celle de la planche» (2018: 143). Boillat rapproche cette conception ostensiblement architecturée du modèle de la mise en page productrice, que Peeters valorise dans ses travaux théoriques:
Dans un art de l’espace comme la bande dessinée où la disposition des cases sur la planche appelle un niveau de lecture tabulaire (facultativement subsumé en partie par la lecture linéaire), la démarche à l’œuvre dans les Cités obscures constitue intrinsèquement un renvoi aux conditions fondamentales de la création/réception de la BD. […] À travers les exemples qu’il convoque (Winsor McCay, Régis Frank et Fred) pour illustrer sa typologie, on comprend bien que c’est une utilisation dite «productrice» (par opposition à celles respectivement qualifiées de «conventionnelle», «décorative» et «rhétorique») qu’il entend valoriser dans la production contemporaine (et par conséquent dans la sienne propre), c’est-à-dire une mise en page obéissant au principe selon lequel «c’est l’organisation de la planche qui semble dicter le récit» (Peeters 1998: 68). (Boillat 2018: 143)
En résumé, même si n’importe quelle mise en page peut être considérée comme une forme d’architecture graphique, on pourrait utiliser l’étiquetage mise en page architecturée pour renvoyer plus spécifiquement à une configuration que l’on qualifierait, dans une autre terminologie, de productrice ou d’ostentatoire. Ce troisième pôle pourra également être défini formellement comme une composition au sein de laquelle des irrégularités locales s’inscrivent dans une configuration de rang supérieur, ce phénomène correspondant par exemple aux effets de symétrie, de contraste ou de hiérarchie qui relient des éléments hétérogènes au sein de la page. Parmi les cas typiques de compositions architecturées, on pourra mentionner par exemple les cases en médaillon placées au milieu de la planche, que l’on trouve parfois chez Jacobs, ou ces grandes cases qui viennent rompre la régularité d’un gaufrier en occupant toute la largeur d’un strip, qui sont fréquentes chez Frederik Peeters. On inclura également les compositions jouant sur des contrastes de couleur ou des correspondances graphiques non linéaires, qui abondent dans les compositions de Watchmen. Il faut rappeler en effet que l’architecture de la page ne passe pas nécessairement par des variations affectant la forme des cases: ainsi que l’ont montré Baetens et Lefèvre (1993: 60), les contrastes de couleurs au sein d’un gaufrier ou d’une mise en page rhétorique peuvent très bien créer des effets saillants à l’échelle de la planche ou de la double planche.
Enfin, il faut noter que les principes de composition peuvent varier au fil d’une œuvre, et que même à l’échelle d’une planche, on peut observer localement différents principes qui se combinent en se superposant les uns aux autres. Ces métissages, qui font parfois glisser une mise en page d’une matrice vers un pôle différent, tout en conservant certains traits inhérents au dispositif de base, soulignent l’importance de disposer d’une typologie suffisamment souple pour ménager des lieux intermédiaires, situés à une plus ou moins grande distance d’un pôle ou de l’autre.
De manière à conserver ces nuances tout en échappant à la question souvent insoluble des «seuils» qui font basculer une mise en page d’une catégorie à une autre, je propose de réarticuler ces trois prototypes (rhétorique, gaufrier, architecturé) au sein d’un continuum, lui-même structuré par les oppositions mises en évidence par Groensteen. Cette articulation serait impossible dans une modélisation sous la forme d’un tableau à double entrée, mais elle peut néanmoins être envisagée dans le cadre d’un typologie circulaire inspirée des travaux du narratologue allemand Franz Karl Stanzel (1955). Dans ce genre d’approche, les prototypes de mises en page s’articulent au sein d’un espace polarisé par deux axes: régularité/irrégularité, discret/ostentatoire. Suivant le modèle de Groensteen et de Peeters, la mise en page rhétorique correspond à un pôle situé dans le quart «irrégulier/discret» alors que le gaufrier se situe du côté «régulier/discret». Enfin, le pôle de la mise en page architecturée se situe sur le versant ostentatoire, mais à l’entrecroisement entre régularité et irrégularité.
Ce modèle possède la caractéristique de ménager des lieux intermédiaires, que l’on peut considérer comme des sous-types dérivant des trois pôles principaux. On peut ainsi mentionner les mises en page semi-régulières de Chavanne, qui partagent la discrétion des pôles rhétorique et du gaufrier tout en se situant à mi-chemin entre les deux dispositifs sur le plan de leur régularité. On peut aussi situer dans ces espaces intermédiaires des mises en page rhétoriques ou dérivant d’un gaufrier, mais qui partagent certains traits du pôle architecturé. Ce schéma circulaire permet enfin de décrire des variations observables localement au sein d’une même œuvre entre des mises en page susceptibles de s’écarter de manière plus ou moins ostensiblement de la matrice dont elles dérivent.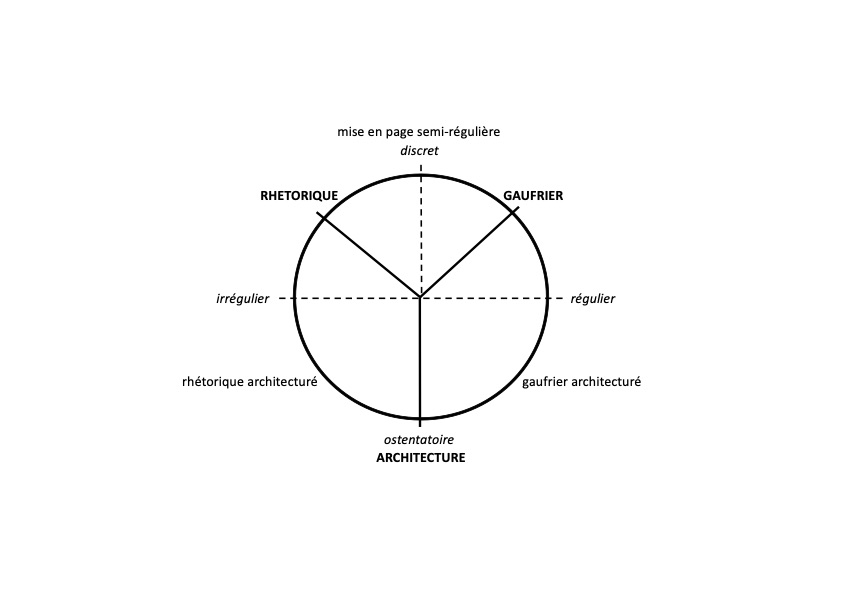 Schéma 1: Typologie circulaire des mises en page
Schéma 1: Typologie circulaire des mises en page
Notons malgré tout que quelques types de composition échappent à cette typologie, laquelle repose fondamentalement sur la possibilité de définir l’agencement d’une séquence d’information (généralement narrative) au sein d’une unité graphique de rang supérieur. Les bandes dessinées qui adoptent une mise en page flottante, c’est-à-dire dépourvue de cadres facilitant le repérage de l’agencement des cases dans l’espace de la planche, mais aussi les dispositions en ruban continu ou suivant une logique de diaporama – qui sont en train de devenir majoritaires dans le domaine de la production numérique14 – échappent à cette logique, car un tel mode de présentation, ainsi que l’explique Groensteen, «déterritorialise chaque image, masquant ou ruinant l'ensemble des liens tissés à la surface de la page» (2011: 72). Ces limites admises, nous allons voir comment l’analyse des mises en page dans un album tel que Le Long Voyage de Léna est susceptible de bénéficier de notre typologie. L’objectif ne sera pas, dans ce cas précis, de rattacher l’ensemble de l’œuvre à un pôle ou à un autre, mais plutôt de dessiner les contours d’une matrice permettant de souligner comment, localement, telle ou telle mise en page investit la dimension tabulaire de l’album en vue de produire tel ou tel effet ou de s’adapter à telle ou telle contrainte. La valeur essentielle de cette approche sera d’objectiver différentes manières d’occuper l’espace et de rendre ainsi possible l’interprétation de la valeur de chacune des compositions.
Mettre en page Léna
Déterminer la matrice à laquelle se rattache l’œuvre de Christin et Juillard n’est pas chose aisée dans la mesure où cette bande dessinée offre une grande diversité de mises en page. Un regard distant pourrait en conclure que l’irrégularité évidente de ces compositions renvoie à une matrice rhétorique, exemplifiée dès l’incipit. Dans cette première planche (qui correspond à la page trois de l’album imprimé), l’irrégularité apparente se révèle beaucoup plus complexe quand on l’analyse de manière plus détaillée en se penchant sur sa genèse.
 Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 3 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 3 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Image 2: Storyboard, planche 1 © André Juillard & Pierre Christin 2005
On constate que le storyboard, contrairement à la planche finale, présente une structure plus régulière, car on n’y trouve pas de variations au sein des cases du premier et du troisième strip. Dans ce travail préparatoire, on voit néanmoins que le gaufrier de base est modifié pour signifier graphiquement que Léna se trouve seule dans le tramway, l’élargissement du cadre permettant de montrer les sièges vides qui l’entourent. Ce procédé fait passer le strip d’un régime régulier de trois cases à une disposition en deux cases de formats différents. Si l’on observe la version finale, on constate que Juillard introduit une seconde variation dans le format des vignettes du premier strip et du troisième strip: les cases centrales montrant la protagoniste cadrée en «plan taille» apparaissent plus étroites que les cases situées sur les bords, qui sont davantage orientées sur la monstration du décor («plan moyen» ou «plan pied»). Cette irrégularité et ces correspondances thématiques produisent une symétrie axiale verticale et, pour les deux strips extérieurs, également horizontale, ainsi qu’une symétrie centrale entre les quatre coins opposés de la page. Ces cases isomorphes et solidaires accentuent ainsi légèrement la visibilité de la dimension tabulaire, ce qui rapproche la configuration du pôle architecturé. On voit ainsi comment deux phases d’élaboration d’une même planche, en dépit de variations que l’on pourrait juger quasi imperceptibles, peuvent néanmoins se situer différemment par rapport à différents pôles de notre typologie, laquelle contribue ainsi à visibiliser le travail graphique du dessinateur: dans un premier état, un gaufrier devient semi-régulier par la fusion de deux cases, ce qui le rapproche du pôle rhétorique, puis dans la mise en page finale, on observe un glissement vers le pôle archtiecturé par un jeu de correspondances formelles et thématiques construisant des effets de symétrie au sein de l’irrégularité du dispositif.
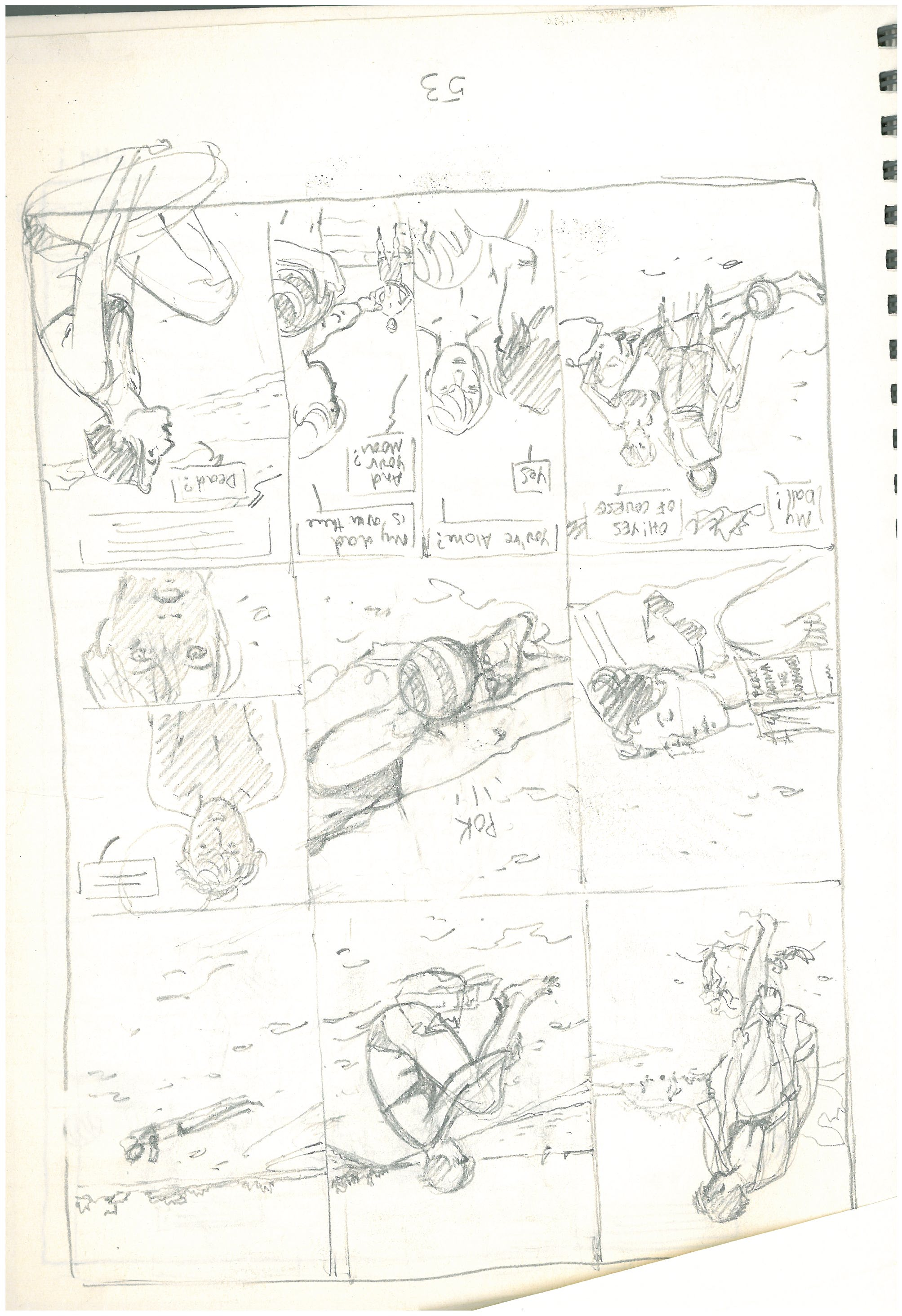
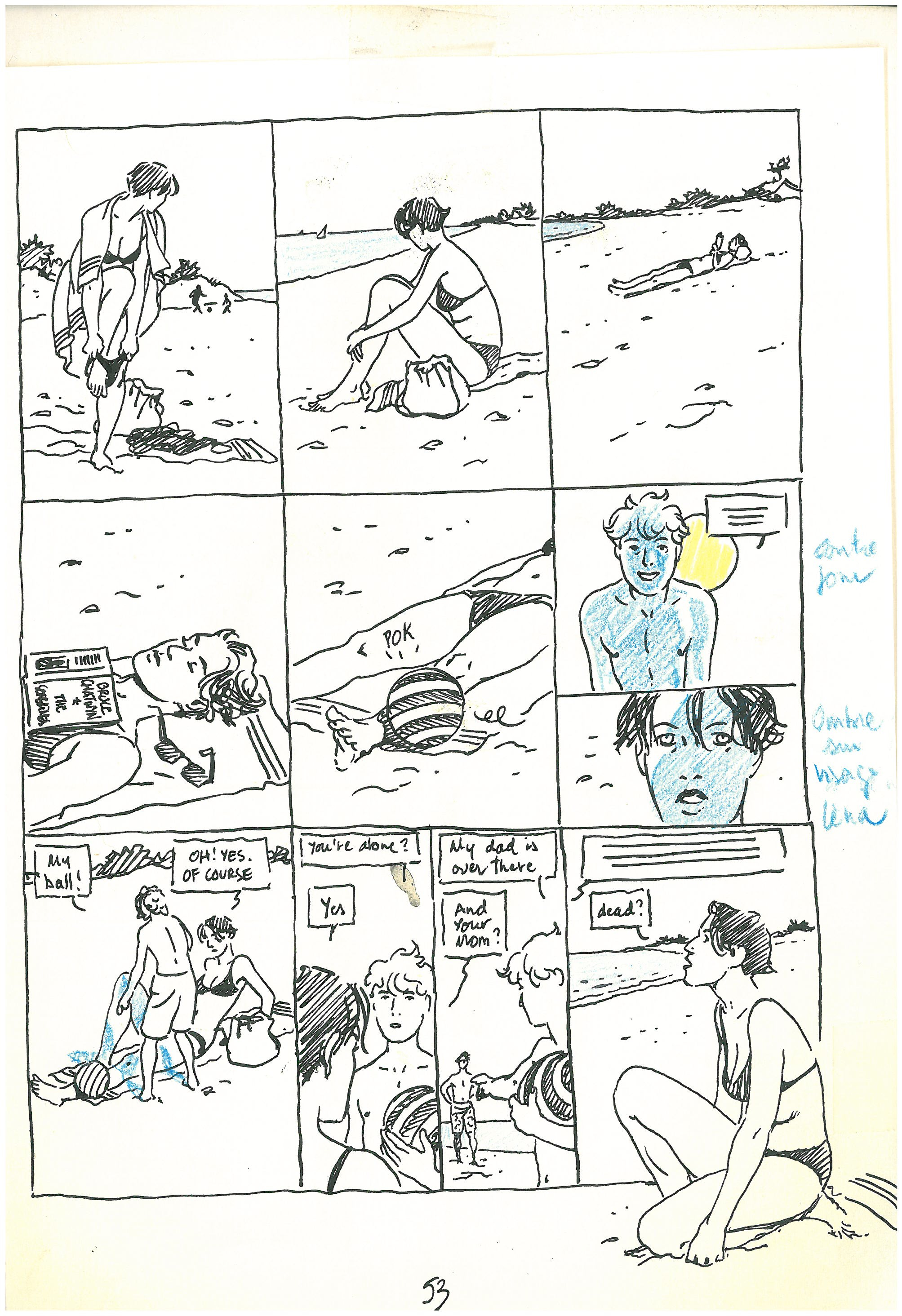
Images 3 et 4: Storyboard, planches 53 et 53bis
© André Juillard & Pierre Christin 2005
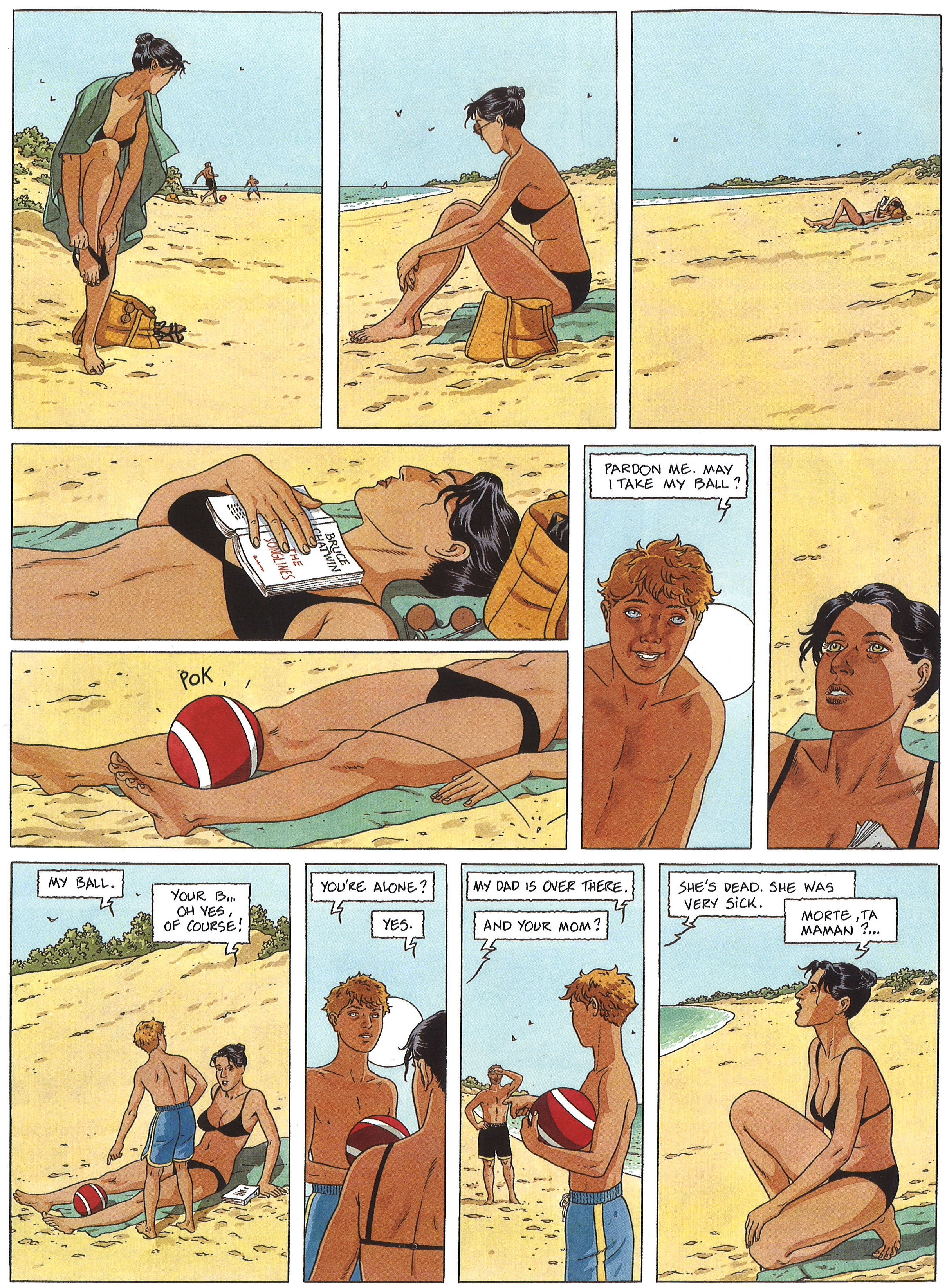
Image 5: Le Long Voyage de Léna, p. 55
© Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
On observe la même tendance à s’écarter du gaufrier dans les planches finales de l’album, l’effet étant particulièrement visible dans la version «encrée» du storyboard, car le tracé du stylo rend le cadre des cases plus ostentatoire15. À cette étape, on perçoit encore clairement la présence du gaufrier, qui a évolué par fragmentation horizontale et verticale pour s’adapter au contenu du scénario. On constate en outre, dans la dernière case, que le corps de Léna déborde du cadre au lieu que celui-ci s’adapte à son contenu. D’un côté, ce débordement crée un effet architectural dans le storyboard en créant un contraste ostentatoire avec le reste de la page, mais d’un autre côté, cela montre que nous sommes encore très éloignés du pôle rhétorique, puisque la case ne s’adapte pas à son contenu, l’auteur devant se résoudre à réduire le corps de Léna dans la version ultérieure pour la «recadrer».
En dépit de cette contrainte, évidemment plus forte sur la dernière case de la planche, la régularité matricielle du gaufrier finit par disparaitre presque complètement dans la version finale, qui offre une beaucoup plus grande hétérogénéité compositionnelle. On constate notamment, dans les cases 4 et 5, que le corps de Léna, qui est allongée sur le sable, impose une reconfiguration débouchant sur une superposition verticale de vignettes au format oblong, qui s’adaptent à leur sujet tout en s’écartant de la grille de départ, qui n’est plus perceptible que dans le premier strip. Dans les versions encrée et crayonnée, le découpage vertical et horizontal ne faisait pas «déborder» les cases du gaufrier, alors que dans la version finale, le strip du milieu présente une variation importante puisque les cases horizontales sont plus courtes que la somme de deux cases, ce qui laisse plus de place pour élargir les deux cases verticales de la fin du strip, qui peuvent ainsi déborder d’une simple case coupée en deux.
En amont du travail de composition auquel procède André Juillard, le scénario rédigé par Pierre Christin propose également un découpage qui témoigne déjà d’une réflexion sur la mise en espace du récit. Alors que le synopsis se présentait sous la forme d’un texte continu, organisé en paragraphes et en lignes de dialogues, le scénario est quant à lui segmenté en cases et en pages. Il est frappant de constater que les planches sont comptées par paires16 (2-3, 4-5, 6-7, etc.), ce qui montre que le scénariste pense d’emblée le récit en fonction des unités graphiques du produit final17. Pour chaque double page, Christin segmente ensuite le contenu en une quinzaine de cases adoptant une numérotation continue, laissant au dessinateur le choix de déterminer le lieu de l’articulation entre les deux planches. On constate d’ailleurs que les annotations manuscrites de Juillard induisent un redécoupage du scénario à partir du travail sur le storyboard: le dessinateur détermine d’abord la charnière entre les planches et procède ensuite à une renumérotation des cases pour la page de droite. 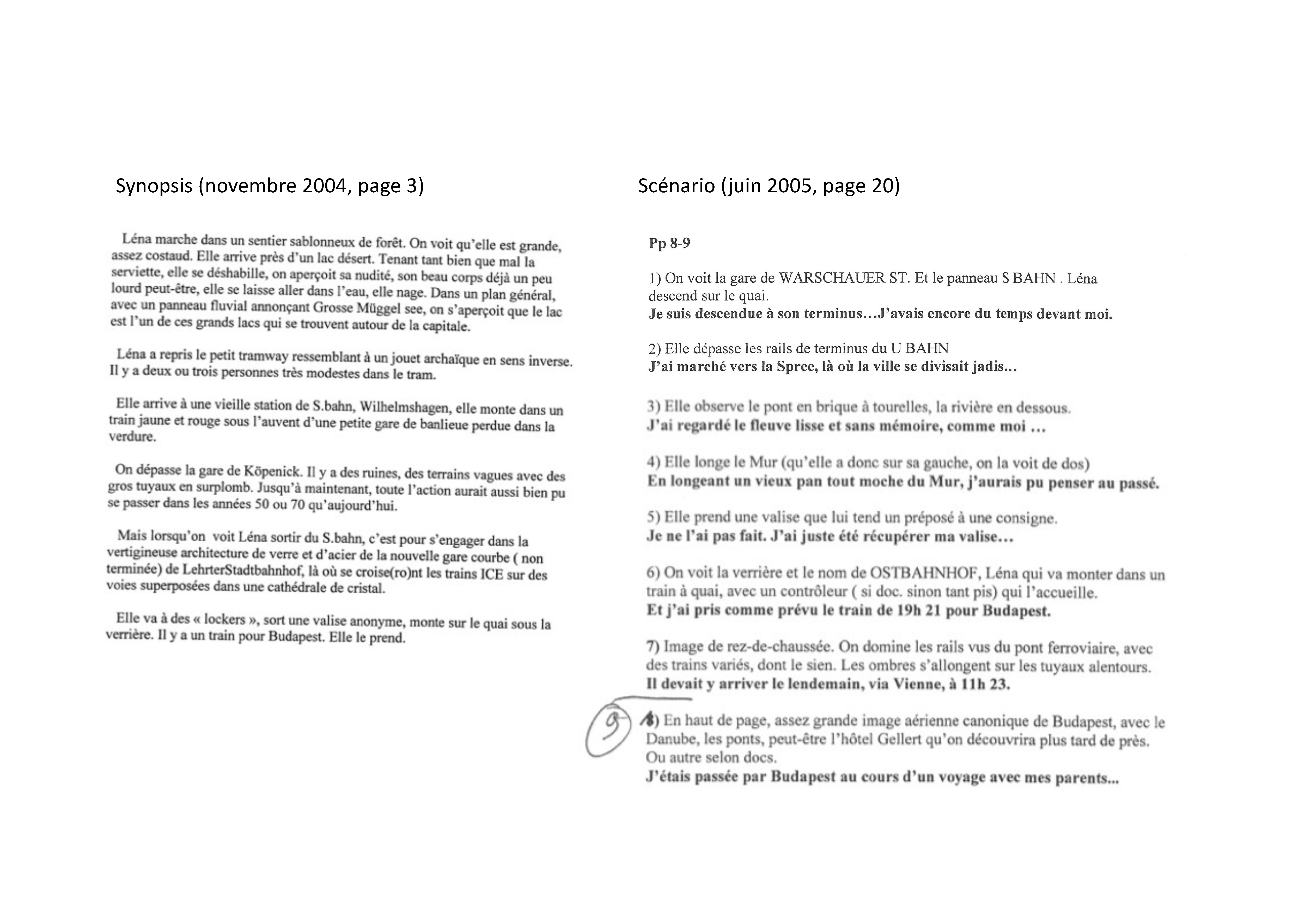
Image 6: synopsis et scénario
© André Juillard & Pierre Christin
Quant au choix de Christin de segmenter les doubles pages en une quinzaine de cases, il se fonde probablement sur un principe d’approximation. Ainsi que l’a précisé Juillard dans un entretien, ce scénario a été écrit sur mesure pour un dessinateur dont les œuvres les plus connues – par exemple sa série Les sept vies de l’épervier ou Le Cahier Bleu, qui lui a valu en 1995 le prix de l’Alph-Art au festival d’Angoulême – s’organisent généralement selon un format assez caractéristique: une mise en page en trois strips, que l’on peut qualifier d’aérée et qui met en valeur le dessin de Juillard, lequel apprécie de représenter des corps aux proportions réalistes dans des décors détaillés, ce qui exige de disposer de plus d’espace que ce que pourrait offrir un découpage sur quatre strips, pourtant assez répandu dans la bande dessinée franco-belge. En cela, Juillard apparait bien comme l’héritier d’Edgar P. Jacobs – dont il a d’ailleurs repris la série Blake et Mortimer – et non comme un continuateur du style d’Hergé, qui avait une approche beaucoup plus rhétorique18. Pour Juillard, une double page canonique consiste donc en une composition articulant deux grilles construites sur une matrice de trois bandeaux de trois cases, soit environ dix-huit cases, qui lui permettent ensuite de moduler des effets, soit à des fins rhétoriques, soit pour architecturer l’espace, souvent en jouant sur des effets de symétrie. Ce qui explique la raison pour laquelle Christin propose généralement trois ou quatre cases de moins que les dix-huit du gaufrier matriciel, c’est qu’il a conscience que le scénario, notamment quand il inclut de longs dialogues ou des récitatifs, exige un étalement de la matière narrative. Cet étalement peut impliquer une fragmentation du contenu en plusieurs «moments» (ce qui conduit à une augmentation du nombre de cases prévues par le scénario) ou une dilatation de la case (ce qui réduit le nombre de cases par rapport à la grille de départ). Par ailleurs, Christin compose avec le fait que le dessinateur doit conserver la liberté d’insérer des cases supplémentaires, fondées sur ce que l’on pourrait appeler des idées graphiques, auxquelles le scénariste n’aurait pas pensé mais qui peuvent surgir au moment de la création du storyboard ou lors de sa reconfiguration lors de l’élaboration de la planche finale.
Si l’on observe le passage du scénario (image 6) au storyboard (image 7), puis à la mise en page finale (image 8), la huitième planche passe ainsi de sept segments à neuf, puis dix cases. On voit notamment que la cinquième vignette est fragmentée in extremis pour isoler la monstration d’un pan du mur de Berlin, dont la nudité coïncide avec le récitatif «Je ne l’ai pas fait». Cette segmentation renforce à la fois l’effet de «virgule» au sein du récitatif, mettant la phrase en saillance, tout en invitant à associer la nudité du mur avec la présence silencieuse d’une pensée refoulée.
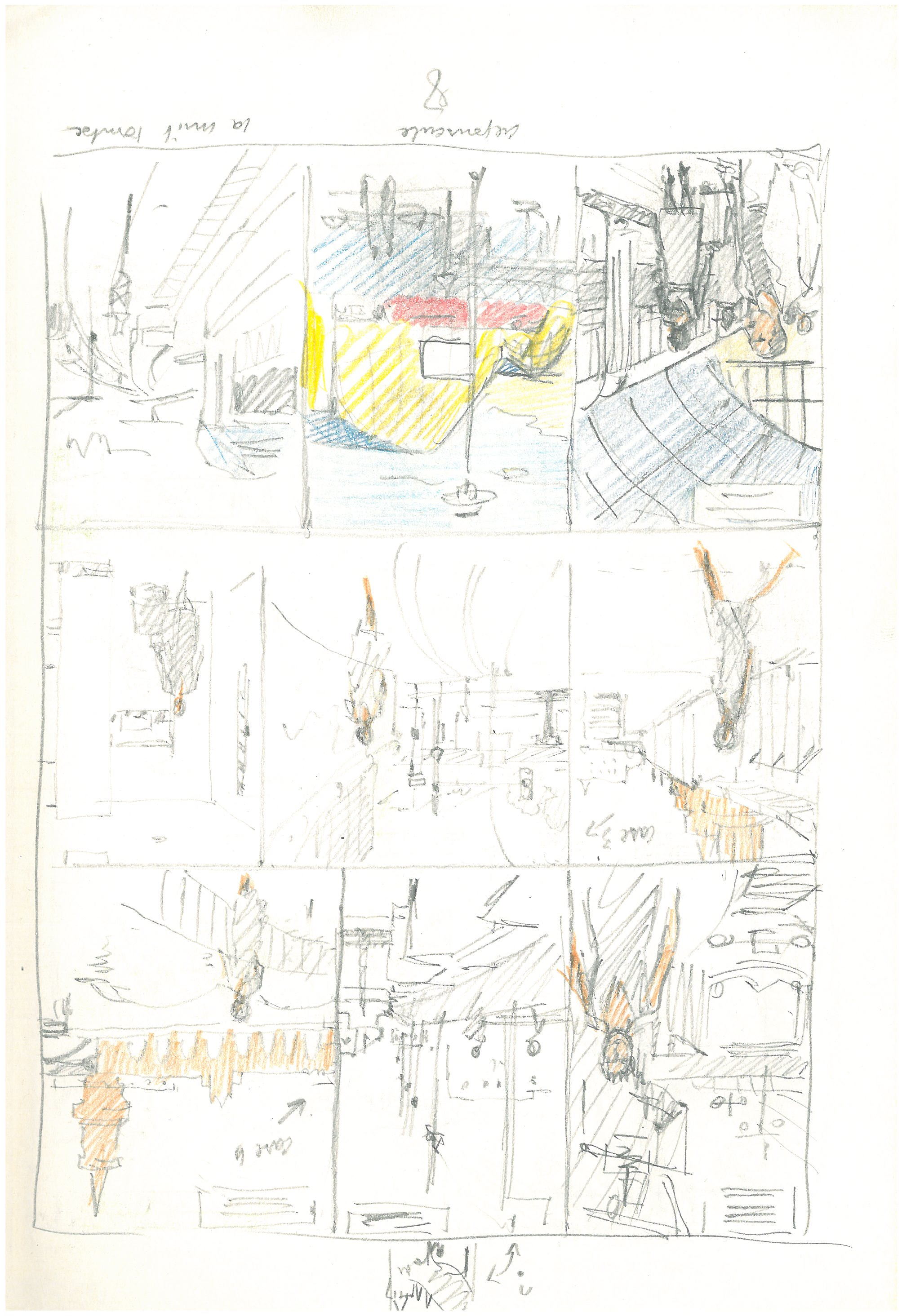
Image 7: Storyboard, planche 8 © André Juillard & Pierre Christin 2005

Image 8: Le Long Voyage de Léna, p. 10 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
On constate ainsi que les notions de matrice et de mise en page régulière et semi-régulière s’avèrent particulièrement opératoires pour définir le processus de création de l’œuvre, même si, dans la version publiée, l’album se situe davantage sur le rhétorique ou architecturé. L’espace graphique se construit progressivement sur la base d’un gaufrier de neuf cases, réparties en trois bandes, qui correspond à une sorte de modèle par défaut sur lequel se fondent aussi bien le dessinateur que le scénariste pour déployer la matière de leur récit. Ajoutons que cette matrice confère une sorte rôle hiérarchique par défaut à la cinquième case, du fait de sa position centrale dans la page, et cet effet est souvent accentué graphiquement ou exploité narrativement lors du passage du scénario à la mise en page finale. L’existence de cette matrice facilite indéniablement la coordination entre les deux auteurs et l’engendrement du récit graphique. On peut aller jusqu’à avancer que cette matrice rythme l’imaginaire de Juillard, comme elle organise l’univers graphique des références dont il s’inspire, sous la figure tutélaire de Jacobs. À partir de cette grille de départ, l’auteur peut procéder à divers ajustements pour occuper de manière optimale l’espace dont il dispose, ce qui oriente – suivant les options choisies – sa mise en page vers les pôles rhétoriques ou architecturés. Si ce gaufrier matriciel est parfois bien visible dans le storyboard, le second niveau de configuration, rattachable à la planche finale, opérera presque invariablement un glissement vers d’autres pôles19.
Si j’ai insisté dans un premier temps sur les ajustements de nature rhétorique que l’on observe non seulement dans l’incipit et l’excipit, mais également dans presque toutes les planches bavardes, qui doivent composer avec un espace saturé de textes, Juillard ne manque pas d’explorer des configurations paginales nettement plus ostentatoires. C’est le cas en particulier dans les planches les plus silencieuses de l’album, qui sont presque toutes fortement architecturées. Pour construire ces planches, Juillard exploite notamment des effets de symétrie centrale ou axiale produits par la variation des cases ou par des contrastes visuels ou thématiques, mais il exploite aussi souvent la valeur hiérarchique de l’image située au milieu de la planche.
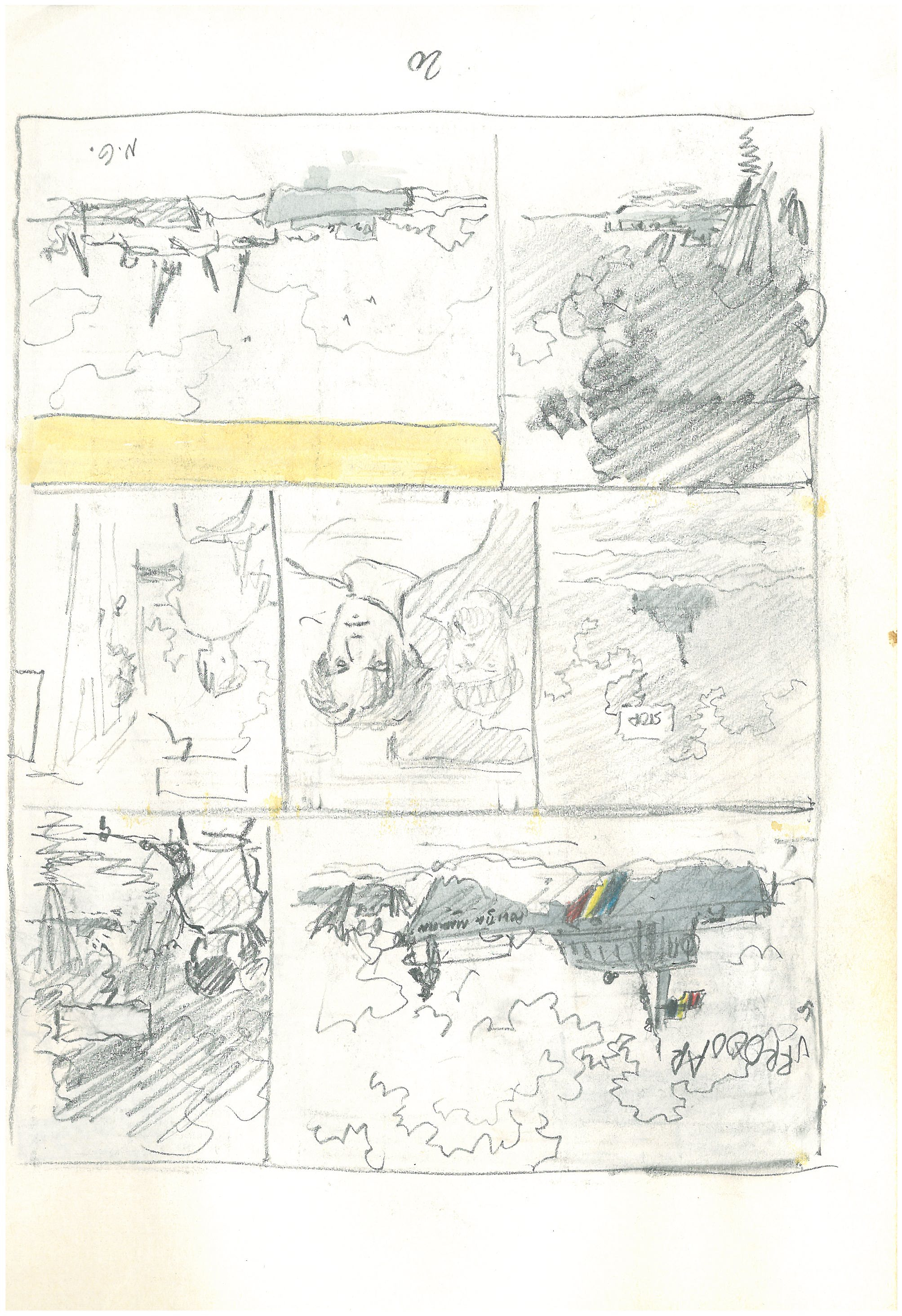
Image 9: Storyboard, planche 20 © André Juillard & Pierre Christin 2005
Ces effets sont exploités dans la vingtième planche, où Juillard joue sur un allongement de la première et de la dernière case pour insérer le dessin détaillé de navires associés à un paysage maritime. Cette déformation construit un effet de symétrie centrale, invitant à contempler la structuration globale de la planche, dont le cœur est occupé stratégiquement par une représentation de l’héroïne. Même si l’isomorphisme du premier et du dernier strip n’est pas parfait, la proximité thématique du contenu des cases renforce la correspondance entre deux segments éloignés du récit qui cadrent la séquence. On remarque aussi, dans la diagonale opposée, un rapprochement entre les arbres de la mangrove, qui se répondent et dont la verticalité contraste avec l’horizontalité des navires. Cette planche montre également que l’effet d’achitecturation de l’espace est davantage prégnant dans ces pages en raison de leur thématique, dans la mesure ou le récit, très silencieux, invite davantage à une contemplation du monde représenté qu’à une lecture linéaire des événements de l’histoire.
Ce procédé va se généraliser vers la fin de l’album, en particulier dans les pages 46 à 54 (qui correspondent aux planches 44 à 52 dans le scénario). Ces pages, pratiquement muettes, se composent selon un principe presque invariant: la construction d’une symétrie axiale verticale à l’échelle globale de la planche (à deux ou trois exceptions près, notamment, pour des raisons clairement rhétoriques, dans le troisième strip de la page 48) et un portrait de Léna, dans une case étroite située centre de la planche, dont le format ne varie jamais, renforçant un effet de tressage iconique entre les pages. Cette architecture est particulièrement visible aux pages 46, 47, 52 et 54, dans la mesure où elle est renforcée par l’isomorphisme des strips 1 et 3 et par le caractère totalement silencieux des images, qui favorise un régime de lecture moins linéaire.

Image 10: Le Long Voyage de Léna, p. 52 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Dans les pages 48 à 53, cette case centrale fonctionne sur le modèle du montage alterné au cinéma: elle insère une référence au voyage en avion de l’héroïne au cœur de la scène focalisée sur les terroristes, quand bien même ces deux évènements ne se déroulent pas dans le même chronotope. Dans ce cas, on peut ajouter que le caractère architecturé de l’espace est renforcé par l’apparence de la vignette centrale, dont l’étroitesse et l’ambiance nocturne du voyage en avion de Léna contraste avec le contexte diurne et très lumineux des cases plus larges qui représentent l’action des terroristes. On peut également signaler l’effet découlant de la récurrence du procédé dans le degré de saillance de la configuration paginale.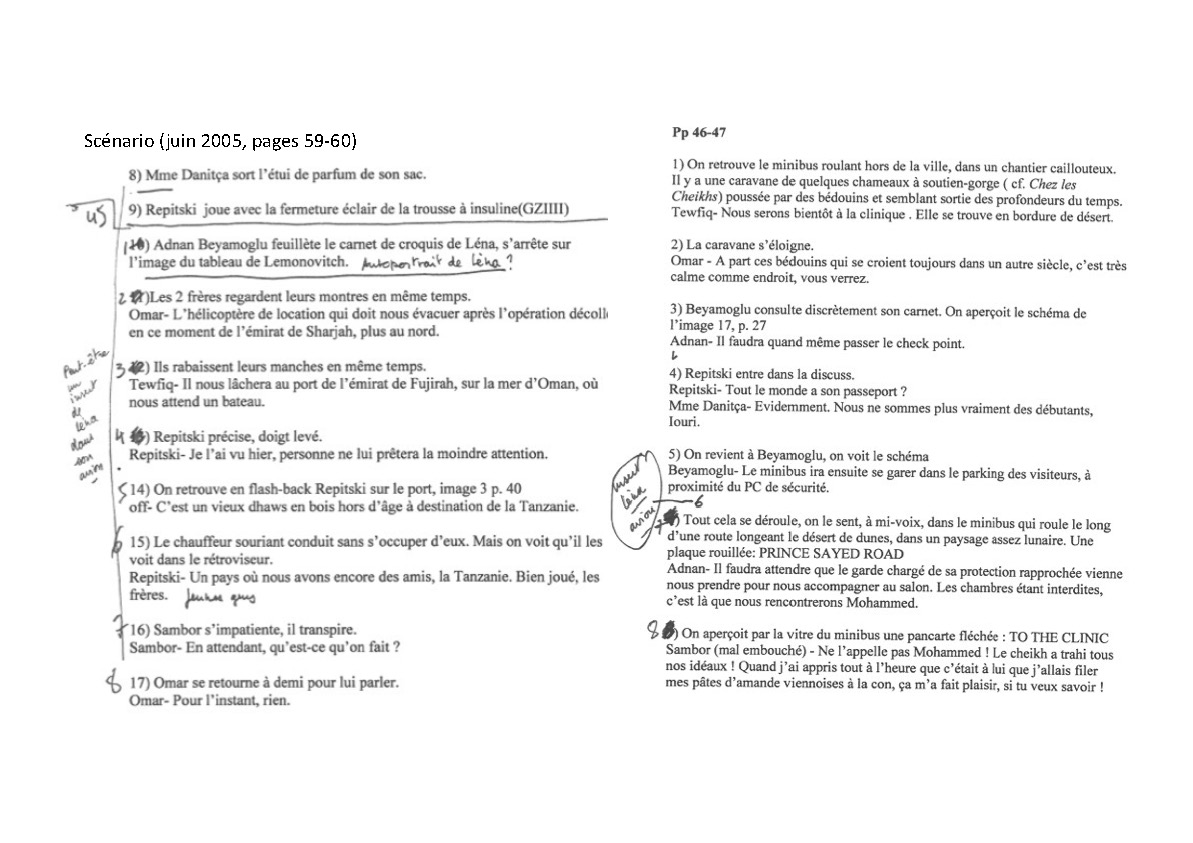
Image 11: scénario du Long Voyage de Léna © André Juillard & Pierre Christin
Il est frappant de constater que cette idée, que l’on pourrait qualifier d’éminemment graphique, est trouvée par Juillard, qui est alors amené à transformer le scénario de Christin pour ajouter ces «inserts» de Léna. Lors d’un entretien qu’il nous a accordé, le dessinateur assume d’ailleurs la paternité de cette idée et en explique l’intérêt narratif:
Cela ne vient pas de Pierre Christin. Ce n’était pas dans le scénario. Cela vient de moi qui avais envie que Léna reste présente. […]C’était une façon de montrer que sa mission continuait bien qu’elle ne soit pas là.
La première occurrence est assez subtile, dans la mesure où Juillard suggère de remplacer un dessin de Lénine par un autoportrait de Léna, de sorte que la contemplation en surcadrage de ses croquis conduise à la replacer au cœur de la planche20, avant que le «montage alterné» se mette en place. L’effet est renforcé par un tressage iconique à l’échelle de la double page: dans la case correspondante de la page précédente, on trouve en effet un autre portrait de Léna, qui la montre installée dans son avion et située au lieu stratégique où le récit bascule d’un régime de focalisation exclusivement centré sur elle, à une perspective qui suivra ensuite le déroulement de l’action des terroristes. Dès la page suivante, Juillard introduit donc systématiquement, au sein du découpage proposé par Christin, une case supplémentaire avec la mention «insert Léna avion», tout en s’arrangeant pour la situer au milieu de la planche et pour l’inscrire dans une série de cases centrales isomorphes. Cet insert est d’ailleurs souligné graphiquement dans le storyboard par l’usage d’une couleur bleue, ajoutée à l’aquarelle, qui vient mettre en évidence la case ou le «dessin21» montrant Léna dans une section du récit où elle est paradoxalement absente ou passive.
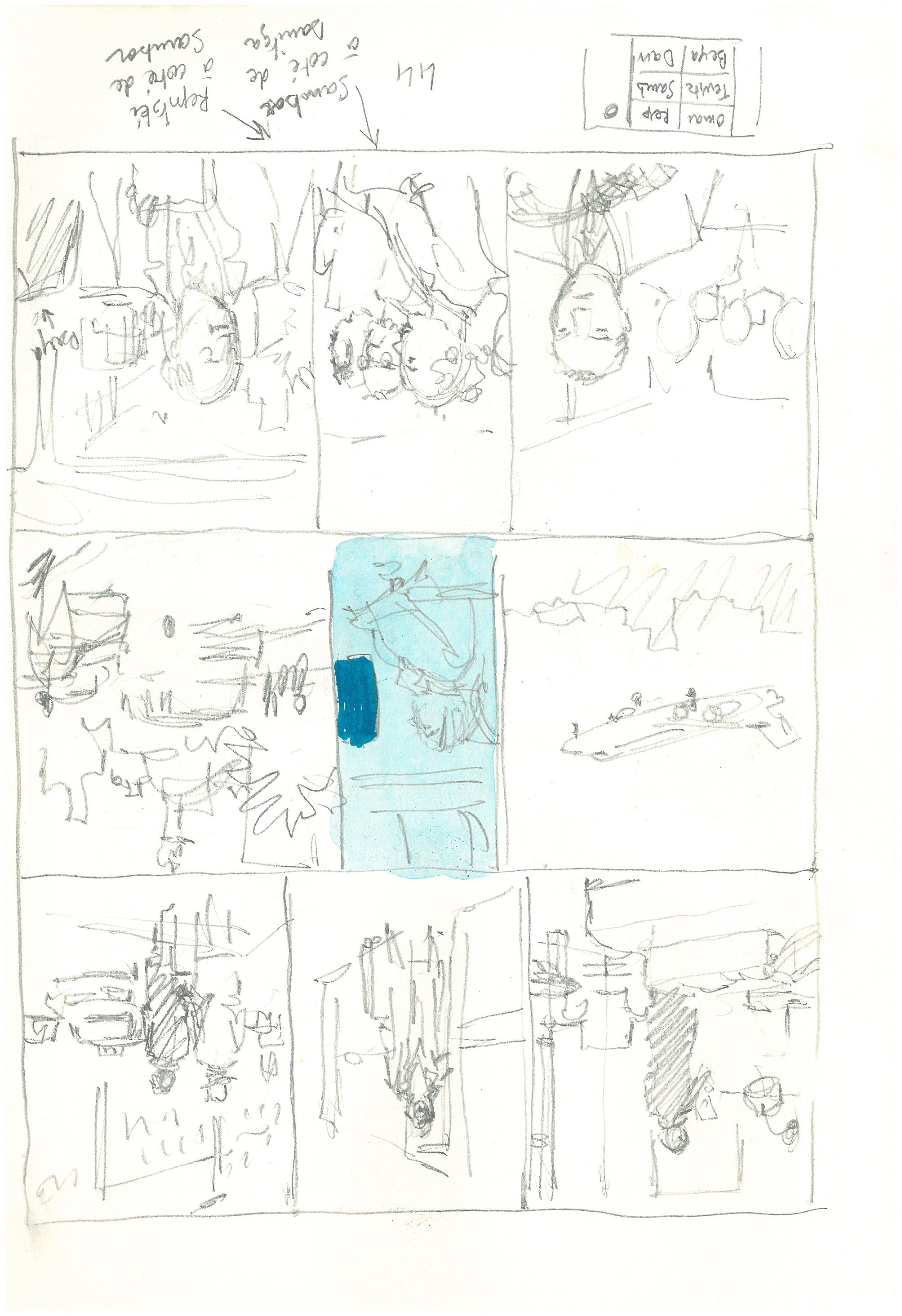
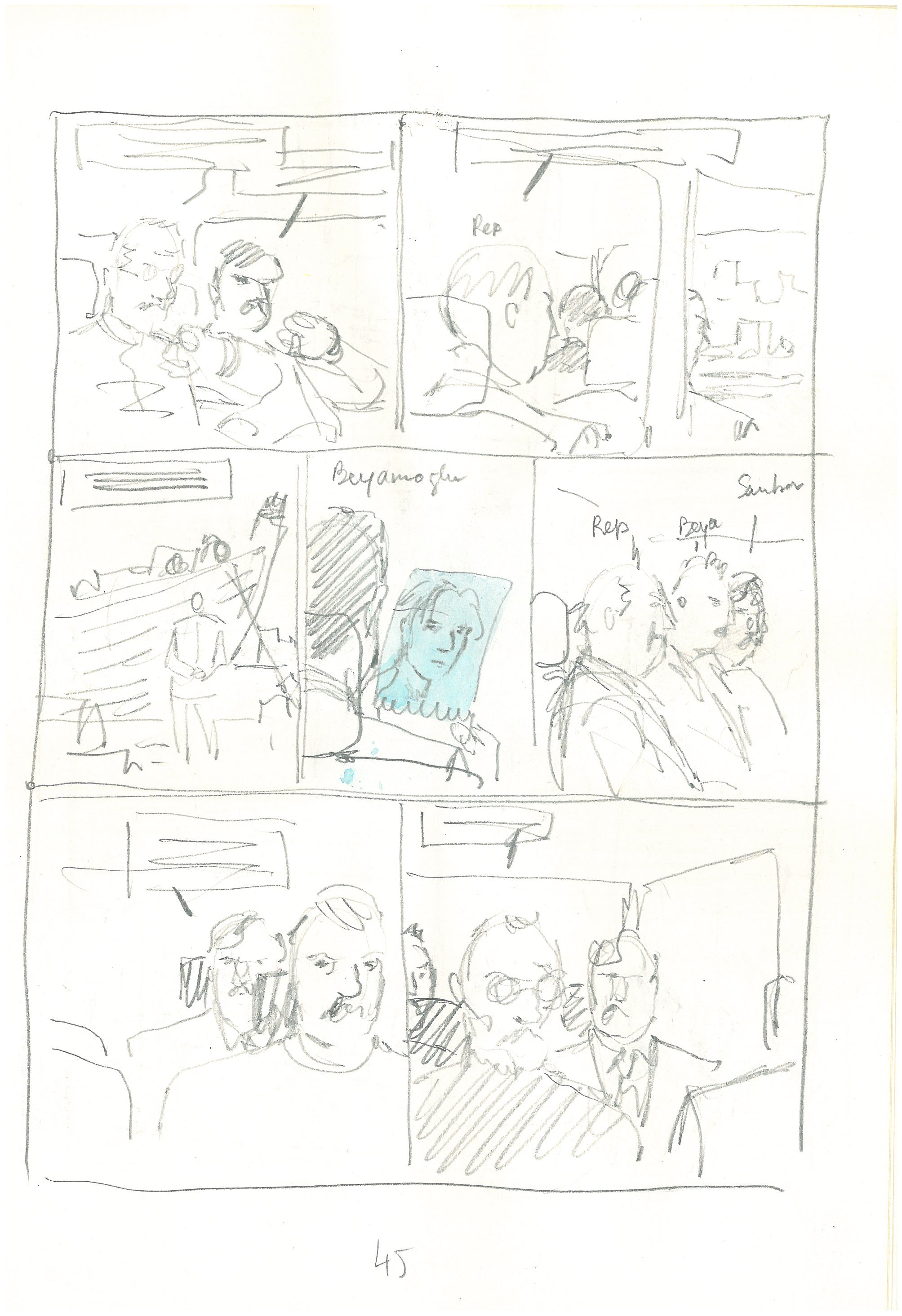
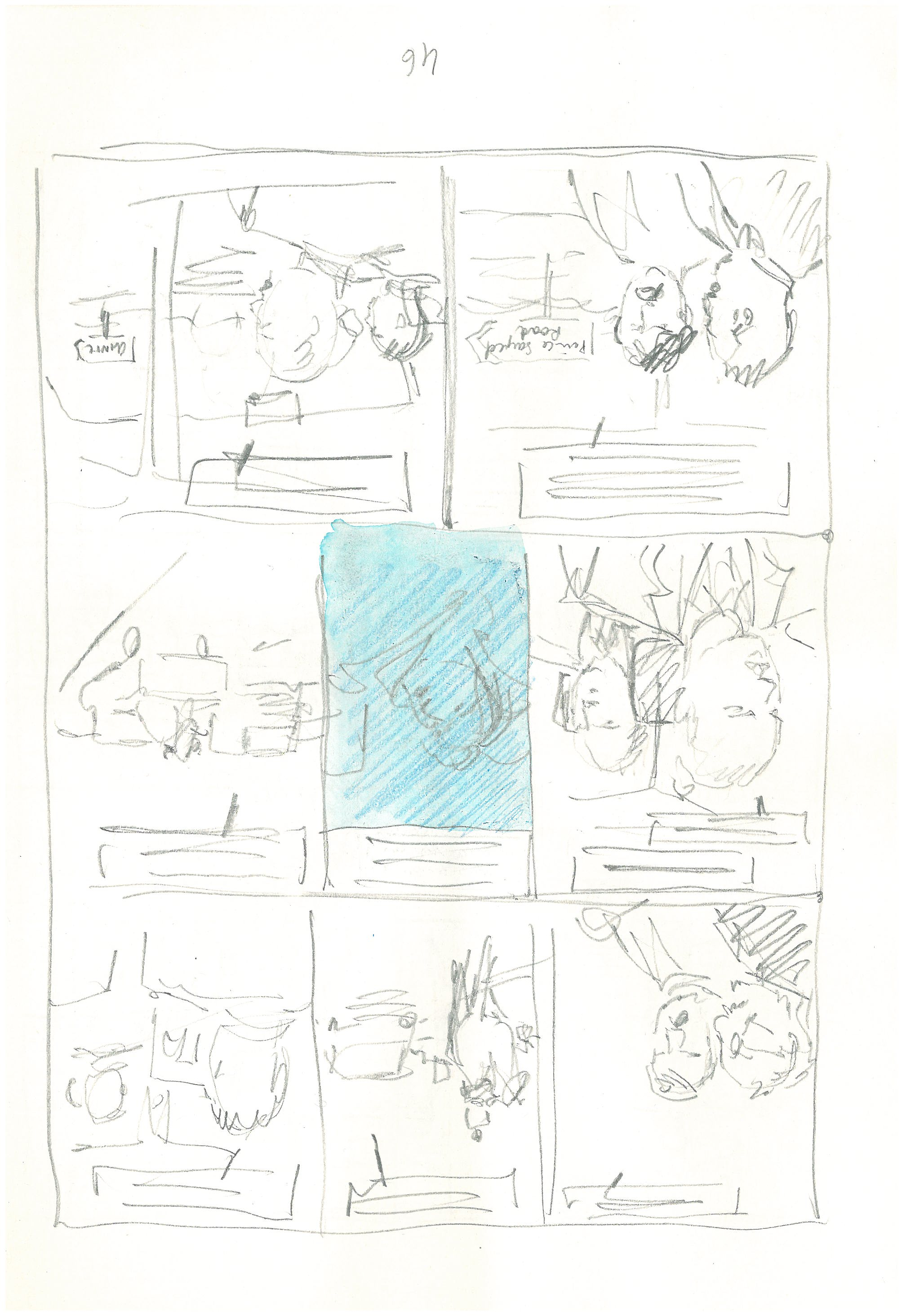
Images 12, 13, 14: Storyboard des planches 44 à 46 © André Juillard & Pierre Christin 2005
On peut enfin mentionner la manière très intéressante dont Juillard exploite localement le gaufrier, qui passe du statut de matrice occultée au rôle de dispositif ostentatoire. Ici, la composition régulière devient saillante, en partie en raison du contexte dans lequel elle s’insère: au sein de l’album, le gaufrier, qui s’étale brusquement sur une double page, tranche avec les compositions antérieures, et cet épisode se distingue aussi par sa fonction dans l’intrigue. De nombreux mystères sont dénoués: Léna décline sa véritable identité, explique ses motivations et finit par révéler l’identité des personnages figurant sur la photo de la case 6, qui avait été montrée comme un leitmotiv aux pages 15, 20, 27 et 32.
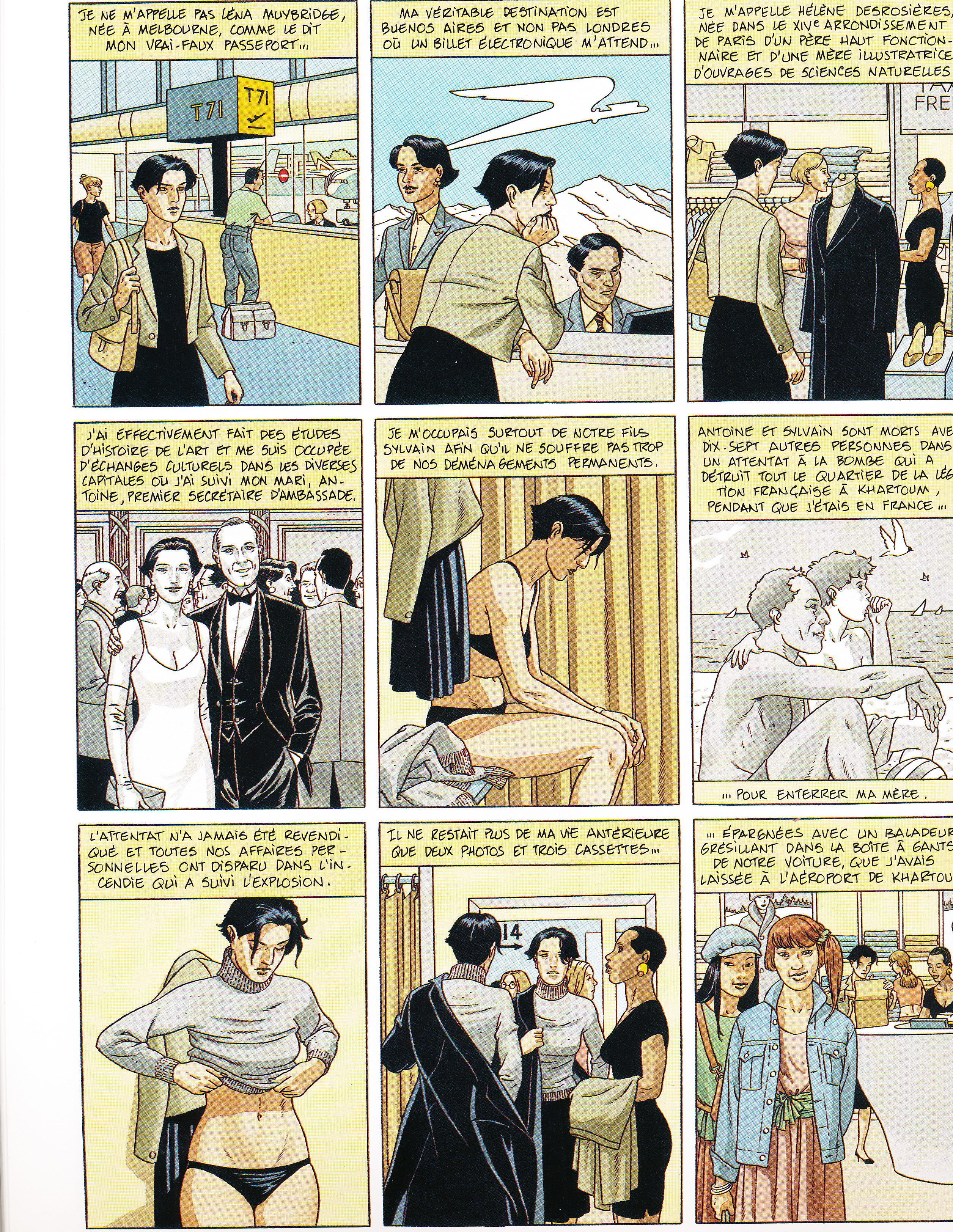
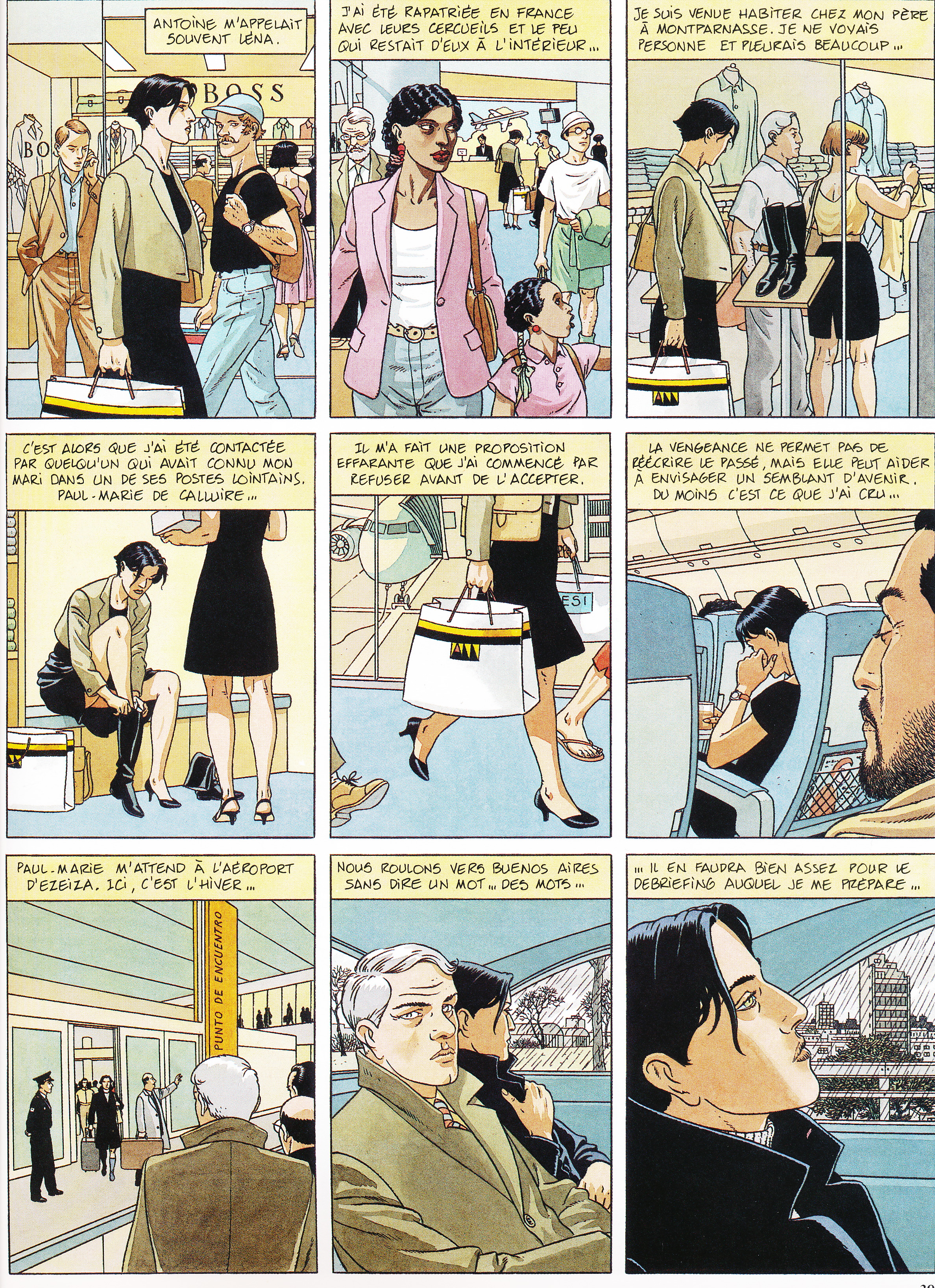
Images 15 et 16: Le Long Voyage de Léna, p. 38-39 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Les pages 38 et 39 sont donc les seules de l’album à adopter ce plan strict du gaufrier et elles tranchent aussi formellement par l’usage systématique du récitatif et l’absence de dialogues. On voit comment Juillard met à profit la valeur expressive du gaufrier, au lieu de le déformer pour l’adapter aux contraintes de son récit. L’absence de variation dans la dimension des cases donne l’impression que les images ne sont pas vraiment coordonnées, qu’elles ne s'imbriquent pas dans la structure organique de la page, ce qui renforce l’effet d’un rythme régulier et dépourvu de relief. Les images deviennent illustratives (quand elles montrent les photos de l’époux ou du fils de Léna) ou anecdotiques (quand elles montrent Léna achetant des vêtements et prenant l’avion). Ce que l’on peut considérer comme un sommaire graphique se subordonne à la voix l’héroïne, sur laquelle repose entièrement la progression narrative. Léna semble perdue dans ses pensées: on la montre méditative, se laissant porter par l’accomplissement d’actions routinières, désormais dépourvues d’importance. L’intrigue est déjà dénouée pour elle. La composition graphique de cette séquence semble ainsi renforcer la perspective distanciée d’une voix over fatiguée, qui peut enfin libérer des pensées réprimées et laisser derrière elle les tensions inhérentes à l’accomplissement de sa mission.
Conclusion
Le modèle que je propose d’introduire pour l’analyse de la mise en page apparait finalement davantage comme un perfectionnement ou une réarticulation des modèles antérieurs que comme une véritable rupture avec ces derniers. La typologie circulaire intègre en particulier les critères dégagés par Groensteen, à savoir le caractère plus ou moins régulier ou ostentatoire du dispositif, tout en reprenant les catégories rhétorique, régulière et semi-régulière de Peeters et Chavanne, ainsi que la notion de matrice introduite par ce dernier. Enfin, ce qui est peut-être encore plus important, ce modèle se fonde sur un principe qui se trouve au cœur de l’approche de Peeters, à savoir que la déformation d’une case au sein d’un système fondé sur la répétition produit une irrégularité qui peut s’expliquer de deux manières différentes: soit elle répond à la nécessité d’adapter le cadre de l’image au contenu représenté (ce qui correspond au pôle rhétorique), soit elle vise à accentuer la dimension tabulaire de la planche en produisant des effets que l’on peut qualifier de décoratifs ou de productifs (ce qui la fait basculer du côté de l’architecture).
La principale innovation, déjà suggérée par Chavanne, tient au caractère progressif des catégories retenues, qui sont redéfinies comme des pôles au sein d’un continuum plutôt que comme des unités discrètes formant un tableau à double entrée. La seconde innovation repose sur l’introduction d’un nouveau prototype, que j’ai appelé mise en page architecturée. En soi, ce pôle n’est pas entièrement original car il découle de la fusion des types décoratif et productif, que je place sur le versant ostentatoire des compositions semi-régulières. En outre, il dérive des nombreuses études ayant souligné la parenté entre architecture et mise en page dans un médium tel que la bande dessinée. L’usage du qualificatif architecturé vise avant tout à définir un principe formel qui se trouve au fondement des mises en page ostentatoires. Ce principe repose sur la possibilité de déceler la présence d’une régularité au sein de l’irrégularité en changeant d’échelle, ce qui revient à décrire une configuration créative de la planche, qui s’écarte peu ou prou des structures conventionnelles, c’est-à-dire de la régularité du gaufrier ou du caractère apparemment aléatoire (car lié à des contraintes locales) des variations de la mise en page rhétorique.
Pour devenir pleinement opératoire, ce modèle devra probablement évoluer, être clarifié et simplifié. D’un point de vue terminologique, on pourra par exemple regretter que les trois pôles soient labellisés avec des termes qui n’appartiennent pas au même paradigme. Peut-être vaudrait-il mieux substituer au substantif gaufrier l’adjectif régulier. Avec le recul, l’adjectif rhétorique n’est peut-être pas si transparent, en dépit de son usage courant chez les spécialistes, car il suggère la présence d’un effet sur le lecteur, ce qui le placerait sur un versant plus ostentatoire. Pour aller plus loin dans la transposition didactique, on pourrait aussi s’émanciper davantage des principes dont dérive le modèle, par exemple en abandonnant la mention des axes de la régularité et de l’ostentation, au profit d’une description plus empirique des trois prototypes et des compositions intermédiaires.
À ce stade, la valeur que l’on peut reconnaitre à ce modèle en devenir est d’offrir un outil suffisamment souple pour dépasser l’impression que la mise en page d’un album tel que Le Long Voyage de Léna serait uniforme ou simplement rhétorique. Il permet au contraire de saisir les nuances locales qui font glisser le dispositif vers tel ou tel pôle, tout en montrant comment les pages dérivent d’une matrice plus ou moins identifiable. Il n’est évidemment pas toujours possible de disposer de documents génétiques permettant de remonter à cette matrice, mais dans de nombreux cas, il est possible d’en déduire les contours en repérant au fil des pages des invariances sur lesquelles repose l’imaginaire graphique de l’auteur. Toutefois, même si l’analyse des planches ne permet pas de définir un principe génétique sous-jacent, ce modèle permet de classer chaque mise en page à une plus ou moins grande distance de tel ou tel pôle, ce qui permet à la fois d’objectiver les éléments formels caractérisant la composition, tout en réfléchissant aux effets produits par ce dispositif. Pour rendre le cercle typologique plus lisible – à l’instar du cercle des situations narratives de Stanzel –, on pourrait en proposer des déclinaisons illustrées en disposant différents types de planches à une plus ou moins grande distance des trois pôles fondamentaux, dont le sens s’éclairerait de manière plus empirique que théorique.
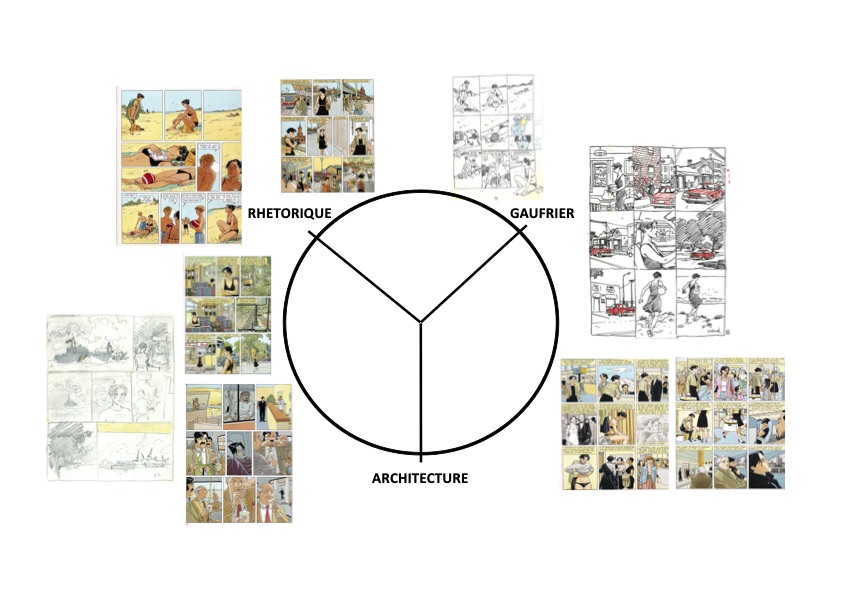
Schéma 2: Classement des planches dans un cercle typologique simplifié
En lien avec l’imaginaire graphique de Juillard, lui-même en partie dérivé des mises en page de Jacobs, j’ai beaucoup insisté sur les effets de symétrie architecturant la planche, mais il y a bien d’autres manières de produire des effets similaires, en jouant sur les contrastes entre les cases ou sur leur contenu graphique. Il faut ajouter qu’il y peut y avoir, sur le pôle des mises en page architecturées, d’importantes variations en termes de degré de visibilité et de complexité des structures, les cas les plus expérimentaux et les plus inextricables étant certainement incarnés par les compositions de Chris Ware. À l’opposé de cette esthétique du scriptible, Juillard déploie au contraire beaucoup d’efforts pour que les variations du gaufrier demeurent toujours très lisibles et même plus ou moins invisibles. L’architecture de la page doit ainsi accomplir ses effets sans nuire à l’immersion ou briser le rythme de la lecture et, en cela, elle reste assez conventionnelle. Ses compositions aérées et plus ou moins architecturées induisent néanmoins un rythme que l’on pourrait qualifier de contemplatif22, à l’instar du long voyage de Léna, qui apprécie de prendre son temps dans ses déambulations. Cette dernière commente son itinérance en ces termes: «Aller où je dois aller, même si c’est lent…» (p. 19). Les déplacements de l’héroïne à pied, à la nage, en train, en bus, en tram, en navire ou dans de vieilles voitures se situent ainsi aux antipodes de la passion hergéenne pour la vitesse mécanique23, mais ils sont au diapason de cette manière très personnelle dont André Juillard occupe l’espace de son médium et construit la lecture de ses albums.
Références
Amiel, Vincent (1986), «Bande dessinée et architecture: l’espace encadré», Les Cahiers de la bande dessinée, n° 69, p. 24-25.
Baetens, Jan (2016), «La question du rythme entre texte et bande dessinée: l’exemple de "Boule de Suif" dans Maupassant. Contes et nouvelles de guerre (Battaglia)», French Forum, n°14 (3), p. 289-301.
Baetens, Jan (2006), «Hergé, auteur à contraintes? Une relecture de L'Affaire», French Forum, n° 31 (1), p. 99-111.
Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.
Baetens, Jan & Kathryn Hume (2006), «Speed, Rhythm, Movement: A Dialogue on K. Hume’s Article "Narrative speed"», Narrative, n° 14 (3), p. 349–355.
Baetens, Jan & Pascal Lefèvre (1993), Pour une lecture moderne de la bande dessinée, Bruxelles, Centre Belge de la Bande Dessinée.
Baroni, Raphaël (2021), «Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée», Lettre de l’AIRDF, n° 68, p. 49-54.
Baroni, Raphaël (2018), «Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne: une segmentation précaire», Cahiers de narratologie, n° 34. En ligne, consulté le 12 août 2021, URL: http://journals.openedition.org/narratologie/8594
Baroni, Raphaël, Gaëlle Kovaliv & Olivier Stucky (2021), «La transition numérique de la bande dessinée. Une mutation impossible?», Belphégor, n° 19 (2). En ligne, consulté le 16 août 2021, URL: https://journals.openedition.org/belphegor/3948
Boillat Alain (2018), «Reflets des cités: les mondes en miroir (sans tain) de Schuiten
et Peeters», Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry, n° 38 (1-2), p. 141–162.
Chavanne, Renaud (2010), Composition de la bande dessinée, Montrouge, PLG.
Chavanne, Renaud (2005), Edgar P. Jacobs et le secret de l’explosion, Montrouge, PLG.
Chiss, Jean-Louis (2003), «La littératie: quelques enjeux d’une réception dans le contexte éducatif et culturel français», in La littéracie: conceptions théoriques et pratiques d'enseignement, p. 43-52.
Christin, Pierre & André Juillard (2006), Le Long Voyage de Léna, Paris, Dargaud, coll. «Long Courier».
Cohn, Jesse (2009), «Mise-en-Page: A Vocabulary of Page Layouts», in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 44-57.
Dufays, Jean-Louis (2017), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n° 45. En ligne, URL: http://trema.revues.org/3486
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2015), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 3e édition.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1976), «Du linéaire au tabulaire», Communications, n° 24, p. 7-23.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (2001), «Le réseau et le lieu: pour une analyse des procédures de tressage iconique», in Time, Narrative & the Fixed Image. Temps, narration & image fixe, J. Baetens & M. Ribière (dir.), Amsterdam, Rodopi, p. 117-129.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration. Système de la bande dessinée 2, Paris, PUF.
Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), «Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée», Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107. En ligne, consulté le 14 août 2021, URL: http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305/1807
Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.
Kukkonen, Karin (2020), «The Speed of Plot. Narrative Acceleration and Deceleration», Orbis Litterarum, n° 75 (2), p. 73-85.
Labio, Catherine (2015), «The Architecture of Comics», Critical Inquiry, n° 41 p. 312-343.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La littératie médiatique multimodale, Québec, Presses Universitaires du Québec.
Lefèvre, Pascal (2009), «The Conquest of Space: Evolution of Panel Arrangements and Page Layouts in Early Comics Published in Belgium (1880–1929)», European Comic Art, n° 2 (2), p. 227-252.
Letourneux, Matthieu (2017), Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil.
Marcoux, Marie-Hélène (2015), La BD au secondaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.
Marcoux, Marie-Hélène (2018), La BD au primaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.
Marion, Philippe (1997), «Narratologie médiatique et médiagénie des récits», Recherches en communication, n°7 p. 61-88.
Meyer, Jean-Paul (2019 [2012]), «À propos des albums de BD adaptés de romans: de la transposition littéraire à la transposition didactique», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, p. 157-170.
Missiou, Marianna (2019 [2012]), «Un médium à la croisée des théories éducatives: bande dessinée et enjeux d’enseignement», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Editions, p. 79-98.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Peeters, Benoît (1991), Case, planche, récit: comment lire une bande dessinée, Paris, Casterman.
Ricardou, Jean (1978), Nouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil.
Rosen, Elizabeth (2009), «The narrative intersection of image and text: teaching panel frames in comics», in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 58-66.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2019 [2012]), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, UGA Éditions.
Sohet, Philippe (2010), Pédagogie de la bande dessinée. Lecture d’un récit d’Edmond Baudoin, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Stanzel, Franz Karl (1955), Die Typischen Erzählsituationen im Roman, Wien, Braumüller.
Stucky, Olivier (2021), «La planche de bande dessinée comme interface: déplacer les rapports texte-image», Arkhaï, n° 16, p. 127-148.
Pour citer l'article
Raphaël Baroni, "Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022http://www.transpositio.org/articles/view/decrire-et-interpreter-l-architecture-graphique-des-bandes-dessinees-lena-mise-en-page
Voir également :
Sur Facebook