Les pratiques d’écriture créative méritent d’être pleinement (ré)investies dans l’enseignement du français au postobligatoire; de l’atelier ponctuel aux pratiques régulières, des exercices épisodiques aux évaluations formatives, voire certificatives. En voici une, laquelle relève cependant d’un projet d’établissement: le camp d’écriture.
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- Vanessa Depallens et Sonya Florey - Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande
- Claire Detcheverry - La narratologie transmédiale pour la lecture d’albums jeunesse au primaire
- Sandrine Aeby Daghé & Glaís Sales Cordeiro - Le système récit-personnages: un outil conceptuel pour penser l’enseignement de la compréhension en lecture
- Marie Béguin & Sonya Florey - Renouer avec la passion du récit avec (ou malgré) le schéma narratif au secondaire I
- Vanessa Depallens - Écrire un récit «réussi»: une des finalités de l’école obligatoire vaudoise. Le cas de la description
Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd
Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd
Ce texte présente un camp d’écriture organisé depuis plusieurs années dans une école du secondaire II genevois. Par l’entremise d’extraits de productions d’élèves, l’auteur discute des avantages didactiques de ce genre d’approche de l’écriture créative.
Les pratiques d’écriture créative méritent d’être pleinement (ré)investies dans l’enseignement du français au postobligatoire; de l’atelier ponctuel aux pratiques régulières 1, des exercices épisodiques aux évaluations formatives, voire certificatives 2. En voici une, laquelle relève cependant d’un projet d’établissement: le camp d’écriture.
Historique
Le Collège et École de commerce Émilie-Gourd, à Genève, organise depuis une dizaine d’années un camp résidentiel d’écriture, proposé aux élèves de 1ère et 3e années gymnasiales 3. Le camp a lieu pendant une semaine consacrée aux activités hors cadre (camp d’astronomie, camp d’art, voyages linguistiques, etc.), généralement au printemps. L’inscription se fait sur une base volontaire.
Ce camp a été créé par plusieurs enseignants de français qui ont décidé de suivre l’exemple du Collège Claparède, dont le premier camp d’écriture avait eu lieu une année plus tôt. Plusieurs autres collèges, tout comme d’autres écoles du canton, ont aussi leur camp d’écriture – parfois sous une forme quelque peu différente.
Depuis 2011, le camp d’écriture du collège Émilie-Gourd bénéficie non seulement des acquis didactiques mis en place par les enseignants qui l’ont créé, mais aussi de certaines modalités de vie collective 4 qui ont permis d’assurer une ambiance propice au partage.
Organisation
Le camp 5 commence le lundi par des jeux (de présentation, d’expression, puis d’écriture), afin de faire connaissance et de créer le groupe – ce qui s’avère important pour favoriser la bienveillance nécessaire au partage des textes. En soirée, un premier atelier a pour but de permettre aux élèves de présenter leur projet d’écriture. Les élèves ont le choix du sujet comme du genre, à condition que leur écriture témoigne d’une préoccupation esthétique. Il ne s’agit donc pas que de raconter une histoire. Si les textes sont plus facilement narratifs, d’autres genres sont aussi représentés. Certains nécessitent un suivi de près, tandis que d’autres se font de façon plus autonome.
Les jours suivants sont consacrés à des ateliers de travail individuel centrés autour du projet des élèves, avec pour contrainte de privilégier le brouillon, de façon à ce qu’ils conservent les différentes étapes de leur production. Dès qu’ils en éprouvent le besoin, les élèves vont voir un enseignant. Dans l’idéal, tous les textes doivent avoir été lus par au moins deux enseignants avant le mercredi soir, où nous organisons un atelier par petit groupe centré sur les difficultés des élèves. Des «trucs et astuces» sont alors échangés. Le jeudi après-midi, les élèves dactylographient leur texte et corrigent les dernières erreurs, tandis que le vendredi est consacré à la préparation de la lecture à haute voix des textes. Les lectures sont enregistrées et les textes font l’objet d’une publication 6. D’autres activités autour de l’écriture sont organisées lors des veillées: la lecture d’un texte commun, la rencontre avec un écrivain, ainsi que des ateliers spécifiques, notamment une soirée «slam»: un verre (sans alcool) pour des vers. Des activités ludiques, des marches et des temps libres sont par ailleurs aussi proposés.
Finalement, les élèves participent à toutes les tâches collectives (repas, vaisselle, rangement, nettoyage, etc.). Un enseignant s’occupe plus spécifiquement de la logistique (établissement des menus, courses, élaboration des repas, etc.), tandis que les cinq autres sont à disposition des élèves (on compte ainsi cinq à six élèves par enseignant, soit vingt-cinq à trente participants pour le camp pour six enseignants).
Le travail des enseignants consiste à accompagner les élèves, à leur faire part de leurs impressions de lecteur, à les conseiller, voire à les orienter, selon les besoins. Les textes sont lus par plusieurs enseignants, et bien évidemment, les avis divergent. Il s’agit évidemment de ne pas faire le texte de l’élève, mais de lui proposer des directions possibles; aux élèves de trancher. De même, les enseignants aident les élèves à mieux lire et interpréter leur texte à l’oral. Leur fonction est donc celle d’une personne-ressource.
Écriture et réécritures
Lors du premier atelier de l’édition 2017, une élève de première année a fait part de son projet: rédiger un échange épistolaire entre des personnages abstraits. Après quelques tâtonnements, elle a choisi d’écrire une lettre de la Vie à la Mort. Un enseignant lui avait conseillé de privilégier la rédaction d’une seule lettre, de qualité, plutôt que plusieurs. Elle a commencé par réfléchir au sujet:
Puis elle s’est lancée dans une première rédaction dont voici le début:
L’idée d’une lettre entre deux amants était née. Les enseignants lui ont proposé de développer cet aspect et de ne pas hésiter à rendre compte du désir de l’une pour l’autre. Une étape de plus a donné cette version:
Puis, après les conseils des enseignants et de ses camarades, elle est arrivée à celle-ci:
C’est là l’exemple d’un texte qui a demandé à son auteure un effort de réécriture important. On trouvera en annexe un texte rédigé par un apprenti gestionnaire du commerce de détail de 3e année (âgé de plus de 20 ans), lors de l’édition 2014. Là aussi, entre les premiers jets et la version finale, l’étudiant a repris inlassablement chaque mot, chaque formule, de façon à faire «sonner» son texte.
Quelques remarques…
D’édition en édition, on note l’originalité des œuvres, leur authenticité, leur richesse d’évocation. Les sujets abordés sont souvent durs, sombres, angoissants, comme si l’écriture ouvrait une porte derrière laquelle se cacheraient les monstres dans le placard – mais sans doute aussi parce que l’humour est plus difficile à faire naître sous la plume.
L’école privilégie l’aspect critique de la littérature dans ses programmes, sans exclure pour autant l’aspect créatif, mais en le réduisant à la portion congrue. Pourtant, de raisons pour favoriser les pratiques d’écriture créative, ou littéraire, il en est de nombreuses: écrire pour mieux lire, écrire pour désacraliser l’écriture, écrire parce que l’écriture ce n’est pas que dissertations et commentaires composés, écrire pour s’immerger en littérature, écrire pour le plaisir, écrire pour s’écrire, se dire, écrire pour soi, écrire pour rencontrer l’autre, écrire pour s’approprier la langue, se faire langage, pour mieux écrire, pour jouer aussi, etc. Et écrire pendant une semaine, dans une maison éloignée de la civilisation, favorise l’immersion. Les textes sont différents; les difficultés sont souvent les mêmes. Surtout, il n’y a aucune évaluation chiffrée, seulement les applaudissements, les commentaires laudatifs et son propre regard critique.
Depuis la première édition, il y a onze ans, les enseignants de français ne cessent de défendre ce camp (ce qu’en réalité ils n’ont guère besoin de faire), tellement il offre aux élèves comme aux enseignants une expérience personnelle et collective extraordinaire, fondée sur la liberté et le partage. Liberté de ton, de sujet, de genre, liberté de style, liberté d’être; partage de la vie collective et des émotions qu’elle suscite, des joies et des difficultés, et surtout du bonheur de découvrir ces textes pour lesquels, souvent, les enseignants se font du souci à mi-parcours. Or, il est à chaque fois magique d’assister à ce petit miracle de la naissance d’un texte qui se veut littéraire au milieu des ratures, des erreurs de français, des hésitations, des traits rageurs sur des feuilles déchirées, des ras-le-bol, des doutes, des longs moments où quelques-uns se disent qu’il n’y arriveront jamais… Et ces lectures, poignantes pour la plupart, parfois mises en musique, voire jouées, dans une ambiance de recueillement où chacun, les yeux fermés ou grands ouverts, goûte les mots, et se laisse porter par les émotions.
Annexes
Planning du camp
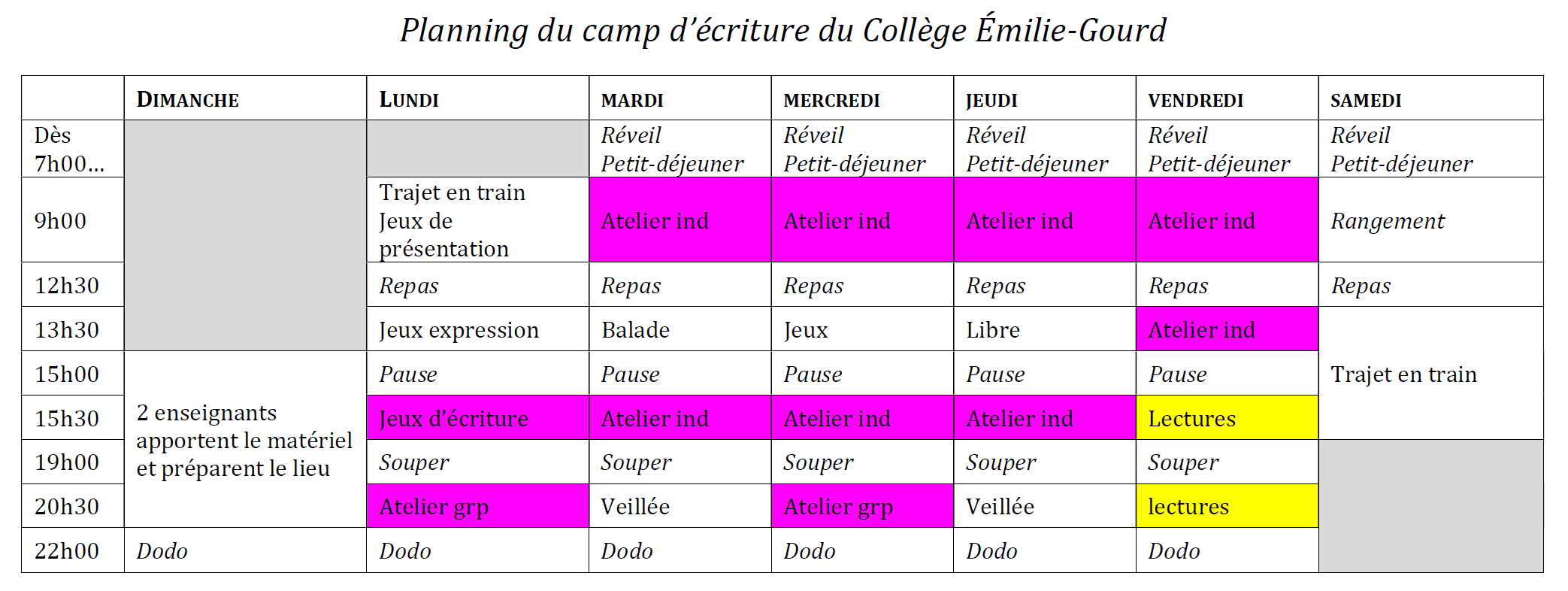
Exemple de texte:

Pour citer l'article
Philippe D. Garo, "Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd", Transpositio, Comment ça s'enseigne, 2017http://www.transpositio.org/articles/view/liberte-et-partage-le-camp-d-ecriture-du-cec-emilie-gourd
La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
Ce texte est basé sur la transcription, révisée par les auteur·ices, d’une table ronde qui s’est tenue le 7 mars 2025 à la HEP du canton de Vaud en Suisse romande dans le cadre du colloque international «Pour une théorie du récit impliquée», financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique (projet n° 197612). Ce colloque marquait la dernière étape du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» porté par l’équipe DiNarr. Cette table ronde peut être lue en complément du n° 6 de la revue Transpositio, ainsi que du dossier «La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins». Elle complète également le dossier «Comment ça s’enseigne?» consacré à la place de la narratologie dans les pratiques enseignantes romandes du primaire au secondaire 2, qui reprend les interventions de praticien·nes et de formateur·ices qui se sont exprimé·es dans le cadre de ce même colloque. On trouvera enfin le reste des contributions de ce colloque dans n° 47 des Cahiers de narratologie.
La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
Table ronde animée par Raphaël Baroni, transcrite et éditée par Vanessa Depallens et Sonya Florey
Ce texte est basé sur la transcription, révisée par les auteur·ices, d’une table ronde qui s’est tenue le 7 mars 2025 à la HEP du canton de Vaud en Suisse romande dans le cadre du colloque international «Pour une théorie du récit impliquée », financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique (projet n° 197612). Ce colloque marquait la dernière étape du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» porté par l’équipe DiNarr. Cette table ronde peut être lue en complément du n° 6 de la revue Transpositio, ainsi que du dossier «La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins ». Elle complète également le dossier «Comment ça s’enseigne?» consacré à la place de la narratologie dans les pratiques enseignantes romandes du primaire au secondaire 2, qui reprend les interventions de praticien·nes et de formateur·ices qui se sont exprimé·es dans le cadre de ce même colloque. On trouvera enfin le reste des contributions de ce colloque dans n° 47 des Cahiers de narratologie.
Participation
- Jean-François Boutin (Québec, professeur en didactique de la littératie à l’Université du Québec, Lévis/UQAR)
- Nathalie Denizot (France, professeure des universités à Sorbonne Université – INSPE de Paris, responsable de l’équipe Prascoll du CELLF – UMR 8599)
- Jean-Louis Dufays (Belgique, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain)
- Chloé Gabathuler (Suisse, professeure en didactique à la HEP Valais)
Modération
- Raphaël Baroni (professeur à l'École de français langue étrangère à l’UNIL, responsable de projet FNS Di Narr)
Raphaël Baroni
Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde plusieurs chercheurs et chercheuses en didactique qui ont accompagné le projet de recherche DiNarr tout au long de son développement. Jean-François Boutin est professeur en didactique du français depuis 1999 au Campus de Lévis dans l'Unité départementale des sciences de l'éducation. Il intervient dans les programmes de formation initiales des maîtres ainsi que des maîtresses. Nathalie Denizot est professeure des universités à l’INSPE de Paris (Sorbonne Université) et responsable de l’équipe Prascoll du CELLF (UMR 8599). Ses travaux portent sur la didactique de la littérature, dans une approche épistémologique et historique. Chloé Gabathuler est professeure en didactique à la Haute École Pédagogique du Valais et responsable de l’équipe LAC. Ses recherches portent principalement sur les modalités de réception des œuvres littéraires à l'école. Elle est l'auteur d'un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat intitulé Apprécier la littérature. Et enfin, Jean-Louis Dufays est professeur émérite à l'Université catholique de Louvain où il a enseigné pendant 28 ans après avoir conjugué la recherche universitaire et l'enseignement dans le secondaire pendant 14 ans.
J'ai préparé trois questions qui serviront de jalons à cette table ronde. La première est la suivante: à partir de votre ancrage institutionnel dans quatre régions différentes de la francophonie (Québec, France, Belgique, Suisse) quelles spécificités percevez-vous dans la manière dont la narratologie s’est scolarisée et continue d’exister dans la culture scolaire?
Chloé Gabathuler
N’étant pas spécialiste de la narratologie appliquée à l’enseignement du français, je vais m’exprimer principalement en tant que formatrice d’enseignant·es et en m’appuyant sur le Plan d’études romand (PER).
Rappelons tout d’abord que l’approche de l’enseignement du français plébiscitée par le PER est de nature communicative ou communicationnelle. C’est pourquoi la notion de “genre de texte» y occupe une place centrale: elle permet, entre autres, de travailler la dimension communicative des textes, de les envisager comme des actes de communication.
Dans cette perspective, si l’on adopte une approche baronienne de la narratologie, qui envisage le récit dans sa dimension rhétorique, on pourrait penser que cette conception communicationnelle de l’enseignement du français crée un terrain favorable au déploiement des outils narratologiques. Or, dans les faits, on remarque que les notions de narratologie sont disséminées, comme des îlots épars, dans différentes sections du PER sans lien entre elles ni réelle définition. On les retrouve soit dans les axes consacrés à la «compréhension» et la «production de l’écrit»; soit dans celui consacré à la littérature. Lorsqu’on examine de plus près les notions présentes dans les axes «compréhension» et «production de l’écrit», on remarque un véritable manque de cohérence. Pour vous donner un exemple:
- au cycle 1, il est question du «contexte d’énonciation»,
- au cycle 2, on introduit la «situation de communication»,
- et au cycle 3, on passe à la «situation d’énonciation».
Ces termes pourtant proches ne sont ni définis, ni articulés entre eux, ce qui rend leur appropriation difficile, tant pour les enseignant·es en formation que pour les élèves. Je comprends que mes étudiant·es — en particulier celles et ceux qui se destinent à l’enseignement primaire — soient perdu.e.s face à ces concepts. Pour la plupart, ils, elles sortent du secondaire sans formation littéraire approfondie. Résultat: ces notions leur semblent abstraites, voire incompréhensibles.
Du côté de l’entrée «apprécier la littérature», d’autres éléments apparaissent: la temporalité, le rapport narrateur-auteur, le point de vue, la manipulation de l’auteur, le suspense, ou encore l’influence sur le lecteur. On y devine une certaine conception du texte littéraire comme construction visant à orienter la lecture, mais là encore, tout cela n'est pas explicité.
Et surtout, ces différentes approches –production/compréhension d’un côté, appréciation littéraire de l’autre– ne se rejoignent jamais vraiment. Les notions sont traitées de façon cloisonnée, ce qui me semble problématique.
Le cycle 1, paradoxalement, me paraît le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu’on y met l’accent sur le lecteur, sur son ressenti, son appréciation. Dans ce cadre, le texte est envisagé en fonction des effets potentiels qu’il peut produire sur le jeune lecteur. Mais au fil de la scolarité, on délaisse le pôle du lecteur au profit de celui du texte. Est mise en avant une approche classique de la lecture littéraire dans le cadre de laquelle l’élève doit repérer ce qui dans le texte constitue sa littérarité.
Enfin, je tiens à souligner que ces outils narratologiques sont non seulement utiles aux élèves, mais aussi nécessaires aux étudiant·es en formation. Pour les futur·es enseignant·es, notamment au primaire, pouvoir analyser finement un album jeunesse (dont la narration est souvent complexe, et enrichie d’images) est crucial. Or, sans une boîte à outils solide, il leur est très difficile d’anticiper les difficultés que les élèves pourraient rencontrer et de construire des séquences d’enseignement adaptées à leurs besoins.
Jean-Louis Dufays
Alors, pour ce qui est de la Belgique francophone, ce pays a peut-être été le premier à avoir intégré dans les outils d'enseignement et dans les prescriptions l'apport de la narratologie. Dès 1975, on trouve en effet un programme d'enseignement qui demande aux enseignants d'accorder une importance significative aux «lectures nouvelles», comme on les appelait à l'époque, et notamment à l'analyse structurale des récits et des poèmes. Et déjà, des notions sont explicitement présentées dans les ouvrages de formation continuée et dans les outils adressés aux enseignants. Je pense tout particulièrement à un livre qui a eu un rôle assez important, Pour comprendre les lectures nouvelles (1978), qui était signé par André Fossion et Jean-Paul Laurent. Laurent a d'ailleurs continué à écrire beaucoup sur l'enseignement du français par la suite. Et donc, on trouvait déjà là une présentation très complète, dense et même créative de la narratologie, alors que les travaux de Todorov, Propp, Greimas et compagnie étaient encore en cours de diffusion. En particulier, on trouve dans l'ouvrage de Fossion et Laurent, mais aussi dans les manuels qu'ils ont dirigés, la collection Français de chez De Boeck-Duculot, des présentations très élaborées du schéma narratif, du schéma quinaire, ainsi qu’une articulation des deux schémas qui ne figurait pas dans les travaux d'origine des narratologues. S’affichait ainsi d’emblée le souci de “bricoler" une transposition renouvelée qui n'était pas simplement descendante, même si elle témoignait d’un enthousiasme évident face aux nouveaux savoirs. En outre, ces outils adressés aux écoles se voulaient adaptés au niveau et aux besoins des élèves et étaient déclinés de manière spécifique en fonction des compétences de réception, d'écriture ou de récit oral: ils témoignaient donc déjà d’une réflexion didactique intéressante.
Certes, il faut préciser que cela a surtout concerné le secondaire, beaucoup moins le primaire, et davantage aussi le réseau de l'enseignement catholique, qui représente en Belgique 60 % des écoles secondaires. Il reste que, historiquement, la Belgique semble avoir eu un rôle pionnier par rapport aux autres pays francophones: je renvoie à ce propos aux données que Luc Mahieu a rassemblées, puisque nous avons maintenant une réponse très documentée à ces questions dans sa thèse qui va être soutenue très prochainement.
Mais si les notions narratologiques ont donc été préconisées en abondance en Belgique francophone dès les années 1970, elles ont reflué assez rapidement au cours des années 80 et surtout des années 90, comme dans les autres pays. Il est clair que là, on est entré dans une période de méfiance, tant sur le plan théorique que sur le plan des discours scolaires. Certes, les outils narratologiques, comme narrateur et point de vue, apparaissent encore çà et là, mais ils sont désormais estompés par rapport à d'autres notions et d'autres approches de la littérature.
Et puis, on assiste à un retour assez clair de la narratologie dans le dernier référentiel inter-réseaux de 2021-2022, qui concerne le nouveau tronc commun des neuf premières années de l'enseignement obligatoire dont la mise en œuvre se fait progressivement. Sans doute est-on maintenant entré dans une génération qui a intégré les recherches en didactique et le dialogue qui s’est établi entre ceux qui se méfiaient des excès du formalisme et ceux qui, au contraire, se rendaient compte de l'utilité des outils narratologiques pour objectiver un peu l'analyse des textes. Et donc, la narratologie est à nouveau explicitement prescrite, avec une progression au fil des niveaux scolaires qui parait relativement bien pensée et dont je parlerai tout à l’heure, puisque c'est l'objet de la deuxième question.
Nathalie Denizot
Je ne suis pas sûre de savoir répondre non plus très précisément à la question. Et je voudrais rappeler tout d’abord que de nombreux éléments importants de réponse à cette question sont dans la thèse de Luc Mahieu (qui, je l’espère, sera bientôt publiée!), et évidemment aussi dans les entretiens avec les acteurs de la scolarisation, qui sont en ligne sur Transpositio.
Cela dit, si j’en crois le petit travail que j’ai fait (dans Transpositio) sur les manuels ou les chapitres de «méthodes», la narratologie au lycée a été scolarisée davantage à partir de la question du point de vue et du narrateur (du personnage aussi, mais de façon sans doute moins «technique»), que du schéma narratif (qui lui relève sans doute davantage du collège). Il faudrait prolonger ce travail pour comparer avec le collège, parce qu’il y a sans doute des différences collège/lycée: Reuter (dans les entretiens) évoque le succès du conte au collège pour travailler le schéma narratif; mais on peut se dire aussi que c’est sans doute parce que le conte était un genre déjà bien scolarisé que le schéma narratif a si bien pris...
Il en est de même pour l’usage de la narratologie dans les classes de lycée, et notamment à l’EAF1. Certes, comme le soulignent les «acteurs de la scolarisation» interrogés dans Transpositio, la narratologie a permis de renouveler l’approche des textes, et de sortir d’approches plus impressionnistes ou paraphrastiques. Mais il me semble que l’on peut aussi renverser la perspective, et que le succès de la narratologie est en partie lié aux exercices métatextuels caractéristiques de ce niveau. D’une certaine manière, il y a eu une forme de rencontre dans les années 1970-1980 entre l’instauration de l’EAF (à partir de 1969), qui comprend une épreuve orale d’explication de texte et une nouvelle épreuve écrite, le «commentaire», et la diffusion des théories narratologiques. C’est en effet à partir des années 1970 que la narratologie et les théories textuelles commencent à être diffusées dans les classes, à travers des revues comme Pratiques, à une époque où les revues de didactique sont adossées à des collectifs qui ne se contentent pas de publier mais qui s’impliquent dans des stages de formation continue, des universités d’été, etc., ou qui participent à des ouvrages de vulgarisation. Or, les exercices métatextuels de l’EAF (explication de texte et commentaire) partagent un point commun, celui de reposer sur des extraits, des textes courts voire très courts (certains textes officiels limitaient même assez drastiquement le format, autour de 15 lignes ou vers). Ils offrent ainsi une occasion de mettre en œuvre des outils tournés vers des lectures microtextuelles (par exemple le point de vue), et la «grammaire narratologique» prend plus facilement le relais des approches philologiques pour outiller ces lectures «de près» qui deviennent incontournables à l’écrit et à l’oral du bac de français. Quand on invente la lecture «méthodique» dans les années 1980, cette idée de «méthodes» pour la lecture des textes suggère clairement l’usage d’outils empruntés aux nouvelles approches en sciences humaines – dont la narratologie, qui fait d’ailleurs son entrée officielle dans les programmes à la fin des années 1980.
Pour le dire autrement, c’est bien sûr parce qu’elle était efficace que la narratologie est devenue un outil (ou un ensemble d’outils) utile pour les exercices métatextuels . Mais c’est aussi parce que les caractéristiques de ces exercices – en tant que genres scolaires – étaient particulièrement bien adaptées au type de lecture qu’elle permettait, que la narratologie s’est ainsi ancrée dans les pratiques. Explication de texte et commentaire ont facilité la scolarisation de la narratologie, voire en ont configuré la scolarisation, ce qui explique peut-être cette centration sur les points de vue et le narrateur.
Jean-François Boutin
Lorsque j’examine les instructions officielles du Québec, il y a peut-être effectivement une spécificité qui émane, mais je vais la contextualiser quelque peu. On est actuellement, au Québec, dans une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a eu un rappel des instructions officielles, aussi bien celles du primaire que du secondaire, seulement pour l'enseignement du français. Ce rappel-là a été demandé en juin 2023 et on termine présentement, quand je dis «on», c'est un peu fallacieux, mais en tout cas, les didacticiens du français québécois et didacticiennes québécoises, on est à terminer notre critique de la proposition de programme. C'est un peu un exercice effectué en vain parce qu'il y a très peu de recommandations qui vont rester malgré tout parmi nos analyses.
Au Québec, il faut dire que nos programmes actuels datent du siècle dernier... Ce sont des programmes qui étaient structurés autour de compétences. Il y avait quatre compétences au primaire: oral, lecture, écriture et appréciation des textes littéraires. Et Il y avait au secondaire trois compétences: lecture, écriture et oral. Donc c'est comme ça que fonctionnaient nos programmes et qu’ils fonctionnent encore. Il y a quelque chose, une spécificité propre peut-être au Québec par rapport aux programmes de français, sur laquelle j’aimerais insister, avant d’aborder la question de la présence de la narratologie dans les programmes.
Chez nous, il y a une pression parentale typiquement nord-américaine (je ne peux pas parler pour l'Europe), qui a mené à une sorte d’hyper-pragmatisme. Et ça s'est traduit dans l'obligation, dans pratiquement toutes les disciplines scolaires, d'avoir des cahiers d'exercices. Et là, je ne parle pas de manuel, mais bel et bien de cahiers d'exercices, ceci à un tel point que l'édition scolaire a complètement basculé. Elle est passée d'une édition qui publiait des manuels scolaires vers une édition qui publie des cahiers d'exercices qui sont évidemment jetés à la fin de l'année scolaire, «brûlés lors d'un feu de la Saint-Jean» par les élèves, etc. Et ça, ça a créé une pression pour qu'on retarde le renouvellement des instructions officielles, qu'on étire au maximum l’élastique. Dans ces cahiers d'exercices, un examen minutieux permet de constater qu’on y est extrêmement fidèle à la progression des apprentissages proposée par le ministère de l'Éducation pour le français aussi bien au primaire qu'au secondaire. Et je dirais que ce qui caractérise les instructions officielles actuelles comme ces cahiers d'exercices, c'est peu d'éléments de narratologie, mais une application très radicale, très radicale et très, très, très pragmatique, voire utilitariste des éléments dont on a parlé depuis deux jours. Donc, on est très traditionnel, si je peux parler ainsi, par rapport à la narratologie. On retrouve très peu d'éléments de rénovation de la narratologie dans les programmes. Et donc, c'est une approche très «clientéliste», d'une certaine façon. Et ça oriente énormément les décisions actuelles parce qu'il n'y aura pas de changement radical. On s'en va vers quelques nouveautés, quelques intégrations. Il y a des résistances très fortes, par exemple, à l'intégration du numérique, notamment de la fiction numérique, dans les programmes. Donc dans les compétences de français revampées, il n'y aura pas d'éléments qui porteront spécifiquement sur un volet numérique du recours, de la production, de la fréquentation, etc. de la fiction en classe. Donc, on reste très, très proche de ce qui s'est fait ailleurs dans la francophonie. On était déjà à la remorque; on restera très «Greimas», très «Genette».
Raphaël Baroni
Deuxième question: en termes de progression, comment voyez-vous l’évolution des notions mobilisées aux différents degrés de la scolarité? Pourrait-on construire des progressions plus claires en ce domaine?
Chloé Gabathuler
J’ai déjà commencé à répondre à cette question en évoquant le Plan d’études romand (PER). Je précise que je ne parlerai pas du secondaire 2, car ce n’est pas mon domaine d’expertise. Je me concentre sur l’école obligatoire, et, plus précisément, sur la structure spiralaire du PER.
Lorsqu’on examine les notions présentes dans les volets «compréhension» et «production», on constate que ce sont globalement les mêmes qui reviennent d’un cycle à l’autre. Les formulations varient légèrement, mais le fond reste très similaire. La seule réelle progression apparente se situe entre le primaire et le secondaire 1, au sein de l’entrée «apprécier la littérature». À ce niveau, on voit apparaître la notion de «suspense», ou encore on parle de l’influence du narrateur sur le lecteur. Ces éléments renvoient à la manière dont un texte est construit pour agir sur le lecteur. Cela pourrait être très stimulant… sauf que ces notions sont souvent présentées dans une approche très classique de l’enseignement de la littérature. Je l’ai dit tout à l’heure, on demande aux élèves de retrouver dans le texte ce qui en fait un objet littéraire. Or on le sait bien: on n’a jamais vraiment réussi à identifier de façon définitive ce qui constitue la littérarité d’un texte. Les outils narratologiques peuvent certes soutenir les analyses des textes, mais n’oublions pas un aspect fondamental de la lecture, à savoir le lecteur et l’interaction entre le texte et celui ou celle qui le lit.
Autre point que j’aimerais souligner – notamment à la lumière de la présentation de Claire Detcheverry– c’est la question de la progression. On entend souvent que cette progression doit aller du plus simple au plus complexe. Pourtant, quand on regarde certains parcours de lecture proposés dans les nouveaux moyens d’enseignement romand, notamment celui portant sur un album sans texte à destination du cycle 1, on se rend compte qu’on est loin de la simplicité. A mon sens, certains albums jeunesse, par leur richesse narrative, sont plus denses que des romans lus au secondaire I. Même si ces romans posent aussi des questions intéressantes, ils restent relativement simples sur le plan narratif.
Alors, doit-on vraiment penser la progression selon un axe allant du simple au complexe? Ne pourrait-on pas envisager que les outils narratifs soient les mêmes tout au long de la scolarité? La seule différence résiderait dans le langage utilisé: on n’emploierait pas le terme de prolepse avec des enfants de quatre ans. Pourtant, lorsqu’on observe ce qui se passe en classe, même au tout début de la scolarité, on se rend compte que les élèves saisissent bien les phénomènes. Un enfant de maternelle peut parfaitement dire qu’un récit «commence par la fin». Il ne disposera pas des concepts, mais il aura déjà une forme d’intuition narrative.
L’enjeu serait donc de maintenir une approche articulée entre le texte et le lecteur tout au long de la scolarité, cela sans tomber d’un côté dans une lecture purement subjective centrée sur les émotions, ni de l’autre dans une analyse froide uniquement textuelle. Il s’agit d’aborder les textes narratifs dans leur dimension rhétorique, d’accompagner les élèves dans une réflexion sur la capacité des histoires à affecter ceux qui les reçoivent – ou pour le dire autrement: porter son attention sur le storytelling dont parle James Phelan et sur les effets que ce storytelling produit sur le lecteur.
C’est aussi une manière d’introduire une réflexion éthique - là je pense à Wayne C. Booth – en interrogeant les relations complexes qui se nouent entre l’auteur, le narrateur et le lecteur. Tous ces éléments mériteraient d’être davantage mis en avant: ce sont de vrais outils pour une approche esthétique de la littérature, qui est, je dois l’avouer, mon cheval de bataille.
Enfin, ce que j’ai beaucoup apprécié dans les interventions précédentes – notamment celle d’Yves Renaud ou encore dans les échanges autour des incipit – c’est la place donnée à la production écrite comme outil de compréhension. Catherine Tauveron le disait déjà dans les années 90: faire écrire les élèves les aide à mieux comprendre les mécanismes esthétiques du texte. Produire pour mieux lire, mieux interpréter, mieux apprécier. Et les outils narratologiques peuvent tout à fait servir de leviers dans cette démarche.
Jean-Louis Dufays
Pour ce qui est de la progression, je dirais qu’il s’agit d’abord de tenir compte du fait qu'il y a plusieurs compétences à travailler autour du récit. Les compétences de lecture évidemment, mais aussi les compétences d'écriture, on en a largement parlé cet après-midi, puis il y a aussi les compétences orales: écouter le récit, dire le récit. Donc, ce serait bien qu'une progression tienne compte de ces quatre compétences. C'est le cas dans le nouveau référentiel dont je parlais tout à l’heure. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots comment cette progression y est proposée car elle a fait l'objet d'un long travail de co-construction qui m'a semblé très fécond entre des enseignants qui avaient expérimenté des choses et des didacticiens qui avaient fait des recherches autour de la question. Je précise que je n'en parlerai pas de façon totalement neutre, puisque j'ai été consulté par ceux qui ont élaboré ce programme.
Première remarque: la progression envisagée distingue cinq stades de la lecture au long de la scolarité obligatoire. Le premier est le stade du lecteur émergent, qui commence à apprendre à lire en maternelle et au tout début du primaire. Puis vient le stade de l'apprenti lecteur, qui concerne surtout la première année du primaire: l’élève y est à la fois dans le décodage et dans le début du travail de compréhension. Ce faisant, il entre déjà dans le stade du lecteur débutant, où des opérations plus complexes se mettent en place, et dès la deuxième année, il arrive au lecteur en transition, qui se poursuit jusqu’à la quatrième et où il accède déjà à une lecture littéraire. Enfin, en cinquième et sixième primaires commence le cheminement vers le lecteur dit confirmé. Et donc les différentes notions qui relèvent de l’analyse du récit sont associées à ces différents stades de développement de la lecture et aux différents niveaux scolaires.
Plus précisément, les compétences de lecture du récit commencent à être développées à partir de la troisième primaire. Dès ce niveau-là, on demande que les enseignants amènent les élèves à identifier les cinq structures narratives majeures définies par Adam, à savoir les structures narrative, argumentative, descriptive, dialoguée et explicative. De plus, le référentiel se distingue en reliant le travail sur les structures textuelles à la promotion d'une lecture littéraire, qu’il définit par sa double modalité, participative et distanciée: il invite à utiliser le récit d'un côté pour amener l'élève à mieux s'identifier aux situations, à vivre l'émotion d'une tension narrative, à se projeter dans l'histoire –c'est la dimension participative–, et de l'autre pour l'amener à acquérir et à mettre en œuvre des outils d'analyse, en étant capable, comme on l'a vu dans plusieurs des interventions de cet après-midi, de déjà nommer les éléments de construction du sens et du récit qui se mettent en place.
Donc, dès l'enseignement primaire, on a cette lecture littéraire qui est préconisée à propos des cinq structures génériques et en lien avec deux productions écrites qui sont demandées. Les productions attendues se complexifient ensuite au fil de la scolarité. Au secondaire, on demande que l'élève soit capable de résumer un court texte narratif et de résumer oralement un court texte narratif et de rédiger un court récit de fiction à partir d'illustrations, puis il va falloir résumer à l'écrit. Le texte sera de plus en plus substantiel, de plus en plus long. À partir de la troisième secondaire, l'élève est amené à utiliser le récit pour relater une rencontre avec une œuvre culturelle. Donc le récit ne sert plus seulement à travailler la lecture ou l'écriture de la fiction, mais aussi à relater une expérience vécue, une expérience culturelle en l'occurrence. Il sert aussi de matrice pour la réécriture (sous la forme d'amplification, de recomposition ou de transposition) de récits de fiction. S’affiche ainsi un souci de distiller au fil des années, dès la troisième primaire et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, des compétences spécifiques.
Par ailleurs, la boîte à outils narratologique va progressivement s'enrichir. Dès la troisième primaire, on parle déjà d'identifier le narrateur, et puis, au fil des trois premières années du secondaire, on intègre de plus en plus d'éléments, la gestion de la temporalité et du rythme narratifs, les notions de récits parallèles et enchâssés, les différents types de focalisation, toutes ces notions inspirées de la narratologie sont explicitement intégrées dans la progression. Au cours des trois dernières années du secondaire, les outils narratologiques sont davantage présupposés comme étant déjà maitrisés, et la lecture des textes littéraires, qui doit à ce moment-là aboutir à des réécritures créatives et à l'explicitation d'une relation critique à l'œuvre, s'appuie sur des outils, notamment narratologiques, mais qui ne sont plus détaillés.
Telle est donc la progression en matière de compétences narratives qui est actuellement préconisée en Belgique francophone. Comme elle vient seulement d’être établie, il est trop tôt pour en mesurer les effets, mais elle a le mérite d’être assez précise et de résulter d’un dialogue avec des enseignants de terrain.
Nathalie Denizot
Je ne suis pas sûre de pouvoir véritablement répondre à cette question, d’abord parce que contrairement à la Belgique, les programmes français actuels sont assez peu détaillés et ne parlent pas explicitement de narratologie. Cela dit, je trouve vraiment intéressant de réfléchir aux types de progression possibles en la matière, et il est clair que ce qui est intéressant pour les notions narratologiques –comme pour bien d’autres objets de la discipline–, c’est d’envisager une progression spiralaire, qui vise des approfondissements successifs d’un même objet et qui procède par reprises et complexification - et non pas une progression linéaire. Qu’est-ce qui serait en effet «plus simple» dans les savoirs narratologiques, et que serait la «base» en narratologie?
Par ailleurs, plutôt que de chercher à opérer des progressions a priori, qui risquent de faire des outils narratologiques non plus tant justement des outils que des contenus à enseigner pour eux-mêmes (c’est une dérive souvent identifiée pour les savoirs grammaticaux), ne pourrait-on pas, comme le suggèrent justement certains didacticiens de la grammaire pour leur domaine, identifier un (très petit) noyau dur de savoirs métatextuels indispensables, et les affiner selon les niveaux mais surtout selon les textes? La notion de narrateur, par exemple, gagnerait sans doute beaucoup à une telle approche spiralaire.
Cela permettrait aussi de découpler l’appropriation du métalangage et l’appropriation des concepts, qui sont deux choses bien différentes et qu’on a parfois tendance à mélanger. Certes, il peut y avoir un vrai plaisir, même pour certains élèves, à affiner la terminologie, à distinguer «homodiégétique», «hétérodiégétique», etc. Mais est-ce que c’est un apprentissage indispensable? Je n’en suis pas sûre. On peut très bien savoir ce qu’est la prolepse ou l’analepse sans connaitre la terminologie narratologique, et cela vaut sans doute pour un certain nombre de notions. Introduisons-les de manière raisonnée et complexifions la terminologie au fur et à mesure que la lecture des textes va demander des interprétations de plus en plus fines et que les textes eux-mêmes se complexifient. Il ne faut pas oublier, comme le rappelait Alain Rabatel dans ce colloque, que tout cela doit rester au service du sens, de l'interprétation du texte. Les concepts et la terminologie sont des outils de lecture des textes avant d’être des objets d’enseignement et d’apprentissage.
Jean-François Boutin
Je vais répondre aux deux questions de cette question. La première question est très intéressante parce qu'elle nous force à constater que si on regarde en termes de progression actuelle, on reconduit dans les instructions québécoises à venir, qui devraient être en application soit à la rentrée 2025 ou plus tard à la rentrée 2026, ce qu'il y avait déjà. Il y a toutefois la disparition de la fameuse compétence «interpréter des textes littéraires» au primaire parce que la pression est venue des enseignants et enseignantes qui disaient qu'ils ne savaient pas quoi en faire... Donc vous voyez que là, on évacue quand même une partie importante de l'expérience de la fiction. On l'intègre toutefois dans les deux autres compétences -lecture et écriture- et on essaie même de l'intégrer dans l'oral, ce qui est quand même intéressant, notamment l'oral qui pourrait tendre vers la fiction. On peut penser aux balados/podcasts. Donc là, il y a une ouverture qui est intéressante. Au Québec aussi, il faut dire qu'au secondaire, il y a une pression très forte générée par l'épreuve uniforme de fin de cycle, l'épreuve de fin d'année. Les enseignants et enseignantes passent un temps fou à préparer leurs élèves à réaliser une épreuve qui est toujours organisée autour d'un type de texte particulier. Et le seul moment où on travaille systématiquement le texte narratif, c'est en troisième secondaire. Donc, vous voyez que c'est là que se concentrent beaucoup les éléments que j'oserais appeler de narratologie, qui sont davantage abordés de façon explicite en classe de français.
Maintenant, pour la deuxième partie de la question, si on se met à rêver, et là j'endosse totalement les propos de Nathalie Denizot, moi aussi j’aimerais garder mon espace critique par rapport à ce qui est proposé par le ministère de l’Éducation chez nous au Québec. Moi, je n'ajouterais rien de plus à ce que Nathalie a dit. Je pense que ça fait grand sens. Ce que j'aimerais simplement évoquer davantage, c'est qu’on a beaucoup de résultats sur les pratiques culturelles des jeunes du Québec et de l’Amérique du Nord. On s'aperçoit que les jeunes, les élèves, les adolescents, les enfants qui fréquentent l'école au Québec sont de très grands amateurs de fiction. Mais pas la fiction qu'on connaît, qui s'est instituée au fil du temps, qui est scolarisée. Ils sont dans des horizons de fiction qui sont même parfois difficiles à accepter pour des spécialistes et l'école, malheureusement, au Québec, prend très peu en considération cette dimension-là. Je pense par exemple aux univers de fan fiction, je pense aux univers de la transfiction, évidemment, le cosplay, la pratique du jeu vidéo, qui est extrêmement populaire, la consommation pratique du manga, etc. Il y a chez nous une effervescence, présentement, il y a manifestement un besoin de s'évader un peu du réel, qui est très présent et fort documenté, statistiquement parlant. Or il y a un fossé avec l'école qui ne prend pas cela en considération. Je pense que c'est là que ça fait mal parce que les élèves en viennent à considérer, par exemple, le conte comme un genre scolaire, comme une forme scolaire, alors que lorsqu'ils vont lire un conte de Tolkien, ils n'auront pas l'impression d'être dans un conte, ils vont avoir l'impression d'être ailleurs en imaginaire. Alors là, il y a, je ne dirais pas un dérapage, mais en tout cas, il y a une discordance assez forte. Et ça me préoccupe énormément. Je souhaiterais qu'on rapproche ces deux univers-là, l'univers des pratiques informelles et celui des pratiques scolaires. On a pourtant essayé de faire bouger les choses...
Raphaël Baroni
Enfin voici ma dernière question: selon vous, à quelles élaborations didactiques faudrait-il procéder aujourd’hui pour que la théorie du récit puisse (re)devenir une ressource pour l’enseignement du français? Quelles approches ou notions vous semblent les plus utiles? Quels sont les principaux obstacles à relever et les principaux dangers à éviter?
Chloé Gabathuler
Je partage entièrement l’avis de Jean-François Boutin. Pour moi, il est essentiel de prendre en compte les pratiques culturelles des élèves. On sait théoriquement qu’il faut partir des élèves, mais dans la réalité –notamment lors d’évaluations–, ce principe reste encore trop peu appliqué.
Les élèves baignent constamment dans des formes narratives: jeux vidéo, mangas, réseaux sociaux… Je pense à TikTok, par exemple. Ces vidéos utilisent souvent certains procédés narratologiques pour pouvoir susciter le plus d’effet possible sur l’audience. Il me semble donc fondamental de partir de ces pratiques-là. Cela peut surprendre ou heurter, mais pourquoi commencer directement par Balzac? On peut tout à fait établir des ponts vers les textes littéraires du secondaire 1 ou 2, à condition de partir d’abord de l’univers et des pratiques culturels des élèves.
Déjà à l’époque –lointaine!– où j’enseignais au secondaire à Genève, je m’appuyais sur des extraits de films pour aborder certaines notions narratologiques. À défaut des outils numériques d’aujourd’hui, on avait déjà besoin du visuel pour faire passer certaines notions. C’est pour ça que le travail évoqué tout à l’heure par Claire Detcheverry me semble si riche: il permet aux élèves de se focaliser d’abord sur l’image et son langage propre, ce qui est loin d’être simple, mais qui propose une autre porte d’entrée probablement plus accessible pour les élèves fragiles ou en difficulté de lecture. Toutefois, il reste à penser le passage entre ces deux modes sémiotiques. Les outils narratologiques pourraient bien servir de charnière entre ces deux modes d’expressions.
Par ailleurs, pour citer de mémoire Raphaël Baroni, l’approche narratologique met en lumière des dispositifs rhétoriques qui ont le pouvoir –ou non– d’orienter et d’affecter le lecteur. Cette approche et les différentes notions ou concepts qu’elle propose pourraient constituer, selon moi, une clef d’articulation entre les différentes dimensions du français (compréhension, réception, production) en offrant une forme de stabilité conceptuelle qu’on peut retrouver à chaque étape du travail avec les élèves.
Et même si l’on se place uniquement du point de vue de la réception, ces outils permettent justement d’éviter l’écueil d’une lecture purement subjective, comme l’a souligné Nathalie Denizot –je la rejoins tout à fait là-dessus. L’école est un espace social au sein duquel l’expression personnelle, idiosyncrasique, y gagne à être structurée. Cela me fait penser aux travaux de Marion Sauvaire, mais surtout à ceux de Lev Vygotski à partir desquelles j’ai développé cette idée de double mouvement vers soi et vers le texte. C’est-à-dire cette capacité qu’on cherche à développer chez les élèves à porter attention à ce qui se passe en eux pendant la lecture tout en étant capables de revenir au texte toujours avec attention et de pointer certaines de ses spécificités responsables de tels ou tels effets. Et c’est précisément ce que permet la nouvelle narratologie: articuler cette tension entre subjectivité et analyse textuelle, entre résonance intime et partage de significations avec les pairs. Il me semble que ce double mouvement est un moteur puissant de transformation sur le plan développemental.
Enfin, j’aimerais évoquer un point qu’on n’a pas abordé: celui des capacités transversales dans le PER. On nous demande aujourd’hui de les intégrer dans nos cours de didactique du français. Parmi elles, il y a notamment la pensée créatrice. Il me semble que c’est une formidable opportunité –une sorte d’alibi pédagogique– pour revisiter ce que l’on enseigne et ce que l’on transmet aux futur·es enseignant·es. Ce pourrait être l'occasion de démontrer l’utilité des outils narratologique (parmi d’autres) dans le développement de la pensée créatrice et de l’imagination.
Jean-Louis Dufays
Je vais peut-être commencer par la fin de ta question où tu demandais s'il y avait des dangers qui me semblaient être à éviter. Il me semble d’abord qu'il faut peut-être observer les mésusages qui ont pu être faits de la narratologie, en tenant compte notamment de la thèse de Luc Mahieu, qui nous permet de voir un certain nombre de remarques qui sont faites par des enseignants eux-mêmes ou par des chercheurs en didactique. Cela étant, je vois quatre problèmes qu'il s'agirait autant que possible d'éviter.
Le premier, ce serait celui de la naturalisation de la narratologie et de ses outils: il s’agirait de ne pas considérer que ceux-ci vont de soi. On a assez dit combien la trop grande évidence accordée au schéma narratif, pour ne citer que lui, a posé des tas de problèmes. Ça fait maintenant trente ans que Catherine Tauveron a signalé qu'il y avait d'autres manières de travailler les récits dès l'enseignement primaire. Donc la naturalisation me paraît un premier problème, et il va de pair avec celui de l'enseignement implicite: trop souvent, on suppose que des notions narratologiques ont été enseignées les années précédentes alors qu’elles ne l'ont pas été, ou du moins pas de la façon que l’on croyait
Le deuxième problème, ce serait la dilution des outils narratologiques ou leur évitement, c'est-à-dire le fait de les utiliser de manière floue. Tant mieux si on fait preuve de souplesse et de créativité dans leur usage, mais il me semble qu'ils requièrent aussi un minimum de rigueur, et c'est tout l'objet de ce colloque d'avoir justement essayé d'un peu remettre cette rigueur-là au premier plan. Donc, ce serait pour moi un rôle du chercheur d'essayer d'être attentif à ce que, quand on emploie les mots focalisation, narrateur, point de vue, schéma narratif ou actantiel, on essaye de le faire avec une certaine précision et avec un certain sens critique et qu'on essaie d'instiller aussi ce sens critique dans le travail même des enseignants.
Le troisième risque, qui est proche du deuxième, ce serait l'atomisation des outils narratologiques, le fait de les travailler de façon isolée, trop morcelée, sans penser à leur intégration dans un ensemble qui fait sens.
Enfin, le quatrième danger, à mon sens, ce serait celui de l'autonomisation trop grande de la narratologie, la tendance à travailler les récits uniquement sous cet angle-là, d'en faire l'unique ou le principal angle de travail pour analyser les textes. Par contraste, comme je l’évoquais tout à l'heure, certains programmes aujourd'hui insistent beaucoup sur l'importance d’aborder les récits en travaillant les différentes modalités et postures de la lecture littéraire. Il me semble que l'intégration de la narratologie, mais aussi des approches sociologique, institutionnelle, intertextuelle et autres, dans cette conception souple et dialectique de la lecture conçue comme un va-et-vient entre distanciation et participation serait un garde-fou qui permettrait d’éviter une autonomisation trop grande de certains outils, quels qu’ils soient, et partant une nouvelle dérive qui risquerait de hérisser certains observateurs.
Pour répondre à ces dangers, quelles seraient pour moi des priorités à travailler? Je vais tout d’abord avancer dans le sens de ce qui vient d'être dit par mes collègues: il me semble essentiel de travailler le récit dans la diversité de ses formes actuelles, de ses réalisations discursives actuelles, pas seulement littéraires et pas seulement traditionnelles, mais à travers la BD, le cinéma, les séries, le théâtre, la poésie, le jeu vidéo, les différentes formes de narrativité que les élèves utilisent, auxquelles ils recourent dans leur vie quotidienne. Ces différentes formes du récit sont en effet des éléments constitutifs de la culture contemporaine, me semble-t-il, et elles ne relèvent pas seulement de la culture des jeunes, mais plus largement de la culture médiatique, des différentes formes de rapports aux objets culturels. Cela me semblerait vraiment important que les classes de français s'ouvrent davantage à cette diversité des formes de récits. En même temps, elles gagneraient à s'interroger sur les enjeux de ces formes de récits, sur la place du storytelling, qui est peut-être une manifestation médiatique et politique de cette place croissante accordée au récit. Cela vaudrait la peine qu'on s'interroge sur la place que prend le récit comme genre parfois un peu totalitaire, et qu'on se demande s'il n'y a pas d'autres manières de penser le rapport au sens, le rapport à l'identité, le rapport au monde. On sait que la notion d'identité narrative a été fortement mise en évidence par Ricoeur, mais il y a aussi peut-être une identité argumentative, une identité poétique, une identité dialoguée: il n'y a pas que le narratif comme entrée. Je pense que ces questions-là ne sont pas que des questions d'universitaires, de chercheurs, d'intellectuels: elles auraient aussi éminemment leur place dans l’enseignement secondaire. Je plaiderais donc volontiers pour qu’une élaboration didactique à venir intègre cette visée un peu plus large du rapport au récit en l’abordant de manière critique.
Pour terminer, il y a des notions qui me semblent essentielles et qui sont encore très peu présentes dans les manuels ainsi que dans les préconisations officielles. Il y a d’abord l'apport de cette «nouvelle narratologie» dont Raphaël est peut-être le porte-parole le plus éminent. Pour moi, les notions de mise en intrigue et de tension narrative, mais aussi les différentes formes de nœuds narratifs -la catastrophe, le conflit, l'action planifiée- constituent des outils extrêmement opératoires que je travaille avec mes étudiants de l'université depuis une quinzaine d'années parce qu'elles offrent une entrée qui fait sens dans les textes narratifs.
J’évoquerai ensuite tout le travail possible sur les blancs du texte, cette notion que j'avais un peu travaillée à l'époque de ma thèse (Dufays 2010: 155-158)2. On peut aussi appeler cela les lieux d'indétermination, les lieux de résistance, et cela intègre les phénomènes d’ambiguïté et d'ambivalence, les ellipses, ce que le texte ne dit pas, et les résidus, ces passages qui ont l'air de ne servir à rien. Dans les récits on en a constamment, j'en avais fait une petite typologie à l’époque. Il me semble que ce travail sur les blancs serait extrêmement utile pour travailler les difficultés de lecture avec les élèves qui sont parfois bloqués devant des textes narratifs et qui disent: «Mais là, je ne comprends pas, qu'est-ce que le texte a voulu dire?» Pourquoi ne pas partir de ce repérage de ces blancs, de ces indéterminations? Cela permettrait de les nommer et d’en faire des outils d'analyse plutôt que les considérer comme des implicites, ce qui contribue à bloquer le rapport au texte.
Et puis enfin, vous ne serez pas étonnés si vous connaissez un petit peu mes travaux, de savoir que, pour moi, travailler le récit, ça suppose aussi de travailler autour des formes instituées des récits et donc les stéréotypies, qu'elles soient d'ordre micro-textuel, d'ordre narratif ou thématique ou d'ordre idéologique. Pour moi, le récit est le lieu privilégié pour travailler la stéréotypie, et en retour, la stéréotypie est un outil privilégié pour s'approprier de manière critique le rapport au récit.
Nathalie Denizot
Je vais répondre un petit peu à côté, parce que je ne sais pas vraiment quelle «élaboration didactique» il faudrait faire pour les savoirs narratologiques. Mais je trouve très intéressant que soit repris ce concept d’élaboration didactique proposé par Jean-François Halté, qui s’inscrit dans une vision praxéologique de la didactique: il s’agit, écrit Halté dans son article de 1998, de redonner à l’enseignant son rôle et sa place de protagoniste essentiel, en tant que cet enseignant va donner du sens à la transposition en «recontextualis[ant] [l]es savoirs de manière efficace» (1998: 191). Et c’est bien le projet d’enseignement qui prime: «Ce n’est pas parce qu’un savoir savant est disponible et enseignable qu’il est (doit être) enseigné: c’est parce que tel projet didactique est poursuivi que tel concept issu de telle théorie est élu et transposé» (1998: 192). Cela fait écho à ce qu’on a déjà dit plusieurs fois au cours de ces journées: c’est l’usage qui prime, et les savoirs narratologiques doivent être au service de la lecture des textes, et pas l’inverse.
En fait, pour Halté, l’élaboration didactique est du ressort des enseignants, dans un contexte (les années 1980-1990, le bouillonnement de l’INRP, les collectifs de Repères ou de Pratiques) où les didacticiens travaillent avec les enseignants pour renouveler l’enseignement du français. Et en tant que «méthodologie implicationniste», pour reprendre son expression (1998: 191), elle implique, relativement aux savoirs, des conséquences qui sans doute ne ravissent pas les spécialistes des «savoirs savants», puisqu’il faut savoir renoncer à une forme de «pureté» (pour reprendre le terme d’Halté, que je m’autorise ici à citer un peu plus longuement):
L’élaboration didactique des savoirs, parce qu’elle implique (et également par cela qu’elle implique), produit des objets d’enseignement qui n’ont pas la pureté, le tranchant, des objets scientifiques, ni, non plus, la fluidité des objets sociaux: ce sont des objets du meilleur compromis possible. (Halté 1992: 122).
Et en effet, ce que tous les travaux depuis plusieurs décennies sur la construction des savoirs scolaires nous apprennent, c’est que les savoirs scolaires ne sont pas –ne peuvent pas être– «purs». Pour ma part, je parlerai sans doute après Chervel du rôle créateur de l’école, qui ne se contente pas de relayer ou de transposer des savoirs forgés en dehors d’elle, mais qui les reconstruit, les reconfigure, pour «fabriquer de l’enseignable ».
Que faire alors? Évidemment, comme Halté et ses amis du collectif Pratiques, ou comme tous ces didacticiens de cette génération, il faudrait non seulement intervenir en formation initiale (à l’université comme dans les instituts de formation des enseignants), mais aussi (et surtout?) en formation continue des enseignants –ce qui en France devient plus compliqué parce que la formation continue relève actuellement davantage du rectorat et des inspecteurs que des Inspé et de la recherche universitaire. Peut-être, comme Dumortier, Reuter, et quelques autres, il faudrait produire de nouveaux usuels, mais des usuels un peu différents, qui aident à comprendre les enjeux, les débats, qui ne figent pas des notions prêtes à l’emploi et qui s’adressent à l’intelligence des enseignant·es ou des formateurs et des formatrices, à leur culture sans doute déjà étendue sur ces questions, sans les prendre pour des élèves avec des reformulations dépersonnalisées. Non pas seulement définir les différents types de «narrateur» ou de «points de vue», mais distinguer les apports des différents théoriciens, les points de tension aussi. Il manque, me semble-t-il, la strate intermédiaire entre les manuels pour les élèves et les travaux des spécialistes. Enfin, comme Petitjean avec ses collègues de Pratiques, et bien d’autres, il faut peut-être aussi prendre sa part dans l’élaboration des manuels.
Dans tous les cas, ce qui me semble essentiel est de garder à l’esprit que si les didacticien·nes et les narratologues peuvent faire quelque chose, ce n’est surtout pas dire aux enseignant·es ce qu’il faut enseigner... Mais on peut aider les enseignant·es à choisir les notions les plus utiles et les plus opérantes pour interpréter les textes, à objectiver et à interroger les démarches ou les dispositifs, à en analyser les intérêts mais aussi les limites, à partir de données construites, pour dépasser les simples témoignages de «bonnes pratiques».
En fait, il me semble qu’il serait vraiment intéressant et utile pour tout le monde (didacticien·nes, narratologues et enseignant·es du second degré) de prolonger le travail par une ou des recherches collaboratives, pour partir des questions et des impasses telles qu’elles se présentent dans les classes, et ré-élaborer/re-construire avec les enseignant·es la boite à outils dont eux et leurs élèves ont besoin –voire, pourquoi pas, élaborer avec eux le manuel ou l’usuel dont ils auraient besoin.
Jean-François Boutin
Je dois faire une digression vers la formation continue, parce que c'est trop tentant, c'est trop «alléchant». Je pense que chez nous, au Québec, on adhère encore trop fortement au mythe que la transformation des pratiques dans les milieux scolaires vient par la relève, donc par les enseignants qu'on forme à l'université. Et c'est ce qui fait qu'on délaisse complètement la formation continue alors que je suis de plus en plus convaincu que c'est par l'inverse qu'on pourra transformer. Il va falloir se donner les moyens et ça veut dire les sous notamment pour aller jouer sur les représentations, les pratiques des maîtres actuels qui ont 20, 25 ans, 30 ans de pratique derrière eux parce qu’il n'y a qu'une reproduction, il y a un élan, oui, initial, mais qui s'éteint très rapidement.
Je pense qu'on a besoin, il me semble en tout cas, de quatre approches que je vous propose. Je crois qu'on a besoin d'une approche inductive de la narratologie. Partons des pratiques de réception, production de la fiction narrative des élèves, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi partons des pratiques scolarisées, des pratiques qui sont bien inscrites dans les inscriptions officielles en français, qui sont liées à la narratologie. Il ne faut pas évacuer, au contraire, pour découvrir progressivement la boîte à outils de la narratologie rénovée. Ça a été fait chez nous au Québec en didactique de la grammaire. On a amené tout un pan du corps enseignant à changer son rapport à l'enseignement de la grammaire. On est passé, sous l'impulsion des travaux de Suzanne Chartrand, qui a vraiment milité fortement là-dessus, à une posture beaucoup plus inductive. Alors pourquoi pas la même chose pour la narratologie? Moi, en tout cas, je pense qu'on peut commencer dans un futur projet de recherche, dans un prolongement de dix ans, on peut commencer à penser à ça.
Autre chose, je pense qu'on a besoin d'une approche communautaire de la narratologie. Et là, je pense, là, j'évoque évidemment Stanley Fish et à son principe de communauté, d'interprétation. Je pense que ça a été évacué un peu trop rapidement pour toutes sortes de raisons, notamment idéologiques liées, par exemple, à la montée du socioconstructivisme. En tout cas, chez nous, il y a eu des réactions fortes. Ça a été mal compris aussi. Or, présentement, les jeunes se réseautent comme jamais. Le réseau, ce n'est même plus un concept, c'est une façon de vivre. Déployons cette forme d'échange par réseautage autour de notre rapport à la fiction. En tout cas, moi, je pense qu'il y a là une piste intéressante pour l'école.
Une autre piste qui me semble incontournable, c'est l'approche des imaginaires contemporains, telle qu'elle est promulguée par Bertrand Gervais, et qui permet d'ancrer assez paradoxalement la rencontre de la fiction narrative dans le réel. Cette rencontre-là, elle donne tellement de sens à l'expérience humaine et individuelle et je pense que de voir ça de façon un peu plus globale, de voir la fiction comme étant quelque chose qui appartient à un tout plus grand qui s'appellerait l'imaginaire collectif et l'imaginaire individuel. En tout cas, il y a là des pistes de réflexion très intéressantes. Je vous recommande notamment son dernier ouvrage, qui est paru et porte là-dessus.
Et je pense enfin et surtout, ça a été évoqué par Jean-Louis, ça a été évoqué par Nathalie, qu'on a besoin d'une approche disciplinaire diachronique de la fiction narrative. Depuis les années 1970, il y a eu plein de travaux en didactique de la littérature qui étaient novateurs, qui étaient progressistes, qui étaient respectueux aussi de la tradition, mais qu'on a malheureusement vu passer et qui, n'ayant plus la saveur du jour, sont progressivement disparus. Le plus bel exemple de cela, et moi ce qui me fâche le plus, ce sont les travaux en stéréotypie littéraire que Jean-Louis a menés, qui sont pour moi fondamentaux. Ça fait des années que je milite pour qu'on travaille davantage, au Québec, cette notion-là, comme d’ailleurs la notion de mimesis, et ça demeure sans écho. Pourtant, il y a des résultats empiriques, on a testé, ça fonctionne. Donc retournons voir en didactique de la littérature dans notre patrimoine de savoirs, de dispositifs et d'expériences, les choses qui peuvent vraiment fonctionner en contexte contemporain. Je pense que là, on peut penser à une intégration beaucoup plus naturelle de la narratologie, non plus comme discipline scientifique de la fiction, mais plutôt comme des clés qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi on en a tant besoin au quotidien. Et quand je dis «nous », je pense aux jeunes et moins jeunes...
Et je dirais qu'ensuite, juste pour terminer, oui à la recherche-action, oui à la recherche collaborative. Par contre, c'est compliqué, c'est complexe. J'ai piloté une recherche où on avait huit projets qu'on accompagnait sur trois ans. On avait huit chantiers de collaboration, huit chantiers de recherche-action. On est parti des besoins des jeunes, on a développé des dispositifs avec les enseignants, on est allé les tester avec les élèves. Les enseignants avaient un statut de chercheur, ce qui était fantastique, et ça a donné de superbes résultats. Le problème, c'est que ça coûte une fortune au gouvernement, et là, je ne pense pas que nos états soient prêts à accentuer le nombre d'enseignants-chercheurs. Pourtant, à l'unanimité, les enseignants qui ont obtenu ce statut-là pendant trois ans, ont métamorphosé leurs pratiques professionnelles parce qu'ils étaient dans ce que Sonya [Florey] appelait ce matin un dialogue de circulation des savoirs et des pratiques. Je pense que ce serait une avenue fantastique, mais il va falloir qu'on milite pour des subsides. Je m'arrête ici, mais je veux juste saluer la richesse de la réflexion au terme du projet Di Narr, parce qu'il y a un rapprochement extrêmement fort qui s'effectue entre ce qu'on pourrait appeler des disciplines, peut-être qui ne semblent pas toujours si proches, mais qui l’ont fondamentalement toujours été.
Références citées
Dufays Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang.
Halté, Jean-François (1998), «L'espace didactique et la transposition », Pratiques, n°97-98, p. 171-192. DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1998.2485
Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, PUF.
Pour citer l'article
J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni, "La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande", Transpositio, Conversations critiques, 2025http://www.transpositio.org/articles/view/la-narratologie-dans-l-enseignement-du-francais-en-belgique-en-france-au-quebec-et-en-suisse-romande
Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande
Le présent dossier regroupe des communications qui rendent compte d’expériences d’enseignement concrètes associées à la narratologie. Il s’agit des actes de l’un des deux volets du colloque organisé dans le cadre du projet DiNarr. qui s’est déroulé à l’Université de Lausanne et à la Haute École pédagogique du Canton de Vaud du 6 au 7 mars 2025. Si le premier volet a été consacré à la définition de notions narratologiques potentiellement utiles à l’enseignement sur un plan théorique (voir le n° 47 des Cahiers de narratologie), le second volet s’est quant à lui intéressé aux manières dont la narratologie a pu être mobilisée dans des classes de différents degrés (primaire, collège, gymnase).
Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande
Le présent dossier regroupe des communications qui rendent compte d’expériences d’enseignement concrètes associées à la narratologie. Il s’agit des actes de l’un des deux volets du colloque organisé dans le cadre du projet DiNarr1 qui s’est déroulé à l’Université de Lausanne et à la Haute École pédagogique du Canton de Vaud du 6 au 7 mars 2025. Si le premier volet a été consacré à la définition de notions narratologiques potentiellement utiles à l’enseignement sur un plan théorique (voir le n°47 des Cahiers de narratologie), le second volet s’est quant à lui intéressé aux manières dont la narratologie a pu être mobilisée dans des classes de différents degrés (primaire, collège, gymnase). Ces deux volets du colloque sont ainsi représentatifs de l’un des objectifs premiers du projet DiNarr: créer un espace de dialogue entre des théoricien·nes du récit, des didacticien·nes et des enseignant·es 2. Les communications qui constituent ce numéro sont donc indissociables d’une réflexion plus globale regroupant des acteurs aux fonctions diverses autour d’un même objectif : mieux comprendre la narratologie scolaire d’aujourd’hui pour envisager celle de demain. Elles n’en restent pas moins caractérisées par des enjeux didactiques spécifiques, qui interrogent les processus de transposition didactique (Schneuwly 1995), la transformation des savoirs pour et dans les classes, ainsi que leur circulation possible entre le milieu de la recherche et celui de l’enseignement (sur la circulation des savoirs, voir le dossier n°2 de Transpositio 3). À ce titre, il semble important de problématiser ces deux concepts aux fondements de la didactique du français, afin de cerner les enjeux liés à la narratologie en contexte scolaire.
La transposition didactique : une recontextualisation des savoirs académiques
Pour Schneuwly (1995), le savoir existe d’abord dans le contexte qui a entouré sa construction: il n’existe pas en premier lieu pour être enseigné. Lorsqu’il devient un savoir enseigné, il devient un autre savoir, un savoir apprêté pour un contexte d’enseignement, un degré, des élèves, une classe.
L’une des manières de concevoir la transposition didactique est la suivante: si l’on définit le didactique, objet de la didactique, comme la transmission et diffusion de savoirs et de pratiques, d’ailleurs consubstantiellement liés, dans des institutions spécialisées à cet effet, la transposition didactique en est constitutive, avec le système didactique. Les savoirs et pratiques sont en effet transportés de là où ils sont utilisés vers une institution où ils deviennent objets d’enseignement et d’apprentissage. (Schneuwly & Ronveaux 2021)
Ne se réduisant pas à une vulgarisation, une simplification ou un appauvrissement du savoir académique, le savoir transposé didactiquement répond à deux principes: il est modélisé pour le rendre enseignable et apprenable, décomposés en éléments et réorganisés selon une progression, en prenant en considération la nature des savoirs, mais aussi des pratiques et des institutions. Par conséquent, les savoirs académiques n’ont pas vocation à être reproduits fidèlement en classe: ils se transforment et prennent une autre signification en contexte scolaire, dans un processus souvent décrit comme un mouvement de décontextualisation et recontextualisation. Les concepts issus de la narratologie ont connu des transpositions didactiques variées, dont on lit les effets aujourd’hui avec du recul, en reconnaissant leurs apports pour les apprentissages des élèves, mais également leurs éventuels freins à l’apprentissage, dus à une transposition didactique peut-être incomplète ou à reconsidérer.
La circulation des savoirs entre recherche et enseignement: constats et pistes
Dans les écrits scientifiques rédigés par les didacticien·nes du français, émerge un consensus autour d’une double portée de la discipline : théorique et pragmatique.
À propos de l’analyse des situations scolaires, la didacticienne Élisabeth Nonnon soulignait déjà en 1990 la nécessité d’interroger les rapports qui existent entre, d’un côté, les modèles théoriques construits pour rendre compte de la pratique enseignante et, de l’autre, la réalité́ de cette pratique et les enjeux de son fonctionnement. Bertrand Daunay et Yves Reuter rappellent quant à eux que «l’émergence de la didactique du français s’est faite sous le signe d’une double tension […]entre une inscription dans la pratique et une exigence théorique» (2008: §6). Claudine Garcia-Debanc (2008) insiste sur l’articulation de la recherche en didactique du français avec l’institution scolaire et s’interroge sur la diffusion de ses résultats dans la communauté enseignante. Bernard Schneuwly (2014) rappelle que la didactique du français a pour objet la transmission de savoirs dans des institutions spécialisées à cet effet, précisant que le terme «savoirs» renvoie toujours également à des savoir-faire. La didactique du français se voit donc attribuer le rôle moteur de coordination des savoirs issus des différentes disciplines constitutives. Le thème de l’articulation entre théories et pratiques apparait donc comme fondamental dans les discours qui interrogent la nature même de la didactique du français, sa constitution comme une discipline scientifique et ses liens avec la profession d’enseignant·e. Cette double visée n’est pas spécifique à la didactique du français, mais rassemble les disciplines parentes des sciences de l’éducation. À ce titre, l’anthropologue Margaret Eisenhart posait de manière claire la nécessité d’une validation à la fois scientifique et pratique:
Dans le domaine de l'éducation, la recherche doit être pertinente sur le plan pratique et scientifiquement rigoureuse. Les modèles de recherche les plus élégants et les plus sophistiqués peuvent facilement aboutir à un échec si les résultats ne sont pas compréhensibles par les praticiens, ne sont pas pertinents pour la pratique ou ne peuvent être mis en œuvre. (Eisenhart 2005: 57, notre traduction)
Or, si l’on examine les usages que font les enseignant·es de la recherche en sciences de l’éducation et en didactique, les résultats sont sans appel : « les résultats des recherches en didactique semblent […] réservés aux didacticiens eux-mêmes qui les produisent, en vue de les réinvestir dans d’autres recherches » (Lenoir 2000: 193). Les enseignant·es consommeraient peu de travaux de recherches en didactique, et corollairement, ces derniers ne conduiraient guère à faire évoluer les pratiques scolaires. C’est le constat que Chartrand et Lord élaborent à la suite de la recherche ELEF portant sur les pratiques d’enseignement de l’écriture et de la grammaire au secondaire québécois:
force est de constater que la recherche en didactique du français n’a pas eu un impact majeur sur l’état de cette discipline, ici. Est-ce à cause des lacunes dans la formation initiale et continue, des stratégies de diffusion, de l’incompatibilité des propositions émanant de ces recherches avec les «habitus» du corps enseignant ou avec les contours de la matrice disciplinaire ou les quatre à la fois? (Chartrand & Lord 2013: 532)
A ces raisons documentées par Chartrand et Lord, s’ajoutent celles définies par Chevallard, pour qui ce faible réinvestissement des travaux de recherche peut être dû à la «tentation académique» qui porte les chercheur·ses «à se penser en surplomb par rapport au monde social qu’ils étudient» et non de s’y positionner en tant qu’un autre type d’acteur·rice (2010: 9). La recherche ignorerait les questions vives des enseignant·es, et leurs véritables besoins. Ou, pis encore, les chercheur·ses comprendraient les besoins des praticien·nes de manière erronée et feraient des interprétations infidèles aux situations problématiques observées dans la classe.
Alors, que faire pour tenter de renouer avec une circulation des savoirs (Dugal et Léziart 2004) entre tous les acteur·rices de la formation: chercheur·ses, formateur·rices, enseignant·es ?
Une première piste a constitué à rapprocher la recherche du terrain: depuis les années 1970, beaucoup de chercheur·es en didactique se sont d’ailleurs tourné·es vers des dispositifs de recherche collaboratifs pour favoriser une dynamique de coopération entre enseignant·es et chercheur·ses dans laquelle «chacun est connaisseur, avec un sens du jeu qui lui est propre» (Sensevy 2001: 680). Différents types de recherche ont été mis en place dans la foulée: recherche-action, ingénierie didactique, design-experiment, design-based research, lesson studies (Dolz & Lacelle 2017).
Parallèlement, dès les années 2000, des recherches descriptives à large échelle se sont multipliées en didactique afin de documenter les pratiques d’enseignement et de formation au plus près de la réalité (Schneuwly & Dolz 2009; Dolz & Gagnon 2018; Ronveaux & Schneuwly 2018; Brunel et al. 2024).
Une autre piste consisterait à investir les espaces de formation (initiale & continue), de manière à ce qu’ils permettent des constructions de savoirs théoriques et praxéologiques, ainsi qu’une véritable circulation des savoirs entre recherche et enseignement, mais également entre enseignement et recherche, en sensibilisant les chercheur·ses aux problématiques auxquelles font face les enseignant·es.
Gageons que le projet DiNarr ainsi que les actes de colloque dont ce numéro est issu, avec l’ouverture proposée à des enseignant·es, à des chercheur·ses et à des formateur·rices de partager leurs travaux, pourra contribuer à la circulation des savoirs entre ces espaces.
Les interventions réunies dans ce numéro
Les interventions qui suivent témoignent d’expériences d’enseignement concrètes variées, qu’il s’agisse de résultats de recherche, de témoignages d’enseignants ou encore d’expérience didactique, de façon à illustrer ce qui se passe dans les classes en s’intéressant à divers degrés scolaires : le primaire (4-12 ans), le collège (12-15 ans) et le gymnase (15-18 ans).
Au primaire
Claire Detcheverry met en avant la nécessité de considérer les albums comme des supports multimodaux pour s’intéresser à la manière dont le récit prend forme, notamment dans les albums sans texte. Elle souhaite ainsi penser la manière dont les contenus s’incarnent médiatiquement pour travailler la compréhension d’albums chez les plus jeunes en recourant notamment aux notions de point de vue, d’ocularisation et de focalisation.
Dans le cadre d’une recherche collaborative,Sandrine Aeby et Glaís Sales Cordeiroont élaboré un outil, le «système récit-personnages», visant à répondre à une demande du terrain relative au travail de la compréhension au cycle 1 (4-8 ans) : comment travailler la compréhension avec des albums de littérature de jeunesse à dominante narrative et ceci au-delà de leur singularité? Dans cet article, elles présentent cet outil, utilisé pour travailler la compréhension de l’album C’est moi le plus beau de Mario Ramos avec des élèves de 5-6 ans. Elles montrent comment le personnage possède une fonction structurante dans le récit (intentions, sentiments, actions), notamment au niveau de l’intrigue et joue ainsi un rôle plus important dans la compréhension du récit que l’ordre chronologique, lequel est très souvent mobilisé dans les classes pour aider de jeunes élèves à comprendre un texte.
Au collège
Dans un article consacré à la description, Vanessa Depallens s’intéresse à la manière dont cette dernière est définie en tant qu’objet d’enseignement dans le canton de Vaud (prescriptions, manuels) et dans quelle mesure certaines approches théoriques (linguistique textuelle, théories du récit, de la fiction) permettent de redéfinir cet objet de façon à inciter les élèves à produire des descriptions mieux insérées dans leur récit et mises au service de l’économie du récit.
Sonya Florey et Marie Béguin se penchent quant à elles sur le potentiel structurant du schéma narratif ainsi que sur les limites de cet outil, très utilisé dans les classes, notamment pour rédiger des récits. En revenant sur une séquence didactique qui a été enseignée dans une classe de 9H (12-13 ans), elles montrent comment le schéma narratif peut conduire à la production d’un récit cohérent sur un plan chronologique, mais également intéressant sur le plan de la tension narrative, ceci en amenant les élèves à «épaissir» un épisode central de leur récit.
Au gymnase
Léo Bolliger présente une séquence d’enseignement faisant la part belle aux incipits de nouvelles de Ramuz tirées du recueil L’Homme perdu dans le brouillard et autres nouvelles. Dans cette séquence, les élèves doivent analyser comment les premiers mots d’un récit peuvent capter leur attention et, dans une perspective comparative, ils et elles sont amené·es à interpréter les choix narratifs opérés par Ramuz. Pour ce faire, l’analyse des incipits est conduite sur plusieurs niveaux (grammatical, stylistique et lexical, narratologique).
Yves Renaud met pour sa part en avant l’intérêt de faire écrire les élèves pour les inciter à s’interroger sur les mécanismes d’un texte, plus précisément sur les changements de perspective dans les récits à la troisième personne. Au lieu d’enseigner théoriquement des notions narratologiques pour ensuite les appliquer à un récit, l’auteur de cet article propose de partir d’une expérience d’écriture créative guidée à même de susciter la curiosité interprétative des élèves. C’est cette envie de discuter des textes qu’ils ont rédigés qui va alors favoriser l’introduction de notions narratologiques, réinvesties par la suite lors de l’analyse de récits lus en classe.
Ces interventions témoignent des possibilités qu’offrent certains outils narratologiques en classe de français, ceci au-delà d’un certain applicationnisme souvent décrié. Chaque proposition montre comment ces outils peuvent être mobilisés dans le but de favoriser la compréhension, l’interprétation et la production de récits variés et jugés intéressants.
Bibliographie
Brunel, Magali, Jean-Louis Dufays, Judith Émery-Bruneau & Sonya Florey (2024), La progression en lecture au fil de la scolarité. Une recherche internationale, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Chevallard, Yves (2010), «La didactique, dites-vous?», Éducation et didactique, n°4 (1), en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL : https://doi.org/10.4000/educationdidactique.771
Daunay, Bertrand & Yves Reuter (2008), «La didactique du français : questions d’enjeux et de méthodes», Pratiques, n°137-138, 137-138, en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL: https://doi.org/10.4000/pratiques.1152
Daunay, Bertrand, Yves Reuter & Bernard Schneuwly (2011), «L'interrogation des concepts et des méthodes en didactique du français», in Les concepts et les méthodes en didactique du français, B. Daunay, Y. Reuter & B. Schneuwly (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 13-31.
Dolz, Joachim & Nathalie Lacelle (2017), «L’innovation en didactique : de la conception à l’évaluation des dispositifs», La Lettre de l'AIRDF, n°62, p. 5-9.
Dolz-Mestre, Joachim, & Roxane Gagnon (2018), Former à enseigner la production écrite, Villeneuve-d’Ascq,Presses universitaires du Septentrion.
Dugal, Jean-Paul & Yvon Léziart (2004), «La circulation des savoirs entre recherche et formation : l’exemple des concepts didactiques lors d’une action de formation de conseillers pédagogiques», Revue française de pédagogie, n°149, p. 37-47.
Eisenhart, Margaret (2005), «Science Plus: A Response to the Responses to Scientific Research in Education», Teachers College Record, n° 107 (1), p. 52–58, en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL : https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2005.00456.x
Garcia-Debanc, Claudia (2008), «De la configuration didactique au modèle disciplinaire en acte : trente ans de didactique du français avec Jean-François Halté», Pratiques, n°137-138, en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL: http://journals.openedition.org/pratiques/1151
Lenoir, Yves (2000), «La recherche dans le champ des didactiques : quelques remarques sur les types de recherches, leur pertinence et leurs limites pour la formation à l’enseignement», Revue suisse des Sciences de l’Éducation, n°22 (1), p. 177-222, en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL: https://doi.org/10.25656/01:3743
Nonnon, Élisabeth (1990), «Est-ce qu’on apprend en discutant ? Interaction maitre-élèves en S.E.S.», in La communication inégale. Heurs et malheurs de l’interaction verbale, F. François (dir.), Paris,Delachaux & Niestlé, p. 147-212.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (dir.) (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Schneuwly, Bernard & Joachim Dolz (dir.) (2009), Des objets enseignés en classe de français, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Schneuwly, Bernard & Christophe Ronveaux (2021), «Une approche instrumentale de la transposition didactique», Pratiques,n°189-190, en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL: https://doi.org/10.4000/pratiques.9515
Sensevy, Gérard (2001), «Théories de l'action et action du professeur», in Théories de l'action et éducation, J.-M. Baudouin (dir.), Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, p. 203-224, en ligne, consulté le 29 mai 2025, URL: https://doi.org/10.3917/dbu.baudo.2001.01.0203
Pour citer l'article
Vanessa Depallens et Sonya Florey, "Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande", Transpositio, Enseigner la narratologie aujourd'hui, 2026http://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-avec-la-narratologie-aujourd-hui-retour-sur-quelques-experiences-d-enseignement-dans-divers-degres-scolaires-en-suisse-romande
Faire écrire pour enseigner le point de vue
«On m’a trop donné, bien avant l’envie», telle pourrait être la complainte de l’élève à qui l’on sert sur le plateau du cours magistral des théories toutes prêtes à appliquer. Gavé avant que d’avoir faim, il ne peut saisir les enjeux d’une telle générosité scientifique et s’en désintéresse avant même que de chercher à les comprendre. Son enthousiasme d’apprenant se limite alors à se demander comment placer les bons termes dans les tableaux ou les phrases exigées par l’épreuve certificative qu’on lui promet déjà.
Plus qu’aucun autre, l’enseignement de la narratologie peut souffrir d’un tel désengagement. Son savant lexique a beau résulter des études les plus passionnées et des exigences les plus pointues concernant la mise en récit des histoires, les élèves se tiennent bien éloignés de telles préoccupations. Si les savants n’en ont cure, les enseignants (par ailleurs également passionnés par les questions de narratologie) le savent: avant toute chose, il faut lutter contre ce qu’on pourrait appeler le syndrome Johnny Hallyday: il faut donner l’envie, l’envie d’avoir envie.
Faire écrire pour enseigner le point de vue
«Qu'on me donne l'envie
L'envie d'avoir envie
qu'on allume ma vie1»
Introduction
«On m’a trop donné, bien avant l’envie», telle pourrait être la complainte de l’élève à qui l’on sert sur le plateau du cours magistral des théories toutes prêtes à appliquer. Gavé avant que d’avoir faim, il ne peut saisir les enjeux d’une telle générosité scientifique et s’en désintéresse avant même que de chercher à les comprendre. Son enthousiasme d’apprenant se limite alors à se demander comment placer les bons termes dans les tableaux ou les phrases exigées par l’épreuve certificative qu’on lui promet déjà.
Plus qu’aucun autre, l’enseignement de la narratologie peut souffrir d’un tel désengagement. Son savant lexique a beau résulter des études les plus passionnées et des exigences les plus pointues concernant la mise en récit des histoires, les élèves se tiennent bien éloignés de telles préoccupations. Si les savants n’en ont cure, les enseignants (par ailleurs également passionnés par les questions de narratologie) le savent: avant toute chose, il faut lutter contre ce qu’on pourrait appeler le syndrome Johnny Hallyday: il faut donner l’envie, l’envie d’avoir envie.
C’est ainsi qu’on lira dans cet article la présentation d’un dispositif destiné à susciter l’appétence intellectuelle pour certains aspects des rouages du récit, aussi bien chez des élèves du secondaire 1 que chez des gymnasiens/lycéens du secondaire 2. Ici il s’agit plus précisément de les rendre capables de repérer les changements de perspective narrative dans les récits à la troisième personne et de percevoir tout l’intérêt qu’il y a à interroger les effets de ces changements. Pour que la connaissance prenne sens pour eux, nous ferons en sorte qu’elle s’incarne dans une démarche active qui fasse passer les élèves du statut de simples récepteurs à celui de véritables acteurs de leur apprentissage. On le verra: tout commence par un atelier d’écriture articulé en deux temps, lequel vise à susciter de nouvelles interrogations sur les récits – tant du point de vue de leur analyse que de leur élaboration – et à amener les participants à s’approprier un vocabulaire inédit, dont la valeur s’impose alors avec évidence.
Candeur académique et structuralisme démodé
On peut soupçonner une certaine candeur de la part des savants lorsqu’ils imaginent comment les résultats de leurs recherches vont être diffusés auprès des profanes. Les éléments théoriques qu’ils ont réussi à établir, une fois ceux-ci publiés et validés par la communauté scientifique à laquelle ils appartiennent, devraient pouvoir s’imposer sans effort au public, notamment aux enseignants et à leurs élèves, pour le plus grand avantage de ces derniers. En effet, ceux-ci n’ont-ils pas tout à gagner d’«[envisager] la théorie narrative comme une pourvoyeuse d’outils pour l’analyse et la production de récits dans la classe de français», comme le formulait l’argumentaire du colloque des 6 et 7 mars 20252? On pourrait presque penser qu’il suffirait aux enseignants et à leurs élèves de s’en emparer pour les appliquer et de le faire avec reconnaissance. Cependant, s’il y a eu colloque, c’est que les chercheurs constatent la lenteur des processus de scolarisation, «les enquêtes de terrain [tendant] à montrer que l’outillage mobilisé dans les classes de français n’a guère évolué en un demi-siècle […], alors que la théorie du récit, elle, n’a jamais cessé d’évoluer3».
Il est aisé alors de déplorer avec Baroni que «les théoriciens du récit se [préoccupent] peu des usages sociaux ou scolaires des notions dont ils débattent» (Baroni 2023: § 3). On peut cependant les comprendre: ils n’envisagent leurs conclusions que comme des énoncés provisoires et ne sauraient se reposer sur leurs acquis – il ne peut s’agir que d’étapes: les savoirs construits doivent permettre d’observer de nouveaux faits; de nouvelles questions surgissent, de nouveaux problèmes sont à résoudre et la recherche continue. Or pour enseigner, il faut que les savoirs dit savants (Chevallard 1985) se présentent d’une façon un tant soit peu stabilisée, objets d’un consensus le plus large possible – difficile sans cela de formuler les contenus à faire acquérir. Une mise en texte est donc nécessaire (Philippe 2010), une reconfiguration qui rendra le savoir enseignable, c'est-à-dire programmable: au contraire des initiés que sont les savants, les élèves ne sont immergés dans aucune problématique et ont besoin d’un début pour pouvoir apprendre. Du savoir savant au savoir enseigné, il faut donc ce que Chevallard appelle une transposition didactique, mieux: une reconstruction, qui ne suit plus l’ordre de la rationalité théorique «mais qui tient compte d’une logique d’apprentissage» (Carette & Rey, 2010: 135). Cette étape, quoique nécessaire, pourrait apparaître comme une «trahison» du savoir initial (Philippe 2010: 44) en ce qu’elle fait disparaître les enjeux de la pratique source pour se généraliser. Elle n’est toutefois pas aussi flagrante dans le cas de la narratologie que dans d’autres disciplines. La profusion terminologique des théories du récit pourrait bien en effet contribuer à entretenir chez les uns et les autres ce que Chevallard (1991: 16) désigne comme une «fiction d’identité» entre le «savoir-tel-qu’il-est-enseigné» et le «savoir-initialement-désigné-comme-devant-être-enseigné» (1991: 15), fiction qu’il considère comme nécessaire à la légitimation de l’enseignement. Elle tend ainsi à faire accroire que le simple maniement du lexique permettrait de constituer des boîtes à outils efficaces, au risque de réduire, pour les enseignants et, par leur intermédiaire, pour les élèves, l’usage de la narratologie à une «petite technique pédagogique […] desséchante» (Compagnon, cité par Baroni 2023: § 3). On se souvient alors de la critique que Todorov avait émise en 2007: il déplorait que, à l’école, les études littéraires n’eussent plus pour but que de faire connaître «les outils dont elles se servent» (Todorov 2007: 18). Quoique bien de nos enseignants en formation initiale applaudissent cette critique et se déclarent séduits par le modèle du sujet lecteur qui valorise les émotions provoquées par les textes littéraires au détriment des approches plus formelles (Langlade 2004), le technicisme semble rester la norme en classe de français, en particulier au secondaire 2 (Ahr & de Peretti 2023; Claude 2024). Cela dit, l’enthousiasme structuraliste ayant quelque peu passé, de plus en plus d’enseignants osent désormais affirmer que plusieurs des notions les plus sacrées héritées de Genette (1972) se révèlent être problématiques, «que ce soit au niveau de leur transmission ou en raison de difficultés de leur maniement par les élèves» (Baroni 2023: §5). Les narratologues de leur côté s’épouvantent que les institutions scolaires ignorent leurs efforts pour «faire évoluer la narratologie en la pensant au plus près des phénomènes verbaux, médiatiques, rhétoriques ou cognitifs qui sous-tendent les notions dégagées par les pères fondateurs de la discipline» (Baroni 2023: § 2). Ils persistent à revendiquer l’utilité de leur discipline, ne serait-ce qu’en tant que pourvoyeuse d’outillage scolaire. Il semble qu’on tourne en rond… Est-ce à nouveau une question de transposition didactique que ne verraient toujours pas les chercheurs? Ou une question de manque de temps et d’engagement de la part des profs pour la remise à niveau de leurs connaissances scientifiques? Nous ne le croyons pas (ou pas seulement). À l’instar de Goigoux, Renaud & Roux-Baron (2021), il nous semble que le problème est ailleurs: il ne suffit pas d’avoir une boîte à outils qui fasse le trait d’union entre chercheurs passionnés et enseignants consciencieux pour qu’aient lieu les apprentissages. Il ne suffit pas non plus de vanter l’utilité qu’on perçoit dans cet outillage pour convaincre les élèves de son intérêt. De ce point de vue, en français, le cas de la narratologie est remarquable: la spécificité de son discours masque plus que tout autre discipline l’écart qu’il y a entre savoir savant et savoir fabriqué pour être enseigné –pour reprendre les termes du titre de l’ouvrage de Jonathan Philippe (2010). Mais de même qu’il n’est pas souhaitable de réduire l’enseignement de la poésie à l’apprentissage et à l’application mécanique de quelques termes de versification –comme si la maîtrise d’un lexique suffisait à faire éprouver aux élèves ce qui, dans la poésie, touche à l’essentiel de l’existence–, de même la simple présentation d’un glossaire narratologique ne saurait déclencher la passion de la grammaire du texte chez des élèves qui, bien souvent, ne pensent d’abord qu’à passer leur année. Il s’agit de donner sens à ce qui est enseigné et de faire de ce sens de quoi les embarquer: il faut leur donner l’envie.
Chevallard pensait un peu vite que la nouveauté des concepts suffisait à mobiliser leur énergie comme le sont la présence de problèmes à résoudre dans le monde savant (1991: 65-69), même s’il distinguait deux temps dans la transposition didactique, le premier qui fait du savoir savant un objet d’enseignement, le second, celui de la préparation des cours, qui rend possible cet enseignement. La question posée par ce deuxième type de transposition didactique dit «interne» (38) rejoint celle des stratégies d’apprentissage, question au cœur des préoccupations d’une école rendue plus hétérogène par la démocratisation de l’enseignement d’une part, et la nécessité de dépasser une conception purement utilitariste des contenus enseignés d’autre part. Ne pas seulement viser une acquisition de savoirs et de savoir-faire et l’aptitude à les mobiliser dans la vie pratique, notamment professionnelle, c’est ce que précise bien le plan d’étude actuel:
La lecture des textes littéraires permet […] de découvrir, dans toute sa diversité, la relation de l’homme à lui-même, à autrui, à la réalité sociale, politique et culturelle.
S’il est question de favoriser une «réflexion constante sur la langue», celle-ci est au service de l’alimentation de l’imaginaire des élèves et du développement de leurs moyens d’expression dans une triple perspective:
Se découvrir et s’affirmer en tant que personne; se définir et s’engager dans la relation à autrui; se situer face au monde en tant qu’individu et citoyen.4
Autrement dit, au secondaire 2 (et, de façon plus générale, à l’école), quand on explore formes et contenus et qu’on en apprend les spécificités, on ne s’intéresse pas à la théorie et à sa mécanique application en tant que telles. Voilà qui oblige à penser comment donner du sens à ce qu’on enseigne et à prévoir des dispositifs engageants. Comme nous le disions, la narratologie est une discipline qui pourrait (à tort) laisser penser que la maîtrise d’un jargon suffit, d’autant plus que celui-ci autorise les élèves à tenir des discours finalement peu impliqués, dénués de sensibilité, voire de connivence, avec les textes littéraires. Or la narratologie vise moins à disséquer les récits qu'à dévoiler, dans leur architecture, une dynamique essentielle: celle par laquelle l'humain donne forme au temps, au sens et à soi-même – et à son rapport au monde. Elle affine la compréhension en lecture en révélant comment les phénomènes textuels les plus subtils peuvent rendre compte de l’expérience humaine et même l’accompagner. C’est ce que Paul Ricœur invite à comprendre quand, dans son ouvrage Temps et récit, quand il soutient
que les récits ont le pouvoir d’agencer, de réfléchir et de conférer un sens au temps [et qu’alors,] réalité problématique et angoissante, celui-ci devient “humain” grâce aux narrations, qui le travaillent, le mettent en forme et le donnent à penser (Dubied 2000: § 2).
Les narratologues ne s’y trompent pas, et, comme Baroni (2010), font le lien entre les enjeux de leur discipline et les thèses de l’herméneute français.
On comprend dès lors que l’étude de la narrativité incite aussi à la création. En prenant conscience des mécanismes qui sous-tendent le récit, elle permet à celui qui écrit d’éclairer la complexité de sa mise en forme, en en saisissant les enjeux. Ce dernier point est ce qui inspire le dispositif didactique que nous présentons dans cet article et la stratégie adoptée pour faire sentir les enjeux des ambitions profondes de la narratologie. Car, oui, il faut adopter une stratégie: les élèves, on ne peut leur en faire le reproche, se trouvent à mille lieues de ces préoccupations. Il n’est pas pour autant question d’en rabattre et de se contenter de ne leur présenter que du «scolaire», autrement dit, tout en prenant acte de la distance qui sépare les apprenants des savoirs les plus élevés, de sacrifier les finalités véritables à la seule acquisition de procédures et de compétences et passer ainsi à côté de la mission véritable de l’école. Il faut que celle-ci parvienne à capter l’attention de son public et à la transformation intellectuelle qu’elle lui promet. Contraindre à apprendre ne donne pas de bons résultats, d’une part parce qu’un apprentissage subordonné à la peur de la punition le détourne de son sens, et d’autre part parce que l’appréhension du sens d’un apprentissage est justement ce qui permet de s’en approprier les contenus. Célestin Freinet, il y a plus d’un siècle, dénonçait ces savoirs dépourvus de finalité qu’il désignait comme scolastiques, des savoirs imposés, comme déversés dans un entonnoir ou comme enregistrés sur une bande magnétique et appelés à être restitués à la demande par l’exercice de la mémoire. Il n’y voyait alors pas «le moindre processus intelligent d'intégration à la vie mentale», juste l’acquisition de «certains procédés mnémotechniques qui font illusion». (Freinet 1969: 157). Lui revendiquait une pédagogie reposant sur deux principes: premièrement que tout enfant peut apprendre (principe d’éducabilité), et deuxièmement qu’on ne peut apprendre à sa place (principe de liberté) (Meirieu 2018).
Comme les élèves ne sont pas «spontanément curieux» (Meirieu 2015), il s’agit de se montrer rusé. Rousseau, on le sait, le prônait déjà, lui qui imaginait quelles astuces devait déployer le précepteur d’Émile pour inciter ce dernier à apprendre. Par exemple en matière d’astronomie: en lieu et place de pédants discours que fuirait son élève pour aller folâtrer dans sa chambre, il choisit de perdre l’indolent en forêt afin que celui-ci se rende compte de l’avantage qu’il y a à connaître les points cardinaux (Rousseau 2009: 257-260). Il convient toutefois de trouver des solutions plus subtiles si l’on ne veut pas en rester à une approche purement pragmatique du savoir.
Cadre théorique pour un dispositif engageant
Le socioconstructivisme, dont la théorie «correspond à l'état actuel de la question des apprentissages et des savoirs» (Astolfi 2021: 1255), nous y invite. On l’a dit, si, comme l’affirme Rosier, «l’inféodation disciplinaire mène à un rapport applicationniste aux théories de référence», alors «l’enseignement du français ne peut se réduire à une linguistique appliquée» (2005: 9). Il ne s’agit pas de transmettre un savoir figé à appliquer mécaniquement, mais bien de faire émerger un rapport vivant au savoir, nourri par une véritable appropriation intellectuelle et sensible.
Dans cette perspective, l’élève n’est pas un simple réceptacle passif: «c’est le sujet en train d’apprendre qui construit son savoir, sans qu’il puisse lui être imposé efficacement de l’extérieur» (Astolfi 2021: 127). Le passage de l’ignorance à la connaissance n’est donc pas linéaire ni transmissible tel quel. Ce que vise l’enseignement, c’est la «transformation des représentations» (Astolfi 2021: 127). La question n’est plus tant de transposer des savoirs savants en savoirs enseignables, mais de permettre une authentique appropriation, en développant des compétences, entendues ici comme la capacité à mobiliser ces savoirs au service de l’analyse littéraire et de la compréhension fine des mécanismes de mise en récit, dans toute leur complexité et leurs effets les plus subtils. Dans cette optique, le socioconstructivisme nous invite à ne pas «exposer le savoir à la classe», mais bien à «exposer la classe au savoir», puisque l’enjeu ne réside pas dans une simple communication d’informations, mais dans un processus d’appropriation engageant et personnel. La transmission dogmatique, aussi efficace puisse-t-elle paraître à court terme – très tentante dans le cas de la narratologie avec son vocabulaire et ses définitions – montre vite ses limites: mémoriser des termes pour les appliquer à quelques extraits de textes ne produit bien souvent que des résultats superficiels, certes évaluables, mais peu transformants. Ce que l’on vise, au contraire, c’est un développement humain, une réflexion personnelle sur la fabrique du littéraire et une appréciation plus éclairée, plus intériorisée, de ses enjeux.
C’est ici que la notion de dévolution proposée par Brousseau (1998) devient centrale. L’enseignant, en tant qu’ingénieur didactique, conçoit un dispositif où il ne s’agit pas de livrer des réponses, mais de créer les conditions d’un questionnement véritable. Rappelons la définition que donne Brousseau de cette opération: elle est «l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage […] ou d'un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert» (1998, p. 303). Autrement dit: on pose un cadre et à l’élève de se débrouiller (moment adidactique de la situation didactique)! La qualité du dispositif dépend donc du respect de deux critères fondamentaux: l’acceptabilité (l’élève doit recevoir l’apprentissage de façon positive) et l’adéquation (le dispositif doit permettre d’atteindre les objectifs visés) (Astolfi 2021: 130). Dans le dispositif que nous présentons ici, la priorité été donnée à l’acceptabilité, comme condition nécessaire à l’ouverture d’une dynamique d’appropriation réelle.
Comme les élèves sont extérieurs aux communautés scientifiques qui ont élaboré les savoirs savants de leur discipline, il faut les conduire à entrevoir quelque chose du processus qui les a fait naître. Autrement dit, l’enseignant doit proposer des médiations qui rendent ces savoirs non seulement accessibles, mais désirables. Car on ne mobilise pas un vocabulaire spécialisé pour faire plaisir au prof ou réussir une épreuve certificative, mais parce qu’on en saisit la pertinence, l’efficacité analytique, la fécondité critique. C’est en s’interrogeant réellement sur les mécanismes textuels que les élèves éprouvent le besoin de ces outils conceptuels, et peuvent en comprendre la portée comme instruments de lecture et de pensée.
Malgré la tentation qu’il y aurait à exposer un appareil théorique complexe à appliquer ensuite sur un corpus littéraire, ce qui, il faut le dire, faciliterait par la même occasion la mise au point d’exercices et d’évaluation notées des plus scolaires, on cherche plutôt à susciter une curiosité interprétative et une envie de discourir qui appelleront comme tout naturellement l’introduction de notions nouvelles. Celles-ci déploieront ainsi tout leur sens dans un mouvement d’élucidation, soutenu par l’enseignant lors des phases de guidage.
Cette façon d’envisager l’enseignement ne vise pas seulement une acquisition de connaissances, mais un élargissement des capacités de pensée. Il s’agit bien de développement cognitif, voire psychique, tel que l’entend Vygotski. Selon ce dernier, on le sait, ni les fonctions psychiques supérieures – telles que la mémoire logique, la volonté, le raisonnement (Brossard 2004: 29) – ni les connaissances ne peuvent être implantées de l’extérieur: l’école doit créer les conditions de leur émergence par l’activité propre de l’élève, dans un contexte structurant. C’est à ce titre que l’apprentissage devient moteur de développement. Encore faut-il que les contenus proposés ne soient ni trop éloignés des acquis de l’élève, ni trop évidents: ils doivent se situer dans ce que Vygotski nomme la zone de développement prochain, cette bonne distance à laquelle un savoir, encore hors de portée immédiate, peut être conquis parce qu’il mobilise et étend ce que l’élève sait déjà faire. Comme le souligne Vygotski, «le bon apprentissage est celui qui devance le développement» (Brossard 2004: 90), et c’est précisément cette tension féconde que le dispositif didactique cherche à activer et que l’enseignant pourrait avoir la tentation de négliger avec la narratologie.
Notons enfin que cette conception rejoint celle de John Dewey (2011), pour qui l’apprentissage naît de l’expérience active, de la résolution de problèmes réels dans des contextes porteurs de sens. Ni Dewey ni Vygotski ne croient à l’efficacité d’une simple transmission descendante du savoir: tous deux insistent sur l’importance de l’apprentissage situé, c’est-à-dire enraciné dans des interactions sociales et des expériences concrètes. Le savoir ne prend forme qu’à travers des activités qui engagent le sujet, qui stimulent à la fois le désir d’apprendre et le questionnement personnel. L’élève est invité à réfléchir sur ce qu’il fait, sur pourquoi il le fait, sur ce que cela lui apprend de lui-même et du monde. Apprendre devient une démarche réflexive, un acte de construction de sens autant qu’un acte d’acquisition.
Problématique et dispositif
Il en est donc des leçons de français comme des récits: construire un dispositif, c’est prévoir de quoi éveiller la curiosité, ménager le suspense et réserver quelques surprises à des élèves qu’il s’agit d’embarquer dans une exploration intellectuelle susceptible de leur faire acquérir de nouveaux savoirs qui affinent leur compréhension des mécanismes narratifs. Or l’objectif de la séquence n’est pas facile à atteindre: en effet, parmi les difficultés que rencontrent les élèves dans leur apprentissage des notions narratologiques, il en est une redoutable: les élèves ont de la peine repérer les changements de perspective narrative dans les textes à la troisième personne, c'est-à-dire quand la narration hétérodiégétique passant par le narrateur bascule vers de la narration hétérodiégétique passant par le personnage (pour reprendre les termes retenus par Reuter 2025: 49-50) et, dans un même mouvement, à sentir l’intérêt d’en interroger les effets tout en observant l’incroyable complexité de sa construction. La preuve: les élèves se retrouvent extrêmement empruntés quand il s’agit de nommer ces effets, qu’ils soient visés par l’auteur ou qu’ils soient issus des interprétations du lecteur. C’est que les élèves se comportent en élèves: quand ils comprennent le texte qu’ils ont à lire (ce qui n’est pas toujours évident notamment parce que cela exige un certain engagement qu’ils ne sont pas forcément prêts à prendre), ils cherchent de façon toute mécanique les indices linguistiques de déplacements et de modifications de perspective dont on leur a livré la liste et se contentent de les étiqueter à l’aide de celle-ci. La théorie s’en trouve réduite à une simple procédure, l’objectif de compréhension et de problématisation n’est pas atteint. C’est là que les lamentions du rocker français à jamais insatisfait prend tout son sens: il faut leur donner l’envie d’avoir envie! Suscitons leur intérêt (Dewey 2011), pensons dévolution (Brousseau 1998), faisons de la leçon elle-même une intrigue.
Le dispositif présenté ici a donc été pensé pour répondre à cette problématique. On remarquera qu’il se passe du détour multimodal, ou «transmédial», terme que propose Baroni (2023) pour en défendre les vertus didactiques. On ne sort pas du domaine littéraire: on fait écrire les élèves pour commencer, les incitant à endosser le costume d’auteur et à éprouver, avant même d’en avoir présenté la théorie, les effets d’un changement de perspective narrative. Loin d’abandonner l’étude des structures textuelles qui conditionnent la mise en récit, on pousse les élèves à désirer cette étude: on espère qu’ainsi les élèves, devenus un tant soit peu écrivains, goûtent à la saveur (Astolfi 2021) de cette modalité narrative. Rappelons que l’atelier d’écriture présente deux avantages éprouvés: d’une part, il développe la confiance en soi (on écrit ensemble, de façon égalitaire, entre pairs), d’autre part il pousse les élèves à produire des textes en les forçant à s’interroger sur les pratiques et les théories qui organisent cette production (Reuter 1989).
Une proposition d’écriture à contrainte doit faciliter l’opération en stimulant la créativité des uns et des autres. Davantage que carcan, la contrainte doit jouer le rôle d’«ouvroir artisanal», selon la formule de Carole Bisenius-Penin (2013: 399). Ici, elle se fait en deux temps. Voyons cela de plus près.
Déroulement de la séquence
Première étape: Écrire des pensées
La formulation de la première consigne d’écriture doit permettre aux élèves de réaliser quelque chose de difficile: ils vont devoir trouver comment transcrire un discours intérieur souvent fragmentaire, qui se présente moins comme une pensée formulée que comme une ébauche intuitive à la syntaxe incertaine. Pour faciliter l’exercice, on leur propose de commencer par choisir une situation de leur quotidien, d’imaginer qu’ils se trouvent dans un lieu qui leur est familier, mais autre que le milieu scolaire, solution de facilité qui risquerait de susciter des textes où les élèves expriment leur difficulté à trouver sur quel sujet écrire – on veut dépasser ce genre de thèmes peu originaux. Ainsi la consigne, donnée par oral, aura la forme suivante:
Imaginez que vous vous trouvez ailleurs qu’ici, sur le chemin de l’école, à l’arrêt de bus, dans un magasin, là où vous pratiquez du sport, en famille, entre amis, etc. À quoi pensez-vous? Mettez ces pensées par écrit. Une dizaine de lignes suffisent: on tente une expérience!
En général, les élèves sont surpris et trouvent la chose bien difficile. On les encourage sans trop les ménager: «Essayez, ce n’est pas grave si ce n’est pas totalement réussi. Faites comme les écrivains, débrouillez-vous pour trouver une solution…»
Une vingtaine de minutes plus, on met en commun ces productions. Les élèves qui souhaitent lire leur texte le font comme il est d’usage dans ce genre de dispositif.
Voici un exemple de production (seule l’orthographe a été corrigée):
Quel abruti! Pourquoi c'est vers moi que tu viens, hein? Oh, c'est bon, ne me regarde pas comme ça... Et que je me frotte et que je ronronne, j'ai pas que ça à faire, moi... Lâche-moi, arrête de miauler, ça sert à rien, t'as déjà eu ta boustifaille! C'est quand que je pourrai enfin travailler sans que tu viennes poser tes miches sur mes feuilles, hein? Idiot! Heureusement que tu sais pas que demain c'est le véto. (Jessica, 17 ans)
Le discours porte les marques de l’oralité, comme les nombreux points d’exclamation révélateurs d’une certaine émotivité ou les points de suspension indiquant l’incomplétude propre à la pensée. À côté de plusieurs interjections, on peut relever la présence de questions rhétoriques, une syntaxe relâchée ou disloquée avec troncatures et effets de répétition, et surtout le recours à un vocabulaire familier. On notera que l’élève a eu la bonne idée de s’adresser mentalement à ce qu’on devine être un chat domestique pour surmonter la difficulté qui consiste à trouver des pensées suffisamment formulées pour les restituer plus facilement.
Deuxième étape: Le changement de point de vue
Il est alors demandé aux élèves de reprendre leurs textes, non pour les améliorer, mais pour en faire autre chose:
Réécrivez ces pensées en passant du “je” au “il” ou “elle”. Prenez comme temps de base le passé simple. Ne changez que le minimum nécessaire, restez au plus près du texte de départ. Ajoutez tout de même une ou deux phrases d’introduction afin de situer l’action: posez le décor.
Le nombre de contraintes est assez élevé, des contraintes plutôt techniques voire abstraites pour les élèves, même si ceux-ci sont censés en saisir parfaitement le sens. Pour faciliter, une fois encore, le travail d’écriture, l’enseignant leur fournit un exemple qu’il rédige à partir d’une des productions de la classe. Voyez ce que cela donne avec le texte de Jessica cité plus haut:
À peine Jessica s’était-elle remise à travailler que son chat bondit sur son bureau et se dirigea d'une patte résolue vers ses feuilles de révision. C'était le genre de choses que Jess avait du mal à supporter en cette veille d'examen. Ce maudit chat, quel abruti! Pourquoi c'était vers elle qu'il venait, hein? Oh, d'accord... mais qu'il ne la regarde pas comme ça... Et que je me frotte et que je ronronne, elle n'avait pas que ça à faire, elle... Qu'il la lâche, qu'il arrête de miauler, ça ne servait à rien, il avait déjà eu sa boustifaille! C'était quand qu'elle pourrait enfin travailler sans qu'il vienne poser ses miches sur ses feuilles, hein? Idiot! Heureusement qu'il ne savait pas que demain, c'était le véto.
Si les élèves comprennent alors aisément ce qu’on attend d’eux, ils posent quelques questions sur les temps, les questions de concordance, les variations possibles et les choix opérés lors de cette phase de transformation. On explique qu’il n’y a pas qu’une solution, on montre que le sens ou l’effet obtenu se voient modifiés selon les options retenues (pourquoi avoir préféré «demain» à «le lendemain», plus strictement correct?), mais que l’important est que ce qu’ils feront leur paraisse fluide, agréable à leur oreille intérieure. N’oublions pas que le français est la langue première des élèves pour lesquels cet atelier est mené, et que l’on s’appuie sur ce qu’ils ont acquis du français de manière implicite, à travers les interactions qui les ont reliés aux autres dès leur plus jeune âge. Néanmoins, quand les élèves se mettent à rédiger, ils posent quelques questions qui exigent un léger guidage de la part de l’enseignant, voire quelques corrections qu’il indique lorsqu’il vient observer leur travail de plus près. Ce qui s’avère être délicat est souvent la question de la nécessité du conditionnel dans la construction de la postériorité dans le passé. Par exemple, tel élève aura tendance à transformer «Je sais, je lui rendrai son fric un jour», en «Il savait qu’il lui rendra son fric un autre jour» plutôt qu’en «Il savait qu’il lui rendrait son fric un autre jour». Des tournures plus orales comme «Il ne savait pas que demain, c’était le vét» ne posent, elles, en général pas de problèmes.
Voici un exemple représentatif de l’ensemble des productions d’élèves, qu’ils aient 14 ou 18 ans, l’expérience ayant été menée aussi bien au secondaire 1 qu’au secondaire 2. Celui-ci a été rédigé par Virginia, 16 ans:
Il y avait des gens bizarres, dans ce BAM6. Virginia était assise au milieu d'eux. Mais franchement, quel âge pouvaient-ils bien avoir? Cette fille avec des mèches rose pétant devait être légèrement tarée... Légèrement seulement? L'autre, la gothique, elle était chou. Virginia aimait bien ses habits, son style, mais elle était tarée aussi... Il y avait un gars avec elle, mais Virginia n'arrivait pas à voir qui c'était. Ah, il se levait.
Oh non, pas lui... Elle ne l'aimait pas beaucoup. En fait, ils ne se connaissaient pas, mais elle l'avait vu des tonnes de fois. Et il était vraiment bizarre.
Il sortit du BAM. Pour fumer sa clope, sur le quai. Et les deux autres y allaient aussi. Virginia hésitait. Allait-elle changer de place? Euh, non. En fait, elle avait trop la flemme pour bouger. Tant pis. Elle allait attendre que ce train démarre pour enfin pouvoir rentrer chez elle. Sa mère en ferait une tête en la voyant débarquer à l'improviste! Bah, c'était la vie.
À nouveau, les auteurs et autrices lisent leurs textes, en tout cas celles et ceux qui le veulent. Ce type d’atelier suscite toujours du plaisir, surtout s’il est mené régulièrement et si les conditions de sa réussite ont été posées en amont par un enseignant attentif à instaurer une atmosphère de bienveillance comme le veut la coutume. Mais il n’est pas question d’en rester là.
Troisième étape: la discussion
C’est en effet à ce moment précis que le dispositif peut déployer ses effets: les élèves sont amenés à parler de leur texte, à commenter les effets des mots, de la ponctuation, des retours à la ligne éventuels, de tout ce qu’ils estiment être digne d’attention. Ils ne commentent pas que le leur, d’ailleurs, mais également ceux de leurs camarades et le font d’autant plus facilement que leur curiosité a été attisée par l’exercice et par le simple bonheur d’entendre des histoires: comment les autres s’en sont-ils sortis et qu’ont-ils choisi de raconter? Notons que l’un de leurs premiers constats consiste toujours à trouver très littéraire leur deuxième production. Ils en sont émerveillés –les voilà écrivains! Le passage de la narration hétérodiégétique qui se présente tour à tour omnisciente puis limitée à la perspective d’un des personnages dont l’histoire est contée marque le style de bien des romans du XIXe siècle qu’on étudie à l’école, qu’il s’agisse d’œuvres de Balzac, Flaubert ou Zola, et cette caractéristique fait croire aux élèves que la bonne littérature a cette forme. Bref, les élèves sont contents, satisfaits de leur performance (et d’avoir pu exercer une liberté d’expression qu’ils n’ont pas toujours éprouvée, le droit leur ayant même été accordé de parsemer leur texte de tournures orales!) Cela étant, ils saisissent de façon inédite et surtout vive combien celui qui raconte n’est pas à confondre avec celui dont il adopte le point de vue. Ils perçoivent même ce que la phrase d’introduction a permis d’ouvrir au cœur d’un récit (supposé). C’est en invitant les élèves à décrire ce qui se passe donc du point de vue de l’écriture elle-même que ces derniers comprennent l’avantage du vocabulaire qu’on leur propose pour faciliter et enrichir ce à quoi ils sont désormais sensibles. Voilà qu’ils ont envie d’en savoir davantage. Les leçons de narratologie les plus sophistiquées peuvent commencer. Elles ne seront jamais détachées des enjeux de compréhension du texte: si mettre en récit une histoire est une affaire diablement complexe et qu’il est intéressant de s’y intéresser, il est tout aussi intéressant de voir ce que les choix de cette opération signifieront quant à la position du narrateur (et peut-être de l’auteur lui-même) et aux sentiments, espoirs, valeurs, etc. des personnages ainsi qu’au rapport entre les deux.
Quatrième étape: l’exposé des notions narratologiques
Les notions de narratologie que l’enseignant aura retenues selon, d’une part ce qui lui paraît essentiel et d’autre part, ce que les discussions de l’atelier auront suscitées, peuvent alors être exposées de façon plus magistrale (ou plus systématique): elles font sens. On l’a compris, cet article n’est pas consacré à la question de la sélection des notions susceptibles d’être considérées comme essentielles. S’il fallait en donner une liste, on pourrait proposer aux enseignants les moins expérimentés de s’inspirer des choix effectués par un auteur aussi significatif qu’Yves Reuter, acteur clé de l’évolution de la didactique du français, à la fois chercheur majeur et médiateur pédagogique, qui a su articuler concepts didactiques et pratiques enseignantes. À titre d’exemple, nous pourrions ainsi retenir les propositions théoriques qu’il synthétise dans son ouvrage intitulé L’analyse du récit et paru en 2025. Ne perdons pas de vue que mon propos est ici de présenter comment on peut embarquer les élèves dans ces questions de recherche, comment on peut surtout leur enseigner à repérer les changements de points de vue et à démontrer, à l’aide d’indices textuels qu’ils ont eux-mêmes mobilisés, que ces changements sont effectifs. C’est le développement d’une sensibilité littéraire experte qui se voit ainsi favorisée, l’expertise en ces matières ne pouvant se passer d’une «expérience de lecture littéraire un tant soit peu attentive à elle-même, [aux] troubles, [aux] émotions, [aux] rêveries, [aux] associations d'idées, voire [aux] rapprochements impromptus» (Langlade 2004: 81).
Cinquième étape: la confrontation aux œuvres
Ainsi, profitant des acquis tout aussi bien de l’expérience de création que des acquis de l’exposé théorique, on pourra confronter les textes d’autrices et d’auteurs classiques ou contemporains, aux textes que les élèves devenus écrivains le temps d’une leçon ont réalisés. Soudain les choses s’éclairent par une compréhension plus profonde non seulement du contenu de tel ou tel récit, mais aussi de l’importance de se mise en forme, de ses mécanismes et de ses effets.
Voyez par exemple le texte final écrit par Nathanaël, 14 ans:
Mmh!... Nathanaël avait « trop faim ». Il prit la direction de la Migros. Il hâta le pas, impatient: quand on a faim, tout paraît long, même le chemin de l'école à la Migros.
Ça faisait longtemps qu'il ne s'y était rendu, mais pfff! c'étaient toujours les mêmes personnes qui étaient devant l'entrée. Nathanaël se dirigea vers les sandwichs. Il avait soif aussi. Combien d'argent avait-il? À peine six francs. Soit il prenait un gros sandwich et un peu à boire, soit un petit sandwich et deux litres à boire. Il fallait choisir! Il aurait bien pris les deux aussi. Il aurait fallu alors qu'il « casse » le billet de dix francs qu'il devait à Marcos... Eh ben, tant pis, il lui rendrait son fric un autre jour.
On relèvera ici le recours aux guillemets que Nathanaël a choisi pour permettre au narrateur de marquer sa distance par rapport au point de vue adopté, guillemets qui équivalent à un «sic» qu’on trouverait dans un article de presse ou dans tout autre compte rendu. Cela dit, ce texte, qui pourrait passer pour une simple production scolaire d’un élève de secondaire 1, se révèle être un avatar involontaire d’un passage de Bel-Ami de Maupassant – l’élève ignorant tout de ce roman. Voyez plutôt:
Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche trois francs quarante pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits; et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. (Maupassant 2018: 45-46)
On y retrouvera un homme au milieu de la rue en proie à l’incertitude. Il a faim, mais que va-t-il manger avec l’argent dont il dispose? De quoi devra-t-il faire le deuil? Tout détail textuel peut alors être discuté, c'est-à-dire pointé comme suffisamment intéressant pour être interrogé quant à ses effets. Pourquoi ces répétitions? Pourquoi cette virgule avant «et»? Pourquoi ce point-virgule? On continue ainsi à nourrir cette envie que nous apprenions manquer tragiquement au numéro 1 des rockers français…
De façon plus générale, la lecture d’autres œuvres gagne en finesse et en attention, soutenue par une curiosité plus vive et un engagement plus impliqué. Certains passages de L’Assommoir, d’Émile Zola, par exemple, réclament mieux qu’une signalétique sommaire du point de vue: ils appellent une lecture sensible aux emboîtements parfois peu perceptibles des changements de perspective, redoublés par des temporalités entremêlées, souvent ramassées en quelques lignes. Par ailleurs, donner à lire les pages les plus déroutantes des Lauriers sont coupés d’Édouard Dujardin ou de l’Ulysse de James Joyce se révélera aussi aisé que stimulant et facilitera la vision de l’histoire littéraire, telle qu’on cherche à l’enseigner au secondaire 2, c’est-à-dire en amenant chaque élève à la construire et à l’intégrer personnellement.
Conclusion
Il est temps de faire le point sur l’essentiel de ce que cet article a tenté de mettre en avant et des réussites que la mise à l’épreuve du dispositif proposé a permis de vérifier au fil des expériences menées auprès de divers publics du secondaire 1 comme du secondaire 2.
Premier constat: les élèves ont eu du plaisir
Quiconque a eu l’occasion de mener un atelier d’écriture en classe sait à quel point les élèves s’y prennent rapidement au jeu, manifestant leur plaisir par leur participation spontanée: ils s’investissent sans rechigner, acceptent volontiers de lire leurs productions à voix haute, écoutent avec attention les textes de leurs camarades, et en redemandent, tout simplement. Les sourires et les rires qui ponctuent ces moments en sont les meilleurs témoins. La dimension ludique et gratuite – car l’écriture n’est ici pas soumise à l’évaluation – joue un rôle essentiel, tout comme l’implication psycho-affective rendue possible par la liberté d’expression qu’offre l’atelier. Les amorces facilitatrices, qui permettent de trouver aisément les mots pour commencer, y contribuent également. Ces éléments sont bien connus. Cet atelier n’a pas dérogé à la règle. Guidés et encouragés par l’enseignant, les élèves ont rapidement perçu les effets littéraires d’un projet d’écriture que d’aucuns avaient (une fois n’est pas coutume) trouvé étrange, voire infaisable au départ. Petit à petit, ils se sont lancés, s’inspirant des suggestions orales de l’enseignant ou des premières lignes écrites par un voisin. Lors des échanges qui ont conclu l’activité, certains ont exprimé leur étonnement devant la transformation de leur texte initial: comment ces manipulations consistant à réécrire au passé les pensées vives d’un présent fictif pouvaient-elles donner un aspect littéraire si satisfaisant à leur premier jet? Ils se découvraient écrivains, et non plus de simples rédacteurs scolaires. Or le plaisir comme condition de l’apprentissage n’est plus à démontrer. Des chercheurs en pédagogie comme Meirieu (2014) l’ont affirmé avant que des spécialistes des neurosciences l’établissent sur le plan biologique: stimuler le plaisir et la curiosité «active le circuit de la dopamine et aiguise le désir d’apprendre, […] besoin fondamental des êtres vivants» (Dehaene 2020: 4). Or l’écriture pratiquée en atelier est source de plaisir, ne serait-ce que parce qu’elle commence souvent par du jeu. Elle permet à l’élève de découvrir le plaisir de manipuler les mots, et favorise son développement cognitif en l’engageant dans des activités en phase avec ses intérêts – c’est-à-dire avec ce qui suscite justement sa curiosité (Vasnasse 2001: 57). Lorsqu’Astolfi (2021: 8-10) défend l’importance de cultiver « la saveur des savoirs » pour donner sens aux apprentissages, il prend à témoin le plaisir qu’il a lui-même ressenti un jour en découvrant les ateliers d’écriture oulipiens, expérience fondatrice d’une compréhension renouvelée des possibilités de l’écriture. Cependant si le plaisir est un moteur, il ne constitue pas une fin en soi: l’objectif reste l’apprentissage.
Deuxième constat: les élèves, grâce à l’écriture, ont saisi ce qu’était un changement de perspective narrative dans les textes à la troisième personne
Le passage par le jeu de l’écriture fait comprendre de l’intérieur les changements de perspective. On profite de l’émerveillement que produit l’effet de littérarité d’un texte au passé simple qui multiplie, dans le cas d’une narration hétérodiégétique passant par le personnage, les discours indirects libres. Les élèves désormais repèrent facilement les glissements d’un regard narratif à l’autre, même s’ils n’en ont dans un premier temps que l’intuition.
Troisième constat: les élèves sont prêts à recevoir une liste de termes techniques
Invités à parler des textes produits ou de ceux d’auteurs reconnus, les élèves voient tout l’intérêt qu’il y a à disposer de quelques outils langagiers non seulement pour formuler leurs constats, mais aussi pour mieux percevoir la complexité de la mise en récit des histoires. Autrement dit, ils comprennent le sens de ce qu’on veut leur faire apprendre. Ce cheminement, où les réflexions partent de leurs propres productions, s’inscrit dans une démarche inductive: en écrivant, puis en observant ce qu’ils ont écrit, les élèves découvrent activement les règles et régularités, construisant ainsi leurs savoirs de manière contextualisée.
Quatrième constat: les élèves sont davantage disposés à s’impliquer dans l’analyse littéraire, notamment sur le plan formel
Voilà des élèves outillés en matière de narratologie, des élèves qui comprennent le sens de cet outillage, qui y trouvent de l’intérêt et qui vont donc porter un regard nouveau sur les textes qu’ils auront à lire, comprendre, analyser, commenter. Bref, devenus chercheurs parce que mis en position de créateurs, les voilà acteurs de leur apprentissage. Nous sommes en accord avec Chevallard et Astolfi, selon lesquels un pacte d’instruction mobilisateur se bâtit non sur des savoirs, mais sur des questions (Astolfi 2021: 50). Il revient donc à l’enseignant de susciter, dès le départ, ce questionnement, cette envie d’en savoir davantage.
Tout cela est bien beau. Cependant, il y a peut-être encore mieux que la maîtrise théorique de notions narratologiques et de leur application aux récits de toutes sortes. Il y a l’expérience de création littéraire qu’ont pu vivre les élèves le temps de quelques exercices. Peut-être est-ce pour eux l’occasion d’être saisis par les enjeux les plus profonds de l’écriture? Cette expérience indique à l’élève qu’il peut s’affranchir de la seule consommation des textes. Placé en posture d’auteur (Tauveron & Sève 2005), il découvre que les œuvres ne sont pas des objets figés à interpréter, mais des formes vivantes dans lesquelles il peut intervenir. En cela, on rejoint les thèses d’Arendt (2020): les œuvres sont les conditions d’existence d’un monde commun, et donc de l’action humaine. L’élève n’est plus seulement lecteur ou apprenant; il devient acteur dans le champ culturel, et sujet de sa propre pensée. Mais cette transformation va plus loin encore: elle affecte le rapport au monde lui-même. Hartmut Rosa, dans sa théorie de la résonance, décrit cette relation vivante et transformatrice que l’individu peut entretenir avec le monde lorsqu’il ne le traite plus comme un objet à maîtriser, mais comme un partenaire de dialogue. L’écriture littéraire, lorsqu’elle est pratiquée comme expérience de création, rend possible ce lien de résonance. Elle engage l’élève dans une relation où il se sent touché, concerné, déplacé – et où il répond. C’est peut-être là l’un des plus puissants effets de l’atelier d’écriture: il ne vise pas seulement des compétences, mais rend possible une forme d’habitation du monde signifiante. Une meilleure connaissance des rouages narratifs prend alors une dimension plus existentielle qu’une simple exigence scolaire.
Bibliographie
Arendt, Hannah (2020), Condition de l’homme moderne, Paris, Le Livre de Poche.
Ahr, Sylvie, Isabelle de Peretti (dir.) (2023). Analyser des textes littéraires du collège au lycée. Quelles pratiques, pour quels enjeux?, Saint-Martin-d'Hères, UGA.
Astolfi, Jean-Pierre (2021), La saveur des savoirs, Paris, ESF.
Baroni, Raphaël (2023), «Comment un théoricien du récit pourrait-il contribuer à améliorer l’outillage narratologique scolarisé?», Transpositio, n° 6, en ligne, consulté le 25 avril 2025, URL: https://www.transpositio.org/articles/view/comment-un-theoricien-du-recit-pourrait-il-contribuer-a-ameliorer-l-outillage-narratologique-scolarise
Baroni, Raphaël (2010), «Le temps de l’intrigue», Cahiers de Narratologie, n°18, en ligne, consulté le27 avril 2025, DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.6085
Bisenius-Penin, Carole (2013), «Écriture à contraintes et processus de création à l’université», in Ateliers d'écriture littéraire, C. Oriol-Boyer & D. Bilous (dir.), Paris, Hermann, p. 391-407, en ligne, consulté le 25 avril 2025, URL: https://doi.org/10.3917/herm.oriol.2013.01.0391
Brossard, Michel (2004), Vygotski: Lectures et perspectives de recherches en éducation, Villeneuve d’Ascq, Septentrion.
Brousseau, Guy (1998), Théories des situations didactiques en mathématiques, Grenoble, La Pensée Sauvage.
Carette, Vincent, Bernard Rey (2010), Savoir enseigner dans le secondaire, Bruxelles, De Boeck.
Chevallard, Yves (1991), La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La pensée sauvage.
Claude, Marie-Sylvie (2024), «Interpréter des textes littéraires: difficultés et complexités des interactions au collège et au lycée (propos recueillis par Isabelle De Peretti)», Le français aujourd'hui, n° 227 (4), p. 43-54, en ligne, consulté le 1er juin 2025, URL: https://doi.org/10.3917/lfa.227.0043
Dewey, John (2011), Démocratie et Éducation suivi de Expérience et Éducation, Paris, Armand Colin.
Dubied, Annik (2000), «Une définition du récit d’après Paul Ricœur», Communication, n° 19 (2), en ligne, consulté le 27 avril 2025, DOI: https://doi.org/10.4000/communication.6312
Freinet, Célestin (1969), Pour une l’école du peuple, Paris, Maspero.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Goigoux, Roland, Juliette Renaud & Isabelle Roux-Baron (2021), «Comment influencer positivement les pratiques pédagogiques des professeurs expérimentés?», in Améliorer les pratiques en éducation: qu’en dit la recherche?, B. Galand & M. Janosz (dir.), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 67-76, en ligne, consulté le 1er juin 2025, URL: https://hal.science/hal-03153950/
Langlade, Gérard (2004), «Le sujet lecteur, auteur de la singularité de l’œuvre», in Le sujet lecteur: lecture subjective et enseignement de la littérature, A. Rouxel & G. Langlade (dir.),Rennes, PUR, p. 81-91.
Maupassant, Guy de (2018), Bel-Ami, Paris, Flammarion.
Meirieu, Philippe (2018), Le choix d’éduquer: éthique et pédagogie, Paris, ESF.
Meirieu, Philippe (2015), «Peut-on susciter le désir d'apprendre?», Sciences Humaines, n° 268 (3), en ligne, consulté le 27 avril 2025, DOI: https://doi.org/10.3917/sh.268.0023
Meirieu, Philippe et col. (2014), Le plaisir d'apprendre, Paris, Autrement.
Philippe, Jonathan (2010), Fabriquer le savoir enseigné, Bruxelles, De Boeck.
Reuter, Yves (2025), L’analyse du récit, Paris, Armand Colin.
Reuter, Yves (1989), «L'enseignement de l'écriture: Histoire et problématique», Pratiques, n° 61, p. 68-90, en ligne, consulté le 10 mai 2025, DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1989.1503
Rosa, Hartmut (2018), Résonance: une sociologie de la relation au monde, Paris, La Découverte.
Rosier, Jean-Maurice (2005), «Le concept fantôme de “dévolution”», Le français aujourd'hui, n° 151 (4), p. 9-14, en ligne, consulté le 3 mai 2025, DOI: https://doi.org/10.3917/lfa.151.0009
Rousseau, Jean-Jacques (2009), Émile ou de l’éducation, Paris, Garnier Flammarion.
Tauveron, Catherine & Pierre Sève (2005), Vers une écriture littéraire ou comment construire une posture d’auteur à l’école de la GS au CM, Paris, Hatier.
Vasnasse, Geneviève-Gaël (2001), «L’atelier d’écriture pour apprendre», Québec français, n° 124, p. 56–58, en ligne, consulté le 11 mai 2025, URL: https://id.erudit.org/iderudit/55872ac
Todorov, Tzvetan (2007), La littérature en péril, Paris, Flammarion.
Pour citer l'article
Yves Renaud, "Faire écrire pour enseigner le point de vue", Transpositio, Enseigner la narratologie aujourd'hui, 2026http://www.transpositio.org/articles/view/faire-ecrire-pour-enseigner-le-point-de-vue
Sur Facebook