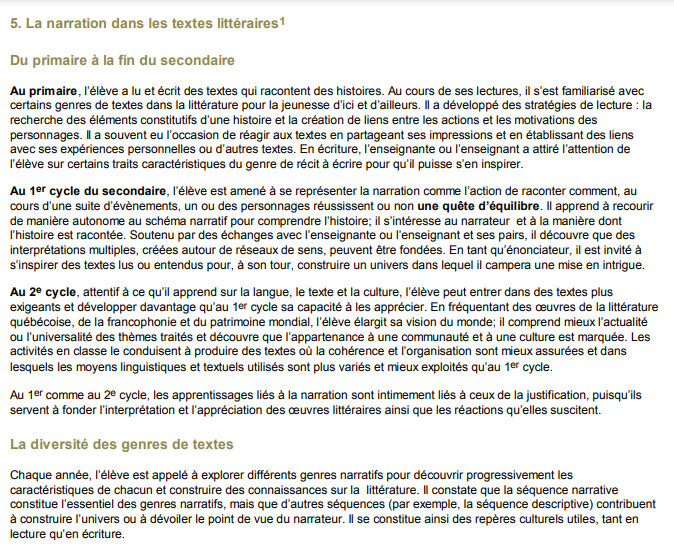La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques.
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- Zeina Hakim & Anne Monnier - Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
- Jan Baetens - Enseigner Proust illustré
- Daniel Delbrassine - Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
- Barbara Hurni-Siegrist - Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques
La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques
Cet article de Hillary Chute, publié en 2008 dans la revue de la Modern Language Association of America 1, a marqué un tournant dans les rapports entre bande dessinée et études littéraires sur le nouveau continent. Chute propose non seulement une définition de ce média, en insistant sur les spécificités sémiotiques de cette forme d’expression plurimodale, mais elle propose également de retracer brièvement son histoire et de réfléchir sur la littérarité de ce qu’elle rebaptise le « récit graphique », en s’attardant notamment sur les œuvres d’Art Spiegelman et de Joe Sacco. Nous sommes reconnaissants à Hillary Chute et à l’éditeur de nous avoir autorisés à republier cet article, qui a été traduit par Raphaël Baroni et Sébastien Graber.
La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques. Pour ceux qui adoptent le point de vue des études littéraires, la manœuvre est évidente: soit on justifie l’intérêt de la bande dessinée en s’appuyant sur une défense de la culture populaire, soit on la rattache à la riche tradition des recherches sur les rapports entre textes et images, qui nous renvoie aux manuscrits enluminés du Moyen Âge. Mais la bande dessinée pose des problèmes que nous essayons encore de résoudre ; le terme n’entre pas facilement dans notre grammaire et la nomenclature qui l’entoure reste compliquée et controversée2. Le domaine des études littéraires n'a pas encore saisi les contours de cet objet fuyant, ni défini clairement son projet le concernant. Pour explorer les bandes dessinées contemporaines, nous devons dépasser certaines classifications antérieures : nous devons réexaminer les catégories de fiction, de narration et d’historicité. Les bourses d'études consacrées aux bandes dessinées – et plus particulièrement à ce que j'appelle les récits graphiques – sont en augmentation dans les sciences humaines. La bande dessinée peut être définie comme une forme hybride combinant des mots et des images, dans laquelle deux cheminements narratifs, l'un verbal et l'autre visuel, construisent une temporalité à l’intérieur d’un espace. La bande dessinée progresse temporellement en cheminant dans l'espace de la page, en s’appuyant sur une alternance de présences et d’absences, les cases saturées d’informations (aussi appelées vignettes ou cadres) alternant avec les gouttières (des espaces vides entre les cases). Extrêmement structurée dans sa construction narrative, la bande dessinée ne se contente pas de mélanger le visuel et le verbal – ni même d'illustrer l'un par l'autre – mais elle est plutôt encline à présenter les deux éléments de manière asynchrone : un lecteur de bande dessinée ne remplit pas seulement les blancs entre les cases, mais il opère aussi des allers-retours entre lecture et recherche visuelle du sens. Dans cet article, je traiterai la bande dessinée (comics) comme un média3, et non comme un genre populaire, telle qu’on l’entend habituellement4. Par ailleurs, je conclurai en attirant l’attention sur un genre particulièrement prégnant au sein de ce domaine : la bande dessinée non fictionnelle.
Je m’intéresserai particulièrement à la manière dont la bande dessinée met en jeu le problème de la représentation de l'histoire, car mon propre travail s'est concentré sur ce que cette forme rendait possible pour le récit non fictionnel, en particulier du fait de sa capacité de juxtaposer spatialement sur la page (et de faire se superposer) des moments passés, présents et futurs. Je m'intéresserai aussi à la manière dont la bande dessinée élargit les modes d'expression de soi et de l’histoire, tout en s'inscrivant dans la culture populaire5. Comment les bandes dessinées contemporaines s’y prennent-elles pour raconter des histoires collectives épouvantables ? Pourquoi les artistes féminines brouillent-elles la distinction entre histoires « privées » et histoires « publiques » ? L'impact esthétique et narratif des bandes dessinées à dimension historique est un élément central de MetaMaus, un livre d'Art Spiegelman à l'édition duquel je participe actuellement6 et qui portera sur les treize années qu'a duré le processus de fabrication de son livre, Maus : l'histoire d'un survivant, qui a été couronné par le prix Pulitzer.
Tour d’horizon
À l’heure actuelle7, trois revues scientifiques ont consacré des numéros spéciaux au récit graphique. Art Spiegelman a récemment donné un séminaire à l'Université de Columbia intitulé « Bandes dessinées : entrer dans le canon », et la Norton Anthology of Postmodern American Fiction intègre depuis peu des bandes dessinées. En dehors du monde académique, le récit graphique occupe l'avant-scène de la critique littéraire et des conversations culturelles : le magazine Time, baromètre du grand public, a nommé comme meilleur livre de 2006 le récit graphique d'Alison Bechdel : Fun Home. A Family Tragicomic. La même année, la maison d’édition Houghton Mifflin, qui publie The Best American Series, inaugurait le premier volume du Best American Comics. On pouvait même lire, en juillet 2004, dans un article de couverture du New York Times Magazine, que cette « nouvelle forme littéraire » rejoint « ce que le roman était autrefois – une forme accessible, vernaculaire [et] ayant un attrait massif » (McGrath 2004 : 24).
Le terme de roman graphique est un terme beaucoup plus commun et facilement identifiable que celui de récit graphique8. Mais ce qui était à l’origine un terme marketing doit aujourd’hui être replacé dans son contexte historique, celui de la seconde moitié du XXe siècle. L'impulsion est venue en partie d’une communauté éditoriale très active issue du milieu underground, qui souhaitait produire des œuvres liées au média de la bande dessinée, mais possédant un impact plus important : le premier usage public attesté de cette expression, par Richard Kyle, apparaît dans un bulletin de 1964 distribué aux membres de l'Amateur Press Association, et le terme fut ensuite emprunté par Bill Spicer dans son fanzine Graphic Story World. Beaucoup pensent que Will Eisneraurait inventé le terme parce qu'il l'a utilisé dans un contexte plus commercial, pour vendre à des éditeurs A Contract with God (1978). Composé d'une série de quatre histoires sérieuses, liées entre elles et racontant les conditions de vie sordides et les désirs d'assimilation de migrants vivant dans un immeuble du Bronx dans les années 1930, A Contract with God fut le premier livre commercialisé en tant que « roman graphique9 ».
Des dizaines d'années plus tard, on retrouve des sections « roman graphique » dans de nombreuses librairies. Pourtant, ce terme semble souvent impropre pour désigner les objets rangés dans ces rayons. De nombreuses œuvres fascinantes regroupées sous cette étiquette – y compris Maus de Spiegelman, qui a contribué à populariser le terme – ne sont pas du tout des romans : ce sont de riches œuvres non fictionnelles, ce qui explique l’accent que je mettrai ici sur le terme plus large de récit. En effet, cette forme remet en question l’idée reçue qui voudrait que, par défaut, le dessin en tant que système serait intrinsèquement plus fictionnel que la prose. Elle donne aussi une nouvelle image de ce que nous considérons comme de la fiction ou de la non-fiction. Dans ce que nous désignons par récit graphique, la longueur substantielle à laquelle faisait référence le terme roman peut être préservée, mais cette expression plus neutre suppose l’existence d'autres modes que celui de la fiction. Un récit graphique est un ouvrage de la longueur d'un livre qui se rattache au média de la bande dessinée10.
Il existe de nombreux formats pour la bande dessinée qui sont tous porteurs d'un bagage culturel unique. Aux Ėtats-Unis11, le comic strip a émergé avant le début du XXe siècle et possède une extension qui varie de moins d'une page à plusieurs pages ou même davantage. Il s'agit d’une séquence qui forme une unité minimale et s’apparente à ce que l’on pourrait désigner comme une histoire courte. Le comic book, qui a vu le jour dans les années 1930, compte généralement trente-deux pages et se présente soit comme un recueil de comic strips, soit comme une histoire continue, souvent sous la forme d’un épisode qui se rattache à une série12. La bande dessinée se décline ainsi en toutes sortes de formats et dans différents contextes sériels, des strips quotidiens ou hebdomadaires aux comic books publiés mensuellement, en passant par les personnages sériels représentés dans tous ces formats. J’ai soutenu ailleurs que la planche de bande dessinée est elle-même un matériau dans lequel s’inscrit une forme de sérialité. En effet, il s’agit d’une architecture narrative fondée sur l'établissement d’intervalles réguliers au sein de l'espace et sur des déviations de cette régularité. Formellement, la bande dessinée diffère du dessin animé (en anglais : cartoon), car ces derniers présentent une succession d’images formées d’une seule case. Alors que ces deux formes utilisent souvent des dispositifs visuels et verbaux similaires, les bandes dessinées, qui se déploient généralement sur plusieurs cases, ont une dynamique narrative qui diffère des dessins animés. Pourtant, les auteurs de bandes dessinées sont encore couramment appelés en anglais cartoonists. Cela s’explique par le fait que la définition historique du cartoon trouve une résonnance chez des auteurs impliqués dans la reproduction de masse d’images dessinées – un aspect de cette forme qui empêche la bande dessinée d'être rattachée aux « beaux-arts ». Cartoon vient du mot italien cartone, qui signifie carton, et désigne un support pour une image ou un motif destiné historiquement à être transféré sur des tapisseries ou des fresques (Harrison 1981 ; Janson 1991 ; Harvey 2001 ; 2005). Pourtant, comme le souligne Randall Harrison, « avec l'arrivée de l’imprimerie, le "cartoon" a pris un autre sens. Il s’agissait d’une esquisse qui pouvait être reproduite en série. C'était une image qui pouvait être largement diffusée13 » (1981 : 16).
Mais comment définir la forme de la bande dessinée, quelles sont ses propriétés, son extension et ses capacités expressives ? Les amateurs de bandes dessinées pourraient en fait dire, comme l'a fait le juge Potter Stewart au sujet de la pornographie : il suffit d’en voir pour savoir ce que c’en est14. La bande dessinée est une forme créative en perpétuelle évolution, toujours soumise aux contraintes des formats imposés par des entreprises commerciales, contrairement au livre d'artiste, qui a connu une histoire parallèle au cours du XXe siècle15. Une partie de la critique s’est occupée de ce que Scott McCloud a appelé les « descriptions fonctionnelles » de la bande dessinée et, dans la plupart des cas, ces travaux négligent joyeusement les méthodologies institutionnelles les mieux établies. Understanding Comics de McCloud (1993a), le premier livre à théoriser la bande dessinée à travers sa propre forme médiatique, en propose une définition délibérément large et provisoire16. Son analyse de la forme intègre, mais sans s'y limiter, le contexte des supports imprimés, paramètre que de nombreux praticiens et critiques considèrent comme essentiel (p. ex. Kunzle 1973 ; Dowd & Reinert 2004).
McCloud définit la bande dessinée comme des « images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquences, destinées à transmettre des informations et / ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur17 » (2007 : 17). McCloud ajoute qu’avant sa projection, la pellicule d'un film « s’apparente à une bande dessinée observée au ralenti » (1999 : 5). Cet accent mis sur la séquence permet à McCloud de rattacher à la préhistoire de ce média des manuscrits d'images précolombiennes, la tapisserie de Bayeux et les Tortures de Saint-Erasme (1460), parmi d'autres antécédents culturels tout aussi improbables. En 2001, Robert Harvey a rejeté la conception de McCloud selon laquelle les bandes dessinées n'auraient pas besoin de contenir des mots pour être identifiées en tant que telles. C’est le cas également de Smolderen (2007), qui réfute l’idée que la séquence serait la propriété définitoire de la bande dessinée en analysant un « effet d'essaimage » à partir d’images uniques tirées de Bibles illustrées, de Bosch et de Brueghel, ainsi que de livres pour enfants. Harvey soulève quant à lui cette objection : « il me semble que la caractéristique essentielle de la bande dessinée – ce qui la distingue des autres types de récits picturaux – est l'incorporation de contenu verbal. […] Et l'histoire de la bande dessinée me semble mieux soutenir ma thèse que la sienne » (2001 : 75-76). Selon Harvey, l’histoire de la bande dessinée remonterait au XVIIIe siècle et débuterait dans les images produites par Hogarth, Gillray, Rowlandson et Goya (voir aussi Katz 2006 et Sabin 1993).
Les positions de McCloud et Harvey ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le penser. La bande dessinée dépend toujours de la manière dont la temporalité peut être construite en empruntant des chemins complexes, et souvent non linéaires, à travers l'espace de la page ; pour l'essentiel, cette forme s’appuie à la fois sur des mots et des images, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire. Comme le suggère Spiegelman, les œuvres en bande dessinée « chorégraphient et donnent forme au temps » (2005 : 4). Et bien que cette fonction puisse être remplie par de nombreuses formes d’expression, c'est dans la manière spécifique dont la bande dessinée accomplit cette opération que l'on peut trouver ce qui constitue souvent l’aspect formel le plus intéressant de ce média. McCloud désigne les cases comme « l’élément iconique le plus important » de la bande dessinée (2007 : 106), car elles nous indiquent, de manière très générale, « que nous sommes face à une division de l’espace et du temps » (2007 : 107) et sont à la base de la grammaire de la bande dessinée. En effet, ainsi que l’affirme McCloud, les cases « fragmentent à la fois l’espace et le temps, proposant un rythme haché des instants qui ne sont pas enchaînés » (2007 : 75). Par cette succession de cases en alternance avec des espaces vides, une page de bande dessinée offre une riche carte temporelle, configurée autant par ce qui est dessiné que par ce qui ne l'est pas ; ce média est très conscient de l'artificialité de ses frontières sélectives, qui organisent la planche sous la forme d’un diagramme de moments encapsulés. McCloud soutient que l'espace vide, appelé la gouttière, « recèle beaucoup du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée » (2007 : 74), et il ajoute que « ce qui se situe entre les cases constitue le seul élément de la bande dessinée qui ne peut pas être imité par un autre média » (1993b : 13).
À travers les travaux de ces chercheurs et critiques, une histoire de la bande dessinée est en train de se constituer et de faire émerger une riche tradition liée à l’histoire des formes, nourrissant ainsi un engouement contemporain pour la narration graphique. La brève histoire que je retracerai dans ces lignes fait référence à plusieurs personnages et événements clés – j’évoquerai ici le contexte des œuvres américaines, mais sans mettre l’accent sur le développement de l’industrie de la bande dessinée commerciale, qui est dominée par deux éditeurs, Marvel et DC, spécialisés dans les histoires de superhéros. Même si McCloud et Harvey sont en désaccord, ils affirment l’un comme l’autre l'importance de Hogarth pour la bande dessinée (McCloud 2007 : 24 ; Harvey 2001 : 77). Dans Modern Fiction Studies, Marianne DeKoven et moi-même avons affirmé à propos d’une œuvre comme La Carrière d’une prostituée –comme dans une bande dessinée, cette œuvre représente des moments ponctuels encadrés qui s’inscrivent dans la progression d’un récit– que l’on peut « comprendre l'influence de Hogarth en lisant son œuvre comme une extension de l’ut pictura poesis, qui fait passer cette dernière de la poésie au genre du roman moderne. Il a introduit une structure séquentielle et romanesque dans une forme picturale » (2006 : 769). Plus tard, au XIXe siècle, Rodolphe Töpffer (1799-1846) – un enseignant suisse considéré comme l'inventeur de la bande dessinée moderne – établit les conventions de cette forme narrative, qu'il définit comme un « langage pictural18 » et qu’il décrit comme un style concis reposant sur l’apparition du cadre des cases dans la page ; il ajoute qu’il se fonde sur deux formes préexistantes : le roman et les histoires en estampe de Hogarth (Kunzle 1990 ; Willems 2007). En 1832, faisant l'éloge de l'œuvre de Töpffer, Goethe vante le potentiel pour la culture de masse de ce qui finira par être baptisé« romans en estampes19 ».
Même dans cette incarnation précoce, la bande dessinée était considérée comme une forme d'art antiélitiste. Néanmoins, les comic strips américains se sont distingués des formes européennes antérieures –lesquelles n'ont jamais été produites en masse de la même manière– par leur usage de personnages récurrents et leur publication dans des journaux à grande diffusion (cf. Gordon 1998). Il est communément admis qu'en Amérique, la bande dessinée a été inventée en 1895 – l’année même où les frères Lumière inventaient le film narratif à Paris – dans le journal de Joseph Pulitzer, le New York World, avec The Yellow Kid de Richard Fenton Outcault, qui mettait en scène des migrants urbains de cette époque, ainsi qu'un enfant attachant et odieux habitant un immeuble de l’East Side20. Pulitzer s'est rapidement rendu compte que la bande dessinée était un moyen d’augmenter la diffusion de son journal. La lutte qui s’ensuivit dans la presse à sensations entre William Randolph Hearst et Pulitzer au sujet du Yellow Kid aurait donné naissance au terme yellow journalism21, et trouverait son origine dans la couleur caractéristique de la robe de chambre du gamin.
Contrairement à la littérature moderniste, qui s'est développée à peu près à la même époque, le média de la bande dessinée a été marqué dès le début par son statut de marchandise. Cependant, on ignore encore souvent le fait que la bande dessinée des premières décennies du XXe siècle était à la fois un produit de la culture de masse et une forme qui influençait et était influencée par les pratiques de l'avant-garde, notamment celles se rattachant au dadaïsme et au surréalisme (Gopnik et Varnedoe 1990 ; Inge 1990). On ignore aussi souvent le fait qu'à la fin des années 1930, alors que les comic books commençaient leur ascension, portés par les épaules de Superman, les premiers récits graphiques modernes, appelés « romans sans paroles », avaient déjà fait leur apparition : il s’agissait d’œuvres gravées sur bois au rendu magnifique – dans certains cas vendues comme des romans classiques – qui servaient presque entièrement un agenda socialiste et incorporaient des pratiques expérimentales largement associées au modernisme littéraire (Joseph 2003). Ces « romans sans paroles », en dépit de leur désignation, comprenaient souvent du texte, mais pas sous la forme de cartouches ou de bulles (Beronä 2001 ; voir aussi Cohen 1977). Bien que ces œuvres n'aient pas toujours été associées à l'histoire de la bande dessinée, certains chercheurs ont commencé à les inclure dans le développement du récit graphique, ce qui leur a permis de montrer comment ce média, au début de son histoire moderne, a pu inclure des expérimentations formelles sans perdre son attrait pour la consommation de masse, ce qui représente un développement crucial pour l'impact de la forme actuelle22. En montrant les tensions entre, d'une part, une production éditoriale de masse et des pratiques artisanales, et, d'autre part, entre convention et expérimentation, ces œuvres montrent comment les premières versions des récits graphiques ont pu répondre aux enjeux de la culture contemporaine tout en anticipant l’émergence de genres marqués par un mélange entre la culture élitiste et populaire, que l'on identifie comme typiques de la littérature contemporaine23.
Dans les années 1950, 1960 et 1970, les bandes dessinées reflètent les bouleversements que l’on observe durant ces décennies dans la culture américaine, souvent en lien avec la Deuxième Guerre mondiale : elles créent un point de jonction entre la culture populaire américaine de masse et les expérimentations que l’on trouve dans les modernismes littéraires et artistiques. Fondée par le caricaturiste Harvey Kurtzman en 1952, la revue Mad Comics: Humor in a Jugular Vein (qui deviendra plus tard le magazine MAD) se présentait comme un comic book sérieusement autoréflexif et profondément préoccupé par l'esthétique de la bande dessinée. Avec Mad, Kurtzman établissait le projet d’une bande dessinée servant de critique pour les valeurs américaines dominantes, en particulier celles véhiculées par les médias, et pour cette raison, ce magazine a constitué une source d’inspiration pour la bande dessinée underground (souvent appelée comix) qui se développera à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
Comme la littérature des années 1960, la bande dessinée de cette période est dominée par des oppositions. Les dernières années de la décennie sont marquées par la révolution des comix undergrounds, ce mouvement revendiquant explicitement son rattachement à l’avant-garde. En réaction aux codes de la censure, qui étouffaient l'industrie mainstream, la bande dessinée underground est devenue un support culturel influent, à la fois frappant et déstabilisant, parce qu'il se fondait sur la transgression des tabous. Rejetant les grands éditeurs, les représentants de la scène underground auto-publiaient des œuvres qui expérimentaient, hors des contraintes commerciales, les capacités formelles de la bande dessinée. C'est de cette culture que sont issus les récits graphiques les plus durables : des œuvres sérieuses et imaginatives explorant les réalités sociales et politiques en repoussant les limites d'un média historiquement inscrit dans la culture de masse. L'autobiographie, sans doute le mode dominant des récits graphiques actuels, a d'abord pris son essor dans cette culture underground.
Spiegelman en est l’exemple éloquent. Ses bandes dessinées expérimentales et ses récits autobiographiques, qui incluent le prototype que constitue Maus, ainsi que ses deux magazines Arcade (1975-1976) et RAW (1980-1991), transposent l’esthétique antinarrative de l'avant-garde dans le média populaire, et même populiste, qu’est la bande dessinée. À l’origine, Spiegelman détournait les attentes du public liées au développement de l’histoire, en travaillant à se démarquer des bandes dessinées de «divertissement». Plus tard, dans le magazine RAW, où Maus a été publié pour la première fois sous la forme d’une série, il a élargi cette pratique.À travers ces expérimentations, nous voyons que l’énonciation historique se construit de manière éclatée, à travers des espaces paradoxaux et des temporalités mouvantes : la bande dessinée – en tant que forme qui s'appuie sur l'espace pour représenter le temps – apparaît alors structurellement équipée pour remettre en question les modes dominants de la narration et de l’historiographie.
Maus, qui a remporté un prix Pulitzer « spécial » et qui a fait découvrir la sophistication de la bande dessinée au monde académique, dépeint les Juifs comme des souris et les Allemands comme des chats. Ce récit raconte, en faisant des allers-retours entre la Pologne de la Seconde Guerre mondiale et le New York des années 1970 et 1980, l'histoire d'un auteur de bande dessinée, nommé Art Spiegelman et de son père, Vladek, un survivant de l'Holocauste. Maus a été largement commenté24. C'est une histoire captivante, un portrait émouvant d'une famille imparfaite. C'est aussi une œuvre dont la complexité esthétique et politique est liée aux spécificités de la bande dessinée. Marianne Hirsch souligne des aspects de l’œuvre de Spiegelman que l’on pourrait généraliser de manière à éclairer les potentialités du récit graphique. Selon elle, l'utilisation par Spiegelman de photographies dans un texte dessiné à la main
fait émerger non seulement la question de savoir comment, quarante ans après la sentence d'Adorno, l'Holocauste peut être représenté, mais aussi comment différents médias – la bande dessinée, la photographie, le récit, le témoignage – peuvent interagir les uns avec les autres pour produire un texte plus perméable et multiple, capable de refonder le problème de la représentation de l’Holocauste et de supprimer définitivement la séparation nette entre les domaines du documentaire et de l’esthétique. (1992-1993 : 11)
Spiegelman s'est battu publiquement, et avec succès, contre le New York Times pour faire passer son livre du classement des best-sellers appartenant au genre de la fiction à celui des œuvres non fictionnelles. En faisant s’entrechoquer dans la bande dessinée des couches narratives asynchrones ou concurrentes, il crée un niveau intense d'autoréflexivité (voir fig. 1). De plus, dans le récit graphique, le corps de l’auteur demeure présent dans le texte à travers le geste de la main visible dans le dessin25. Cette absence de transparence inscrit le récit déployé à la surface de la page dans le registre de la subjectivité, ce qui permet aux œuvres de bande dessinée d'être productivement conscientes de la façon dont elles «matérialisent» l'histoire – ce terme frappant étant utilisé par Spiegelman (Brown 1988 : 98). Concernant la place occupée par Maus dans la recherche académique, lors d’une interview donnée en 2003, Marianne Hirsch a affirmé que « dans le monde universitaire... c'est plus qu'une acceptation. Tout le monde se précipite pour écrire sur Maus » (2005).
Contextes
L'étude d'un texte de référence tel que Maus est en train de donner naissance à un domaine de recherche dont l’objectif est d’étudier plus largement le potentiel de cette forme d’expression. Dans un commentaire à propos de son œuvre, Spiegelman affirme que « la surface stylistique [de la page] était un problème à résoudre » (1994), ce qui caractérise bien la manière dont le récit graphique appréhende le style et la forme : il s’agit d’articuler les histoires à travers une esthétique spatiale liée aux cases, aux gaufriers26, aux gouttières et aux strips. Le récit graphique attire donc l'attention sur ce qui a été désigné par Mitchell comme un formalisme politique reconfiguré27. Selon lui, ce média nous confronterait aujourd’hui à un « nouveau type de formalisme », alors que le « moment moderniste de la forme […] est peut-être derrière nous28 » (2003 : 324). La narration graphique offre en particulier des exemples convaincants et diversifiés d’œuvres mobilisant différents styles, méthodes et modes pour traiter le problème de la représentation historique. Une conscience des limites de la représentation – qui est non seulement un problème spécifique à l’expression d’un traumatisme mais aussi une« condition sine qua non de toute représentation » (Kunow 1997 : 252) – fait partie intégrante du langage de la bande dessinée, du fait de sa forme architecturée, consciente d’elle-même et bimodale. Et simultanément, c’est pourtant à travers une visualisation à la fois saisissante, émouvante et directe des circonstances historiques, que la BD aspire à un engagement éthique.
Certains des livres les plus fascinants – ceux qui suscitent l’intérêt des critiques littéraires29 – représentent souvent des réalités historiques dramatiques. Par exemple, trois des auteurs de bande dessinée parmi les plus acclamés aujourd'hui, Art Spiegelman, Joe Sacco et Marjane Satrapi, travaillent dans un mode non fictionnel. Spiegelman s’est penché sur la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre, Sacco sur la Palestine et la Bosnie, Satrapi sur la révolution islamique en Iran et la guerre en Irak. Ce n'est pas une coïncidence. À travers sa manière congénitalement formaliste de raconter des histoires, à travers ses expérimentations avec les contraintes artificielles de son propre langage, la bande dessinée attire notre attention sur ce que Shoshana Felman et Dori Laub appellent la f«textualisation du contexte » :
le contenu empirique ne doit pas seulement être connu, mais doit être lu […]. L’exigence fondamentale et légitime de contextualisation du texte doit elle-même être complétée, simultanément, par le travail moins familier, et pourtant nécessaire, de textualisation du contexte. (Felman & Laub 1992 : xv)
Le récit graphique accomplit ce travail en rendant manifestes ses propres artifices et en attirant l’attention sur ses raccords. Sa grammaire formelle rejette la transparence et rend la textualisation visible, inscrivant le contexte dans la présentation graphique. Dans Maus, par exemple, le contexte du récit, sa nature de production culturelle sur l'Holocauste renonçant délibérément à la maîtrise esthétique, est affiché de manière extra-sémantique dans l’apparence de ses lignes au tracé hésitant. Lorsque nous lisons ce texte, nous percevons la texture granuleuse de ses lignes et nous constatons de ce fait le rejet des tropes nazis de la maîtrise.
 Figure 1 : Art Spiegelman, Maus II: A Survivor’s Tale, p. 41.
Figure 1 : Art Spiegelman, Maus II: A Survivor’s Tale, p. 41.
Reproduit avec la permission de l’auteur.
Les récits graphiques les plus importants explorent les limites incertaines de ce qui peut être dit et de ce qui peut être montré, à l'intersection entre l’histoire collective et les histoires vécues30. Des auteurs comme Spiegelman et Sacco, aux prises avec un horizon historique, dépeignent la torture et le massacre sur un mode formel complexe, qui ne se détourne pas du traumatisme et qui ne cherche pas à l'atténuer. En fait, ils démontrent comment le fait de retracer visuellement ce traumatisme peut se révéler à la fois éthique et productif. Il y a aussi un riche éventail d'œuvres d'écrivaines qui explorent l'enfance et le corps – des préoccupations généralement reléguées au silence et à l'invisibilité de la sphère privée. Le récit de Satrapi sur sa jeunesse en Iran, Persepolis, ainsi que des œuvres d'autrices américaines comme Lynda Barry, Alison Bechdel, Phoebe Gloeckner et Aline Kominski-Crumb illustrent comment le récit graphique peut dépeindre la réalité quotidienne de la vie des femmes ; et cette réalité, tout en étant enracinée dans une individualité, apparaît investie et intriquée dans la collectivité, au-delà des modèles prescriptifs de l’altérité et de la différence sexuelle. Dans tous les cas, de l’échelle la plus large à l'échelle locale, le récit graphique met en scène l’aspect traumatique de l'histoire, mais tous ces auteurs et toutes ces autrices refusent de montrer cet aspect à travers le prisme de l'indicible ou de l'invisible ; à l’inverse ils ou elles transcrivent plutôt sa difficulté à travers des procédés textuels inventifs et variés.
On ne devrait pas conclure de cet enthousiasme engendré par les productions non fictionnelles que des œuvres puissantes ne pourraient pas relever de la fiction. Des auteurs comme Charles Burns (Black Hole), Daniel Clowes (Ghost World) et Chris Ware (Jimmy Corrigan : The Smartest Kid on Earth) ont rehaussé le niveau de la bande dessinée littéraire en racontant des histoires à la fois sérieuses dans leur portée et denses stylistiquement. Il s’agit cependant d’affirmer que la combinaison des mots et des images crée de nouvelles possibilités pour l'écriture de l'histoire en proposant des expérimentations formelles, tout en conservant l’attrait du texte pour un public de masse. La narration graphique suggère ainsi que l'exactitude historique n'est pas le contraire de l'invention créative, car la problématique de la distinction entre fait et fiction est rendue visible par le dessin. En effet, structurellement parlant, la bande dessinée est un média double et stratifié, qui peut juxtaposer différents moments historiques sur une même planche, ainsi qu’on peut le constater dans la dernière case de la figure 1, dans laquelle Spiegelman montre des cadavres de camps de concentration qui envahissent silencieusement son studio de SoHo.
Pour présenter certains travaux prometteurs sur ces questions, je reviendrai brièvement sur Mitchell, car sa manière de montrer comment les horizons formel et politique peuvent s'entrelacer est particulièrement pertinente pour réfléchir sur les récits graphiques non fictionnels. Mitchell s’est intéressé à After the Last Sky: Palestinian Lives, une œuvre d’Edward Said produite en collaboration avec le photographe Jean Mohr, dont le texte mélange des mots et des images. Dans son commentaire, Mitchell met en évidence l’importance de ce qu’il définit comme une « esthétique spatiale » (2003 : 324). Dans l'introduction du livre, Said écrit d’ailleurs : « Je crois que pour nous représenter, nous devrions utiliser essentiellement des formes d'expression non conventionnelles, hybrides et fragmentaires. […] Une double vision donne forme à mon texte » (2003 : 6).
Publié en 1986, la même année que l’œuvre charnière de Spiegelman, l'appel de Said au mélange des genres, des disciplines et des médias, explique son enthousiasme pour la bande dessinée, qu'il détaille dans l'admirable introduction qu’il a rédigée en 2001 pour le récit graphique de Sacco sur la Palestine, un exemple de ce que l'on appelle aujourd’hui le «journalisme en bande dessinée31». Selon lui, la bande dessinée offre une vision double en raison de son hybridité structurelle, par cette combinaison narrative de mots et d'images qui ne forment pas une synthèse. Dans une case de bande dessinée, les images et les mots peuvent signifier différemment, et de cette manière, l'œuvre peut véhiculer des récits ou des sens à double codage.
Le travail de Sacco, par la densité de ses détails, attire l'attention sur le rythme – un aspect formel que Said considère comme étant peut-être « la plus importantes de ses réussites » (Sacco 2015 : n.p.). Faisant l'éloge de Palestine, Naseer Aruri va jusqu’à écrire que « chaque page équivaut à un essai », une appréciation de la densité du récit qui ne se limite pas à la prose du texte, mais qui indique plutôt comment l'épaisseur de la forme iconotextuelle, telle qu’elle est travaillée par Sacco, transmet ce qui apparaît comme un surplus d'information ou de plénitude32. Peu de récits narratifs résistent mieux à la consommation facile que ceux de Sacco : le formalisme de ses pages constitue une jungle exigeant un intense travail de « décodage ». Ce terme, qui connote une difficulté, est utilisé conjointement par Spiegelman et par Said pour parler de la bande dessinée (Said 2001 : ii ; 2015 : np ; Spiegelman 1995 : 61). Les œuvres de Sacco s’appuient effectivement sur un va-et-vient disjonctif entre la contemplation de l’image et la lecture du texte, et ce rythme – souvent compliqué et coûteux en temps – fait partie de leur pouvoir de «captation», selon la formulation de Said, ce qui est particulièrement pertinent pour traiter un sujet aussi politisé et éthiquement compliqué que le conflit israélo-palestinien33. Said loue la façon dont Sacco associe bizarrement une forme d’accélération (les pages sautent aux yeux avec une sorte d’urgence) et de décélération (chaque page doit être arpentée de long en large pour être décodée), et il en conclut que ses « bandes dessinées offrent aux lecteurs un séjour raisonnablement long auprès d’un peuple » rarement représenté avec autant de complexité et de rigueur (2001 : v ; 2015 : np). Une planche de bande dessinée, à la différence d'un film ou d'un récit en prose traditionnel, est capable de maintenir ce flux contradictoire en tension, car le développement narratif est retardé, rétracté ou rendu récursif par la profondeur et le volume de la structure graphique.
Pour aborder la question de la littératie liée à l'idée d’un « décodage » de la bande dessinée, on pourrait s'inspirer de l’explication que donne Spiegelman de ce terme. Ses commentaires associent à la bande dessinée une littératie spécifique et active, ainsi qu’en témoigne la déclaration suivante, publiée en 1995 dans le Comics Journal :
Il me semble que la bande dessinée est déjà passée du statut d'icône de l'analphabétisme à celui de l'un des derniers bastions de la littératie. […] Si [ce média] a un problème aujourd’hui, c'est que le public actuel n'a plus la patience de décoder les bandes dessinées. […] Je ne sais pas si nous sommes à l'avant-garde d'une culture différente ou si nous sommes plutôt les derniers artisans d’une culture passée. (1995 : 61)
Ce commentaire s'écarte de l’image que beaucoup se font encore du média. Ainsi que l’écrivait Will Eisner dans Graphic Storytelling : « la bande dessinée en tant que forme de lecture a toujours été considérée comme une menace pour la littératie » (1996 : 3). Fredric Wertham, auteur en 1954 de l'incendiaire Seduction of the Innocent, un livre qui a contribué à introduire la censure dans le champ de la bande dessinée, désignait la consommation des récits graphiques comme « une dérobade à la lecture, et presque son contraire » (cité dans Schmitt 1992 : 157). Pourtant, en présentant des moments ponctuels encadrés qui alternent avec les espaces vides des gouttières au sein desquels il faut projeter une causalité, certains commentateurs (par exemple McCloud 1993a : 66-93, 106 ; Carrier 2000 : 51) soulignent que la bande dessinée exige une participation substantielle du lecteur pour construire le récit, allant jusqu’à favoriser une sorte d’«intimité interprétative» avec celui-ci (Mc Cloud 1993a : 69). Et même à l’intérieur de ses cases, le récit graphique, comme le suggère mon bref commentaire sur l’œuvre de Sacco, peut nécessiter un ralentissement, la forme pouvant devenir très exigeante mentalement. Étant donné que la construction spatiale de la page peut encourager les relectures et brouiller délibérément la linéarité narrative (en bande dessinée, la lecture peut se faire dans toutes les directions), la reconstruction du récit de base exige ainsi un degré élevé d'engagement cognitif34. Dans Goražde, Sacco spatialise le style elliptique de sa prose, que l’on pourrait rattacher à celui d’un écrivain de l’avant-garde littéraire comme Louis-Ferdinand Céline, en fragmentant le texte dans des cartouches flottant à la surface des images. Spatialiser le récit verbal pour dramatiser ou bousculer les fils du récit visuel, revient à introduire des ellipses dans la grammaire d'un support déjà caractérisé par la structure elliptique de la séquence case-gouttière-case. On peut voir un exemple de ce type dans l'une des pages les plus troublantes de Goražde, dans laquelle Sacco illustre le témoignage d’Edin, son ami bosniaque, qui est aussi traducteur. Cette image montre les cadavres des amis d’Edin, quatre hommes morts le premier jour de la première attaque serbe sur Goražde en mai 1992 (fig. 2).
La réaction négative suscitée par la bande dessinée « littéraire » en tant qu’objet de recherche, que l’on peut observer chez beaucoup d’universitaires, met en évidence l’anxiété engendrée par la dimension visuelle de la culture, en lien avec ce que Mitchell a identifié comme le «tournant visuel» (pictorial turn) des années 1990. Cette réaction montre aussi une suspicion envers une forme esthétique profondément marquée par son histoire populaire. Dans un éditorial publié en 2004 intitulé «Dommages collatéraux», Hirsch souligne la crainte de notre profession «qu'à l'ère médiatique contemporaine, nos étudiants (sans parler de nos représentants politiques) aient perdu leur littératie verbale et se soient abandonnés à une visualité dominante et incontrôlable qui altère la pensée». Mais elle écrit aussi – en introduisant les contributions à ce numéro de la revue PMLA portant sur les rapports entre études littéraires et arts visuels, qui comprend quatre prises de position sur la visualité dans The Changing Profession – que ces travaux «révèlent que notre domaine a déjà dépassé cette anxiété» (Hirsch 2004 : 1210).
En effet, le moment est venu d’élargir notre expertise scientifique et notre intérêt pour la bande dessinée. « Quel type de littératie visuelle et verbale sera en mesure de répondre aux besoins du moment présent ? » se demande Hirsch (2004 : 1212). Je parie – tout comme elle, qui analyse ensuite le dernier livre de Spiegelman In the Shadow of No Tower – que les récits graphiques embrassent certaines des questions les plus pressantes posées à la littérature contemporaine : quelle sont les structures narratives les plus pertinentes pour produire une représentation éthique de l’histoire ? Quels sont les enjeux actuels liés au droit de montrer et de raconter l'histoire ? Quels sont les risques de la représentation ? Comment les gens comprennent-ils leur vie en concevant des récits et parviennent-ils à rendre intelligible la difficulté du processus de remémoration ? Les récits graphiques font écho et prolongent les inventions formelles de la littérature, depuis les attitudes sociales et les pratiques esthétiques du modernisme jusqu’à la transition postmoderniste vers une démocratisation des formes populaires. Dans le récit graphique, nous voyons qu’une prise en compte de la reproductibilité et de la circulation de masse peut se conjuguer avec une attention rigoureuse et expérimentale à la forme comme mode d'intervention politique. Les approches critiques de la littérature, comme elles commencent à le faire, doivent porter une attention plus soutenue à cette forme en développement – une forme qui exige de repenser le récit, le genre et, pour reprendre l'expression de James Joyce, la «modalité du visible» (1948 : 39).
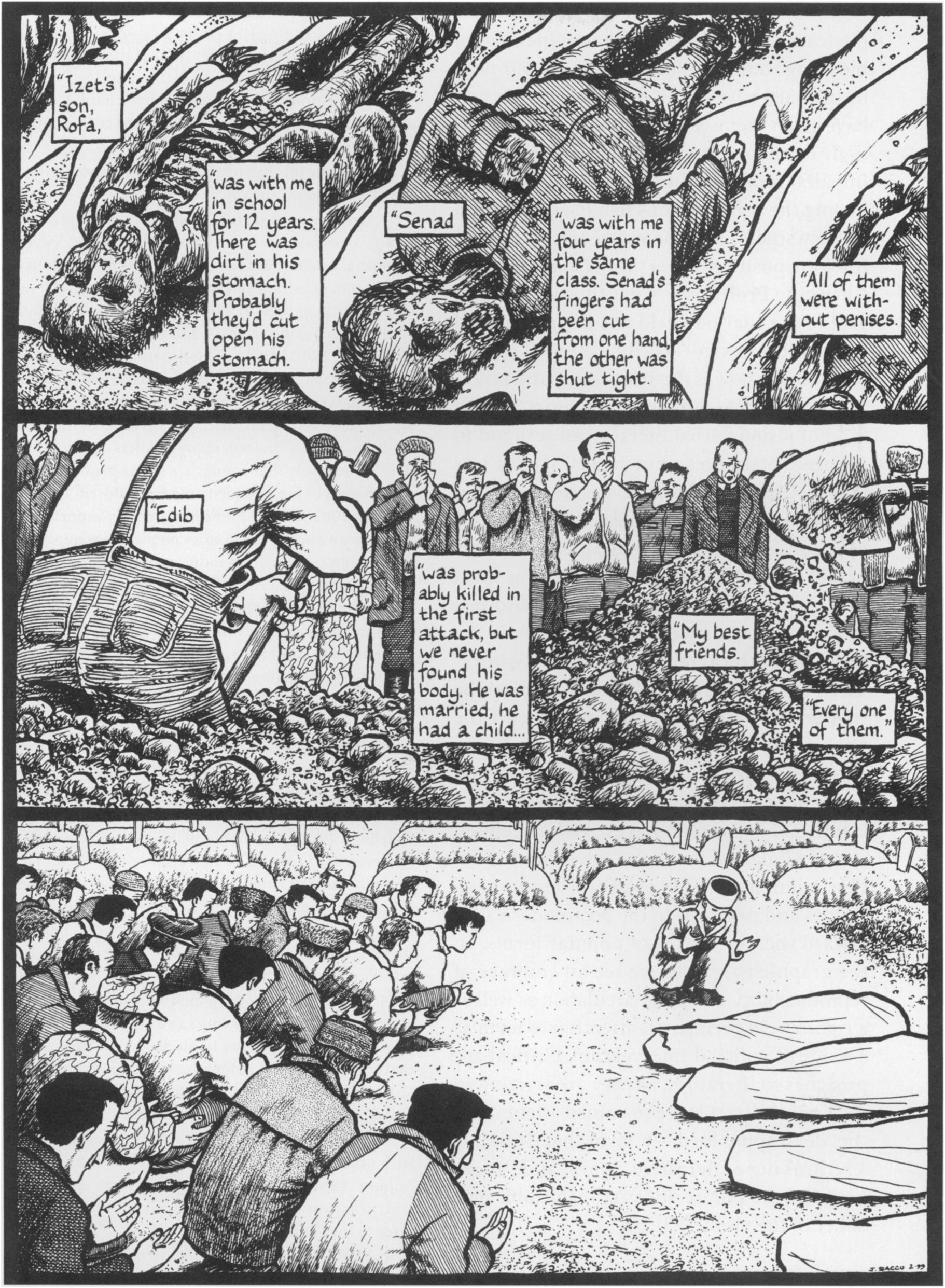 Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.
Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.
Reproduit avec la permission de l’auteur.
Bibliographie
Arnold, Andrew (21 novembre 2003), « A graphic literature library », Time. URL[1] : http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,547796,00.html 35
Baker, Steve (1993), Picturing the Beast: Animals, Identity and Representation, Manchester, Manchester University Press.
Beronä, David A. (2001), « Pictures speak in comics without words: pictorial principles in the work of Milt Gross, Hendrik Dorgathen, Eric Drooker, and Peter Kuper », in The Language of Comics : Words and Image, R. Varnum & C. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississipi, p. 19-39.
Bosmajian, Hamida (1998), « The orphaned voice in Art Spiegelman’s Maus I and II », Literature and Psychology, n° 44 (1-2), p. 1-22.
Brown, Joshua (1988), « Of mice and memory », Oral History Review, n° 16 (1), p. 91-109.
Burns, Charles (2005), Black Hole, New York, Pantheon.
Carrier, David (2000), The Aesthetics of Comics, University Park, University Park, Penn State University Press.
Chute, Hillary (2008), « Ragtime, Kavalier and Clay, and the Framing of Comics », Modern Fiction Studies, n° 54 (2), p. 268-301. URL : https://muse.jhu.edu/article/240720/pdf
Chute, Hillary & Marianne DeKoven (2006), « Introduction: Graphic Narrative », Modern Fiction Studies, n° 52, p. 767-787.
Clowes, Daniel (1998), Ghost World, Seattle, Fantagraphics.
Cohen, Martin S. (1977), « The Novel in Woodcuts: A Handbook », Journal of Modern Literature, n° 6, p. 171-195.
Dowd, D. B., & Melanie Reinert (2004), « A Chronology of Comics and the Graphic Arts », in Strips, Toons, and Bluesies, T Hignite & D. B. Dowd (dir.), New York, Princeton Architectural.
Drucker, Johanna (1995), A Century of Artists' Books, New York, Granary.
Eisner, Will (1996), Graphic Storytelling and Visual Narrative, Tamarac, Poorhouse.
Eisner, Will (1978), A Contract with God: A Graphic Novel by Will Eisner, New York, DC Comics.
Elmwood, Victoria (2004), « "Happy, happy ever after?": The transformation of trauma between generations in Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale », Biography, n° 27, p. 691-720.
Ewert, Jeanne C. (2000), « Reading visual narrative: Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 8, p. 87-103.
Felman, Shoshana & Dori Laub (1992), « Foreword », in Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York, Routledge, p. xiii-xx.
Gardner, Jared (10 septembre 2004), « Reading out of the gutter: early comics, film, and the serial pleasures of modernity », Repetition, conférence à l'English Institute of Harvard University de Cambridge.
Geis, Deborah R. (dir.) (2003), Considering Maus: Approaches to Art Spiegelman’s "Survivor’s Tale" of the Holocaust, Tuscaloosa, University of Alabama Press.
Gopnik, Adam & Kirk Varnedoe (1990), High and Low: Modern Art, Popular Culture, New York, Museum of Modern Art & Harry N. Abrams.
Gordon, Ian (1998), Comic Strips and Consumer Culture, 1890–1945, Washington, Smithsonian Institute.
Harrison, Randall (1981), The Cartoon: Communication to the Quick, Beverly Hills, Sage.
Harvey, Robert C. (2005), « Describing and discarding "comics" as an impotent act of philosophical rigor », in Comics as Philosophy, J. McLaughlin (dir.), Jackson, University press of Mississippi, p. 14-26.
Harvey, Robert C. (2001), « Comedy at the juncture of word and image: the emergence of the modern magazine gag cartoon reveals the vital blend », in The Language of Comics: Word and Image, R. Varnum and C. T. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississippi, p. 75–96.
Heer, Jeet & Kent Worcester (dir.) (2004), Arguing Comics: Literary Masters on a Popular Medium. Jackson, University Press of Mississippi.
Hirsch, Marianne (hiver 2006) « Marianne Hirsch on Maus », entretien avec M. Kuhlman, Indy Magazine.
Hirsch, Marianne (2004), « Collateral damage », PMLA, n°119, p. 1209-1215.
Hirsch, Marianne (1992-1993), « Family pictures: Maus, mourning, and post-memory », Discourse, n°15 (2), p. 3-30.
Hungerford, Amy (2003), The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification, Chicago, University of Chicago Press.
Hutcheon, Linda (1997), « Postmodern provocation: history and "graphic" literature », La Torre, n° 2, p. 299-308.
Huyssen, Andreas (2000), « Of Mice and mimesis: reading Spiegelman with Adorno », New German Critique, n° 81, p. 65-83.
Iadonisi, Rick (1994), « Bleeding history and owning his [father’s] story: Maus and collaborative autobiography », CEA Critic, n° 57 (1), p. 41-56.
Inge, M. Thomas (1990), Comics as Culture, Jackson, University Press of Mississippi.
Janson, Horst Waldemar (1991), « Glossary: cartoon », History of Art, New York, Prentice & Abrams, p. 828.
Joseph, Michael (2003), « Vertigo: a graphic novel of the great depression – an exhibition of the original woodblocks and wood engravings by Lynd Ward », Introduction, exposition organisée par M. Joseph, Special Collections and University Archives, Rutgers University.
Joyce, James (1986 [1922]), Ulysses, New York, Vintage.
Katz, Harry (2006), « A brief history of American cartooning », in Cartoon America: Comic Art in the Library of Congress, New York, Abrams, p. 28-109.
Koch, Gertrude (1997), « "Against all odds"; or, the will to survive: moral conclusions from narrative closure », History and Memory, n° 9 (1), p. 393-408.
Kunow, Rüdiger (1997), « "Emotion in tranquility?" Representing the Holocaust in fiction », Emotion in Postmodernism, G. Hoffmann & A. Hornung (dir.), Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, p. 247-270.
Kunzle, David (2007), Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of Mississippi.
Kunzle, David (1990), The Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, vol. 2 « The history of the comic strip ».
Kunzle, David (1973), The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c.1450 to 1825, Berkeley, University of California Press, vol. 1 « The history of the comic strip ».
LaCapra, Dominick (1998), History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press.
Landsberg, Alison (1997), « America, the Holocaust, and the mass culture of memory: toward a radical politics of empathy », New German Critique, n° 71, p. 63-86.
Lefèvre, Pascal (2000), « The Importance of being "published": a comparative study of different comics formats », Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics, A. Magnussen & H. C. Christianson (dir.), Copenhagen, Museum Tusculanum & University of Copenhagen, p. 91-106.
Levine, Michael G. (2002), « Necessary stains: Spiegelman’s Maus and the bleeding of history », American Imago, n° 59 (3), p. 317-338.
Liss, Andrea (1998), Trespassing through Shadows: Memory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Macdonald, Heidi (17 janvier 2003), « New BISAC category for graphic novels/comics », Publishers Weekly.
McCloud, Scott (mars 2007), « Interview with Hillary Chute », Believer, p. 80-86.
McCloud Scott (1993a), Understanding Comics: The Invisible Art. New York, Harper.
McCloud, Scott (1993b), « Scott McCloud: Understanding Comics », in Comic Book Rebels: Conversations with the Creators of New Comics, S. Wiater & S. R. Bissette (dir.), New York, Fine, p. 3-16.
McGlothlin, Erin (2003), « No time like the present: narrative and time in Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 11 (2), p. 177-198.
McGrath, Charles (11 juillet 2004), « Not Funnies », New York Times Magazine, p. 24+.
Miller, Nancy K. (1992), « Cartoons of the self: portrait of the artist as a young murderer », M/E/A/N/I/N/G, n°12, p. 43-54.
Mitchell, William John Thomas (2003), « The commitment to form; or, Still crazy after all these years », PMLA, n° 118, p. 321-325.
Orvell, Miles (1992), « Writing post historically: Krazy Kat, Maus, and the contemporary fiction cartoon », American Literary History, n° 4, p. 110-128.
Reid, Calvin (23 décembre 2002), « D&Q Heads BISAC, Bookseller Efforts », Publishers Weekly. URL : https://www.publishersweekly.com/pw/print/20021223/19013-d-amp-q-heads-bisac-bookseller-efforts.html
Rosen, Alan (1995), « "The language of survival: English as metaphor on Art Spiegelman’s Maus », Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, n° 15, p. 249-262.
Rothberg, Michael (1994), « "We were talking Jewish": Art Spiegelman’s Maus as "Holocaust" Production », Contemporary Literature, n° 35, p. 661-687.
Sabin, Roger (1993), Adult comics: an introduction, New York, Routledge.
Sacco, Joe (2001), Palestine, Seattle, Fantagraphics.
Sacco, Joe (2000), Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia, 1992–95, Seattle, Fantagraphics.
Said, Edward (2001), « Homage to Joe Sacco », in Palestine, J. Sacco, Seattle, Fantagraphics, p. i-v.
Said, Edward (1985), After the Last Sky: Palestinian Lives, Photographies par J. Mohr, New York, Pantheon.
Satrapi, Majane (2002), Persepolis: The story of a childhood, New York, Pantheon.
Schmitt, Ronald (1992), « Deconstructive Comics », Journal of Popular Culture, n° 25 (4), p. 153-161.
Smolderen, Thierry (6 décembre 2007), « Why the brownies are important», Coconino World.
Spiegelman, Art (1994), The Complete Maus, CD-ROM, New York, Voyager.
Spiegelman, Art (automne 2005), « Ephemera vs. the Apocalypse », Indy Magazine. URL : http://web.archive.org/web/20080615145704/http://64.23.98.142/indy/autumn_2004/spiegelman_ephemera/index.html
Spiegelman, Art (1995), « Interview with Gary Groth », Comics Journal, n°180, p. 52-106.
Spiegelman, Art (1991), Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began, New York, Pantheon.
Spiegelman, Art (1986), Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History, New York, Pantheon.
Staub, Michael E . (1995), « The Shoah goes on and on: remembrance and representation in art Spiegelman’s Maus », MELUS, n° 20 (3), p. 33-46.
Varnum, Robin & Christina T. Gibbons (dir.) (2001), The Language of Comics: Word and Image, Jackson, University press of Mississippi.
Ware, Chris (2000), Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, New York, Pantheon.
Wertham, Fredric (1954), Seduction of the Innocent, New York, Rinehart.
Wheeler, Doug, Robert L . Beerbohm & Leonardo De Sá (2003), « Töpffer in America », Comic Art, n° 3, p. 28-47.
White, Hayden (1992), « Historical emplotment and the problem of truth », in Probing the Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution", S. Friedlander (dir.), Cambridge, Harvard University Press, p. 37-53.
Willems, Philippe (2007), « Form(ul)ation of a novel narrative form: nineteenth-century pedagogues and the comics », Word and Image, n° 24, p. 1-14.
Young, James E. (1998), « The Holocaust as vicarious past: Art Spiegelman’s Maus and the afterimages of history », Critical Inquiry, n° 24, p. 666-699.
Références additionnelles pour la version française
Baetens, Jan (1998), Formes et politique de la bande dessinée, Bruxelles, Peeters.
Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.
Baroni, Raphaël (2018) « Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne : une segmentation précaire », Cahiers de narratologie, n° 34.
URL : http://journals.openedition.org/narratologie/8594
Burns, Charles (2006), Black Hole, Paris, Delcourt.
Clowes, Daniel (1999), Ghost World, Paris, Vertige Graphic.
Eisner, Will (2004 [1978]), Un Pacte avec Dieu, Paris, Delcourt.
Joyce, James (1948 [1922]), Ulysse, Paris, Gallimard.
Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), « A Bilingual Lexicon for a Functional Analysis of Basic Elements of Comic’s Language / Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée », Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107.
URL : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305
Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.
Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée. Les éditeurs franco-belges et l'album, Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB.
Marion, Philippe (2018), « Les stratégies du chapitre en BD reportage », Cahiers de narratologie, n° 34. URL : https://journals.openedition.org/narratologie/9085
Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée), Louvain-la-Neuve, Academia.
McCloud, Scott (2008), L’Art invisible, Paris, Delcourt.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Robert, Pascal (2018), La Bande dessinée, une intelligence subversive, Villeurbanne, Presses de l’Enssib.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des Humanités, Grenoble, UGA Grenoble.
Sacco, Joe (2015), Palestine, Paris, Rackham.
Sacco, Joe (2004), Goražde : la guerre en Bosnie orientale (1993-1995), Paris, Rackham.
Satrapi, Majane (2007), Persepolis, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette ».
Spiegelman, Art (2012 [2011]), MetaMaus, Paris, Flammarion.
Tabachnick, Stephen E. (dir.) (2009), Teaching the Graphic Novel, New York, The Modern Langage Association of America.
Töpffer, Rodolphe (1845), Essai de physiognomonie, Reproduit par Project Gutenberg Canada, n° 957. URL : https://www.gutenberg.ca/ebooks/toeppferr-physiognomonie/toeppferr-physiognomonie-00-t.txt
Ware, Chris (2002), Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth, Paris, Delcourt.
Pour citer l'article
Hillary Chute , "La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques ", Transpositio, Traductions, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques
Voir également :
Lire la littérature à l’école élémentaire en France
Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.
Lire la littérature à l’école élémentaire en France
Lire la littérature
à l’école élémentaire en France :
enjeux et débats au cours du XXe siècle
Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.
Pour saisir ces variations, le croisement de deux approches est nécessaire. D’une part, une investigation didactique permet de saisir comment la lecture des textes littéraires se scolarise, par quelles démarches, avec quels supports, grâce à quels corpus. D’autre part, une approche diachronique rend compréhensibles les contextes sociaux et politiques, les choix effectués, les débats et les enjeux de cette scolarisation. Cette double démarche méthodologique que j’ai qualifiée de didactique historique en français (Bishop 2013), permet de percevoir les finalités attachées à la scolarisation des savoirs et de saisir les transformations liées à des redéfinitions plus ou moins explicites de ces finalités par l’école et la société. Grâce à cette approche, il est possible d’aborder la scolarisation des objets scolaires selon les différentes configurations de la discipline (Reuter & Lahanier-Reuter 2004), comme une organisation de modèles, c'est-à-dire comme des données historiques et disciplinaires qui dépendent des contextes sociaux, des théories disciplinaires sous-jacentes, des prescriptions officielles, des pratiques préconisées et réelles. Ces modèles ne peuvent être datés de manière précise car ils évoluent, changent et ne disparaissent que très progressivement. Le plus souvent, ils se juxtaposent et les plus anciens ne sont que lentement abandonnés dans les pratiques. Cette coexistence crée des effets de feuilletage et de sédimentation (Schneuwly & Dolz 2009). Trois modèles peuvent aider à décrire les différents moments de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire en France. Le premier est celui qui s’installe sous la IIIe République et qui persiste sous la IVe République, il s’agit du modèle fondateur de cet objet scolaire. Le second modèle est celui qui, au moment de la rénovation et de la massification de l’enseignement nait de la remise en question du précédent. Le dernier qui semble émerger à la fin du XXe siècle est le modèle actuel, modèle dominant, nourri des apports d’une didactique qui se constitue.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, ne seront évoquées que les classes de l’école élémentaire, relevant du secteur public, même si, parfois, il est fait référence de manière globale à l’ordre primaire, jusqu’en 1959.
Le modèle fondateur de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire
Introduire la littérature
Le 28 mars 1882 est publiée la Loi sur l’enseignement primaire obligatoire, signée du président Jules Grévy et du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry. Pour la première fois est défini un programme national qui comprend «La langue et les éléments de la littérature française». Accoler ces deux termes n’est pas un hasard, le rôle de la littérature est d’apporter une alternative à l’étude de la langue. Déjà en 1866, Victor Duruy alors ministre sous le Second Empire prend acte dans une circulaire de l’échec de l’enseignement de la langue apprise comme une langue morte par mémorisation et répétition de définitions. Influencé par les écrits du Père Girard (1844) et par les conceptions d’Octave Gréard, directeur de l’Instruction primaire de la Seine depuis 1865, il préconise de réduire l’enseignement grammatical à quelques définitions simples et courtes et à quelques règles fondamentales. Mais surtout, il propose pour la première fois de mettre les élèves «en présence des plus beaux morceaux de notre littérature» 1. Proposer la lecture des textes littéraires comme alternative à la grammaire constitue sans doute un événement majeur en ce milieu de siècle, qui se généralisera à la fin du XIXe siècle (Chervel 2006). C’est à partir de cette période que la lecture des textes va être peu à peu liée à l’étude de la langue et à sa maitrise. Se dessine ainsi ce qui va prendre forme sous la IIIe République, c'est-à-dire la jonction entre l’enseignement de la langue nationale et la littérature.
Toutefois, le projet républicain de la fin du XIXe siècle est beaucoup plus ambitieux et ambivalent, puisqu’il s’agit d’émanciper le peuple par l’éducation, tout en maintenant un ordre social respectueux des différentes classes, c'est-à-dire en conservant les finalités pratiques de l’enseignement primaire. Le but est d’instaurer une démocratie durable en mettant en œuvre un enseignement capable de former à la fois des travailleurs, des citoyens et des électeurs. Pour cela, il est nécessaire de développer, grâce aux textes littéraires, un fonds commun d’idées, de représentations et de valeurs laïques.
Le but de l’enseignement est l’édification du citoyen avec pour principal outil l’enseignement laïc de la morale, mais toutes les disciplines contribuent à cette éducation et la littérature va occuper une place centrale dans l’édifice. C’est là certainement l’une des grandes innovations des pédagogues de la fin du XIXe siècle: pour eux, la lecture des textes littéraires qui existe depuis longtemps dans les lycées et collèges peut être adaptée à l’école élémentaire et contribuer au projet d’éducation populaire.
Les fonctions de la littérature
Pour connaitre les différentes fonctions dévolues à la littérature dans le projet des républicains, il est possible de s’appuyer sur les écrits et les discours de trois acteurs majeurs de cette période. Le premier est Félix Pécaut à qui Jules Ferry propose en 1879 la direction de l’école normale supérieure d’institutrices de Fontenay aux Roses, poste qu’il occupera jusqu’en 1896. Le second est Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire à partir de 1879, puis détenteur de la chaire de pédagogie de la Sorbonne à partir de 1896 et surtout célèbre concepteur du Dictionnaire de pédagogie dont la première édition date de 1887. Notre troisième référence est naturellement Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, malgré quelques interruptions. Ces trois hommes vont défendre une certaine conception de l’école primaire, novatrice et laïque et introduire de manière durable la lecture des textes littéraires dans les classes de l’élémentaire. Leurs discours se croisent et se répondent, s’y dessine un projet politique et social d’édification par la littérature. Tous trois défendent comme principe que la littérature constitue l’un des piliers du projet éducatif des républicains, comme le rappelle F. Pécaut en 1872:
Il n'y a pas d'éducation sérieuse dont la littérature, c'est-à-dire la langue maternelle, l'étude des bons auteurs, les exercices écrits ou les morceaux de style, ne soit le fonds principal. (Pécaut 1881: 96)
Vont lui être dévolus différents rôles qui répondent aux finalités éducatives et politiques du projet d’éducation des classes populaires. Tout d’abord, la littérature occupe une place essentielle dans le processus de laïcisation de l’éducation et dans l’enseignement de la morale. Elle apparait comme un bien commun largement partagé (Chartier & Hébrard 2000) qui permet de conforter les valeurs morales autour d’une émotion esthétique séparée des principes religieux. Comme l’affirme Félix Pécaut:
Il reste à faire passer l’instruction de l’école dans les mœurs, de l’enfance dans toute la vie; il faut de bons livres et le gout de les lire; il faut que cette instruction serve à former des esprits droits et sensés, à aiguiser la curiosité et aussi à la discipliner. (Pécaut 1881: 25)
Ensuite, la littérature permet de développer et d’élever la culture des classes populaires. Jusqu’alors, l’école apportait le strict nécessaire pour entrer dans la vie active, mais pour les républicains, l’école doit éduquer l’individu tout entier et lui fournir un ensemble de connaissances qu’il pourra développer tout au long de sa vie, comme l’affirme F. Buisson dans une conférence de 1883:
[La République] emploiera ces jeunes années à donner aux futurs citoyens, non seulement une instruction rudimentaire, mais tout un trésor d’idées et de sentiments qui feront le bonheur et la dignité de leur vie. (Buisson 1818: 20)
Le livre de littérature et le gout de lire sont les instruments nécessaires au développement d’une culture populaire, comme l’affirme Jules Ferry dans un discours aux directeurs d’école:
Veillez surtout à la culture générale. […] le meilleur service que vous puissiez rendre aux maitres adjoints et aux maitresses adjointes, et puis à vos élèves […] est de leur inspirer le gout de la lecture. Qu’ils aient des livres et qu’ils les aiment; laissez-leur le temps de lire; faites mieux, provoquez-les à lire. (Ferry 1895: 522-523)
La troisième fonction de la littérature est scolaire, car elle permet d’envisager autrement l’étude de la langue. À partir du début du XXe siècle, l’appareil didactique évolue dans les manuels et à la suite de la lecture des textes d’auteurs, divers exercices de langue apparaissent dont des rédactions sur des sujets simples, empruntés à la littérature et à la vie des élèves (Bishop 2010b).
Enfin, la littérature est associée à une conception rénovée du savoir lire. Prenant le contrepied des lectures ânonnantes des décennies précédentes (Chartier 2007), les républicains redéfinissent les objectifs de la lecture scolaire. Il ne s’agit plus de lire pour déchiffrer, mais de lire pour apprendre dans toutes les disciplines, pour comprendre et pour découvrir la littérature française, comme le rappelleront plus tard les programmes de 1923 2:
À l'école primaire, l'enseignement de la lecture sert à deux fins. Il met entre les mains de l'enfant l'un des deux outils - l'autre étant l'écriture - indispensables à toute éducation scolaire. Il lui donne le moyen de s'initier à la connaissance de la langue et de la littérature françaises. (Chervel 1995: t.2, 321)
Quelle littérature pour l’école élémentaire?
Dans le nouveau plan d’études de 1882, les maitres sont invités à lire deux fois par semaine des morceaux empruntés aux auteurs classiques, et ce dès le cours moyen.
Mais que faire lire à l’école élémentaire? Peut-on proposer les mêmes auteurs que dans le secondaire? Les élèves sont-ils en mesure de comprendre la littérature? Comment constituer un fonds littéraire spécifique? Ces questions soulèvent parmi les pédagogues un débat passionné dans les dernières décennies du XIXe siècle (Jey 2003). L’incapacité des élèves des écoles primaires à lire et comprendre les textes classiques apparait comme un frein au projet d’acculturation. Certains, parmi les plus engagés, à l’instar de Buisson, soulignent les limites d’une lecture des œuvres littéraires dans la formation des maitres. Voici ce qu’il écrit dans l’article «Analyse» du Dictionnaire de 1888:
Il manque à la plupart, à la presque totalité de nos élèves maitres une culture esthétique, une initiation littéraire suffisante pour apprécier pleinement les beautés des œuvres qu’on leur demande d’analyser. C’est là l’écueil inévitable; plus qu’aucune autre en Europe, notre littérature nationale est imprégnée, pénétrée, inspirée des souvenirs classiques, elle perd beaucoup de son charme et de son sens pour qui n’a pu passer par l’école de la Grèce et de Rome; or nos instituteurs ne savent ni latin ni grec: il ne faut donc pas se flatter de pouvoir les mettre en état de saisir et de gouter le parfum classique de notre littérature. (Buisson 1888: t.1, 78)
Mais pour résoudre cette difficile contradiction entre nécessité d’une lecture des œuvres littéraires et manque de culture classique, Buisson évoque la qualité des grands écrivains français « qui se sont assez rapprochés de la nature pour être éternellement compris et aimés de tous. ». Il propose de s’appuyer sur les émotions suscitées par ces chefs-d’œuvre et de veiller à « ne faire analyser que des œuvres susceptibles d’entrer dans l’éducation populaire, les plus simples, les plus humaines, les plus naturelles de toutes » (Buisson 1888 : 78).
La solution va donc résider dans le choix d’œuvres accessibles à tous les élèves de l’école primaire, œuvres simples dont maitres et élèves pourront saisir la qualité. Ce que Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction primaire appelle quelques années plus tard, dans une circulaire de 1890, non pas des humanités classiques, mais des «humanités françaises» 3, adaptées au public des écoles primaires.
De quelles œuvres sont constituées ces humanités françaises? Dans une analyse antérieure, cinquante manuels parus entre 1923 et 1995 ont été analysés (Bishop 2010a). À la suite de cette étude, il apparait sans surprise que les deux grands auteurs de la IIIe République sont incontestablement Victor Hugo et La Fontaine, suivis de Molière, qui demeure le seul représentant du trio du théâtre classique à l’école élémentaire (Molière, Racine, Corneille). Mais c’est principalement Victor Hugo qui s’affirme comme le grand auteur de l’école élémentaire et ce jusqu’au milieu du XXe siècle. De veine plus populaire que la Fontaine ou Molière, c’est celui qui est de loin le plus présent dans les manuels. On récite ses poésies morales ou patriotiques mais peu à peu, ses romans prennent une place importante dans les manuels et trois personnages, Cosette, Jean Valjean et Gavroche, vont devenir emblématiques de la culture populaire. Dès le début du XXe siècle, un autre auteur occupe l’une des premières places, il s’agit d’Alphonse Daudet. Également lu en 5e et 6e, il devient une référence de la littérature scolaire et l’un des grands classiques de l’enfance, prenant place dans le panthéon littéraire. Ses œuvres les plus reprises dans les manuels sont sans surprise La Chèvre de M. Seguin parmi Les Lettres de mon moulin, Le Petit Chose et Tartarin de Tarascon.
En-dehors de ces quatre auteurs, les éditeurs scolaires sélectionnent des écrivains du XIXe siècle ou du tout début XXe qui vont constituer le répertoire de la littérature scolaire jusqu’en 1972. Ils sont souvent choisis pour leur écriture classique et reconnue. Parmi eux se trouvent de nombreux académiciens (comme Anatole France, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Duhamel, Henri Troyat ou Maurice Genevoix.) D’autres sont également appréciés pour leurs poèmes édifiants comme Jean Aicard. Certains de ces auteurs décrivent un monde quotidien, (George Sand, Colette, Marcel Pagnol). Nombreux sont les récits situés à la campagne avec ses différentes activités: la chasse, les vendanges, les semailles, etc. Il s’agit de descriptions d’une vie rurale, familiale et laborieuse. On peut y voir la glorification des valeurs traditionnelle de la société française que souligne la forte présence des auteurs régionalistes (Thiesse 1991, 1997) tels que Edmond About, Joseph Cressot, Henri Pérochon, Joseph de Pesquidoux, André Theuriet, pour ne citer que quelques noms. Cette veine importante sous la IIIe République est renforcée par les prescriptions de Vichy et se poursuit encore sous la IVe République.
Une pédagogie de la lecture des textes littéraires
Les leçons de lecture des textes littéraires sous la IIIe République se déroulent selon le schéma en trois temps défini par les instructions officielles de 1923 2:
L'instituteur commencera par lire lui-même à haute voix, en indiquant par les variations de l'intonation les nuances de la pensée et du sentiment, le morceau qu'il veut faire expliquer. Il en fera trouver rapidement les intentions principales. Par des questions alertes et des explications sobres, il fera comprendre le sens des détails et sentir la beauté des expressions. Alors seulement il fera lire le texte à haute voix par des élèves, afin de s'assurer qu'ils en comprennent la signification et en apprécient la valeur. Il va de soi que cette valeur doit être incontestable. (Chervel 1995: t.2, 322)
La démarche se veut toujours identique: d’abord une lecture du maitre, suivie de l’explication des mots, des phrases et l’élucidation du sens, pour finir par la lecture expressive des élèves. Cette lecture expressive, qui ne concerne que les textes littéraires, constitue une véritable pédagogie de la lecture à l’école élémentaire, différente de l’explication de textes des classes du secondaire. Le but de cette démarche est de conduire les élèves à percevoir la beauté des œuvres en suscitant l’émotion esthétique:
Très simplement, [le maitre] suscitera l’émotion esthétique, sans théories abstraites, sans expressions tirées du vieux jargon de la rhétorique, par un simple appel au gout d’enfants dont les impressions sont naïves et dont le jugement n’a pas été formé. (Chervel 1995: t.2, 322)
La lecture n’est pas un événement isolé car tout l’enseignement du français s’organise dans les manuels à partir des textes découverts collectivement, grâce à un appareil didactique assez récurrent d’un manuel à l’autre. Les textes d’auteurs offrent des répertoires d’idées, des réflexions morales et un vocabulaire réutilisés dans les rédactions.
Ce modèle de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire fait preuve d’une belle longévité puisqu’il persiste, malgré les remises en question et débats, jusqu’aux années 1970. Dans son ouvrage Le français tel qu’on l’enseigne, publié en 1971, Frank Marchand entreprend de décrire ce qu’il appelle «le modèle pédagogique standard que l’on retrouve dans la plupart des écoles françaises.» (Marchand 1971: 16). Il constate que les pratiques et les manuels qu’il présente et analyse n’ont guère changé depuis la IIIe République et son constat est sans appel: «Depuis bientôt un siècle, la pédagogie du français à l’école primaire n’a donc fait pour ainsi dire, aucun progrès» (Marchand 1971: 13).
La lecture au moment de la démocratisation
Redéfinir le savoir lire au tournant du XXe siècle
L’arrivée de De Gaulle au gouvernement en 1958 marque un changement de politique scolaire important (Prost 1992). Deux réformes successives, le décret Berthoin en 1959 (qui prolonge la scolarité jusqu’à 16 ans) et le décret Fouchet-Capelle en 1963, institutionnalisent le principe d’un collège pour tous et modifient profondément le paysage scolaire français.
Cependant dans le domaine de l’enseignement de la lecture la question du modèle de lecteur à former commence à se poser beaucoup plus tôt. Comme le remarque A.-M. Chartier (2007), la lecture silencieuse apparait dès 1938 dans les instructions qui prescrivent pour le certificat d’études:
Au cours supérieur deuxième année, le programme prescrit explicitement la lecture silencieuse. Par ailleurs, le Conseil supérieur a voulu qu'à l'épreuve de lecture du certificat d'études, il fût accordé à l'enfant cinq minutes de préparation. Cette préparation ne peut consister qu'en une lecture silencieuse; il faut bien que les élèves y aient été d'avance exercés. Dès la classe du certificat d'études on se préoccupera donc de la lecture silencieuse. On ne peut lire intelligemment que si l'on embrasse rapidement des yeux le texte qu'on va lire. On ne peut lire à haute voix correctement les mots d'une phrase, couper cette phrase aux silences imposés par le sens, accentuer exactement les syllabes significatives, que si l'on a, par avance, saisi le sens de la phrase dans son ensemble. La voix est nécessairement devancée par les yeux. (Chervel 1995: t.2, 273)
Le problème que soulève ce texte est celui de la méthode de lecture: peut-on considérer que l’élève qui n’aborde jamais seul un texte, qui ne le découvre que par la lecture du maitre comprend ce qu’il lit? La lecture expressive permet-elle la compréhension?
Cette question prend une réelle importance au sortir de la Seconde Guerre, lorsque la reconstruction du pays nécessite de faire appel à une main d’œuvre plus qualifiée, capable de lire et de comprendre de manière autonome. Dès 1945, certainement sous l’influence des bibliothécaires selon Chartier et Hébrard (2000), les mentalités changent, la lecture personnelle n’apparait plus comme un risque pour les jeunes esprits et l’on voit naitre l’idée qu’elle peut avoir une valeur éducative. Mais ce principe ne pénètre pas immédiatement dans les discours officiels et il faut attendre la circulaire datée du 29 décembre 1956 sur la suppression des devoirs du soir pour que soit évoquée une lecture autonome, silencieuse, personnelle, distrayante et en même temps éducative.
La fin des années 1950 constitue un tournant dans la manière dont l’école définit le savoir-lire. Au cours de cette période se manifeste une évolution dans les attentes sociale vis-à-vis de la lecture et dans les finalités dévolues à la lecture des textes littéraires à l’école. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces changements.
Le premier est celui d’une demande sociale. La diffusion de plus en plus importante des livres et journaux dans les classes populaires en lien avec l’action militante de certains bibliothécaires (Butlen 2008) répand l’idée que la lecture est une pratique qui permet l’épanouissement et l’accès à la culture et qu’il est nécessaire de développer dès l’école primaire ce gout de la lecture.
Le second facteur de changement est lié à l’arrivée massive des écoliers dans les classes de 6e, dans le courant des années 1950. Le niveau de ces nouveaux élèves ne correspond pas aux attentes des professeurs qui déplorent régulièrement leur faible maitrise de la lecture. Les nouveaux collégiens, disent-ils, n’aiment pas lire et le plus souvent lisent mal ou ne savent pas lire. Et que leur reproche-t-on? D’avoir une lecture trop scolaire, c'est-à-dire d’être capables d’oraliser sans comprendre ce que dit le texte. La lecture expressive définie en 1923, ne répond plus aux exigences de la scolarité allongée. Pour savoir lire au-delà de l’école élémentaire, il faut être capable d’appréhender le contenu de n’importe quel écrit.
Ces reproches sont pris en compte par le ministère et en janvier 1958, des instructions 5 concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire sont publiées. Elles proposent une nouvelle définition du savoir lire scolaire en insistant sur la compréhension.
L’expression «savoir lire» a un sens au cours préparatoire; elle doit en avoir un autre au cours élémentaire, au cours moyen et dans la classe de fin d’études. Il convient de ne pas jouer sur les mots. Pour un élève de la grande classe, ce n’est pas «savoir lire» que de savoir déchiffrer péniblement un texte. Savoir lire, pour un candidat au certificat d’études primaires, c’est être capable de lire un texte – silencieusement ou à haute voix – à un rythme assez rapide pour que l’intelligence soit capable de saisir le sens, non d’un mot mais d’un groupe de mots. […] À une époque où évoluent si rapidement les techniques et les structures économiques et sociales, notre premier devoir est de donner à l’enfant le moyen, quand il aura quitté notre école, de se tenir au courant. Or ce moyen c’est de savoir lire – au sens où nous l’entendons. (Bulletin officiel 1958: 1103)
Ce texte remet en cause la pédagogie de la lecture expressive qui était le modèle dominant des IIIe et IVe Républiques. Le savoir lire, en 1958, nécessite de développer l’autonomie des élèves dans ce domaine et de s’assurer que le sens est saisi, comme le précise cette même circulaire:
L’exercice de lecture expressive n’a pas pour fin, on le sait, de dresser l’enfant à lire comme un acteur, mais seulement d’apporter la preuve qu’il comprend ce qu’il lit. Encore faut-il ne pas se laisser duper. Un enfant moyennement habile peut lire avec expression un texte qu’il ne comprend pas. (Bulletin officiel 1958: 1103)
Ces instructions instituent un changement important des pratiques de lecture. Celle-ci ne devrait plus être l’exercice collectif et oralisé des décennies précédentes, au contraire il est question de lectures personnelles et silencieuses, faites à la maison et restituées sous forme d’exposés et de discussions.
La lecture silencieuse et le plaisir de lire
Mais le grand changement va être la prescription de la lecture silencieuse qui advient quelques années plus tard, en décembre 1972, dans de nouvelles instructions. Ces textes s’inspirent de l’important travail de la Commission Rouchette qui a été mise en place en 1963 et reprennent une partie des propositions du Plan de Rénovation, rédigé en 1969. La conception de la lecture scolaire qui apparait à cette période se démarque totalement des prescriptions antérieures par trois aspects. Le premier est le constat de l’inefficacité des pratiques scolaires, ce que souligne le nombre important d’échecs scolaires et de redoublements. En effet, une enquête menée en 1967 6 chiffre à plus de 70% le nombre d’élèves 7 ayant redoublé au moins une fois au cours de la scolarité primaire, avec plus de 35% de redoublements au CP. Le second élément est que la compréhension des textes devient la finalité principale et qu’elle ne peut se réduire à l’oralisation. La nouvelle prescription insiste sur la nécessité de lire pour comprendre et ce dès le CP, car le principal problème des mauvais lecteurs en 6e est bien la difficulté à saisir le sens des textes. Dans les instructions de 1972, lire est défini comme la capacité à prélever les informations essentielles d’un texte au cours d’une lecture individuelle et silencieuse. La démarche de 1923 qui prônait la lecture à haute voix, expressive, et la répétition d’un même texte est définitivement abandonnée. Le dernier point est que les supports de lecture se diversifient, car il semble nécessaire de ne plus s’appuyer sur le seul corpus des textes littéraires reconnus. L’objectif, à partir de 1972, est d’être capable de tout lire. La lecture est présentée comme un acte de communication qui sert à s’informer, et à se distraire; sont donc privilégiés les textes issus de situations de communication concrètes et les ouvrages que les jeunes lecteurs pourront lire seuls.
Mais dans les faits, ces instructions de 1972 ne modifient que peu les pratiques de lecture à l’école élémentaire. C’est ce que révèle un rapport de 1985 8 demandé par le ministère sur l’enseignement du français: dans de nombreuses classes, c’est encore la lecture à haute voix qui tient fréquemment lieu d’unique pédagogie de la lecture.
Toutefois, ces instructions amorcent un grand changement dont les effets deviendront perceptibles quelques années plus tard. La lecture demeure une activité éducative mais ses finalités sont radicalement différentes. Il ne s’agit plus de partager dans une démarche collective l’admiration pour les œuvres, mais de satisfaire un plaisir qui ne peut se découvrir que dans des pratiques personnelles et silencieuses. Les deux objectifs de l’enseignement sont désormais de développer la motivation et le plaisir de la lecture.
Changement des corpus
Redéfinir le savoir lire et les finalités de la lecture entraine d’importantes modifications dans les corpus proposés par l’école. Entre 1970 et 1980 les listes d’auteurs mis à disposition dans les manuels changent. Plusieurs facteurs contribuent à ces modifications radicales.
Le premier est l’influence des mouvements pédagogiques qui considèrent la lecture comme un élément clé de l’éducation et de l’épanouissement des enfants, il s’agit du Groupe français d’Éducation nouvelle (GFEN), de l’Institut coopératif de l’école moderne fondé par Freinet (ICEM) et de l’Association française pour la lecture (AFL) pour n’en citer que trois. Ces mouvements n’accordent cependant pas tous la même importance à la lecture des œuvres de littérature en classe et c’est principalement l’AFL qui s’engage pour que les œuvres destinées à la jeunesse deviennent des supports de l’apprentissage de la lecture. La seconde cause de changement est la prise de conscience d’un rejet des œuvres littéraires classiques par les jeunes lecteurs et les risques de concurrence avec les nouveaux médias. Les gouts des élèves deviennent le critère de choix. Il ne s’agit plus d’imposer des lectures édifiantes choisies par le maitre, mais de proposer des ouvrages capables de susciter motivation et plaisir de lire. Le principe des lectures attractives, destinées au jeune public et d’accès facile apparait dans le Plan de Rénovation et sera repris dans les instructions de 1972.
Encore que le gout des enfants ne soit pas le seul critère, il est indispensable qu'ils se plaisent à lire les livres que nous choisissons pour eux. Des enquêtes diverses sur les gouts des enfants ont permis d'établir qu'ils préfèrent les livres captivants, amusants, les livres tonifiants où l'amitié, la sympathie, la solidarité jouent un grand rôle, les livres riches en aventure, qui leur donnent des informations vraies ou vraisemblables. Il serait inconcevable de n'en pas tenir compte, comme de ne pas attacher un prix particulier à la valeur humaine, à l'authenticité dans la réalité comme dans l'imaginaire, à la qualité de la langue comme de l'illustration.
L’étude déjà citée sur les corpus des manuels (Bishop 2010a) rend compte de ce changement et le palmarès des vingt auteurs les plus cités dans dix manuels édités entre 1972 à 1985 est significatif. On assiste d’abord à un déplacement des grandes figures littéraires de l’école laïque: Alphonse Daudet prend la tête du classement pour une dizaine d’années, Victor Hugo reste encore présent, mais Jean de La Fontaine est beaucoup moins cité.
Les thèmes qui organisent les lectures connaissent également de grands bouleversements, les saisons et les travaux sont remplacés par l’aventure et l’amitié. Saint-Exupéry qui aborde ces deux thèmes apparait en seconde position après Daudet, dans le palmarès de 1972-1985. On lit Le petit prince, et plus particulièrement le passage de la rencontre avec le renard. Les passages concernant les aventures aéronautiques de l’auteur sont nombreux, empruntés à Vol de nuit ou Terre des hommes. D’autres récits d’aventures vécues comme ceux du Commandant Cousteau, de Joseph Kessel, ou encore de Paul Émile Victor, de Frison-Roche, de Haroun Tazieff, de René Demaison et de Maurice Herzog figurent aussi dans plusieurs manuels. Leur point commun est le thème de l’aventure, du courage et du dépassement de soi. Les personnages et les auteurs sont considérés comme des héros modernes. Ces récits défendent certaines valeurs auxquelles l’école attache une importance morale, telles que le courage et la solidarité. En ce sens, l’édification par la littérature demeure une constante de la lecture à l’école même si elle adopte d’autres formes. Ces choix sont également à mettre en relation avec l’attrait pour la modernité, notion forte au cours de cette période. Il s’agit d’une modernité technologique et urbaine qui prend souvent l’avion comme symbole et qui explique la moindre présence des auteurs régionalistes. En effet, on ne retrouve plus que Joseph Cressot auteur du Pain au lièvre dont on continue à lire les souvenirs d’écolier campagnard. Cependant, de nombreux auteurs de la toute fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle demeurent dans le corpus scolaire. Il s’agit de Henri Bosco, Marcel Pagnol, Louis Pergaud, Jules Renard, qui tous mettent en scène des enfants, de même que des auteurs plus récents comme Joseph Joffo. Dans le même esprit, se rencontrent des romans qui décrivent l’amitié entre un enfant et un animal, c’est le cas des textes de René Guillot, auteur de Crin Blanc ou des textes de Joseph Kessel. C’est ainsi qu’une littérature qui s’adresse au jeune public s’installe véritablement, avec de plus en plus de contes et de récits écrits pour les enfants, comme les Histoires comme ça de Rudyard Kipling. La BD fait même une timide apparition avec des extraits d’Astérix ou de Tintin, malgré une certaine défiance vis-à-vis du genre.
La lecture des textes
Le changement de méthode institué par les textes officiels à partir de 1972 est radical, puisqu’il est préconisé une lecture individuelle et silencieuse. Dans les manuels ou fichiers, les textes sont accompagnés le plus souvent d’un questionnaire qui permet de vérifier la compréhension de l’élève. Les questions sollicitent un relevé d’informations portant sur les lieux, la temporalité, la chronologie, les agents et leurs principales actions. Les lectures sont souvent placées dans des ensembles thématiques qui permettent de croiser différents types de documents: récits, documentaires, publicités, etc. Les conceptions de la lecture comme traitement de l’information et l’ouvrage de Richaudeau sur la lecture rapide, daté de 1969, ont une influence certaine sur les conceptions de la lecture et on en trouve trace dans les préconisations officielles. Ainsi, les instructions de juillet 1980 9 pour les cours moyens présentent la lecture comme un prélèvement d’informations qui ne nécessite pas nécessairement une lecture exhaustive.
Savoir lire, c'est: - pratiquer naturellement et efficacement la lecture silencieuse, c'est-à-dire la vraie lecture, celle qui permet de comprendre le sens, sans s'attarder aux syllabations, en maitrisant assez les mécanismes et les techniques pour n'y recourir qu'à titre de contrôle ou de moyen d'élucidation. (Chervel 1995: t.3, 332)
La lecture doit être silencieuse pour permettre de comprendre et de prélever des informations. Les lectures privées d’œuvres complètes accessibles aux jeunes lecteurs sont encouragées, la littérature dépasse le cadre de la classe. Les instructions de 1985 vont renforcer le caractère culturel de la lecture en insistant sur le développement du désir de lire et sur la nécessaire fréquentation des livres, prônant que «lire c’est comprendre». Mais les limites de la lecture silencieuse apparaissent assez vite pour deux raisons, la première est la difficulté à contrôler les apprentissages des élèves, la seconde raison est sociale, il s’agit d’une remise en question de l’école lors de la prise de conscience du phénomène de l’illettrisme en 1984.
La didactique de la lecture des textes littéraires
La critique de la lecture silencieuse
Dès le milieu des années 1980, les résultats de l’école dans le domaine de la lecture sont dénoncés pour leur insuffisance. Deux rapports vont jouer un rôle important. Le premier, intitulé les Illettrés en France (Espérandieu et al. 1984), suscite une remise en question des méthodes scolaires. Ce rapport va déclencher un important courant de réflexion sur la lecture et provoquer une réflexion sur sa définition, son apprentissage et sur les dispositifs d’aide et de remédiation. Le second rapport, celui du recteur Migeon de 1989 (Ministère de l’Éducation nationale 1989), souligne les inadéquations entre «les attentes que suscite l’école et les résultats qu’elle obtient». Ce rapport dénonce les inégalités sociales et territoriales, les redoublements et les faibles acquis en lecture puisque, reprenant les résultats d’une enquête de l’AFL, il annonce que le nombre de lecteurs capables de comprendre ce qu’ils lisent est faible: 9% à l’entrée au collège et 19% en 3e.
Ces publications nourrissent et accompagnent de nombreux débats sur l’apprentissage de la lecture qui touchent principalement l’acquisition du lire-écrire et qui tentent de définir et de trouver un consensus sur ce qu’est la lecture et sur la meilleure manière de l’enseigner (Chartier & Hébard 2000). Le domaine est occupé par deux grandes familles de recherches. Les premières sont celles des innovateurs qui refusent les apprentissages trop mécanistes et restent méfiants face au décodage et à la lecture à haute voix. Les secondes sont celles des psychologues cognitivistes qui vont modifier profondément les conceptions du savoir lire en France. D’une manière générale, ces chercheurs remettent en question le modèle de la lecture silencieuse et plus particulièrement les approches idéovisuelles. Dès 1988, Liliane Sprenger-Charolles souligne dans sa thèse que les difficultés ne viennent pas de la compréhension mais d’un déficit de l’identification des mots, ce que les méthodes uniquement centrées sur la reconnaissance logographique ne peuvent améliorer. Au cours des Entretiens Nathan sur la lecture qui ont lieu les 10 et 11 novembre 1990 à Paris se côtoient les innovateurs et les cognitivistes. Les travaux de ces derniers apportent de nouveaux modèles qui mettent en lumière la complexité du processus de compréhension qui va être peu à peu envisagé comme un possible objet d’enseignement et d’apprentissage.
La didactique de la lecture des textes littéraires va naitre de ces débats car il apparait dans le courant des années 1990 que la seule fréquentation des livres ne suffit pas à mener les élèves vers le désir de lire et que la lecture silencieuse ne peut garantir des acquisitions définitives. De plus, les travaux anglo-saxons de psychologie cognitive conduisent à modifier les conceptions sur la compréhension en lecture et mettent en lumière les procédures mentales des lecteurs. Enfin, les théories littéraires sur la réception du texte et sur le rôle du lecteur dans l’activité interprétative vont entrer en collision avec les précédentes.
Le ministère rend compte de cette profusion de recherches et publie en 1992 une véritable mise au point théorique, il s’agit de La maitrise de la langue à l’école (Ministère de l’Éducation nationale 1992a) qui présente un état des lieux de la didactique du français, accompagné d’une bibliographie d’études portant sur la didactique du français entre 1980 et 1992. Mais sur les cent titres proposés treize seulement concernent la lecture des textes et l’activité du lecteur, parmi ceux-ci sept sont des ouvrages de sociologie et six seulement traitent de la littérature de jeunesse ou des activités de compréhension des textes dans une approche pédagogique ou littéraire. La didactique de la littérature est encore peu présente dans les travaux répertoriés. Les rédacteurs de l’ouvrage La maitrise de la langue à l’école envisagent la fréquentation des livres du patrimoine comme une nécessité et évoquent «l’initiation des jeunes lecteurs à la lecture littéraire» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) ainsi qu’une «pédagogie de la réception des textes» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) pour laquelle il n’existe pas encore, en 1992, de méthode clairement définie sinon le souci de se démarquer des pratiques du second degré.
À l'école élémentaire, l'approche des grands textes ne relève ni de l'histoire littéraire ni d'une technique particulière de lecture (lecture expliquée, lecture méthodique, etc.). Elle se construit dans le cadre d'une connivence culturelle et émotive qu'il appartient à l'enseignant d'installer avec soin. (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 107)
La naissance de la didactique de la lecture des textes littéraires
Les groupes de recherche créés dans le courant des années 1970 par l’INRP pour accompagner le mouvement de rénovation du français suscitent un développement rapide des études de didactique de la langue maternelle, qui portent surtout sur l’oral, l’étude de la langue et l’écriture. Mais il faut attendre le début des années 1990 pour que soit posée la question de l’enseignement de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire.
Cependant différentes approches existent déjà, elles vont servir de base aux travaux ultérieurs. Un premier domaine d’investigation est linguistique ou psycholinguistique. Il s’agit d’une réflexion sur l’utilisation des typologies textuelles comme outil de lecture. Ce sont, entre autres, les travaux des revues Pratiques et du Français aujourd'hui, à partir de 1984 avec des articles de Brigitte Duhamel, de Bernard Schneuwly, Jean-Paul Bronckart ou Jean-Louis Chiss, et d’autres encore. Un autre courant plus pédagogique est issu des mouvements qui promeuvent la littérature de jeunesse comme support éducatif. Ces recherches sont proches ou issues des mouvements pédagogiques comme l’AFL ou le GFEN, des associations de défense des livres de jeunesse, ou des groupes de bibliothécaires comme L’Heure Joyeuse. Les publications qui proposent des activités concrètes à partir de titre d’ouvrages paraissent à partir de 1985, signées de Jean-Claude Bourguignon, Rémy Stoecklé, Josette Jolibert, Bernard Devanne, Jean Perrot, pour ne citer que quelques noms. Un dernier courant s’intéresse davantage à l’histoire et aux relations entre école et littérature, on peut citer l’ouvrage de Francis Marcoin, À l’école de la littérature, paru en 1992.
Mais c’est réellement à partir de 1995 que des travaux vont tenter de définir des modèles didactiques de lecture des œuvres littéraires, en utilisant les amorces de recherches citées précédemment. Le n°13 de la revue Repères, publié en 1996 sous la direction de Catherine Tauveron et Yves Reuter témoigne de ce souci de formaliser ce qui commence à se dessiner dans le champ de la didactique, puisqu’il propose, en introduction, de «problématiser l’enseignement/apprentissage de la littérature à l’école élémentaire et de construire des propositions pour une didactique de la littérature à l’école» (Tauveron & Reuter 1996: 13).
Mais les auteurs reconnaissent que la tentative est précoce et «audacieuse», que le domaine est encore bien peu exploré et que les travaux gardent une dimension spéculative. Cependant, très rapidement l’espace va se remplir. L’institutionnalisation de la littérature dans les instructions de 2002 et la mise en place d’une épreuve orale spécifique au concours de professeur des écoles en 2005 développent un courant de recherches et de formation prolifiques. Certains travaux spécifiques comme ceux de Catherine Tauveron (Tauveron 2002) ont une forte influence sur l’ensemble de la communauté éducative et ont certainement irrigué les instructions de 2002.
Lire des textes littéraires
La lecture des textes littéraires à l’école élémentaire se développe en lien avec l’évolution des enjeux sociaux à l’aube du XXIe siècle. Il s’agit d’éviter les clivages culturels et d’utiliser la littérature comme ciment de la communauté nationale. L’introduction des instructions de 2002, signées du ministre Jack Lang, est significative de ce phénomène. Le thème de la culture commune, fondement d’une langue commune, est largement présenté et la relation entre inégalités sociales et inégalités culturelles institue la littérature comme l’un des principaux moyens que possède l’école pour dépasser ces inégalités:
L’inégalité sociale, nous le savons est d’abord une inégalité culturelle: c’est à l’école qu’il appartient de réduire cette distance par rapport au savoir et à la culture. (Ministère de l’Éducation nationale 2002b: 8)
Ce partage d’une culture commune se produit grâce à la connaissance d’œuvres patrimoniales contribuant à ressouder une communauté autour de la littérature.
Le but des instructions de 2002 est d’instituer une pédagogie de la lecture littéraire spécifique pour l’école primaire, libérée du modèle secondaire de type explicatif. Cette lecture est conçue comme une activité interprétative, et pour la première fois, l’objectif n’est plus seulement de s’assurer de la compréhension des textes. Les instructions de 2002 tentent d’instituer un lecteur spécifique, lecteur interprète, dans une approche inspirée des théories de la réception. La nouvelle didactique de la lecture littéraire s’appuie sur des pratiques pédagogiques qui vont connaitre un certain succès auprès des enseignants. Il s’agit des lectures en réseaux, fondées sur le principe de l’intertextualité et des débats interprétatifs qui font de la lecture une activité partagée et socialisante devant permettre de fonder une communauté de lecteurs. Les liens entre lecture et écriture sont renforcés par la tenue de carnets de lecture, recommandés par les instructions.
De plus, l’activité intertextuelle et interprétative suppose un corpus de textes « ouverts à interprétation ». Pour l’école élémentaire, ces textes sont systématiquement choisis dans la littérature de jeunesse, considérée à l’égal de la littérature adulte dont elle possèderait toutes les caractéristiques. Les ouvrages de jeunesse sont proposés dans trois listes publiées en 2002, 2004 et 2007 et servant de référence tant pour les enseignants que pour les éditeurs. Là encore il s’agit d’une première fois : le ministère n’avait jusqu’alors jamais publié de liste pour les niveaux élémentaire ou maternelle du primaire.
Les corpus proposés par les manuels se modifient dès 1985. Selon l’étude de 2010 déjà évoquée (Bishop 2010a), nous pouvons remarquer que les corpus scolaires évoluent rapidement entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, ils présentent quatre caractéristiques nouvelles. La première est l’entrée massive de la littérature de jeunesse dans les manuels, dès 1985, avec des auteurs dont une grande partie de l’œuvre est dédiée à la jeunesse tels que Michaël Morpurgot, Anthony Horowitz, Roald Dahl, Gianni Rodari, Evelyne Brisou Pellen, Bernard Friot, Pierre Gripari, Dick King-Smith, pour ne citer que quelques noms. Le second élément est la disparition des auteurs du XIXe siècle. Ils sont remplacés par des œuvres appartenant à un patrimoine national ou mondial, où les contes et les fables retrouvent une place de choix: Grimm, Perrault, Andersen, Mme Le Prince de Beaumont, La Fontaine, Ésope, etc. Un troisième élément est la présence importante de la poésie, considérée comme un objet littéraire en soi et non uniquement comme support de récitation. La poésie est proposée pour être dite, créée, écoutée, imitée. Les auteurs fréquemment mentionnés s’adressent à un jeune public. Il s’agit, entre autres de Claude Roy, Pierre Gamarra, Maurice Carême, Jacques Charpentreau, Georges Jean, etc. Le quatrième et dernier point est l’ouverture des corpus: la littérature donnée à lire dépasse le cadre des frontières et s’internationalise. Les œuvres étrangères, traduites ou francophones, représentent près de 40 % de l’ensemble des titres proposés dans les listes ministérielles de 2002 et 2004 (Bishop & Ulma 2007). Mais ces textes sont lus avec des objectifs littéraires tels que la connaissance des personnages ou l’intertextualité. À la fin du XXe siècle, l’école institue un nouvel ensemble d’œuvres à lire dans les classes qui deviennent des classiques de la jeunesse. Ces corpus répondent aux finalités culturelles, sociales, éducatives, patrimoniales et littéraires que la société semble assigner à la lecture des œuvres littéraires à l’école élémentaire.
Pour conclure, il est possible de remarquer que, au cours des différentes périodes évoquées, la lecture des textes littéraires à l’école primaire a été fortement marquée par les contextes sociaux et politiques et par le projet éducatif attaché à l’école élémentaire. Cette activité a été maintes fois l’objet de débats et d’enjeux. L’une de ses caractéristiques est d’avoir toujours tenté de se dégager du modèle du secondaire, et il n’a jamais été envisagé de transmettre des savoirs sur la littérature ou sur son histoire, ni de pratiquer des explications littérales des textes. Au contraire, depuis la IIIe République, on s’efforce de mettre en place une pédagogie de la lecture des textes littéraires qui soit spécifique au public des écoles primaires. Mais surtout, avant 2002, la littérature ne constitue pas un objet d’enseignement, il n’y a pas d’éléments littéraires à enseigner. On enseigne la lecture des textes littéraires, mais jamais la littérature en soi. C’est à partir des instructions de 2002 que la lecture littéraire est instituée par les textes officiels avec des objets et des démarches particuliers. Cette didactique de la littérature à l’école élémentaire est récente, elle repose sur des procédures spéculatives qui relèvent de notre conception moderne de l’interprétation et de l’institution de l’élève comme individu autonome.
Bibliographie
Anonyme (1985) - Réflexions sur l’enseignement du français 1983-1985, Rapport de la Commission de Réflexion sur l’Enseignement du français, Angers, CNDP de Maine et Loire.
Bulletin officiel de l'éducation nationale, « Instructions concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire », n°14, 27 mars 1958, p. 1103.
Bishop, Marie-France & Dominique Ulma (2007), «Approche historique et comparatiste de la place de la littérature à l’école», in La littérature à l’école, enjeux, résistances, perspectives, M. Lebrun, A. Rouxel & C. Vargas (dir.), Aix en Provence, Publications de l’Université de Provence, 2007, p. 63-88.
Bishop, Marie-France (2010a), «Que lit-on à l’école primaire au cours du XXe siècle? Listes et corpus de textes de 1880 à 1995» in Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Rennes, PUR, 2010, p. 139-152.
Bishop, Marie-France (2010b), Racontez vos vacances, Grenoble, PUG.
Bishop, Marie-France (2013), Statuts et fonctions de la mise en perspective historique dans la didactique du français, Mémoire d’habilitation, Lille, Université de Lille 3.
Butlen, Max (2008), Les politiques de lecture et leurs acteurs (1980-2000), Lyon, INRP.
Chartier, Anne-Marie (2007), L’école et la lecture obligatoire, Paris, Retz.
Chartier, Anne-Marie & Jean Hebrard, (1989), Discours sur la lecture. (1880-2000), Paris, Fayard (2e éd. : Fayard, 2000).
Chervel, André (1988), «Pour une histoire des disciplines scolaires», Histoire de l’éducation, n°38, p. 59-119.
Chervel, André (1995), L’enseignement du français à l’école primaire. Textes officiels, t.1-3, Paris, INRP.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (1996), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck (2e éd. : De Boeck 2005).
Espérandieu, Véronique, Antoine Lion & Pierre Bénichou (1984), Des illettrés en France. Rapport au premier ministre, Paris, La Documentation française.
Girard, Grégoire (1844), De l’enseignement régulier de la langue maternelle dans les écoles et les familles, Paris, Debrozy, E. Magdeleine et Cie.
Jey, Martine (2003), «La littérature, un objet ambigu» in D. Denis & P. Khan (dir.), L’école républicaine et la question des savoirs, Paris, CNRS, p. 79-102.
Ministère de l’Éducation nationale (1989), La réussite à l’école. Rapport du recteur Michel Migeon à Lionel Jospin, Paris, CNDP.
Ministère de l’Éducation nationale (1992a), La maitrise de la langue à l’école, Paris, CNDP, Savoir Lire.
Ministère de l’Éducation nationale (1992b), Qu’apprend-on à l’école élémentaire?, Paris, CNDP.
Prost, Antoine (1992), Éducation, société et politique, Paris, Seuil.
Reuter, Yves & Dominique Lahanier-Reuter (2004), Présentation de quelques concepts pour analyser l’écrit, St. Louis, Colloque Writing across the curriculum international.
Schneuwly, Bernard & Dolz Joachim (2009), Des objets enseignés en classe de français, Rennes, PUR.
Sprenger-Charolles, Liliane (1988), L'apprentissage de la lecture et de ses difficultés: contribution. Thèse soutenue sous la direction de Frédéric François, Paris 5.
Tauveron, Catherine (dir.) (2002), Lire la littérature à l’école, Paris, Hatier.
Tauveron, Catherine & Yves Reuter (dir.) (1996), Repères, n°13, «Lecture et écriture littéraire à l’école».
Thiesse, Anne-Marie (1991), Écrire la France, le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la belle époque et la Libération, Paris, PUF.
Thiesse, Anne-Marie (1997), Ils apprenaient la France, l’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Pour citer l'article
Marie-France Bishop, "Lire la littérature à l’école élémentaire en France", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/lire-la-litterature-a-l-ecole-elementaire-en-france
Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images
Pourquoi et comment enseigner la littérature aujourd'hui {{Mes remerciements à Sophie Queuniet, ainsi qu’aux lecteurs anonymes de cet article, pour leurs suggestions et retours, que je n’ai pas toujours pu développer suffisamment, faute de place.}} ? J’aborderai cette question à travers un grand écart instaurant une double distance envers la définition canonique de « la littérature », telle que cette définition s'est imposée dans nos cultures occidentales aux XIXe et XXe siècles. En aval de cette période, je réfléchirai à la façon dont les évolutions médiologiques des trois dernières décennies ont induit des pratiques interprétatives que nos catégories encore dominantes au sein de larges segments de l'université refusent souvent de reconnaître comme littéraires – alors qu’il me semble au contraire important d’y repérer une mutation de « la littérature » hors d’elle-même {{Sur ce point, voir Rosenthal & Ruffel (2010). }}. En amont, je remonterai brièvement à un usage du mot « littérature » qui était prévalente jusque vers 1750 – et qui peut, par-dessus les siècles, nous indiquer une direction d'avenir pour repenser la fonction des études de lettres.
Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images
Pourquoi et comment enseigner la littérature aujourd'hui 1? J’aborderai cette question à travers un grand écart instaurant une double distance envers la définition canonique de «la littérature», telle que cette définition s'est imposée dans nos cultures occidentales aux XIXe et XXe siècles. En aval de cette période, je réfléchirai à la façon dont les évolutions médiologiques des trois dernières décennies ont induit des pratiques interprétatives que nos catégories encore dominantes au sein de larges segments de l'université refusent souvent de reconnaître comme littéraires – alors qu’il me semble au contraire important d’y repérer une mutation de «la littérature» hors d’elle-même 2. En amont, je remonterai brièvement à un usage du mot «littérature» qui était prévalente jusque vers 1750 – et qui peut, par-dessus les siècles, nous indiquer une direction d'avenir pour repenser la fonction des études de lettres.
Ce grand écart quelque peu acrobatique trouve appui sur un certain nombre de théories des media malheureusement peu connues et peu diffusées dans le domaine francophone en général, et parmi ceux qui réfléchissent à la littérature et à sa didactique en particulier. La pertinence de ces théories ne prenant son sens qu'à la lumière des problèmes écopolitiques auxquels nous devons faire face à l'âge de l'anthropocène, je commencerai par quelques remarques très générales, avant de présenter très sommairement quelques idées-clés reprises de ces théories des media, qui me semblent indispensables pour articuler le problème central posé à l'enseignement de la littérature aujourd'hui, qui est précisément un problème de cadrage, c'est-à-dire d'adaptation à un certain contexte socio-historique, et plus particulièrement médiologique.
L'orientation générale de ce propos – qui relèvera donc plutôt de «prolégomènes» que d’un traitement direct et pragmatique des questions posées – visera à esquiver le double écueil de la lamentation catastrophiste et de la technophilie naïve qui se font fréquemment face dans les débats concernant ces problèmes. Les élégies sur la mort de la littérature et des lettrés, sur l'indifférence prétendue de «la jeunesse» envers «les classiques», sur la distraction abrutissante induite par les (in)cultures numériques – tout cela me paraît à la fois aussi (partiellement) fondé et aussi (largement) leurrant que les espoirs de voir chaque enfant muni d'une tablette profiter spontanément d'une intelligence collective sur laquelle il suffirait de se brancher à travers l’appareillage approprié (si possible user-friendly). Je suis convaincu que les expériences littéraires restent plus précieuses, plus nécessaires, et plus jouissives que jamais à l'ère des media numériques – pour peu qu'on apprenne à les chercher là où elles peuvent se trouver aujourd'hui, et pour autant qu'on se donne les moyens de les cultiver et de les valoriser comme telles.
Mon propos commencera donc par dresser un tableau très large de quelques grands bouleversements médiologiques repérables au cours du dernier siècle, avant de proposer quelques gestes par lesquels les études littéraires peuvent se repositionner dans les nouveaux contextes induits par ces bouleversements.
Figures d'écriture et retours de fond à l'âge de l'anthropocène
L'intuition de base développée, entre autres, par des penseurs comme Vilém Flusser (1920-1991) ou Friedrich Kittler (1943-2011) – approfondissant les formules lancées par Marshall McLuhan (1911-1980) dès les années 1960 et faisant échos parfois à une «médiologie» française qui s'est malheureusement développée dans un certain isolationnisme national – est qu'une nouvelle culture a commencé à se déployer à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'impulsion de l'invention et de la diffusion des moyens techniques d'enregistrement automatique de l'image (photographie) et du son (phonographe). Le nouvel «univers des techno-images» 3, qui a mis plus d'un siècle à s'imposer progressivement, qui devient clairement hégémonique depuis quelques décennies, mais dont nous commençons à peine à entrevoir les conséquences, se comprend par contraste avec la phase précédente, qui se caractérisait par une domination de l'écriture, qui a elle aussi mis plusieurs siècles à s'infiltrer dans nos pratiques, et qui continue bien entendu à les structurer en profondeur.
Dans la description qu'en donne Flusser, le régime historique de l'écriture se caractérise par la réduction de la complexité de nos perceptions du réel à un défilement linéaire de symboles alphabétiques, conçus pour manifester des rapports de causalités également formalisés comme linéaires. L'énorme puissance de l'écriture, remarquablement analysée par Michel de Certeau dans «L’économie scripturaire» (1990: 195-224), tient à ce qu'elle nous donne une emprise pratique considérable sur le façonnement de notre réalité, en faisant passer celle-ci par le fil de causalités linéaires sur lesquelles nous pouvons agir après les avoir isolées et identifiées comme telles.
Cette opération fondamentale assurée par l'écriture ne date bien entendu pas de la modernité. Toutes les cultures écrites ont formalisé des chaînes de causalité de façon à pouvoir intervenir sur elles. À travers son idéal et son idéologie de «la science», la modernité a seulement poussé à ses extrêmes conséquences cette virtualité possible du régime de l'écriture: n'existe «réellement» pour nous aujourd'hui que ce qui peut être transcrit à travers des séquences linéaires d'enchaînements causaux. Cet énorme travail d'élucidation des relations de causalité mené depuis des siècles s'appuie sur au moins deux types de réduction qui apparaissent aujourd'hui dans toute leur clarté.
D'une part, le règne de l'écriture linéaire présuppose l'isolation de certaines chaînes causales au sein du tissu complexe de multi-causalités qui trame nos existences quotidiennes: c'est le travail qu'on mène dans des laboratoires, dont la fonction est justement d'isoler certains fils, séparés de façon parfaitement artificielle du tissu de corrélations causales au sein desquelles ils opèrent à l'extérieur des murs aseptisés du laboratoire. D'autre part, de façon intimement liée au point précédent, ce règne s'appuie sur tout un travail souterrain d'analyse segmentant les objets composés en objets composants, selon des opérations de discrétisation (ou de «grammatisation») qui se sont imposés aussi bien à la physique (les particules) et à la chimie (le tableau des éléments) qu’à la biologie (l'ADN) et à la linguistique (les unités de base), aboutissant à des «éléments» discrets, censés être «premiers», dont les multiples recombinaisons permettront de récréer le monde «par synthèse».
D'un point de vue phénoménologique, tout ce processus consiste à isoler des figures au sein d'un fond (en fonction de la pertinence des traits envisagés selon les observations de causalités), pour analyser ces figures en éléments minimaux (générant par grammatisation l'alphabet du domaine envisagé), de façon à pouvoir produire de nouvelles figures (selon des procédures de recombinaisons synthétiques), plus désirables que celles offertes spontanément par la nature. Comme l'avait bien relevé Gilbert Simondon dès 1958 avec sa description Du mode d'existence des objets techniques, cette attitude focalisée sur l'identification, l'analyse et la recombinaison de figures tend à laisser dans l'ombre le statut et le rôle des fonds, dont la prise en charge incombait aux religions qu’une certaine modernité a reléguées au domaine des superstitions – comme si la perception (généralement «intuitive») de ces phénomènes de fond, n'avait pas son importance dans la façon dont les subjectivités humaines s'orientent dans l'existence 4.
Au moment où de plus en plus larges segments de nos populations humaines commencent à prendre une conscience de plus en plus vive de «l'événement anthropocène» 5 – c’est-à-dire du changement de perspective induit par notre prise en compte des dommages irréparables infligés à notre environnement planétaire (biologique, géologique, climatique) par la furie productiviste caractéristique de la modernité industrielle – une fierté légitime envers les gains de maîtrise acquis grâce à ces procédures d'écriture ne peut plus s'aveugler aux conséquences fâcheuses, voire catastrophiques, entraînées par la domination exclusive de ce mode opératoire. Face à des problèmes locaux comme l'amiante, face à des hydres incontrôlables comme le nucléaire ou les pesticides, ou face à des emballements globaux comme le dérèglement climatique, force est de constater la pauvreté des lignes de causalités analysées et recomposées dans nos laboratoires par notre façon linéaire d'écrire le monde en régime de modernité impérialiste et extractiviste. Notre ignorance du fond environnemental sur lequel s'inscrivaient les figures que nous y avons isolées (par analyse causale, grammatisation et recombinaisons de synthèse) se paie au prix d'un retour potentiellement très douloureux (pour nous humains) de ce fond imprudemment refoulé 6. Le règne moderne des figures – dont la science économique orthodoxe assure aujourd'hui l'emprise en imposant la loi des seules figures chiffrées, désormais traitées à la vitesse de la lumières par les algorithmes du high-speed trading – s'avère de moins en moins soutenable face à la multiplication des retours de feu que sont les retours de fond sous leurs multiples formes, depuis la fonte des glaciers, le dégel du permafrost, la pollution atmosphérique des villes chinoises, jusqu'au regain de vigueur des courants les plus intégristes de certaines pratiques religieuses.
Pratiques artistiques et critique de l'immédacie
Chacun à sa façon, Marshall McLuhan, Vilém Flusser et Friedrich Kittler nous invitent à sortir de l'aveuglement qui caractérise notre rapport habituel aux media, entendus ici dans leur sens le plus large, celui des médiations qui assurent les communications entre les différents composants de notre monde humain. En affirmant que «le message, c'est le medium lui-même» ou que les media constituent un environnement que nous ne voyons pas davantage que l'air que nous respirons, le premier ouvrait une brèche où se sont engagés les seconds, lorsqu'ils soulignent à quel point nos subjectivités se trouvent aujourd'hui intimement programmées par les appareils dont nous croyons nous servir, alors même qu'ils sont en passe de nous asservir. Leurs enseignements les plus fondamentaux peuvent se formuler en quatre propositions qu'ils formulent tous trois avec leurs nuances propres.
1. En même temps qu'il semble parachever le règne de l'écriture linéaire, l'avènement du numérique risque (ou permet) d'en miner les bases, en nous immergeant dans l'univers analogique des techno-images. La numérisation en cours de notre monde matériel et mental constitue bien entendu le triomphe des opérations d'écriture linéaire qui ont assuré la puissance de la modernité. Tout se voit analysé (grammatisé) en ces unités de base que sont le 0 et le 1, à partir desquelles différents algorithmes s'efforcent à la fois de formaliser les chaînes causales observées dans la réalité et de créer de nouvelles figures de synthèse par le jeu des recombinaisons.
Tout cela repose bien entendu sur des procédures d'écriture de programmes logiciels qui restent de nature linéaire (sur le mode si... alors...). Cette réalité du fonctionnement profond des appareils numériques ne doit toutefois pas cacher leurs effets de surface, qui est de permettre aux humains de communiquer directement entre eux par l'enregistrement et la transmission de blocs de perceptions sensorielles captés par des appareils court-circuitant l'intervention d'une subjectivité. La nouveauté de ces «techno-images» (photographies, enregistrements sonores, cinéma, vidéo) est en effet que, contrairement à ce qui se passait depuis l'époque de la Grotte Chauvet jusqu'au début du XIXe siècle, des appareils peuvent saisir, enregistrer et communiquer automatiquement des blocs de perceptions qui n’ont pas été préalablement filtrés par une subjectivité humaine (celle de l’écrivain, de l’enseignant, du peintre, du musicien, etc.). Même si, bien entendu, un humain doit poser un appareil photo devant une certaine portion de réalité, choisir un certain cadrage, une certaine focale, un certain temps d'exposition, etc., lorsqu'il appuie sur le déclencheur, l'appareil capte tout ce qui est dans son champ en court-circuitant tout filtre subjectif humain. Il en va de même pour l'enregistreur de sons, pour la caméra du cinéma ou de vidéo (ainsi d’ailleurs que pour les transactions du high-speed trading, qui opèrent sur des chiffres plutôt que sur du sensible). Une des particularités de nos nouveaux gadgets numériques est justement d'automatiser intégralement ces processus de captations de perceptions sensibles, en laissant les appareils faire tous les réglages à la place des humains.
Une première conséquence de notre immersion dans un univers de techno-images est que nous pouvons désormais communiquer directement par des transmissions d'images-sons captées automatiquement par des appareils – comme lorsque nous voyons en direct sur CNN des bombes occidentales frapper une ville comme Bagdad, ou lorsque des Africain-Américains peuvent diffuser sur Internet des scènes de brutalités policières, dynamisant le mouvement Black Lives Matter. La grammatisation intégrale de nos perceptions en séquences algorithmées de 0 et de 1 court-circuite (apparemment) l'intervention d'un travail subjectif d'écriture, permettant de nous affecter «immédiatement» par des captations automatiques de blocs de réalité perçus par nous sur le mode analogique (imaginaire) du continu, plutôt que sur le mode linaire (symbolique) du numérique ou «digital». Cette numérisation s’inscrivant par ailleurs dans un régime mass-médiatique (qu’elle altère profondément quoique marginalement), elle renforce une situation déjà dénoncée par Adorno, Debord ou Baudrillard dès la seconde moitié du XXe siècle, où, au sein de nos régimes marchands et électoraux structurés par les mass-médias, n'existe «effectivement» que ce qui peut être transmis à travers des images et des récits frappants.
2. En tant qu'elles relèvent de modes de perception analogiques, les techno-images sont porteuses d’un inévitable «bruit», qui communique un «fond» en excès sur le signal-figure visé par l'acte de communication. Friedrich Kittler aimait à rappeler que c'est le gramophone qui a rendu possible l'apparition du «bruit» comme objet de perception humaine. La particularité de la captation automatique pratiquée à travers les appareils est justement de ne pas sélectionner «subjectivement» ce qui est saisi (enregistré/transmis). Anything goes : tout passe. C'est ce qui fait la difficulté d'un tournage de film (argentique) en extérieur: un bruit d'avion, un lapsus de l'acteur, un fil électrique en arrière-plan, quoique non voulus par le réalisateur, se trouvent fixés sur la pellicule une fois pour toutes – sans que la distinction fondamentale entre ce qui est visé (le «signal» intentionnel) et ce qui le parasite (le «bruit») ne soit pertinente du point de vue de l'appareil.
Dans le domaine de la musique – en particulier de la musique «noise», depuis John Cage jusqu'aux drones («bourdonnements») de guitares en distorsion – comme dans celui des théories esthétiques 7, cette capacité des appareils à saisir et à transmettre du bruit est de la première importance: elle réinjecte du «fond» en excès sur les figures isolées par les intentions humaines. En même temps qu'il assure un triomphe de la grammatisation, le déploiement des techno-images numériques permet donc un retour du fond analogique qui hante (et enrichit) nos perceptions des figures au sein de l'univers matériel 8.
3. En proportion de l’amélioration de la définition des techno-images qui circulent entre nous, s'accroissent l'impression de transparence et l'illusion d'immédiacie qui dominent notre rapport aux appareils de médiation. Vilém Flusser est l'un des premiers à avoir pris la mesure des enjeux de la présence cachée des programmes sous la surface des illusions d'immédiacie donnée par les techno-images. Lorsque je crois voir des bombes qui s'abattent sur une ville ou un policier brutalisant un concitoyen africain-américain, j'ignore le très grand nombre de médiations qui ont rendu possibles la captation et la diffusion de ces techno-images. Flusser montre que lorsque nous prenons une photo, ce sont les ingénieurs qui ont développé l'appareil, les marketeurs qui en ont diffusé l'usage, les circuits de circulation des clichés commandant nos attentes et nos goûts esthétiques qui prennent la photo – bien davantage que notre singularité individuelle 9. Plus l'appareil dont on se sert est apparemment simple à utiliser, plus nombreux sont les programmes (et les réseaux) qui en conditionnent l'usage en sous-main, et plus ce sont ces programmes, censés nous servir, qui se servent de l'utilisateur pour se répandre dans nos usages sociaux.
Flusser et Kittler (et avec eux la grande majorité des théoriciens et archéologues des media) nous appellent donc à un recul critique face à l'impression de transparence (ou d’«immédiacie»10) véhiculée par certains media. Contrairement aux discours vulgaires sur «la civilisation de l'image», ils soulignent que le danger n'est pas à situer dans les techno-images elles-mêmes, mais dans l'illusion d'immédiacie qu'elles peuvent contribuer à répandre, ainsi que dans les différents types de «modes protégés» qui rendent opaques les programmations opérées par les médias 11. Leur travail consiste non pas à dénoncer le règne des images, mais à faire mieux comprendre et mieux sentir les procédés d'écriture sous-jacents à nos modes de perception et de communication.
4. Ré-envisagées dans cette perspective, les pratiques artistiques et les pratiques herméneutiques convergent en faisant porter notre attention sur les médiations elles-mêmes, aidant ainsi à briser l'emprise de l'illusion d'immédiacie. Que l'on identifie toutes les pratiques artistiques à une attention portée sur le «style» du signal (sa «forme» propre) plutôt que sur son «contenu», ou que l'on réserve à l'art moderne – qui s’est déployé en même temps que les techno-images – la particularité d'induire une attitude réflexive envers les «moyens» (media) de la communication, en nous donnant ainsi un certain recul face à ses fins (le message, le sens), dans les deux cas, l'expérience artistique apparaît comme un dispositif attentionnel prenant pour objet privilégié le travail parallèle des médiations et des interprétations qui contribuent à produire une certaine expérience esthétique.
Dans les années 1960, pendant que Roland Barthes questionnait l’apparente «transparence» de Racine pour y voir un jeu réflexif de miroirs où chaque époque, chaque interprète projette ses problématisations propres – c’est-à-dire comme un fond de relations dans lequel chaque génération peut construire des figures relativement nouvelles – Marshall McLuhan théorisait la façon dont les media, conçus comme des prolongements sensoriels et nerveux de l’humain, généraient de nouveaux «environnements» où nous ne repérons certaines figures (des informations, des messages) qu’en restant aveugles à cet environnement médiatique lui-même. Il présentait les pratiques artistiques comme proposant des «anti-environnements» qui nous rendent capables de percevoir des fonds environnementaux habituellement inaperçus comme tels:
[S]euls le petit enfant et l’artiste ont cette immédiateté d’approche qui permet la perception de l’environnemental. L’artiste nous fournit des anti-environnements qui nous rendent capables de voir l’environnement. Ces moyens anti-environnementaux doivent être constamment renouvelés pour être efficaces. (McLuhan 2011: 24)
Quelques années plus tard, Vilém Flusser concevait une «philosophie de la photographie» qui attribuait à l’artiste la capacité rare de déjouer le jeu automatique des appareils, en injectant des «images contemplatives» au sein du déferlement des techno-images qui constituent notre environnement quotidien:
la partie de beaucoup la plus grande des photographies (qui sont innombrables) témoigne de l’intention préprogrammée dans l’appareil qui les fait. […] De telles photos auraient aussi bien pu, au fond, être faites sans l’intervention d’un photographe, au moyen d’un déclencheur automatique, car leurs véritables producteurs sont le technicien qui a conçu l’appareil et l’industrie qui a engagé ce technicien. Cela apparaît clairement sur les photos dites d’amateur. […] Il y a cependant un très petit nombre de photos dont l’intention est visiblement inverse: on y tente d’être encore plus rusé que le programme de l’appareil, et de contraindre celui-ci à faire quelque chose pour quoi il n’est pas construit. L’intention de ceux qui les prennent est de produire des images qui se mettent en travers du déferlement [des clichés], qui forcent l’appareil à fonctionner contre le progrès de l’appareillage qu’il représente. […] Ces acrobates qui en produisent au sein même du déferlement des images et se maintiennent avec constance en dehors, ils méritent le nom d’«artistes» au vrai sens du mot: leur tour de main habile, rusé, contourne l’effroyable flot des images crachées par les appareils. (Flusser 2006: 64-65).
Des études littéraires aux études de media comparés
Les lecteurs familiers avec la façon dont les études littéraires ont théorisé leurs enjeux, leurs fonctions et leurs méthodes au cours du dernier demi-siècle auront certainement reconnu au passage toute une série de thèmes largement banalisés depuis des décennies. La littérature – conçue comme un cas particulier des pratiques artistiques en contexte de modernité – y apparaît comme un masque qui se pointe du doigt (le larvatus prodeo si souvent évoqué par Roland Barthes), comme une certaine «forme d’attention» (Frank Kermode) produisant des effets de «défamiliarisation» (Victor Chlovski) qui accroissent, raffinent, intensifient notre sensibilité à notre environnement (Nelson Goodman, Arthur Danto), parfois dans la perspective politique de reconfigurer notre «partage du sensible» (Jacques Rancière). L’appel flussérien à mettre en lumière réflexive les «programmes» qui «écrivent par avance» ce que nous croyons inventer subjectivement ne donne-t-il pas une définition parfaite de l’entreprise structuraliste qui a dominé la recherche et l’enseignement de la littérature pendant quelques décennies? Qu’est-ce donc que l’exercice de l’explication de texte, tel que le pratiquent quotidiennement les enseignants de littérature, sinon activer cette «immédiateté d’approche» que McLuhan conférait au «petit enfant et à l’artiste», pour nous rendre attentifs et sensibles au medium même du texte, que les interprétations non-littéraires tendent à occulter en discutant ses significations (contenus, idées, informations) plutôt que ses effets de forme? Loin d’être hors sujet, les paragraphes précédents n’ont fait que généraliser en termes de media ce que la théorie littéraire avait établi de longue date en termes de régime interprétatif.
Tel pourrait justement être l’enjeu historique de l’enseignement de la littérature en notre début de troisième millénaire. Des méthodes de sensibilisation, d’analyse et de réflexion se sont mises en place depuis plusieurs décennies dans le domaine restreint des études littéraires, qui méritent aujourd’hui d’être reprises, développées, adaptées pour s’étendre à l’ensemble de nos rapports aux media, au-delà des seuls «textes» sur lesquels s’est focalisée l’attention littéraire, pour se porter désormais sur le vaste domaine des techno-images. N’est-ce pas là un mouvement déjà en place, lui aussi, depuis plusieurs décennies, dont témoigne la croissance des inscriptions d’étudiants en programmes d’études cinématographiques ou d’arts du spectacle, alors même que les filières (étroitement) littéraires ont de plus en plus de difficultés à attirer les foules?
Cette nécessaire extension du domaine de la littérature est toutefois appelée à s’opérer dans un contexte difficile, dont les lamentations sur la mort de la littérature et des lettrés sont le symptôme superficiel. On sait que ce que nous appelons «la littérature», avec sa constellation unique de dimensions nationale, culturelle, existentielle, sociale et politique, est apparu vers le début du XIXe siècle, autour de Germaine de Staël, puis des Romantiques, pour dominer nos paysages intellectuels pendant un peu plus d’un siècle – avec ses conséquences multiples sur le paysage scolaire, universitaire, médiatique. En un paradoxe temporel fréquent dans l’histoire des régimes médiologiques, un certain culte d’une certaine forme d’utilisation de l’imprimé est devenu dominant alors même que l’univers des techno-images commençait à se mettre en place et à monter en puissance, au point de faire clamer aujourd’hui l’obsolescence de l’imprimé et la mort de la littérature. La perte de prestige et le délitement du statut hégémonique de «la littérature» dans le paysage culturel se prépare – et se proclame! – en réalité depuis plus d’un siècle. Au lieu de nous consumer en regrets du bon vieux temps, nous gagnerions à identifier plus précisément et plus pragmatiquement la façon dont ce que les études littéraires nous ont appris à faire depuis des siècles peut se traduire en termes de pratiques créatives, interprétatives et didactiques pertinentes
– voire indispensables – au sein du paysage médiatique actuel. En s’inspirant de plusieurs enseignants-chercheurs ancrés dans la double tradition (souvent jumelle) des études littéraires et des études de media, on gagnerait à envisager l’avenir de l’enseignement de la littérature dans le cadre d’»études de media comparés» permettant de redéployer au sein de l’univers des techno-images le savoir particulier (et infiniment précieux) développé sur les textes littéraires12.
Un tel redéploiement tient en partie du business as usual. Les enseignants de lettres n’ont nullement à se reconvertir en experts ès jeux vidéo pour survivre: contrairement à ce qu’on entend souvent dire, les humains n’ont jamais autant lu de textes écrits qu’à l’heure actuelle, et apprendre à interpréter ce qu’on lit sous forme de discours écrit restera une pratique centrale de toute éducation. Rien de plus stimulant que d’interpréter ensemble une page d’Ovide, Christine de Pisan, Montaigne, Isabelle de Charrière, Proust ou Nathalie Quintane 13. On peut toutefois penser à au moins trois domaines – parmi bien d’autres – dans lesquels les nouvelles pratiques médiales rendues possibles (et, dès lors, souvent imposées) par internet peuvent nous conduire à réaménager quelque peu le champ et les pratiques de l’enseignement littéraire. J’évoquerais très brièvement ces trois domaines, en me contentant à chaque fois de repérer des pratiques inédites et de signaler des manières possibles d’en tenir compte dans nos conceptions de l’enseignement littéraire.
L’interprétation littéraire à l'âge du faire
L’emprise d’une certaine vulgate des sciences de l’information et de la communication, adossée à la critique (justifiée) des industries culturelles par les philosophes de l’École de Francfort, a fait apparaître le lecteur dans une position passive: un message est préparé, composé, «encodé», peaufiné, envoyé, diffusé par un émetteur, pour être simplement «décodé» par un «récepteur», comme si, dès lors qu’on disposait du bon code, le déchiffrage était une opération mécanique allant de soi. La traduction pédagogique en est que le travail de l’enseignant consiste à apprendre le bon code aux étudiants, à leur transmettre les informations servant de clés à la bonne compréhension du texte. Les cinquante dernières années de théorie de la littérature se sont ingéniées à montrer au contraire à quel point l’activité du lecteur était à proprement parler «déterminante» dans la construction (toujours quelque peu nouvelle) de la signification d’un texte. Un des apports principaux des études littéraires aux études de media tient justement à la puissance et au raffinement des outils dont elles disposent pour établir une distinction essentielle – plus importante que jamais à l’ère numérique – entre «information» (mesurable en bits au sein de dispositifs machiniques) et «signification» (toujours suspendue à des pertinences, et donc à des pratiques humaines, incarnées dans des corps matériels sensibles au plaisir et à la douleur). Reconnaître l’importance et les enjeux de cette activité propre au pôle de la réception est au cœur de «l’économie de l’attention» ainsi que de toute une série d’entreprises intellectuelles inspirées aussi bien par des penseur devenus classiques comme Peirce, Gadamer, Barthes, de Certeau ou Fish, que par des théoriciens plus récents aussi divers que Maurizio Lazzarato, Tiziana Terranova, Tim Ingold, Michael Goldhaber, Chris Anderson ou Michel Lallement – lequel résume bien l’engouement actuel pour les do-it-yourself, fablabs, hackers’ spaces et autres formes d’»économie de la contribution» dans le titre de son dernier ouvrage, L’Âge du faire (Lallement 2015).
Enseigner la littérature à l’âge du faire implique de prendre la mesure des multiples façons dont la lecture est créative. Si la dimension herméneutique de cette créativité a déjà été finement balisée depuis longtemps, d’autres formes plus récentes méritent d’être prises en compte et utilisées dans nos activités d’enseignement, plutôt que refoulées hors de nos salles de classe. Pour beaucoup d’enseignants, le monde des fans-fictions n’a rien à voir avec celui l’enseignement littéraire, sinon comme objet d’étude pour sociologues en quête de «cultures populaires». En restreignant l’enseignement au seul domaine d’un savoir objectivable, et en excluant les dimensions affectives et hédoniques de ce qui se partage dans un enseignement de littérature, une certaine idéologie scientiste a dangereusement mutilé ce qui fait la puissance propre de nos expériences esthétiques, comme le montre bien l’ouvrage récent de Jean-Marie Schaeffer (2015)14. Prendre le relais de l’auteur en poursuivant le développement d’une fiction au-delà de son point final, que ce soit sous la forme savante d’une théorie des textes possibles, d’adaptations transmédiales ou de fan-fictions, constitue bel et bien un travail littéraire sur un matériau littéraire (pour autant qu’on n’étrangle pas la définition de «la littérature» au point de lui ôter toute respiration vitale)15.
La question – à la fois évidente mais souvent perçue comme scandaleuse – est bien celle que pose Rita Felski (2011) dans un ouvrage récent: que faire de la littérature? Qu’en faisons-nous en classe, pour que nos étudiants en fassent quoi, lorsqu’ils sortent de nos cours et séminaires? Qu’en font-ils déjà, pour quoi en ont-ils besoin, et comment pouvons-nous les aider à mieux faire ce qu’ils en font? Au-delà d’un retour bien intentionné mais quelque peu superficiel vers une conception de la lecture comme source de morale pratique délivrée des envoûtements du démon de la théorie (Compagnon 2007; Nussbaum 2015), cette attitude pragmatiste mérite surtout de se traduire en nouvelles modalités d’enseignement. La salle de classe littéraire gagnerait à devenir un hackers’ lab où chacun(e), riche de ses ressources propres, aide les autres à bricoler des interprétations qui nous aident à vivre ensemble sur notre petit bout de Terre en train de surchauffer. Si l’enseignant(e) a bien accumulé une expertise à transmettre, celle-ci relève davantage de sensibilisations, de raffinements attentionnels, de gestes de recherche, d’ajustement, de collaboration et d’autocorrection que de contenus informationnels à transmettre prédigérés.
Dans la mesure où il s’agit de gestes (à incorporer par imitation) plutôt que de connaissances (à comprendre abstraitement), leur enseignement passe moins par l’explication d’une « méthode » que par l’exercice répété d’une pratique. L’enjeu crucial de l’enseignement est aujourd’hui d’inculquer les gestes qui sauvent ce qu’il y a de précieux dans la vie, au sein d’un univers numérique qui sauve (et fraie) indifféremment les traces du meilleur comme du pire. Les études littéraires ont développé toute une tradition de gestes interprétatifs dont nous ne sommes que les passeurs et dont l’importance est plus cruciale que jamais, au sein de ce qu’un philosophe comme Andy Clark nous a appris à considérer comme la « cognition étendue » (extended cognition) qui enchevêtre de plus en plus étroitement le fonctionnement de notre système nerveux physiologique avec celui du système médiologique électronique. Apprendre à être « lettré », qu’est-ce d’autre qu’apprendre où et comment mobiliser les puissances des lettres qui peuplent les livres (c’est-à-dire des media et des médiations), au sein d’une circulation plus large, transindividuelle, des signes et des significations ? Les humanités ont un rôle central à jouer en tant que moment réflexif au sein de cette circulation systémique, hybridant de façon inextricable nos cerveaux biologiques (wetware), nos systèmes symboliques (software) et nos infrastructures matérielles de computation (hardware) – comme l’illustre bien cette citation de Michael Wheeler :
Quand des apprenants s’attendent à ce que l’information soit accessible de façon aisée et fiable de la part d’un support externe (tel qu’internet), ils sont davantage susceptibles de se rappeler où trouver l’information que les détails de l’information elle-même. Un tel profil cognitif paraît entièrement adéquat pour un monde dans lequel la capacité à trouver en temps réel les bonnes informations en réseau (non seulement des faits, mais de quoi résoudre les problèmes) peut être considérée comme plus importante que la capacité de retenir ces informations dans sa mémoire organique. Dans un tel monde, qui est bien notre monde, le cerveau apparaît comme un lieu de plasticité adaptative, un système contrôlant les compétences et capacités incarnées qui rendent possible la mobilisation temporaire de certaines technologies au sein des scénarios visant à résoudre certains problèmes. Du point de vue de la cognition étendue, la conceptualisation la plus éclairante du cerveau y voit un élément – un élément certes crucial et persistant – dans des séquences de systèmes cognitifs étendus qui se construisent de façon dynamique et s’assemblent de façon temporaire. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer, ce devrait donc être sur l’éducation de ces assemblages hybrides – tâche qui est pleinement consistante avec le but de conférer au cerveau les compétences dont il a besoin pour être un contributeur effectif à de tels assemblages (Wheeler 2015: 97) 16.
L’écart littéraire dans l'univers des techno-images
En réinsérant le sujet (apprenant, lecteur, interprète) dans un «système cognitif étendu» fait d’»assemblages hybrides» où neurones et circuits intégrés se connectent de façon fluide et indistincte, la citation précédente a sans doute poussé aussi loin que possible le sentiment d’aliénation et d’inconfort qu’un littéraire normalement constitué peut ressentir au milieu d’un alignement de technolâtres entichés de cyborgs et d’efficacité. À la question Que faire de la littérature?, il ne saurait suffire de répondre: un super-entraînement pour super-athlète cérébral capable de dialoguer au mieux avec nos super-ordinateurs… Si l’enseignement littéraire apporte une spécificité à la circulation de l’information au sein de nos sociétés, c’est sans doute bien davantage en en détournant qu’en en accélérant les flux. Trop de cognition trop dangereusement étendue tourne à vide ou à rebours du bon sens (cf. ici aussi l’exemple emblématique du high-speed trading) pour qu’on veuille enrôler la pauvre littérature dans la démence suicidaire d’une efficacité dévoyée 17. Si la littérature peut nous aider à vivre (ensemble), c’est dans la mesure où elle nous invite à contrefaire autant qu’à faire, à déjouer le jeu productiviste autant qu’à le jouer, à subvertir les obstacles autant qu’à résoudre les problèmes. Sa façon d’instaurer des écarts au sein de circulations menaçant toujours de nous enfermer dans leurs boucles répétitives repose en bonne partie sur le même déplacement attentionnel qui nous fait regarder la lettre plutôt que de nous ruer sur le sens.
Derrière la question aujourd’hui passablement éculée des «rapports de la forme et du fond», qui posait les problèmes à travers une opposition entre forme et matière, entre expression et contenu, l’heure est peut-être venue de repenser les rapports entre figures et fonds. Un des enjeux centraux (et particulièrement complexe) des cultures numériques est en effet, comme on l’a évoqué plus haut, d’une part, de pousser la grammatisation à son comble en réduisant toute notre vie relationnelle (avec les humains et les non-humains) à des séquences discrètes de 0 et de 1, mais aussi, de façon apparemment contradictoire, de permettre, par cette numérisation même, à des captations audio-visuelles d’opérer parmi nous sur le mode de l’analogique (continu, nuancé) et non seulement du digital (discontinu, discret). Indépendamment des pratiques artistiques qui en font un enjeu explicite de leur travail 18, cette remontée du fond est liée à au moins deux types de phénomènes qui méritent d’être pris en compte dans la façon dont nous concevons l’enseignement littéraire.
D’une part, nos nouveaux modes numériques de figuration permettent aux fonds de circuler plus facilement entre nous: au lieu de décrire l’aspect physique d’une personne à l’aide de quelques phrases qui schématisent sa figure en quelques caractéristiques discontinues (son âge, sa taille, ses couleurs d’yeux, de cheveux), j’envoie une photographie qui inclut les nuances indescriptibles de son sourire et de sa complexion. Ce faisant, je laisse au récepteur le travail de faire émerger ce qui fait «figure» (signifiante) au sein de ce qui reste en «fond» (bruit insignifiant), et je lui transmets du même coup une riche réserve de traits potentiellement pertinents à explorer et utiliser différemment que je ne l’aurais fait moi-même. Je lui transmets une richesse de fond (le medium comme «milieu») en même temps qu’un instrument d’identification d’une figure (le medium comme «moyen»). L’écart consiste ici à regarder autre chose que la figure qui crève l’écran, à trouver dans le fond, dans le bruit, dans le non-sens, dans l’insignifiant, dans le surplus de matière sensorielle offert par le continuum analogique, de quoi faire émerger de nouvelles figures de sens, ce qui implique de regarder plus longtemps, plus intensément – tâche que le dernier Roland Barthes attribuait à la fois au cinéaste (en l’occurrence Antonioni), à l’artiste en général et au critique littéraire (qu’il dépeint dans le miroir que lui offre le réalisateur italien) 19.
Mais cette remontée du fond peut aussi, d’autre part, s’entendre dans un sens très différent, qui tient à ce que, grâce à la numérisation, tant de documents (très riches sensoriellement) peuvent circuler ou être accessibles (très facilement). Pour quiconque a accès à internet (ce que certaines prédictions estiment devoir être le cas de 80% de la population mondiale d’ici 2020), toute donnée s’entoure instantanément d’un nuage de données apparentées, pour peu que je l’insère dans un moteur de recherche. Un étudiant qui a pour tâche d’étudier un poème, un personnage ou un épisode d’un roman dispose en quelques fractions de seconde de toute une constellation de rapprochements qui re-contextualisent son objet d’étude dans un univers intrinsèquement multimédiatique, induisant des approches de plus en plus inter- ou trans-médiales. Des images, des sons, des vidéos, des adaptations, des reprises, des réécritures, des articles savants, des commentaires impressionnistes, des lubies idiosyncrasiques, des chansons, des réappropriations idéologiques plus ou moins violentes: tout ce halo associatif généré algorithmiquement par nos appareils attentionnels numériques constitue une nouvelle réserve de fond que l’étudiant peut solliciter de façon plus ou moins systématique et réfléchie, enrichissant (ou appauvrissant) sa propre perception de l’œuvre étudiée. L’écart consiste ici à se laisser détourner de sa quête première pour se laisser surprendre et stimuler par des effets de sérendipité, qui nous conduisent à trouver ce qu’on ne cherchait pas, à résoudre des problèmes qu’on ne se posait pas. En s’ouvrant à la fécondité de tels détournements de notre intention initiale, l’attitude littéraire fait dérailler des «systèmes cognitifs étendus» qui ont toujours trop tendance à tourner en rond. De telles errances, qu’on réduirait trop facilement à des erreurs ou à des aberrations, sont en réalité une condition de survie des systèmes vivants au sein d’environnements instables et évolutifs – selon la logique du «crapaud fou» qui part dans la direction opposée à celle de ses congénères, mais qui en perpétue l’espèce lorsque le trajet grégaire des premiers trouve une autoroute sur son chemin.
Le cheminement littéraire à l'âge de l'accès
Ces dernières remarques commencent à répondre à la question centrale: si l’enseignement de la littérature doit apprendre à intégrer les nouvelles pratiques médiales à ce qui se fait et se discute en classe, qu’a-t-il à leur apporter en retour? On pourrait en effet considérer que nos étudiants n’ont pas besoin de cours de littérature (ni de media comparés) pour rédiger des fan-fictions, écouter des chansons, regarder des vidéos ou surfer sur internet: ils le font déjà suffisamment sans notre aide! Pourtant, si l’idéal d’instruction correspond à quelque chose, c’est justement à aider les étudiants à construire une capacité intérieure à développer des habitudes de recherche plus adéquates à une meilleure orientation dans l’existence – ce qui implique de savoir se laisser désorienter ponctuellement au besoin. Ce sont donc ces pratiques spontanées, dirigées par leurs désirs et par leurs besoins extra-curriculaires, qu’il nous faut essayer de rendre plus efficaces, plus réflexives et plus émancipantes. Si l’enjeu est bien d’apprendre à «se faire un chemin» – de chercheur discipliné et de crapaud fou, puisque les deux doivent nécessairement aller de pair 20 – au sein des constellations associatives qui apparaissent comme le halo algorithmique des objets culturels numérisés, cette tâche implique au moins trois gestes que l’enseignement littéraire peut aider à former, puisqu’ils sont au cœur de nos activités interprétatives depuis des siècles.
Un geste de sélection critique, sur lequel les pédagogues du web insistent depuis pas mal de temps, réinjecte un peu du vieux principe d’autorité au sein de l’horizontalité (largement imaginaire) du numérique. Une des angoisses récurrentes des internetophobes est que tout arriverait sur l’écran de l’étudiant au même niveau et avec le même statut, dans une sorte d’accès direct («désintermédié») qui exposerait sa naïveté à tomber aussi bien sur le «savoir» autorisé d’un site «sérieux» (universitaire, gouvernemental), que sur les «délires» d’illuminés conspirationnistes ou sur les «dérives sectaires» d’intégristes poussant au «terrorisme». Même si l’ensemble des catégorisations qui sous-tendent ces angoisses mériterait d’être discuté, il faut remarquer d’emblée que si une certaine horizontalité anarchique a pu se déployer dans un moment précoce du développement d’internet, on a aujourd’hui basculé dans une phase où les dynamiques d’agrégation et de commercialisation conduisent au contraire à des rapports de forces très verticaux entre, d’une part, de grosses plateformes dominantes, qui agencent la visibilité algorithmique selon leurs intérêts propres, et, d’autre part, des myriades d’invisibilités diffuses qui existent certes, mais en marge des flux significatifs de circulation. Rêve ou cauchemar, l’anarchie appartient surtout à un trop éphémère passé 21.
La logique agrégative des algorithmes de recherche opère un premier tri sélectif utile (parce que basé en partie sur notre intelligence collective), mais néanmoins très envahissant, qui relaie parfois les sources les plus intéressantes loin derrière les acteurs les mieux dotés en finances et/ou en capital attentionnel. Si les études universitaires ont quelque chose à nous apprendre, c’est justement à se faire un chemin de chercheur au sein de (et parfois contre) les propositions de sources qui nous sont suggérées par le halo algorithmique. Ce geste de sélection critique passe par différentes phases que l’étudiant apprend à respecter lorsqu’il rédige un mémoire de recherche: citer ses sources, pour pouvoir les réexaminer avec un regard mieux informé; suspecter ses sources, pour tempérer l’intérêt de ce qu’on trouve par sérendipité; filtrer ses sources, c’est-à-dire savoir que toutes ne se valent pas. On est bien ici au cœur de l’activité d’inter-prétation : une activité collective où l’on s’emprunte et s’inter-prête des idées et des enchaînements de mots, mais où le cheminement vers l’idée compte autant que le point d’arrivée.
Le deuxième geste que la pratique des études littéraires aide à incorporer est celui du freinage réflexif. La culture d’internet, miroir des anticipations dont se nourrit le profit capitaliste, enjoint à la rapidité. Aller ou faire plus vite est un bien en soi, qui rapporte gros – avec ici aussi à l’horizon la démence du high-speed trading. L’une des choses les plus précieuses que nous apprenons dans nos séminaires littéraires est le ralentissement de lecture inhérent à l’exercice de l’explication de texte. Que l’on prenne pour objet un poème, un paragraphe extrait d’un texte narratif, un raisonnement philosophique, une scène de tragédie, mais aussi bien un texte de loi, un tableau, une photographie, un mouvement chorégraphique, une séquence filmique ou une situation tirée d’un jeu vidéo, dans tous les cas, l’important est de freiner pour discerner les éléments constitutifs de l’objet analysé, pour réfléchir à leurs fonctions et à leurs effets en leur substituant des équivalents possibles, bref pour décomposer une sensation originellement perçue comme immédiate afin d’en faire sentir les médiations multiples ainsi que leur entrejeu dynamique.
Ce ralentissement permet le déploiement d’un troisième geste, qui relève de la suspension flâneuse. Il s’agit en effet moins de «concentrer» son attention que de lui permettre de se redéployer différemment, en se donnant les moyens d’explorer des bifurcations inaperçues en régime de précipitation coutumière. Freiner ne vise pas tant à l’immobilité qu’à un autre type de mouvement que celui imposé par les contraintes extérieures de la vitesse: mouvement latéral de crapaud fou, de traverse, de promenade, d’exploration hasardeuse, de tâtonnements hésitants, de frayages erratiques, d’allers-retours sans progression évidente – mouvement de «cheminement» (wayfaring) dont l’anthropologue Tim Ingold a bien montré qu’il constituait l’alternative (pré- et post-moderne) au régime de «transport» qui nous pousse aujourd’hui à aller aussi vite que possible d’un point A vers un point B et qui nous fait considérer comme «perdu» le temps du déplacement lui-même, vécu à travers une éclipse d’insensibilité momentanée envers l’environnement traversé 22. Si ces trois gestes esquissent une «méthode», c’est moins au sens d’une série de règles inculquées à partir de formalisations abstraites (selon le modèle d’écriture linéaire de la programmation algorithmique) qu’au sens étymologique d’un art du cheminement (hodos) au sein d’un espace continu, perçu dans sa continuité analogique et dans les richesses de ses fonds, plutôt que dans les figures pré-paramétrées pour démarquer ses étapes opérationnelles.
Si les sections précédentes poussaient la littérature en aval de son moment hégémonique romantico-moderne en la plongeant dans l’univers des techno-images, nous remontons ici en amont de ce moment, en retrouvant l’usage du mot « littérature » qui prédominait encore au XVIIIe siècle, lorsqu’« avoir de la littérature » signifiait pouvoir se repérer dans un monde de discours autorisés et de références canoniques (généralement gréco-latines). Dans le bref article qu’il lui consacre dans l’Encyclopédie, le chevalier de Jaucourt en fait un « terme général, qui désigne l'érudition, la connaissance des Belles-Lettres et des matières qui y ont rapport », permettant à celui ou celle qui écrit ou parle de « se parer à propos de ses lectures, de sa critique et de son érudition ».
Que peut donc signifier « avoir de la littérature » à l’heure où quelques fractions de seconde font apparaître des dizaines de citations (latines ou autres) par la seule grâce des moteurs de recherche ? Derrière cette conception apparemment obsolète, la littérature et son enseignement mettent en lumière le besoin de porter son attention sur les cheminements qui nous conduisent à certaines conclusions, d’interroger les propriétés de media (moyens, appareils, documents, canaux, milieux) qu’on a utilisés pour arriver là où l’on est, de réfléchir au fonctionnement de ces media en termes de valeurs, et d’imaginer des alternatives possibles aux cheminements effectivement suivis. L’immédiacie numérique généralise le mode du « transport » dans notre rapport aux objets culturels : PageRank, l’algorithme de recherche de Google, fonctionne comme un avion supersonique qui nous envoie là où nous voulions aller avant même que nous ne le sachions nous-mêmes. Son utilité courante est indéniable et admirable. Mais, comme le souligne Tim Ingold, les appareils de transport nous font parfois payer le prix fort pour leur rapidité. En pouvant si facilement être transporté presque partout instantanément, on risque de ne plus « habiter » nulle part (dwelling), puisqu’on n’habite un territoire qu’en l’arpentant par des cheminements qui nous sensibilisent à son environnement. Les études littéraires ne sauraient aujourd’hui être conçues contre l’univers numérique des algorithmes et des techno-images, mais dans cet univers – comme un moyen-medium pour mieux l’habiter, de façon moins automatique et plus autonome, par des mouvements moins rapides mais mieux orientés.
Bibliographie
Abram, David (2013), Comment la Terre s’est tue, Paris, La Découverte.
Berardi, Franco (2016a), Tueries, Montréal, Éditions Lux.
Berardi, Franco (2016b), «Décomposition et recombinaison à l’âge de la précarité», Multitudes n° 62.
Bolter, Jay David & Richard Grusin (2000), Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MIT Press.
Bonamy, Robert (2013), Le fond cinématographique, Paris, L’Harmattan.
Bonneuil, Christophe & Jean-Baptiste Fressoz (2014), L’événement anthropocène, Paris, Seuil.
Bratton, Benjamin (2016), The Stack. On Software and Sovereignty, Cambridge MA, MIT Press.
De Certeau, Michel (1990 [1980]), L’invention du quotidien. 1 Arts de faire, Paris, Gallimard, «Folio».
Citton, Yves (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires?, Paris, Éditions Amsterdam, réédition augmentée en 2016.
Cardon, Dominique (2015), À quoi rêvent les algorithmes?, Paris, Seuil.
Clark, Andy (2011), Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford University Press.
Clark, Andy (2003), Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence, Oxford University Press
Compagnon, Antoine (2007), La littérature, pour quoi faire?, Paris, Fayard.
Escola, Marc (dir.) (2012), Théorie des textes possibles, Amsterdam, Rodopi (n° 57 de la revue CRIN).
Felski, Rita (2011), Uses of Literature, New York, Wiley-Blackwell.
Flusser, Vilém (2011 [1985]), Into the Universe of Technical Images, N. A. Roth (trad.), Minneapolis, University of Minnesota Press.
Flusser, Vilém (2006), La civilisation des médias, Belval, Circé.
Flusser, Vilém (1985), Ins Universum der technischen Bilder, Göttingen, European Photography.
Hayles, N. Katherine (2016), Lire et penser en milieu numériques, Grenoble, ELLUG.
Hayles, N. Katherine (2015), «Non-conscient cognitif et algorithme de trading automatisé», in Le sujet digital, Claire Larsonneur et al. (dir.), Dijon, Les presses du réel, p. 20-41.
Huyghe, Pierre-Damien (2012), Le cinéma avant après, Saint Vincent de Mercuze, De l’incidence éditeurs.
Ingold, Tim (2011), Une brève histoire des lignes, Paris, Zones Sensibles.
Jenkins, Henry (2013), La culture de la convergence: des médias au transmédia, Paris, Armand Colin.
Kittler, Friedrich (2015), Mode protégé, Dijon, Les presses du réel.
Lallement, Michel (2015), L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil.
Latour, Bruno (2015), Face à Gaia, Paris, La Découverte.
McLuhan, Marshall (2011 [1964]), «The Relation of Environment to Anti-Environment», in Media and Formal Cause, Marshall McLuhan and Eric McLuhan (dir.), Houston (Texas), NeoPoiesis Press.
Nussbaum, Martha (2015), L’art d’être juste. L’imagination littéraire et la vie publique, Paris, Climats.
Parikka, Jussi (2018), Qu’est-ce que l’archéologie des media?, Grenoble ELLUG.
Pasquale, Franck (2015), The Black Box Society: les algorithmes secrets qui contrôlent l’économie et l’information, Paris, FYP.
Quessada, Dominique (2013), L’inséparé. Essai sur un monde sans Autre, Paris, PUF.
Rosenthal, Olivia & Lionel Ruffel (dir.) (2010), «La littérature exposée», Littérature, n° 160.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (2005), Le sujet-lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, PUR.
Simondon, Gilbert (1958), Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier.
Schaeffer, Jean-Marie (2015), L’expérience esthétique, Paris, Gallimard.
Stengers, Isabelle (2013), Au temps des catastrophes, Paris, La Découverte.
Thrift, Nigel (2016), «Inconscient technologique et connaissances positionnelles», Multitudes, n° 62.
Wheeler, Michael (2015), «Thinking Beyond the Brain: Educating and Building from the Standpoint of Extended Cognition», in Alleys of Your Mind.Augmented Intellligence and Its Traumas, Matteo Pasquinelli (dir.), Lüneburg, Meson Press, p. 85-106.
Pour citer l'article
Yves Citton, "Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-dans-l-univers-des-techno-images
Apprendre la littérature, pour quoi faire ? Du débat des experts aux discours des élèves
La question des justifications de l’enseignement de la littérature n’a jamais autant mobilisé les didacticiens qu’en ce début de XXIe siècle. La thèse de Suzanne Richard Finalités de l’enseignement de la littérature et de la lecture de textes littéraires au secondaire (2004), le livre collectif Les valeurs dans/de la littérature (Canvat & Legros 2004), les actes du colloque Enseigner et apprendre la littérature, pour quoi faire ? (Dufays 2007), l’essai tout récent de Sylviane Ahr (2015) Enseigner la littérature aujourd’hui : « disputes » françaises, autant d’ouvrages qui ont fait de l’examen du sens de l’enseignement littéraire leur objet même.
Au-delà des didacticiens, les chercheurs en littérature sont eux aussi en pleine interrogation sur la place de leur activité dans la formation. De La littérature en péril de Todorov (2007) à Pourquoi étudier la littérature ? de Jouve (2010) en passant par Contre Saint Proust ou la fin de la Littérature de Maingueneau (2006), La littérature pour quoi faire ? de Compagnon (2007), Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? de Pierre Bayard (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ? d’Yves Citton ou encore Petite écologie des études littéraires de Jean-Marie Schaeffer (2011), le questionnement est devenu permanent.
Apprendre la littérature, pour quoi faire ? Du débat des experts aux discours des élèves
La question des justifications de l’enseignement de la littérature n’a jamais autant mobilisé les didacticiens qu’en ce début de XXIe siècle. La thèse de Suzanne Richard Finalités de l’enseignement de la littérature et de la lecture de textes littéraires au secondaire (2004), le livre collectif Les valeurs dans/de la littérature (Canvat & Legros 2004), les actes du colloque Enseigner et apprendre la littérature, pour quoi faire? (Dufays 2007), l’essai tout récent de Sylviane Ahr (2015) Enseigner la littérature aujourd’hui: «disputes» françaises, autant d’ouvrages qui ont fait de l’examen du sens de l’enseignement littéraire leur objet même.
Au-delà des didacticiens, les chercheurs en littérature sont eux aussi en pleine interrogation sur la place de leur activité dans la formation. De La littérature en péril de Todorov (2007) à Pourquoi étudier la littérature? de Jouve (2010) en passant par Contre Saint Proust ou la fin de la Littérature de Maingueneau (2006), La littérature pour quoi faire? de Compagnon (2007), Comment parler des livres que l’on n’a pas lus? de Pierre Bayard (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires? d’Yves Citton ou encore Petite écologie des études littéraires de Jean-Marie Schaeffer (2011), le questionnement est devenu permanent.
Certes, ces différents ouvrages ne portent pas tous sur le même objet, puisqu’il y est question tantôt de formation littéraire à l’université tantôt d’enseignement obligatoire, et leurs thèses sont parfois loin de converger, mais c’est précisément cette diversité qui retient l’attention et justifie qu’on s’y attarde.
Ce débat, pour autant, n’a rien de bien nouveau. Comme l’a rappelé André Chervel dans son Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle (2006), on enseigne la littérature française depuis plus de quatre cents ans et on n’a cessé depuis lors de justifier son enseignement sur la base d’arguments qui ont évolué à chaque génération. Pourquoi enseigner la littérature? Si les débats sont légion, c’est parce que les réponses émanent d’une diversité d’acteurs aux intérêts divergents. En l’occurrence, l’avis des chercheurs et des professeurs d’université spécialisés en littérature ne rejoint pas toujours celui des didacticiens du français; celui des décideurs du système éducatif – ministres, auteurs de programmes, inspecteurs, auteurs de manuels – diffère souvent de celui des enseignants de terrain; et celui des élèves est quant à lui rarement écouté 1.
Mais la diversité des positions tient aussi à la polysémie de la question elle-même. Qu’entend-on en effet par «justification de l’enseignement de la littérature»? Au moins trois types de choses, me semble-t-il, qui correspondent à trois types de débats parallèles, parfois entremêlés: certaines justifications concernent le corpus, d’autres, les manières de lire, et d’autres encore, les connaissances théoriques sur l’objet littérature.
Mon propos dans cet article sera d’essayer, très modestement, de démêler cet écheveau en examinant tour à tour trois discours de justifications: celui de l’institution scolaire, dont je retracerai l’évolution à grands traits depuis les origines, celui des experts, dans lequel je tenterai de dégager les termes et les positions du débat actuel, et celui des élèves du secondaire, dont j’ai recueilli les perceptions dans trois écoles aux profils contrastés. Mon espoir en confrontant ces trois regards est d’arriver à mieux mesurer à la fois leurs portées et leurs limites respectives.
Les discours de l’école
Un premier ensemble de discours sur les finalités de l’enseignement littéraire est celui qui émane de l’institution scolaire elle-même, à travers ses programmes et ses manuels. Par commodité, je m’en tiendrai ici au domaine de l’enseignement du français, et je distinguerai les finalités d’hier, qui ont été associées à cet enseignement du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, et les finalités d’aujourd’hui, qui ont été préconisées depuis les réformes scolaires des années 1970.
Les finalités d’hier: évolution du XVIIe au XXe siècle
À la suite d’André Chervel (2006), il importe d’abord de se rappeler qu’aux origines de l’enseignement du français, au XVIIe siècle, la littérature n’était retenue que pour sa valeur gnomique : les maitres y puisaient des maximes de sagesse supposées universelles, destinées à former des esprits droits. Au siècle suivant, sous l’influence des écrivains classiques, cette visée se double d’une préoccupation esthétique : La Fontaine, notamment, est enseigné autant comme maitre du style que comme un maitre à penser, mais, comme Boileau et quelques autres, il prévaut aussi pour les analogies que son œuvre présente avec celles des auteurs antiques, lesquels continueront longtemps à servir de modèles et de matière première de l’enseignement. Au XIXe siècle, la sensibilité romantique accentuera la priorité accordée aux valeurs esthétiques et stylistiques, si bien qu’à la fin du siècle, au moment où l’école primaire se généralise, les œuvres littéraires sont enseignées en tant que modèles pour la rédaction.
Simultanément, on voit se développer en France les valeurs patriotiques, et l’histoire littéraire reçoit la mission de faire connaitre la culture nationale, même si une méfiance durable persiste envers les œuvres du Moyen Âge, du XVIe siècle et même du XIXe siècle qui sortent du canon classique et postclassique. Il faudra attendre les années 1930 pour voir se développer un nouvel enjeu, en contraste radical avec l’idéal de sagesse propre à l’enseignement des classiques: celui de la formation à la sensibilité et aux émotions, qui va se traduire par la promotion d’œuvres jusque-là ignorées comme le Dom Juan de Molière, la Phèdre de Racine ou Les fleurs du mal de Baudelaire.
Jusqu’au milieu des années 1960, la littérature demeure néanmoins le socle de l’enseignement du français, et l’enjeu qui prédomine reste un enjeu patrimonial, à forte dimension morale, culturelle et humaniste: enseigner la littérature vise d’abord à faire connaitre les grands courants de l’histoire littéraire et la vie et l’œuvre des grands auteurs, et par là à transmettre des modèles de vie, de pensée et d’écriture. Il s’agit à la fois d’éduquer les élèves et de les relier entre eux et aux générations précédentes. Il faut rappeler qu’à cette époque, l’enseignement secondaire n’était pas obligatoire et n’accueillait donc qu’une population limitée, favorisée socioculturellement, celle que Bourdieu appellera les «héritiers».
Les finalités d’aujourd’hui: quatre tendances depuis 1970
Si l’on considère ensuite les cinquante dernières années, quatre tendances successives, qui sont largement communes aux différents pays francophones (cf. Dufays, Gemenne & Ledur 2015), peuvent être dégagées.
Le discours sur l’enseignement de la littérature connait un premier changement radical à la fin des années 1960 dans la foulée des grands bouleversements sociologiques (explosion de la démographie scolaire, apparition de la problématique des échecs) et culturels (mai 68, révolution des sciences humaines, succès du nouveau roman, du nouveau théâtre, de la nouvelle critique, mouvements yéyé et hippie), qui conduisent à une remise en question de toutes les valeurs antérieures. Rompant avec l’idée de culture patrimoniale, les années 1970 seront désormais dominées par la centration sur les textes et par l’ouverture au paralittéraire et au non-littéraire. La transmission des chefs-d’œuvre consacrés fait place au rejet de toute hiérarchie entre les textes. Pour autant, la finalité de l’enseignement littéraire demeure tout aussi normative, mais au lieu de reposer sur la connaissance d’un corpus, la norme tient désormais à la maitrise d’une méthode, celle de l’analyse structurale. Pour reprendre les mots de Bernard Veck (1995), les humanités font ainsi place aux méthodes. Corollairement, l’enjeu qui prévaut à ce moment est à la fois « scientifique » et esthétique : il faut apprendre à lire toutes sortes d’œuvres pour elles-mêmes, pour autant qu’on le fasse méthodiquement. On passe ainsi d’un point de vue ségrégationniste à un point de vue intégrationniste, et d’une finalité externe, centrée sur les usages de la littérature, à une finalité interne, centrée sur ses textes.
Les années 1980 connaitront des mouvements opposés. En France, elles voient s’accentuer le versant méthodique à travers la lecture du même nom, qui apparait comme un prolongement de l’enjeu précédent: il faut lire la littérature pour acquérir une méthode et devenir un lecteur autonome et critique. Cette approche est très inspirée par les travaux d’Eco (1985) sur la coopération interprétative du lecteur modèle. En Belgique, si le réseau officiel prône un retour au patrimoine, dans le réseau catholique, on assiste plutôt à une rupture, marquée par l’avènement des théories affirmant la souveraineté du lecteur et l’importance de la diversification des réceptions. Désormais l’enjeu n’est plus seulement d’émanciper l’élève ni de le doter de méthodes – même si ces valeurs continuent de prévaloir–, il est avant tout de l’amener à lire, de lui donner le gout et la pratique de la lecture. C’est ainsi que l’on voit se développer des propositions qui privilégient l’entrée en littérature par les activités spontanées et/ou ludiques.
Dans les années 1990, un nouveau contraste se fait jour. D’un côté, l’entrée dans l’ère des compétences. Tenu de déboucher sur des productions balisées et évaluables, l’enseignement de la littérature se voit subordonné à une logique utilitaire: désormais il faut lire pour devenir un lecteur compétent, capable de réinvestir ses acquis et ses outils dans des tâches complexes inédites. De l’autre côté, l’entrée dans la lecture littéraire: cette notion qui inspire fortement les programmes du primaire en France et ceux du secondaire en Belgique et au Québec cherche à concilier les deux approches de la lecture mises en évidence par les théories de la lecture, notamment par les travaux de Picard. On assiste ainsi au développement du modèle de la lecture littéraire conçue comme un va-et-vient: désormais, il faut lire pour développer conjointement la participation psychoaffective à l’univers référentiel du texte et l’analyse critique de ses significations.
Si elles sont potentiellement en tension (cf. Dufays 2011), l’approche par compétences et la lecture littéraire peuvent, à l’occasion, se combiner dans des dispositifs qui intègrent l’alternance des postures de lecture au sein de séquences didactiques débouchant sur des productions finales évaluables, ou qui étendent la notion de compétence aux compétences culturelles. La capacité de mettre en relation des textes du présent et du passé devient ainsi une compétence clé dans le référentiel des Compétences terminales de 1999 de la Communauté française de Belgique, qui justifie comme suit l’enseignement de la littérature:
L'objectif à poursuivre dans l'enseignement de savoirs littéraires et artistiques n'est en aucune manière de transmettre une culture encyclopédique passéiste, mais de donner de manière vivante aux élèves la maitrise des références culturelles qui ont influencé durablement la pensée et l'écriture occidentale et/ou s'avèrent les plus utiles pour décoder les productions culturelles contemporaines. Seuls ont donc été retenus ici des savoirs – dont la liste n'est en rien exhaustive – qui, à l'analyse, participent de l'alphabet culturel de l'homme contemporain. (Ministère de la communauté française 1999: 17)
Les années 2000 enfin donnent lieu à nouveau à plusieurs mouvements contrastés, dont la perpétuation de la tension déjà évoquée entre deux conceptions de la lecture. D’un côté, en France surtout, sous l’influence de certains didacticiens (G. Langlade, A. Rouxel, M.-J. Fourtanier, C. Mazauric), la promotion du « sujet lecteur », qui conçoit la littérature avant tout comme un objet d’expériences personnelles. De l’autre côté, en Suisse surtout, la promotion d’un « archilecteur » (Ronveaux 2014), qui va dans le sens contraire, invitant l’école plutôt à former les élèves aux exigences communes d’un savoir légitimité par l’école et partagé au sein de la communauté interprétative que constitue la classe.
Parallèlement, les enjeux patrimoniaux résistent mais sont revisités : il faut désormais enseigner la littérature pour transmettre une culture commune mais aussi des codes pour lire le monde et la culture. Par ailleurs, tant en Belgique qu’en France, une place plus explicite est accordée à la lecture et à l’écriture littéraires dans l’enseignement qualifiant (technique et professionnel).
Par-delà les tensions, il semble que, dans les différents pays francophones, l’heure soit aujourd’hui au compromis à l’égard de la littérature : après avoir connu des mouvements en sens opposés, tous les programmes accordent désormais une place égale aux enjeux de la communication par rapport à ceux de la littérature. En témoigne par exemple l’introduction du Programme intégré de l’enseignement fondamental promulgué en 2001 par la Fédération de l’enseignement catholique (toujours en cours en 2016) :
[I]l est important de veiller à ce que les enfants soient sensibilisés aux deux grands pôles de l'utilisation de la langue: tantôt outil de simple communication, dans une perspective intellectuelle ou utilitaire; tantôt instrument de création et d'émotion, à des fins littéraires ou simplement ludiques. L'école évitera de privilégier la première dimension au détriment de la seconde, car, sans une réelle ouverture aux œuvres «littéraires» (au sens le plus large du terme: de la comptine à l'histoire drôle, en passant par la chanson ou les contes folkloriques...), les enfants risquent fort de n'avoir de leur langue et du monde qu'une expérience et une perception réductrices.
Ces œuvres en effet offrent deux apports essentiels à la construction du langage et de la pensée. D'une part, elles permettent une meilleure prise de conscience du langage en tant que tel, dont les différents niveaux constitutifs sont mis en évidence dans ce type de productions. D'autre part, elles permettent d'accéder, sur le mode intuitif, à une perception plus nuancée et à une compréhension plus fine de soi, des autres et du monde. (2001: 3)
Voilà qui témoigne d’une conception pour le moins ouverte de la notion de compétence littéraire… et aussi qui ponctue ce bref parcours historique à travers les programmes 2.
Les discours des experts
Dans quelle mesure le discours de l’école sur la littérature rejoint-il celui des experts ? Je regroupe sous ce terme des théoriciens de la littérature et des didacticiens, qui, certes, n’ont pas toujours le même point de vue sur la réalité scolaire mais s’adressent les uns et les autres aux enseignants, et parfois cumulent deux casquettes en se déployant à la fois sur le terrain de la théorie littéraire et celui de la didactique.
La réflexion sur les justifications de l’enseignement de la littérature était déjà au cœur des travaux de Lanson et elle a traversé tout le XXe siècle, mais c’est depuis les années 1970 qu’elle est devenue l’objet de débats permanents, notamment chez des acteurs de l’enseignement supérieur 3.
Si, au-delà de la énième querelle des anciens et des modernes qui a entouré un temps l’émergence de la nouvelle critique, les discours de ces experts ont parfois pu sembler consensuels, ils sont aujourd’hui traversés par trois clivages qui ne se recoupent que partiellement. Ceux-ci concernent la place du canon (quel corpus faut-il retenir et enseigner?), l’approche des textes (faut-il promouvoir l’analyse distanciée ou l’implication subjective?) et la place de la théorie littéraire (faut-il l’enseigner ou non?).
Quel canon pour quelle transmission?
Une première justification de la formation littéraire avancée par les experts s’appuie sur la valeur formative des œuvres qui constituent la littérature : il faudrait enseigner la littérature parce qu’elle regorge de richesses et qu’elle ouvre les jeunes à des savoirs et à des valeurs fondamentaux pour leur développement culturel et leur épanouissement personnel. Si cette idée semble faire largement consensus, l’accord disparait dès qu’on essaie d’en préciser les termes.
Le désaccord concerne d’abord le corpus des œuvres à enseigner. D’un côté, un certain nombre d’auteurs restent attachés au canon littéraire traditionnel et à l’idée d’enseigner prioritairement, voire exclusivement, la littérature consacrée par rapport aux autres productions, jugées « paralittéraires » ou moins légitimes. Cette position, proche à certains égards de celle qui prévalait dans les programmes scolaires jusqu’aux années 1960, traverse plus ou moins explicitement les propos de Vincent Jouve (2010), qui plaide pour que la littérature soit enseignée en tant qu’objet d’art, et plus encore ceux de Danièle Sallenave (1991, 1995, 1997, 2009), qui présente la littérature comme un monument : « Dire que la littérature n’est pas seulement document, dire qu’elle est d’abord monument, c’est en faire un instrument de mémoire, non en user comme d’une preuve » (1995 : 140-141). Chez l’un comme chez l’autre, c’est uniquement de littérature au sens strict qu’il est question, c’est-à-dire de textes reconnus par les instances de légitimation propres à ce champ, et la place qui pourrait être faite dans l’enseignement aux genres ou aux types de productions moins consacrés n’est guère prise en considération. Ceux-là estiment dès lors que l’enseignement de la littérature doit servir prioritairement à transmettre la connaissance des courants, des auteurs, des œuvres et des thèmes et des mythes qu’elle véhicule.
D’autres auteurs, à l’inverse, soulignent la relativité et le renouvellement régulier du canon, et conçoivent l’enseignement de la littérature comme une démarche d’ouverture et d’intégration des œuvres les plus diverses, plaidant pour qu’à côté des œuvres classiques, les enseignants accordent une place croissante aux œuvres dites paralittéraires et aux genres mixtes mêlant l’image au texte. Ces auteurs, dont les positions rejoignent les programmes scolaires des années 1970, s’opposent à la transmission exclusive des savoirs patrimoniaux au nom de divers arguments : le caractère conservateur du patrimoine, qui serait en décalage avec l’évolution de la culture, la relativité de tout canon, en évolution permanente, et qu’il serait donc dangereux de figer, la priorité accordée à la lecture, aux pratiques et aux méthodes sur les savoirs. On retrouve ici la thèse de Pennac (1992) sur les droits souverains du lecteur, mais aussi celle de Citton (2010) sur le passage de l’économie de la connaissance à la culture de l’interprétation. C’est également ce type de position que défendent Baroni (2007) ou Schaeffer (1999, 2011), qui puisent volontiers leurs exemples aussi bien dans la bande dessinée ou les productions audiovisuelles (y compris les jeux vidéo) que dans la littérature au sens strict.
A vrai dire, au vu de l’évolution des institutions culturelles et des choix effectués par les programmes d’enseignement, ce débat entre les points de vue ségrégationniste et intégrationniste semble aujourd’hui en voie d’obsolescence: si, à l’école, la littérature «classique» n’a certes pas perdu sa raison d’être, la présence à ses côtés, dans les programmes et les manuels, des œuvres de la «production élargie» est devenue, depuis une trentaine d’années au moins, un fait aussi irréversible qu’exponentiel. La question qui se pose aujourd’hui aux enseignants à propos du corpus concerne dès lors moins son ouverture – qui semble acquise – que les critères de sélection des œuvres à enseigner en tant que «noyau dur» du patrimoine. Sur ce point, si des auteurs comme Jouve ou Sallenave privilégient avant tout la portée existentielle des œuvres et leur contribution à la perpétuation d’une mémoire et d’une identité collective, d’autres s’appuient prioritairement sur des critères pragmatiques, comme la valeur emblématique de certaines œuvres par rapport à des genres ou à des courants déterminés (Balzac par rapport au réalisme, Mallarmé par rapport à la poésie contemporaine, etc.) (Legros 2005), ou bien l’importance des textes dérivés (les «objets sémiotiques secondaires») que ces œuvres ont inspirés (Louichon 2012), ou encore les stéréotypes qu’elles ont contribué à fonder ou à renouveler (Dufays & al. 2015). Plus généralement, pour Bayard (2007), ce que l’enseignement de la littérature se doit de transmettre avant tout, ce sont des repères permettant aux lecteurs de s’orienter dans la masse des textes: «La culture est d’abord une affaire d’orientation. `Être cultivé, ce n’est pas avoir lu tel ou tel livre, c’est savoir se repérer dans leur ensemble, donc savoir qu’ils forment un ensemble et être en mesure de situer chaque élément par rapport aux autres» (Bayard 2007: 26). Ces critères pragmatiques présentent le double avantage d’être les plus commodes à expliciter aux élèves et de donner moins prise à des débats idéologiques que les critères liés au contenu des œuvres.
Cela étant, les différentes justifications précitées n’ont rien d’incompatible, comme le montre la position médiane défendue à leur égard par Todorov (2007) ou Compagnon (1998) : s’il existe une difficulté à leur propos, elle semble plutôt venir de l’exclusivité que certaines tendent parfois à s’arroger et du caractère parfois peu explicite de leur mobilisation.
Valeurs de la distanciation vs de la participation
Justifier l’enseignement de la littérature ne se limite pas à promouvoir la connaissance ou la valeur de certaines œuvres, cela revient aussi à préconiser la manière de lire qu’on suppose la plus apte à former les esprits. À cet égard, une deuxième tension oppose les adeptes de la distanciation, qui promeuvent les droits du texte et les vertus de la lecture analytique, ancrée dans les valeurs esthétiques, aux adeptes de la participation, qui célèbrent à l’inverse les vertus de la lecture subjective, existentielle, ancrée dans les droits du lecteur et dans les questions vives de l’humain.
La première option vise avant tout à former l’élève à l’usage de méthodes et d’outils. Elle caractérise les approches dites «formalistes», qui considèrent les textes comme des supports ou des exemples servant avant tout à révéler des procédés et à exercer des démarches d’analyse. Enseigner la littérature dans cette perspective revient à développer des savoir-faire et des notions à propos de la littérature. Un temps incarnée par l’analyse structurale, puis par la coopération interprétative chère à Eco (1985), cette approche trouve aujourd’hui un prolongement dans le plaidoyer d’Yves Citton (2010) en faveur d’une culture de l’interprétation.
La seconde option caractérise à l’inverse une auteure comme Michèle Petit quand elle invite les enseignants à se montrer ouverts à la singularité des expériences de leurs élèves (2002 : 134), mais aussi Jean-Marie Schaeffer lorsqu’il préconise une « activation de la littérature comme mode d’accès au monde », qui seule, selon lui, « peut garantir que cette transmission soit autre chose qu’un savoir mort ». Il en conclut que « guider les élèves vers cette expérience devrait […], en toute logique, constituer le cœur même de l’apprentissage littéraire » (2011 : 117). C’est encore cette option que défend Todorov lorsqu’il demande aux enseignants de transmettre la littérature non pour former des spécialistes de l’analyse littéraire, mais pour former des connaisseurs de l’être humain (2007 : 88-89).
Sans doute une certaine solidarité relie-t-elle l’attachement au canon des classiques à la conception distanciée de la lecture, et à l’inverse, ceux qui conçoivent la littérature comme un monument acceptent généralement mal qu’on l’utilise à des fins strictement subjectives. Nulle nécessité cependant sur ce point: le fait de s’appuyer seulement sur un corpus traditionnel d’auteurs légitimés n’empêche pas Picard (1986) de plaider pour une lecture ludique et ouverte, et à l’inverse, nombreux sont les amateurs de paralittérature qui soumettent leur corpus aux analyses narratologiques ou poétiques les plus orthodoxes.
Cela étant, entre distanciation et participation, ou, pour parler comme Eco, entre interprétation et utilisation, faut-il choisir ? Ne convient-il pas plutôt de souligner, à la suite d’Annie Rouxel (2007), que les deux approches n’ont rien d’incompatible en contexte scolaire ? Il semble bien que le fait d’inviter leurs élèves à réagir subjectivement aux textes ne les empêche nullement de les soumettre ensuite à une analyse objectivante, et inversement.
Valeurs de la théorie vs valeurs du «sens commun»
La troisième opposition, qui oppose les enjeux de la théorie littéraire à ceux d’une approche des textes fondée sur le sens commun, est une variante de la précédente car la théorie relève par excellence de l’approche distanciée. Antoine Compagnon a consacré son essai Le démon de la théorie (1998) à déployer le conflit potentiel qui entoure chaque notion liée à la littérature: qu’il soit question de la notion de littérature elle-même, de l’auteur, du monde, du lecteur, du style, de l’histoire ou de la valeur, on voit bien qu’une fracture sépare ceux qui souhaitent enseigner la littérature comme un laboratoire langagier, comme un lieu d’explorations et d’expériences plus ou moins radicales, et ceux qui entendent à l’inverse l’ancrer dans les valeurs communes de la lecture ordinaire. Dans le premier cas, l’enjeu est d’expliquer aux élèves que l’auteur se dissout dans ses textes, que le monde que ceux-ci mettent en scène n’existe qu’en tant qu’illusion, que le lecteur est tout-puissant, que le style est une notion non pertinente et que toute valeur est relative; dans le second, à l’inverse, il s’agit de leur présenter l’intention de l’auteur comme une clé de lecture, les œuvres comme des miroirs du monde, le lecteur comme une instance docile (respectueuse du texte), le style comme un critère de distinction essentiel et la littérature comme le lieu d’une certaine hiérarchie des valeurs.
Ici encore, pourtant, l’alternative n’a rien d’implacable, car, comme Compagnon s’est attaché à le montrer, il est parfaitement possible de dépasser chacun des clivages en refusant d’accorder une valeur de vérité à l’un des deux termes : « c’est […] cette violente logique binaire, terroriste, manichéenne, si chère aux littéraires – fond ou forme, description ou narration, représentation ou signification – qui induit des alternatives dramatiques et nous envoie nous cogner contre les murs et les moulins à vent. Alors que la littérature est lieu même de l’entre-deux, du passe-muraille » (1998 : 145).
Bilan d’étape
Comme on s’en doute, cette rapide typologie des débats qui animent la noosphère littéraire est loin d’épuiser le sujet : il faudrait un livre entier pour analyser finement les arguments déployés par les uns et les autres. Ces quelques éléments pourraient cependant suffire pour l’objectif que je me suis fixé ici, qui était de démêler les principaux clivages repérables dans le discours des experts à propos de la justification de l’enseignement de la littérature.
Par ailleurs, ce bref examen montre à quel point certains débats ou tensions sont communs entre les experts et les auteurs des Instructions officielles. Chez les uns comme chez les autres, la tension est palpable entre les points de vue ségrégationniste et intégrationniste vis-à-vis du patrimoine ou du canon, de même qu’entre la lecture distanciée (analytique, coopérative, modèle, ancrée dans les droits du texte) et la lecture participative (utilisatrice, subjective, ancrée dans les droits du lecteur): l’étude du discours des experts montre combien toutes ces positions demeurent vivaces malgré l’ancienneté de leur inscription dans les programmes scolaires, mais il est frappant de voir que certains experts – comme Todorov (2007), Schaeffer (2011) ou David (2012) – rejoignent aujourd’hui le discours de l’école en faveur de la subjectivité des lectures.
Enfin, on remarquera que, si les experts comme les instructions officielles associent surtout la littérature soit à la culture (patrimoniale) soit à la lecture, ils la relient assez peu à l’oralité et à l’écriture: ce privilège de la réception sur la production et de la lettre sur la voix mériterait assurément d’être analysé plus avant.
Le discours des élèves
Dans quelle mesure les tensions que l’on vient de parcourir concernent-elles les perceptions des élèves ? Plus fondamentalement, quel est leur discours à eux sur les justifications de l’enseignement de la littérature ? Jugent-ils cet enseignement utile, nécessaire ? Quel regard posent-ils sur lui ? Pour le savoir, j’ai mené l’enquête dans neuf classes de français des trois dernières années du secondaire, en vue de recueillir les avis des 193 élèves concernés sur le sens qu’ils accordent au cours de français, et à l’intérieur de celui-ci, à l’enseignement de la littérature. Le choix d’interroger sur le cours de français dans son ensemble avant de se focaliser d’emblée sur la seule littérature devait permettre de cerner la place relative accordée par les élèves à celle-ci par rapport aux autres contenus de la discipline « français ». Afin de viser une certaine représentativité sociologique, l’enquête a été menée dans trois écoles d’indices socioéconomiques contrastés : le Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve (qui jouit d’un indice maximal), l’Institut du Sacré-Cœur de Ganshoren (indice moyen) et l’Institut de l’Enfant Jésus d’Etterbeek (indice faible) 4. Dans chacune d’elles, le même questionnaire a été soumis à trois classes de français (de 4e, 5e et 6e année), à qui il était demandé de répondre à quatre questions ouvertes :
- Que t’apporte personnellement le cours de français ?
- Quels sont les aspects du cours de français qui te plaisent le plus ?
- Quelles sont les difficultés particulières que tu rencontres dans le cours de français ?
- Quels liens y a-t-il entre le cours de français et ta vie de tous les jours ?
Le premier constat qui ressort nettement des réponses est que, pour les élèves des trois dernières années du secondaire, le premier intérêt du cours de français réside dans ses dimensions culturelle et analytique: celles-ci sont en effet mentionnées par la moitié des réponses à la question 1 et par 28 % des réponses à la question 2. Même si 28 % signalent l’analyse de textes comme source de difficulté, la même proportion estime que les compétences d’analyse et la culture transmise par le cours sont des éléments essentiels pour la vie de tous les jours.
Selon les élèves, plus précisément, c’est la littérature qui est la matière la plus importante du cours de français: tout au long des trois années, elle est plébiscitée par plus de la moitié d’entre eux en tant qu’apport principal du cours de français. C’est qu’elle présente à leurs yeux deux intérêts majeurs: elle enrichit leur culture («une découverte de nouveaux horizons», «une ouverture d’esprit», «une meilleure connaissance des auteurs importants», «voir par des textes comment la mentalité et la manière de vivre a évolué au fil du temps») et elle développe leur capacité d’analyse («une capacité à développer ma façon de voir les choses et à mieux les expliquer», «une plus grande réflexion», «un meilleur esprit critique», «une vision de la littérature différente»), ainsi que, pour environ 15 % d’entre eux, leur plaisir de lire («le plaisir de découvrir de nouvelles histoires», «d’autres styles de textes»).
On observe à ce propos une évolution spectaculaire de la 4e à la 6e année secondaire : plus les élèves avancent dans la scolarité, plus ils passent de l’intérêt accordé à la lecture participative (que plusieurs d’entre eux appellent « lecture plaisir ») à l’intérêt accordé à la lecture critique et analytique : cette dernière est en effet plébiscitée par 49 % des élèves de 6e, alors qu’elle n’obtient que 19 % des suffrages en 5e et 15 % des suffrages en 4e. Parallèlement, l’importance donnée à l’expression écrite cède le pas à celle qui est attribuée à la littérature et à l’analyse, puisque la première passe de 58 % en 4e à 30 % en 6e, tandis que la seconde connait exactement l’évolution inverse.
Pour autant, tous les élèves ne sont pas des adeptes de l’enseignement de la littérature: si les scores d’adhésion à cette matière frisent le maximum dans l’école qui possède l’indice socioéconomique le plus élevé, ils touchent seulement la moitié des élèves de l’école dont l’indice socioéconomique est le plus bas. Qui plus est, la littérature est perçue comme une source de difficultés pour un dixième des élèves environ, surtout pour les problèmes d’analyse qu’elle pose (les aspects historiques et culturels ne faisant, quant à eux, l’objet de presque aucune remarque critique).
Pour un tiers des élèves, la reconnaissance des apports de l’enseignement de la littérature se double d’une ferveur avouée à l’égard de cette dimension du cours de français, puisqu’en réponse à la question «quels sont les aspects du cours qui te plaisent le plus?», 33 % (avec un pic de 40 % en 5e année) évoquent la littérature et son histoire («découverte de nouveaux courants et auteurs», «lire des textes qui nous aident à comprendre la philosophie des gens à des époques différentes», «l’étude de la poésie et des courants littéraires») et environ 15 % (chiffre stable au long des trois années) plébiscitent l’analyse de textes («avoir appris à regarder derrière les lignes d’un livre, d’un texte, voir la littérature autrement», «les analyses de livres», «l’analyse de poèmes»).
Mais la littérature ne se limite pas à une matière culturelle et à un support de lecture et d’analyse : pour 25 % des élèves (dont 35 % des élèves de 4e), elle est appréciée aussi en tant qu’objet d’interactions et de liberté d’expression : pour eux, « parler des livres qu’on a lus », « pouvoir donner son avis » constitue une source d’intérêt essentiel du cours de français et une justification majeure de l’enseignement de la littérature.
Enfin, de manière plus surprenante, lecture et culture sont perçues comme « utiles pour la vie de tous les jours » par un élève sur quatre : « la littérature est partout », « ça ouvre notre champ de lectures personnelles », « je passe plus de temps à lire qu’à être sur internet » affirment ainsi plusieurs d’entre eux, qui témoignent par là d’une conception originale du critère d’utilité.
Cette enquête montre en somme que les élèves attachent autant d’importance à développer leurs moyens d’expression et à être initiés aux outils d’analyse de la littérature qu’à connaitre les œuvres littéraires. Ils perçoivent que ces compétences sont en lien avec leur vie quotidienne envisagée à court et à long terme :
Le cours de français m’est utile pour mieux m’exprimer, utiliser des mots adéquats, m’ouvrir aux différentes cultures, m’intéresser davantage à l’actualité et pour synthétiser des informations.
Last but not least, beaucoup d’élèves témoignent d’une disposition à la réflexivité qui parait étroitement liée à leur découverte de la littérature :
Le cours de français m’est utile pour enrichir ma culture générale, développer mes capacités critiques, changer positivement ma façon de penser, et je procède en me focalisant et en analysant des textes intéressants.
Pour conclure
Même si les questions posées aux élèves dans l’enquête qu’on vient d’évoquer ne permettent d’avoir qu’un aperçu des finalités qu’ils attribuent à l’enseignement de la littérature, il est frappant de voir que celles qu’ils expriment rejoignent plus clairement les plaidoyers de Sallenave et de Bayard en faveur de l’histoire littéraire ou celle de Citton en faveur du travail interprétatif que ceux de Todorov ou de Schaeffer pour les vertus existentielles et psychoaffectives de la lecture. Pour les élèves que j’ai interrogés, en effet – qui, rappelons-le, sont issus seulement des trois dernières années du secondaire 5 –, la littérature est avant tout l’objet d’un double apprentissage: celui d’un enrichissement culturel et celui d’une compétence analytique, et si la lecture participative est certes plébiscitée par certains d’entre eux, elle perd du terrain à mesure qu’ils avancent en âge. Ce constat devrait bien sûr être confirmé par d’autres enquêtes, et il ne suffit pas comme tel à justifier une approche plutôt qu’une autre, mais, si l’on accepte d’accorder une certaine pertinence au point de vue des élèves, il pourrait servir de balise aux décideurs qui ont la charge d’actualiser les programmes et de définir des équilibres. C’est l’occasion ici de redire combien un modèle dialectique comme celui de la «lecture littéraire», entendue comme l’activation alternée ou intégrée des modes de réception «participatif» et «distancié», et donc des appréciations à dominante éthique et à dominante esthétique, permet de dépasser des dichotomies qui paraissent aujourd’hui aussi datées que peu productives (Dufays 2017).
Un autre enseignement de cette enquête est que le seul fait d’interroger ainsi les élèves sur leurs intérêts à l’égard du cours de littérature présente en soi un enjeu didactique majeur, dès l’instant où l’enquête apparait non pas comme une fin en soi, mais comme une production que l’on exploitera ensuite explicitement avec eux en dépliant ses résultats, en explicitant les différentes valeurs en jeu ainsi que les différences dont elles font l’objet au sein de la classe et en suscitant un échange de vues collectif. En proposant à ses élèves un tel dépliage de leurs propres valeurs et représentations, l’enseignant leur montre concrètement qu’il s’intéresse à eux, qu’il entend tenir compte de leurs attentes, qu’il entend aussi susciter leur réflexivité et leur recul critique, qu’il cherche à développer chez eux un savoir mobilisable sur les valeurs, ainsi qu’à favoriser une meilleure perception du sens des «matières» de l’année. Mobiliser les élèves dans la tâche et se soucier de leurs attentes: dans une perspective de justification de l’enseignement de la littérature, n’est-ce pas là la première nécessité?
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2015), Enseigner la littérature: «disputes» françaises, Paris, Champion.
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative. Suspense, curiosité, surprise, Paris, Seuil.
Batistini, Carole (2007), «Désir de littérature: quelles composantes?», in Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, J.-L. Dufays (dir.), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 79-88.
Bayard Pierre (2007), Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, Paris, Minuit.
Canvat Karl & Georges Legros (dir.) (2004), Les valeurs dans/de la littérature, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. « Diptyque ».
Canvat, Karl, Georges Legros, Michèle Monballin & Isabelle Streel (1999), «L’enseignement de la littérature au secondaire supérieur belge. Une enquête auprès des professeurs», in DFLM: quels savoirs pour quelles valeurs? Actes du VIIe colloque, G. Legros, M.-C. Pollet & J.-M. Rosier (dir.), Bruxelles, DFLM, p. 215-218.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Citton, Yves (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires? Paris, Éditions Amsterdam.
Citton, Yves (2010), L’avenir des humanités. Économie de la connaissance ou cultures de l’interprétation?, Paris, La Découverte.
Compagnon, Antoine (1998), Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil.
Compagnon, Antoine (2007), La littérature, pour quoi faire?, Paris, Collège de France.
David, Jérôme (2012), «Le premier degré de la littérature», Fabula LHT, n° 9, en ligne, consulté le 7 novembre 2017, URL : http://www.fabula.org/lht/9/david.html
De Beaudrap, Anne Raymonde (dir.) (2004), Images de la littérature et de son enseignement. Étude réalisée à l’IUFM des Pays de la Loire auprès des PLC de Lettres, Nantes, CNDP-CRDPP.
Doubrovsky, Serge & Tzvetan Todorov (dir.) (1971), L'enseignement de la littérature [Actes du colloque organisé à Cerisy en 1969], Paris, Plon (2e éd. : Hermann, 2012).
Dufays, Jean-Louis (dir.) (2007), Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
Dufays, Jean-Louis (2006), «La lecture littéraire, des pratiques enseignantes aux modèles théoriques», LIDIL, n° 36, p. 79-101.
Dufays, Jean-Louis (2011), «Quel enseignement de la lecture et de la littérature à l’heure des "compétences"?», in Pratiques, 149-150, Didactique du français. 2. Problèmes, objets et méthodes, p. 227-248.
Dufays, Jean-Louis (2017), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n° 45, en ligne, consulté le 7 novembre 2017, URL : http://trema.revues.org/3486 ; DOI : 10.4000/trema.3486.
Dufays, Jean-Louis, Myriam De Kesel, Ghislain Carlier & Jim Plumat (2015), Donner du sens aux savoirs. Comment amener nos élèves à (mieux) réfléchir à leurs apprentissages?, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2015), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, 3e éd. revue et actualisée, Bruxelles, De Boeck.
Dufays, Jean-Louis & Manon Ronneau (2015), «La formation littéraire dans le secondaire belge. Une enquête, des constats, des propositions», in Les patrimoines littéraires à l’école. Tensions et débats actuels, M.-F. Bishop & A. Belhadjin (dir.), Paris, Champion, p. 245-262.
Eco, Umberto (1985), Lector in fabula, Paris, Grasset.
Fédération de l’enseignement catholique (2001), Programme intégré, enseignement fondamental, Bruxelles, Secrétariat de l’enseignement catholique, section « Langue française ».
Fraisse, Emmanuel & Violaine Houdart-Mérot (dir.) (2004), Les enseignants et la littérature: la transmission en question. Actes du colloque de l’université de Cergy-Pontoise, Paris, Scérén – CRDP Académie de Créteil.
Houdart-Merot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes et Adapt Editions.
Jey, Martine (1998), La littérature au lycée: invention d’une discipline (1880-1925), Metz, Université de Metz.
Jouve, Vincent (2010), Pourquoi étudier la littérature?, Paris, Armand Colin.
Lafontaine, Dominique (2002), «Les lectures obligatoires en 5e année de l’enseignement secondaire de transition en Communauté française de Belgique», Enjeux, n° 55, p. 177-193.
Legros, Georges (2005), «Quelle place pour la didactique de la littérature?», in Didactique du français. Fondements d’une discipline, J.-L. Chiss, J. David & Y. Reuter (dir.), Bruxelles, De Boeck, p. 35-46.
Louichon, Brigitte (2012), «Définir la littérature patrimoniale», in Enseigner les «classiques» aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. de Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang (ThéoCrit’), p. 37-49.
Mansuy, Michel (dir.) (1977), L'enseignement de la littérature. Crise et perspectives, Paris, Nathan.
Ministère de la communauté française (1999), Compétences terminales et savoirs communs. Humanités générales et technologiques, Bruxelles, Communauté française de Belgique.
Pennac, Daniel (1992), Comme un roman, Paris, Gallimard.
Petit, Michèle (2002), Éloge de la lecture. La construction de soi, Paris, Belin.
Picard, Michel (1986), La lecture comme jeu, Paris, Minuit.
Richard, Suzanne (2004), Finalités de l’enseignement de la littérature et de la lecture de textes littéraires au secondaire, Thèse de doctorat, Université Laval.
Ronveaux, Christophe (2014), «L’archi-élève lecteur entre tâche, activité et performance de lecture», in Didactique du français: du côté des élèves, B. Daunay & J.-L. Dufays (dir.), Bruxelles, De Boeck, p. 119-138
Rouxel, Annie (2007), «De la tension entre utiliser et interpréter dans la réception des œuvres littéraires en classe: réflexion sur une inversion des valeurs au fil du cursus», in Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, J.-L. Dufays (dir.), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 45-54.
Sallenave, Danielle (1991), Le don des morts. Essai sur la littérature, Paris, Gallimard.
Sallenave, Danielle (1995), Lettres mortes. De l'enseignement des lettres en général et de la culture générale en particulier, Paris, Michalon.
Sallenave, Danielle (1997), À quoi sert la littérature? Entretien avec Philippe Petit, Paris, Textuel.
Sallenave, Danielle (2011), «Nous, on n’aime pas lire», Paris, Gallimard.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil.
Schaeffer, Jean-Marie (2011), Petite écologie des études littéraires, Paris, Thierry Marchaisse.
Schmitt, Michel P. (1994), Leçons de littérature, Paris, L’Harmattan.
Todorov, Tzvetan (2007), La littérature en péril, Paris, Quai Voltaire.
Veck, Bernard (1995), La culture littéraire au lycée: des humanités aux méthodes?, Lyon, ENS.
Pour citer l'article
Jean-Louis Dufays, "Apprendre la littérature, pour quoi faire ? Du débat des experts aux discours des élèves", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/apprendre-la-litterature-pour-quoi-faire-du-debat-des-experts-aux-discours-des-eleves
Où situer la critique ?
Dans un colloque sur l’enseignement de la littérature à Cerisy-la-Salle, il y a bien des années, j’ai fait une communication intitulée : la critique des pédagogues (1971). Je voulais, par ce titre, indiquer que la critique anglo-américaine de la deuxième moitié du XXe siècle – grosso modo, le New Criticism – s’était développée sous un impératif lié à une pratique pédagogique. Depuis les expériences de I.A. Richards à l’Université de Cambridge, où il a donné à ses élèves des poèmes sans date ni nom d’auteur pour étudier leurs réponses, la critique anglo-américaine s’est donnée la tâche d’insérer la pratique critique dans la salle de classe. Practical Criticism (1956) – la critique pratique – est d’ailleurs le titre du livre où Richards a présenté les résultats de son expérience. Il a été suivi par des anthologies à usage scolaire, dont les textes étaient également dépourvus de dates et de noms d’auteurs, de manière à proposer des lectures décontextualisées. L’explication de texte en classe devait donc se dérouler dans un dialogue maître-élève, où il n’y avait que le texte lui-même à interroger, où ce n’était que le texte qui fournissait les principes de sa compréhension.
Où situer la critique ?
Dans un colloque sur l’enseignement de la littérature à Cerisy-la-Salle, il y a bien des années, j’ai fait une communication intitulée: la critique des pédagogues (1971). Je voulais, par ce titre, indiquer que la critique anglo-américaine de la deuxième moitié du XXe siècle – grosso modo, le New Criticism – s’était développée sous un impératif lié à une pratique pédagogique. Depuis les expériences de I.A. Richards à l’Université de Cambridge, où il a donné à ses élèves des poèmes sans date ni nom d’auteur pour étudier leurs réponses, la critique anglo-américaine s’est donnée la tâche d’insérer la pratique critique dans la salle de classe. Practical Criticism (1956) – la critique pratique – est d’ailleurs le titre du livre où Richards a présenté les résultats de son expérience. Il a été suivi par des anthologies à usage scolaire, dont les textes étaient également dépourvus de dates et de noms d’auteurs, de manière à proposer des lectures décontextualisées. L’explication de texte en classe devait donc se dérouler dans un dialogue maître-élève, où il n’y avait que le texte lui-même à interroger, où ce n’était que le texte qui fournissait les principes de sa compréhension.
C’était ainsi une pratique textuelle qui se voulait démocratique: tous les lecteurs avaient le potentiel d’être des interprètes, même sans un savoir approfondi. Et c’était aussi, pour ainsi dire, une pratique protestante: ce n’était pas l’interprétation imposée par une autorité ecclésiastique (ou autre) qui devait être retenue, mais plutôt celle produite par l’individu et, par la suite, par le groupe – une vérité de la congrégation, pourrait-on dire. Certes, ce parti pris a donné lieu à des versions quasi parodiques, telle la «critique subjective», qui attribuait une valeur égale à toutes les réponses des étudiants, le but étant d’étudier leurs caractéristiques psychiques plutôt que le texte. Une version plus modérée existait, et existe encore, sous l’appellation de « reader response criticism » dont l’objectif est d’étudier l’interaction entre lecteur et le texte dans la réalisation de la signification.
L’explication de texte dans cette tradition diffère radicalement de son homologue français dans sa version classique. La pratique française tendait en effet à la dissolution du texte dans un contexte sapientiel qui l’emportait sur tout autre aspect. Depuis l’avènement de Gustave Lanson – Antoine Compagnon l’a bien montré – il n’y a en fin de compte que l’histoire littéraire qui puisse transformer les études littéraires en une véritable compétence, une science, qui mérite une place dans l’enseignement secondaire et universitaire. Alors que le New Criticism voulait se débarrasser de l’histoire littéraire (du moins telle qu’elle existait alors, sous une forme bien plus rudimentaire qu’en France: comme disait Geoffrey Hartman, il s’agissait d’une sorte d’»aventure picaresque dans la pseudo-causalité») (Hartman 1970: 356), le New Criticism voulait délester l’étude du texte de tous ses présupposés, pour insister sur la nécessité de la lecture, comprise comme la rencontre radicale d’une conscience et d’un texte. L’idéologie de cette pratique critique devait beaucoup, je l’ai déjà signalé, à une situation spécifiquement américaine, l’étudiant entrant souvent dans l’enseignement supérieur sans grand bagage culturel. Par conséquent, il fallait que ses cours de littérature repartent presque de zéro. Dire que l’on peut aborder l’étude de la poésie sans avoir une formation préalable répondait à une situation de fait, qu’il fallait prendre en compte pour réussir sur le marché du savoir universitaire.
Il est vrai aussi que cette nouvelle critique se situait dans une mouvance moderniste de poètes qui voulaient renouveler leur art par un retour aux sources préromantiques. C’est notamment le parti pris de T.S. Eliot, qui voulait que le poète exprime non sa personnalité, mais plutôt le médium dans le lequel il travaille, et qui a rénové l’étude des poètes élisabéthains et «métaphysiques» du XVIe et du XVIIe siècles en les présentant comme un antidote à l’expressionisme romantique. Les premiers «new critics » étaient des poètes eux-mêmes, et cherchaient un moyen pour parler de la poésie en tant que langage et structure, sans référence au contexte idéologique ou historique. L’enseignement de la littérature devait donc être en quelque sorte une «leçon de choses» rousseauiste, une manipulation du texte par la classe. La réponse individuelle au texte devait être en principe – c’est le rôle du pédagogue – orchestrée, afin qu’elle devienne, en fin de compte, communautaire, le produit d’un chœur où les voix disparates s’harmonisent.
On peut donc dire que la nouvelle critique américaine s’ancrait résolument dans une pratique pédagogique, et elle a pu ainsi acquérir une place dans l’université, et avoir une influence réelle dans les études universitaires. Ce que l’on a nommé close reading ou encore slow reading – une lecture caractérisée par la minutie et la lenteur – a exercé son influence un peu partout dans les sciences humaines, de l’anthropologie à l’étude du droit. On avait l’impression, à la fin du XXe siècle, que la leçon du New Criticism était acquise un peu partout dans l’éducation américaine. Même ses contestataires employaient les méthodes qu’ils avaient puisées chez leurs adversaires.
Ce n’est plus vrai aujourd’hui. À mon avis, nous avons vécu une scission entre la critique et la pédagogie littéraire, pour des raisons qui ne sont pas propres seulement aux Etats-Unis, et qui touchent en fait à la situation du savoir littéraire dans les universités en Occident. On pourrait mettre en cause ce que la critique littéraire est devenue sous l’influence la théorie littéraire telle qu’elle s’est installée dans l’université, et telle qu’elle a été pratiquée par beaucoup de mes collègues américains—bien que, selon moi, il n’y ait rien d’inhérent à la théorie littéraire qui dicte ce divorce. Il me semble que le divorce dérive bien plus d’un certain abandon de l’impératif pédagogique de la part d’universitaires qui ont voulu parler à un public différent, voire prendre leur place comme acolytes dans une chapelle connue pour l’exclusivité de ses pratiques et, surtout, de son langage.
Le bannissement de l’idéologie voulu par le New Criticism a naturellement fait l’objet d’une contestation féroce de la part de ceux qui voulaient démasquer le parti pris plutôt conservateur de la première génération de ces critiques, souvent issus du Sud des Etats-Unis. La fétichisation du poème comme «icône verbale», comme objet fermé sur lui-même, se prêtait aux attaques soit des marxisants, soit des poststructuralistes de diverses obédiances. C’est, je crois, surtout le New Historicism, fondé par Stephen Greenblatt, qui a remis à l’honneur une lecture fondée sur un ensemble de documents de provenances diverses, fournissant une certaine épaisseur à l’analyse, à l’instar de la «description dense» pratiquée par l’anthropologue Clifford Geertz (1998). En effet, plus que la théorie littéraire, c’est surtout cet historicisme nouveau qui a contesté la nouvelle critique. Et après avoir connu l’influence de Lévi-Strauss, de Barthes, de Genette, voire de Derrida, les jeunes universitaires américains lisent volontiers maintenant les historiens de l’école des Annales (et aussi Foucault, bien entendu). Ceux parmi mes collègues français qui assistent avec fidélité à la réunion annuelle de la société des dix-neuviémistes américains ont certainement dû remarquer la dominance d’une parole culturo-historique, entre Walter Benjamin et Alain Corbin. Je ne veux nullement m’en moquer: on y trouve des travaux très pertinents et des connaissances remarquables.
Néanmoins, je détecte les symptômes d’une certaine désespérance à l’égard de la critique littéraire. Pour beaucoup de mes jeunes collègues, la critique littéraire telle que je l’entends a cessé d’être possible. On ne peut pas, de bonne foi, se mettre à l’exégèse des textes: le contexte pèse toujours trop lourd. On ne peut pas entreprendre une explication de texte avec les seuls outils fournis par le texte lui-même. Le langage est insuffisant pour parler du langage – il faut un système différent, un discours qui trouve ses assises ailleurs, pour fournir un métalangage à la critique littéraire. Quand Roland Barthes a avoué, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, qu’il n’y avait pas de métalangage, c’était, ce me semble, une invitation à entrer dans le pluriel du texte sans le support d’un savoir venu d’ailleurs. Mais je crois que la jeune critique a trouvé ce manque de support trop vertigineux. Elle s’est ruée plutôt sur des domaines où le savoir paraissait plus positif et plus sûr. Et je crois que, ce faisant, elle a perdu en grande partie l’impulsion pédagogique qui présidait à ce qu’il y avait de plus génial dans la critique américaine.
Rares sont ceux qui soutiendraient aujourd’hui l’idée que les études littéraires constituent un domaine autonome, et que la lecture d’un poème est une activité autotélique, sans autre mobile et sans autre conséquence. L’idée que la littérature relève du spirituel, de ce qui a pris la place de la religion après la mort de Dieu, était très répandue parmi les nouveaux critiques américains. Le grand poète américain Wallace Stevens l’a exprimé très nettement: après que l’on a cessé de croire en dieu, c’est la poésie qui prend sa place comme source spirituelle. Ce qui fait des profs de Lettres des prêtres du culte. Je ne sais si nous autres, professeurs de Lettres, avons totalement abandonné cette croyance, mais nous ne sommes plus prêts à la défendre explicitement en tant que telle. La littérature ne peut pas nous sauver, et il vaut mieux se délester de toutes les traces de la théologie, même si l’on pourrait soutenir que notre discipline, sous son aspect moderne, commence dans l’exégèse et la philologie biblique. Reste à savoir si l’étude de la chose littéraire telle que nous l’entendons aujourd’hui devrait s’enraciner dans l’enseignement autant que par le passé.
Certes, la critique littéraire peut très bien exister indépendamment de l’école et, sous la forme du journalisme littéraire et culturel, elle atteint un public bien plus large. Il y a peut-être une libération dans le divorce actuel entre l’université et le savoir présenté par les médias. Et pourtant, je suis persuadé qu’une critique littéraire digne de ce nom – c’est-à-dire un discours plus sérieux, plus consistant et plus utile que les appréciations médiatiques qui nous disent quel film, quel livre ou quelle exposition choisir – ne peut être que pédagogique, et donc fortement lié à l’enseignement. Je ne pense pas qu’une étude des œuvres littéraires qui se voudrait autre chose que l’exercice du bon goût d’un connaisseur, puisse être séparé de son enseignement. Mon titre pour le colloque de Cerisy n’était donc qu’une tautologie: idéalement il ne peut exister qu’une critique de pédagogues.
Mais dire ceci ne résout aucunement le problème concernant le but de cette critique. On reste toujours hanté par la possibilité que la place accordée aux Lettres dans l’université depuis la Troisième République n’est pas méritée, qu’en fin de compte, notre casier universitaire est vide. Ici, les nouveaux critiques américains nous abandonnent, parce qu’ils ont trop facilement accepté le rôle spiritualiste de la poésie, ainsi que son exégèse, seule tâche de ses acolytes. D’autres critiques, de Kenneth Burke à Northrop Frye et au-delà, ont compris le besoin d’une organisation supérieure de ce qui peut être appris dans l’acte de lecture d’un texte: le besoin d’un système qui expliquerait la nécessité et la signification des actes de critiques individuels. C’est que derrière chaque acte critique valable, chaque lecture qui nous apprend à mieux comprendre le texte, il y a cette connaissance globale et analytique de la littérature qui s’appelle poétique. Si la critique littéraire peut prétendre au statut d’un savoir, si elle peut légitimer sa place dans l’université, c’est bien par rapport à la poétique, comprise comme l’ensemble organisé de nos connaissances sur le fonctionnement des textes, leur mécanisme, le comment de leur fabrique.
Mon ancien collègue Paul de Man, trop facilement étiqueté comme pratiquant de la déconstruction, au même titre que Jacques Derrida, a publié un article sous le tire «le retour à la philologie» (1986), où il a soutenu que l’étude linguistique, promue par la déconstruction aussi bien que par la nouvelle critique américaine – qu’il connaissait pour l’avoir pratiquée dans un cours à Harvard désormais célèbre – pouvait amener les étudiants à des prises de conscience absolument radicales à partir de la seule étude du langage du texte, sans a priori théorique ou historique. Ce qui amène de Man à affirmer que, dans l’enseignement de la littérature, il faudrait étudier la rhétorique et la poétique avant l’herméneutique et l’histoire littéraire. Autrement dit, il faudrait connaître les structures du langage et du système littéraire avant d’interpréter les textes et de les enchaîner dans un récit historique. Mais paradoxalement, pour de Man, cette connaissance de la poétique et de la rhétorique ne peut dériver que de l’étude des textes, de l’acte de lecture. Il n’y a pas de court-circuit à la lecture, cette dernière devant, selon lui, d’abord repérer les systèmes formels du texte, ses moyens de signification, avant d’arriver à l’interprétation. L’expérience radicale de la lecture est en même temps la source de la théorie littéraire et ce qui déjoue toute théorie.
J’évoque les prises de position de Paul de Man pour démontrer, encore une fois, que la pratique de la critique littéraire aux Etats-Unis revient toujours, chez les maîtres à penser du moins, à la lecture, et cette lecture elle-même s’insère dans une certaine pratique de l’enseignement. Je peux témoigner que la leçon orale de Paul de Man, sa présence pédagogique, était encore plus forte que sa parole publiée. Son influence s’est exercée surtout par ses élèves, qui presque tous vous diraient que de Man publié n’est qu’un pâle reflet du maître vivant. Ce qu’il fallait, dans son cas, c’était la convergence d’un texte, d’un public, et de son discours analytique. Et c’est ainsi que, dans sa pratique, il a pris la relève des New Critics. Il n’y a pas d’exégèse textuelle sans enseignement. À quoi servirait l’exégèse s’il n’y avait pas de public, d’enseignés?
Dans le sillage de la French Theory et du New Historicism, que se passe-t-il dans la critique américaine aujourd’hui? J’ai déjà noté une persistance de la référence au contexte historique, où souvent le texte littéraire n’est que la mise en scène d’autres forces et d’autres discours du moment. Mais il y a – parmi de nombreuses tendances, il faut le dire – deux mouvements qui semblent primer sur les autres. D’abord, l’étude du littéraire comme instrument cognitif. Il y a par exemple le travail de Terence Cave à Oxford sur la littérature en tant qu’objet de connaissance, et aussi des explorations dans le domaine de la science cognitive et de la neuroscience, souvent sous l’étendard des études cognitives littéraires. Le même phénomène se trouve par exemple dans l’étude de la musique et de l’esthétique picturale. Que se passe-t-il dans le système cérébral quand nous lisons, écoutons ou regardons une œuvre? Existe-t-il des effets de miroir cérébral qui «expliquent» notre rapport aux fictions qui nous intéressent? La recherche dans ce domaine s’étend des expériences de laboratoire – étude des synapses lors d’une expérience esthétique chez le sujet – aux explications de texte dans un contexte cognitif. Par exemple, on a pu établir par des tests que le sujet qui a pratiqué le roman social du XIXe siècle – Jane Austen ou George Eliot, par exemple – a une plus grande capacité de reconnaître et de maîtriser les rapports affectifs et sociaux de ses congénères. Si le roman est un miroir promené le long d’un chemin, on sait mieux s’orienter sur ce chemin grâce au roman. Oui, mais – et c’est un reproche que l’on peut adresser à beaucoup de travaux dans ce domaine – nous qui lisons Balzac et Proust, nous le nous savions déjà. Tout de même, je tiens à signaler que l’étude cognitive de la littérature s’appuie, elle aussi, sur un acte de lecture.
L’autre tendance actuelle, à laquelle j’ai participé moi-même, doit me semble-t-il être évoquée avec une certaine hésitation. Il s’agit un retour à la substance éthique de la littérature, ou plus exactement à une étude orientée sur la place éthique occupée par la littérature dans le monde. Mon hésitation vient de l’application facile des notions d’éthique et d’humanisme à propos de la littérature. Je refuse l’idée simpliste, et très répandue, que la lecture de bonnes œuvres nous rend meilleurs: plus aptes à bien agir avec nos amis, plus sensibles aux différences entre les gens, plus apitoyés envers le sort des damnés de la terre. Il y a trop d’exemples du contraire, notamment le trop souvent cité nazi d’Auschwitz qui se délassait d’une journée de tuerie en se pâmant dans l’écoute de la Flûte enchantée de Mozart. Il est aussi vrai que les chefs-d’œuvres de notre tradition ne se prêtent généralement pas à une lecture réjouissante, mais plutôt à une perspective sombre sur la condition humaine. Le miroir de l’humanité qui nous paraît le plus valable est de nature critique, rebelle, il est mû par un esprit de négation. La vertu n’est pas inhérente à la lecture, surtout pas à celle des grands classiques.
Néanmoins, je tâcherai de récupérer l’idée d’une éthique de la lecture par le biais de la lecture même. Je dirige depuis quelques années un séminaire qui porte ce titre un peu solennel: «The Ethics of Reading and the Cultures of Professionalism». L’idée de ce projet m’est venue après la lecture des «torture memos«, qui ont été nommés ainsi quand ils sont sortis de l’ombre et ont été placés devant le public, il y a une dizaine d’années. Il s’agissait d’avis émanant du bureau de conseil légal du Ministère de la Justice concernant l’application de la «Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», incorporés dans le code criminel américain et concernant des captifs de la «guerre contre le terrorisme». En d’autres termes, ce sont des avis sur la légalité des actions entreprises par l’exécutif américain, conçus par les esprits les plus éminents de la jurisprudence américaine. Le résultat: une lecture par trop ingénieuse de la Convention, lue dans un contexte intertextuel qui s’appuyait sur des lois concernant l’assurance médicale en vue de reculer très loin les limites physiques et psychiques au-delà desquelles on entrait dans le régime de la torture. Je ne citerai pas ici ces textes, qui peuvent ressembler à une espèce de parodie bouffonne de certaines interprétations littéraires, où l’enjeu est tout-à-fait autre. Je me suis dit que quelqu’un qui avait reçu une bonne formation d’analyste de textes littéraires n’aurait jamais pu écrire des interprétations aussi bizarres, aussi détachées de tout sens commun, aussi dépourvues de toute considération morale. La conséquence de ces actes de lecture et d’interprétation était, vous le savez tous, la pratique de la torture sur plusieurs des détenus de «haute valeur», pratique qui était présentée par l’administration Bush-Cheney non comme de la torture mais comme des «enhanced interrogation techniques ». Comment traduire? Des techniques d’interrogation «augmentées», «mises en valeur», «ameliorées». L’euphémisme du langage sert à cacher une réalité brutale. Une journaliste américaine, Jane Mayer, l’a très bien dit: avant de corrompre la réalité, l’administration Bush-Cheney a commencé par corrompre le langage.
Nous autres professeurs de Lettres, poéticiens et herméneutes, possédons une compétence qui nous empêcherait de publier une interprétation textuelle aussi déraisonnable et abusive. Ce n’est pas que nous soyons forcément plus vertueux que les juristes qui sont les auteurs de ces avis sur la torture, mais nous, nous savons que nous sommes responsables des actes d’interprétation que nous soumettons au public. Et au fond, ce qui engage notre responsabilité, c’est notre rôle pédagogique. Devant une classe, en dialogue, réel ou imaginaire, avec des étudiants, nous pouvons bien sûr commettre des erreurs, mais nous ne pouvons pas mentir. Ce serait tout simplement déroger à notre définition du professionnalisme. La lecture que nous pratiquons – l’effort que nous faisons pour arriver à une lecture qui nous semble correcte, fidèle, justifiable – exige et constitue une espèce d’éthique, celle dont dépend notre définition en tant qu’enseignants.
L’exemple des directives sur la torture est extrême, je le concède. Mais je suis convaincu qu‘il existe une éthique de la lecture, et que, le plus souvent, nous y conformons notre travail. Il y a ceci de distinctif dans l’enseignement de la littérature – et dans d’autres disciplines proches, telles que l’histoire de l’art, l’archéologie, la musicologie – que nous ne sommes pas seuls dans la salle de classe. Il y a nos élèves, bien entendu, mais aussi un objet: un tableau, un artefact fragmentaire ou bien un texte. Ce que nous avons à expliquer, ce n’est pas nous-mêmes, c’est une autre voix, qu’il s’agit de réaliser par notre propre voix, un objet venu d’ailleurs qu’il faut faire revivre. Notre propre personnalité est pour ainsi dire subordonnée à cette autre présence dans la salle, une présence qui est plus importante que nous-mêmes, que nous devons convoquer, rendre immédiate et compréhensible. Nous sommes des médiateurs, des truchements, des ambassadeurs d’objets et de textes qui représentent une culture qui est plus vaste que nous. Nous sommes des ventriloques d’autres êtres qui ne peuvent pas parler directement. Cette situation, selon moi, doit nous dicter un rôle assez humble: nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais pour ce qui passe à travers nous.
Nous qui enseignons la littérature savons que notre métier est authentiquement une discipline, qu’on ne peut pas dire n’importe quoi. Le grand critique canadien Northrop Frye disait que l’étude de la littérature peut être aussi exacte et rigoureuse que l’étude scientifique. Je n’en suis pas entièrement persuadé, mais je pense tout de même que nous nous inscrivons dans une praxis définie par des règles, des traditions et des exigences d’intelligibilité. Ce que nous pratiquons nous permet au minimum de détecter une lecture fausse du fait de sa mauvaise foi et de son abus du langage. Et le contrôle de notre pratique, me semble-t-il, vient de celui ou ceux qui nous écoutent, qu’il faut convaincre. La communication du processus de notre lecture à d’autres est bien entendu un acte rhétorique, qui nous place de nouveau dans la posture d’un enseignant.
Pour conclure, je reviens à mon titre: où situer la critique? Je propose de considérer que les troubles de la critique actuelle et le sentiment très répandu dans le grand public que la critique universitaire est devenue abscons ou pire (une espèce de trahison des clercs, qui a détruit la clarté classique des Lettres françaises) dérivent non de la théorie littéraire, le grand coupable selon beaucoup de commentateurs, mais de son oubli de la situation pédagogique qui lui revient, je dirais, naturellement. Car je ne vois d’autre rôle pour la critique que pédagogique. Je reviens à ce j’ai dit sur le critique en tant que truchement, traducteur ou médiateur entre un texte (ou un objet d’art quelconque) et ceux qui veulent mieux le connaître. C’est un rôle qui, selon moi, doit dicter une certaine humilité. L’arrogance d’une certaine critique, qui prétend savoir mieux que le passé, savoir mieux par exemple que le pauvre XIXe siècle aveuglé par ses préjugés, ne peut qu’être nuisible dans ce que je conçois comme la tâche majeure de la critique: faire comprendre.
Où situer la critique? Justement, dans la situation pédagogique, avec toutes ses incertitudes, ses difficultés, ses séductions et ses transferts, situation réelle ou, pour la critique écrite, imaginaire mais contraignante quand même. Certes, il faut reconnaître que cette situation est fragile et menacée dans le nouveau monde universitaire qui s’esquisse, où l’enseignant en chair et en os sera remplacé par l’écran de télévision. Si nous continuons à croire en la relation pédagogique, essentielle dans le domaine littéraire, il va falloir la défendre contre les comptables de l’université néo-libérale de l’avenir – un avenir qui, en fait, est déjà arrivé.
Bibliographie
Brooks, Peter (1971), «La Critique des pédagogues», in L'Enseignement de la littérature, Serge Doubrovsky et Tzvetan Todorov (dir.), Paris, Plon, p. 551-564.
De Man, Paul (1986), «The Return to Philology», in The Resistance to Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press, p. 21-26.
Geertz, Clifford (1998), «La description dense», trad. André Mary, Enquête, n°6, p. 73-105. En ligne, mis en ligne le 15 juillet 2013, consulté le 11 octobre 2017. URL: http://enquete.revues.org/1443
Hartman, Geoffrey (1970), «Toward Literary History», in Beyond Formalism, New Haven, Yale University Press, p. 356-386.
Richards, I. A. (1956), Practical Criticism. A Study of Literary Judgment, New York, Mariner Books.
Pour citer l'article
Peter Brooks, "Où situer la critique ?", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/ou-situer-la-critique
Le premier numéro d’une revue consacrée à l’enseignement de la littérature se doit d’embrasser le plus largement possible son objet, pour en donner d’emblée la véritable mesure et l’inscrire dans les débats qui agitent aussi bien les spécialistes que le grand public. L’histoire et l’actualité des arguments avancés pour soutenir l’intérêt de la lecture et de l’étude des œuvres littéraires dans le cadre scolaire et académique...
Justifier l’enseignement de la littérature:
Arguments passés et contemporains
Le premier numéro d’une revue consacrée à l’enseignement de la littérature se doit d’embrasser le plus largement possible son objet, pour en donner d’emblée la véritable mesure et l’inscrire dans les débats qui agitent aussi bien les spécialistes que le grand public. L’histoire et l’actualité des arguments avancés pour soutenir l’intérêt de la lecture et de l’étude des œuvres littéraires dans le cadre scolaire et académique nous semble à ce titre fournir matière à des réflexions rigoureuses et riches d’aperçus généraux.
Depuis une quinzaine d’années, l’étude des œuvres littéraires souffre d’un déficit croissant de légitimité à l’école et dans l’enseignement supérieur. Les raisons en sont diverses, malaisément interprétables ; et les symptômes, très controversés : réformes scolaires novatrices ou maladroites (c’est selon), baisse des effectifs dans les filières de formation en lettres, chute des ventes dans le domaine de la critique littéraire, transformation éditoriale de la littérature en offre de divertissement ou de développement personnel, prééminence culturelle de l’image sur l’écrit, etc. Pour autant, cette « crise » putative de l’enseignement littéraire n’est pas la première du genre, et on en dénombrerait sans peine plusieurs de comparables depuis le XIXe siècle.
Le parti pris de ce dossier thématique de Transpositio est donc double : (i) rappeler à la fois les mises en doute récurrentes de l’utilité ou de la pertinence d’un tel enseignement, et les faisceaux successifs de contre-objections qui leur ont été opposés ; (ii) suggérer la pluralité et la complexité des positions défendues aujourd’hui en la matière.
Au nom de quoi, en somme, justifier la lecture et l’étude des œuvres littéraires à l’école et à l’université ? Quels arguments a-t-on avancés par le passé ? Quels arguments peut-on avancer aujourd’hui ?
L’accueil des points de vue contemporains les plus différents sur la question est crucial à nos yeux. Non pas parce que la revue aurait pour vocation de fabriquer du consensus sur cette question, mais bien plutôt parce qu’elle se donne pour tâche de construire un espace où les éventuelles divergences puissent être formulées avec clarté et discutées comme telles.
Les contributions témoignent ainsi de la diversité des angles possibles sur un problème commun. Les degrés de scolarité évoqués vont du primaire à l’université. Les auteurs sont des didacticiens, des chercheurs issus des études littéraires ou médiatiques — et des enseignants en poste. La Suisse, la France, la Belgique et les États-Unis dessinent une première carte des affiliations institutionnelles des contributeurs, que nous espérons voir se diversifier encore. Les générations se côtoient: Peter Brooks revient ainsi sur l’un de ses articles paru en 1971 — à une date où certains des autres auteurs du dossier n’étaient pas encore nés. Inutile de préciser que ce savoir de l’expérience nous est très précieux.
Les trois premières contributions revendiquent un parti-pris résolument historique. En mobilisant ce qu’elle nomme une « didactique historique en français », Marie-France Bishop identifie trois moments où se sont particulièrement déployés des débats et des arguments pour justifier l’enseignement de la littérature à l’école élémentaire en France, de la IIIe République à nos jours. Cela lui permet à la fois de déplier les enjeux politiques, moraux et culturels au cœur des débats, et de penser les effets de ces derniers sur la constitution des corpus scolaires et les conceptualisations variées du savoir-lire. Après un examen de l’éventail des justifications institutionnelles et didactiques de l’enseignement de la littérature à l’école, Jean-Louis Dufays porte une attention rare à la manière dont les élèves eux-mêmes expliquent leur rapport à l’enseignement littéraire. Des résultats d’une enquête menée en Belgique auprès d’élèves de trois écoles du secondaire, il ressort que les étudiants perçoivent un rapport précieux entre les compétences acquises en classe de français et leur vie quotidienne. Jérôme David quant à lui rapporte la « crise » actuelle de l’enseignement de la littérature au temps long de la gamme de ses justifications passées et présentes. Il suggère qu’une conceptualisation serrée des éthiques éducatives permettrait de rassembler les recherches en didactique et en littérature ainsi que les pratiques enseignantes afin de susciter des questions communes et de clarifier les usages que l’on a prêtés et que l’on pourrait confier aujourd’hui à l’enseignement de la littérature.
Les contributions suivantes s’attachent principalement à la situation actuelle. C’est le souci de réajuster l’enseignement de la littérature à notre contexte contemporain connecté en tout temps et peuplé de techno-images qui suscite l’intervention d’Yves Citton. De son point de vue, la culture médiatique et les études littéraires, loin de s’opposer, convergent: les méthodes herméneutiques sont indispensables à la compréhension des média, tout comme l’attention aux média offre de nombreuses possibilités de renouvellement de l’enseignement de la littérature. Ce frayage des cultures numériques et littéraires invite à privilégier les cheminements indisciplinés et l’imagination critique.
Peter Brooks revient sur la perte d’influence contemporaine de la critique littéraire à l’université, notamment américaine, qu’il impute non pas à la Nouvelle critique, mais à son divorce d’avec son origine proprement pédagogique. La critique littéraire n’a de sens, selon lui, qu’en tant qu’elle s’adresse à un public d’étudiants et non à des collègues experts: par là même, elle engage une éthique de la lecture que le critique ne peut exercer qu’en enseignant et dont la transmission est fondamentale.
Pour citer l'article
J. David, M. Ecoeur & A.-F. Schläpfer, "Éditorial", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/editorial
Enseigner la littérature: une approche par les justifications (XIXe-XXIe siècles)
La littérature, quelle que soit la conception qu’on en a — c’est-à-dire: quelle qu’en soit la théorisation (plus ou moins explicite, cohérente et rigoureuse) dans laquelle on la pense — présente des caractéristiques en partie différentes, selon qu’on l’appréhende comme objet de recherche ou comme objet d’enseignement. L’étude de la littérature, dans la recherche, vise à produire des connaissances et à renouveler des savoirs; l’étude de la littérature, dans un enseignement, s’attache notamment à transmettre ces savoirs — dûment simplifiés, remaniés, opérationnalisés, pour ainsi dire {{C’est ce qu’on appelle en didactique le processus de transposition (voir Verret, 1975; Chevallard, 1985; Martinand, 1985, sur les «pratiques sociales de référence»; Schneuwly, 1995; Bronckart et Plazaola Giger, 1998; et, pour la littérature: Poslaniec, 1992, 164-165; Petitjean, 1998; Denizot, 2013; Gabathuler, 2016, 69-95).}} — à des élèves ou des étudiants qui les apprennent — qui les découvrent, certes, mais en un autre sens que les chercheurs.
Enseigner la littérature: une approche par les justifications (XIXe-XXIe siècles)
La littérature, quelle que soit la conception qu’on en a — c’est-à-dire: quelle qu’en soit la théorisation (plus ou moins explicite, cohérente et rigoureuse) dans laquelle on la pense — présente des caractéristiques en partie différentes, selon qu’on l’appréhende comme objet de recherche ou comme objet d’enseignement. L’étude de la littérature, dans la recherche, vise à produire des connaissances et à renouveler des savoirs; l’étude de la littérature, dans un enseignement, s’attache notamment à transmettre ces savoirs — dûment simplifiés, remaniés, opérationnalisés, pour ainsi dire 1 — à des élèves ou des étudiants qui les apprennent — qui les découvrent, certes, mais en un autre sens que les chercheurs.
Autrement dit, il n’y a pas, d’un côté, «la» littérature et, de l’autre, des recherches et des enseignements qui cherchent à la définir et à la transmettre. Et il n’y a pas non plus, face à «la» littérature, une recherche qui formule la signification ultime des textes et un enseignement qui tâche d’en inculquer quelques bribes aux apprenants. Le terrain où se déploient ici aussi bien l’écriture et la lecture, que la recherche et l’enseignement, ne se laisse pas désigner par un nom commun (la littérature): il y faut un adjectif (littéraire) et peut-être même, davantage encore, un adverbe (littérairement). Nulle essence, mais des propriétés mouvantes qui répondent à des usages divers; un régime pluriel de l’attention et de l’expérience.
1. Qu’est-ce que justifier?
1.1. Le déclin du platonisme dans les études littéraires
Sans doute convient-il de lever en préambule une confusion fréquente. «La» littérature, ou la Littérature, si l’on assimile ce singulier à une essence quelconque, n’existe plus dans les savoirs littéraires depuis près d’un demi-siècle. Définir le propre de la littérature par des qualités qui seraient intrinsèques aux textes mêmes, indépendamment de leurs lectures et de leurs usages, relève désormais d’une méprise: la «littérarité» est une qualité variable, changeante, et «la» littérature est toujours déclarée telle par un groupe donné 2.
Deux mouvements de fond ont contribué à instaurer une telle méfiance à l’égard de la Littérature, avec majuscule. L’historicisation radicale des textes littéraires, d’abord, a fragilisé certaines des évidences sur lesquelles reposait jusqu’alors la critique 3. Dans le sillage des travaux de Pierre Bourdieu (1992), on envisage désormais que les agents d’un «champ littéraire» partagent une conception de ce qui les réunit — la littérature — dont les variations suivent à peu près celles des générations. Roger Chartier (1991; 2005), pour sa part, a défendu l’idée selon laquelle les multiples éditions d’un «même» texte en modèlent le sens d’une façon telle qu’il est difficile de proposer des interprétations qui en intègrent toutes les variations: «la» littérature n’est plus un invariant éthéré aux supports divers et, surtout, indifférents, mais la gamme historique très riche et très disparate de ces «inscriptions» éditoriales qui préparent et appellent un type d’attention particulier (avec ou sans illustration, à la typographie plus ou moins dense, aux formats plus ou moins prestigieux, etc.). Par ailleurs, l’analyse de discours — prise en un sens large qui accueille aussi bien les travaux de Marc Angenot (1989) que ceux d’Alain Corbin (dès Le Miasme et la jonquille, en 1982) et de ses élèves, comme Dominique Kalifa (1995; 2013), Judith Lyon-Caen (2010) ou Sylvain Venayre (2002)) — plonge les textes reconnus comme littéraires dans le continuum effectif des productions discursives d’une époque: la «littérarité», ainsi mise à l’épreuve de sa congruence avec des textes de médecine, de droit, de police ou de presse, ne présente plus les dehors nets d’un écart répété au langage ordinaire et au sens commun, critère longtemps constitutif de la «littérarité», mais désigne des manières d’ouvrir la langue et de battre en brèche les préjugés qui sont trop hétéroclites pour dessiner une règle générale.
Du côté des approches formelles, poétiques ou narratologiques, le «texte» cède progressivement le pas à des notions plus englobantes, comme celles de «fiction» (Schaeffer, 1999; Caïra, 2011; Lavocat, 2016), d’«intrigue» (Brooks, 1984; Baroni, 2007; 2017) ou de «style» (Jenny, 1990; 2011; Macé, 2016), qui permettent d’aborder la littérature à l’horizon d’autres médias à vocation esthétique, comme la bande-dessinée, le cinéma, les jeux vidéo, la musique ou la danse. L’intermédialité, comme on l’appelle — ou la transfictionnalité (Saint-Gelais, 2011) — déplace le propre présumé de la littérature en partie ailleurs que dans l’écriture même. Les œuvres créent des mondes fictionnels dont les personnages ne sont plus seulement de papier, comme on le répétait dans les années 1970 (voir Hamon, 1972), mais dotés d’une vie virtuelle qui leur permet d’exister hors des textes. Les récits ne piègent plus tant les lecteurs, comme l’affirmait Louis Marin (1978): ils les captent, les fascinent et les éduquent en mobilisant leurs émotions. La «fonction poétique» jadis assignée par Roman Jakobson (1963) à la littérature, comme réflexivité sur son propre message, ne suffit plus à distinguer une forme spécifiquement littéraire de l’expression et de la communication: il va de soi aujourd’hui qu’un roman, un poème, une pièce de théâtre nous disent quelque chose du monde (fonction référentielle), nous rassemblent pour en penser quelque chose en commun (fonction phatique), s’adressent à nous d’une manière précise (fonction conative), etc. Les critères de la littérarité, si on cherchait à les fixer, s’en trouveraient multipliés d’autant.
Il n’incombe donc plus aux études littéraires de formuler l’essence de la littérature — quand bien même cette essence serait de soustraction, pour ainsi dire, à savoir le pouvoir littéraire, critique ou ironique, de dénoncer dans les autres discours toute prétention à dire le vrai sur le monde. Les énoncés généraux sur la littérature ne déterminent plus les conditions de toute «bonne» interprétation des textes. Et lorsque des chercheurs se résignent encore à expliciter l’une ou l’autre des composantes qu’ils associent à «la» littérarité, avec une sorte de gêne qui mêle la haine du cliché, la crainte du ridicule et la pudeur d’un strict professionnalisme, c’est le plus souvent en une posture de défense, parce qu’ils s’inquiètent de la perte de légitimité de la critique littéraire, et des effets que ce discrédit pourrait avoir sur le rôle de la littérature dans la socialisation des individus (voir Todorov, 2007; ou Compagnon, 2007). Ils tâchent alors d’argumenter, bon gré mal gré, dans l’arène des idées toutes faites sur la littérature en s’y avançant parfois à titre personnel.
Délesté de cette inquiétude institutionnelle ou civique, toutefois, le statut problématique de «la» littérature offre des avantages intellectuels indéniables. Au moment même où les anthropologues se demandent ce que désigne au juste cette humanité que leur discipline s’est donnée comme objet pendant deux siècles et demi (voir p. ex. Saillant et al., 2011), où les sociologues s’interrogent sur «la» société à partir des innombrables liens qui attachent les individus les uns aux autres et diversifient leurs différents régimes d’action et d’attachement (voir Dubet et Martucelli, 1998; Lahire, 1998; Thévenot, 2006), et que les historiens, préoccupés du fétichisme mémoriel ambiant, questionnent la nature «du» passé (voir Revel, 2000; Hartog, 2003), il n’est guère étonnant de voir les études littéraires renoncer à l’unité a priori de leur objet commun. L’anthropologie, la sociologie et l’histoire ont renouvelé leurs questionnaires disciplinaires d’une façon qui les a rendues plus attentives à la diversité et aux discontinuités des collectivités humaines, et plus aptes à éclairer notre présent dans ce qu’il recèle de tensions raciales, communautaires et sociales.
Les études littéraires ont perdu ce repère commode d’une définition indiscutable de la littérature («ostranenie», autotélicité, modélisation seconde, etc.), certes, mais elles ont également enrichi leur propre questionnaire: si l’on ne peut plus distinguer aisément un roman d’un film, un texte d’un livre, une création imaginaire d’un témoignage, c’est peut-être en partie parce que la vraie vie de la littérature est ailleurs que dans les textes et les discours (voir Schechner, 2002; Barras et Eigenmann, 2006; Rosenthal et Ruffel, 2010) — dans les investissements émotionnels, les performances ou le partage des expériences. Et cette multiplication des foyers possibles de littérarité réclame de nouveaux outils d’analyse et d’interprétation.
Bref, on ne définit jamais «la» littérature en dévoilant son essence, mais dans l’intention d’en favoriser certains usages — qui varient grandement selon les groupes, les lieux et les périodes. Cet axiome résume une grande partie des études littéraires actuelles, dans leur rapport commun à «leur» objet 4. Mais cet axiome, parce qu’il modifie l’autorité des assertions produites dans les études littéraires, n’est pas sans incidence sur l’enseignement de la littérature.
1.2. Transposition des savoirs et idéaux éducatifs
L’enseignement, réévalué à cette aune, ne dispense pas à des profanes l’essence de la littérature dévoilée par la recherche. Il réarticule, dans des cadres institutionnels de formation, une partie des notions, des méthodes et des résultats produits dans d’autres cadres, à partir d’usages non scolaires: ceux de la recherche académique principalement — mais pas exclusivement, puisqu’un savoir sur le théâtre ou la littérature contemporaine peut s’acquérir au contact de metteurs en scène, d’éditeurs, de traducteurs ou d’écrivains vivants. Les savoirs de référence que mobilise l’enseignement de la littérature sont issus de lieux multiples.
On comprendra mieux l’intérêt des remarques précédentes, si l’on songe aux exigences que doit satisfaire, pour être réussie, une telle transposition didactique. Les pratiques sociales — et leurs savoirs de référence — ne peuvent d’abord prétendre nourrir des apprentissages que si leurs modélisations tiennent compte des contraintes d’une situation scolaire donnée: les règlements en vigueur, les ressources d’enseignement disponibles, les types d’évaluation, le bagage des élèves ou les habitudes héritées par les enseignants de leur parcours antérieur. Sans ce calibrage minutieux, les meilleures intentions restent au seuil des classes.
Par ailleurs, un plan d’études ou un enseignement transpose des pratiques sociales existantes en fonction des effets escomptés de leurs savoirs de référence sur les élèves et les étudiants qui se les approprient. On emprunte des notions, des méthodes, des procédés à des manières de penser ou de pratiquer la littérature qu’on estime propices à la transmission de certains idéaux éducatifs. Et ces idéaux varient: que doit développer chez les apprenants la fréquentation des œuvres littéraires orientée par des enseignants? En vue de les préparer à penser et à agir dans quels contextes sociaux? Et en quelle qualité? Tout enseignement engage une idée — même vague, même tacite — de ce que doit apporter aux élèves ou aux étudiants une fréquentation accompagnée de la littérature.
La didactique de la littérature est familière de ces exigences de la transposition, qu’elle pense et décrit depuis une vingtaine d’années (voir note 1). Mais elle s’intéresse souvent davantage aux contraintes qui pèsent sur l’implantation des savoirs de référence dans les classes et aux «gestes» qui les rendent enseignables (dans tel pays, à tel degré de scolarité), qu’aux idéaux qui guident le choix et l’adaptation de tels de ces savoirs de référence dans les programmes et les enseignements. Il s’agira par exemple d’y étudier les opérations qui ont permis de transformer Figures III de Gérard Genette en un kit clé en main de notions opératoires (narrateur, récit, voix, etc.), ou les obstacles que pose l’apprentissage de la focalisation ou de l’itératif. Mais le questionnement didactique n’incitera guère à interroger les vertus que l’on a pu prêter, dans les années 1980, à l’importation dans les classes de cette conception-là — plutôt qu’une autre — de la littérature dans l’enseignement secondaire 5.
La rationalité généralement privilégiée par la didactique se veut axiologiquement neutre: on observe, on constate, on compare, on infère; et lorsqu’on préconise, c’est dans le cadre tacite d’un accord sur des valeurs très générales prises comme allant de soi dans toute société démocratique digne de ce nom (tolérance, «sens critique», connaissance de soi, etc.). Ce consensus a deux conséquences. Comme les valeurs aujourd’hui attachées à l’enseignement semblent trop évidentes pour être discutées, leur étude ne se justifie qu’au sujet du passé, et elle incombe à l’histoire de l’éducation. D’autre part, la didactique de la littérature, de crainte de devenir normative, ne soumet pas à la discussion argumentée les valeurs implicites qui portent ses descriptions et ses propositions d’ingénierie 6. Or, il est à parier qu’un examen réflexif de ses valeurs cardinales, loin de mettre à mal son «objectivité» scientifique 7, relancerait certaines de ses questions de recherche: s’il s’agit d’encourager la «tolérance» à l’école, les instructions officielles, les méthodes, les ressources et les pratiques d’enseignement, en matière de littérature, y participent-elles toutes au même titre? Lorsqu’on défend l’idée que les élèves doivent débattre d’un texte littéraire dans le respect de leurs camarades, prend-on la peine de spécifier cette notion de respect, sa pertinence scolaire et, surtout, les déclinaisons peut-être diverses qu’elle peut prendre chez les enseignants? De même pour le «sens critique»: a-t-on fait l’inventaire précis de ses acceptions multiples dans les directives officielles et les discours des enseignants? On s’apercevrait en effet que l’expression recouvre un spectre très large d’opérations cognitives et de jugements, soit: évaluer le degré de validité d’une règle générale lorsqu’elle doit être appliquée sur un cas particulier, ou assigner un énoncé à son énonciateur (même implicite), ou repérer les incohérences d’un discours, ou se prémunir des mécanismes irrationnels de la persuasion, etc. Sans même compter les sens qu’y mettent eux-mêmes les didacticiens — et les chercheurs en études littéraires.
1.3. Usages scolaires des textes et conduites de vie
Pour revenir à l’exemple de Genette, on peut ainsi se demander pourquoi ce sont ses travaux à lui qui ont suscité, et suscitent encore, un tel engouement scolaire, plutôt que ceux de Paul Bénichou ou de Pierre Barbéris. Ou, dans le cadre plus restreint des théoriciens formalistes de l’époque, pourquoi Genette, et non Jean Ricardou? Ou encore, dans l’œuvre même de Genette, pourquoi Figures III au lieu de Fiction et diction? Pourquoi avoir fétichisé de la sorte, dans l’enseignement, la distinction entre auteur et narrateur? Autrement dit, quelles vertus, non pas seulement intellectuelles ou cognitives, mais éducatives — ou, plus exactement, éthiques — a-t-on pensé cultiver chez les élèves à travers ce rapport spécifique aux textes?
Éthique, le mot est lâché. Et il fâche souvent, au nom de la rationalité axiologiquement neutre. Se soucier d’éthique, pense-t-on, c’est toujours un peu vouloir faire la morale. Et je ne nierai pas que ce soupçon est parfois fondé. Mais la dimension «éthique» des pratiques sociales — ici d’enseignement — peut être décrite et pensée avec la rigueur que l’on réserve à des faits jugés sans lien avec les valeurs. Il suffit d’en retenir une définition adéquate.
Je propose, dans le sillage de Max Weber, de qualifier d’éthiques ces dispositions qu’on espère faire acquérir à l’élève ou à l’étudiant au contact de la littérature, mais qui n’ont pas pour autant trait uniquement à la compréhension ou à l’utilisation judicieuse de catégories de description ou d’interprétation. Il serait possible de les assimiler à un «savoir-être», à des «aptitudes» ou à des «attitudes», si ces termes très prisés n’étaient pas le plus souvent rapportés à des «compétences» vagues sans lien avec l’objet d’enseignement. Le «sens critique», pour reprendre cet exemple, se décline ainsi dans certains programmes en une «faculté de discernement» et une «indépendance de jugement», sans pour autant que soit précisée la spécificité de ce «discernement» et de cette «indépendance» dans le cas d’une analyse d’un conte de La Fontaine ou de Madame Bovary, ni par contraste avec le «sens critique» impliqué dans l’enseignement de l’histoire (David et Graber, 2013).
Weber a montré, dans les travaux qu’il a consacrés aux éthiques religieuses et, plus encore, aux «affinités» (c’était l’un de ses termes) entre ces éthiques et certaines formes de discipline des activités sociales (dans le domaine économique, notamment), comment sa sociologie compréhensive s’emparait de l’éthique et de la discipline de l’enseignement. Dans Confucianisme et taoïsme (2000), on trouve des pages très éclairantes sur les examens des lettrés chinois à partir des «classiques» de la littérature qui brossent à grands traits ce que serait une histoire comparée des éthiques pédagogiques:
[L]a pédagogie de façonnement (Kultivationspädagogik) vise à éduquer un «homme de culture» (Kulturmensch), différent selon l’idéal de culture de la couche déterminante; cela veut dire ici: un homme qui ait une conduite de vie intérieur et extérieure déterminée. Cela peut aussi, dans le principe, être entrepris avec tout le monde; seul diffère l’objectif. Si une couche de guerriers constituée en corps séparé — comme au Japon — représente le corps déterminant, l’éducation cherchera à faire de l’élève, même si c’est dans une grande variété de formes concrètes, un chevalier de style courtisan [qui n’a, à l’instar du samouraï japonais, que mépris pour les écrivailleries]. S’il s’agit d’une couche sacerdotale, l’objectif sera la formation d’un scribe, voire d’un intellectuel, avec, là encore, une grande variété dans les conformations concrètes. Les combinaisons et les chaînons intermédiaires sont nombreux — en réalité, on ne trouve jamais aucun de ces types à l’état pur; il est impossible de les évoquer dans le contexte présent. Ce qui nous importe ici, c’est la position que l’éducation chinoise occupe parmi ces formes. [La qualification par les examens littéraires y] constituait une qualification «culturelle», au sens d’une formation générale, à l’instar par exemple, mais en plus spécifique, de la qualification occidentale traditionnelle établie par une formation humaniste, laquelle procurait chez nous, et d’une façon quasi exclusive jusque récemment, l’accès à la carrière dans les fonctions qui étaient dotées d’un pouvoir de commandement dans l’administration civile et militaire; une qualification qui, dans le même temps, conférait aux élèves qui devaient suivre cette formation la marque de leur appartenance sociale au corps des «hommes cultivés» (Gebildeten). Simplement, chez nous [— et c’est là une différence très importante entre la Chine et l’Occident —], le dressage spécialisé et rationnel est venu compléter et, en partie, remplacer cette qualification culturelle correspondant à une statut social. (p. 176-178)
Ce qu’il s’agit d’éclairer, selon Weber, ce sont les conduites de vie (Lebensführungen) auxquelles incitent les enseignements (religieux ou laïques). L’idéal éducatif n’est pas une utopie abstraite, mais une force active de subjectivation des croyants ou des apprenants. La conduite de vie est en effet intérieure et extérieure. Elle oriente le souci de soi, le lien à autrui et l’ancrage dans le monde. Elle engage également une disposition d’esprit et des qualités éthiques: soit une propension déterminée à une certaine gamme d’aptitudes intellectuelles, ainsi qu’un ensemble de valeurs guidant l’expérience de la vie intérieure, la sociabilité et l’action. Elle est enfin sociale en un double sens au moins: parce que son acquisition est instituée par des apprentissages et des évaluations (ici, des examens, ailleurs des rites), et parce que son exercice reconnu donne accès à un statut privilégié, au statut reconnu de membre valorisé d’une collectivité.
Dans le cas de l’enseignement de la littérature qui nous retient ici, cela ouvre à la didactique la possibilité de penser ensemble, à partir des pratiques mêmes, les opérations qui constituent les textes littéraires en objets d’un savoir évaluable — soit ce que devient la littérature, lorsqu’elle est enseignée — et les valeurs qui président à l’encouragement de ces opérations-là d’analyse et d’interprétation — des valeurs non pas morales, au sens normatif, mais sociales, c’est-à-dire passibles d’une description sociologique.
S’il ne s’agit plus d’interroger les façons dont on enseigne «la» littérature, alors le questionnement se modifie: quels usages des textes dits littéraires favorise-t-on dans l’enseignement? Et à quelles conduites de vie associe-t-on l’acquisition scolaire de ces usages? Comment, en somme, justifie-t-on la fréquentation par les élèves de corpus déclarés littéraires?
2. Justifications passées
2.1. Un dialogue contemporain nourri de repères historiques
Le gain est double, me semble-t-il. Au lieu de distinguer trop nettement dans le processus même de transposition didactique le «savoir savant» et le «savoir enseigné», comme les appelait jadis Yves Chevallard, cette approche ouvre d’abord la description d’un espace indissociablement scolaire et savant des justifications de l’étude de la littérature, où des échanges se produisent qui ne touchent pas seulement aux savoirs, mais aux éthiques, et qui en outre ne vont pas seulement dans le sens descendant de l’université vers l’école: on prend alors la pleine mesure de ce fait apparemment anodin que des conceptualisations savantes de la littérature sont nées pour répondre à un souci pédagogique, comme en témoignent par exemple les cas de Gustave Lanson (1909) au tournant du XXe siècle (voir Jey, 2004) ou, un siècle plus tard, de David Damrosch (2003, 2009) pour la «littérature mondiale» dans les «colleges» nord-américains.
Cette question commune des conduites de vie circonscrit un véritable espace de dialogue entre les littéraires, les chercheurs en didactique et les enseignants. Elle prélude à la coopération, selon moi souhaitable, entre théoriciens de la littérature et spécialistes de la didactique, aussi bien qu’entre chercheurs et enseignants du primaire, du secondaire et des universités.
Si l’on se lance en outre dans une histoire des conduites de vie associées à l’étude de la littérature, les débats contemporains sur la «crise» de la littérature — ou de son étude, ou de son enseignement — prennent tout à coup sens dans le temps long des justifications de l’étude de textes littéraires à l’école et à l’université. Lorsque j’ai cherché à comprendre la spécificité de la «crise» actuelle, en remontant à certaines des «crises» antérieures de même ampleur en Europe francophone, j’ai en effet été frappé par le retour à intervalles réguliers (années 1820, 1880, 1910, 1960, 2000) d’inquiétudes, d’arguments et d’objections très proches. Il semble qu’un certain rapport pédagogique à la littérature se soit cristallisé au début du XIXe siècle, dont nous retrouvons encore les traces dans les controverses d’aujourd’hui.
Devant cette impression de «déjà-vu» qui m’a notamment saisi en lisant la Chrestomathie d’Alexandre Vinet, publiée en 1829, j’ai tâché de comprendre ce qui avait pu ne pas changer durant deux siècles, ou ne pas changer assez pour que se dessine ainsi un espace logique stabilisé de réflexions francophones sur l’enseignement de la littérature. Plusieurs traits me sont apparus, d’ordres très divers, mais dont la prégnance durable, en tel ou tel lieu de réflexion ou de décision, a pu contenir l’émiettement des enjeux tout autant que le surgissement de conceptions nouvelles. Je les livre ici comme autant de pistes à suivre dans une telle enquête, et non à titre de constats péremptoires.
Le premier trait concerne d’abord les études littéraires. Dans le sillage du pré-romantisme allemand, une certaine idée de la littérature s’est imposée en Europe dont les critiques se sont faits les relais, puis les ardents défenseurs: le travail artistique sur la forme a été assimilé à la problématisation d’une expérience (singulière, mais potentiellement collective); et le travail littéraire sur les formes a été considéré comme la forme suprême de la remise en cause, dans le langage, de tout ordre établi — que cet ordre se nourrisse d’évidences, de préjugés, d’«idées reçues», d’expressions toutes faites, de bêtise, de clichés, d’habitudes, d’idéologie, de domination inconsciemment consentie, etc. L’attention portée aux formes est devenue riche d’une prometteuse lucidité des lecteurs sur eux-mêmes, indissociable d’une certaine éthique éducative (dans le sillage de la notion allemande de Bildung, précisément).
Le deuxième trait semble à première vue plus anecdotique, mais il est crucial. Au début du XIXe siècle, on ne propose plus seulement de lire en classe Euripide et Cicéron, Racine et La Fontaine, mais Chateaubriand, Hugo, Lamartine. L’objet enseigné sous le nom de «littérature» touche à la langue française, mais également au présent historique que partagent les élèves, les enseignants et les écrivains. Le modèle d’expression rhétorique des textes «classiques» — i.e. qui entrent en classe — n’est plus situé dans un âge d’or passé: on enseigne la correction, sinon la beauté, dans le cadre de la langue effectivement parlée hors de l’école, dans des cercles très restreints certes, mais contemporains; et on donne aux élèves le nouvel horizon d’une langue en constante évolution, où il s’agit de s’inscrire à son tour. L’attention portée aux formes langagières — en l’occurrence, le choix du vocabulaire, l’élégance syntaxique, la précision grammaticale, etc. — repose sur une admiration aux critères infléchis, une admiration qui confie aux écrivains la tâche infinie d’élever la langue au-dessus de ses usages communs. L’école se souciera désormais aussi du «style» des écrivains vivants.
Le dernier trait n’est pas spécifique à l’enseignement de la littérature. Il suppose en effet d’articuler les éthiques éducatives engagées dans le rapport scolaire à la littérature à des orientations plus massives des politiques éducatives européennes. Depuis deux siècles, les débats sur l’école s’organisent autour d’une tension régulièrement ravivée entre deux ambitions divergentes: soit l’éducation libérale ou humaniste contre l’éducation réaliste; la culture contre la spécialité; le désintéressement contre l’utilité; la Bildung contre la compétence; la citoyenneté contre le marché; et, au plan académique, l’idéal de l’université de Berlin, fondée en 1810, contre les conventions de Bologne et l’Espace européen de l’enseignement supérieur de 2010. Quand l’équilibre se fait autour de l’utilité, de la spécialisation et de la professionnalisation de la formation, l’autre pôle entre en «crise» et l’enseignement de la littérature — qui en est venu à exemplifier presque à lui seul la culture et la Bildung dans les établissements secondaires — suscite une effervescence de prises de position défensives (voir p.ex. Jey, 1998 et 2000 pour les années 1880-1925; Houdart-Merot, 1998; Chervel, 2006). Nous en sommes là depuis 2000. Il y a sans doute des leçons à tirer de ce mouvement de balancier: un certain calme, d’abord 8, de la patience, et l’ambition peut-être de transformer enfin le référentiel dans lequel on pense depuis deux siècles l’enseignement de la littérature.
En attendant (car il y faut de la patience, je l’ai dit), je reviendrai pour finir sur plusieurs justifications passées de l’enseignement de la littérature. Leur inventaire n’est ni exhaustif, ni définitif, mais significatif 9. J’exemplifierai chacune de ces conduites de vie d’un extrait de texte exemplaire, instructif par sa densité et sa concision, que j’ai glané au cours de mes enquêtes dans les règlements, les manuels, les travaux de didactique ou les études littéraires. Un programme de recherche collectif pourrait seul épuiser la gamme des exemples possibles aussi bien en France, en Suisse ou en Belgique, qu’au Canada, au Maroc, au Sénégal ou au Cambodge. Les échantillons qui suivent ne prétendent même pas ouvrir un tel chapitre de l’histoire globale de l’éducation; ils articulent tout au plus un faisceau prometteur d’interrogations. J’ajouterai enfin, pour donner la mesure de ce qu’il reste à faire, que je me suis concentré sur les seules assertions les plus générales: il manque donc à mes analyses l’examen des corpus scolaires et des activités proposées.
Ce parcours suffira néanmoins, je l’espère, à mettre en relief les trois dimensions que j’ai suggérées: la pertinence d’une histoire des éthiques éducatives en matière de littérature; la troublante affinité des justifications passées et présentes de certains rapports aux textes dits littéraires; l’incitation à penser aujourd’hui nos pratiques de chercheurs et d’enseignants dans le prolongement — ou en rupture — des deux siècles passés.
2.2. L’argument rhétorique
Alexandre Vinet publie à Lausanne, en 1829, une Chrestomathie française, ou choix et morceaux des meilleurs écrivains français. Théologien, homme politique et historien de la littérature, il place sa réflexion sur l’enseignement de la littérature à la croisée d’une visée morale de l’éducation, d’une ambition progressiste de l’école et d’une attention patiente aux textes. La Chrestomathie était initialement destinée aux élèves germanophones de ses classes de français, à Bâle, mais elle est très vite devenue une ressource pour l’apprentissage de la «langue maternelle», selon le terme affectionné par Vinet, dans plusieurs cantons suisses de langue française. Surtout, son auteur a conçu cette Chrestomathie dans le cadre du dialogue qu’il entretenait avec certains écrivains et critiques parisiens, comme Sainte-Beuve, si bien que l’on peut tenir ce manuel pour l’un des développements pédagogiques possibles des débats littéraires qui avaient cours en France durant la première moitié du XIXe siècle. L’ancrage local de la réflexion, on le voit, est donc à nuancer.
Dans sa préface, Vinet énonce d’emblée la polarisation de l’éducation qui menace à ses yeux de porter préjudice à l’enseignement de la littérature:
Si les institutions qu’on nous promet oublient que l’école est un établissement de culture et non d’apprentissage; qu’on y vient encore moins apprendre que s’exercer à apprendre; que l’école, aussi longtemps qu’elle n’est pas strictement spéciale, doit avoir en première vue la culture de l’élément humain et social; que ce qu’elle doit rendre à la société et à Dieu, c’est avant tout des hommes; que l’éducation de l’esprit et du cœur doit être le premier objet de tout système d’études; si ces institutions, au contraire, ne montrent qu’un esprit étroitement pratique, avide de résultats matériels, impatient d’applications immédiates, elles n’auront fait que pousser la société vers une nouvelle forme de barbarie. (2e éd., 1833, XVII, je souligne)
Les arguments nous semblent étrangement familiers: les têtes bien faites, plutôt que bien pleines; le plaidoyer contre l’urgence pratique des contenus d’études; ou l’exigence de former des êtres humains, et non des diplômés. La conviction religieuse, par contre, s’écarte quelque peu de nos débats actuels: l’école, pour Vinet, est responsable devant Dieu de ce qu’elle fait des élèves, ce qui signifie qu’elle doit cultiver en eux une forme d’élévation spirituelle (chrétienne, en l’occurrence).
Quel rôle la lecture méticuleuse des œuvres littéraires, dans une anthologie d’extraits choisis, peut-elle assumer à cet égard?
La parole est le grand levier du bien et du mal; la parole, produit de la pensée, réagit sur la pensée; et par elle sur la vie. Il est impossible de calculer les résultats sociaux d’une étude au moyen de laquelle, si elle est bien faite, on ne parlera plus sans savoir ce qu’on dit. («Avertissement» de l’édition de 1844)
La lecture d’extraits contemporains de langue française met les élèves au contact vivant de la langue, dont les écrivains emploient les inflexions les plus récentes avec une justesse qui écarte toute éloquence sophistique et toute fantasmagorie du langage. Plus encore, cette justesse suffit, pour Vinet, à tracer la frontière entre le bien et le mal et, partant, à guider l’action vers la vertu.
La disposition d’esprit évoquée, ici, tient dans cet effort du mot juste, cette relance de la pensée par elle-même dans la proximité attentive d’une langue sans artifice 10. La qualité éthique prend les dehors d’une connaissance morale aiguillée par la littérature. Une telle anthologie prépare ainsi les jeunes lecteurs à une discipline chrétienne de l’expression et à un rapport à autrui dénué de ruses et de persuasion. Il y a, dans le cas de Vinet, de l’austérité protestante dans cet idéal éducatif qui conçoit gravement la littérature comme un art sans jeu, tout entier dédié à des leçons de choses morales. Quant au maître, il prendra garde de bien parler lorsqu’il s’assurera que ses élèves ont compris les tournures et la moralité des extraits.
2.3. L’argument nationaliste
Un demi-siècle plus tard, dans les années 1890, l’enseignement de la littérature nourrit une autre conduite de vie, que Charles Cottier, dans son Histoire de la littérature française, explicite sans ambiguïtés:
Si tout ce qui est digne de provoquer l’exercice de nos facultés intellectuelles, peut faire partie de la littérature, si rien de ce qui est humain ne lui est étranger, on conçoit, pour la culture de l’esprit, la haute importance d’une étude qui porte sur les sujets les plus divers, traités avec l’intelligence de l’élite. L’étude de la littérature d’un peuple n’enrichit pas seulement notre esprit des connaissances les plus variées, elle nous en révèle le génie et le caractère, les qualités et les défauts, les vertus et les faiblesses, les besoins et les aspirations. En effet, le génie d’une nation se réfléchit avec fidélité dans les productions de ses principaux écrivains, à la fois interprètes et éducateurs de la société dont ils font partie, organes et promoteurs des idées qui sommeillent dans son sein, et dont elle n’aurait sans eux qu’une perception confuse. La littérature est le fruit le plus savoureux de l’activité intellectuelle, morale et religieuse d’un peuple; c’est le trésor de ses pensées et de ses aspirations, c’est sa vie même, s’y reflétant dans tous ses aspects et dans toutes ses manifestations. (1896, 2, je souligne)
Cette conduite de vie se cultive par l’intermédiaire d’un enseignement patriotique de la littérature. On y apprend l’humble respect de l’autorité, la saveur particulière du génie national; on s’entraîne, guidé par l’élite, à aiguiser une «perception confuse» de ce que l’on est censé ressentir en tant que compatriote; on s’identifie avec «les qualités et les défauts, les vertus et les faiblesses, les besoins et les aspirations» du peuple auquel l’école nous assimile.
La littérature, comme telle, revêt dans ce dispositif une importance capitale: comme «reflet fidèle» du génie d’un peuple, elle en exemplifie le mieux les traits singuliers; comme «produit savoureux de l’activité intellectuelle, morale et religieuse», elle rend plus aisé que d’autres discours l’accès à ce savoir patriotique. L’enseignement distingue une élite qui interprète et éduque, exprime et diffuse; et un peuple d’abord informe qui se reconnaît des contours, des limites, des frontières dans cette pédagogie littéraire du nationalisme.
2.4. L’argument rationaliste
Mais cet idéal éducatif se trouve concurrencé au début du XXe siècle par une veine plus rationaliste. La littérature n’y est plus un objet dont les leçons doivent être simplement relayées ou amplifiées par l’enseignement. Ce qui importe dès lors, c’est la nature du savoir applicable à des textes littéraires. La conduite de vie est moins indexée sur des œuvres que sur une méthode de lecture et d’interprétation:
Nous voudrions que ce livre fût pour les élèves un secours, sans être une tentation et un danger. Quelques jugements hâtifs retenus qu’ils répéteront sans contrôle, voilà trop souvent le profit qu’ils attendent d’un manuel de littérature. Ils chargent leur mémoire de formules abstraites, parent maladroitement leur style d’une phraséologie critique, et se croient savants parce qu’ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Au fond, ils n’ont dans l’esprit qu’une collection d’étiquettes. Il faut donc, pour les préserver de cette sorte de psittacisme critique et faire d’eux des esprits solides et des lecteurs intelligents, leur offrir avant tout des réalités concrètes. […]
C’est donc un ouvrage d’initiation à la lecture de nos chefs-d’œuvre que nous avons eu le dessein de réaliser, avec l’espoir de former pour les maîtres des auditeurs mieux préparés. Mieux préparés, d’abord, parce qu’ils auraient sous la main tous les renseignements matériels nécessaires et que le professeur pourrait se consacrer librement à sa tâche d’éveilleur d’idées; mieux préparés, ensuite, parce qu’ils n’auraient dans l’esprit rien que de concret, et auraient pris peu à peu, nous l’espérons, l’habitude de la précision, le sentiment que toute idée qui ne repose pas sur un fait est le plus souvent discutable ou fausse, et auraient ainsi commencé tout doucement, en même temps que leur formation littéraire, l'apprentissage de l’esprit scientifique moderne. (Abry et al., 1912, 2-4, je souligne)
Le psittacisme, le bachotage, le bluff et, en filigrane, la propagande éhontée, voilà ce que cherche à éradiquer un tel programme. Cette vigilance à traquer les abstractions vides est une marque d’époque: Lucien Febvre, dans ses Combats pour l’histoire, s’en fera l’athlète infatigable. Mais on la retrouvera aussi chez Erich Auerbach (2005), dans ses considérations sur les «philologues de la littérature mondiale» au début des années 1950 et, plus près de nous, sous la plume de Tzvetan Todorov (2007) dans son ouvrage La littérature en péril. Il ne s’agit pas tant d’un positivisme, qui prétendrait garantir un accès direct au réel, que d’un rationalisme soucieux de fixer dans les habitudes des élèves une procédure universellement valable d’établissement du jugement: appliqué à la littérature, cet «esprit scientifique moderne» transforme le texte en réservoir d’indices et de preuves susceptibles d’«éveiller» à bon escient les idées des jeunes lecteurs. Vinet (1833, IX) disait qu’une «promenade inattentive» à travers les beautés des «classiques» (ici, des «chefs-d’œuvre») ne suffit pas: l’attention doit être aiguisée sur les textes mêmes pour qu’elle prenne le tour d’une conduite de vie. Mais la discipline de la compréhension et de l’interprétation troque désormais une élévation morale pour une autre: non pas la vertu, mais la raison — pour former des citoyens au jugement sûr, et non des croyants agissant selon leur conscience clarifiée.
On le voit, l’ajustement du langage à l’expérience vécue semble être une disposition d’esprit partagée, à éclipse, par des enseignements de la littérature pourtant très éloignés dans leurs propensions éthiques (notamment sur le plan du rapport à la religion). En 1912, cet appel au réel encourage, du point de vue des valeurs et du lien à autrui, l’insertion des élèves dans une communauté d’être rationnels — une communauté dont les idéaux (de plénitude attentionnelle et d’objectivité) tracent une sorte d’intérêt général presque universel à l’horizon de toute conduite de vie individuelle: l’«intelligence», dans le domaine de la littérature comme ailleurs, exclut la distraction, la nonchalance et l’irrespect.
Cette disposition d’esprit face aux textes est encore souvent encouragée dans la microlecture scolaire ou universitaire, mais en lien avec des valeurs quelque peu différentes. L’étude méticuleuse d’un passage est aujourd’hui le gage d’une écoute préalable au jugement: comprendre une fable de La Fontaine dans toute sa complexité avant de l’interpréter, c’est accueillir dans mon acte de lecture l’altérité d’une parole autre, susceptible de bousculer mes attentes. Chaque mot compte, non plus pour apprendre à m’exprimer de façon juste (Vinet), ni même parce que ma rationalité traite de façon rigoureuse l’ensemble des éléments à disposition (Abry et al.), mais parce qu’un «vouloir-dire», plus ou moins entravé par son époque, l’inconscient ou l’écriture (c’est selon), s’y fait entendre dans la moindre de ses options de langage. La conduite de vie à laquelle forme ce rapport à la littérature m’inscrit dans une communauté particulièrement bien disposée à écouter la parole d’autrui, dans tout ce qu’elle peut avoir de nuancé et de fragile. Il s’agit, pour le dire en un mot, d’une éthique démocratique propice au gouvernement par la discussion.
2.5. L’objection libertaire
L’enseignement de la littérature a cependant aussi été considéré comme une contradiction dans les termes: la conduite de vie associée à l’éducation par la littérature a été, une cinquantaine d’années plus tard, jugée incompatible avec la conduite de vie associée au savoir sur la littérature que transmettait précisément l’enseignement. Nous voici au seuil des années 1970. Avec Roland Barthes:
A mon sens, il y a une antinomie profonde et irréductible entre la littérature comme pratique et la littérature comme enseignement. Cette antinomie est grave parce qu’elle se rattache au problème qui est peut-être le plus brûlant aujourd’hui, et qui est le problème de la transmission du savoir; c’est là, sans doute, maintenant, le problème fondamental de l’aliénation, car, si les grandes structures de l’aliénation économique ont été à peu près mises au jour, les structures de l’aliénation du savoir ne l’ont pas été; je crois que, sur ce plan, un appareil conceptuel politique ne suffirait pas et qu’il y faut précisément un appareil d’analyse psychanalytique. C’est donc cela qu’il faut travailler, et cela aura ensuite des répercussions sur la littérature et ce qu’on peut en faire dans un enseignement, à supposer que la littérature puisse subsister dans un enseignement, qu’elle soit compatible avec l’enseignement. (2002a, p. 945, je souligne)
Et, quelques années plus tard, dans un entretien (2002b):
[I]l faut affirmer, en face d’un non-savoir, un savoir du texte: le «savoir du symbolique», à définir comme le savoir psychanalytique ou, mieux, comme la science du déplacement, au sens freudien du terme. Il est évident que le «savoir du symbolique» ne peut être positiviste, puisqu’il est lui-même pris dans l’énonciation de ce savoir. […] Il faut enseigner le doute lié à la jouissance, non le scepticisme. […] La visée ultime reste de faire frissonner la différence, le pluriel au sens nietzschéen, sans jamais faire sombrer le pluriel dans un simple libéralisme, bien que cela soit préférable au dogmatisme. Il faut poser les rapports du sens au «naturel» et ébranler ce «naturel», asséné aux classes sociales par le pouvoir et la culture de masse. (p. 886)
Dans ces lignes, on entend poindre — avec l’oreille interne de nos disciplines, pour ainsi dire — l’avènement de l’intertextualité, de l’illusion référentielle, de la mise en abyme ou de la puissance critique (ou ironique ou démystificatrice) des textes, comme postulats des études littéraires, puis de l’enseignement de la littérature durant deux décennies au moins. Toutefois, cette angoisse de l’aliénation et cette confiance dans la psychanalyse ne sont, je crois, plus aussi communément partagées qu’elles ne l’étaient autrefois parmi les chercheurs et les enseignants.
L’objection de Barthes, qu’il tempère dans la suite de son article de 1971 11, mais qui sera prise à la lettre par maints commentateurs (ce qui explique l’exemplarité que je lui confère), consiste à affirmer l’antagonisme du savoir du texte et du savoir scolaire. La littérature n’est pas un objet stabilisé par une institution et ses savoirs, mais une force de déstabilisation des catégories sur lesquelles l’enseignement prétendrait appuyer son autorité et son opération. La «littérature comme pratique» déplace les rapports (des enseignants à leurs élèves, de la lecture à l’écriture, du civique au politique) qui fondent la «littérature comme enseignement».
Une conduite de vie s’épanouit ici en dehors des institutions, qui s’arme d’une «science du déplacement» néanmoins enseignable: «Il faut enseigner le doute lié à la jouissance», dit Barthes, c’est-à-dire l’implosion dionysiaque brouillant les attributions. Et cet enseignement (où donc: à l’EHESS, au Collège de France, dans les revues, au théâtre brechtien?) commence par interroger l’enseignabilité même de la littérature.
La disposition d’esprit qui la caractérise concentre l’attention critique sur «l’énonciation» du savoir et donc, dans le cas de l’enseignement, sur la scénographie qui transforme des textes en objets susceptibles d’être transmis par une autorité quelconque. Une telle réflexivité suspicieuse cherche à parer les pièges de l’aliénation culturelle et symbolique, en activant le pluriel intrinsèque à la «littérature comme pratique». L’éthique de la résistance aux préjugés, aux idées reçues, à l’idéologie, se détache sur fond d’émancipation individuelle et de lutte des classes.
Les liens qu’institue cette conduite de vie ont ainsi un statut ambivalent: ce sont ceux d’un lecteur désireux de s’analyser lui-même avec un texte sans auteur, dont l’écriture suscite chez lui quelque chose comme un transfert, voire un contre-transfert, et contribue à le désaliéner de toute idéologie, et peut-être de tout lieu commun; mais ce sont aussi les liens, si valorisés à l’époque, des classes dominées dont on attend impatiemment une révolution. Pour sortir de la masse et assumer sa classe (sociale), pour se «désaliéner», il faut donc en passer par un chemin tortueux — au risque de se «désaliéner» du savoir qui identifie les classes sociales, dans une sorte de halte prolongée du critique que même le sens commun du prolétariat révolutionnaire ne satisferait plus.
Autrement dit, il y a, à l’horizon de cette disposition d’esprit face aux textes, deux subjectivations distinctes aux statuts très différents: la première prépare à l’inscription lucide de soi dans la lutte des classes, mais elle est davantage rêvée que prescrite; la seconde, immédiatement enclenchée par le «savoir du symbolique», ouvre l’accès à une communauté d’êtres travaillant, par la critique, à libérer leur désir, leur jouissance, leur pluralité intime.
La conduite de vie attachée à un tel rapport libérateur à la littérature devait alors, par l’intermédiaire d’une conversion intime, conduire à une révolution collective; mais son ancrage dans la psychanalyse ne pouvait à l’inverse que favoriser un solipsisme préalable de l’émancipation, qui rendait presque impossible, par la suite, toute affiliation à une classe sociale comme telle, conçue en bloc comme une force stratégique sans différences internes.
La discipline exercée face à la littérature est ici paradoxalement libertaire. Elle précède et annule toute autre forme de discipline: scolaire et bourgeoise, bien sûr, puisque c’est son but, mais aussi politique et prolétarienne, par le ricochet imprévu d’une critique trop intransigeante pour permettre de se reconnaître pareil à autrui, c’est-à-dire moins singulier qu’un patient de la psychanalyse (la révolution supposerait, en toute rigueur, que l’on se couche à plusieurs sur le divan). Le marxisme déclaré se mâtine de blanchotisme: le prolétariat n’y est plus qu’une communauté inavouable.
3. Justifications contemporaines
3.1. L’argument humaniste
Qu’en est-il aujourd’hui?
La plupart des plaidoyers en faveur de l’enseignement de la littérature défendent la contribution des œuvres littéraires à la connaissance de la nature humaine, à l’apprentissage de la tolérance culturelle et à la poursuite de la «vie bonne» (dans une proximité parfois périlleuse aux ouvrages de développement personnel et à la «bibliothérapie»). Appelons cela un humanisme, puisque la communauté dernière qu’ouvre aux élèves la conduite de vie ainsi acquise à l’épreuve de la littérature s’étend à la planète entière et, bien souvent, à l’humanité comme telle. L’enseignement de la littérature prépare à nouer avec autrui des liens cosmopolites, et à les penser comme la condition sociale de notre espèce polymorphe.
Antoine Compagnon, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, a lui-même parlé à propos de sa conception de la littérature d’une «formule humaniste, désormais hors de tout conflit avec la religion et la science» (2007, 64). Quant à Tzvetan Todorov, le lyrisme qu’il privilégie dans La littérature en péril puise dans son enthousiasme face à cette affiliation sans frontières: «Ce que les romans nous donnent est, non un nouveau savoir, mais une nouvelle capacité de communication avec des êtres différents de nous […]. L’horizon ultime de cette expérience n’est pas la vérité mais l’amour, forme suprême du rapport humain» (2007, 77). Un humanisme à la française, faudrait-il préciser, dont la figure tutélaire serait Montaigne.
Aussi la disposition d’esprit dominante s’illustre-t-elle au mieux dans la capacité à se décentrer pour se mettre à la place d’autrui, dans une attitude d’empathie ou d’identification (voir Nussbaum, 2015). La littérature l’entraîne, parce qu’elle regorge de personnages fictionnels dont elle nous propose la compagnie (comme le défendait jadis Wayne C. Booth, en 1988) — ou d’affects inconnus dont elle nous suggère l’expérience. Les qualités éthiques en découlent: compréhension respectueuse des croyances d’autrui, tolérance.
Cet humanisme présente des accents divers: Yves Citton (2007) défend un humanisme critique, en ce sens que l’enseignement de la littérature lui paraît être un lieu où l’on peut tirer parti du polymorphisme radical de l’humanité — en imaginant collectivement des formes de vie alternatives ou inédites; Gérard Langlade (2001), du côté de la didactique, prône un humanisme multiculturel, si j’ose dire, où le rapport à la littérature développe l’aptitude des individus à évoluer dans des jeux de langage multiples et donc à s’intégrer dans des contextes sociaux très variés; Jean-Marie Schaeffer (1989), enfin, soutient que la littérature, entendue comme fiction, exploite et raffine des compétences mentales et interactionnelles propres à notre espèce (la simulation et la feintise ludique), inscrivant sa perspective dans un humanisme dynamique.
3.2. Un humanisme outillé par un anti-humanisme
Mais cette convergence contemporaine n’est pas sans soulever des difficultés. La plus redoutable peut-être découle de la tension, sensible actuellement dans les pratiques d’enseignement de la littérature — tant au niveau du secondaire que des hautes écoles et des universités —, entre ces aspirations humanistes et un outillage notionnel hérité de l’anti-humanisme des théories critiques des années 1960-1980 (auquel l’humanisme actuel réagit à tout le moins dans ses professions de foi). On apprend encore, dans les classes et les amphithéâtres, à distinguer l’auteur du narrateur, à repérer les champs lexicaux et les isotopies, à se méfier de l’illusion référentielle ou à privilégier la lucidité de la relecture sur la naïveté de la première lecture — tout en déclarant miser sur le plaisir de lire, la participation subjective, le partage des impressions de lecture et la valorisation de l’immersion fictionnelle.
Nombre de notions que nous utilisons aujourd’hui dans l’enseignement étaient jadis au service d’une autre conduite de vie associée à l’étude de la littérature. Nous mobilisons, à d’autres fins éducatives, des procédures interprétatives chargées de psychanalyse freudienne ou lacanienne ou de marxisme althussérien — bref, de l’espoir de voir advenir une révolution au moins culturelle. Certes, en mettant en sourdine leur dimension critique ou politique, nous sommes parvenus à les rendre transmissibles par une autorité enseignante; mais cette édulcoration ne les rend pas pour autant disponibles pour l’apprentissage d’autres dispositions d’esprit et d’autres qualités éthiques.
La transposition didactique des thèses de Picard sur la «lecture littéraire» en fournit un exemple éloquent. Dans un article publié voici quarante ans, Picard s’interrogeait sur les contenus d’enseignement: «comment continuer à accepter que la psychanalyse, la linguistique, le matérialisme dialectique et historique ne constituent pas les bases de la culture générale?» (1977, 48). Car la conduite de vie favorisée par la «lecture littéraire» était, selon lui, de dresser tout lecteur contre les «travestissements» de sa propre culture, contre la reproduction de l’ordre bourgeois encapsulée dans un rapport mystificateur à des textes littéraires le plus souvent eux aussi mystificateurs — à l’exception des rares spécimens de la modernité que Picard regroupait en un canon fréquentable:
La lecture aurait ainsi pour fonction en effet de procurer au sujet lisant «une épreuve de réalité» d’un type particulier, une expérience de socialisation privilégiée. La mise en crise du langage par le texte s’accompagnerait d’une mise en crise du sujet déterminé, interpellé, par l’idéologie dans le lecteur. La contradiction, produite par le procès de lecture et de production du sens lui-même, rendrait antagoniques les couples sujet assujetti («sujet» du Pouvoir) / sujet actif (sujet du verbe), immobilité / mouvement, consommateur / producteur, méconnaissance / connaissance, conservatisme / révolution. Le dépassement, toujours à recommencer, de ces contradictions, fournit le citoyen. (1977, 49)
Jean-Louis Dufays, avec le succès que l’on sait, a le plus activement contribué à transposer la théorie de Picard en une méthode de lecture à destination de l’enseignement. Il a lui-même précisé qu’il s’était «inspiré librement de son modèle théorique pour développer une conception cohérente de la didactique de la littérature» (2002, § 23). Il en a conservé notamment le postulat d’une distinction entre deux types de lecture caractérisées chacune par un rapport différent aux valeurs charriées par le texte:
[I]l s’agit de prendre au sérieux l’idée forte de Picard selon laquelle toute lecture est plurielle, et de penser la relation entre lecture «ordinaire» et «lecture littéraire» sur le mode du continuum plutôt que de la rupture: on admettra alors que toute lecture s’avère s’avère plus ou moins «ordinaire» et plus ou moins «littéraire» selon l’intensité avec laquelle elle met en tension des postures axiologiques opposées.
[…] Cette définition se doit d’aller de pair avec une pratique d’enseignement elle-même dialectique, axée sur différentes activités complémentaires, les unes relevant de la participation, les autres privilégiant la distanciation (réflexion sur le fait littéraire, transmission de connaissances littéraires utiles, développement de compétences interprétatives). (2002, § 35-36, je souligne)
Là où Picard faisait de la «lecture littéraire» une rupture salutaire vis-à-vis de la lecture spontanée, qu’il jugeait compromise idéologiquement, Dufays rétablit un «continuum». L’idéologie, même, n’existe plus dans la didactique que sous la forme de «valeurs» dont l’opposition n’est plus politique, mais méthodologique: la littérature, par définition, problématise l’ordre axiologique, si bien que l’accès à la dimension littéraire passe par la reconnaissance de cette tension esthétique constitutive entre des systèmes de croyances incompatibles.
L’outillage didactique hérite d’une conception intrinsèquement clivée de la culture, mais neutralise la hiérarchisation que dessinait Picard entre de «bonnes» et de «mauvaises» valeurs. La littérature éclaire dans ses formes propres les contradictions de toute communauté humaine, mais la «lecture littéraire» n’œuvre plus à la résolution de ces contradictions. La «distanciation» n’est plus un levier d’émancipation, c’est une compétence avant tout cognitive (repérer les formes) — dont les prolongements éthiques en une conduite de vie spécifique demeurent à clarifier:
Pour conclure provisoirement cette réflexion, nous voudrions souligner le fait que, dans la mesure où il veille à se situer constamment sur le double registre du game et du playing, de la participation et de la distanciation, l’enseignement de la lecture comporte un enjeu qui domine tous les autres: celui de développer chez l’homme la faculté de jouer. Comme le dit Picard: «Ce qu’on pourrait attendre d’une nouvelle pédagogie de la lecture, c’est avant tout la reconnaissance de son enjeu. On sublime ou on refoule: c’est le jeu (l’art) ou la névrose. Non seulement, par référence au jeu et à ses fonctions littéralement vitales, on aura la possibilité de donner une base solide à tant d’affirmations intuitives ou convenues concernant l’utilité et les bienfaits de la lecture, mais on écartera résolument toutes les fausses justifications moralisantes ou métaphysiques et, du même coup, le terrorisme simplificateur de la «distinction», qui en est parfois moins la dénonciation que l’envers.»
Ces déclarations situent bien l’esprit dans lequel seront présentées les propositions qui vont suivre: la lecture dont nous voudrions promouvoir l’enseignement n’est pas la maîtrise d’une culture de classe réservée aux élites, ni l’acquisition d’un savoir de type utilitaire, ni l’initiation à nous ne savons quelle conception étriquée de la vérité du texte;la lecture dont nous voudrions promouvoir l’enseignement n’est pas la maîtrise d’une culture de classe réservée aux élites, ni l’acquisition d’un savoir de type utilitaire, ni l’initiation à nous ne savons quelle conception étriquée de la vérité du texte; il s’agit bien plutôt d’un jeu, d’une «activité transitionnelle d’expérimentation simulée», qui se trouve aussi être un «art de faire» émancipateur (de Certeau) et la voie d’accès privilégiée à cette sapientia, à la fois savoir, sagesse et saveur, dont Roland Barthes faisait l’objet ultime de sa recherche. (Dufays et al., 2005, 161-162)
On aurait pu imaginer que la «lecture littéraire», ainsi proposée à l’enseignement, viserait à favoriser l’insertion des élèves dans une société multiculturelle dont ils auraient, tôt ou tard, à gérer les dilemmes moraux dans leur expérience la plus intime 12. Il s’agit pourtant d’autre chose. La conduite de vie à laquelle prépare la «lecture littéraire», dans ce cas, est celle d’un individu se jouant des différents systèmes de valeurs dans une distance au monde social qui est celle du sage contemplant avec gourmandise et mansuétude la diversité des passions humaines. Il reste donc, dans cette transposition de la «lecture littéraire», un héritage des années 1970: celui-là même que l’on trouve chez Barthes, si l’on arrête Picard sur le chemin de l’émancipation marxiste à ce moment d’apesanteur sociale où le critique ne se reconnaît plus dans aucune idéologie — où, libéré de toutes ses illusions (même celles du marxisme), il lévite en pleine béatitude, sur le mode stoïcien de l’ataraxie ou, japonais, du satori zen. L’argument libertaire se mue en argument «liquide» — pour reprendre le terme au sociologue Zygmunt Bauman (2006), lorsqu’il décrit la nouvelle forme qu’ont prise les liens sociaux dans la «seconde modernité»: fragiles, précaires, mouvants, toujours conditionnels.
3.3. Le chantier gigantesque d’un inventaire critique
La question qui se pose alors est à la fois simple, redoutable et difficilement soluble: si l’on ne vise plus à enseigner aux élèves à devenir des citoyens révolutionnaires, souhaite-t-on pour autant leur apprendre aujourd’hui à évoluer sans heurts dans cette «société liquide»? C’est sans doute là notre présent, mais est-ce aussi leur futur?
La gamme des éthiques éducatives passées suggère qu’il a existé plusieurs manières de justifier l’enseignement de la littérature et, plus précisément, l’attention méticuleuse aux textes qu’implique la microlecture. Ces arguments de jadis sont aujourd’hui devenus mineurs, mais ils n’ont pas pour autant disparu de notre horizon. L’argument rhétorique fait son retour dans certains plaidoyers pour l’écriture d’invention ou pour l’enseignement de l’argumentation. L’argument nationaliste affleure parfois lorsqu’il s’agit de promouvoir l’enseignement des littératures régionales. L’argument rationaliste prévaut dans les réflexions sur la dissertation littéraire. Et l’argument libertaire, comme on l’a vu, oriente la réhabilitation d’un certain humanisme du côté d’une «liquidité» des conduites individuelles.
Il y a d’autres pistes possibles. Et leur cartographie supposerait que l’on passe au crible d’une seule et unique interrogation l’ensemble des réflexions contemporaines: dans quelle communauté l’enseignement de la littérature vise-t-il à inscrire les élèves ou les étudiants? Une communauté culturelle de proximité (la région)? La communauté imaginée de la nation? Le cosmopolitisme de la francophonie, de l’Europe, de la mondialisation? Le collectivité humaine envisagée comme une espèce animale ou comme un destin façonnable? C’est un programme de recherche qui gagnerait à devenir collectif.
Quoi qu’il en soit, ces pistes nouvelles exigent que soient explicités sur plusieurs plans à la fois, puis soumis à un inventaire critique, l’ensemble des présupposés du passé. Il ne suffit pas de se réclamer de l’humanisme, quand on ne dispose pas de l’outillage indissociablement conceptuel et opératoire le plus apte à exercer la disposition d’esprit «humaniste» que l’on souhaite faire acquérir aux élèves face aux texte. Inversement, on ne peut manipuler sans scrupule la distinction entre auteur et narrateur, par exemple, quand on comprend qu’elle a visé, pour la Nouvelle Critique, à dissocier radicalement l’interprétation des textes de toute expérience vécue (celle de l’écrivain et celle des lecteurs) ou quand on s’aperçoit, comme Sylvie Patron (2009), qu’il n’y a pas de narrateur dans tous les textes littéraires.
«La» littérature n’existe plus. Et son enseignement nous met désormais devant la responsabilité impérieuse de clarifier les usages et les conduites de vie qui lui sont associées dans les classes, les règlements ou les institutions de formation (voir De Beaudrop, 2004; Aeby Daghé, 2010; Emery-Bruneau, 2014), les amphithéâtres, les colloques et les publications savantes, voire même chez les écrivains eux-mêmes, en vue d’entamer un débat de fond sur les justifications encore recevables de l’étude scolaire des textes jugés littéraires. La raison n’en est pas tant de répondre à des attaques — au gré de ce mouvement de balancier entre culture et spécialité qui fixe les effervescences successives depuis deux siècles — que de renouveler d’un seul tenant les pratiques d’enseignement, les questionnaires de la didactique et l’appareil conceptuel des études littéraires:
[À] mesure qu’on avance dans l’histoire, l’évolution sociale devient plus rapide; une époque ne ressemble pas à celle qui précède; chaque temps a sa physionomie. Des besoins nouveaux et de nouvelles idées surgissent sans cesse; pour pouvoir répondre aux changements incessants qui surviennent ainsi dans les opinions et dans les mœurs, il faut que l’éducation elle-même change, et, par conséquent, reste dans un état de malléabilité qui permette le changement. Or, le seul moyen de l’empêcher de tomber sous le joug de l’habitude et de dégénérer en automatisme machinal et immuable, c’est de la tenir perpétuellement en haleine par la réflexion. Quand l’éducateur se rend compte des méthodes qu’il emploie, de leur but et de leur raison d’être, il est en état de les juger et, par suite, il se tient prêt à les modifier s’il arrive à se convaincre que le but à poursuivre n’est plus le même ou que les moyens à employer doivent être différents. La réflexion est, par excellence, la force antagoniste de la routine, et la routine est l’obstacle aux progrès nécessaires. (Durkheim, 2003, 83)
Bibliographie
Abry, Emile, Charles Audic & Paul Crouzet (1912), Histoire illustrée de la littérature française. Précis méthodique, Paris et Toulouse, Didier et Privat.
Aeby Daghé, Sandrine (2010), «Quels gestes professionnels pour quelles activités scolaires? Lire et interpréter des textes littéraires», Repères, n° 42, p. 127-144.
Angenot, Marc (1989), 1889, un État du discours social, Montréal, éd. Balzac [réédité en libre accès, en ligne, par l’équipe Médias 19 en 2013].
Auerbach, Erich (2005 [1952]), «Philologie de la littérature mondiale», trad. D. Meur, in Où est la littérature mondiale?, C. Pradeau & T. Samoyault (dir.), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, p. 25-37.
Baroni, Raphaël (2007), La Tension narrative: suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Baroni, Raphaël (2017), Les Rouages de l’intrigue, Genève, Slatkine.
Barras, Ambroise, & Eric Eigenmann (dir.) (2006), Textes en performance, Genève, Métis Presses.
Barthes, Roland (2002 [1971]), «Réflexions sur un manuel», in Œuvres complètes, E. Marty (éd.), t. 3, Paris, Seuil, p. 945-951.
Barthes, Roland (2002 [1975]), «Littérature/enseignement (entretien avec André Petitjean)», in Œuvres complètes, E. Marty (éd.), t. 4, Paris, Seuil, p. 879-886.
Baumann, Zygmunt (2006), La Vie liquide, trad. C. Rosson, Rodez, Le Rouergue-Chambon.
Booth, Wayne C. (1988), The Company we Keep: an Ethics of Fiction, Berkeley, UCP.
Bourdieu, Pierre (1992), Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil.
Bronckart, Jean-Paul & Miren Itziar Plazaola Giger (1998), «La transposition didactique. Histoire et perspectives d'une problématique fondatrice», Pratiques, n° 97-98, p. 35-58.
Brooks, Peter (1984), Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, New York, Kropf.
Caïra, Olivier (2011), Définir la fiction: du roman au jeu d’échecs, Paris, Éd. de l’EHESS.
Canvat, Karl (2016), «Manuels des origines, origines des manuels: L’enseignement de la littérature, de Batteux à Lanson», Le Français aujourd’hui, n° 194, p. 25-33.
Chartier, Roger (1991), «Préface» à D.F. McKenzie, La Bibliographie et la sociologie des textes, trad. M. Amfreville, Paris, Éd. du cercle de la Librairie.
Chartier, Roger (2005), Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècles), Paris, Gallimard et Seuil.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée sauvage.
Citton, Yves (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires?, Paris, Amsterdam.
Citton, Yves (2010), Mythocraties: Storytelling et imaginaires de gauche, Paris, Éd. Amsterdam.
Compagnon, Antoine (2007), La Littérature, pour quoi faire?, Paris, Collège de France et Fayard.
Corbin, Alain (1982), Le Miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Aubier-Montaigne.
Coste, Florent (2017), Explore. Investigations littéraires, Paris, Questions théoriques.
Cottier, Charles (1896), Histoire abrégée de la littérature française, Lausanne, Bridel & Cie.
Damrosch, David (2003), What is World Literature?, Princeton University Press.
Damrosch, David (ed.) (2009), Teaching World Literature, New York, Modern Language Association.
David, Jérôme & Sébastien Graber (2013), «Didactique de la littérature et microlecture scolaire: le défi d’un sens pratique», in Didactique en construction, constructions des didactiques, J.-L. Dorier et al. (dir.), Bruxelles, De Boeck, p. 163-177.
De Beaudrap, Anne-Raymond (dir.) (2004), Images de la littérature et de son enseignement, Nantes, CNDP-CRDPP.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Develay, Michel (1992), De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF.
Dubet, François & Danilo Martucelli (1998), Dans quelle Société vivons-nous?, Paris, Seuil.
Dufays, Jean-Louis (2002), «Les lectures littéraires: évolution et enjeux d’un concept», in Tréma, n° 19 [en ligne].
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2005), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Bruxelles, De Boeck, 2e édition.
Durkheim, Emile (2003 [1922]), Éducation et société, Paris, PUF, coll. «Quadrige».
Émery-Bruneau, Judith (2014), «La littérature au secondaire québécois: conceptions d’enseignants et pratiques déclarées en classe de français», in Lidil, n° 49, p. 71-91.
Febvre, Lucien (1953), Combats pour l’histoire, Paris, Colin.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature, Rennes, PUR.
Glaudes, Pierre & Yves Reuter (1998), Le Personnage, Paris, PUF.
Hamon, Philippe (1972), «Pour un statut sémiologique du personnage», Littérature, vol. 6, n° 2, p. 86-110.
Hartog, François (2003), Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil.
Houdart-Merot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, PUR et Adapt Éditions.
Jakobson, Roman (1963), «Linguistique et poétique», in Essais de linguistique générale, trad. N. Ruwet, Paris, Minuit, p. 209-248.
Jenny, Laurent (1990), La Parole singulière, Paris, Belin (rééd. 2009).
Jenny, Laurent (dir.) (2011), Le Style en acte. Vers une pragmatique du style, Genève, Métis Presses.
Jey, Martine (1998), La Littérature au lycée: invention d’une discipline, Metz, Université de Metz.
Jey, Martine (2000), «“Crise du français” et réforme de l’enseignement secondaire (1902-1914)», Études de linguistique appliquée, n° 118, p. 162-177.
Jey, Martine (2004), «Gustave Lanson: De l’histoire littéraire à une histoire sociale de la littérature», in Le Français aujourd’hui, n° 145, p. 15-22.
Kalifa, Dominique (1995), L’Encre et le sang: récits de crime et société à la Belle Époque, Paris, Fayard.
Kalifa, Dominique (2013), Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil.
Lacoue-Labarthe, Philippe & Jean-Luc Nancy (1978), L’Absolu littéraire: théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil.
Lahire, Bernard (1998), L’Homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.
Langlade, Gérard (2001), «Et le sujet lecteur dans tout ça?», Enjeux, n°51-52, p. 53-61.
Langlade, Gérard (2006a), «Quelle théorie de la lecture littéraire?», in Une formation littéraire malgré tout, J.-L. Dumortier & M. Lebrun (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 17-20.
Langlade, Gérard (2006b), «L’activité “fictionnalisante” du lecteur», in Les Enseignements de la fiction, Modernités, B. Louichon & B. Laville (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, p. 163-177.
Lanson, Gustave (1909), «La crise des méthodes dans l’enseignement du français», in L’enseignement du français, G. Lanson et al. (dir.), Paris, Imprimerie nationale, p. 1-24.
Lavocat, Françoise (2016), Fait et fiction — pour une frontière, Paris, Seuil.
Lyon-Caen, Judith & Dinah Ribard (2010), L’Historien et la littérature, Paris, La Découverte.
Macé, Marielle (2016), Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard.
Macé, Marielle (2017), Sidérer, considérer. Migrants en France, 2017, Lagrasse, Verdier.
Marin, Louis (1978), Le Récit est un piège, Paris, Minuit.
Martinand, Jean-Louis (1985), Connaître et transformer la matière, Bern, Peter Lang Verlag.
Menant, Sylvain (2002), «Littérature et enseignement: la réduction polymathique», Revue d’Histoire littéraire de la France, vol. 102, n° 3, p. 355-364.
Merlin-Kajman, Hélène (2016a), Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard.
Merlin-Kajman, Hélène (2016b), L’Animal ensorcelé. Traumatismes, littérature, transitionnalité, Paris, Ithaque.
Nussbaum, Martha (2015), L’Art d’être juste: l’imagination littéraire et la vie publique, trad. S. Chavel, Paris, Flammarion.
Patron, Sylvie (2009), Le Narrateur. Introduction à la théorie narrative, Paris, Colin.
Picard, Michel (1977), «Pour la lecture littéraire», Littérature, n° 26, p. 42-50.
Poslaniec, Christian (1992), De la lecture à la littérature, Paris, Édition du Sorbier.
Putnam, Hilary (2004 [2002]), Fait/valeur, la fin d’un dogme, et autres essais, trad. M. Caverbière & J.-P. Cometti, Paris-Tel-Aviv, Editions de l’Eclat.
Petitjean, André (1998), «La transposition didactique en français». Pratiques, n° 97-98, p. 7-34.
Reuter, Yves (1992), «Enseigner la littérature?», Recherches, n° 16, p. 55-70.
Reuter, Yves (1998), «La gestion des valeurs dans la didactique de l’écriture», Spirales, n° 22, p. 201-213.
Reuter, Yves (2001), «La “prise en compte” des pratiques extrascolaires de lecture et d’écriture: problèmes et enjeux», Repères, vol. 23, n° 1, p. 9-31.
Revel, Jacques (2000), «Histoire vs. Mémoire en France aujourd'hui», French Politics, Culture and Society, vol. 18, n° 1, p. 1-12.
Rosenthal, Olivia & Lionel Ruffel (2010), «Introduction», Littérature, n° 160 («La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre»), p. 3-13.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (dir.) (2004), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, PUR.
Saillant, Francine, Mondher Kilani & Florence Graezer Bideau (dir.) (2011), Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique, Montréal, Liber.
Saint-Gelais Richard (2011), Fictions transfuges: la transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Seuil.
Saint-Gérand, Jacques-Philippe (1989), «“La langue française est un coursier moins fougueux que rétif”: les considérations linguistiques et littéraires de la Chrestomathie française (Alexandre Vinet)», La Licorne, n° 16 [désormais en ligne].
Salmon, Christian (2007), Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil.
Schaeffer, Jean-Marie (2011), Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature?, Vincennes, Éd. Thierry Marchaisse.
Schechner, Richard (2002), Performance studies, an introduction, London and New York, Routledge.
Schneuwly, Bernard (1995), «De l’utilité de la transposition didactique», in Didactique du français: état d’une discipline, J.-L. Chiss, J. David & Y. Reuter (dir.), Paris, Nathan, p. 47-62.
Tauveron, Catherine (dir.) (2002), Lire la littérature à l’école, Paris, Hatier.
Tauveron, Catherine (2003), «Des vertus homéopathiques de la littérature», Langages et pratiques, n° 31, 36-49.
Thévenot, Laurent (2006), L’Action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte.
Todorov, Tzvetan (dir.) (1965), Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Paris, Seuil.
Todorov, Tzvetan (2007), La Littérature en péril, Paris, Flammarion.
Venayre, Sylvain (2002), La Gloire de l’aventure. Genèse d’une mystique moderne, 1850-1940, Paris, Aubier.
Verret, Michel (1975), Le Temps des études, 2 vol., Paris, Honoré Champion.
Vinet, Alexandre (1833 [1829]), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français, t. 1, Bâle, Neukirch.
Weber, Max (2000 [1915]), Confucianisme et taoïsme, trad. C. Colliot-Thélène & J.-P. Grossein, Paris, Gallimard.
Pour citer l'article
Jérôme David, "Enseigner la littérature: une approche par les justifications (XIXe-XXIe siècles)", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-une-approche-par-les-justifications-xixe-xxie-siecles
Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd
Les pratiques d’écriture créative méritent d’être pleinement (ré)investies dans l’enseignement du français au postobligatoire; de l’atelier ponctuel aux pratiques régulières, des exercices épisodiques aux évaluations formatives, voire certificatives. En voici une, laquelle relève cependant d’un projet d’établissement: le camp d’écriture.
Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd
Ce texte présente un camp d’écriture organisé depuis plusieurs années dans une école du secondaire II genevois. Par l’entremise d’extraits de productions d’élèves, l’auteur discute des avantages didactiques de ce genre d’approche de l’écriture créative.
Les pratiques d’écriture créative méritent d’être pleinement (ré)investies dans l’enseignement du français au postobligatoire; de l’atelier ponctuel aux pratiques régulières 1, des exercices épisodiques aux évaluations formatives, voire certificatives 2. En voici une, laquelle relève cependant d’un projet d’établissement: le camp d’écriture.
Historique
Le Collège et École de commerce Émilie-Gourd, à Genève, organise depuis une dizaine d’années un camp résidentiel d’écriture, proposé aux élèves de 1ère et 3e années gymnasiales 3. Le camp a lieu pendant une semaine consacrée aux activités hors cadre (camp d’astronomie, camp d’art, voyages linguistiques, etc.), généralement au printemps. L’inscription se fait sur une base volontaire.
Ce camp a été créé par plusieurs enseignants de français qui ont décidé de suivre l’exemple du Collège Claparède, dont le premier camp d’écriture avait eu lieu une année plus tôt. Plusieurs autres collèges, tout comme d’autres écoles du canton, ont aussi leur camp d’écriture – parfois sous une forme quelque peu différente.
Depuis 2011, le camp d’écriture du collège Émilie-Gourd bénéficie non seulement des acquis didactiques mis en place par les enseignants qui l’ont créé, mais aussi de certaines modalités de vie collective 4 qui ont permis d’assurer une ambiance propice au partage.
Organisation
Le camp 5 commence le lundi par des jeux (de présentation, d’expression, puis d’écriture), afin de faire connaissance et de créer le groupe – ce qui s’avère important pour favoriser la bienveillance nécessaire au partage des textes. En soirée, un premier atelier a pour but de permettre aux élèves de présenter leur projet d’écriture. Les élèves ont le choix du sujet comme du genre, à condition que leur écriture témoigne d’une préoccupation esthétique. Il ne s’agit donc pas que de raconter une histoire. Si les textes sont plus facilement narratifs, d’autres genres sont aussi représentés. Certains nécessitent un suivi de près, tandis que d’autres se font de façon plus autonome.
Les jours suivants sont consacrés à des ateliers de travail individuel centrés autour du projet des élèves, avec pour contrainte de privilégier le brouillon, de façon à ce qu’ils conservent les différentes étapes de leur production. Dès qu’ils en éprouvent le besoin, les élèves vont voir un enseignant. Dans l’idéal, tous les textes doivent avoir été lus par au moins deux enseignants avant le mercredi soir, où nous organisons un atelier par petit groupe centré sur les difficultés des élèves. Des «trucs et astuces» sont alors échangés. Le jeudi après-midi, les élèves dactylographient leur texte et corrigent les dernières erreurs, tandis que le vendredi est consacré à la préparation de la lecture à haute voix des textes. Les lectures sont enregistrées et les textes font l’objet d’une publication 6. D’autres activités autour de l’écriture sont organisées lors des veillées: la lecture d’un texte commun, la rencontre avec un écrivain, ainsi que des ateliers spécifiques, notamment une soirée «slam»: un verre (sans alcool) pour des vers. Des activités ludiques, des marches et des temps libres sont par ailleurs aussi proposés.
Finalement, les élèves participent à toutes les tâches collectives (repas, vaisselle, rangement, nettoyage, etc.). Un enseignant s’occupe plus spécifiquement de la logistique (établissement des menus, courses, élaboration des repas, etc.), tandis que les cinq autres sont à disposition des élèves (on compte ainsi cinq à six élèves par enseignant, soit vingt-cinq à trente participants pour le camp pour six enseignants).
Le travail des enseignants consiste à accompagner les élèves, à leur faire part de leurs impressions de lecteur, à les conseiller, voire à les orienter, selon les besoins. Les textes sont lus par plusieurs enseignants, et bien évidemment, les avis divergent. Il s’agit évidemment de ne pas faire le texte de l’élève, mais de lui proposer des directions possibles; aux élèves de trancher. De même, les enseignants aident les élèves à mieux lire et interpréter leur texte à l’oral. Leur fonction est donc celle d’une personne-ressource.
Écriture et réécritures
Lors du premier atelier de l’édition 2017, une élève de première année a fait part de son projet: rédiger un échange épistolaire entre des personnages abstraits. Après quelques tâtonnements, elle a choisi d’écrire une lettre de la Vie à la Mort. Un enseignant lui avait conseillé de privilégier la rédaction d’une seule lettre, de qualité, plutôt que plusieurs. Elle a commencé par réfléchir au sujet:
Puis elle s’est lancée dans une première rédaction dont voici le début:
L’idée d’une lettre entre deux amants était née. Les enseignants lui ont proposé de développer cet aspect et de ne pas hésiter à rendre compte du désir de l’une pour l’autre. Une étape de plus a donné cette version:
Puis, après les conseils des enseignants et de ses camarades, elle est arrivée à celle-ci:
C’est là l’exemple d’un texte qui a demandé à son auteure un effort de réécriture important. On trouvera en annexe un texte rédigé par un apprenti gestionnaire du commerce de détail de 3e année (âgé de plus de 20 ans), lors de l’édition 2014. Là aussi, entre les premiers jets et la version finale, l’étudiant a repris inlassablement chaque mot, chaque formule, de façon à faire «sonner» son texte.
Quelques remarques…
D’édition en édition, on note l’originalité des œuvres, leur authenticité, leur richesse d’évocation. Les sujets abordés sont souvent durs, sombres, angoissants, comme si l’écriture ouvrait une porte derrière laquelle se cacheraient les monstres dans le placard – mais sans doute aussi parce que l’humour est plus difficile à faire naître sous la plume.
L’école privilégie l’aspect critique de la littérature dans ses programmes, sans exclure pour autant l’aspect créatif, mais en le réduisant à la portion congrue. Pourtant, de raisons pour favoriser les pratiques d’écriture créative, ou littéraire, il en est de nombreuses: écrire pour mieux lire, écrire pour désacraliser l’écriture, écrire parce que l’écriture ce n’est pas que dissertations et commentaires composés, écrire pour s’immerger en littérature, écrire pour le plaisir, écrire pour s’écrire, se dire, écrire pour soi, écrire pour rencontrer l’autre, écrire pour s’approprier la langue, se faire langage, pour mieux écrire, pour jouer aussi, etc. Et écrire pendant une semaine, dans une maison éloignée de la civilisation, favorise l’immersion. Les textes sont différents; les difficultés sont souvent les mêmes. Surtout, il n’y a aucune évaluation chiffrée, seulement les applaudissements, les commentaires laudatifs et son propre regard critique.
Depuis la première édition, il y a onze ans, les enseignants de français ne cessent de défendre ce camp (ce qu’en réalité ils n’ont guère besoin de faire), tellement il offre aux élèves comme aux enseignants une expérience personnelle et collective extraordinaire, fondée sur la liberté et le partage. Liberté de ton, de sujet, de genre, liberté de style, liberté d’être; partage de la vie collective et des émotions qu’elle suscite, des joies et des difficultés, et surtout du bonheur de découvrir ces textes pour lesquels, souvent, les enseignants se font du souci à mi-parcours. Or, il est à chaque fois magique d’assister à ce petit miracle de la naissance d’un texte qui se veut littéraire au milieu des ratures, des erreurs de français, des hésitations, des traits rageurs sur des feuilles déchirées, des ras-le-bol, des doutes, des longs moments où quelques-uns se disent qu’il n’y arriveront jamais… Et ces lectures, poignantes pour la plupart, parfois mises en musique, voire jouées, dans une ambiance de recueillement où chacun, les yeux fermés ou grands ouverts, goûte les mots, et se laisse porter par les émotions.
Annexes
Planning du camp
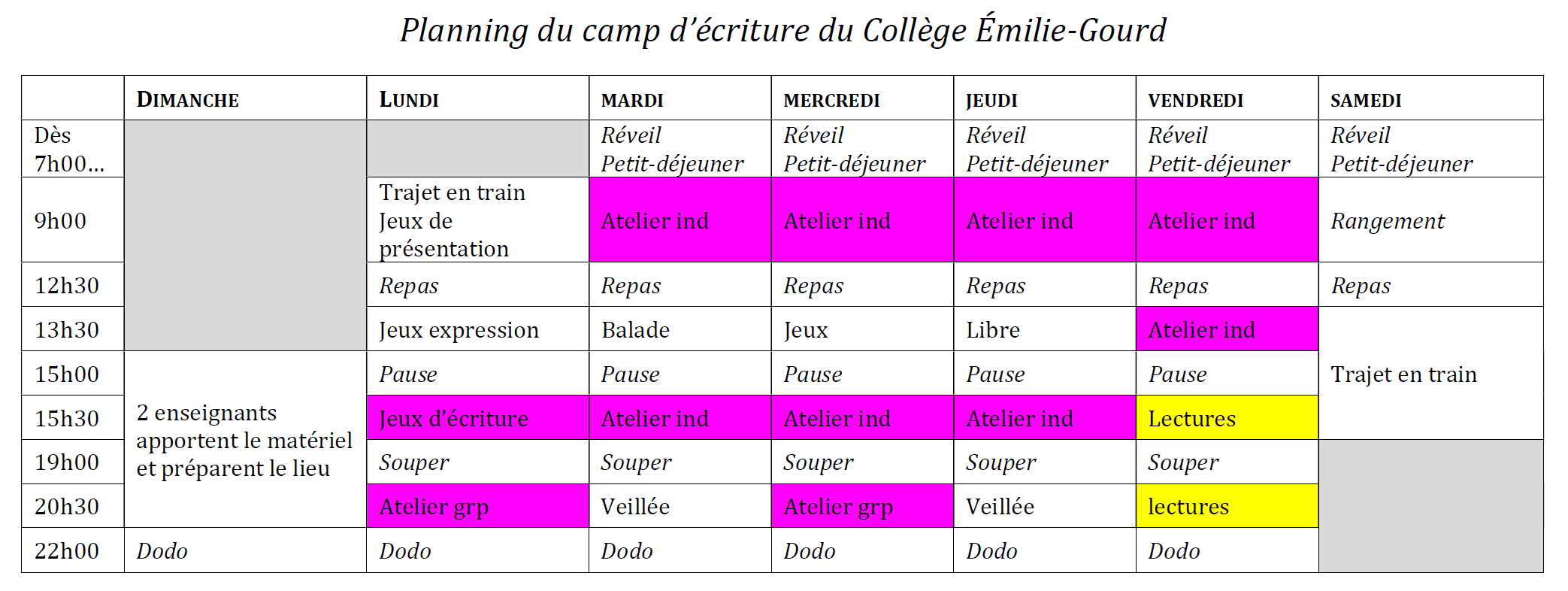
Exemple de texte:

Pour citer l'article
Philippe D. Garo, "Liberté et partage: le camp d’écriture du CEC Émilie-Gourd", Transpositio, Comment ça s'enseigne, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/liberte-et-partage-le-camp-d-ecriture-du-cec-emilie-gourd
Rap et "Bucoliques" de Virgile
Dans sa thèse « Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture », Dominique Augé insiste sur la nécessité, pour faire des élèves latinistes ou hellénistes des lecteurs curieux, de leur présenter des textes en langue originale dont les schémas narratifs et certaines composantes, tels les personnages ou les lieux, « leur permettent de mobiliser des savoirs ou des référentiels antérieurs » (Augé 2013 : 154). Aussi recommande-t-elle de construire les postures du lecteur auprès des élèves en abordant la littérature grecque et latine à l’aide de textes relevant de genres littéraires connus en français, par exemple la fable, emboîtant le pas à Anne Armand (1997 : 79-97) et Mireille Ko (2000 : 41) : familiers des Fables de La Fontaine, les élèves nourrissent des attentes qui les motivent à entrer dans les Fables d’Ésope ou de Phèdre, tout en possédant un univers référentiel qui le leur permet (Augé 2013 : 147-175).
Rap et "Bucoliques" de Virgile
I. Introduction et questionnement
Dans sa thèse «Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture», Dominique Augé insiste sur la nécessité, pour faire des élèves latinistes ou hellénistes des lecteurs curieux, de leur présenter des textes en langue originale dont les schémas narratifs et certaines composantes, tels les personnages ou les lieux, «leur permettent de mobiliser des savoirs ou des référentiels antérieurs» (Augé 2013 : 154). Aussi recommande-t-elle de construire les postures du lecteur auprès des élèves en abordant la littérature grecque et latine à l’aide de textes relevant de genres littéraires connus en français, par exemple la fable, emboîtant le pas à Anne Armand (1997 : 79-97) et Mireille Ko (2000 : 41): familiers des Fables de La Fontaine, les élèves nourrissent des attentes qui les motivent à entrer dans les Fables d’Ésope ou de Phèdre, tout en possédant un univers référentiel qui le leur permet (Augé 2013 : 147-175).
Pour la plupart des genres littéraires antiques il existe un correspondant plus récent que les élèves ont déjà rencontré dans le cadre de leur parcours scolaire ou de leur parcours personnel au moment où l’on aborde en latin ou en grec un texte relevant dudit genre littéraire. Mais il y a aussi des genres que les élèves ne connaissent pas du tout et dont la thématique, de prime abord, n’est pas de celles qui les passionnent. Le genre bucolique en est un bon exemple. Ce n’est sans doute pas pour rien que les Bucoliques de Théocrite ou celles de Virgile ne sont pas mentionnées dans les Plans d’études actuels de Suisse romande pour l’école secondaire 1 ou 2, qu’elles ne figurent presque jamais dans les moyens d’enseignement1 et qu’elles sont encore plus rarement lues en classe.
Si cependant on investit un périmètre plus large que la littérature à la recherche d’expressions artistiques connues des élèves et dont l’exploitation éveillerait chez eux des attentes et les mettrait dans la posture de lecteurs actifs, cette lacune peut être comblée grâce au rap.
De fait, les dimensions poétique, rythmique et théâtralisée caractérisent pareillement cette création culturelle populaire issue du mouvement hip hop que la bucolique gréco-latine, ces textes «monumentalisés dans la culture savante» (Dupont 2015). Aussi l’omniprésence du rap et sa notoriété auprès de tous les élèves –certes à des degrés divers– semblent le désigner comme une possible porte d’entrée dans les Bucoliques. Comment? Ce sera le propos de la deuxième partie de cet article, qui décrira le dispositif didactique développé et en relatera trois mises en pratique, alors que la conclusion s’interrogera sur sa validité.
II. Virgile, le rap et des apprenants
a) Acte 1
Il convient de faire précéder la description de notre dispositif et de ses réalisations par une réflexion concernant le domaine dans lequel nous entendons faire construire des stratégies et des compétences par les apprenants. Alors que Ko, Armand et Augé recommandent de recourir à des genres littéraires connus des élèves pour leur permettre de mobiliser leurs savoirs littéraires, formels ou thématiques, le parcours que nous avons proposé convoque certes aussi des connaissances littéraires, mais également un ensemble de données performatives et énonciatives ; par conséquent, il stimule davantage une réflexion d’anthropologie historique avec une perspective ethnopoétique2. De fait, le pivot principal de notre dispositif consiste dans la battle que les protagonistes se livrent sur les divers niveaux évoqués, le performatif étant sans doute le plus important3.
La séquence a été réalisée pour la première fois en juin 2018 avec deux des classes de latin de Catherine Fidanza, regroupant dix élèves de 1ère et de 2ème année du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, en classe hétérogène. Ces élèves de 16-17 ans étaient à la fin de leur deuxième ou troisième année de latin – leurs connaissances étaient donc encore relativement modestes. Ils connaissaient Virgile pour avoir lu plusieurs passages de l’Énéide, mais ils n’avaient encore jamais entendu parler des Bucoliques. Pour disposer d’un bon point de comparaison, d’une Bucolique offrant un bon exemple de battle, nous avions choisi la Bucolique 3, qui met en scène deux pâtres, Menalcas et Damoetas. Au début du poème, Menalcas demande à Damoetas à qui appartient le troupeau de brebis qu’il garde. Les deux se disputent rapidement, puis Damoetas propose une joute à Menalcas. Tous deux présentent leur enjeu, ils demandent à un voisin de jouer à l’arbitre – et la joute commence.
Dans un premier temps, Catherine Fidanza a consacré deux périodes à parcourir cette Bucolique avec ses élèves et leur en faire découvrir en traduction française le contenu et les personnages.
Le cœur de la séquence, composé d’une amorce, de quatre activités et d’une conclusion, a occupé deux périodes de 45 min. Il a été modéré par les trois intervenants Catherine Fidanza, Antje Kolde et Martin Conod.
En guise d’amorce, les élèves ont été invités à répondre à la question suivante : «L’association des termes “Bucoliques” et “rap” fait-elle sens pour vous? Si oui, pourquoi?» Au cours d’un tour de table, certains ont déjà pointé l’affrontement entre deux personnages présents dans les deux expressions artistiques tout comme leur dimension poétique.
La première activité a consisté dans le visionnement d’une petite dizaine d’exemples de battles diverses, allant de plusieurs extraits de rap à des caricatures en passant par de la street dance, une joute orale népalaise, une battle de percussionnistes indiens, de chanteurs sud-coréens, de guitaristes émo-métal japonais et finlandais4. Le but était que les élèves dégagent les caractéristiques des battles modernes, tous genres confondus. À l’issue de discussions modérées par les intervenants, ils ont formulé les réponses suivantes : a) les joutes se pratiquent dans beaucoup de domaines et expressions artistiques ; b) ce sont des «performances» (au sens anglo-saxon : avec implication du public) ; c) l’expression est «holistique» : musique, rythme, corps, voix, mots, tout y participe ; d) elles sont ritualisées : les deux personnages s’affrontent, passant par l’émulation, l’invective et l’humiliation, le second reprenant et variant ce qu’a fait le premier.
La deuxième activité était centrée sur un extrait de la Bucolique retenue5. Les élèves devaient écouter un échange entre les deux pâtres présenté par Antje Kolde qui marquait le passage d’un berger à l’autre en se déplaçant dans la salle ; le texte latin était oralisé à l’aide d’une scansion respectant tant le rythme de l’hexamètre dactylique que l’accent tonique des mots et les césures ; sans donc avoir le texte sous les yeux, les élèves avaient la consigne de dire a) si certains mots étaient mis en évidence, b) si oui, par quels procédés et c) les remarques générales qui en découlaient du point de vue du contenu. Par un jeu de questions-réponses, les élèves ont trouvé diverses manifestations de variatio et d’imitatio, que ce soit au niveau de la thématique ou de procédés rythmiques6 et rhétoriques ; cela leur a permis d’établir des parallèles entre les battles modernes et celles de la Bucolique. Il convient de préciser que la recherche tant des mots mis en évidence par leur accentuation et leur place dans le vers que des réseaux entre les mots a poussé les élèves à articuler une réflexion profonde sur l’effet de la poésie aussi bien sur le poète que sur le personnage intradiégétique et l’auditeur / le lecteur.
La troisième activité revenait au rap : en écoutant un extrait d’un rap d’Oxmo Puccino7, les élèves ont dû pointer la correspondance entre contenu et forme induite par l’accentuation d’une syllabe.
La quatrième activité se proposait de faire découvrir aux élèves le même phénomène dans le texte latin8 : comme lors de la deuxième activité, les élèves n’ont pas eu de difficultés à réaliser l’activité, en écoutant attentivement l’oralisation du texte latin selon les mêmes modalités.
La séquence s’est conclue par la comparaison de plusieurs traductions des deux passages étudiés, datant d’époques différentes. Les élèves avaient comme consigne d’évaluer si les traducteurs avaient mis en valeur les éléments dégagés par la réception orale, comparable à une réception en rap.
En aval, les élèves ont dû répondre après quelques jours à deux questions visant tant la motivation qu’ils retiraient de cette démarche de comparaison que son utilité pour la suite de leurs études.
Les réponses à la première question montrent que les élèves ont été sensibilisés à la dimension esthétique du texte latin qui leur a été rendue accessible par l’actualisation opérée par le biais du rap, tout comme à la construction du sens du texte antique et au rapprochement créateur de sens avec les battles modernes. Ainsi, une élève énumère ce qu’elle retient particulièrement : «Les passages sur la scansion et ce qu’elle peut révéler sur le texte, les mises en évidence qu’elle opère et ce qu’en font les traducteurs, les liens faits entre les constructions du texte antique et celles des battles modernes.»
Si la deuxième question était censée porter sur le microcosme du lycée, certains l’ont élargie au macrocosme de la vie. Comme il leur était demandé, les élèves ont pris du recul et il ressort de leurs réponses qu’ils ont intériorisé la matière qui leur a été apportée puisqu’ils insistent sur l’importance des sonorités dans toute poésie, de la place des mots et du lien entre l’expression actuelle rappée et le texte de Virgile.
b) Acte 2
La séquence a pu être reconduite le 27 octobre 2018, à l’occasion du 6ème Lateintag à Wettingen. Le scénario a dû être adapté aux circonstances légèrement modifiées : le nombre d’intervenants réduit à deux, un temps à disposition de 60 min et le public composé de latinistes en partie d’un niveau très avancé. Le dispositif a été modifié en un point : les répliques des deux pâtres n’ont pas été oralisées par une seule et même intervenante, mais chaque berger a été représenté par une intervenante ; cette modification constitue une nette amélioration, car elle a facilité la compréhension de la partie latine par une meilleure répartition des voix. Les activités ont été réalisées avec le même succès qu’à Neuchâtel et les réactions du public ont été en tous points semblables à celles des gymnasiens.
c) Acte 3
La troisième réalisation de la séquence a eu lieu le 12 janvier 2019 à l’École Normale Supérieure de Lyon, à l’occasion d’une journée de formation ELLASS (Enseigner les Langues Anciennes dans le Secondaire et le Supérieur) : les conditions étaient identiques à celles du Lateintag ; le public était constitué d’une douzaine d’étudiants qui préparaient leur concours d’agrégation. Bien que la plupart des agrégatifs aient montré peu de sympathie pour le rap, la séquence et les activités ont rencontré un vif succès. À la fin de la séance, les étudiants ont souligné l’effet actualisant de cette approche, qui comble l’abîme spatio-temporel et culturel séparant le texte de Virgile du rap et lui confère par là un sens tout à fait actuel. «Avant, je trouvais que l’enseignement des langues anciennes était un enseignement mort», s’exprime l’un d’eux ; «maintenant, je sais qu’on peut le faire vivre.»
III. Conclusion : validité de la séquence ?
Interrogeons-nous en guise de conclusion sur la validité de notre dispositif, et cela du triple point de vue des connaissances acquises, de la motivation et des connaissances transmises.
Il est difficile de s’exprimer sur le premier point : il eût fallu tester les connaissances acquises après un certain laps de temps. Or, c’était impossible. De fait, nous n’avons jamais revu les participants à la deuxième et à la troisième réalisation ; quant aux élèves neuchâtelois, notre intervention était trop proche de la fin de l’année. Cependant, des remarques que les uns et les autres ont faites durant l’année scolaire 2018-2019 ont montré qu’ils avaient assimilé l’importance de la place des mots, de leur accent et du rythme pour l’énonciation du texte et la construction de son sens.
En ce qui concerne la motivation, l’enthousiasme rencontré lors des trois réalisations montre la validité du scénario, même s’il était à chaque fois imputable aussi à d’autres facteurs. Ainsi, la séquence s’est toujours située en dehors du quotidien de l’école – dans le cadre d’un festival de langues anciennes et d’une journée de formation pour les réalisations 2 et 3, dans celui d’un enseignement un peu particulier, d’emblée déclaré comme expérimental, en ce qui concerne les élèves neuchâtelois. À leur propos, la présence de deux personnes extérieures, dont un chanteur connu et annoncé dans le programme d’un festival de peu postérieur à son intervention, a certainement joué un rôle. Selon les dires des participants à l’issue des trois réalisations, c’était néanmoins le scénario et les connaissances variées qu’il convoquait qui étaient particulièrement motivants pour eux.
L’évocation des connaissances convoquées permet de passer au dernier point : les connaissances transmises. Pour aborder la lecture des Fables gréco-latines, les didacticiens recommandent fréquemment, nous l’avons vu, de recourir aux Fables de la Fontaine ; outre la stratégie didactique, la filiation entre la fable antique et celle du XVIIème légitime ce procédé. Qu’en est-il dans notre cas? Notre scénario risque-t-il de transmettre des erreurs ou repose-t-il sur des parallèles vraisemblables entre Virgile et le rap? La vraisemblance des parallèles nous semble plus que probable : le texte des Bucoliques, que l’on a l'habitude de voir comme «monument de la culture savante», porte en effet les traces d'activités collectives qui ont disparu, alors qu'elles étaient vivantes dans la culture populaire ; on a ainsi perdu l'usage lié à leur pratique, qui était sans doute, pour les Bucoliques, des mimes ou d'autres styles de spectacles. En d’autres termes, le texte des Bucoliques a été «déterritorialisé» (Dupont 2015) – mais le recours aux comparaisons avec le rap permet de le «reterritorialiser». Certes, plusieurs éléments sur lesquels nous nous appuyons, tels la scansion accentuée et la performance des Bucoliques, sont toujours débattus. Mais loin de constituer un frein pour notre scénario, cette donne fournit un argument en faveur de sa validité didactique : en expliquant ces débats aux élèves, on leur montre que les langues anciennes sont encore bien vivantes – puisqu’on débat à leur sujet.
Bibliographie
Armand, Anne (1997), Didactique des langues anciennes, Paris, Bertrand-Lacoste.
Augé, Dominique (2013), Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture, Grenoble, Ellug.
Calame, Claude (2015), « Chanter les vulnérabilités : des poèmes de Sappho au rap bernois, du modèle choral au paradigme néolibéral », Cahiers du genre, 2015/1 (n° 58), p. 69-92. DOI : 10.3917/cdge.058.0069. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2015-1-page-69.htm, consulté le 7 octobre 2019.
Dupont, Florence (2010). La voix actée, pour une nouvelle ethnopoétique, Paris, Kimé.
Dupont, Florence (2015) « La voix des classiques, aux arènes de Lutèce, Paris 2015 - entretien de Laure de Chantal », réalisation de Hocine Gasmi, URL : https://www.youtube.com/watch?v=z55Urz_ErQ4
Ko, Mireille (2000), Enseigner les langues anciennes, Paris, Hachette.
Damoetas : «Jupiter est le début de tout, Muses ; tout est plein de Jupiter ; il prend soin de nos terres, mes chants lui plaisent». Menalcas : «Et moi, Phoebus m’aime : j’ai toujours des offrandes pour Phoebus chez moi, du laurier et le doux hyacinthe pourpré». (Traduction : A. Kolde)
Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.» (Ibid. note 5).
Damoetas : «Hélas, comme il est maigre, mon taureau, dans son gras pâturage ! L’amour est pareillement la mort pour le troupeau que pour le maître du troupeau.» Menalcas : «Chez ceux-là – et l’amour n’est pas en cause ! – la peau tient à peine aux os ; je ne sais quel mauvais œil jette un sort à mes tendres agneaux». (Traduction : A. Kolde)
Pour citer l'article
Antje Kolde & Catherine Fidanza, "Rap et "Bucoliques" de Virgile", Transpositio, Comment ça s'enseigne, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/rap-et-bucoliques-de-virgile
Voir également :
Manuels de lecture genevois au début du XXe siècle
Manuels de lecture genevois au début du XXe siècle
Manuels de lecture genevois au début du XXe siècle:
ou comment l’école œuvre à la fabrication
d’une culture suisse romande commune.
Ce bref texte montre à travers l’analyse de trois manuels scolaires suisses romands des XIXe et XXe siècles le lien étroit qui unit finalités conférées à l’enseignement de la littérature et politiques éducatives.
L’enseignement de la littérature est bien souvent au cœur des débats lorsqu’il s’agit de réformer l’école. Les finalités qu’on lui confère sont en effet étroitement liées aux «éthiques éducatives» que l’institution scolaire cherche à promouvoir et valoriser (David 2017). Ainsi, dans une perspective historique et didactique, il parait intéressant de se pencher sur les manuels scolaires parce qu’ils sont autant de traces qui témoignent des finalités conférées au fil du temps à l’enseignement de la littérature et plus largement à l’école. Nous proposons dans ce court texte de mettre en évidence ce lien entre politiques éducatives et enseignement de la littérature en analysant trois manuels utilisés à Genève dans les écoles secondaires entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle.
Le premier manuel suisse romand qui nous intéresse parait en 1871, soit une année avant l’adoption de la loi sur l’instruction publique instituant l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 13 ans. Intitulé Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, ce manuel est destiné aux élèves de la fin du primaire et du début du secondaire inférieur. À cette époque, le secondaire est constitué d’un grand nombre de filières organisées en fonction du genre des élèves et de leur appartenance sociale (Farquet 1994). Dans leur préface, Dussaud et Gavard, concepteurs de ce livre de lecture, affirment que l’ouvrage s’adresse spécifiquement «au peuple hétérogène» de Suisse romande. Or ce détail n’est pas sans importance. En effet, ce manuel parait une vingtaine d’années après la guerre civile du Sonderbund qui opposa cantons catholiques et protestants. Ce conflit, qui aurait pu mal tourner, débouche finalement sur la première constitution Suisse (1848) et la création d’un état fédéral 1. Les concepteurs du manuel entendent unifier, autant que faire se peut, le peuple romand alors divisé par leurs confessions religieuses, mais également par l’usage de patois différents. Cette unification est rendue possible grâce à l’apprentissage d’une langue et d’une culture communes. Les textes littéraires présents dans cet ouvrage apparaissent comme un réservoir de récits exemplaires et comme l’occasion de mettre en avant la beauté de la langue française au moyen d’œuvres d’auteurs suisses romands et français (Ronveaux & Gabathuler 2017).
Durant cette même période, une réédition (1876) du premier tome de la Chrestomathie de Vinet, dirigée par Eugène Rambert, écrivain, éditeur et critique littéraire romand est utilisée à la fin du secondaire inférieur. Dans cette nouvelle édition, Rambert modifie quelque peu le corpus établi par Vinet. Dans sa préface, il met l’accent sur la dimension «utile» des morceaux en vers ou en prose en ce qu’ils mettent en avant, d’après lui, ce qui est «bon» et «vrai», c’est-à-dire des idées morales et chrétiennes. Rambert préconise également une certaine distance temporelle entre les auteurs proposés et les lecteurs. Il s’agit ainsi de faciliter l’accès «aux histoires d’un Philoctète ou d’un Aristonoüs» car l’Antiquité resterait, selon lui, «la grande école du gout, et celle qui nous enseigne encore, après 20 siècles, la simplicité et le naturel» (p. 4). Rambert ajoute également quelques auteurs romands au corpus:
Nous avons aussi fait place à quelques rares morceaux empruntés à notre littérature nationale. Notre jeunesse, nous le savons, a plus besoin qu’aucune autre d’être mise en présence des vrais modèles français. Toutefois, il nous a paru qu’il y aurait excès de purisme et injustice envers nous-même à écarter systématiquement les pages les mieux inspirées d’un de Saussure, par exemple, d’un Töpffer, d’un Juste Olivier, ou d’un Vinet lui-même. (Rambert 1876: 5)
L’approche de la littérature de Rambert est sensiblement différente de celle défendue par Dussaud et Gavard. En effet, on décèle dans l’extrait ci-dessus une vision plutôt circonspecte des productions littéraires romandes, une forme de défiance vis-à-vis des usages linguistiques régionaux. La norme et le «bon usage» sont fixés par Paris et les productions françaises paraissent être encore, pour ce niveau de la scolarité (à savoir la fin du secondaire inférieur), le meilleur modèle possible. Rambert perpétue ici la position de Vinet (1829) qui encourageait ses contemporains à purifier leur langue au contact des écrivains français du XVIIe. Cette position se retrouve également chez un Rossel, qui, dans son Histoire littéraire de la suisse romande (1889), exhorte ses compatriotes en ces termes:
Prenez (…) des cours de langue et des leçons à Paris, plutôt qu’à Genève ou à Neuchâtel. A Dieu ne plaise que nous devenions aussi peu romands et aussi parisiens que possible! Soyons d’excellents suisses, mais fanatiques du meilleur français! N’ayons pas le culte exclusif de nos petites originalités! (Rossel 1889/1903: 12 dans Meizoz 1996)
Durant la première moitié du XXe siècle, le secondaire genevois inférieur est soumis à de fortes tensions, provoquées notamment par la volonté affichée de certains partis libéraux de créer une école secondaire unique, garantissant une scolarité secondaire obligatoire pour tous les élèves, quels que soient leur provenance sociale, leur genre ou leur niveau scolaire. Ce mouvement, après deux tentatives infructueuses en 1927 et en 1946, aboutit en 1962 à la création du cycle d’orientation genevois. C’est dans ce contexte tendu qu’en 1908 une nouvelle anthologie romande voit le jour. Celle-ci est réalisée par Dupraz et Bonjour et approuvée par le département de l’instruction publique genevois. Cette anthologie, qui connaitra un immense succès et sera rééditée à de nombreuses reprises (1911, 1917, 1923, 1939), s’inscrit dans la volonté d’unification du secondaire inférieur. Le processus de démocratisation qui débute à la charnière du XIXe et du XXe siècles à Genève et qui s’illustre par la volonté de créer une école moyenne unique, obligatoire, à fin d’orientation, a pour effet la réduction du fossé qui avait pu auparavant séparer primaire et secondaire, a fortiori dans les filières plus professionnelles.
Dans les préfaces des différentes éditions, Dupraz et Bonjour se positionnent contre l’approche classique des manuels de lecture telle que celle préconisée par Rambert. En effet, ils mettent en avant la nécessité de se démarquer des ouvrages «parisiens» qui en «dehors de très grands noms (Rousseau ou Töpffer) ignorent tout de la culture suisse romande». Ainsi à côté «du fond commun de toutes les anthologies» se trouvent des auteurs suisses d’expression française, « des pages dignes d’être recueillies et données en exemple » (Dupraz & Bonjour: 5). Par ailleurs, Dupraz et Bonjour soulignent, contrairement à Rambert, la nécessité d’intégrer largement des auteurs « vivants » (Dupraz & Bonjour: 5). Cette anthologie semble ainsi participer à la fabrication d’une culture commune grâce à la littérature. Les auteurs classiques comme La Fontaine légitiment, par le simple fait de leur présence, toute une série d’auteurs romands contemporains (Ronveaux & Gabathuler 2017). On passe donc d’une conception de l’enseignement de la littérature qui vise l’acquisition de la langue et de l’expression, voire d’une éthique chrétienne, à une visée plus culturelle, la création d’une communauté romande.
L’école telle que voulue par les politiques au tournant du XXe siècle à Genève et en Suisse romande doit jouer ainsi deux rôles fondamentaux. Premièrement, elle a pour mission d’unifier les peuples romands autour d’une culture et d’une langue communes. Deuxièmement, elle doit réduire le fossé entre primaire et secondaire inférieur, fossé générateur de discriminations tant sociales que de genre. L’enseignement de la littérature, tel que nous pouvons le reconstruire à partir des manuels de lecture, c’est-à-dire à travers les choix de corpus et les préfaces des concepteurs, se voit attribuer un rôle non négligeable dans cette entreprise de démocratisation et de renforcement du sentiment d’appartenance romande. Les trois manuels que nous avons brièvement présentés rendent compte de trois moments distincts. Le Dussaud et Gavard (1871) a pour objectif de rassembler des cantons et des classes sociales diverses, de les unifier au moyen d’une langue et d’une culture commune, au moment même où l’école primaire devient obligatoire. La réédition du Vinet par Rambert (1976) s’inscrit dans la continuité des manuels du XIXe siècle. Le concepteur y revendique le primat de la langue et de l’expression française, ainsi que celui d’une certaine éthique chrétienne, sur l’expression locale d’une spécificité culturelle. Ce manuel, destiné aux élèves de la fin du secondaire inférieur, reconduit au seuil du secondaire supérieur, l’écart qui prévalait jusqu’alors entre primaire et secondaire. Enfin, le Dupraz et Bonjour (1908) privilégie les spécificités culturelles romandes par rapport à la culture française et entend réduire la distance entre les élèves du secondaire inférieur et les œuvres littéraires. En d’autres termes, l’objectif ici est de permettre à tous les élèves d’accéder à une certaine culture littéraire romande.
La préface
La table des matières
Bibliographie
David, Jérôme (2017), «Enseigner la littérature: une approche par les participations», Transpositio, n°1.
Farquet, Raphaël (1994), Le tremplin et l’obstacle I et II, Genève, Département de l’instruction publique.
Meizoz, Jérôme (1996), «Le droit de mal écrire», Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 11-112, p. 92-109.
Ronveaux, Christophe & Chloé Gabathuler (2017), «Les fables à l’école d’un siècle en Suisse romande. Une comparaison des manuels du primaire et du secondaire», in M.-F. Bishop, L. Louichon & C. Ronveaux (dir.), Les fables à l’école. Un genre patrimonial européen?, Bern, Peter Lang, p. 75-94.
Pour citer l'article
Chloé Gabathuler, "Manuels de lecture genevois au début du XXe siècle ", Transpositio, Archives, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/manuels-de-lecture-genevois-au-debut-du-xxe-siecle
Haïku et pédagogie : le cas René Maublanc (1927)
En août 1927, la Revue Franco-Nippone publie une communication signée par René Maublanc (1891-1960) et intitulée «Le Haï-Kaï au lycée» (1927){{Maublanc écrit régulièrement dans cette revue : voir les numéros de février, mai, août et novembre 1926.}}. Dirigée par Akimasa Nakanishi, la Revue Franco-Nippone compte parmi ses collaborateurs des Japonais de Paris, d’éminents japonologues et des Français passionnés par le Pays du Soleil Levant. Parmi eux, Maublanc se profile comme l’un des principaux promoteurs du haïkaï dans la France de l’entre-deux-guerres.
Haïku et pédagogie : le cas René Maublanc (1927)
En août 1927, la Revue Franco-Nippone publie une communication signée par René Maublanc (1891-1960) et intitulée «Le Haï-Kaï au lycée» (1927)1. Dirigée par Akimasa Nakanishi, la Revue Franco-Nippone compte parmi ses collaborateurs des Japonais de Paris, d’éminents japonologues et des Français passionnés par le Pays du Soleil Levant. Parmi eux, Maublanc se profile comme l’un des principaux promoteurs du haïkaï dans la France de l’entre-deux-guerres.
Le haïkaï, une forme voyageuse
Sous l’appellation «haïkaï» se cache une forme poétique d’origine japonaise, dont la brièveté extrême fascine aujourd’hui encore l’Occident : le haïku2. Lorsque paraît «Le Haï-Kaï au lycée», le petit poème est déjà familier des lecteurs français. L’ouverture forcée du Japon en 1853-1854, la vogue japoniste initiée par les collectionneurs et les artistes, puis amplifiée par les diverses Expositions universelles, lui ont préparé un terreau fertile. Au Japon, sous l’impulsion du poète Masaoka Shiki (1867-1902)3, la forme connaît une importante réforme qui accentue sa circulation en Occident. Elle est d’abord connue en France grâce à des traductions4 et éveille l’intérêt des poètes au moment où le refus de l’éloquence, la recherche de l’impair et le souci du bref se placent au centre des préoccupations5. Fraîchement revenu d’un tour du monde, le jeune philosophe Paul-Louis Couchoud (1879-1959) – dont les travaux porteront plus tard sur Spinoza ou l’historicité de Jésus – compose les premiers haïkus en français au début du XXe siècle et les rassemble sous le titre Au fil de l’eau (2004 [1905]). Cette mince plaquette, tirée à compte d’auteur, est suivie d’études plus ambitieuses parmi lesquelles il faut citer Sages et Poètes d’Asie (1916)6. Couchoud y donne une définition qui influencera durablement la réception française de la forme :
Un haïkaï est une poésie japonaise en trois vers, ou plutôt en trois petits membres de phrase, le premier de cinq syllabes, le second de sept, le troisième de cinq : dix-sept syllabes en tout […] un simple tableau en trois coups de brosse, une vignette, une esquisse, quelquefois une simple touche, une impression. (1916: 53-54)
La Première Guerre mondiale fournit au haïku français une impulsion inattendue, lorsque des poètes s’en saisissent pour témoigner de l’enfer qu’ils ont vécu dans les tranchées. Parmi eux, l’Ardéchois Julien Vocance (pseudonyme de Joseph Seguin) rencontre le succès avec ses «Cent visions de guerre» (1916)7. Néanmoins, ce n’est qu’en septembre 1920 que la forme entre réellement sur la scène littéraire, à la faveur d’un numéro de La Nouvelle Revue Française (Paulhan [et al.] 1920)8. Jean Paulhan, initiateur de l’anthologie et alors secrétaire de La NRF, considère le haïku comme un terrain expérimental à investir collectivement pour revivifier la pratique poétique. Il s’en explique dans sa note liminaire :
Dix faiseurs de haï-kaïs, qui se retrouvent ici réunis autour de Couchoud, tâchent de mettre au point un instrument d’analyse. Ils ne savent pas quelles aventures, ils supposent la plupart que des aventures attendent le haï-kaï français – (qui pourrait trouver par exemple la sorte de succès qui vint en d’autres temps au madrigal, ou bien au sonnet ; et par là former un goût commun : ce goût justement qui passe pour préparer la venue d’œuvres plus décisives). (1920: 330)
La mode est lancée, les publications se multiplient, poètes et critiques s’emparent du petit poème. Ce sont ces floraisons foisonnantes que René Maublanc cherche à ordonner dès le milieu des années 1920, faisant preuve d’un sens aigu de la vulgarisation.
Le haïku, un instrument démocratique
Lorsque Maublanc publie «Le Haï-Kaï au lycée» (1920), voilà presque dix ans qu’il se penche sur cette forme qu’il nomme, dans le sillage du traducteur anglais Basil Hall Chamberlain, «épigramme lyrique du Japon» (Chamberlain 1902). Son approche témoigne d’une volonté de diffusion qui, dès 1920, s’appuie sur des préoccupations à la fois pédagogiques et politiques :
Nous souhaitons que tout homme cultivé, chez nous, s’exerce à cet effort, comme au Japon, où le paysan même et l’ouvrier se piquent, comme le lettré, de savoir tourner leur haï-kaï. Dans les pays et aux époques de grande vitalité littéraire, il existe des genres populaires que chaque amateur est capable de pratiquer lui-même […], tel est, au Japon, le haï-kaï, tel il pourrait être demain, en France, si l’on voulait bien nous suivre. Car la littérature d’un peuple n’est pas faite seulement de la production de quelques écrivains de métier ; elle est d’autant plus forte et vivante que plus d’hommes y collaborent dans un effort unanime. […] Dans un pays où le haï-kaï serait familier à tous, ces mille inspirations anonymes ne seraient plus toutes perdues pour l’art, et les efforts associés de tous ces ouvriers obscurs prépareraient la venue prochaine des œuvres décisives. (1920: 4-5)9
L’appel de Maublanc s’adresse avant tout à l’amateur, qui pratique la poésie par délassement – et non par métier. À ce poète particulier, le haïku fournit, par sa brièveté et l’exigence qu’il requiert dans le choix des mots, un instrument d’analyse de soi, «presque une méthode de vie» permettant de «décomposer ses sensations et ses sentiments jusqu’à l’élément le plus fugitif [pour y retrouver] une force profonde et essentielle de l’univers» (1920: 4). Si cet outil de connaissance n’est pas en lui-même garant de chefs-d’œuvre, il doit préparer «un milieu de culture favorable» et «[élever] le goût général» (1920: 5), afin d’être, «à brève ou longue échéance, créateur de beauté durable» (1920: 5). En 1923, afin d’illustrer les possibilités que le haïku ouvre en français, Maublanc compose à l’attention du grand public une série d’articles de vulgarisation, ainsi qu’une vaste anthologie-bibliographie qui réunit plusieurs dizaines d’auteurs pratiquant la forme en France (1923a, 1923b). Ses propres haïkus, régulièrement publiés dans des revues diverses, sont rassemblés en volume en 192410.
Démocratique et pédagogique, son approche s’explique par son orientation professionnelle et politique : enseignant en philosophie, il donne notamment des cours au lycée de Reims entre 1921et 1922, tandis qu’il travaille à son anthologie-bibliographie. En parallèle à ses activités d’écrivain, de revuiste et d’enseignant, il est actif dans des syndicats socialistes et communistes – ce qui lui vaut quelques démêlés avec ses supérieurs (Chipot 2013: 15-55). «Le Haïkaï au lycée» témoigne de cette double position : Maublanc y pose «le problème de la valeur pédagogique» d’une forme à même de remettre en question les «abus de verbiage» de l’«enseignement littéraire traditionnel», en ouvrant les élèves «à l’expression directe, concrète, d’une pensée originale» (1927: 35). Secouer la vieille rhétorique à l’aide du haïku ? Peut-être – mais avant de soulever la poussière qui recouvre Cicéron et Bossuet, il faut s’interroger sur le chemin que devra emprunter le haïku français afin de n’être ni «un jeu de mot [ni] un trait d’esprit» (1927: 35). Un problème que Maublanc souligne, non sans malice :
Pour cela, d’ailleurs, il faudrait que le haïkaï français eût ses règles strictes, comme le haïkaï du Japon : les mêmes qu’au Japon ou d’autres, mais des règles. C’est par la forme plus encore que par le fond que pêchent les essais des fillettes de Saint-Omer. […] Et cela encore est un utile enseignement : cela prouve qu’un bon haïkaï ne se fait pas par subite inspiration, qu’il n’est pas si facile à forger qu’on le croit d’ordinaire (1927: 36)11.
À près d’un siècle d’écart, les mots de René Maublanc résonnent encore, comme une invitation à se saisir d’une forme poétique paradoxale, à la fois si modeste mais si exigeante.
Magali Bossi
Le Haïkaï au lycée
Un de mes amis, professeur dans une petite ville du Nord de la France, vient d’introduire le haïkaï, comme exercice littéraire, dans l’Université12. À ses élèves du cours secondaire, – cinq jeunes filles de douze à quinze ans, – il a expliqué le sens et la forme de l’«épigramme lyrique du Japon» ; il leur a lu quelques beaux haïkaï japonais et quelques essais de haïkaï français ; puis, au lieu de la traditionnelle «narration»13, il leur a demandé de lui remettre des tercets composés par elles sur des sujets de leur choix. Les fillettes ont répondu avec joie à son appel, et j’ai devant moi les résultats de leur travail.
Que ces premières ébauches soient tout à fait satisfaisantes, on ne saurait le dire sans excès d’indulgence. Mais elles peuvent intéresser, par leurs qualités et par leurs défauts mêmes, les Français comme les Japonais. Et elles posent le problème de la valeur pédagogique du haïkaï.
Imposer à des élèves de lycée la concision du haïkaï, c’est les mettre en garde contre la rhétorique, l’éloquence, le «laïus».
Ceux qui connaissent par expérience notre enseignement littéraire traditionnel savent combien il peut être utile d’y réfréner les abus de verbiage. Le haïkaï est un excellent contrepoison à Cicéron et à Bossuet. Aussi bien, cet effort de brièveté, de concentration semble-t-il pénible à certaines des élèves qui s’y sont appliquées : dans la plupart de leurs haïkaï, il y a des adjectifs inutiles, des expressions toutes faites, – des longueurs.
Un autre objet, et plus profond, de cet exercice, serait d’amener les enfants à l’expression directe, concrète, d’une pensée originale. Les élèves de nos lycées voient la nature, les hommes, leur propre corps et leur propre cœur à travers les littératures anciennes et modernes dont on leur a bourré le crâne ; ils savent trop de vers des autres pour en créer qui soient bien à eux. Si pourtant on leur demande de noter, sans prétention et hors des cadres réguliers, une sensation, une émotion, un souvenir vécu, ils pourront quelquefois retrouver l’idée pure, la pensée vierge. Trois ou quatre fois, devant les haïkaï qu’a reçus mon ami Jean Laubier14, on a l’impression rafraîchissante d’une idée à l’état naissant.
Mais plus souvent, et par malheur, on trouve autre chose qu’un véritable haïkaï : un jeu de mots ou un trait d’esprit, ou une «pensée» à la manière de La Rochefoucauld. Le goût du «trait» et le goût de la «pensée» (l’un et l’autre d’ailleurs se confondant souvent) semblent ainsi des marques de ce qu’on appelle l’esprit français15.
Enfin, le haïkaï devrait donner à ceux qui s’y exercent le sens du rythme. Ce devrait être un travail poétique, c’est-à-dire un travail de construction, d’ajustage, une combinaison harmonieuse de syllabes en nombre choisi. Pour cela, d’ailleurs, il faudrait que le haïkaï français eût ses règles strictes, comme le haïkaï du Japon : les mêmes qu’au Japon ou d’autres, mais des règles. C’est par la forme plus encore que par le fond que pèchent les essais des fillettes de Saint-Omer. Les unes croient qu’un haïkaï n’est qu’une ligne de prose coupée arbitrairement et écrite sur trois lignes. D’autres négligent tout équilibre du vers et tout accord des sons. Et cela encore est un utile enseignement : cela prouve qu’un bon haïkaï ne se fait pas par subite inspiration, qu’il n’est pas si facile à forger qu’on le croit d’ordinaire. Il est agréable de constater que les premiers haïkaï de jeunes filles intelligentes et cultivées sont ingénieux et encourageants ; mais il est nécessaire qu’aucun ne soit excellent. Car un exercice ne vaut rien si l’on y réussit du premier coup.
En ce sens et sous ces réserves, j’espère que les lecteurs de la Revue Franco-Nippone reconnaîtront l’intérêt de cette expérience pédagogique. Je publie ci-dessous quelques exemples caractéristiques des haïkaï remis à Jean Laubier. Leurs auteurs ont quinze ans au plus ; la dernière a quatorze ans.
René Maublanc
Au loin, on voit s’approcher deux grands yeux.
Arrive un bruit sourd, lointain, un bruit confus.
Un sifflement aigu, un grincement, le train entre en gare.
Irène B…
***
Fier et solitaire,
La queue droite comme un épi,
Le chat se promène.
***
Un bêlement, un aboiement, une clochette,
Un ruisseau qui murmure,
Nuit dans la montagne.
Reynolde T.-R.
***
La chanson,
Comme une écharpe,
Flotte autour de ta voix.
***
La mer et le ciel. Un bateau
Vogue-t-il dans les nues
Ou sur l’eau ?
Édith N…
***
Du métal fondu.
Mêlez de la sueur d’homme.
Il en sort une machine.
***
Un travail, un péril immense.
La gloire aujourd’hui.
L’oubli demain.
Collette B…
***
Le muguet.
Clochette dont le son
S’est changé
En parfum.
Bibliographie
Barthes, Roland (2007 [1970]), L’empire des signes, Paris, [Éditions d’Art Albert Skira] Le Seuil.
Barthes, Roland (2003), La préparation du roman : I et II : notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980, Paris, Le Seuil.
Bassmann, Lutz (2008), Haïkus de prison, Paris, Verdier.
Chamberlain, Basil Hall (1902), «Bashô and the Japanese Poetical Epigram», Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. 2, n° 30, pp. 243-362.
Chipot, Dominique (2013), En pleine figure. Haïkus de la guerre de 14-18, Paris, Bruno Doucey.
Chipot, Dominique (2016), René Maublanc. Le haïku des années folles, Saint-Chéron, Éditions Unicité.
Couchoud, Paul-Louis (1906), «Les haïkaï (Épigrammes lyriques du Japon). I à IV», Les Lettres, avril-août.
Couchoud, Paul-Louis (1916), Sages et Poètes d’Asie, Paris, Calmann-Lévy.
Couchoud, Paul-Louis (2004 [1905]), (nouvelle édition établie par Éric Dussert), Au Fil de l’eau, Paris, Mille et une nuits.
De Rosny, Léon (1871), Anthologie japonaise : poésies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, Paris, Maisonneuve et Cie.
Gautier, Judith (1885), Poëmes de la libellule, [s.n.].
Jaccottet, Philippe (1967), Airs : poèmes : 1961-1964, Paris, Gallimard.
Jey, Martine (2005), «Quel enseignement littéraire pour les élites (1880-1924) ?», in Pierre Caspard, Jean-Noël Luc, Philippe Savoie, Lycées, lycéens, lycéennes, deux siècles d’histoire, Paris, Institut national de recherche pédagogique, pp. 199-210 (consulté sur www.persee.fr/doc/inrp_0000-0000_2005_act_28_1_9251).
Johnson, Jeffrey (2011), Haiku poetics in twentieth-century avant-garde poetry, Lanham, Lexington Book.
Léon, Antoine, Roche, Pierre (2012 [1967]), Histoire de l’enseignement en France, Paris, PUF.
Maublanc, René (1920), «Sur le Haï-Kaï français», La Gerbe, octobre, pp. 4-5.
Maublanc, René (1923a), «Le Haïkaï français, bibliographie et anthologie», Le Pampre, n°10-11, 2e année, pp. 1-62.
Maublanc, René (1923b), «Un mouvement japonisant de la littérature contemporaine : le Haï-Kaï français», La Grande Revue, n°2, février-mars.
Maublanc, René (1924), Cent Haïkaï, Maupré, Le Mouton Blanc.
Maublanc, René (1927) «Le Haï-Kaï au lycée», Revue Franco-Nippone, n° 6, août, pp. 34-37.
Paulhan, Jean [et al.] (1920), «Haïkaï», La Nouvelle Revue Française, n° 84, 1er septembre, pp. 329-345.
Senk, Pascale (2016), L’effet haïku, Paris, Leduc.s Éditions.
Shiki, Masaoka (2016), Un lit de malade six pieds de long (traduit, annoté et présenté par Emmanuel Lozerand), Paris, Les Belles Lettres.
Sirinelli, Jean-François (1994), Génération intellectuelle : Khâgneux et Normaliens dans l'entre-deux-guerre, Paris, Quadrige/PUF.
Pour citer l'article
Magali Bossi, "Haïku et pédagogie : le cas René Maublanc (1927)", Transpositio, Archives, 2019https://www.transpositio.org/articles/view/haiku-et-pedagogie-le-cas-rene-maublanc-1927
Voir également :
Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
... la «crise» frappe l’enseignement de la littérature tous les «vingt-cinq à trente ans, soit l’équivalent d’une génération (2005:8), depuis que celui-ci est inscrit comme tel dans les programmes scolaires. Je ne saurais donc que souligner – comme le font d’ailleurs, à la suite d’André Chervel (2006), Marie-France Bishop et Jean-Louis Dufays dans ce premier dossier que nous offre la nouvelle revue Transpositio – combien l’histoire d’une discipline scolaire...
Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
Dans votre ouvrage paru en 2015 et intitulé Enseigner la littérature aujourd’hui: «disputes» françaises (Paris, Champion), vous mettez l’accent sur les débats qui ont accompagné depuis une vingtaine d’années les réformes de l’enseignement de la littérature en France. Les prises de position, très tranchées et virulentes, ont été nombreuses. À relire certaines d’entre elles, on s’étonne de leur forte teneur émotionnelle. Comment expliquez-vous cette composante affective des débats? Serait-elle une caractéristique de la «crise» de l’enseignement de la littérature en ce début du XXIe siècle?
Je me permets de répondre à votre seconde question avant de proposer quelques explications à «cette composante affective des débats» qui ont accompagné les réformes de l’enseignement de la littérature en France au cours des vingt dernières années.
Cette «composante affective» ne me semble pas être une caractéristique de la «crise» de l’enseignement de la littérature en ce début du XXIe siècle, du moins pour ce qui concerne la France. En effet, comme tend à le souligner le titre donné au premier chapitre, cette «crise» est en quelque sorte «congénitale». Selon Alain Viala, président du groupe d’experts à l’origine des programmes de lycée vivement contestés au tout début des années 2000, la «crise» frappe l’enseignement de la littérature tous les «vingt-cinq à trente ans, soit l’équivalent d’une génération (2005:8), depuis que celui-ci est inscrit comme tel dans les programmes scolaires. Je ne saurais donc que souligner – comme le font d’ailleurs, à la suite d’André Chervel (2006), Marie-France Bishop et Jean-Louis Dufays dans ce premier dossier que nous offre la nouvelle revue Transpositio – combien l’histoire d’une discipline scolaire (ses évolutions et ses régressions en termes de finalités mais aussi de corpus, de contenus et de modalités d’enseignement) nous aide à comprendre les reconfigurations successives auxquelles elle est soumise.
La «teneur émotionnelle» qui caractérise les discours de déploration qui ont envahi la scène publique française au tournant du XXIe siècle n’est en rien exceptionnelle. Déjà au début du siècle précédent, Gustave Lanson a dû répondre aux vives attaques qui lui étaient adressées depuis la mise en application de la réforme de 1902, considérée alors comme le facteur essentiel de la «crise du français». Il lui a fallu expliquer à ses détracteurs que les changements sociaux et sociétaux observés à partir des années 1840 avaient accentué les écarts entre la culture littéraire classique enseignée au lycée, dont le public s’était diversifié, et la culture bourgeoise, dont les pratiques culturelles s’étaient également modifiées. Et une telle situation jalonne tout le vingtième siècle, période durant laquelle les politiques publiques d’éducation tendent progressivement à favoriser la massification et la démocratisation de l’enseignement scolaire et, plus tardivement, universitaire. Or, si les réformes Berthoin, Fouchet-Capelle et Haby 1, adoptées respectivement en 1959, en 1963 et en 1975, ont permis, en France, la massification de l’enseignement secondaire, sa démocratisation se fait attendre aujourd’hui encore, alors même que les acteurs politiques comme institutionnels n’ont eu de cesse tout au long du dernier demi-siècle de la promouvoir par une série de mesures, parfois contradictoires et contre-productives pour ce qui concerne l’enseignement de la littérature. C’est précisément ce que j’explique dans l’ouvrage L’enseignement de la littérature au collège (2005:25-91), duquel je vais tirer trois exemples afin de montrer combien cet enseignement répond à des enjeux sociaux et sociétaux et, par là même, à des enjeux politiques, raison pour laquelle toute orientation nouvelle donnée à cet enseignement est source de tensions et donc de réactions souvent très vives. On peut lire, par exemple, dans les Instructions du 27 octobre 1960 concernant «la lecture suivie et dirigée»:
[Il faut] restaurer dans une certaine mesure la notion de littérature qui a pris pour de nombreux esprits un sens péjoratif. Il faut montrer qu’elle n’est pas un jeu gratuit de l’esprit, une parade étincelante chargée de divertir la galerie, un musée poussiéreux d’écrivains qu’on salue au passage et qu’on s’empresse d’oublier, mais l’expression d’une époque dont elle reflète les idées et les rêves, les inquiétudes comme les espoirs, les déchirements comme les enthousiasmes, mais le témoignage d’hommes profondément engagés dans l’existence et qui nous font part de leurs multiples expériences. Nos élèves doivent savoir que la littérature est une force sociale, qu’elle forme et oriente les esprits, qu’elle dégage des styles de vie, qu’elle influe puissamment sur la mentalité et l’opinion et que, par suite, c’est avec sérieux qu’on doit la considérer 2.
Considérer la littérature et, de fait, son enseignement scolaire «avec sérieux» est alors d’autant plus indispensable qu’elle entre en concurrence, semble-t-il, avec un nouveau medium culturel (la télévision voire, dans une moindre mesure, le cinéma), susceptible de «forme[r] et [d’]oriente[r] les esprits». Situation qui conduit, par exemple, les auteurs du manuel Lire – Troisième (Descazaux & Littman), édité par Bordas en 1968, à émettre un véritable cri de détresse:
Homme sans passé, sans drame, sans langage, transparent et puéril, infiniment fragile, perméable à toutes les entreprises, et les plus vulgaires, de la propagande et de la publicité. Consommateur conditionné, automate consentant aux rouages bien huilés, curieux de déguisement, de violence et de bruit pour mieux dissimuler son néant intérieur. Dès lors comment douter que notre devoir le plus pressant soit de rendre à ce pantin son humanité? C’est à préparer les futurs adhérents des maisons de la culture qu’il nous faut œuvrer. Ah! Comme tout reprend sens et saveur dès que passe à nouveau le courant humain, dès que retentit la voix oubliée des poètes, dès que la litote, l’allusion, la nuance fine sont à nouveau entendues et saluées comme telles!
C’est également avec une grande charge affective que les auteurs du manuel Textes vivants – Expression personnelle – Sixième édité par Magnard en 1973 rappellent aux professeurs de français que leur mission est de «sauver la personne, au moment où elle risque d’être altérée par la mécanisation et la robotisation de la vie, happée par la fourmilière des villes, submergée par le déferlement d’images télévisées» (Arnaud L. & C.:6). On retrouve cette même «teneur émotionnelle» dans le propos tenu par l’universitaire français Jean Burgos en 1975: «J’ai l’impression que notre enseignement fait naufrage, il faut trouver au plus vite des solutions» (1977:97). Et, vingt-cinq ans plus tard, le Belge Karl Canvat dresse un constatanalogue à celui de son ainé: «Tout le monde connait la crise que traverse,depuis une trentaine d’années, l’enseignement de la littérature dans lesecondaire» (2001:151). Comme je m’efforce de le (dé)montrer dans la première partie de l’ouvrage auquel vous faites allusion, ces discours de déploration reflètent certes une situation conflictuelle mais ils sont aussi, selon moi, le signe de lavitalité d’un enseignement humaniste qui interroge sans cesse ses finalités, ses contenus,ses modalités. C’est d’ailleurs ce que tend également à rappeler Jean Caune dans sa monographie publiée en 2013. Selon ce spécialiste de la médiation culturelle, l’enseignement des sciences serait également en crise dans la mesure où il est en rupture avec l’état actuel du monde et de la société. Et, de fait, le chercheur questionne la place de la science au sein des humanités contemporaines.
La «forte teneur émotionnelle», perceptible dans les propos qui ont accompagné la mise en application de nouveaux programmes de français au tournant du XXIe siècle, est présente dans un grand nombre de discours tenus en réaction aux réformes successives qui ont jalonné le XXe siècle en vue d’adapter les disciplines scolaires – et, en particulier, l’enseignement de la littérature comme celui de la langue – à la réalité sociale et technologique du moment. À l’occasion des premières Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, Martine Jey ouvre sa communication par cette question: «Et si les débats et polémiques actuels étaient, pour une bonne part, la répétition des débats de la fin du siècle dernier?» (2001:35). On peut donner au moins deux explications, étroitement liées, à cette «composante affective des débat» d’hier et d’aujourd’hui.
La première réside dans les liens, plus ou moins ténus, qui unissent «humanités» et enseignement de la littérature, notamment française, depuis sa création, c’est-à-dire depuis l’instauration de l’explication de textes d’auteurs français au baccalauréat en 1840: mise en concurrence des humanités classiques et des humanités modernes dès le milieu du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, des humanités modernes et des méthodes dans la seconde moitié du XXe siècle (Veck 1994) puis «retour en force» des humanités au tournant du XXIe siècle (Denizot 2015) et questionnement sur la définition même des «humanités» aujourd’hui (Citton 2010; Doueihi 2008, 2011). Certes, comme N. Denizot le fait remarquer, «[d]ans le champ de l’enseignement, le terme “humanités” semble réapparaitre depuis quelques années, mais avec des acceptions qui ne sont pas complètement stabilisées» (Ibid.). On observe cependant depuis une décennie un recentrage des programmes sur la dimension humaniste3 de la culture – de la culture littéraire étroitement liée à la culture artistique, comme le soulignent les programmes de l’école et du collège de 2015 – et, de fait, sur la portée éthique, politique voire philosophique des œuvres. À l’heure où les valeurs de la République française sont ébranlées, l’enseignement de la littérature apparaît comme un espace de «formation des élèves à une posture éthique d’interprète, quels que soient les discours auxquels ils ont affaire. […] Il s'agit d'une préoccupation d'ordre politique, en ce qu'elle réintroduit la question de l'effet de vérité des textes et la question des valeurs que le lecteur actualise à leur contact» 4. On perçoit dans ces orientations, assumées tout à la fois par quelques acteurs institutionnels et par certains chercheurs (en didactique de la littérature mais aussi en philosophie éthique, en sociologie des valeurs, en théories littéraires), combien l’enseignement de la littérature est susceptible de répondre à des enjeux éthiques et politiques et, par voie de conséquence, de faire l’objet de débats à forte charge affective, et cela, indépendamment du contexte dans lequel ces débats s’inscrivent.
Afin de développer quelque peu cette deuxième explication, je vais prendre appui sur la double acception du terme «politique» que Paul Aron rappelle dans Le dictionnaire du littéraire (2002:590-591): le politique désigne «l’espace social de la confrontation des opinions et des intérêts des citoyens», la politique désigne «l’art de gouverner la cité». Et il précise:
Le domaine du littéraire ne peut être pensé à l’écart de ces deux acceptions. Il est, pour une part, un lieu d’intégration «civile» des citoyens dans la vie sociale, parce qu’il permet de maîtriser la langue, les discours, les savoirs et les représentations, et parce qu’il offre un moyen d’invention et de divertissement; d’autre part, il peut être vu comme un vecteur d’opinions et d’intérêts. La place et les missions qu’on lui accorde dépendent donc de choix (du) «politique(s)».
La réalité institutionnelle française d’hier et d’aujourd’hui confirme cette corrélation établie ici entre l’enseignement littéraire et le/la politique, tous deux reposant sur des idéologies variables. Cette corrélation explique donc aussi la dimension polémique que revêtent les réactions des uns et des autres lors de toute réforme affectant en profondeur les finalités de cet enseignement et, de fait, ses modalités ainsi que les corpus sur lesquels il repose. Le propos développé au tournant du XXIe siècle par François Baluteau au sujet de l’enseignement dispensé dans les collèges souligne les tensions idéologiques qui l’affectent alors et qui concernent aujourd’hui tout autant le lycée, soumis au phénomène de massification évoqué plus haut:
S’il [le collège] se cale sur l’égalité des chances, on dénonce un renoncement à une excellence intellectuelle, une chute culturelle de la Nation, s’il maintient une exigence savante, on entendra des voix déclarer l’élitisme, s’il s’engage dans une reconnaissance d’une éducation intégrale, certains verront les signes de la défaite intellectuelle. […] Le collège serait finalement réussi si tous les jeunes, qui lui sont confiés, pouvaient en sortir avec un égal «bagage culturel ». Et par conséquent, au centre de tous les problèmes et de tous les espoirs, se place l’accès du plus grand nombre à la culture savante. Celle-ci est défendue largement comme une fierté nationale 5. Elle est aussi un principe supérieur qui rend indécidable la solution égalitaire par un renoncement à une culture scolaire exigeante. (2001:6)
L’enseignement de la littérature cristallise la tension évoquée ici de façon plus générale. Pour certains (législateurs, enseignants, parents et même élèves, chercheurs, etc.), celui-ci vise (doit viser) à l’acquisition de ladite «culture savante», culture «commune» autour de laquelle il s’agit de fédérer des (pré-)adolescents aux identités diverses afin d’assurer la cohésion du groupe social, dont le fonctionnement est effectivement assujetti à une communauté de normes, de références. La religion a longtemps assuré cette fonction normative: elle parvenait à «lier» les hommes autour d’un même objet sacré, autour des mêmes valeurs morales. Il est dès lors attendu de l’enseignement de la littérature qu’il poursuive cette même finalité dans la mesure où, comme l’explique Emmanuel Fraisse, «même sans Dieu (et surtout peut-être sans Dieu), même sans Auteur et sans origine, le livre et la lecture demeurent, en dernière analyse, le lieu du lien, de la solidarité absolue, de la religion au sens propre du terme» (2000:594). Or, faire apparaître la littérature (et son enseignement) comme un «liant social», facteur d’harmonie dans une communauté que d’aucuns disent qu’elle souffre de déliquescence, n’est-ce pas l’asservir à des raisons d’État, comme le soulignent les auteurs de l’ouvrage S’approprier le champ littéraire?
Mais l’État n’a pas joué uniquement au cours des siècles le rôle d’une instance régulatrice ou répressive, l’État, par le biais de certains de ses appareils idéologiques ou hégémoniques (surtout l’Église au moyen âge et l’École aux temps modernes) a orienté les pratiques du champ littéraire.
Par l’art et la littérature, l’État entend produire des discours de cohésion sociale et diffuse des valeurs dans le langage de l’universel. […]
Progressivement l’Église céda ses prérogatives à l’Appareil Judiciaire d’État en matière de censure et sa fonction idéologique à l’Appareil Scolaire. (Rosier, Dupont & Reuter, 2000:144)
Que l’on adhère ou non à cette prise de position, il n’en demeure pas moins que les contours de cette discipline scolaire sont à interroger car, comme le montre Alain Vaillant, «nous sommes aujourd’hui engagés dans un bouleversement littéraire d’une ampleur exceptionnelle – peut-être le plus considérable depuis la Renaissance»: non seulement les outils numériques transforment les conditions de création, de diffusion et de réception de l’objet littéraire, mais «le processus global de mondialisation, qui touche les productions intellectuelles au moins autant que l’économie, remet en cause [le] modèle national» (2011:12) sur lequel la littérature s’est construite dans l’hexagone.
On peut percevoir dans cette rapide démonstration combien l’enseignement de la littérature s’est fondé et se fonde aujourd’hui encore sur des considérations idéologiques et politiques, ce qui explique la «teneur émotionnelle» des débats qui surgissent lors de toute réforme affectant ses finalités, ses contenus, ses modalités.
L’enseignement de la littérature est l’objet de pratiques et de réflexions de la part d’une grande diversité d’individus impliqués au primaire, dans le secondaire, dans les universités et les hautes écoles; dans les instances nationales et régionales chargées d’élaborer les programmes; parmi les formateurs et les formatrices; en didactique; et dans les études littéraires. Il semblerait, à vous lire, que les «disputes» récentes n’aient pas mobilisé au même degré chacun de ces champs. Existe-t-il néanmoins des préoccupations qui leur seraient communes − en dépit de ces divergences éventuelles?
Limitant ma réflexion à l’enseignement de la littérature au collège et au lycée en France – même si je convoque des recherches menées dans différents contextes de la francophonie –, il est vrai que certains des champs que vous évoquez peuvent sembler ne pas être concernés par ces «disputes». Je vais donc, avant de répondre à votre question, apporter quelques précisions concernant les choix que j’ai opérés.
Il faut savoir qu’en France les programmes sont élaborés par une instance nationale (la Direction générale de l'Enseignement scolaire, qui dépend du Ministère de l’Éducation nationale) et qu’ils concernent donc l’ensemble de la population scolaire de l’hexagone et des départements et régions d’outre-mer.
Les formateurs et les formatrices ont pour mission de relayer les prescriptions institutionnelles et de faciliter leur mise en œuvre. Si contestation il y a de leur part, c’est le plus souvent sous une autre «étiquette» que celle de formateurs ou de formatrices qu’elle s’exprime: ils/elles adoptent alors la posture du chercheur, qui questionne, entre autres, la validité de ces prescriptions. Les travaux de recherche en didactique de la littérature que je confronte sont donc aussi le fruit de formateurs et de formatrices engagés dans un travail de recherche personnel ou bien mené sous le pilotage d’un ou d’enseignants- chercheurs.
Par ailleurs, l’enseignement de la littérature au primaire, institué en France en 2002, a certes donné lieu à des discours multiples. Mais il s’est agi, au cours des quinze dernières années, principalement de configurer une «sous discipline du français» (Bishop 2016:383) et de donner naissance à une «didactique spécifique qui ne peut être totalement dissociée de l’apprentissage du savoir lire» (ibid.: 367),la didactique de la lecture littéraire «concern[ant] principalement les classes de collège et de lycée» (ibid.: 382). Très majoritairement et même si certaines résistances sont perceptibles au sein du corps enseignant, ces discours ne remettent pas en cause l’enseignement de la littérature de façon aussi virulente et aussi polémique que cela est le cas pour cet enseignement dans le secondaire et, plus particulièrement, au lycée 6. Et cela, pour deux raisons, me semble-t-il: cet enseignement concerne essentiellement la littérature de jeunesse, la littérature «consacrée» relevant de la «culture savante» n’est donc pas «menacée»; même si une théorisation didactique de la lecture littéraire à l’école, s’intéressant à la réception des textes par le sujet lecteur, se fait jour au tournant du XXIe siècle 7 et qu’une épreuve de littérature est inscrite au concours de recrutement des professeurs des écoles de 2005 à 2010, l’enseignement de la lecture des textes littéraires répond à deux finalités distinctes, comme tendent d’ailleurs à le rappeler les programmes du cycle 3 de 2015 8: des enjeux littéraires et de formation personnelle d’une part, des enjeux cognitifs et métacognitifs (développer la compréhension de l’écrit grâce à un enseignement explicite de celle-ci et contrôler son activité de lecteur) d’autre part. En raison de cette distinction et des corpus littéraires concernés, l’enseignement de la littérature à l’école ne «serait» donc pas contesté. Je modalise mon propos car je pense que les années à venir confirmeront ou infirmeront la validité de cette hypothèse.
Quant à l’enseignement de la littérature à l’université, il demeure prioritairement un enseignement magistral centré sur l’auteur, l’œuvre et le contexte historique, littéraire et artistique dans lequel celle-ci a émergé, comme je le montre dans un article récent rendant compte d’une enquête par questionnaire menée en 2014 auprès de quatre-vingt-deux professeurs stagiaires de lettres d’une même académie (Ahr 2017a). Il est vrai que certains universitaires s’efforcent de promouvoir un renouvellement de l’enseignement de la littérature: ouverture des corpus à la littérature toute contemporaine, prise en compte de l’actualisation des œuvres par les étudiants lecteurs, articulation entre lecture des œuvres et activités d’écriture, mise en dialogue de la littérature avec d’autres œuvres artistiques, etc. Mais, ces orientations ne sont pas majoritaires. Il est à noter cependant qu’un certain nombre d’universitaires, aux spécialités différentes, se sont engagés dans les débats qui ont dominé la sphère médiatique française au cours de la dernière décennie. En effet, il y a bien une préoccupation commune aux différents acteurs que vous listez dans votre question, et cette préoccupation ne concerne pas seulement la France: il s’agit de donner du sens à l’enseignement de la littérature, ainsi que le soulignent les auteurs de l’ouvrage Conditions de l’éducation:
Les disciplines littéraires sont parmi les plus touchées par le phénomène de perte de sens. [...]
Il faut se demander: pourquoi la littérature? On ne peut échapper à la question. Là-dessus les réformateurs ont raison. Il est vain de se voiler la face, le sens de l’enseignement de la littérature fait aujourd’hui question. Cette question doit être affrontée sans tabou ni préjugés. Est-ce l’objet littéraire en tant que tel qui est en cause, ou bien une certaine littérature? Est-ce sa fonction en général qui est atteinte, ou bien une certaine façon de la mettre en œuvre? En tout cas, l’interrogation sur la justification de cet enseignement ne saurait être éludée? (Blais, Gauchet & Ottavi, 2008:93, 95).
C’est un aspect que je développe, entre autres, dans le premier chapitre de la première partie de l’ouvrage auquel vous faites référence, en m’appuyant notamment sur les essais publiés au cours de la dernière décennie par des chercheurs dont les travaux s’inscrivent dans des champs différents 9. Consensus il y a donc quant à la nécessité de redéfinir les finalités de cet enseignement, de l’adapter à la réalité sociale, sociétale et technologique d’aujourd’hui.
En France, les prescriptions institutionnelles actuelles du lycée professionnel, de l’école et du collège s’appuient sur les travaux de recherche en didactique de la littérature menés depuis le tournant du XXIe siècle. Elles définissent clairement les finalités de l’enseignement de la littérature: acquisition d’une culture littéraire et artistique, formation personnelle, formation d’un esprit critique et de jugements de goût 10, mais aussi, pour l’école et le collège, compréhension de l’écrit, «[l]es activités de lecture mêl[a]nt de manière indissociable compréhension et interprétation» (2015:109). Cependant, leur mise en application requiert un accompagnement de la part de l’institution afin que les enseignants s’emparent également des fondements épistémologiques sur lesquels ces programmes reposent et donnent ainsi du sens aux choix didactiques qu’ils opèrent. De plus, la validité de ces prescriptions se trouve, pour l’école et le collège, contestée par le ministère recomposé suite aux élections présidentielles, et cette contestation concerne précisément les finalités que ces programmes attribuent à l’enseignement de la littérature et autour desquelles ils s’organisent. On perçoit bien ici les liens qui unissent littérature, idéologie et politique, encore aujourd’hui. Si l’on admet avec Antoine Compagnon que «l’initiation à la langue littéraire et à la culture humaniste, moins rentable à court terme, semble vulnérable dans l’école et la société de demain» (2007:31), on comprend aisément que cet apprentissage soit peu conforme à une idéologie basée sur la «rentabilité» immédiate. Néanmoins, force est de reconnaitre la nécessité d’interroger les contours de cette discipline scolaire – et, en premier lieu, les «justifications» de son enseignement, comme le confirme le choix que vous avez opéré pour ce premier dossier –, et de l’adapter à la société d’aujourd’hui. Donner du sens à cet enseignement et réévaluer ponctuellement ce sens à l’aune des évolutions sociétales et technologiques (et non politiques), certes ! Mais prenons le temps 11 de réfléchir aux enjeux prioritaires auxquels cet enseignement est susceptible de répondre et faisons en sorte que la recherche soit une force suffisamment convaincante et peut-être aussi persuasive pour influencer les choix politiques, desquels dépend la formation des citoyens de demain {{On remarquera la «composante affective» qui caractérise mon propre propos ! Peut-il en être autrement lorsqu’il s’agit du devenir des enfants et des adolescents à la formation desquels nous contribuons, de façon plus ou moins directe selon nos statuts respectifs?}.
La littérature est enseignée du primaire à l’université. Et chaque degré de scolarité ou de formation en fait un objet adapté à ses fins, à ses méthodes et à ses publics. Cela implique-t-il, dans les faits, qu’il y a autant de justifications de l’enseignement de la littérature qu’il y a de programmes ou de filières? Ou observe-t-on, au contraire, des cohérences partielles au sein de ces étapes multiples de la scolarisation et des études?
Je me permets tout d’abord de revenir sur votre affirmation: autant je vous rejoins quand vous précisez que «chaque degré de scolarité ou de formation fait [de la littérature] un objet adapté à ses fins, à ses méthodes», autant je nuancerais pour ce qui concerne l’adaptation de cet enseignement «à ses publics» dans la mesure où, d’une part, ces publics évoluent aujourd’hui très rapidement (par exemple, la culture des jeunes de 2018 est-elle vraiment celle des générations précédentes auxquelles appartiennent les adultes qui les forment?) et, où, d’autre part, la massification de l’enseignement, que j’ai évoquée précédemment, a pour conséquence de diversifier considérablement la population scolaire, voire universitaire. Sont-ce exactement les mêmes publics auxquels on enseigne si l’on exerce dans un établissement situé dans le centre d’une grande ville, ou dans un établissement situé à la périphérie de celle-ci? Or, les programmes scolaires français sont effectivement nationaux 12!
Pour répondre à votre question, il me faut distinguer les différents acteurs qui, d’une façon ou d’une autre, tentent d’assurer un continuum entre les divers paliers de l’enseignement scolaire et universitaire de la littérature. Et, faute de connaitre suffisamment bien l’histoire et la réalité présente d’autres systèmes éducatifs et universitaires, je limiterai ma réflexion à la France.
Les discours institutionnels tendent, de façon plus marquée aujourd’hui, à promouvoir une progression curriculaire de l’enseignement scolaire de la littérature. Ces discours favorisent la mise en place d’actions de formation professionnelle visant à assurer la liaison entre les différents cycles et degrés d’enseignement (liaison école/collège, collège/lycée, par exemple). Cependant, ces actions restent minoritaires et généralement d’une efficacité relative, compte tenu de la durée qui leur est accordée (le plus souvent, trois journées réparties sur une année scolaire). Comme j’ai pu le remarquer, ayant assuré moi-même ce type de formation, quand, sous l’impulsion de l’inspection, d’un chef d’établissement ou des enseignants eux-mêmes, ces actions de formation continue s’inscrivent dans la durée (sur deux ou trois années, par exemple), les échanges entre enseignants ne se centrent pas seulement sur les contenus et les modalités d’enseignement, mais également sur les finalités de cet enseignement (non sur «le faire», mais sur le (pourquoi/pour quoi faire»). Par ailleurs, autant il semble possible de faire émerger une certaine continuité entre l’enseignement de la littérature à l’école élémentaire et celui dispensé en début de collège 13, autant les difficultés surgissent quand il s’agit de faire réfléchir les professeurs à la liaison collège/lycée. Deux raisons peuvent expliquer cette situation. La première concerne la pression que les examens exercent sur les choix didactiques des enseignants: la préparation au baccalauréat 14 conduit les professeurs de lycée à privilégier un enseignement, souvent magistral, centré sur les procédés d’écriture à la source des effets programmés par le texte sur la réception par le «lecteur modèle» 15; la préparation au Diplôme national du brevet, que les élèves passent à l’issue de leur dernière année de collège, invitent les professeurs à privilégier l’étude de la langue et la compréhension de l’écrit 16[4]. La seconde raison tient à l’identité des concepteurs des programmes (spécialistes de la discipline ou de la didactique de cette discipline): cette identité détermine les conceptions de la littérature et des finalités de son enseignement ainsi que les fondements épistémologiques sur lesquels les programmes d’enseignement reposent 17.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la continuité entre l’enseignement scolaire et l’enseignement universitaire de la littérature, même si des mesures sont prises par l’institution pour assurer à tous la réussite de cette transition, les écarts en termes de finalités, de contenus et de modalités sont importants dans l’ensemble des disciplines, comme le souligne un article de Sophie Blitman, publié dans Le Monde du 25 mai 2017, au titre évocateur: «Du lycée à l’université: le grand écart». La journaliste, qui a mené une enquête auprès d’enseignants exerçant dans des universités réparties sur l’hexagone, note au sujet de l’enseignement des lettres:
En lettres, l'apprentissage de la grammaire et de la linguistique est renforcé en licence, où les étudiants élargissent par ailleurs leur culture littéraire en se confrontant davantage à des œuvres anciennes, du Moyen Âge ou du XVIe siècle. Mais «il existe une relative continuité, dans la mesure où l'objectif, in fine, est de comprendre le sens des textes», relève Cécile Rochelois, maître de conférences à l'université de Pau et membre de l'Association des professeurs de lettres.
[…] «Alors que les lycéens sont surtout formés à l'analyse stylistique et à l'interprétation d'un texte seul, on leur demande, à l'université, de disserter sur plusieurs œuvres qu'il s'agit de mettre en relation les unes avec les autres, en les replaçant dans leur contexte historique et idéologique», indique Romain Vignest, président de l'Association des professeurs de lettres. Et de souligner que «l'université attend une vision plus globale qui fait parfois ressortir le manque de culture des étudiants».
Les finalités de l’enseignement universitaire de la littérature seraient donc tout d’abord de développer la culture littéraire des étudiants et, «in fine», de leur permettre de «comprendre le sens des textes». Peut-on dès lors parler d’«une relative continuité» entre l’enseignement scolaire et l’enseignement universitaire de la littérature?
Enfin, les plans de formation initiale des enseignants, que proposent les Écoles supérieures du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ) créées en 2013, prévoient des actions visant à favoriser une réflexion sur la continuité des apprentissages de l’école au lycée. Les enseignant débutants sont donc sensibilisés à la nécessité d’envisager leur enseignement de la littérature au sein d’un espace qui ne se réduit pas au(x) seul(s) niveau(x) dans le(s)quel(s) ils enseignent ou enseigneront. Cependant, ainsi que je le montre dans un article paru très récemment (Ahr 2017b), une harmonisation des discours institutionnels s’avère indispensable: la confrontation des rapports de jury des deux épreuves orales du Capes externe de lettres modernes des trois dernières sessions (2014-2016) et des divers textes et documents officiels cadrant aujourd’hui l’enseignement de la littérature dans le secondaire me conduit à mettre au jour certaines contradictions, qui reflètent des conceptions différentes – ou, tout du moins, non stabilisées – de l’enseignement scolaire de la littérature, notamment en lien avec les autres langages artistiques. Ces contradictions sont à la fois internes, puisqu’on relève des orientations divergentes au sein des diverses commissions ou bien d’une année sur l’autre, et externes, si l’on met certaines de ces orientations en écho avec celles privilégiées par le ministère de l’Éducation nationale dans ses textes de cadrage récents.
En conclusion, ce premier «dossier» de Transpositio consacré aux «justifications de l’enseignement de la littérature» dans une perspective à la fois synchronique et diachronique montre combien il est important de réfléchir à l’articulation possible, aujourd’hui, entre ces diverses justifications et cela, à tous les paliers de la scolarité et de la formation universitaire et professionnelle. En effet, que ces finalités soient d’ordre cognitif, langagier, esthétique, culturel, éthique, social et/ou philosophique, elles déterminent la nature des connaissances et des compétences à construire ou à développer et, par voie de conséquence, les situations d’enseignement les plus propices à la réalisation des objectifs d’apprentissage ainsi clairement définis tant par/pour l’enseignant que par/pour l’élève. Avant d’enseigner ou d’apprendre la littérature, il y a lieu, dans un cas comme dans l’autre, de savoir «pour quoi faire», «pourquoi étudier la littérature», aspect auquel bon nombre de chercheurs (voir note 9) se sont intéressés au cours de la dernière décennie. C’est à cette condition que le professeur, quel que soit le niveau dans lequel il enseigne, opérera les choix didactiques adéquats (connaissances et compétences visées, contenus et modalités d’enseignement, corpus, supports, évaluations) et que les élèves, comme les étudiants, prendront plaisir à découvrir des textes et des œuvres dont la lecture leur est généralement imposée.
Votre ouvrage aborde la spécificité française des «disputes» concernant l’enseignement de la littérature. Cela signifie-t-il que la France fait exception sur ce point?
Si j’aborde dans l’ouvrage la spécificité française des «disputes», c’est en premier lieu parce que c’est l’espace que je connais le mieux. Mais il me semble aussi que les liens qui se sont tissés au cours des siècles entre littérature, école et politique sont spécifiques à la France et expliquent les changements successifs des programmes de français et, en particulier, de ceux de littérature, qui reposent sur des conceptions différentes du littéraire et sur des enjeux différents assignés à son enseignement.
Francis Marcoin explique, par exemple, dans son ouvrage À l’École de la littérature les liens étroits qui unissent l’École et la littérature:
École et Littérature, Littérature et École, de quelque façon qu’on prenne les choses, ce couple reste inséparable dans la France telle qu’elle s’est constituée tout au long du XIXe siècle, depuis la Révolution de 1789. Les livres ont existé bien avant la généralisation de l’instruction, et inversement il existait de la lecture sans livre et sans littérature. Mais l’Institution littéraire et l’Institution scolaire se sont développées solidairement et conflictuellement, en débordant le domaine d’une minorité lettrée ou d’une demande populaire fractionnée pour s’ouvrir à l’ensemble d’une population qui a fait siennes les images idéales où se construit la figure du lecteur que tous ne seront pas, mais que chacun rêve d’être. […] Sur le long terme, c’est l’école qui, bien ou mal, assure à la littérature l’essentiel de son statut, en diffusant les textes, en créant un horizon d’attente, en soutenant la commercialisation des livres (activités de lectures suivies, lectures conseillées) et en générant une corporation enseignante dont au moins une forte minorité est étroitement mêlée à la production et à la consommation de littérature. (1992:68-69)
De plus, comme je l’ai déjà rappelé, la littérature française et donc son enseignement ont été longtemps considérés en France comme un vecteur d’unification sociale. C’est notamment ce que tend à souligner la Circulaire du 15 juillet 1890:
Les grands écrivains français figurent à présent sur tous les programmes: dans l’enseignement spécial ils tiennent la première place, par les écoles supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses ils pénètrent dans l’enseignement primaire pour l’élever et le vivifier. N’offrent-ils pas ainsi le lien que l’on cherchait pour unir entre eux, sur quelques points du moins, des enseignements si dispersés? Du lycée à la plus modeste école de village ne peut-il ainsi s’établir une sorte de concert entre tous les enfants de la même patrie?
Il est quelques grands noms que tous connaîtront, quelques belles pages que tous auront lues, admirées, apprises par cœur: n’est-ce pas une richesse de plus ajoutée au patrimoine commun? N’est-ce pas un précieux secours pour maintenir, par ce qu’il a de plus intime et de plus durable, l’unité de l’esprit
national 18?
Et, effectivement, dans les instructions publiées sous les IIIe et IVe République, le caractère national de la littérature est fortement souligné. Après la suprématie des textes antiques dans l’enseignement des lettres, il apparait comme fondamental que l’école de la République transmette à ses futurs citoyens le patrimoine culturel sur lequel elle s’est fondée. De même, les avant-propos qui accompagnent les manuels font apparaitre un discours qui insiste sur la précellence de la littérature française, signe du «génie français» 19. Je cite ici un exemple parmi bien d’autres:
De plus, ils [les textes littéraires] sont empruntés exclusivement à la littérature française,les traductions des œuvres étrangères se prêtant peu à la culture littéraire et à la formation du goût. Mais lorsque les traducteurs s’appellent Fénelon ou Leconte de Lisle, leurs traductions d’Homère appartiennent évidemment à la littérature française. À ce titre, nous le savons retenues. (Philippon & Plantié, 1927. Je souligne.)
Je ne peux pas développer cet aspect dans le cadre de cette «conversation critique», mais l’analyse diachronique des instructions officielles et des manuels publiés au XXe siècle (Jey 1998; Houdart-Merot 1998; Ahr 2005; contribution de Marie-France Bishop à ce premier dossier de Transpositio) confirme la prédominance de la littérature «franco-française» dans les programmes scolaires français, celle-ci étant considérée comme un bien national dont l’École doit assurer la transmission. Ce n’est qu’au tournant du XXIe siècle où l’on observe une certaine ouverture aux autres littératures, que les programmes de l’école, du collège et du lycée général et technologique de la fin des années 2000 remettent en question. Nouveau ministère peu d’années plus tard, nouveaux programmes pour l’école et le collège fondés sur une conception plus ouverte de la littérature et des finalités de son enseignement ! On ne peut nier que celui-ci repose, en France, sur des conceptions idéologiques contrastées et donc sur des choix politiques qui varient au fil des changements gouvernementaux. C’est d’ailleurs ce que Paul Aron laisse entendre à la toute fin de son article du Dictionnaire du littéraire auquel j’ai déjà fait référence, puisqu’il précise que «l’idée qu’un président de la République se sente obligé de faire état de ses préférences littéraires est caractéristique de la relation qui unit politique et littérature dans la tradition française» (2002:591).
Pour conclure, si vous le voulez bien, permettez-nous une question un peu plus personnelle. On l’a vu, les répertoires de justification de l’enseignement de la littérature sont pluriels aujourd’hui, et ils se multiplient d’autant si l’on privilégie une approche historique sur la longue durée. À considérer toutefois l’avenir de cet enseignement, lequel de ces répertoires vous semble-t-il le plus pertinent et le plus prometteur?
Je ne pense pas qu’un répertoire soit «plus pertinent» et «plus prometteur» qu’un autre. J’estime, en revanche, que les multiples finalités assignées, hier et aujourd’hui, à l’enseignement de la littérature doivent être étayées épistémologiquement – cet étayage devant conjuguer divers champs théoriques des sciences humaines et sociales – et que ces justifications plurielles soient connues des enseignants, à quelque niveau qu’ils exercent, afin qu’ils opèrent des choix didactiques motivés. D’ailleurs, n’est-ce pas là l’un des enjeux de votre revue et, plus particulièrement, de ce premier dossier?
Avant de donner à lire et, éventuellement, d’étudier collectivement une œuvre ou un texte littéraire, la question à se poser est en effet non de savoir si elle/il est ou non conforme aux prescriptions institutionnelles (si elle/il figure dans les programmes), si cette étude préparera efficacement la classe aux évaluations certificatives, mais de savoir si elle répond aux enjeux que l’enseignant donne à son enseignement à un instant T en fonction du profil et des besoins des élèves, besoins en termes d’apprentissages et de formation personnelle (connaissances et compétences inscrites dans les référentiels, développement d’une culture littéraire et artistique, construction de l’identité individuelle et sociale, découverte de l’autre, etc.). Il revient donc à chacun de se demander, en premier lieu, pourquoi/pour quoi il choisit de faire lire et étudier à cette classe cette œuvre, ce texte; dans quelle mesure ce choix contribuera efficacement à la formation de ses élèves lecteurs, sachant que cette formation est d’une grande complexité et que l’on ne cherche pas, à l’école (et peut-être aussi, dans certains cas, à l’université), à former des lecteurs experts mais des lecteurs autonomes, capables de comprendre ce qu’ils lisent, d’interroger les représentations de l’homme et du monde que l’œuvre ou le texte leur renvoient, de percevoir l’aptitude du langage à dire le monde (dans sa diversité), d’émettre un jugement esthétique et/ou éthique personnel fondé, etc. De la réponse à ces questions préliminaires dépendront les choix que l’enseignant opérera pour ce qui concerne les modalités et les supports d’enseignement et d’apprentissage, ceux-ci pouvant être aujourd’hui de natures fort diverses20 et leur utilisation produisant également des effets différents en termes d’apprentissages.
Et, pour conclure, je reprendrai l’une des phrases par lesquelles j’achève la réflexion que je mène dans l’ouvrage qui est le point de départ de cette «conversation critique»: «Littérature, lecture, culture, humanité se déclinent désormais au pluriel». C’est, selon moi, cette pluralité qui est à privilégier dans l’enseignement de la littérature et qui doit aussi caractériser les finalités qui lui sont assignées. Il faut veiller cependant à ce que chacune d’elles conduise à des choix didactiques adéquats. Lire une œuvre littéraire ou lire un extrait de cette œuvre ne répondent pas à la même finalité. Lire (étudier) une œuvre pour rendre compte de sa compréhension globale, pour identifier le courant littéraire et artistique dans lequel elle s’inscrit, pour interroger le passé à la lumière du présent et/ou le présent à la lumière du passé, pour confronter son propre système de valeurs à celui porté par un ou des personnages, pour découvrir une culture temporellement et/ou géographiquement différente, pour développer sa sensibilité esthétique, etc., conduit à développer des postures de lecture et, de fait, des modalités d’enseignement et d’apprentissage différentes mais aussi complémentaires. On mesure combien la tâche de l’enseignant est complexe aujourd’hui (indéniablement, bien plus qu’hier) et, par conséquent, combien il est important d’assurer la circulation des savoirs entre la recherche, la formation et le terrain enseignant. On ne peut donc que féliciter l’équipe à l’origine de ce projet de création d’un «espace collectif de recherche sur l’enseignement de la littérature», accessible à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, se sentent concernés par cet enseignement, objet de multiples controverses, passées et présentes, qui sont aussi le signe de sa vitalité.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2005), L’enseignement de la littérature au collège, Paris, L’Harmattan.
Ahr, Sylviane (2017a), «Les écritures de la réception chez les professeurs stagiaires de lettres», in Les formes plurielles des écritures de la réception, Namur, Presses Universitaires de Namur, coll. Diptyque, vol. 1, p. 95-109.
Ahr, Sylviane (2017b), «L’enseignement de la littérature en dialogue avec les arts: des discours institutionnels à harmoniser», Pratiques, 175-176 | 2017, mis en ligne le 22 décembre 2017.
Arnaud, Louis et Charlotte (1973), Textes vivants – Expression personnelle – Sixième, Paris, Magnard, 1973 (livre du professeur).
Aron, Paul, Denis Saint-Jacques & Alain Viala (dir.) (2002), Le dictionnaire du littéraire, Paris, Presses Universitaires de France.
Baluteau, François (2001), «Le collège et ses tensions» in Collèges sous tension. Perspectives documentaires en éducation, n° 50/51, INRP, p. 5-9.
Bishop, Marie-France (2016), «Lire, comprendre, interpréter? Quels objectifs pour la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire, en France, depuis la fin du XIXe siècle», in A. Petitjean (dir.), «Didactique du français et de la littérature», Recherches textuelles, n° 14, Metz, CREM Université de Lorraine, p. 367-386.
Blais, Marie-Claude, Marcel Gauchet & Dominique Ottavi, (2008), Conditions de l’éducation,Paris, Stock.
Burgos, Jean (1977), «Littérature-inventaire ou littérature à réinventer? Regard sur le Second Degré», in L’enseignement de la littérature – Crise et perspectives, Actes du colloque organisé par la Faculté des Lettres modernes de Strasbourg (11-12 décembre 1975), Paris, Nathan, «Université Information Formation», p. 87-97.
Canvat, Karl (2001), «Recherches et formation au Cedocef (Centre d’étude et de documentation pour l’enseignement du français de l’Université de Namur)», in Marie-José Fourtanier, Gérard Langlade, Annie Rouxel (dir.), Recherches en didactique de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 150-154.
Caune, Jean (2013), Pour des humanités contemporaines – Science, technique, culture: quelles médiations?, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Citton, Yces (2007), Lire, interpréter, actualiser – Pourquoi les études littéraires?, Paris, Éditions Amsterdam.
Citton, Yves (2010), L’avenir des humanités – Économie de la connaissance ou cultures de l’interprétation?, Paris, La Découverte.
Compagnon, Antoine (2007), La littérature, pour quoi faire?, Paris, Collège de France / Fayard.
Denizot, Nathalie (2015), «Les humanités, la culture humaniste et la culture scolaire», Tréma, n° 43, mis en ligne le 25 juin 2015, consulté le 30 septembre 2015.
Descazaux, Pierre & Alfred Littman (1968), Lire – Troisième, Paris, Bordas.
Doueihi, Milad (2008), La grande conversion numérique, suivie de Rêveries d’un promeneur numérique, Paris, Éditions du Seuil.
Doueihi, Milad (2011), Pour un humanisme numérique, Paris, Éditions du Seuil.
Dufays, Jean-Louis (dir.) (2007), Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
Dulong Gustave (1925), Morceaux choisis des Auteurs Français – Troisième, Paris, Delamain.
Élèves-inspecteurs de l’École nationale supérieure de Saint-Cloud (1972), Un demi-siècle de pédagogie du français à travers les textes officiels (1923-1972), ENS Saint-Cloud, C.R.E.F.E.D., CRDP Limoges.
Fraisse, Emmanuel ([1989], 2000, 2e éd.), «Le livre, la lecture et le lecteur dans la critique littéraire en France (1880/1980)», in Anne-Marie Chartier & Jean Hébrard, Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, BPI Centre Pompidou, p. 561-594.
Houdart-Merot, Violaine (1998), La Culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes / Adapt Éditions.
Jey, Martine (1998), La littérature au lycée - Invention d'une discipline (1880-1925), Metz, CREM Université de Lorraine.
Jey, Martine (2001), «L’enseignement du français et ses enjeux sociaux: le point de vue de Lanson», in Marie-José Fourtanier, Gérard Langlade, Annie Rouxel (coord.), Recherches en didactique de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes p. 35-39.
Jouve, Vincent (2010), Pourquoi étudier la littérature?, Paris, Armand Colin.
Maingueneau, Dominique (2006), Contre Saint Proust ou la fin de la littérature, Paris, Éditions Belin.
Marcoin, Francis (1992), À l’école de la littérature, Paris, Les Éditions Ouvrières.
Merlin-Kajman, Hélène (2016), Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard, NRF Essais.
Ministère de l’Éducation nationale (2009), Lycée professionnel – Ressources Baccalauréat professionnel – Lire. En ligne.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2015), Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). En ligne.
Philippon, P. & B. Plantié (1927), Les Lectures littéraires de l’école – Cours supérieurs, Cours complémentaires et EPS, Paris, Larousse.
Rosier, Jean-Maurice, Didier Dupont & Yves Reuter (2000), S’approprier le champ littéraire. Propositions pour travailler l’institution littéraire en classe de français, Bruxelles, DeBoeck-Duculot.
Schaeffer, Jean-Marie (2011), Petite écologie des études littéraires – Pourquoi et comment étudier la littérature?, Vincennes, Éditions Thierry Marchaisse.
Vaillant, Alain, (2011), L’histoire littéraire, Paris, Armand Colin.
Veck, Bernard (dir.) (1994), La culture littéraire au lycée: des humanités aux méthodes, Paris, INRP.
Viala, Alain, (2005), «Former la personne et le citoyen – Entretien avec Alain Viala», Le Débat, n° 135, Paris, Gallimard, p. 7-21.
Pour citer l'article
Sylviane Ahr, "Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature", Transpositio, Conversations critiques, 2018https://www.transpositio.org/articles/view/entretien-disputes-et-justifications-de-l-enseignement-de-la-litterature
Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
Raphaël Baroni a fait le choix de s’inscrire dans la tradition – aussi glorieuse que délaissée – des théoriciens de la littérature qui conjuguent un intérêt pour de nouvelles formes d’approches du texte littéraire et pour les processus de leur enseignement.
Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
Raphaël Baroni a fait le choix de s’inscrire dans la tradition – aussi glorieuse que délaissée – des théoriciens de la littérature qui conjuguent un intérêt pour de nouvelles formes d’approches du texte littéraire et pour les processus de leur enseignement. Son dernier ouvrage, Les Rouages de l’intrigue1, s’emploie ainsi à penser à nouveau frais une question importante pour la théorie littéraire, celle de l’intrigue, tout en interrogeant la possibilité de son traitement scolaire. S’agissant de la réflexion didactique de l’auteur, précisons d’emblée qu’il s’y prend avec une modestie qui montre sa connaissance de la complexité des problèmes en jeu : c’est ce qui le distingue de nombre de littéraires qui, s’aventurant dans les questions de l’école, supposent tout en connaitre sans en rien étudier.
L’intérêt de Baroni pour l’enseignement scolaire de la littérature et son approche didactique est ancien, ce dont témoigne l’intéressant dossier qu’il a dirigé avec Antonio Rodriguez, Les passions en littérature, où se côtoient (plus qu’ils ne discutent à vrai dire) littéraires et didacticiens2. Le nouvel ouvrage poursuit donc une préoccupation constante, que confirment les remerciements liminaires et la préface demandée à Jean-Louis Dufays.
Cette alliance de deux préoccupations théoriques, littéraire et didactique, peut à elle seule laisser entrevoir l’intérêt que trouveront les lecteurs de Transpositio à Rouages de l’intrigue ; mais ce n’est pas la seule : l’ouvrage possède en effet, entre autres vertus, celle de donner une idée la plus claire possible de la conception que l’auteur propose de l’intrigue, reprenant l’essentiel de son magistral ouvrage sur la question, paru dix ans plus tôt3, tout en faisant le choix, par souci de clarté d’exposition et d’efficacité didactique, d’une triple réduction de son approche aux formes verbales, textuelles et littéraires du récit.
L’ouvrage veut aider à comprendre le ressort du plaisir que peut susciter chez le lecteur la tension narrative qui est comme le moteur de l’intrigue d’un récit. Traitant la question en narratologue, Baroni essaie de comprendre comment le récit peut intriguer le lecteur et comment ce dernier peut jouer le jeu de l’intrigue. Reprenant les anciennes théories littéraires et leurs développement récents, il les confronte aux apports d’autres disciplines, principalement la didactique, la philosophie morale et les sciences cognitives, pour expliquer la fonction et le fonctionnement de l’intrigue, dont «l’expérience esthétique» possèderait, selon l’auteur (p. 14), une «valeur anthropologique fondamentale».
Dans son essai de clarification conceptuelle, Baroni fait, dans sa première partie, un tour d’horizon historique des approches théoriques de l’intrigue, pour construire un solide réseau conceptuel qui permet de distinguer configuration du savoir sur les évènements narrés (qui, en donnant sens et forme à l’histoire, crée un effet de concordance dans la lecture) et intrigue, destinée à saisir le lecteur (et qui, par la tension qu’elle instaure, crée un effet de discordance). Cette distinction, établie non comme une dichotomie mais plutôt comme une polarité, fait apparaitre deux modalités de fonctionnement du récit – qui peut s’opérer aussi bien dans les récits fictionnels que factuels ; elle peut se projeter sur une autre distinction, entre récits mimétiques (tendanciellement intrigants) et informatifs (tendanciellement configurants), sachant par ailleurs que ces deux catégories (dont la distinction ne recoupe pas non plus celle entre récits factuels et fictionnels) peuvent bien sûr faire apparaitre (mais de façon tendanciellement variable) configuration et intrigue. La mise en intrigue n’est cependant pas qu’une affaire de stratégie textuelle (qui agence la séquentialité de l’histoire et celle du récit) mais une question d’interaction discursive, où le lecteur doit actualiser les potentialités du texte : le rôle du lecteur – de son interprétation au sens fort du terme – dans le fonctionnement de l’intrigue est l’un des apports principaux de l’approche de Baroni sur la question.
La deuxième des trois parties (dont la centralité est encore soulignée par le fait qu’elle porte le même titre que celui de l’ouvrage) investigue le fonctionnement de l’intrigue. La description des modalités de l’intrigue fait ressortir l’interaction entre la réticence qui s’observe dans la mise en texte de l’histoire et le travail cognitif du lecteur pour déjouer cette réticence afin de se représenter l’histoire, de manière évolutive et toujours un peu surprise : c’est cette interaction qui permet de comprendre l’effet esthétique de la mise en intrigue, sous la forme du suspense ou de la curiosité (il faut noter l’abandon, assez heureux, du concept de « fonction thymique », que proposait l’ouvrage antérieur, pour désigner la dimension affective de ces effets chez le lecteur). Enfin, se plaçant dans une logique fonctionnelle, qui veut identifier quelles fonctions peuvent – au moins virtuellement – remplir telle ou telle forme textuelle ou discursive, Baroni revisite quelques concepts saillants de la narratologie ou de la linguistique de l’énonciation, pour montrer comment les caractéristiques formelles du récit peuvent concourir à la dynamique de la mise en intrigue.
Cette dimension est ce qui fait l’apport le plus original de l’ouvrage par rapport aux travaux précédents de l’auteur, puisqu’elle n’avait pas été traitée dans l’ouvrage de 2007, La Tension narrative. C’est du reste l’intention didactique qui explique cet ajout : car même si Baroni s’abstient à juste titre de faire des propositions concrètes pour la classe, le choix d’articuler des notions nouvelles à celles qui relèvent d’une culture théorique partagée, associé aux analyses de textes proposées dans la troisième partie de l’ouvrage, donne à ses lecteurs les clés nécessaires à la conception d’outils pour penser l’enseignement de la question de l’intrigue. L’analyse de belle facture des textes singuliers choisis (Derborence de Charles Ferdinand Ramuz, Le Roi Cophetua de Julien Gracq, Les Gommes d’Alain Robbe-Grillet) ne sonnent pas comme des applications, mais comme des ouvertures qui interrogent les ressorts de l’intrigue dans ces œuvres, en exploitant les outils théoriques construits mais en les associant à des modalités d’analyses (contextuelles, textuelles, intertextuelles) classiques.
Cette approche de la didactique, qui laisse aux acteurs de l’enseignement la responsabilité de le penser, est aux rebours d’une conception descendante et est l’une des formes que prend l’heureuse modestie de l’auteur en la matière. Pour autant, l’ouvrage n’est pas exempt de traces d’une conception applicationniste de la relation entre les théories littéraire et didactique. On les trouvait en germe dans Les passions en littérature. De la théorie à l’enseignement – dont le titre, comme celui de l’introduction, «Instruire par les émotions : théorie et didactique littéraires», dit assez cette conception d’une application de la théorie à la pratique et d’un cantonnement de la didactique à cette dernière, quand il s’agit de «transformer un propos théorique en une didactique de la littérature», pour reprendre les mots de l’introduction de ce même ouvrage. Dans Les Rouages de l’intrigue, cela se traduit par l’utilisation du syntagme «théorique et didactique» (p. 19), mais aussi par une utilisation abusive de l’expression «transposition didactique» (par exemple p. 19), puisqu’au rebours du concept didactique, élaboré au départ en didactique des mathématiques4et repris ensuite dans d’autres didactiques, il est question ici d’une application pratique de savoirs théoriques, sans égard pour la transformation de nature qu’opère le processus sur ces savoirs.
Peut-être pourrait-on aussi s’interroger sur le choix de reprendre au début du chapitre 2 (sous le titre «Premier et second degrés de la lecture») les dichotomies classiques avancées pour classer les modalités (scolaires ou non) de lecture. Que ces dichotomies aient été et soient encore reprises par des didacticiens (dont certains sont cités ici), n’empêche pas qu’elles reposent sur une fable – que j’avais, sans grand succès, tenté de déconstruire il y a vingt ans5, non pour laisser accroire que ces modalités «se rejoignent dans une conception “postmoderne” de la littérature» (pour reprendre les termes de Baroni, p. 50), mais tout simplement pour faire apparaitre leur inconsistance théorique. Une autre vision dichotomique se donne à voir dans le traitement de l’histoire de la théorie littéraire et de sa destinée scolaire (formalisme vs rhétorique, narratologie classique vs postclassique), dans le but d’opposer une ancienne approche, présentée comme négligente voire méprisante à l’égard de l’intrigue, et une nouvelle qui la revaloriserait. Outre la fonction rhétorique, bien connue dans l’écriture de recherche, d’une telle position dans la construction d’une niche, ce propos semble en fait obéir ici à un topos théorique (assez vivace en didactique) qui privilégie les excès de quelques épigones au détriment du travail de fond des théoriciens les plus marquants, dont une relecture permet d’interroger de telle dichotomies. Du reste, cela est illustré dans l’ouvrage même de Baroni, par les nombreuses citations qui, fussent-elle concédées et minorées, montrent combien les auteurs censés relever de l’ancienne théorie, peuvent aisément concourir à la nouvelle approche. Au point que l’ouvrage apparait finalement presque comme une contre-illustration de cet affichage de rupture : c’est plutôt la normale continuité théorique qui ressort de sa lecture.
Cela n’est pas le moindre gage du sérieux des Rouages de l’intrigue : dans une logique cumulative qui caractérise la pratique scientifique, il capitalise les apports les plus intéressants pour cerner son objet. Il le fait avec l’assurance du théoricien qui pense un objet complexe avec des outils qui ont fait leurs preuves mais qui demandent parfois à être à nouveau aiguisés ; il le fait avec le souci éthique de penser aux possibles usages sociaux (parmi lesquels les usages scolaires) des propositions avancées ; il le fait avec la préoccupation d’intéresser toujours son lecteur en l’intriguant, confirmant une fois de plus l’intuition de Greimas et Landowski selon laquelle les textes théoriques pouvaient être appréhendés comme de «petits récits6»…
Pour citer l'article
Bertrand Daunay, "Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"", Transpositio, Conversations critiques, 2019https://www.transpositio.org/articles/view/recension-baroni-raphael-2017-les-rouages-de-l-intrigue
Voir également :
D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
Lorsqu’on m’a demandé de jouer le rôle de grand témoin des 19es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, organisée en Suisse à la Haute École Pédagogique de Lausanne du 21 au 23 juin 2018, la première question que je me suis posée fut : mais quelles sont les caractéristiques du discours d’un grand témoin? Comment préparer, puis réaliser cette prise de parole?
D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
Lorsqu’on m’a demandé de jouer le rôle de grand témoin des 19es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, organisée en Suisse à la Haute École Pédagogique de Lausanne du 21 au 23 juin 2018, la première question que je me suis posée fut: mais quelles sont les caractéristiques du discours d’un grand témoin? Comment préparer, puis réaliser cette prise de parole?
À partir de mes expériences passées comme auditrice de grands témoins, j’ai compris qu’il s’agit d’abord de dresser une synthèse, de faire un bilan de ce que j’ai observé pendant ces journées, mais aussi de donner mon point de vue sur ce que j’ai entendu, en fonction de mes connaissances, de mes ignorances, de mes biais, de mes attentes, de ma formation, de ma vision de la recherche en didactique de la littérature...
Nouvelles bifurcations dans le champ de la didactique de la littérature
Ces 19es Rencontres auront été marquées par plus ou moins 41 communications libres ou inscrites dans l’un des trois symposiums, deux tables rondes et trois conférences plénières.
La conférence d’ouverture a été donnée par Bertrand Daunay qui, d’entrée de jeu, a lancé la boutade suivante: «on ne dira rien de neuf sur cette question qui se répète sans cesse et qui remet encore en cause l’identité de notre champ de recherche», à savoir: peut-on considérer la didactique de la littérature comme une véritable discipline alors qu’elle demeure marquée par une triple rupture dans la circulation des savoirs, encore à sens unique, entre les études littéraires et la didactique de la littérature, soit: 1°l’absence de références à la didactique dans le champ des études littéraires; 2°la rareté des discussions sur les théories littéraires que nous reprenons dans nos travaux; 3°et l’autorité que nous semblons encore accorder aux théoriciens plutôt qu’aux didacticiens? Nous sommes donc encore dans une phase d’émergence du champ disciplinaire, a conclu Daunay. Et j’ajouterai, pour aller plus loin, que nos méthodologies et paradigmes de recherche dominants corroborent ce constat (j’y reviendrai).
Pour comprendre comment ont évolué les travaux en didactique de la littérature depuis vingt ans, j’ai procédé à une analyse de contenu de tous les résumés du programme de ces 19es Rencontres et comparé mes résultats à une analyse semblable faite par Bertrand Daunay et Jean-Louis Dufays (2007) il y a une dizaine d’années.
Daunay et Dufays avaient identifié les méthodes de recherche qui ont marqué les cinq premières années des Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature (de 2000 à 2005) en analysant les résumés de 157 communications qu’ils ont classés en fonction des types de recherches. Ils étaient arrivés aux mêmes constats que Georgette Pastiaux-Thiriat (qui, elle, en 1997, avait analysé les recherches publiées entre 1970 et 1984 et répertoriées dans la banque de données DAF). Ainsi, Daunay et Dufays ont constaté que les recherches théoriques dominaient (76/1391 – 55%), les recherches descriptives venaient en deuxième position (47/139 – 34%) et les recherches-actions en troisième place (16/139 – 11%). Quant à la recherche expérimentale, le pourcentage en était si faible qu’il n’était pas pris en compte dans les totaux.
Or, avec un thème portant sur la circulation des savoirs entre les recherches et les pratiques, nous assistons forcément à un revirement dans notre champ. En effet, depuis une dizaine d’années, les types de recherche se sont diversifiés; mais, surtout, les recherches de type action/formation/collaborative occupent désormais un espace manifeste dans nos travaux, car sur la quarantaine de communications du programme de ces 19es Rencontres, j’ai globalement relevé 21 recherches descriptives (dont celles de Christophe Ronveaux, de Stéphanie Genre et de Martin Lépine2), 17 recherches action/collaborative (dont celles d’Anne Leclaire-Halté et Luc Maisonneuve, de Florent Biao et Véronique Bourhis), deux recherches théoriques (celles de Raphael Baroni et de François Le Goff) et une recherche expérimentale. Il est donc fascinant et fantastique de constater que nous avons présenté quasiment autant de recherches collaboratives que descriptives, ce qui marque un virement non négligeable par rapport à ce qui s’est fait non seulement lors des 7 premières années des Rencontres, mais depuis près de 45 ans (pour remonter à l’analyse de Pastiaux-Thiriat). Alors à la boutade lancée par Daunay en conférence d’ouverture, je m’opposerai en rétorquant que oui, il y a du neuf dans notre champ de recherche: les types de méthodologie que nous choisissons se diversifient davantage.
Apports des 19es Rencontres
Après avoir travaillé sur des thèmes nourrissant davantage des réflexions littéraires que didactiques dont, à titre d’exemple, les Rencontres de 2017 sur l’altérité, celles de 2012 sur les patrimoines littéraires ou celles de 2008 sur le texte du lecteur, le thème pleinement didactique des 19es Rencontres soulève de nouvelles problématiques dans notre discipline, qui nécessitent de mettre en place des recherches de type action, formation, développement ou collaborative. Quatre nouvelles catégories de recherche ont marqué ces 19es Rencontres:
- les recherches qui ont pour objectif d’évaluer l’influence de la recherche collaborative sur les conceptions professorales, ainsi que sur les fondements épistémologiques sur lesquels ces conceptions reposent, comme les trois communications des membres de l’équipe Pratiques Effectives de la Lecture Analytique dans le Secondaire, en France et en Belgique (PELAS);
- celles qui s’intéressent à la manière dont certains genres (théâtre, poésie, roman, conte, BD) donnent lieu à des lectures, interprétations, usages différents selon la catégorie de récepteurs, comme les sept communications du symposium du Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Didactique, Education et Formation (LIRDEF);
- les recherches qui décrivent les actions des chercheurs et des enseignants lors de formations continues (comme celles de Marie-Sylvie Claude ou de Suzanne Richard et Jacques Lecavalier);
- les recherches développement, dont les ingénieries didactiques et conceptions de leçons, de séquences d’enseignement ou d’activités (de lecture, d’écriture) sont élaborées conjointement par les chercheurs et les enseignants, ainsi que leur mise en œuvre, l’analyse des démarches expérimentées, l’analyse du travail collectif et des interactions occasionnées, afin de trouver un équilibre entre ce qui fait consensus, dissensus, etc. (comme celles d’Anne Leclaire-Halté et Luc Maisonneuve, de Marion Sauvaire et Stéphanie St-Onge ou de Florent Biao).
Nous pouvons évidemment expliquer cette forte présence des recherches action/collaboratives par le thème du colloque. Pourrait-on penser que ce type de recherche continue de se tailler une place de même importance aux côtés de nos recherches théoriques et descriptives? Qu’elles nous permettent de proposer des innovations à partir de nos observations des pratiques effectives des enseignants, des compétences lectorales, orales ou scripturales des élèves, des corpus enseignés, etc.? Cet engouement récent pour les recherches collaboratives témoigne-t-il d’un intérêt ponctuel qui ne marquera que quelques années de l’histoire de notre jeune discipline? Car, avouons-le, nous sommes encore en train d’explorer ces méthodologies, qui sont autant de propositions de dispositifs d’enseignement novateurs, voire même de formation de ces enseignants que nous jugeons « démunis » d’outils adéquats pour «améliorer leurs pratiques» —expressions que j’ai entendues à plusieurs reprises au fil des interventions. Je suis néanmoins convaincue que nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la rigueur avec laquelle nous menons nos recherches. Et par «rigueur», je ne fais pas référence aux seuls critères de scientificité, plus chers aux positivistes, comme la neutralité, l’objectivité, l’universalité ou la vérité ; quand je pense à la rigueur de nos recherches, qualitatives pour la très grande majorité, je pense à notre subjectivité, notre intégrité, notre humilité, notre éthique de la recherche, nos responsabilités de chercheurs…
Deux points aveugles de la didactique actuelle de la littérature
Malgré ces travaux qui dynamisent la recherche en didactique de la littérature, j’ai relevé au moins deux points aveugles de notre champ de recherche: le paradigme de recherche dominant, qui contraste avec d’autres paradigmes parfois oubliés –en tout cas pour le moment; et le rôle crucial des formateurs qui interviennent dans la formation en didactique de la littérature.
Des paradigmes de recherche pas toujours avoués ou assumés
La très grande majorité des travaux de notre champ sont des recherches qualitatives, réalisées sur de petits échantillons, dans un temps plutôt restreint (données souvent recueillies en quelques jours, parfois répartis sur trois ou quatre ans). Nos recherches collaboratives sont ponctuelles et réalisées avec des enseignants généralement motivés, fiers de leurs pratiques d’enseignement, curieux de la recherche. Bref, nous réalisons nos recherches avec des enseignants volontaires, passionnés et ouverts, et plus rarement avec ceux qui en auraient peut-être davantage besoin —ou même l’envie, s’ils se trouvaient dans des contextes plus propices, avec des tâches moins lourdes ou du temps spécifique à disposition. Je pense à ces enseignants travaillant dans des contextes où leur quotidien se confronte à leurs idéaux pédagogiques et didactiques, dont la formation didactique ou littéraire peut nous paraitre limitée, voire insuffisante, ou dont les pratiques littéraires dotées d’autres visées que celles de leur enseignement font plus ou moins partie de leurs habitudes depuis qu’ils enseignent. Comment solliciter ces enseignants et les engager dans nos recherches collaboratives, afin qu’ils puissent mieux nous aider à comprendre leur réalité et qu’ils puissent aussi participer activement à leur formation continue? En d’autres mots, comment, en tant que chercheurs en didactique de la littérature, faire circuler les savoirs, de façon bidirectionnelle, à toutes les classes d’enseignants, pour tout le corps enseignant, et non à un groupe privilégié d’entre eux?
Peu de grandes enquêtes ou de recherches quantitatives ont été présentées lors de ce colloque —faute de moyens financiers, sans doute, pour être en mesure de traiter ces nombreuses données, mais peut-être aussi en raison de nos «choix épistémologiques» (Goigoux, 2001) et, j’ajouterai aussi, de nos choix politiques. Les paradigmes de recherche dominants en didactique de la littérature sont les paradigmes interprétatifs (nous voulons, par exemple, analyser la mise en œuvre d’un dispositif créé avec des enseignants; décrire les effets d’un corpus sur les capacités des élèves à comprendre une œuvre; expliquer l’effet d’une tâche sur le développement de compétences interprétatives). Le paradigme positiviste, au sein duquel on viserait à généraliser nos résultats en nous appuyant sur des données probantes pour prescrire et défendre des pratiques d’enseignement que nous jugerions efficaces en matière de lecture littéraire, par exemple, est un paradigme plutôt marginal dans nos travaux (et je m’en réjouis, car cela nous éloigne d’une uniformisation de la pensée des élèves et d’une normativité des pratiques d’enseignement de la littérature).
Quant aux paradigmes critiques,ils semblent peu affirmés et même absents de nos interventions. Ce sont pourtant ces paradigmes critiques qui forcent à orienter volontairement l’analyse de nos données selon un point de vue sociopolitique assumé et défendu3. Par exemple, pour faire l’analyse des corpus d’œuvres littéraires prescrites ou enseignées au secondaire, il s’agirait d’avoir recours: à la critique marxiste pour comprendre les classes sociales représentées dans les corpus enseignés et les effets que produisent les œuvres dans les représentations de la littérature qu’ont les élèves; ou à la posture féministe pour comprendre le poids du patriarcat sur les genres d’activités scolaires privilégiés par les enseignants; ou au postcolonialisme pour expliquer en quoi les corpus enseignés au Maroc, au Québec, à Haïti ou en Suisse sont fortement dominés par la littérature française, laissant dans l’ombre toutes les autres littératures étrangères, ce qui force à reproduire une vision de l’histoire de la littérature à travers l’histoire des conquérants plutôt que celle des vaincus. Pourtant, nos travaux sur la circulation des savoirs entre les modèles théoriques et les pratiques scolaires devraient nous amener, à mon avis, à ouvrir et à multiplier nos points de vue: ce parti pris influerait sur la manière dont nous analysons nos données et formulons nos conclusions, mais aussi, et surtout, jetterait une lumière neuve sur les conséquences des choix théoriques et méthodologiques que nous privilégions dans nos collaborations avec les enseignants, avec les élèves, avec les formateurs, avec les décideurs… et, plus largement, sur l’enseignement et l’apprentissage de la littérature, de la maternelle à l’université.
Bien honnêtement, ou naïvement, je m’interroge sérieusement sur la question des paradigmes dans les recherches en didactique de la littérature. Nous nous faisons pourtant un devoir d’expliciter les courants théoriques de recherche dans lesquels nous nous inscrivons (par exemple, du côté de la lecture subjective issue de la tradition d’Annie Rouxel ou de Gérard Langlade, ou de la lecture cognitive en poursuivant le travail de Jocelyne Giasson), mais les conséquences de nos choix, souvent idéologiques, sont rarement abordées, affirmées, assumées. Il me semble que nous osons peu explorer les motivations qui sont à l’origine de nos sujets de recherche et comment nous pourrions réfléchir plus en amont aux répercussions de nos choix sur l’apprentissage et, plus largement, sur la société: par exemple, pourquoi devrions-nous investir davantage dans la formation continue en didactique de la littérature –comparativement aux autres champs, comme celui de la psychoéducation ou de l’évaluation? Pourquoi souhaitons-nous faire lire plus de poésie aux enfants, pour en faire quoi en classe et pour former quels types de lecteurs, et de citoyens? Faire de l’ingénierie didactique avec les praticiens valide-t-il davantage nos résultats et, si oui, à quelles autres fins que celle d’être intégrés aux manuels et programmes? Bref, quelles sont les valeurs morales et humaines que nous défendons dans nos recherches, comme l’a déjà avancé Cordonier (2014 : 25)?
Bien que les retombées de nos recherches collaboratives, lors desquelles nous développons, mettons en œuvre, ajustons et validons des dispositifs avec les enseignants, soient nobles (après tout, nous voulons mieux former les élèves et développer davantage leurs compétences, contribuer à la réussite scolaire, mieux outiller les enseignants, innover, etc.), pourquoi développer ces dispositifs, sinon pour les valider et pouvoir les utiliser dans la formation des enseignants, actuels et futurs? Cela ressemble, à s’y méprendre, à une acculturation : on se persuade d’«aider» les enseignants, de leur «montrer» ce qui pourrait marcher, de leur «donner» les moyens d’y arriver —dans l’idée implicite, semble-t-il, qu’ils n’auraient pas pu y parvenir par eux-mêmes sans l’intervention du chercheur… Puis, nous autres didacticiens, nous quittons la classe et laissons les enseignants reproduire ces dispositifs validés ensemble.
Même s’il peut y avoir circulation des savoirs entre quelques enseignants et une équipe de recherche, en quoi cette collaboration transforme-t-elle réellement et, surtout, de façon pérenne ces pratiques des enseignants qui ne semblent guère avoir changé depuis 30 ans (Chartrand et Lord, 2013) —ce que plusieurs d’entre nous ont encore souligné dans leurs interventions? Qu’est-ce qui fait que les enseignants ne peuvent pas, selon plusieurs communications entendues lors de ces Rencontres, prendre par eux-mêmes suffisamment de recul sur leur pratique, avoir le temps de mieux s’informer et s’outiller pour devenir des praticiens-chercheurs affranchis, capables de mettre en place leur propre communauté d’apprentissage professionnelle?
Qu’on le veuille ou non, et même avec notre meilleure volonté, la circulation des savoirs entre les acteurs des recherches de type action/formation/collaborative demeurent encore verticale et alimente une logique de reproduction. Comme chercheurs, nous demeurons en position d’autorité symbolique, puisque nous représentons l’institution universitaire, la figure de l’expert, celle qui porte la posture épistémologique ou l’idéologie. C’est donc pour rendre la circulation des savoirs plus horizontale que je nous encourage, et je m’inclus évidemment, à partager et à discuter davantage de nos faiblesses, de nos biais, de nos limites, de nos inquiétudes, de la manière dont nos propres subjectivités teintent nos analyses; à agir avec humilité, intégrité, éthique, et de continuer à nous auto-évaluer et à coévaluer nos travaux afin d’en connaitre les effets sur le rapport aux savoirs des enseignants, élèves, formateurs, concepteurs de manuels, etc. Bref, à être encore plus conscients et critiques de ce que nous faisons, pour ajouter à notre paradigme interprétatif dominant ce paradigme critique assumé.
Des acteurs à étudier : les formateurs d'enseignants et les chercheurs (nous!)
Les postures que nous valorisons ont forcément des impacts sur la formation en recherche que nous prodiguons à nos étudiants des cycles supérieurs, mais aussi sur notre manière d’agir dans les formations initiales et continues auxquelles nous participons tous en tant que formateurs en didactique de la littérature. Quelles sont nos actions en tant que formateurs et formatrices en didactique de la littérature? Quelles sont les conséquences de nos recherches collaboratives, théoriques et descriptives sur la formation des formateurs? Rappelons qu’il n’y a pas de formation professionnelle spécifique pour devenir formateur en didactique de la littérature, sinon d’être doctorant ou d’avoir soutenu une thèse en lettres ou en didactique. Or, nos parcours sont variés et influencent évidemment nos conceptions de la disciplination (Schneuwly et Hofstetter, 2017): nous sommes littéraires ou linguistes de formation qui œuvrent désormais en didactique, ou des enseignants expérimentés devenus chercheurs, ou des doctorants se formant à la recherche et s’autoformant à la formation… Notre dénominateur commun tient à ce que, didacticiens de la littérature, nous sommes des chercheurs, mais aussi des formateurs: nous nous formons avec les textes théoriques que nous lisons, avec les communications scientifiques auxquelles nous assistons, avec les recherches que nous menons, avec nos expériences personnelles du terrain, etc. Mais comment nous dédoubler pour nous mettre à distance de nous-mêmes ? Je nous invite en effet à passer d’un paradigme interprétatif à un paradigme critique, même vis-à-vis de nos propres pratiques d’enseignement et de formation.
C’est pour moi un point aveugle important à souligner, car je n’ai pas été témoin pendant ces Rencontres de recherches descriptives ou collaboratives qui interrogeaient par exemple les pratiques d’enseignement de ceux qui donnent les cours de didactique de la littérature dans nos universités ou hautes écoles pédagogiques (bien que j’aie entendu plusieurs interventions parler des réactions des élèves ou étudiants à l’égard de dispositifs de recherche). Quelles sont nos conceptions de la didactique de la littérature? Quels sont les savoirs que nous convoquons dans nos cours et de quels courants théoriques et idéologiques sont-ils issus? Quels sont les tâches et dispositifs que nous privilégions pour former nos étudiants à l’enseignement de la littérature4? Quelles sont les évaluations que nous imposons à nos étudiants pour mesurer leurs connaissances et leurs compétences en didactique de la littérature –puis comment évaluons-nous leurs travaux et examens? Qu’est-ce que nous institutionnalisons dans ces formations? Bref, quelles sont nos pratiques pédagogiques et didactiques et quelle est notre influence dans cette autre circulation des savoirs? A-t-on une culture commune de formation en didactique de la littérature qui définirait plus clairement les pourtours de notre discipline?
Une fois que nous connaitrons mieux les pratiques de formation en didactique de la littérature, nous pourrons ensuite être critiques vis-à-vis de nous-mêmes et nous demander pourquoi nous agissons de la sorte. Pourquoi choisissons-nous de faire lire tel texte plutôt que tel autre dans nos cours de didactique de la littérature? Pourquoi décidons-nous de présenter tels résultats de recherche et évitons-nous de mentionner telle autre recherche dans nos cours? Quels sont les sujets de mémoire ou de thèse que nous acceptons ou refusons, et quelles raisons en donnons-nous à nos étudiants? Il me semble qu’ajouter ces interrogations aux questionnements de la didactique de la littérature contribuerait à faire mûrir notre jeune discipline.
Bibliographie
Chartrand, Suzanne et Lord, Marie-Andrée (2013), «L’enseignement du français au secondaire a peu changé depuis 25 ans», Québec français, 168, 86-88. En ligne, URL: https://www.erudit.org/en/journals/qf/2013-n168-qf0476/68675ac/
Cordonnier, Noël (2014), «Questions critiques, et donc constructives, sur la recherche en didactique du français», Littérature, langue et didactique. Hommages à Jean-Louis Dumortier, Namur, Presses universitaires de Namur.
Daunay, Bertrand et Dufays Jean-Louis (2007) « Méthodes de recherche en didactique de la littérature », Lettre de l’AIRDF, 40, 8-13. En ligne, URL: https://www.persee.fr/doc/airdf_1776-7784_2007_num_40_1_1730
Goigoux, Roland (2001), «Recherche en didactique du français: contribution aux débats d’orientation», In Marquilló Marruy, M. (dir.), Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère), Poitiers, Les Cahiers FORELL-Université de Poitiers, 125-132.
Schneuwly, Bernard et Hofstetter, Rita (2017), «Forme scolaire, un concept trop séduisant?» in A. Dias-Chiaruttini et C. Cohen-Azria (éd.), Théories – didactiques de la lecture et de l’écriture. Fondements d’un champ de recherche en cheminant avec Yves Reuter, Villeneuve-d’Ascq, Septentrion.
Pour citer l'article
Judith Émery-Bruneau, "D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature", Transpositio, Conversations critiques, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/d-un-paradigme-interpretatif-a-un-paradigme-critique-prolegomenes-a-une-transformation-des-recherches-en-didactique-de-la-litterature
Voir également :
La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
Ce texte est basé sur la transcription, révisée par les auteur·ices, d’une table ronde qui s’est tenue le 7 mars 2025 à la HEP du canton de Vaud en Suisse romande dans le cadre du colloque international «Pour une théorie du récit impliquée», financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique (projet n° 197612). Ce colloque marquait la dernière étape du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» porté par l’équipe DiNarr. Cette table ronde peut être lue en complément du n° 6 de la revue Transpositio, ainsi que du dossier «La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins». Elle complète également le dossier «Comment ça s’enseigne?» consacré à la place de la narratologie dans les pratiques enseignantes romandes du primaire au secondaire 2, qui reprend les interventions de praticien·nes et de formateur·ices qui se sont exprimé·es dans le cadre de ce même colloque. On trouvera enfin le reste des contributions de ce colloque dans n° 47 des Cahiers de narratologie.
La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
Table ronde animée par Raphaël Baroni, transcrite et éditée par Vanessa Depallens et Sonya Florey
Ce texte est basé sur la transcription, révisée par les auteur·ices, d’une table ronde qui s’est tenue le 7 mars 2025 à la HEP du canton de Vaud en Suisse romande dans le cadre du colloque international «Pour une théorie du récit impliquée », financé par le fonds national suisse de la recherche scientifique (projet n° 197612). Ce colloque marquait la dernière étape du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» porté par l’équipe DiNarr. Cette table ronde peut être lue en complément du n° 6 de la revue Transpositio, ainsi que du dossier «La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins ». Elle complète également le dossier «Comment ça s’enseigne?» consacré à la place de la narratologie dans les pratiques enseignantes romandes du primaire au secondaire 2, qui reprend les interventions de praticien·nes et de formateur·ices qui se sont exprimé·es dans le cadre de ce même colloque. On trouvera enfin le reste des contributions de ce colloque dans n° 47 des Cahiers de narratologie.
Participation
- Jean-François Boutin (Québec, professeur en didactique de la littératie à l’Université du Québec, Lévis/UQAR)
- Nathalie Denizot (France, professeure des universités à Sorbonne Université – INSPE de Paris, responsable de l’équipe Prascoll du CELLF – UMR 8599)
- Jean-Louis Dufays (Belgique, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain)
- Chloé Gabathuler (Suisse, professeure en didactique à la HEP Valais)
Modération
- Raphaël Baroni (professeur à l'École de français langue étrangère à l’UNIL, responsable de projet FNS Di Narr)
Raphaël Baroni
Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde plusieurs chercheurs et chercheuses en didactique qui ont accompagné le projet de recherche DiNarr tout au long de son développement. Jean-François Boutin est professeur en didactique du français depuis 1999 au Campus de Lévis dans l'Unité départementale des sciences de l'éducation. Il intervient dans les programmes de formation initiales des maîtres ainsi que des maîtresses. Nathalie Denizot est professeure des universités à l’INSPE de Paris (Sorbonne Université) et responsable de l’équipe Prascoll du CELLF (UMR 8599). Ses travaux portent sur la didactique de la littérature, dans une approche épistémologique et historique. Chloé Gabathuler est professeure en didactique à la Haute École Pédagogique du Valais et responsable de l’équipe LAC. Ses recherches portent principalement sur les modalités de réception des œuvres littéraires à l'école. Elle est l'auteur d'un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat intitulé Apprécier la littérature. Et enfin, Jean-Louis Dufays est professeur émérite à l'Université catholique de Louvain où il a enseigné pendant 28 ans après avoir conjugué la recherche universitaire et l'enseignement dans le secondaire pendant 14 ans.
J'ai préparé trois questions qui serviront de jalons à cette table ronde. La première est la suivante: à partir de votre ancrage institutionnel dans quatre régions différentes de la francophonie (Québec, France, Belgique, Suisse) quelles spécificités percevez-vous dans la manière dont la narratologie s’est scolarisée et continue d’exister dans la culture scolaire?
Chloé Gabathuler
N’étant pas spécialiste de la narratologie appliquée à l’enseignement du français, je vais m’exprimer principalement en tant que formatrice d’enseignant·es et en m’appuyant sur le Plan d’études romand (PER).
Rappelons tout d’abord que l’approche de l’enseignement du français plébiscitée par le PER est de nature communicative ou communicationnelle. C’est pourquoi la notion de “genre de texte» y occupe une place centrale: elle permet, entre autres, de travailler la dimension communicative des textes, de les envisager comme des actes de communication.
Dans cette perspective, si l’on adopte une approche baronienne de la narratologie, qui envisage le récit dans sa dimension rhétorique, on pourrait penser que cette conception communicationnelle de l’enseignement du français crée un terrain favorable au déploiement des outils narratologiques. Or, dans les faits, on remarque que les notions de narratologie sont disséminées, comme des îlots épars, dans différentes sections du PER sans lien entre elles ni réelle définition. On les retrouve soit dans les axes consacrés à la «compréhension» et la «production de l’écrit»; soit dans celui consacré à la littérature. Lorsqu’on examine de plus près les notions présentes dans les axes «compréhension» et «production de l’écrit», on remarque un véritable manque de cohérence. Pour vous donner un exemple:
- au cycle 1, il est question du «contexte d’énonciation»,
- au cycle 2, on introduit la «situation de communication»,
- et au cycle 3, on passe à la «situation d’énonciation».
Ces termes pourtant proches ne sont ni définis, ni articulés entre eux, ce qui rend leur appropriation difficile, tant pour les enseignant·es en formation que pour les élèves. Je comprends que mes étudiant·es — en particulier celles et ceux qui se destinent à l’enseignement primaire — soient perdu.e.s face à ces concepts. Pour la plupart, ils, elles sortent du secondaire sans formation littéraire approfondie. Résultat: ces notions leur semblent abstraites, voire incompréhensibles.
Du côté de l’entrée «apprécier la littérature», d’autres éléments apparaissent: la temporalité, le rapport narrateur-auteur, le point de vue, la manipulation de l’auteur, le suspense, ou encore l’influence sur le lecteur. On y devine une certaine conception du texte littéraire comme construction visant à orienter la lecture, mais là encore, tout cela n'est pas explicité.
Et surtout, ces différentes approches –production/compréhension d’un côté, appréciation littéraire de l’autre– ne se rejoignent jamais vraiment. Les notions sont traitées de façon cloisonnée, ce qui me semble problématique.
Le cycle 1, paradoxalement, me paraît le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu’on y met l’accent sur le lecteur, sur son ressenti, son appréciation. Dans ce cadre, le texte est envisagé en fonction des effets potentiels qu’il peut produire sur le jeune lecteur. Mais au fil de la scolarité, on délaisse le pôle du lecteur au profit de celui du texte. Est mise en avant une approche classique de la lecture littéraire dans le cadre de laquelle l’élève doit repérer ce qui dans le texte constitue sa littérarité.
Enfin, je tiens à souligner que ces outils narratologiques sont non seulement utiles aux élèves, mais aussi nécessaires aux étudiant·es en formation. Pour les futur·es enseignant·es, notamment au primaire, pouvoir analyser finement un album jeunesse (dont la narration est souvent complexe, et enrichie d’images) est crucial. Or, sans une boîte à outils solide, il leur est très difficile d’anticiper les difficultés que les élèves pourraient rencontrer et de construire des séquences d’enseignement adaptées à leurs besoins.
Jean-Louis Dufays
Alors, pour ce qui est de la Belgique francophone, ce pays a peut-être été le premier à avoir intégré dans les outils d'enseignement et dans les prescriptions l'apport de la narratologie. Dès 1975, on trouve en effet un programme d'enseignement qui demande aux enseignants d'accorder une importance significative aux «lectures nouvelles», comme on les appelait à l'époque, et notamment à l'analyse structurelle des récits et des poèmes. Et déjà, des notions sont explicitement présentées dans les ouvrages de formation continuée et dans les outils adressés aux enseignants. Je pense tout particulièrement à un livre qui a eu un rôle assez important, Pour comprendre les lectures nouvelles (1978), qui était signé par André Fossion et Jean-Paul Laurent. Laurenta d'ailleurs continué à écrire beaucoup sur l'enseignement du français par la suite. Et donc, on trouvait déjà là une présentation très complète, dense et même créative de la narratologie, alors que les travaux de Todorov, Propp, Greimas et compagnie étaient encore en cours de diffusion. En particulier, on trouve dans l'ouvrage de Fossion et Laurent, mais aussi dans les manuels qu'ils ont dirigés, la collection Français de chez De Boeck-Duculot, des présentations très élaborées du schéma narratif, du schéma quinaire, ainsi qu’une articulation des deux schémas qui ne figurait pas dans les travaux d'origine des narratologues. S’affichait ainsi d’emblée le souci de “bricoler» une transposition renouvelée qui n'était pas simplement descendante, même si elle témoignait d’un enthousiasme évident face aux nouveaux savoirs. En outre, ces outils adressés aux écoles se voulaient adaptés au niveau et aux besoins des élèves et étaient déclinés de manière spécifique en fonction des compétences de réception, d'écriture ou de récit orale: ils témoignaient donc déjà d’une réflexion didactique intéressante.
Certes, il faut préciser que cela a surtout concerné le secondaire, beaucoup moins le primaire, et davantage aussi le réseau de l'enseignement catholique, qui représente en Belgique 60 % des écoles secondaires. Il reste que, historiquement, la Belgique semble avoir eu un rôle pionnier par rapport aux autres pays francophones: je renvoie à ce propos aux données que Luc Mahieu a rassemblées, puisque nous avons maintenant une réponse très documentée à ces questions dans sa thèse qui va être soutenue très prochainement.
Mais si les notions narratologiques ont donc été préconisées en abondance en Belgique francophone dès les années 1970, elles ont reflué assez rapidement au cours des années 80 et surtout des années 90, comme dans les autres pays. Il est clair que là, on est entré dans une période de méfiance, tant sur le plan théorique que sur le plan des discours scolaires. Certes, les outils narratologiques, comme narrateur et point de vue, apparaissent encore çà et là, mais ils sont désormais estompés par rapport à d'autres notions et d'autres approches de la littérature.
Et puis, on assiste à un retour assez clair de la narratologie dans le dernier référentiel inter-réseaux de 2021-2022, qui concerne le nouveau tronc commun des neuf premières années de l'enseignement obligatoire dont la mise en œuvre se fait progressivement. Sans doute est-on maintenant entré dans une génération qui a intégré les recherches en didactique et le dialogue qui s’est établi entre ceux qui se méfiaient des excès du formalisme et ceux qui, au contraire, se rendaient compte de l'utilité des outils narratologiques pour objectiver un peu l'analyse des textes. Et donc, la narratologie est à nouveau explicitement prescrite, avec une progression au fil des niveaux scolaires qui parait relativement bien pensée et dont je parlerai tout à l’heure, puisque c'est l'objet de la deuxième question.
Nathalie Denizot
Je ne suis pas sûre de savoir répondre non plus très précisément à la question. Et je voudrais rappeler tout d’abord que de nombreux éléments importants de réponse à cette question sont dans la thèse de Luc Mahieu (qui, je l’espère, sera bientôt publiée!), et évidemment aussi dans les entretiens avec les acteurs de la scolarisation, qui sont en ligne sur Transpositio.
Cela dit, si j’en crois le petit travail que j’ai fait (dans Transpositio) sur les manuels ou les chapitres de «méthodes», la narratologie au lycée a été scolarisée davantage à partir de la question du point de vue et du narrateur (du personnage aussi, mais de façon sans doute moins «technique»), que du schéma narratif (qui lui relève sans doute davantage du collège). Il faudrait prolonger ce travail pour comparer avec le collège, parce qu’il y a sans doute des différences collège/lycée: Reuter (dans les entretiens) évoque le succès du conte au collège pour travailler le schéma narratif; mais on peut se dire aussi que c’est sans doute parce que le conte était un genre déjà bien scolarisé que le schéma narratif a si bien pris...
Il en est de même pour l’usage de la narratologie dans les classes de lycée, et notamment à l’EAF1. Certes, comme le soulignent les «acteurs de la scolarisation» interrogés dans Transpositio, la narratologie a permis de renouveler l’approche des textes, et de sortir d’approches plus impressionnistes ou paraphrastiques. Mais il me semble que l’on peut aussi renverser la perspective, et que le succès de la narratologie est en partie lié aux exercices métatextuels caractéristiques de ce niveau. D’une certaine manière, il y a eu une forme de rencontre dans les années 1970-1980 entre l’instauration de l’EAF (à partir de 1969), qui comprend une épreuve orale d’explication de texte et une nouvelle épreuve écrite, le «commentaire», et la diffusion des théories narratologiques. C’est en effet à partir des années 1970 que la narratologie et les théories textuelles commencent à être diffusées dans les classes, à travers des revues comme Pratiques, à une époque où les revues de didactique sont adossées à des collectifs qui ne se contentent pas de publier mais qui s’impliquent dans des stages de formation continue, des universités d’été, etc., ou qui participent à des ouvrages de vulgarisation. Or, les exercices métatextuels de l’EAF (explication de texte et commentaire) partagent un point commun, celui de reposer sur des extraits, des textes courts voire très courts (certains textes officiels limitaient même assez drastiquement le format, autour de 15 lignes ou vers). Ils offrent ainsi une occasion de mettre en œuvre des outils tournés vers des lectures microtextuelles (par exemple le point de vue), et la «grammaire narratologique» prend plus facilement le relais des approches philologiques pour outiller ces lectures «de près» qui deviennent incontournables à l’écrit et à l’oral du bac de français. Quand on invente la lecture «méthodique» dans les années 1980, cette idée de «méthodes» pour la lecture des textes suggère clairement l’usage d’outils empruntés aux nouvelles approches en sciences humaines – dont la narratologie, qui fait d’ailleurs son entrée officielle dans les programmes à la fin des années 1980.
Pour le dire autrement, c’est bien sûr parce qu’elle était efficace que la narratologie est devenue un outil (ou un ensemble d’outils) utile pour les exercices métatextuels . Mais c’est aussi parce que les caractéristiques de ces exercices – en tant que genres scolaires – étaient particulièrement bien adaptées au type de lecture qu’elle permettait, que la narratologie s’est ainsi ancrée dans les pratiques. Explication de texte et commentaire ont facilité la scolarisation de la narratologie, voire en ont configuré la scolarisation, ce qui explique peut-être cette centration sur les points de vue et le narrateur.
Jean-François Boutin
Lorsque j’examine les instructions officielles du Québec, il y a peut-être effectivement une spécificité qui émane, mais je vais la contextualiser quelque peu. On est actuellement, au Québec, dans une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a eu un rappel des instructions officielles, aussi bien celles du primaire que du secondaire, seulement pour l'enseignement du français. Ce rappel-là a été demandé en juin 2023 et on termine présentement, quand je dis «on», c'est un peu fallacieux, mais en tout cas, les didacticiens du français québécois et didacticiennes québécoises, on est à terminer notre critique de la proposition de programme. C'est un peu un exercice effectué en vain parce qu'il y a très peu de recommandations qui vont rester malgré tout parmi nos analyses.
Au Québec, il faut dire que nos programmes actuels datent du siècle dernier... Ce sont des programmes qui étaient structurés autour de compétences. Il y avait quatre compétences au primaire: oral, lecture, écriture et appréciation des textes littéraires. Et Il y avait au secondaire trois compétences: lecture, écriture et oral. Donc c'est comme ça que fonctionnaient nos programmes et qu’ils fonctionnent encore. Il y a quelque chose, une spécificité propre peut-être au Québec par rapport aux programmes de français, sur laquelle j’aimerais insister, avant d’aborder la question de la présence de la narratologie dans les programmes.
Chez nous, il y a une pression parentale typiquement nord-américaine (je ne peux pas parler pour l'Europe), qui a mené à une sorte d’hyper-pragmatisme. Et ça s'est traduit dans l'obligation, dans pratiquement toutes les disciplines scolaires, d'avoir des cahiers d'exercices. Et là, je ne parle pas de manuel, mais bel et bien de cahiers d'exercices, ceci à un tel point que l'édition scolaire a complètement basculé. Elle est passée d'une édition qui publiait des manuels scolaires vers une édition qui publie des cahiers d'exercices qui sont évidemment jetés à la fin de l'année scolaire, «brûlés lors d'un feu de la Saint-Jean» par les élèves, etc. Et ça, ça a créé une pression pour qu'on retarde le renouvellement des instructions officielles, qu'on étire au maximum l’élastique. Dans ces cahiers d'exercices, un examen minutieux permet de constater qu’on y est extrêmement fidèle à la progression des apprentissages proposée par le ministère de l'Éducation pour le français aussi bien au primaire qu'au secondaire. Et je dirais que ce qui caractérise les instructions officielles actuelles comme ces cahiers d'exercices, c'est peu d'éléments de narratologie, mais une application très radicale, très radicale et très, très, très pragmatique, voire utilitariste des éléments dont on a parlé depuis deux jours. Donc, on est très traditionnel, si je peux parler ainsi, par rapport à la narratologie. On retrouve très peu d'éléments de rénovation de la narratologie dans les programmes. Et donc, c'est une approche très «clientéliste», d'une certaine façon. Et ça oriente énormément les décisions actuelles parce qu'il n'y aura pas de changement radical. On s'en va vers quelques nouveautés, quelques intégrations. Il y a des résistances très fortes, par exemple, à l'intégration du numérique, notamment de la fiction numérique, dans les programmes. Donc dans les compétences de français revampées, il n'y aura pas d'éléments qui porteront spécifiquement sur un volet numérique du recours, de la production, de la fréquentation, etc. de la fiction en classe. Donc, on reste très, très proche de ce qui s'est fait ailleurs dans la francophonie. On était déjà à la remorque; on restera très «Greimas», très «Genette».
Raphaël Baroni
Deuxième question: en termes de progression, comment voyez-vous l’évolution des notions mobilisées aux différents degrés de la scolarité? Pourrait-on construire des progressions plus claires en ce domaine?
Chloé Gabathuler
J’ai déjà commencé à répondre à cette question en évoquant le Plan d’études romand (PER). Je précise que je ne parlerai pas du secondaire 2, car ce n’est pas mon domaine d’expertise. Je me concentre sur l’école obligatoire, et, plus précisément, sur la structure spiralaire du PER.
Lorsqu’on examine les notions présentes dans les volets «compréhension» et «production», on constate que ce sont globalement les mêmes qui reviennent d’un cycle à l’autre. Les formulations varient légèrement, mais le fond reste très similaire. La seule réelle progression apparente se situe entre le primaire et le secondaire 1, au sein de l’entrée «apprécier la littérature». À ce niveau, on voit apparaître la notion de «suspense», ou encore on parle de l’influence du narrateur sur le lecteur. Ces éléments renvoient à la manière dont un texte est construit pour agir sur le lecteur. Cela pourrait être très stimulant… sauf que ces notions sont souvent présentées dans une approche très classique de l’enseignement de la littérature. Je l’ai dit tout à l’heure, on demande aux élèves de retrouver dans le texte ce qui en fait un objet littéraire. Or on le sait bien: on n’a jamais vraiment réussi à identifier de façon définitive ce qui constitue la littérarité d’un texte. Les outils narratologiques peuvent certes soutenir les analyses des textes, mais n’oublions pas un aspect fondamental de la lecture, à savoir le lecteur et l’interaction entre le texte et celui ou celle qui le lit.
Autre point que j’aimerais souligner – notamment à la lumière de la présentation de Claire Detcheverry– c’est la question de la progression. On entend souvent que cette progression doit aller du plus simple au plus complexe. Pourtant, quand on regarde certains parcours de lecture proposés dans les nouveaux moyens d’enseignement romand, notamment celui portant sur un album sans texte à destination du cycle 1, on se rend compte qu’on est loin de la simplicité. A mon sens, certains albums jeunesse, par leur richesse narrative, sont plus denses que des romans lus au secondaire I. Même si ces romans posent aussi des questions intéressantes, ils restent relativement simples sur le plan narratif.
Alors, doit-on vraiment penser la progression selon un axe allant du simple au complexe? Ne pourrait-on pas envisager que les outils narratifs soient les mêmes tout au long de la scolarité? La seule différence résiderait dans le langage utilisé: on n’emploierait pas le terme de prolepse avec des enfants de quatre ans. Pourtant, lorsqu’on observe ce qui se passe en classe, même au tout début de la scolarité, on se rend compte que les élèves saisissent bien les phénomènes. Un enfant de maternelle peut parfaitement dire qu’un récit «commence par la fin». Il ne disposera pas des concepts, mais il aura déjà une forme d’intuition narrative.
L’enjeu serait donc de maintenir une approche articulée entre le texte et le lecteur tout au long de la scolarité, cela sans tomber d’un côté dans une lecture purement subjective centrée sur les émotions, ni de l’autre dans une analyse froide uniquement textuelle. Il s’agit d’aborder les textes narratifs dans leur dimension rhétorique, d’accompagner les élèves dans une réflexion sur la capacité des histoires à affecter ceux qui les reçoivent – ou pour le dire autrement: porter son attention sur le storytelling dont parle James Phelan et sur les effets que ce storytelling produit sur le lecteur.
C’est aussi une manière d’introduire une réflexion éthique - là je pense à Wayne C. Booth – en interrogeant les relations complexes qui se nouent entre l’auteur, le narrateur et le lecteur. Tous ces éléments mériteraient d’être davantage mis en avant: ce sont de vrais outils pour une approche esthétique de la littérature, qui est, je dois l’avouer, mon cheval de bataille.
Enfin, ce que j’ai beaucoup apprécié dans les interventions précédentes – notamment celle d’Yves Renaud ou encore dans les échanges autour des incipit – c’est la place donnée à la production écrite comme outil de compréhension. Catherine Tauveron le disait déjà dans les années 90: faire écrire les élèves les aide à mieux comprendre les mécanismes esthétiques du texte. Produire pour mieux lire, mieux interpréter, mieux apprécier. Et les outils narratologiques peuvent tout à fait servir de leviers dans cette démarche.
Jean-Louis Dufays
Pour ce qui est de la progression, je dirais qu’il s’agit d’abord de tenir compte du fait qu'il y a plusieurs compétences à travailler autour du récit. Les compétences de lecture évidemment, mais aussi les compétences d'écriture, on en a largement parlé cet après-midi, puis il y a aussi les compétences orales: écouter le récit, dire le récit. Donc, ce serait bien qu'une progression tienne compte de ces quatre compétences. C'est le cas dans le nouveau référentiel dont je parlais tout à l’heure. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots comment cette progression y est proposée car elle a fait l'objet d'un long travail de co-construction qui m'a semblé très fécond entre des enseignants qui avaient expérimenté des choses et des didacticiens qui avaient fait des recherches autour de la question. Je précise que je n'en parlerai pas de façon totalement neutre, puisque j'ai été consulté par ceux qui ont élaboré ce programme.
Première remarque: la progression envisagée distingue cinq stades de la lecture au long de la scolarité obligatoire. Le premier est le stade du lecteur émergent, qui commence à apprendre à lire en maternelle et au tout début du primaire. Puis vient le stade de l'apprenti lecteur, qui concerne surtout la première année du primaire: l’élève y est à la fois dans le décodage et dans le début du travail de compréhension. Ce faisant, il entre déjà dans le stade du lecteur débutant, où des opérations plus complexes se mettent en place, et dès la deuxième année, il arrive au lecteur en transition, qui se poursuit jusqu’à la quatrième et où il accède déjà à une lecture littéraire. Enfin, en cinquième et sixième secondaire commence le cheminement vers le lecteur dit confirmé. Et donc les différentes notions qui relèvent de l’analyse du récit sont associées à ces différents stades de développement de la lecture et aux différents niveaux scolaires.
Plus précisément, les compétences de lecture du récit commencent à être développées à partir de la troisième primaire. Dès ce niveau-là, on demande que les enseignants amènent les élèves à identifier les cinq structures narratives majeures définies par Adam, à savoir les structures narrative, argumentative, descriptive, dialoguées et explicatives. De plus, le référentiel se distingue en reliant le travail sur les structures textuelles à la promotion d'une lecture littéraire, qu’il définit par sa double modalité, participative et distanciée: il invite à utiliser le récit d'un côté pour amener l'élève à mieux s'identifier aux situations, à vivre l'émotion d'une tension narrative, à se projeter dans l'histoire –c'est la dimension participative–, et de l'autre pour l'amener à acquérir et à mettre en œuvre des outils d'analyse, en étant capable, comme on l'a vu dans plusieurs des interventions de cet après-midi, de déjà nommer les éléments de construction du sens et du récit qui se mettent en place.
Donc, dès l'enseignement primaire, on a cette lecture littéraire qui est préconisée à propos des cinq structures génériques et en lien avec deux productions écrites qui sont demandées. Les productions attendues se complexifient ensuite au fil de la scolarité. Au secondaire, on demande que l'élève soit capable de résumer un court texte narratif et de résumer oralement un court texte narratif et de rédiger un court récit de fiction à partir d'illustrations, puis il va falloir résumer à l'écrit. Le texte sera de plus en plus substantiel, de plus en plus long. À partir de la troisième secondaire, l'élève est amené à utiliser le récit pour relater une rencontre avec une œuvre culturelle. Donc le récit ne sert plus seulement à travailler la lecture ou l'écriture de la fiction, mais aussi à relater une expérience vécue, une expérience culturelle en l'occurrence. Il sert aussi de matrice pour la réécriture (sous la forme d'amplification, de recomposition ou de transposition) de récits de fiction. S’affiche ainsi un souci de distiller au fil des années, dès la troisième primaire et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, des compétences spécifiques.
Par ailleurs, la boîte à outils narratologique va progressivement s'enrichir. Dès la troisième primaire, on parle déjà d'identifier le narrateur, et puis, au fil des trois premières années du secondaire, on intègre de plus en plus d'éléments, la gestion de la temporalité et du rythme narratifs, les notions de récits parallèles et enchâssés, les différents types de focalisation, toutes ces notions inspirées de la narratologie sont explicitement intégrées dans la progression. Au cours des trois dernières années du secondaire, les outils narratologiques sont davantage présupposés comme étant déjà maitrisés, et la lecture des textes littéraires, qui doit à ce moment-là aboutir à des réécritures créatives et à l'explicitation d'une relation critique à l'œuvre, s'appuie sur des outils, notamment narratologiques, mais qui ne sont plus détaillés.
Telle est donc la progression en matière de compétences narratives qui est actuellement préconisée en Belgique francophone. Comme elle vient seulement d’être établie, il est trop tôt pour en mesurer les effets, mais elle a le mérite d’être assez précise et de résulter d’un dialogue avec des enseignants de terrain.
Nathalie Denizot
Je ne suis pas sûre de pouvoir véritablement répondre à cette question, d’abord parce que contrairement à la Belgique, les programmes français actuels sont assez peu détaillés et ne parlent pas explicitement de narratologie. Cela dit, je trouve vraiment intéressant de réfléchir aux types de progression possibles en la matière, et il est clair que ce qui est intéressant pour les notions narratologiques –comme pour bien d’autres objets de la discipline–, c’est d’envisager une progression spiralaire, qui vise des approfondissements successifs d’un même objet et qui procède par reprises et complexification - et non pas une progression linéaire. Qu’est-ce qui serait en effet «plus simple» dans les savoirs narratologiques, et que serait la «base» en narratologie?
Par ailleurs, plutôt que de chercher à opérer des progressions a priori, qui risquent de faire des outils narratologiques non plus tant justement des outils que des contenus à enseigner pour eux-mêmes (c’est une dérive souvent identifiée pour les savoirs grammaticaux), ne pourrait-on pas, comme le suggèrent justement certains didacticiens de la grammaire pour leur domaine, identifier un (très petit) noyau dur de savoirs métatextuels indispensables, et les affiner selon les niveaux mais surtout selon les textes? La notion de narrateur, par exemple, gagnerait sans doute beaucoup à une telle approche spiralaire.
Cela permettrait aussi de découpler l’appropriation du métalangage et l’appropriation des concepts, qui sont deux choses bien différentes et qu’on a parfois tendance à mélanger. Certes, il peut y avoir un vrai plaisir, même pour certains élèves, à affiner la terminologie, à distinguer «homodiégétique», «hétérodiégétique», etc. Mais est-ce que c’est un apprentissage indispensable? Je n’en suis pas sûre. On peut très bien savoir ce qu’est la prolepse ou l’analepse sans connaitre la terminologie narratologique, et cela vaut sans doute pour un certain nombre de notions. Introduisons-les de manière raisonnée et complexifions la terminologie au fur et à mesure que la lecture des textes va demander des interprétations de plus en plus fines et que les textes eux-mêmes se complexifient. Il ne faut pas oublier, comme le rappelait Alain Rabatel dans ce colloque, que tout cela doit rester au service du sens, de l'interprétation du texte. Les concepts et la terminologie sont des outils de lecture des textes avant d’être des objets d’enseignement et d’apprentissage.
Jean-François Boutin
Je vais répondre aux deux questions de cette question. La première question est très intéressante parce qu'elle nous force à constater que si on regarde en termes de progression actuelle, on reconduit dans les instructions québécoises à venir, qui devraient être en application soit à la rentrée 2025 ou plus tard à la rentrée 2026, ce qu'il y avait déjà. Il y a toutefois la disparition de la fameuse compétence «interpréter des textes littéraires» au primaire parce que la pression est venue des enseignants et enseignantes qui disaient qu'ils ne savaient pas quoi en faire... Donc vous voyez que là, on évacue quand même une partie importante de l'expérience de la fiction. On l'intègre toutefois dans les deux autres compétences -lecture et écriture- et on essaie même de l'intégrer dans l'oral, ce qui est quand même intéressant, notamment l'oral qui pourrait tendre vers la fiction. On peut penser aux balados/podcasts. Donc là, il y a une ouverture qui est intéressante. Au Québec aussi, il faut dire qu'au secondaire, il y a une pression très forte générée par l'épreuve uniforme de fin de cycle, l'épreuve de fin d'année. Les enseignants et enseignantes passent un temps fou à préparer leurs élèves à réaliser une épreuve qui est toujours organisée autour d'un type de texte particulier. Et le seul moment où on travaille systématiquement le texte narratif, c'est en troisième secondaire. Donc, vous voyez que c'est là que se concentrent beaucoup les éléments que j'oserais appeler de narratologie, qui sont davantage abordés de façon explicite en classe de français.
Maintenant, pour la deuxième partie de la question, si on se met à rêver, et là j'endosse totalement les propos de Nathalie Denizot, moi aussi j’aimerais garder mon espace critique par rapport à ce qui est proposé par le ministère de l’Éducation chez nous au Québec. Moi, je n'ajouterais rien de plus à ce que Nathalie a dit. Je pense que ça fait grand sens. Ce que j'aimerais simplement évoquer davantage, c'est qu’on a beaucoup de résultats sur les pratiques culturelles des jeunes du Québec et de l’Amérique du Nord. On s'aperçoit que les jeunes, les élèves, les adolescents, les enfants qui fréquentent l'école au Québec sont de très grands amateurs de fiction. Mais pas la fiction qu'on connaît, qui s'est instituée au fil du temps, qui est scolarisée. Ils sont dans des horizons de fiction qui sont même parfois difficiles à accepter pour des spécialistes et l'école, malheureusement, au Québec, prend très peu en considération cette dimension-là. Je pense par exemple aux univers de fan fiction, je pense aux univers de la transfiction, évidemment, le cosplay, la pratique du jeu vidéo, qui est extrêmement populaire, la consommation pratique du manga, etc. Il y a chez nous une effervescence, présentement, il y a manifestement un besoin de s'évader un peu du réel, qui est très présent et fort documenté, statistiquement parlant. Or il y a un fossé avec l'école qui ne prend pas cela en considération. Je pense que c'est là que ça fait mal parce que les élèves en viennent à considérer, par exemple, le conte comme un genre scolaire, comme une forme scolaire, alors que lorsqu'ils vont lire un conte de Tolkien, ils n'auront pas l'impression d'être dans un conte, ils vont avoir l'impression d'être ailleurs en imaginaire. Alors là, il y a, je ne dirais pas un dérapage, mais en tout cas, il y a une discordance assez forte. Et ça me préoccupe énormément. Je souhaiterais qu'on rapproche ces deux univers-là, l'univers des pratiques informelles et celui des pratiques scolaires. On a pourtant essayé de faire bouger les choses...
Raphaël Baroni
Enfin voici ma dernière question: selon vous, à quelles élaborations didactiques faudrait-il procéder aujourd’hui pour que la théorie du récit puisse (re)devenir une ressource pour l’enseignement du français? Quelles approches ou notions vous semblent les plus utiles? Quels sont les principaux obstacles à relever et les principaux dangers à éviter?
Chloé Gabathuler
Je partage entièrement l’avis de Jean-François Boutin. Pour moi, il est essentiel de prendre en compte les pratiques culturelles des élèves. On sait théoriquement qu’il faut partir des élèves, mais dans la réalité –notamment lors d’évaluations–, ce principe reste encore trop peu appliqué.
Les élèves baignent constamment dans des formes narratives: jeux vidéo, mangas, réseaux sociaux… Je pense à TikTok, par exemple. Ces vidéos utilisent souvent certains procédés narratologiques pour pouvoir susciter le plus d’effet possible sur l’audience. Il me semble donc fondamental de partir de ces pratiques-là. Cela peut surprendre ou heurter, mais pourquoi commencer directement par Balzac? On peut tout à fait établir des ponts vers les textes littéraires du secondaire 1 ou 2, à condition de partir d’abord de l’univers et des pratiques culturels des élèves.
Déjà à l’époque –lointaine!– où j’enseignais au secondaire à Genève, je m’appuyais sur des extraits de films pour aborder certaines notions narratologiques. À défaut des outils numériques d’aujourd’hui, on avait déjà besoin du visuel pour faire passer certaines notions. C’est pour ça que le travail évoqué tout à l’heure par Claire Detcheverry me semble si riche: il permet aux élèves de se focaliser d’abord sur l’image et son langage propre, ce qui est loin d’être simple, mais qui propose une autre porte d’entrée probablement plus accessible pour les élèves fragiles ou en difficulté de lecture. Toutefois, il reste à penser le passage entre ces deux modes sémiotiques. Les outils narratologiques pourraient bien servir de charnière entre ces deux modes d’expressions.
Par ailleurs, pour citer de mémoire Raphaël Baroni, l’approche narratologique met en lumière des dispositifs rhétoriques qui ont le pouvoir –ou non– d’orienter et d’affecter le lecteur. Cette approche et les différentes notions ou concepts qu’elle propose pourraient constituer, selon moi, une clef d’articulation entre les différentes dimensions du français (compréhension, réception, production) en offrant une forme de stabilité conceptuelle qu’on peut retrouver à chaque étape du travail avec les élèves.
Et même si l’on se place uniquement du point de vue de la réception, ces outils permettent justement d’éviter l’écueil d’une lecture purement subjective, comme l’a souligné Nathalie Denizot –je la rejoins tout à fait là-dessus. L’école est un espace social au sein duquel l’expression personnelle, idiosyncrasique, y gagne à être structurée. Cela me fait penser aux travaux de Marion Sauvaire, mais surtout à ceux de Lev Vygotski à partir desquelles j’ai développé cette idée de double mouvement vers soi et vers le texte. C’est-à-dire cette capacité qu’on cherche à développer chez les élèves à porter attention à ce qui se passe en eux pendant la lecture tout en étant capables de revenir au texte toujours avec attention et de pointer certaines de ses spécificités responsables de tels ou tels effets. Et c’est précisément ce que permet la nouvelle narratologie: articuler cette tension entre subjectivité et analyse textuelle, entre résonance intime et partage de significations avec les pairs. Il me semble que ce double mouvement est un moteur puissant de transformation sur le plan développemental.
Enfin, j’aimerais évoquer un point qu’on n’a pas abordé: celui des capacités transversales dans le PER. On nous demande aujourd’hui de les intégrer dans nos cours de didactique du français. Parmi elles, il y a notamment la pensée créatrice. Il me semble que c’est une formidable opportunité –une sorte d’alibi pédagogique– pour revisiter ce que l’on enseigne et ce que l’on transmet aux futur·es enseignant·es. Ce pourrait être l'occasion de démontrer l’utilité des outils narratologique (parmi d’autres) dans le développement de la pensée créatrice et de l’imagination.
Jean-Louis Dufays
Je vais peut-être commencer par la fin de ta question où tu demandais s'il y avait des dangers qui me semblaient être à éviter. Il me semble d’abord qu'il faut peut-être observer les mésusages qui ont pu être faits de la narratologie, en tenant compte notamment de la thèse de Luc Mahieu, qui nous permet de voir un certain nombre de remarques qui sont faites par des enseignants eux-mêmes ou par des chercheurs en didactique. Cela étant, je vois quatre problèmes qu'il s'agirait autant que possible d'éviter.
Le premier, ce serait de la naturalisation de la narratologie et de ses outils: il s’agirait de ne pas considérer que ceux-ci vont de soi. On a assez dit combien la trop grande évidence accordée au schéma narratif, pour ne citer que lui, a posé des tas de problèmes. Ça fait maintenant trente ans que Catherine Tauveron a signalé qu'il y avait d'autres manières de travailler les récits dès l'enseignement primaire. Donc la naturalisation me paraît un premier problème, et il va de pair avec celui de l'enseignement implicite: trop souvent, on suppose que des notions narratologiques ont été enseignées les années précédentes alors qu’elles ne l'ont pas été, ou du moins pas de la façon que l’on croyait
Le deuxième problème, ce serait la dilution des outils narratologiques ou leur évitement, c'est-à-dire le fait de les utiliser de manière floue. Tant mieux si on fait preuve de souplesse et de créativité dans leur usage, mais il me semble qu'ils requièrent aussi un minimum de rigueur, et c'est tout l'objet de ce colloque d'avoir justement essayé d'un peu remettre cette rigueur-là au premier plan. Donc, ce serait pour moi un rôle du chercheur d'essayer d'être attentif à ce que, quand on emploie les mots focalisation, narrateur, point de vue, schéma narratif ou actantiel, on essaye de le faire avec une certaine précision et avec un certain sens critique et qu'on essaie d'instiller aussi ce sens critique dans le travail même des enseignants.
Le troisième risque, qui est proche du deuxième, ce serait l'atomisation des outils narratologiques, le fait de les travailler de façon isolée, trop morcelée, sans penser à leur intégration dans un ensemble qui fait sens.
Enfin, le quatrième danger, à mon sens, ce serait celui de l'autonomisation trop grande de la narratologie, la tendance à travailler les récits uniquement sous cet angle-là, d'en faire l'unique ou le principal angle de travail pour analyser les textes. Par contraste, comme je l’évoquais tout à l'heure, certains programmes aujourd'hui insistent beaucoup sur l'importance d’aborder les récits en travaillant les différentes modalités et postures de la lecture littéraire. Il me semble que l'intégration de la narratologie, mais aussi des approches sociologique, institutionnelle, intertextuelle et autres, dans cette conception souple et dialectique de la lecture conçue comme un va-et-vient entre distanciation et participation serait un garde-fou qui permettrait d’éviter une autonomisation trop grande de certains outils, quels qu’ils soient, et partant une nouvelle dérive qui risquerait de hérisser certains observateurs.
Pour répondre à ces dangers, quelles seraient pour moi des priorités à travailler? Je vais tout d’abord avancer dans le sens de ce qui vient d'être dit par mes collègues: il me semble essentiel de travailler le récit dans la diversité de ses formes actuelles, de ses réalisations discursives actuelles, pas seulement littéraires et pas seulement traditionnelles, mais à travers la BD, le cinéma, les séries, le théâtre, la poésie, le jeu vidéo, les différentes formes de narrativité que les élèves utilisent, auxquelles ils recourent dans leur vie quotidienne. Ces différentes formes du récit sont en effet des éléments constitutifs de la culture contemporaine, me semble-t-il, et elles ne relèvent pas seulement de la culture des jeunes, mais plus largement de la culture médiatique, des différentes formes de rapports aux objets culturels. Cela me semblerait vraiment important que les classes de français s'ouvrent davantage à cette diversité des formes de récits. En même temps, elles gagneraient à s'interroger sur les enjeux de ces formes de récits, sur la place du storytelling, qui est peut-être une manifestation médiatique et politique de cette place croissante accordée au récit. Cela vaudrait la peine qu'on s'interroge sur la place que prend le récit comme genre parfois un peu totalitaire, et qu'on se demande s'il n'y a pas d'autres manières de penser le rapport au sens, le rapport à l'identité, le rapport au monde. On sait que la notion d'identité narrative a été fortement mise en évidence par Ricoeur, mais il y a aussi peut-être une identité argumentative, une identité poétique, une identité dialoguée: il n'y a pas que le narratif comme entrée. Je pense que ces questions-là ne sont pas que des questions d'universitaires, de chercheurs, d'intellectuels: elles auraient aussi éminemment leur place dans l’enseignement secondaire. Je plaiderais donc volontiers pour qu’une élaboration didactique à venir intègre cette visée un peu plus large du rapport au récit en l’abordant de manière critique.
Pour terminer, il y a des notions qui me semblent essentielles et qui sont encore très peu présentes dans les manuels ainsi que dans les préconisations officielles. Il y a d’abord l'apport de cette «nouvelle narratologie» dont Raphaël est peut-être le porte-parole le plus éminent. Pour moi, les notions de mise en intrigue et de tension narrative, mais aussi les différentes formes de nœuds narratifs -la catastrophe, le conflit, l'action planifiée- constituent des outils extrêmement opératoires que je travaille avec mes étudiants de l'université depuis une quinzaine d'années parce qu'elles offrent une entrée qui fait sens dans les textes narratifs.
J’évoquerai ensuite tout le travail possible sur les blancs du texte, cette notion que j'avais un peu travaillée à l'époque de ma thèse (Dufays 2010: 155-158)2. On peut aussi appeler cela les lieux d'indétermination, les lieux de résistance, et cela intègre les phénomènes d’ambiguïté et d'ambivalence, les ellipses, ce que le texte ne dit pas, et les résidus, ces passages qui ont l'air de ne servir à rien. Dans les récits on en a constamment, j'en avais fait une petite typologie à l’époque. Il me semble que ce travail sur les blancs serait extrêmement utile pour travailler les difficultés de lecture avec les élèves qui sont parfois bloqués devant des textes narratifs et qui disent: «Mais là, je ne comprends pas, qu'est-ce que le texte a voulu dire?» Pourquoi ne pas partir de ce repérage de ces blancs, de ces indéterminations? Cela permettrait de les nommer et d’en faire des outils d'analyse plutôt que les considérer comme des implicites, ce qui contribue à bloquer le rapport au texte.
Et puis enfin, vous ne serez pas étonnés si vous connaissez un petit peu mes travaux, de savoir que, pour moi, travailler le récit, ça suppose aussi de travailler autour des formes instituées des récits et donc les stéréotypies, qu'elles soient d'ordre micro-textuel, d'ordre narratif ou thématique ou d'ordre idéologique. Pour moi, le récit est le lieu privilégié pour travailler la stéréotypie, et en retour, la stéréotypie est un outil privilégié pour s'approprier de manière critique le rapport au récit.
Nathalie Denizot
Je vais répondre un petit peu à côté, parce que je ne sais pas vraiment quelle «élaboration didactique» il faudrait faire pour les savoirs narratologiques. Mais je trouve très intéressant que soit repris ce concept d’élaboration didactique proposé par Jean-François Halté, qui s’inscrit dans une vision praxéologique de la didactique: il s’agit, écrit Halté dans son article de 1998, de redonner à l’enseignant son rôle et sa place de protagoniste essentiel, en tant que cet enseignant va donner du sens à la transposition en «recontextualis[ant] [l]es savoirs de manière efficace» (1998: 191). Et c’est bien le projet d’enseignement qui prime: «Ce n’est pas parce qu’un savoir savant est disponible et enseignable qu’il est (doit être) enseigné: c’est parce que tel projet didactique est poursuivi que tel concept issu de telle théorie est élu et transposé» (1998: 192). Cela fait écho à ce qu’on a déjà dit plusieurs fois au cours de ces journées: c’est l’usage qui prime, et les savoirs narratologiques doivent être au service de la lecture des textes, et pas l’inverse.
En fait, pour Halté, l’élaboration didactique est du ressort des enseignants, dans un contexte (les années 1980-1990, le bouillonnement de l’INRP, les collectifs de Repères ou de Pratiques) où les didacticiens travaillent avec les enseignants pour renouveler l’enseignement du français. Et en tant que «méthodologie implicationniste», pour reprendre son expression (1998: 191), elle implique, relativement aux savoirs, des conséquences qui sans doute ne ravissent pas les spécialistes des «savoirs savants», puisqu’il faut savoir renoncer à une forme de «pureté» (pour reprendre le terme d’Halté, que je m’autorise ici à citer un peu plus longuement):
L’élaboration didactique des savoirs, parce qu’elle implique (et également par cela qu’elle implique), produit des objets d’enseignement qui n’ont pas la pureté, le tranchant, des objets scientifiques, ni, non plus, la fluidité des objets sociaux: ce sont des objets du meilleur compromis possible. (Halté 1992: 122).
Et en effet, ce que tous les travaux depuis plusieurs décennies sur la construction des savoirs scolaires nous apprennent, c’est que les savoirs scolaires ne sont pas –ne peuvent pas être– «purs». Pour ma part, je parlerai sans doute après Chervel du rôle créateur de l’école, qui ne se contente pas de relayer ou de transposer des savoirs forgés en dehors d’elle, mais qui les reconstruit, les reconfigure, pour «fabriquer de l’enseignable ».
Que faire alors? Évidemment, comme Halté et ses amis du collectif Pratiques, ou comme tous ces didacticiens de cette génération, il faudrait non seulement intervenir en formation initiale (à l’université comme dans les instituts de formation des enseignants), mais aussi (et surtout?) en formation continue des enseignants –ce qui en France devient plus compliqué parce que la formation continue relève actuellement davantage du rectorat et des inspecteurs que des Inspé et de la recherche universitaire. Peut-être, comme Dumortier, Reuter, et quelques autres, il faudrait produire de nouveaux usuels, mais des usuels un peu différents, qui aident à comprendre les enjeux, les débats, qui ne figent pas des notions prêtes à l’emploi et qui s’adressent à l’intelligence des enseignant·es ou des formateurs et des formatrices, à leur culture sans doute déjà étendue sur ces questions, sans les prendre pour des élèves avec des reformulations dépersonnalisées. Non pas seulement définir les différents types de «narrateur» ou de «points de vue», mais distinguer les apports des différents théoriciens, les points de tension aussi. Il manque, me semble-t-il, la strate intermédiaire entre les manuels pour les élèves et les travaux des spécialistes. Enfin, comme Petitjean avec ses collègues de Pratiques, et bien d’autres, il faut peut-être aussi prendre sa part dans l’élaboration des manuels.
Dans tous les cas, ce qui me semble essentiel est de garder à l’esprit que si les didacticien·nes et les narratologues peuvent faire quelque chose, ce n’est surtout pas dire aux enseignant·es ce qu’il faut enseigner... Mais on peut aider les enseignant·es à choisir les notions les plus utiles et les plus opérantes pour interpréter les textes, à objectiver et à interroger les démarches ou les dispositifs, à en analyser les intérêts mais aussi les limites, à partir de données construites, pour dépasser les simples témoignages de «bonnes pratiques».
En fait, il me semble qu’il serait vraiment intéressant et utile pour tout le monde (didacticien·nes, narratologues et enseignant·es du second degré) de prolonger le travail par une ou des recherches collaboratives, pour partir des questions et des impasses telles qu’elles se présentent dans les classes, et ré-élaborer/re-construire avec les enseignant·es la boite à outils dont eux et leurs élèves ont besoin –voire, pourquoi pas, élaborer avec eux le manuel ou l’usuel dont ils auraient besoin.
Jean-François Boutin
Je dois faire une digression vers la formation continue, parce que c'est trop tentant, c'est trop «alléchant». Je pense que chez nous, au Québec, on adhère encore trop fortement au mythe que la transformation des pratiques dans les milieux scolaires vient par la relève, donc par les enseignants qu'on forme à l'université. Et c'est ce qui fait qu'on délaisse complètement la formation continue alors que je suis de plus en plus convaincu que c'est par l'inverse qu'on pourra transformer. Il va falloir se donner les moyens et ça veut dire les sous notamment pour aller jouer sur les représentations, les pratiques des maîtres actuels qui ont 20, 25 ans, 30 ans de pratique derrière eux parce qu’il n'y a qu'une reproduction, il y a un élan, oui, initial, mais qui s'éteint très rapidement.
Je pense qu'on a besoin, il me semble en tout cas, de quatre approches que je vous propose. Je crois qu'on a besoin d'une approche inductive de la narratologie. Partons des pratiques de réception, production de la fiction narrative des élèves, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi partons des pratiques scolarisées, des pratiques qui sont bien inscrites dans les inscriptions officielles en français, qui sont liées à la narratologie. Il ne faut pas évacuer, au contraire, pour découvrir progressivement la boîte à outils de la narratologie rénovée. Ça a été fait chez nous au Québec en didactique de la grammaire. On a amené tout un pan du corps enseignant à changer son rapport à l'enseignement de la grammaire. On est passé, sous l'impulsion des travaux de Suzanne Chartrand, qui a vraiment milité fortement là-dessus, à une posture beaucoup plus inductive. Alors pourquoi pas la même chose pour la narratologie? Moi, en tout cas, je pense qu'on peut commencer dans un futur projet de recherche, dans un prolongement de dix ans, on peut commencer à penser à ça.
Autre chose, je pense qu'on a besoin d'une approche communautaire de la narratologie. Et là, je pense, là, j'évoque évidemment Stanley Fish et à son principe de communauté, d'interprétation. Je pense que ça a été évacué un peu trop rapidement pour toutes sortes de raisons, notamment idéologiques liées, par exemple, à la montée du socioconstructivisme. En tout cas, chez nous, il y a eu des réactions fortes. Ça a été mal compris aussi. Or, présentement, les jeunes se réseautent comme jamais. Le réseau, ce n'est même plus un concept, c'est une façon de vivre. Déployons cette forme d'échange par réseautage autour de notre rapport à la fiction. En tout cas, moi, je pense qu'il y a là une piste intéressante pour l'école.
Une autre piste qui me semble incontournable, c'est l'approche des imaginaires contemporains, telle qu'elle est promulguée par Bertrand Gervais, et qui permet d'ancrer assez paradoxalement la rencontre de la fiction narrative dans le réel. Cette rencontre-là, elle donne tellement de sens à l'expérience humaine et individuelle et je pense que de voir ça de façon un peu plus globale, de voir la fiction comme étant quelque chose qui appartient à un tout plus grand qui s'appellerait l'imaginaire collectif et l'imaginaire individuel. En tout cas, il y a là des pistes de réflexion très intéressantes. Je vous recommande notamment son dernier ouvrage, qui est paru et porte là-dessus.
Et je pense enfin et surtout, ça a été évoqué par Jean-Louis, ça a été évoqué par Nathalie, qu'on a besoin d'une approche disciplinaire diachronique de la fiction narrative. Depuis les années 1970, il y a eu plein de travaux en didactique de la littérature qui étaient novateurs, qui étaient progressistes, qui étaient respectueux aussi de la tradition, mais qu'on a malheureusement vu passer et qui, n'ayant plus la saveur du jour, sont progressivement disparus. Le plus bel exemple de cela, et moi ce qui me fâche le plus, ce sont les travaux en stéréotypie littéraire que Jean-Louis a menés, qui sont pour moi fondamentaux. Ça fait des années que je milite pour qu'on travaille davantage, au Québec, cette notion-là, comme d’ailleurs la notion de mimesis, et ça demeure sans écho. Pourtant, il y a des résultats empiriques, on a testé, ça fonctionne. Donc retournons voir en didactique de la littérature dans notre patrimoine de savoirs, de dispositifs et d'expériences, les choses qui peuvent vraiment fonctionner en contexte contemporain. Je pense que là, on peut penser à une intégration beaucoup plus naturelle de la narratologie, non plus comme discipline scientifique de la fiction, mais plutôt comme des clés qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi on en a tant besoin au quotidien. Et quand je dis «nous », je pense aux jeunes et moins jeunes...
Et je dirais qu'ensuite, juste pour terminer, oui à la recherche-action, oui à la recherche collaborative. Par contre, c'est compliqué, c'est complexe. J'ai piloté une recherche où on avait huit projets qu'on accompagnait sur trois ans. On avait huit chantiers de collaboration, huit chantiers de recherche-action. On est parti des besoins des jeunes, on a développé des dispositifs avec les enseignants, on est allé les tester avec les élèves. Les enseignants avaient un statut de chercheur, ce qui était fantastique, et ça a donné de superbes résultats. Le problème, c'est que ça coûte une fortune au gouvernement, et là, je ne pense pas que nos états soient prêts à accentuer le nombre d'enseignants-chercheurs. Pourtant, à l'unanimité, les enseignants qui ont obtenu ce statut-là pendant trois ans, ont métamorphosé leurs pratiques professionnelles parce qu'ils étaient dans ce que Sonya [Florey] appelait ce matin un dialogue de circulation des savoirs et des pratiques. Je pense que ce serait une avenue fantastique, mais il va falloir qu'on milite pour des subsides. Je m'arrête ici, mais je veux juste saluer la richesse de la réflexion au terme du projet Di Narr, parce qu'il y a un rapprochement extrêmement fort qui s'effectue entre ce qu'on pourrait appeler des disciplines, peut-être qui ne semblent pas toujours si proches, mais qui l’ont fondamentalement toujours été.
Références citées
Dufays Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang.
Halté, Jean-François (1998), «L'espace didactique et la transposition », Pratiques, n°97-98, p. 171-192. DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1998.2485
Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, PUF.
Pour citer l'article
J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufay, C. Gabathuler et R. Baroni, "La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande", Transpositio, Conversations critiques, 2025https://www.transpositio.org/articles/view/la-narratologie-dans-l-enseignement-du-francais-en-belgique-en-france-au-quebec-et-en-suisse-romande
Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement : schéma quinaire et focalisation en débat
Dans le champ de la didactique de la littérature, l’attention portée aux expériences des sujets lecteurs a eu le mérite de revaloriser des rapports aux textes plus personnels et passionnels, moins inféodés à des techniques d’analyse qui risqueraient de nous détourner de l’essentiel, c’est-à-dire du plaisir esthétique et de l’expérience immersive où se jouent certainement certains enjeux éthiques fondamentaux des fictions narratives.
Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement : schéma quinaire et focalisation en débat
Dans le champ de la didactique de la littérature, l’attention portée aux expériences des sujets lecteurs a eu le mérite de revaloriser des rapports aux textes plus personnels et passionnels, moins inféodés à des techniques d’analyse qui risqueraient de nous détourner de l’essentiel, c’est-à-dire du plaisir esthétique et de l’expérience immersive où se jouent certains enjeux éthiques fondamentaux des fictions narratives. En dépit de son indéniable intérêt, cette orientation sur la dimension expérientielle ou subjective de la lecture a eu néanmoins la fâcheuse conséquence de marginaliser les réflexions portant sur les outils d’analyse qui relèvent de la poétique ou, plus précisément, de ce courant de la théorie littéraire identifié comme la narratologie. Dans le champ de la didactique, on risque en effet de considérer la théorie du récit avec méfiance du fait de sa réputation formaliste et de son lien supposé avec un paradigme structuraliste jugé caduque et desséchant pour la lecture. Cela explique en partie le peu d’attention porté au travail de transmission d’un outillage conceptuel qui vise pourtant à enrichir le commentaire des œuvres, et quand bien même ce genre d’enseignement demeure fréquent, et même souvent central dans les plans d’étude actuels, surtout au niveau des deuxième et troisième cycles1. Si l’on accepte le principe selon lequel l’analyse textuelle ne saurait se satisfaire d’un commentaire purement intuitif ou subjectif2, il est étrange que l’on ne se préoccupe pas davantage, notamment au niveau de la formation des enseignant·e·s, de la nature de ces outils et de la manière dont ils sont enseignés, comme si l’affaire était entendue depuis longtemps, et qu’il suffisait de se reposer sur un corpus notionnel usuel et des définitions standardisées3.
Toutes les conditions sont donc réunies pour produire une dangereuse circularité fondée sur un recyclage non problématisé de savoirs acquis sur le tas, à travers l’enseignement obligatoire et post-obligatoire, la lecture de quelques «classiques» de la théorie (surtout Genette), d’ouvrages de synthèses ou de manuels. Tout au plus, les futurs enseignant·e·s sont-ils/elles mis en garde contre un excès de formalisme, comme si théorie et plaisirs esthétiques étaient nécessairement antinomiques. Mais si l’on accepte de voir la narratologie non comme un «moment» de l’histoire de la théorie littéraire, mais bien comme une discipline à part entière, à l’instar de la linguistique ou de la stylistique, c’est-à-dire comme un courant de pensée traversé par différents paradigmes épistémologiques et par des débats parfois intenses entre des positions antagonistes, peut-être découvrira-t-on que cette dernière offre des ressources critiques beaucoup plus riches que les notions figées dont héritent les enseignant·e·s. N’est-il pas alors dommageable de faire l’économie d’une réflexion didactique sur le choix des notions enseignées, et notamment sur leur utilité et la clarté de leurs définitions ? La qualité des échanges portant sur les expériences éthiques ou esthétiques des sujets lecteurs ne dépend-elle pas, au moins en partie, de la qualité des outils qui peuvent être mobilisés dans la discussion, que ce soit pour produire des étayages argumentatifs ou pour offrir un éclairage inédit sur les œuvres ?
Cet article vise à mettre en discussion deux concepts fondamentaux de la théorie littéraire pour en évaluer la valeur didactique et en proposer une mise à jour, de sorte qu’ils gagnent en clarté et en efficacité pour le commentaire de texte. Je prendrai comme cas emblématiques les notions de schéma quinaire et de focalisation, pour montrer comment des paradigmes alternatifs offrent des perspectives intéressantes pour l’enseignement en réglant certains malentendus tenaces et en accroissant considérablement l’intelligibilité et le pouvoir heuristique de ces concepts. On verra que la familiarité apparente de cette terminologie, qui a été standardisée par les ouvrages de synthèse, les manuels et les institutions scolaires, dissimule en fait des définitions instables, qui s’inscrivent dans un long débat épistémologique et critique.
On proposera d’une part de soigneusement distinguer la focalisation de la construction textuelle du point de vue, et l’on montrera d’autre part que la mise en intrigue ne se résume pas nécessairement à un schéma quinaire décrivant la trame des événements racontés. On verra enfin, sur la base de nouvelles définitions, les liens qui peuvent être tissés entre focalisation et intrigue, la dynamique de cette dernière reposant autant sur la structure des événements racontés que sur la gestion des informations mises à disposition du lecteur.
La discussion abordera également la manière dont l’étude de ces mécanismes narratifs peut être associée à des expériences éthiques et esthétiques qui constituent des objectifs centraux dans les plans d’études actuels. La conclusion reviendra sur l’intérêt d’acquérir des compétences théoriques dans le cadre des études littéraires. J’essayerai de montrer que la narratologie contemporaine, qui ne se situe pas en rupture avec l’héritage formaliste, mais qui en perfectionne les outils, en élargit la portée et en redéfinit les usages, demeure une ressource incontournable pour les enseignant·e·s et les apprenant·e·s.
1. La narratologie à l’épreuve de l’enseignement de la littérature
Ainsi que l’affirme Yves Reuter, l’entrée de la narratologie dans les pratiques enseignantes s’est faite dans une période antérieure à l’essor de la didactique de la littérature, ce qui a eu des conséquences plus ou moins fâcheuses. Il souligne en particulier une tendance à l’applicationisme, une dogmatisation de la théorie, des confusions notionnelles et une occultation des débats internes et externes à la discipline aboutissant à un figement des concepts (Reuter 2000 : 10). Pour dresser un inventaire des concepts qui ont été transférés du champ de la théorie à celui de l’enseignement, il faudrait idéalement mener une enquête de terrain auprès des enseignant·e·s, en leur demandant de détailler les outils mobilisés pour le commentaire de textes, voire ceux qui font l’objet d’un apprentissage spécifique à telle ou telle étape de la formation. De manière plus simple, on peut dresser un état des lieux des concepts présentés dans les manuels scolaires et les principaux ouvrages de synthèse, en supposant que ces derniers ont plus de chances que les autres d’entrer dans les pratiques enseignantes. Dans le cadre de cet article, je me suis basé sur un corpus de quatre ouvrages de synthèse largement diffusés : Le Récit de Jean-Michel Adam dans la collection «Que sais-je ?» (1996, première édition en 1984), L’Analyse des récits d’Yves Reuter dans la collection «128» (2016, première édition en 1997), Le Roman. Des théories aux analyses de Gilles Philippe dans la collection «Mémo» (1997) et L’Analyse des récits de Jean-Michel Adam et Françoise Revaz dans la collection «Mémo» (1996).
Dans ce corpus, et dans les manuels qui en dérivent, aux premiers rangs des concepts importés du structuralisme, on trouve le schéma quinaire et le schéma actantiel, qui sont censés décrire la structure temporelle du monde raconté et les fonctions narratives des personnages. À cela s’ajoute les désormais classiques typologies établies par Genette dans Discours du récit (2007, première édition en 1972) : typologie de la «voix» (narrateurs homo-/hétéro-/intra-/extra- diégétiques), typologie du «mode» (focalisation interne, externe ou zéro) et organisation de la temporalité, en particulier les paramètres qui définissent l’ordre (analepse/prolepse) et la durée (pause/scène/sommaire/ellipse), plus rarement la fréquence (singulative, itérative).
Sur un plan plus linguistique, on trouvera encore l’opposition entre récit et discours4 dérivée des travaux de Benveniste (1966), qui peut servir à distinguer les passages narratifs articulés autour du passé simple des dialogues, dont le temps pivot est généralement le présent et où l’on retrouve l’appareil formel de l’énonciation. On peut aussi se servir de cette opposition pour expliquer la différence entre les récits narrés au passé simple (énonciation dite «coupée» du narrateur) et les récits dont le temps pivot est le passé composé (énonciation dite «liée» au narrateur). Importé des travaux de Weinrich (1973), il arrive encore que l’on distingue entre premier plan et arrière-plan du récit, ce dernier correspondant aux énoncés à l’imparfait renvoyant aux descriptions, commentaires ou actions secondaires. On mentionnera enfin la distinction établie par Jean-Michel Adam (1997) entre différents prototypes de séquences textuelles, qui peuvent se combiner de manière plus ou moins complexe dans un roman : narration, description, dialogue, explication et argumentation.
On peut faire l’hypothèse que le recours à la narratologie et à la linguistique a longtemps présenté deux avantages symboliques dans la classe de littérature. D’une part, en accord avec l’idéologie qui sous-tend la notion de «lecture littéraire5», la scientificité apparente de ces schémas et d’une terminologie spécialisée renforcent le sentiment de légitimité des enseignant·e·s, qui se donnent pour mission de transmettre des compétences supposées élever les apprenant·e·s au-dessus de la paraphrase, du sens commun ou de la pratique de la lecture dite «ordinaire6». D’autre part, cet appareillage critique fournit un savoir qui peut faire l’objet d’une évaluation d’acquis de compétences selon des procédures normalisées. On peut vérifier assez aisément que des notions telles que le schéma quinaire ou la focalisation ont été comprises et correctement appliquées pour interpréter tel ou tel texte, ce qui fournit des critères objectifs pour vérifier si une compétence est acquise ou non.
Mais ces bénéfices apparaissent de plus en plus superficiels, pour ne pas dire fallacieux, à mesure qu’évolue notre compréhension de la manière dont la littérature enrichit l’existence des apprenant·e·s, que ce soit sur un plan langagier, esthétique ou même éthique7, ce qui constitue un enjeu majeur dans le contexte actuel de crise des études littéraires8. L’idée qu’il existerait une lecture littéraire, que l’on associe à un apprentissage guidé, a fait l’objet de critiques répétées, notamment du fait de son soubassement idéologique, qui promeut une forme d’élitisme et dévalue d’autres rapports au texte, comme la lecture participative et immersive (Daunay 1999 ; 2002 ; Rouxel & Langlade 2004 ; David 2012 ; Bemporad 2014 ; Daunay & Dufays 2016 ; Dufays 2017). Ainsi que l’explique Chiara Bemporad:
L’articulation entre les distinctions opérées dans le champ de la didactique des littératures et l’analyse des témoignages de lecteurs réels a permis de réviser les manières traditionnelles de considérer les dichotomies entre différentes lectures, et de confirmer à quel point le plaisir joue un rôle clé pour briser ces oppositions. Une telle approche permet un décloisonnement des représentations, attitudes et actions qui ne peut être que bénéfique pour la didactique de la littérature. (Bemporad 2014 : 80)
À une époque où le sujet lecteur est revalorisé et où les plans d’études accordent une place croissante au plaisir esthétique9, les approches formalistes ont été placées sous le signe du soupçon. Todorov, pourtant l’un des pionniers de la narratologie, s’est ainsi fait l’auteur, il y a une douzaine d’années, d’une mise en garde relativement sévère:
Il est vrai que le sens de l’œuvre ne se réduit pas au jugement purement subjectif de l’élève, mais relève d’un travail de connaissance. Pour s’y engager, il peut donc être utile à cet élève d’apprendre des faits d’histoire littéraire ou quelques principes issus de l’analyse structurale. Cependant, en aucun cas l’analyse de ces moyens d’accès ne doit se substituer à celle du sens, qui est sa fin. (Todorov 2007 : 23)
Reuter suggère néanmoins qu’il ne faudrait pas «jeter le bébé avec l’eau du bain» (2000 : 7), car l’outillage narratologique demeure selon lui une ressource importante pour l’étude de la littérature. Elle permet notamment de socialiser l’expérience esthétique en fournissant un étayage de l’interprétation sous forme de procédures objectivées. Bertrand Daunay ajoute quant à lui que:
mettre en cause une entreprise de négation de certains rapports au texte littéraire n’est pas prôner un retour à un subjectivisme empiriste dans l’approche scolaire des textes littéraires : un danger guette toujours, qui est celui d’un empirisme spontanéiste, qui négligerait la nécessité didactique de la construction d’outils conceptuels pour la lecture. (Daunay 2007 : 46-47)
On constate par ailleurs que dans le plan d’études romand actuellement en vigueur, l’un des objectifs du deuxième cycle consiste à être capable de décrire les moyens verbaux par lesquels un auteur parvient à «ménager le suspense» ou à «influencer le lecteur10». Il ne s’agit donc pas seulement d’exprimer un rapport subjectif au texte, mais aussi d’être capable de rendre compte de la manière dont l’intérêt narratif est suscité et d’objectiver les vecteurs d’immersion qui orientent notre rapport à la fiction. En plus d’enrichir le plaisir esthétique des apprenant·e·s et de développer leur sens critique face aux usages sociaux des discours narratifs11, cela permet aussi d’ouvrir une porte en direction d’une réappropriation de ces rouages narratifs, qui peuvent être actualisés lors de productions orales ou écrites, voire non verbales. La narratologie contemporaine apparaît alors comme une ressource pertinente, d’autant plus que les approches dites « postclassiques » (Patron 2018) ne se limitent plus à dresser des typologies formelles, mais accordent une place croissante à l’ancrage linguistique des phénomènes, à la transmédialité, à la rhétorique et aux effets de lecture, offrant ainsi de nouveaux leviers pour éclairer les mécanismes narratifs et cognitifs qui entrent en jeu dans la lecture.
Toutefois, ainsi que le préconise Reuter, avant de se pencher sur ces outils, il convient de répondre au préalable à quelques questions trop rarement posées : «Quels savoirs pour qui? (chercheurs? formateurs? enseignants? élèves?) et pour quoi?» (2000 : 9). En première approximation, j’avancerai que la confrontation de la théorie du récit avec la pratique du commentaire de texte en classe fait apparaître deux risques majeurs:
- - l’enseignant·e mobilise un concept apparemment facile à expliquer, mais son rendement est discutable pour l’interprétation du texte;
- - l’enseignant·e recourt à un concept potentiellement utile, mais tellement difficile à expliquer que son usage pour le commentaire de texte apparaît malaisé.
De telles situations posent la question de la pertinence d’acquérir ou d’enseigner un appareillage critique dont la définition apparaît obscure ou le gain pour l’interprétation discutable. Mais ces difficultés peuvent aussi avoir une valeur heuristique, dans la mesure où elles devraient être considérées comme le symptôme d’un défaut de la théorie, ce qui devrait nous encourager à la réformer. Théorie et enseignement ne sont pas deux champs d’activités liés par un rapport de transfert unilatéral, mais bien deux pratiques qui se nourrissent mutuellement, dans un cercle que l’on peut espérer vertueux pour autant que l’on accepte de ne pas figer les concepts hérités du passé.
Pour sortir de ce figement conceptuel, je tenterai en premier lieu de retracer les débats internes à la théorie du récit. Sur ce plan, la vive controverse actuelle portant sur le statut «optionnel» du narrateur (Patron 2009) doit être vue comme la partie émergée d’un champ de bataille théorique beaucoup plus vaste, la narratologie étant loin de s’être figée dans un dogmatisme hérité des pères fondateurs structuralistes, contrairement à une idée reçue encore tenace. Aujourd’hui, aucune des notions narratologiques fondamentales que j’ai mentionnées au début de cet article, dont on peut supposer qu’elles sont encore mobilisées dans les classes de littérature, ne sauraient être considérées comme complètement stabilisées. Elles font toutes l’objet de discussions plus ou moins animées et sont sujettes à diverses formes de perfectionnement, qui peuvent être liées à l’émergence d’un nouveau paradigme, à une meilleure description linguistique des phénomènes, ou aux perspectives offertes par une approche comparée des médias.
Ainsi qu’indiqué plus haut, dans le cadre restreint de cette étude, j’exposerai d’abord les principales divergences dans la définition des notions de focalisation et d’intrigue. Dans un deuxième temps, je m’interrogerai sur l’intérêt didactique de recourir à tel ou tel concept et sur les éventuelles difficultés inhérentes à leur usage en classe. On verra que la standardisation de la définition de ces deux notions illustre de manière exemplaire les dangers précédemment cités : définition flottante et/ou concept à faible valeur heuristique. Dans un troisième temps, j’essaierai de proposer une redéfinition de ces concepts, qui sera pensée pour être aisément transposable en classe, tout en offrant le meilleur potentiel pour enrichir les commentaires des œuvres.
Cet article vise en premier lieu à offrir aux enseignant·e·s un appareillage théorique clairement défini et facilement transposable dans les classes de littérature, mais il s’adresse également aux formateurs de formateurs, car ces derniers sont les mieux placés pour briser un cercle vicieux qui a figé pendant plusieurs décennies la théorie du récit, en la réduisant à un inventaire d’outils plus ou moins obsolètes, mal définis ou dont l’utilité finit par apparaître douteuse. Il s’agit de montrer, en levant un certain nombre de difficultés conceptuelles, que la théorie du récit, trop souvent considérée comme une technique desséchante ou désuète, ouvre au contraire une porte sur ce qui fait le sel des œuvres, tout en développant des compétences transférables qui justifient pleinement l’intérêt des études littéraires dans la formation obligatoire et post-obligatoire.
2. Intrigue et schéma quinaire
2.1. Aperçu des débats théoriques
Le premier constat que l’on peut dresser concernant la notion d’intrigue est celui du contraste étonnant entre une très forte standardisation de sa définition dans le contexte scolaire et l’instabilité de sa définition dans l’histoire de la théorie.
Du côté de la didactique, l’intrigue est presque toujours présentée sous la forme d’un schéma quinaire (Adam 1996 : 90 ; Adam 1997 : 51-56 ; Revaz 1997 : 163-195 ; Reuter 2016 : 22). Ainsi que le rappelle Reuter (2016 : 22-23), cette structure est née de la simplification et de la généralisation par Paul Larivaille (1974) de la représentation séquentielle du conte merveilleux que l’on devait aux travaux du formaliste russe Vladimir Propp (1970). Ce schéma a été ensuite popularisé par la linguistique textuelle (Adam 1997 : 54) et relayé dans la plupart des ouvrages de synthèse (Adam 1996 : 85 ; Reuter 2016 : 24 ; Adam & Revaz 1996 : 67). On rappellera que cette définition présente l’intrigue comme une séquence hiérarchisant cinq étapes dans le déroulement d’une histoire: une situation initiale s’oppose symétriquement à une situation finale (qui définit les états transformés par les événements racontés), un noyau narratif est formé par le couple nœud-dénouement (ou complication-résolution), et une action ou une évaluation –Reuter parle de dynamique (2016 : 24)– constitue le procès qui doit conduire du nœud au dénouement.
Il faut remarquer que cette définition, en dépit de son formalisme, est souvent présentée comme renvoyant à une conception «dynamique» de l’intrigue. Ainsi que l’affirme Adam : «Pour qu’il y ait récit, il faut que cette temporalité de base soit emportée par une tension : la détermination rétrograde qui fait qu’un récit est tendu vers sa fin (t + n), organisé en fonction de cette situation finale» (1996 : 87 ; aussi dans Adam 1997 : 46). Toutefois, il convient de préciser que s’il y a dynamisme, ce dernier se situe au niveau de la logique des événements racontés, et non au niveau de l’effet de la mise en intrigue sur le récepteur. La tension qui caractérise sémantiquement l’histoire racontée peut éventuellement se prolonger en effet esthétique, c’est-à-dire en tension ressentie dans la lecture, mais elle repose avant tout sur un codage de l’action lié au destin des personnages. Adam et Revaz précisent d’ailleurs qu’il est important de ne pas confondre la tension dramatique «notion essentiellement sémantique» avec la structure d’intrigue «notion purement compositionnelle» (Adam & Revaz 1996 : 68).
En dépit de la standardisation de l’intrigue que l’on observe dans le domaine de l’enseignement, il existe bien d’autres manières de définir cette notion, à tel point que dans le Cambridge Companion to Narrative, Hans Porter Abbott estime que le terme «plot» est «encore plus insaisissable que celui de récit, l’un comme l'autre étant à ce point polyvalents et approximatifs dans leur signification, et en fait tellement vagues dans leur usage ordinaire, que les narratologues évitent le plus souvent de les utiliser» (Abbott 2007 : 43, m.t.). Le constat est le même chez Hilary Dannenberg, qui souligne en revanche la centralité de cette problématique:
Malgré l'apparente simplicité de l'objet auquel elle se réfère, l'intrigue est l'un des termes les plus insaisissables de la théorie du récit. Les narratologues l'utilisent pour se référer à une variété de phénomènes différents. La plupart des définitions de base du récit butent sur la question de la séquentialité, et les tentatives répétées de redéfinir les paramètres de l'intrigue reflètent à la fois la centralité et la complexité de la dimension temporelle du récit. (Dannenberg 2005 : 435, m.t.)
Dans les limites de cet article12, je me contenterai de mentionner une conception alternative au schéma quinaire, très répandue dans les approches rhétoriques ou cognitives, qui me semble particulièrement apte à renouveler l’enseignement du fait de ses affinités avec le paradigme de l’interactionnisme socio-discursif, qui a fait ses preuves dans le champ de la didactique des langues et de la littérature.
Pour faire ressortir le point crucial du recadrage qu’il s’agit d’opérer, on peut affirmer, à la suite de Richard Pedot, que les récits «ne peuvent être réduits au schéma chrono-logique de l’intrigue sans laisser échapper ce qui en fait la force, la capacité d’intriguer» (2008 : 25). Dans le prolongement de la poétique aristotélicienne, l’approche que j’appellerai désormais rhétorique consiste donc à affirmer que:
la forme de l'intrigue — dans le sens de ce qui la rend utile au sein d'un objet artistique spécifique — c'est plutôt son «mécanisme» ou son «pouvoir», comme la forme de l'intrigue dans une tragédie, par exemple, est la capacité de sa séquence d'action unifiée d'effectuer, par l'effet de la pitié ou de la peur, une catharsis de ce genre d'émotions. (Crane 1952 : 68)
Jean-Paul Bronckart a défendu une conception de l’intrigue très similaire en rapprochant cette dernière de la planification discursive monogérée, qu’il compare à un arc de tension, à l’instar des modèles scénaristiques enseignés à Hollywood:
L’effet attendu de la planification monogérée peut être visualisé par une feuille de papier que l’on fait bomber en son milieu ; l’importance de la déclivité produite figure l’intensité de la tension obtenue, et en conséquence l’aspect spectaculaire de la résolution ou de la chute ; si la déclivité est insuffisante, le texte sera considéré comme «plat», sans tension, sans «relief». (Bronckart 1985 : 51)
Une telle approche revient par conséquent à mettre au premier plan le dialogisme de la séquence narrative, qui repose sur l’alternance d’un nœud, qui noue une tension, et d’une résolution, qui la dénoue:
S’il est rarement posé comme tel, le statut dialogique de la séquence narrative est néanmoins évident. Comme nous l’avons montré, qu’elle soit ternaire, quinaire ou plus complexe encore, cette séquence se caractérise toujours par la mise en intrigue des événements évoqués. Elle dispose ces derniers de manière à créer une tension, puis à la résoudre, et le suspense ainsi établi contribue au maintien de l’attention du destinataire. (Bronckart 1996 : 237)
Contrairement à Jean-Michel Adam, qui fonde le schéma quinaire sur une description renvoyant à la chronologie de l’histoire racontée, Bronckart précise par ailleurs que cette mise en tension du récit par la mise en intrigue se situe clairement au niveau de l’organisation du discours narratif, ou de ce que l’on appellerait en rhétorique classique la dispositio:
Tomachevski distinguait la FABLE et le SUJET, Genette l’HISTOIRE et le RÉCIT, Fayol le NARRÉ et la NARRATION, et on assimile fréquemment à cette distinction celle qui existerait entre l’INVENTIO et la DISPOSITIO de la rhétorique classique (il serait d’ailleurs plus pertinent d’opposer à ce niveau la COMPOSITIO à la DISPOSITIO). Telles que nous venons de les définir, les opérations de planification ont manifestement trait au versant «disposition superficielle» de ces couples conceptuels ; les moules superstructurels concerneraient donc exclusivement le SUJET, le RÉCIT, la NARRATION ou la DISPOSITIO. (Bronckart 1985 : 51)
Dans le prolongement de cette approche, j’ai proposé de considérer la tension narrative comme constituant l’élément fondamental déterminant la dynamique et la structuration de la mise en intrigue:
la tension est le phénomène qui survient lorsque l’interprète d’un récit est encouragé à attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d’incertitude qui confère des traits passionnels à l’acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit et l’on reconnaîtra en elle l’aspect dynamique ou la «force» de ce que l’on a coutume d’appeler une intrigue. (Baroni 2007 : 18)
Françoise Revaz précise qu’étant moins «rigide que le schéma quinaire habituel, [cette conception de l’intrigue] permet de tenir compte de degrés de tension différents, entre un texte à tension maximale qui fait la pyramide et un texte à tension minimale tendant à la platitude» (2009 : 133). Elle ajoute que l’avantage de ce modèle «est de montrer que la structuration de l’intrigue ne repose pas nécessairement sur le développement chronologique d’une action, mais peut se construire également sur un mystère ou une énigme, comme c’est le cas, par exemple, dans le roman policier» (2009 : 132).
En plaçant la fonction avant la forme, et le dynamisme dialogique avant la structure logique de l’action, cette approche permet de corréler le profil de l’intrigue à des effets tels que le suspense, la curiosité ou la surprise. Le dénouement n’est pas une structure symétrique qui s’oppose au nœud, mais un horizon d’attente créé par ce dernier, ce qui explique qu’il peut être indéfiniment repoussé, comme dans les formes feuilletonnantes ou dans les œuvres «ouvertes» évoquées par Umberto Eco (1979). L’analyse de la structure cède donc la place à celle des fonctions discursives et des intérêts narratifs liés à la progression dans le texte, ce qui implique, sur un plan linguistique ou poétique, de prendre en compte le rôle fondamental joué par la manière dont l’information narrative est distribuée dans le récit13(Phelan 1989 ; Sternberg 1992 ; Brooks 1992 ; Baroni 2007 ; 2017a ; Kukkonen 2014a).
Une telle définition pourrait passer pour superficiellement compatible avec la définition du schéma quinaire, surtout lorsque cette dernière insiste sur le dynamisme de l’histoire. Il s’agit en réalité de deux phénomènes très différents car, rappelons-le, le schéma quinaire est défini par la logique des actions racontées, là où le second modèle repose sur l’organisation du discours narratif en tenant compte de ses effets sur le destinataire du récit.
Certes, dans un récit d’aventure, la rupture instaurée par un événement imprévu peut à la fois lancer la quête du héros et engendrer la production d’un effet de suspense, ce qui conduit à superposer les deux modèles. Mais la différence apparaîtra clairement si l’on considère le cas des dispositifs narratifs visant à susciter la curiosité du lecteur, la progression vers le dénouement impliquant ce que Genette appellerait une série de paralipses et d’analepses complétives, c’est-à-dire des omissions stratégiques du récit ultérieurement comblées par des informations rétrospectives. Avec ce procédé relativement banal14 le récit se noue sans que la chronologie des événements n’ait besoin d’être respectée et sans que l’on puisse nécessairement établir un schéma quinaire fondé sur une complication que rencontrerait le héros. Cette technique est familière à tous les scénaristes qui entremêlent leurs récits de secrets et de mystères autant que d’aventures et de conflits, et l’on peut y reconnaître l’une des formes classiques de la mise en intrigue dans le contexte de ce que Bronckart appellerait une planification discursive monogérée.
2.2. Problèmes didactiques
Même si la définition standardisée de l’intrigue, qui la confond avec le schéma quinaire, reste dominante dans le domaine de la didactique, elle n’est pas nécessairement la plus intuitive. Dans ses usages ordinaires, l’intrigue est souvent corrélée à la tension narrative. Cela s’observe par exemple dans les liens qui peuvent être établis en français entre le substantif intrigue, l’action d’intriguer et les rôles de l’intriguant et de l’intrigué. Dominique Legallois et Céline Poudat ont aussi montré, en analysant un grand nombre de commentaires publiés par des internautes, que les lecteurs et lectrices établissent très spontanément des corrélations entre l’intrigue et ce qu’ils ou elles définissent comme le «happage», notion exemplifiée de la manière suivante: «on se laisse immédiatement emporter dans l’histoire et on ne lâche plus le livre» (Legallois & Poudat 2008 : § 90).
Cette ambiguïté dans la définition de l’intrigue apparaît aussi dans l’ouvrage de Reuter, qui situe d’abord cette dernière au niveau de la «fiction15», ce qui l’isole clairement du niveau de la «narration». Dans cette première définition, conforme au standard du schéma quinaire, il affirme que «l’intrigue incite à s’interroger sur la structure globale de l’histoire» (2016 : 22), cette saisie s’opposant clairement à la dynamique de la progression dans le récit. Pourtant, lorsqu’il aborde la question de l’instance narrative, Reuter reconnaît que ce paramètre:
participe, de façon souvent déterminante, de l’intérêt de l’intrigue (malentendus, quiproquos, rebondissements autour des sentiments amoureux ou d’autres secrets que l’on dissimule plus ou moins), de l’intérêt de certains genres (la lutte entre l’enquêteur et le lecteur pour la découverte du coupable à partir d’un savoir commun véhiculé dans le texte du roman à énigme) et de la construction d’effets de lecture. En effet, c’est à partir de ces jeux entre différents savoirs que l’on peut mieux analyser des procédés tels l’effet de surprise (rendu possible par des informations inconnues d’un personnage, du narrateur et du lecteur), tels la crainte ou l’amusement lorsque le lecteur possède des informations qu’un personnage ignore et qui le conduisent dans la gueule du loup ou dans une série de bévues. (Reuter 2016 : 55-56)
En liant la distribution du savoir à l’intérêt de l’intrigue, Reuter déplace nettement le curseur vers le modèle rhétorique. D’un point de vue strictement théorique, nous sommes ici confrontés à un cas de polysémie, lié à un foisonnement de terminologies spécialisées, qui se heurtent parfois aux usages ordinaires. Le problème pourrait être résolu en posant les bases d’une terminologie plus précise, distinguant différents phénomènes qui risqueraient autrement d'être confondus : par exemple le schéma quinaire définit la structure de l’action, mais il ne s’agit pas de l’intrigue au sens rhétorique du terme, qui repose quant à elle sur le nouement et le dénouement d’une tension pendant l’acte de lecture, qui forme un arc narratif et détermine ce que Reuter appelle «l’intérêt de l’intrigue».
Pour conserver la valeur didactique de la notion, plusieurs raisons justifient une différenciation claire entre le concept d’intrigue et celui de schéma quinaire. La première est liée au rendement de la conception rhétorique pour l’analyse des récits, et notamment pour l’explication de texte. Le schéma quinaire restreint le commentaire à une saisie globale de l’histoire, à un niveau d’abstraction qui permet tout au plus de clarifier les enjeux du récit, de produire des résumés ou de distinguer l’action racontée de l’ordre de sa narration. Reuter considère quant à lui que le schéma quinaire, en reconstruisant la structure des événements, permettrait de:
rendre compte de la gêne que ressentent certains lecteurs ou spectateurs lorsque l’ordre de la fiction n’est pas respecté (flash-back [sic], anticipations…) ou lorsque les étapes finales manquent (la fin en «queue de poisson»). (Reuter 2016 : 26).
Pour ma part, je ne suis pas certain qu’il faille passer par l’établissement d’un schéma quinaire pour parvenir à reconstituer le déroulement chronologique d’une histoire ou pour saisir les effets produits par les anachronies. Quand le résumé est difficile à établir, plutôt que de tenter de résoudre ce «problème», il faudrait plutôt y voir la trace d’une stratégie narrative dont il s’agit de rendre compte. Par ailleurs, les récits non linéaires n’engendrent pas nécessairement une «gêne» : ils peuvent au contraire se révéler extrêmement excitants, ainsi qu’en témoigne l’usage de plus en plus répandu des prolepses et des analepses dans les séries américaines (Jost 2016).
Si l’on accepte de les distinguer, il est d’ailleurs tout à fait possible de garder d’un côté le schéma quinaire pour définir la trame de l’histoire, tout en ajoutant d’un autre côté une définition de l’intrigue qui lie clairement cette dernière à la production d’un arc de tension. L’avantage de la définition rhétorique de l’intrigue, c’est qu’elle permet d’associer l’analyse de la succession des nœuds et des dénouements aux moyens formels par lesquels les auteurs tentent d’orienter l’attention des lecteurs ou lectrices vers le déroulement ultérieur du récit, et cette analyse peut se pratiquer à n’importe quelle échelle du texte, du simple paragraphe au chapitre ou à l’œuvre entière.
En termes de représentation mentale de l’histoire, cela conduit aussi à intégrer à la discussion les hypothèses interprétatives qui s’articulent à diverses étapes du récit, qu’elles prennent la forme de pronostics ou de diagnostics de la situation narrative (Baroni 2017a : 66). La discussion autour de ces scénarios virtuels, que les lecteurs ou lectrices esquissent tout au long de leur progression dans le récit, situe le commentaire sur le terrain de la prévisibilité de l’histoire, des éventuelles surprises et recadrages interprétatifs qui en découlent, dont dépendent souvent le plaisir esthétique et la valeur proprement éducative que l’on associe aux formes narratives. Il est aussi possible d’articuler sur cette base des questions éthiques: tel personnage, à tel moment de l’histoire, pourrait agir de telle ou telle façon, mais en fin de compte, il agit ainsi… qu’est-ce que cela nous apprend sur son caractère et sur la valeur de son action? Qu’aurions-nous fait à sa place? Pourrait-on imaginer une version alternative de l’histoire16?
Ainsi que le suggèrent certaines approches cognitivistes, une telle conception de l’intrigue permet également de mettre l’accent sur l’une des fonctions anthropologiques centrales des formes narratives. Les récits peuvent en effet être envisagés comme des simulations permettant d’apprendre à s’adapter à un environnement en constante évolution, qui ne peut être appréhendé que sous la forme de fragiles réseaux de probabilités. Ainsi que l’explique Karin Kukkonen :
Ce processus de révision des probabilités ne concerne pas uniquement le niveau des énoncés propositionnels concernant le monde fictif ou celui de la résolution de problèmes à travers des jeux de questions et de réponses, mais il s'étend à une expérience de lecture immersive et incarnée, et à l’investissement émotionnel des lecteurs dans le récit. Il peut nous permettre de construire – à travers des récits – des explications concernant l'inattendu […], plus généralement, les récits littéraires explorent et négocient ce que nous considérons comme possible à travers des modèles de probabilité. (Kukkonen 2014 : 737, m.t.)
Sur le plan poétique ou stylistique, l’analyse des mécanismes textuels qui permettent de nouer l’intrigue peut produire des commentaires très riches à partir d’une question élémentaire : comme l’auteur s’y prend-il, ou elle, pour tenter d’intriguer son lecteur ou sa lectrice ? La réponse pourra s’orienter vers l’analyse de phénomènes stylistiques : marquage d’une rupture avec un adverbe, alternance de l’imparfait au passé simple, usage de pronoms ou d’hyperonymes dont les référents sont ambigus, etc. On pourra aussi mobiliser des structures narratives plus générales : par exemple les jeux de focalisation, la caractérisation des personnages, les anachronies, la segmentation du récit, etc.17.
Une autre raison de privilégier l’approche rhétorique tient aux rapports qui peuvent être établis avec des mécanismes très largement répandus dans la culture médiatique contemporaine. Même les apprenant·e·s qui n’ont pas une très grande culture littéraire peuvent se révéler des expert·e·s dans la compréhension de l’art de construire des arcs narratifs, par exemple à travers leur expérience des séries télévisées. L’établissement de liens entre cliffhangers télévisuels et chapitrage romanesque pourrait ainsi nourrir une boucle vertueuse, dans laquelle des compétences acquises hors de la classe permettent de participer activement aux activités de commentaire des œuvres. Il s’agit d’affiner un savoir-faire interprétatif transférable dans un grand nombre de contextes médiatiques, tout en renforçant la compréhension des spécificités inhérentes aux mécanismes verbaux ou textuels sur lesquels reposent ces effets identifiés comme transversaux.
Il s’agit donc de substituer un outil qui servait essentiellement à produire des résumés normalisés à une médiation orientant le commentaire des œuvres vers l’analyse des intérêts narratifs, vers la mise en lumière des enjeux éthiques de la fiction et vers la compréhension des mécanismes narratifs fondamentaux de la narrativité fictionnelle. Sans entrer dans le détail des séquences didactiques qui pourraient être construites à partir de cette reconceptualisation, je proposerai maintenant de formuler une définition de l’intrigue aussi précise et intelligible que possible, de manière à ce qu’elle puisse être utilisée aussi bien dans la formation des enseignant·e·s que dans l’enseignement.
On verra que cette définition ne sera pas plus ardue à saisir que celle de schéma quinaire, et même qu’elle est très intuitive du fait de sa proximité avec les usages courants du terme. Il est parfaitement possible de conserver en parallèle la définition classique du schéma quinaire, mais ce dernier changera de statut. Il s’agira alors de souligner à quel niveau d’analyse cette séquence se situe, et de lui associer le couple complication-résolution, qui renvoie à la sémantique de l’action racontée, plutôt que les termes nœud-dénouement, qui serviront exclusivement à décrire l’arc de tension formé par la mise en intrigue des événements.
2.3. Proposition de redéfinition
Dans le langage courant, on entend souvent l’expression : «C’était ennuyeux, il n’y avait pas d’intrigue!» Dans cette phrase, on comprend que l’intrigue est liée aux intérêts qui rythment le récit, à sa capacité de susciter de la curiosité ou du suspense et de résoudre ces incertitudes tout en ménageant des surprises. On s’intéresse ici à l’effet que le récit est susceptible de produire sur son destinataire, à la tension narrative que l’auteur ou l’autrice veut faire ressentir au public et à son éventuelle résolution. L’intrigue peut ainsi être définie comme une structuration dynamique du récit fondé sur un nœud, qui crée de la tension narrative, et d’un dénouement, qui a pour fonction de la résoudre.
L’art de mettre en intrigue, c’est l’art d’intriguer le lecteur. Dans le langage cinématographique ou télévisuel, on parle d’arcs narratifs pour décrire ces séquences qui rythment le déroulement du récit. Dans les séries télévisées, ces arcs de tension peuvent s’articuler à différents niveaux, qui s’enchâssent les uns dans les autres: une intrigue peut être dénouée au niveau de l’épisode, mais un arc plus large peut entretenir l’intérêt du public à l’échelle d’une saison ou de la série complète. Pareillement, dans un roman, un chapitre peut dénouer certains fils narratifs tout en nouant de nouveaux problèmes ou mystères, de sorte que le récit a l’air de progresser tout en gardant son incertitude. Pour déterminer les enjeux de l’intrigue, il suffit de se demander quelles sont les questions induites par le récit à un moment donné de son développement. Quand un chapitre ou un épisode s’interrompent brusquement, avant de fournir des réponses aux questions que se pose le public, on parle de cliffhanger, cette image renvoyant à un personnage littéralement suspendu au bord d’une falaise. Quand la tension atteint son apogée, souvent juste avant le dénouement, on parle de climax.
Il existe deux manières de nouer une intrigue:
- - le récit raconte des événements dramatiques (une action difficile, un conflit) dont le développement ou l’issue sont incertains, ce qui engendre du suspense;
- - le récit évoque des événements énigmatiques, ce qui engendre de la curiosité;
Dans le premier cas, une complication vient perturber une situation ordinaire, et les actions qui s’ensuivent ouvrent différentes virtualités, que le lecteur peut envisager sous la forme de pronostics incertains. L’effet de suspense est alors renforcé par le respect au moins partiel de la chronologie de l’histoire, ce qui rapproche le lecteur du plan des personnages impliqués dans les événements dramatiques. Souvent, le suspense est obtenu en signalant un danger imminent, dont les personnages n’ont pas forcément conscience. Le lecteur se demande alors: que va-t-il se passer? va-t-il y arriver? comment cela va-t-il finir?, etc.
Dans le second cas, le respect de la chronologie n'est pas respectée. Le lecteur est confronté à une représentation incomplète des événements qui suscite sa curiosité. Dans ce cas, le dénouement implique des retours en arrière, sous forme de flashback (analepses dramatisées18) ou d’explications rétrospectives (analepses non dramatisées), jusqu’à ce qu’une compréhension suffisante de la situation narrative puisse être reconstruite. Le recours à ce procédé est une façon assez classique de nouer une intrigue dans les premières pages d’un roman ou dans le genre des enquêtes policières. Dans ce cas, le lecteur peut tenter d’anticiper le dénouement en formulant des diagnostics à partir d’indices disséminés dans le récit. Le lecteur se demande alors : que s’est-il passé? quel est le secret que dissimule ce personnage? qui est le coupable?, etc.
Mise en intrigue
exposition > nœud > tension (suspense ou curiosité) > dénouement > épilogue
Il arrive que le début d’un récit, qu’on appelle exposition, soit dépourvu de tension, il s’agit surtout de poser la situation initiale, de définir le monde et les personnages, mais on peut aussi nouer directement le récit en jouant sur une exposition retardée, qui produit un effet de curiosité dès les premières lignes. On peut aussi décrire la situation des personnages après le dénouement de l’intrigue, voire commenter rétrospectivement les événements qui ont été racontés, cette phase finale du récit constituant ce qu’on appelle un épilogue. Il faut noter cependant qu’il existe des récits non dénoués. Dans ce dernier cas, la fin demeure ouverte, et le lecteur est invité à trouver lui-même des réponses aux questions laissées en suspens par le récit. Il y a en principe autant d’intrigues (ou d’arcs narratifs) qu’il y a de questions laissées en suspens dans un récit à un point donné de son développement, mais il est en général possible de déterminer une intrigue principale et des intrigues secondaires ou subsidiaires, qui sont souvent liées à cet arc majeur.
Pour résumer la structure des événements racontés, en faisant abstraction de l’ordre de leur présentation dans le récit et de la manière dont ils contribuent à nouer l’intrigue, on peut utiliser un schéma quinaire, qui insiste sur les défis que doivent relever les personnages :
Schéma quinaire
situation initiale > complication > action > résolution > situation finale
L’incertitude liée au déroulement des événements, qui est souvent liée à un conflit, une quête ou une action difficile à accomplir, sert à nouer une intrigue, qui doit alors respecter plus ou moins la chronologie des événements pour entretenir le suspense de l’action jusqu’au dénouement.
3. Focalisation et point de vue
3.1. Aperçu des débats théoriques
La focalisation est certainement l’une des notions les plus débattues dans le champ de la narratologie. Elle est aussi parmi les plus difficiles à cerner et à enseigner. Un problème majeur tient à la difficulté de distinguer la perspective adoptée par le récit de la question de la distance, qui concerne la quantité d’information concernant telle ou telle partie prenante de l’histoire. Cette ambiguïté apparaît dès la première définition que donne Genette de la focalisation dans Discours du récit:
le récit peut fournir au lecteur plus ou moins de détails, et de façon plus ou moins directe, et sembler ainsi (pour reprendre une métaphore spatiale courante et commode, à condition de ne pas la prendre au pied de la lettre) se tenir à plus ou moins grande distance de ce qu’il raconte ; il peut aussi choisir de régler l’information narrative qu’il livre, non plus par cette sorte de filtrage uniforme, mais selon les capacités de connaissance de telle ou telle partie prenante de l’histoire (personnage ou groupe de personnages), dont il adoptera ou feindra d’adopter ce que l’on nomme couramment la «vision» ou le «point de vue», semblant alors prendre à l’égard de l’histoire (pour continuer la métaphore spatiale) telle ou telle perspective. (Genette 2007 : 164)
L’objectif principal de Genette, lorsqu’il introduit le concept de focalisation, est de distinguer la «voix» (qui parle?) du «mode» (qui voit? qui perçoit? ou qui pense?). Cette distinction apparaît certes utile, mais elle pose un certain nombre de problèmes relatifs à la manière dont Genette définit ensuite les trois «modes» de focalisation qu’un récit peut adopter. De manière à faire apparaître l’origine de la confusion entre focalisation et point de vue, je reprends ici in extenso les trois définitions données par Genette, qui s’appuie explicitement sur les analyses antérieures de Blain, Lubbock, Pouillon et Todorov:
- focalisation interne : «Narrateur = Personnage (le narrateur ne dit que ce que sait tel personnage) ; c’est le récit "à point de vue" selon Lubbock ou à "champ restreint" selon Blain, la "vision avec" selon Pouillon » (2007 : 193)»;
- focalisation externe : «Narrateur < Personnage (le narrateur en dit moins que n’en sait le personnage) ; c’est le récit "objectif" ou "behavioriste", que Pouillon nomme "vision du dehors". […][L]e héros agit devant nous sans que nous soyons jamais admis à connaître ses pensées ou sentiment» (2007 : 194-195) ;
- focalisation zéro : «ce que la critique anglo-saxonne nomme le récit à narrateur omniscient et Pouillon "vision par derrière", et que Todorov symbolise par la formule Narrateur > Personnage (où le narrateur en sait plus que le personnage, ou plus précisément en dit plus que n’en sait aucun des personnages)» (2007 : 193).
Genette justifie le choix du terme «focalisation» par le fait qu’il permet d’«éviter ce que les termes de vision, de champ, et de point de vue ont de trop spécifiquement visuel » (2007 : 194). Au niveau des sources évoquées par Genette, on constate en effet que la schématisation de Todorov « =, <, > »(1966 : 141-142) fonde les trois régimes de focalisation sur la quantité d’information, alors que les terminologies dérivées de Lubbock et de Blain, mais surtout celle de Pouillon (1946), associent les «modes» à l’orientation d’une «vision».
Cette absence de discrimination claire entre focalisation, vision et point de vue a ouvert la porte à différentes critiques. Mieke Bal a par exemple reproché à Genette de parler seulement de «focalisation sur» sans évoquer la possibilité d’une «focalisation par» un personnage (1977 : 22). Selon elle, le point de vue ne peut se définir que par l’orientation entre un sujet focalisateur et un objet focalisé. Dans la même lignée, Shlomith Rimmon-Kenan avance qu’il ne peut exister par conséquent que deux types d’orientation du point de vue, suivant que ce dernier est interne ou externe au monde raconté, ce qui l’amène à redéfinir la focalisation sur des bases complètement différentes de celles sur lesquelles reposaient les définitions de Todorov ou de Genette:
la focalisation externe est ressentie comme étant proche de l’agent qui raconte, et son véhicule peut donc être appelé le "narrateur-focalisateur" (Bal 1977 : 33). […] Comme le terme le suggère, le lieu de la focalisation interne se trouve à l’intérieur des évènements. Ce type prend généralement la forme d’un personnage focalisateur (Rimmon-Kenan 2002 : 75-76).
Alain Rabatel a lui aussi critiqué la typologie genettienne en soulignant le fait qu’il n’existe, sur le plan de la construction textuelle du point de vue, que deux perspectives possibles : soit le texte adopte le point de vue subjectif d’un personnage, soit le texte adopte le point de vue plus large du narrateur, qu’il associe à la focalisation zéro de Genette. Quant à la perspective externe, elle tiendrait «non pas à d'illusoires distinctions de foyer, mais à des stratégies différentes de gestion de l'information narrative, en fonction des intentions communicationnelles de l'écrivain» (Rabatel 1997 : 107).
Il faut ajouter que Rabatel (2009 : 47) distingue trois niveaux de construction textuelle du point de vue :
- le point de vue asserté (lorsque le narrateur cède effectivement la parole à un personnage, par exemple sous la forme d’un discours direct) ;
- le point de vue représenté (lorsque le discours adopte le point de vue du personnage sans lui céder la parole) ;
- le point de vue embryonnaire (lorsque l’impression de subjectivité repose surtout sur un effet d’empathie construit par le récit).
Du point de vue des sciences du langage, le point de vue représenté apparaît comme le plus intéressants à décrire, car la linguistique offre ici des moyens efficaces permettant de mettre en évidence les mécanismes par lesquels le discours produit un débrayage partiel du point de vue du narrateur pour le réancrer dans la subjectivité d’un personnage, sans pour autant que le narrateur lui cède la parole, phénomène que l’on peut associer, entre autres, au fonctionnement du discours indirect libre.
Faut-il pour autant abandonner la triple focalisation genettienne au profit d’une analyse linguistique du point de vue ? Rien n’est moins sûr. On peut par exemple se demander si le point de vue embryonnaire tel que défini par Rabatel, qui ne repose sur aucun marquage linguistique spécifique, ne recouvre pas plutôt des phénomènes que les trois régimes de focalisation définissaient déjà de manière satisfaisante. Rabatel affirme que ce point de vue émerge lorsque le discours invite le lecteur à se mettre à la place des personnages « en suivant le déroulement de l’action qu’ils exercent ou dans laquelle ils sont engagés » (2014 : 43). Or cette focalisation sur les personnages est surtout déterminée par la quantité d’informations dispensées par le narrateur. Ce sont les personnages dont on parle le plus, ceux qui cumulent le plus d’information, qui seront érigés en protagonistes et par rapports auxquels la question de déterminer si l’on en sait autant, plus ou moins qu’eux sera décisive. Nous nous retrouvons ici de plain-pied dans la problématique de la focalisation genettienne.
Par ailleurs, dans le prolongement de son analyse des effets d’ocularisation et d’auricularisation au cinéma, François Jost insiste sur le fait que la «focalisation – c’est-à-dire le problème du savoir narratif – est en droit différente de la question du point de vue» (1989 : 103). Jost défend ainsi, depuis plus de trente ans, le caractère complémentaire de l’analyse de la focalisation et de celle du point de vue en appliquant, aussi bien au cinéma qu’à la littérature, une double grille d’analyse. Plus récemment, Florence de Chalonge a insisté elle-aussi sur le fait que la typologie proposée par Genette ne faisait pas «de la perception l’enjeu central», ce qui distingue cette approche des théories du point de vue, ces dernières incluant «le postulat phénoménologique d’un ancrage du langage sur la perception» (2003 : 71). Dans une synthèse plus récente, Burkhardt Niederhoff débouche sur la conclusion suivante:
Il y a de la place pour les deux [concepts] parce que chacun met en évidence un aspect différent d'un phénomène complexe et difficile à saisir. Le point de vue semble être la métaphore la plus efficace pour les récits qui tentent de rendre l’expérience subjective d’un personnage. Affirmer qu’une histoire est racontée du point de vue d’un personnage a plus de sens que d’affirmer qu’il y a une focalisation interne sur ce personnage. La focalisation est un terme plus approprié lorsqu’on analyse la sélection des informations narratives qui ne servent pas à restituer l’expérience subjective d’un personnage mais à créer d’autres effets, tels que le suspense, le mystère, la perplexité, etc. Pour que la théorie de la focalisation puisse progresser, la conscience des différences entre les deux termes[,] mais aussi la conscience de leurs forces et de leurs faiblesses respectives est indispensable. (Niederhoff 2011 : §18, m.t.)
Sans aller jusqu’à affirmer que la théorie du récit contemporaine serait parvenue à établir un nouveau consensus, on constate néanmoins que l’analyse comparée des médias et l’histoire critique des concepts narratologiques convergent dans l’affirmation que focalisation et point de vue ne sont pas des notions synonymes ou concurrentes, mais différenciées et complémentaires. Le problème tient à leur définition, qui doit permettre de sortir de la confusion que l’on observe dans la plupart des manuels.
3.2. Problèmes didactiques
Du côté des ouvrages de synthèse, la différenciation entre les notions de focalisation et de point de vue n’apparaît pas clairement, même si elle est parfois esquissée, ce qui pose d’énormes problèmes pour la didactique et pour l’enseignement de la littérature. Dans la dernière mise à jour de son ouvrage, Yves Reuter mentionne les travaux de Rabatel et reconnaît que «la question fort complexe des perspectives ne fait l’objet d’aucun consensus chez les théoriciens et ne cesse de susciter des débats» (Reuter 2016 : 48). Il suggère de s’appuyer sur une «prise en compte beaucoup plus précise des faits linguistique» (2016 : 48) qui sont au fondement de la construction textuelle d’une perspective dans le récit. Malheureusement, il ne précise pas les procédures par lesquelles on pourrait mettre en lumière ces faits linguistiques, et conformément à la terminologie introduite par Genette, il continue de suggérer l’existence d’équivalences entre les termes perspectives, focalisation, vision et point de vue:
Définition : la question des voix narratives concernait le fait de raconter. Celle des perspectives (ou focalisation, ou visions, ou points de vue) porte sur le fait de percevoir. (Reuter 2016 : 47)
Surtout, Reuter n’introduit pas de distinction claire entre l’ancrage du récit dans un point de vue, qui renverrait occasionnellement à l’expérience subjective d’un personnage, et la question de la quantité des informations mises à disposition du lecteur:
La question des perspectives est en fait très importante pour l’analyse des récits car le lecteur perçoit l’histoire selon un prisme, une vision, une conscience, qui détermine la quantité des informations : on peut en effet en savoir plus ou moins sur l’univers et les êtres, on peut rester à l’extérieur des êtres ou pénétrer leur intériorité. La perspective – il convient de le préciser car le terme est trompeur – peut passer non seulement par la vision (cas le plus fréquent), mais aussi par l’ouïe, l’odorat (voir le Parfum de Süskind), le goût, le toucher. (Reuter 2016 : 47)
Jean-Michel Adam et Françoise Revaz ménagent quant à eux une place à l’analyse de l’ocularisation et de l’auricularisation, qui est cette fois clairement découplée des trois régimes de focalisation (1996 : 84-85), mais les termes «focalisation» et «point de vue» continuent d’être présentés comme synonymes:
La diégèse peut être présentée en choisissant (ou non) un point de vue restrictif («mode» que Gérard Genette est un des premiers à avoir clairement distingué de la «voix»). (Adam & Revaz 1996 : 84)
On retrouve également cette synonymie dans la synthèse proposée par Gilles Philippe (1996 : 82-83), ce qui s’explique, dans la perspective historique de cet ouvrage, par le renvoi à la terminologie de Jean Pouillon (1946), dont Genette s’est inspiré pour établir sa propre typologie19. Philippe souligne que cette «question fondamentale de la gestion de l’information dans le texte romanesque est généralement abordée à l’aide d’éclairantes mais encombrantes métaphores visuelles: point de vue, vision, focalisation, restriction de champ…» (Philippe 1996 : 81). Il insiste quant à lui sur la nécessité de distinguer clairement les paramètres textuels qui définissent la quantité de l’information de ceux qui concernent la qualité de l’information, où s’opposent les « textes à direction objective (accent mis sur le perçu) et les textes à direction subjective (accent mis sur le percevant) » (Philippe 1996 : 82).
La confusion entre focalisation et point de vue est à l’origine de bien des difficultés pour le commentaire des textes. Les problèmes apparaissent lorsqu’un point de vue interne est décrit, sur la base de la définition genettienne, comme fondé sur une égalité entre ce que sait le personnage et ce qu’en dit le narrateur. Pourtant, adopter le point de vue d’un personnage ne signifie pas nécessairement dévoiler toutes les informations que ce dernier possède. Dans La Modification de Butor, par exemple, il faut attendre d’avoir atteint la moitié du roman pour comprendre les tenants et aboutissants de l’action entamée par le protagoniste au début du récit, alors que l’intégralité du récit est en flux de conscience. Il faudrait alors parler de focalisation externe malgré un ancrage dans un point de vue interne, ce qui démontre le caractère inadéquat de cette terminologie. De même, il est fréquent que le récit adopte le point de vue de tel ou tel personnage, alors que l’on en sait en réalité beaucoup plus que ce dernier, ne serait-ce que parce que la perspective interne apparaît souvent comme un phénomène local, et que nous disposons alors d’informations qui débordent du cadre du savoir auquel peut avoir accès telle ou telle partie prenante de l’histoire. C’est le cas notamment dans les romans épistolaires, où la lecture de lettres adressés à des destinataires différents place d’emblée le lecteur en régime de focalisation dite «zéro», alors que, localement, le point de vue est toujours interne. Il suffit de considérer les effets tirés de ce décalage épistémique dans Les Liaisons dangereuses pour comprendre l’importance de cette association [focalisation zéro + point de vue interne] dans la dynamique de l’intrigue.
Il me semble donc absolument nécessaire, ainsi que nous y invite Gilles Philippe, d’éviter de confondre quantité et qualité de l’information, ce qui devrait nous conduire à distinguer strictement deux concepts complémentaires:
- Focalisation = quantité de l’information (-/=/+)
- Point de vue = qualité de l’information (interne/externe)
L’approche linguistique d’Alain Rabatel possède d’indéniables vertus pour l’enseignement de la littérature, dans la mesure où elle fournit un appareillage efficace pour décrire la manière dont le récit est susceptible de procéder à un débrayage énonciatif pour aboutir à un réancrage partiel dans le point de vue d’un personnage. Dans ce contexte, la problématique interne/externe renvoie à l’opposition entre point de vue du personnage et point de vue du narrateur, bien qu’il faille encore préciser, à la suite de Reuter, que cette perspective inclut non seulement une vision, mais aussi, potentiellement, toutes les autres formes de perceptions subjectives (ouïe, toucher, odorat, goût), à quoi il faut ajouter les pensées et émotions.
Quant à la triple focalisation, elle constitue un paramètre fondamental dans l’analyse de la dynamique de l’intrigue, mais pour éviter les confusions avec le point de vue, il faut renoncer à lui associer les termes interne/externe et éviter les métaphores renvoyant à la subjectivité des personnages, telles que «vision avec», «vision du dehors» ou «vision par-derrière», qui sont à l’origine de tant de confusions. Nous proposons donc de rebaptiser les trois régimes de focalisation :
- focalisation restreinte ;
- focalisation sur un personnage ;
- focalisation élargie.
Déterminer sur quel foyer le récit est focalisé revient simplement à décrire quel personnage ou groupe de personnages est mis au premier plan dans le récit ou dans une portion de celui-ci (souvent un chapitre), ce qui induit l’établissement de hiérarchies entre protagonistes, personnages principaux et personnages secondaires. Il n’y a pas ici de marquage linguistique spécifique du régime de focalisation, mais il s’agit d’une question de densité de l’information orientant l’attention du lecteur sur un ou plusieurs personnages au détriment d’autres. Par défaut, la fiction est un récit focalisé, même si elle suit les destins parallèles de plusieurs personnages, car la dimension expérientielle20 est fondamentale pour ce genre de représentation de l’action. Le Trône de fer apparaît ainsi comme un cas exemplaire de roman à focalisation variable, puisque chaque chapitre est centré sur un personnage différent, le procédé étant reproduit dans le montage de la série télévisée, qui alterne des séquences centrées sur différents personnages principaux. À l’inverse, pour les récits qui se focalisent sur un seul personnage, on parlera plutôt de récit à focalisation unique ou invariable.
Le marquage de la restriction et de l’élargissement permet quant à lui de souligner les lieux dans lesquels un récit joue ouvertement sur des décalages épistémiques par rapport aux savoirs des personnages sur lesquels se focalise le récit. Focalisation restreinte et focalisation élargie créent des effets que l’on peut corréler à la dynamique de l’intrigue, et notamment aux effets de curiosité et de suspense. On peut enfin envisager l’existence de récits non focalisés21, c’est-à-dire qui n’érigent pas telle ou telle partie prenante des événements en point focal du récit, ce qui est fréquent dans l’écriture historique ou journalistique.
Reste un dernier point à régler : que faire de ces récits hétérodiégétiques qui adoptent pourtant intégralement la perspective intérieure d’un personnage, à l’instar des récits dits «en flux de conscience» (stream of consciousness). Franz Karl Stanzel, qui associait voix et point de vue pour définir les médiations narratives parlerait dans ce cas de récits racontés par des «personnages réflecteurs» (1981 : 5). Si l’on maintient la stricte distinction entre «voix» et «mode», et pour toutes les raisons précédemment mentionnées, je pense qu’il faudrait dans tous les cas éviter d’utiliser l’expression « récit en focalisation interne», et préférer un étiquetage du type : «récit intérieur» ou style «expressionniste», cette dernière notion étant particulièrement appropriée pour les récits graphiques jouant sur une modalisation spectaculaire de l’univers raconté, qui se déforme de manière à exprimer les états émotionnels d’un personnage focal22.
Je propose dans les lignes qui suivent une reformulation aussi claire que possible de ces deux paramètres qui renvoient à la distance (quantité de l’information liée à la focalisation) et à la perspective (qualité de l’information liée au point de vue), tout en essayant d’illustrer ces concepts avec des exemples concrets, tirés de différents médias, de sorte que leur explicitation en soit facilitée.
3.3. Proposition de redéfinitions
Le récit n’offre jamais de représentation parfaitement neutre ou objective de l’histoire, il est toujours orienté, non seulement par la posture d’un éventuel narrateur, qui a parfois participé aux événements, mais aussi par la quantité et la qualité des informations qui sont fournies au lecteur. Pour déterminer la qualité des informations, on s’intéressera à la construction textuelle du point du vue, et pour déterminer la quantité, on dégagera différents régimes de focalisation. Dans les deux cas, l’orientation du récit sera liée à des personnages, qui constituent en quelque sorte un étalon ou un foyer à partir duquel on pourra mesurer différents écarts ou variations.
Il existe deux points de vue fondamentaux : soit le récit adopte le point de vue du narrateur (qui peut ne pas être spécifié, sa «figure» se confondant alors avec celle de l’écrivain), soit le récit adopte le point de vue du personnage. Quand le récit adopte le point de vue du personnage sans lui céder directement la parole (c’est-à-dire sans recourir à des discours directs ou des dialogues), sa subjectivité s’exprime à travers un filtrage des informations qui décrivent ses pensées (réflexions, jugements), ses émotions ou ses perceptions (vue, ouïe, toucher, odorat, goût).
Point de vue représenté
(qualité de l'information narrative)
- Point de vue interne : le récit s’ancre dans la subjectivité d’un personnage ;
- Point de vue externe : le récit n’est pas ancré dans une subjectivité (récit objectif) ou renvoie à la perspective d’un narrateur (subjectivité narratoriale).
Parmi les indices les plus clairs qui permettent de déterminer les passages dans lesquels le récit est ancré dans la subjectivité d’un ou de plusieurs personnages, on mentionnera le discours indirect libre: le caractère expressif d’un énoncé peut occasionnellement être rattaché au ressenti du personnage, et non à la subjectivité du narrateur, le contexte nous permettant le plus souvent de trancher entre les deux. On peut aussi s’intéresser à l’arrière-plan du récit, c’est-à-dire aux énoncés à l’imparfait exprimant les pensées, les sentiments ou les perceptions d’un ou de plusieurs personnages. Dans ce passage tiré d’Un cœur simple, le récit s’ancre dans le point de vue de deux femmes menacées par un taureau:
Mais quand l’herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s’éleva. C’était un taureau, que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Mme Aubain allait courir. – «Non ! non ! moins vite ! » Elles pressaient le pas cependant, et entendaient par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l’herbe de la prairie ; voilà qu’il galopait maintenant ! (Flaubert 1877 : 55)
Dans ce passage, nous voyons que la création d’un effet de point de vue interne passe notamment par un verbe de perception (« entendaient par derrière») et par l’énoncé «voilà qu’il galopait maintenant !» qui exprime l’effroi qui saisit Mme Aubain et sa servante lorsqu’elles entendent les sabots du taureau battre la prairie et qu’elles en déduisent un changement d’allure chez leur poursuivant. Les termes «par derrière» et «se rapprochait» sont par ailleurs des indications spatiales qui sont associées à un point de référence interne à la fiction, qui correspond à la situation occupée par les deux personnages féminins23.
On peut aussi noter que le changement d’allure du taureau s’appuie sur les sens de l’ouïe et du toucher (si l’on inclut les vibrations du sol) et non sur le sens de la vue.. Pour les personnages qui s’enfuient par une nuit de brouillard, et qui font par conséquent dos à leur adversaire, il s’agit en effet des seuls canaux disponibles pour saisir l’augmentation de la menace. Ici, la perspective subjective renforce le sentiment d’immersion dans le point de vue des victimes et accentue le potentiel dramatique de la scène.
Si le point de vue interne est lié à l’ancrage de la représentation dans une intériorité, la focalisation renvoie quant à elle à la manière dont le récit oriente, restreint ou élargit le champ de connaissance auquel peuvent accéder les lecteurs, de manière à engendrer différents effets. Généralement, le récit est focalisé sur un ou plusieurs personnages, l’accumulation d’information conduisant à ériger un foyer de référence à partir duquel on pourra mesurer notre degré de connaissance du monde. De nombreux récits jouent sur une focalisation multiple ou variable, qui permet de mettre en avant, alternativement, plusieurs personnages principaux dont on suit les destins parallèles, mais il arrive aussi qu’un personnage focal soit privilégié et devienne ainsi clairement le protagoniste du récit. On parle alors de focalisation unique ou invariable.
Une fois déterminé le ou les personnages sur le(s)quel(s) se focalise(nt) le récit, on peut observer deux altérations du mode dont dépendent des effets qui contribuent à la dynamique de l’intrigue. La première altération consiste en une restriction plus ou moins marquée et plus ou moins durable des informations que possède un personnage, ce qui induit un effet de curiosité. On peut mentionner quelques cas typiques de cette focalisation restreinte : les intentions, le rôle ou l’identité d’un personnage peuvent apparaître ambigus, ou alors un personnage élabore un plan dont l’objectif ou les modalités de réalisation ne sont pas tout de suite dévoilés. Très souvent, les personnages secondaires peuvent apparaître comme étant par défaut en régime de focalisation restreinte, comme dans les romans policiers dans lesquels le protagoniste-enquêteur peut soupçonner tous les personnages liés de près ou de loin à un crime.
La seconde altération tient, au contraire, à un élargissement du champ des connaissances auxquelles les lecteurs peuvent accéder, ce qui leur donne en quelque sorte un avantage sur les personnages. Ce type de focalisation élargie sert souvent à produire un effet de suspense, notamment lorsqu’une menace dont les personnages n’ont pas conscience est identifiée. On peut aussi lui rattacher différentes formes d’ironie tragique.
Focalisation
(quantité d’informations disponibles)
restreinte (-) < équivalente (=) < élargie (+)
Cette distinction entre quantité et qualité de l’information narrative permet de comprendre que la représentation du point de vue interne du requin dans la scène d’ouverture des Dents de la mer (Jaws, S. Spielberg, 1975) se rattache par ailleurs à un régime de focalisation élargie, dont découle directement le renforcement du suspense. Il serait en effet difficile d’affirmer que le récit est focalisé sur le requin, même si, dans certains plans, la représentation audio-visuelle est ancrée dans son point de vue, car le public s’identifie plus volontiers à des agents humains. Par ailleurs, au niveau du montage, les différents plans qui précèdent cette image subjective sont focalisés sur la future victime, l’adoption éphémère du point de vue du requin visant surtout à transmettre au public une information que la jeune femme ignore. Une victime potentielle inconsciente d’un danger imminent, qui est identifié par le public à travers la représentation du point de vue interne de l’agresseur : nous sommes face à un stéréotype du thriller, qui illustre la manière dont les jeux sur le point de vue et sur la focalisation constituent des ingrédients incontournables de la mise en intrigue.
La construction textuelle d’un point de vue interne est généralement un phénomène local, de nombreux récits jouant sur une variation fréquente des perspectives narratives. Il existe cependant des récits qui ont l’air d’être intégralement racontés du point de vue d’un personnage central, mais sans que ce dernier ne soit véritablement érigé en narrateur, puisque les événements sont racontés à la troisième personne. Ces récits sont parfois décrits comme reposant sur un «flux de conscience» (stream of consciousness) à l’instar de Mrs Dalloway de Virginia Woolf, de La Métamorphose de Franz Kafka ou de La Modification de Michel Butor. Dans ce cas, on parlera de récit intérieur ou de style expressionniste.
4. Pour une narratologie au service des études littéraires
Au terme de cette discussion, j’aimerais insister une fois de plus sur l’importance de sortir d’une représentation figée de la narratologie, qui n’est pas un simple paradigme qui appartiendrait à l’histoire des idées, mais une discipline de recherche en constante évolution et traversée de débats contradictoires. Si, dans une perspective narratologique, l’attention est davantage portée sur les structures textuelles qui conditionnent l’expérience esthétique que sur la manière plus ou moins personnelle dont celle-ci se concrétise, cette approche n’en est pas moins essentielle dans l’élargissement des horizons du sujet lecteur. Il s’agit en effet de saisir, à partir de l’étude de cas singuliers, des phénomènes transversaux à toutes les formes narratives, dont Barthes affirmait la «variété prodigieuse» des genres et des substances, «comme si toute matière était bonne à l’homme pour lui confier ses récits»(1966 : 1). En ce sens, elle est l’une des meilleures ressources pour construire chez les apprenant·e·s des ponts entre le commentaire des textes littéraires en classe et le développement de compétences susceptibles d’être réactualisées dans de nombreux contextes extra-scolaires.
Il me paraît utile de rappeler que l’époque durant laquelle les approches théoriques dominaient les études littéraires a coïncidé avec une période qu’Antoine Compagnon décrit comme un âge d’or : «l’image de l’étude littéraire, soutenue par la théorie, était séduisante, persuasive, triomphante» (2001 : 9). La raison de ce succès tient au fait que les approches théoriques permettent de rendre compte de fonctionnements narratifs ou fictionnels qui ont une portée débordant l’étude de la littérature, cette dernière ne constituant qu’un point de départ. C’est d’ailleurs la raison qui a amené Todorov à inventer le terme «narratologie», pour éviter de confondre cette approche avec la seule théorie littéraire:
La narration est un phénomène que l’on rencontre non seulement en littérature mais aussi dans d’autres domaines qui pour l’instant relèvent, chacun, d’une discipline différente (ainsi contes populaires, mythes, films, rêves, etc.). Notre effort ici sera d’aboutir à une théorie de la narration, telle qu’elle puisse s’appliquer à chacun de ces domaines. Plutôt que des études littéraires, cet ouvrage relève d’une science qui n’existe pas encore, disons la narratologie, la science du récit.(Todorov, 1969 : 10)
La théorie du récit a donc la vertu de faire des études littéraires une luxueuse rampe de lancement pour une compréhension de phénomènes très répandus et dont la pertinence ne peut échapper à personne. Nous vivons aujourd’hui dans une société saturée de récits, dont les usages ne se limitent pas au simple plaisir esthétique ou au divertissement des masses, mais incluent aussi des visées idéologiques, politiques ou commerciales (Salmon 2007), voire des usages plus spécifiques dans les champs de l’éducation, de la médecine ou du droit. Pour faire face aux défis posés par ce qu’Yves Citton (2010) appelle une «mythocratie», le rôle joué par les études littéraires apparaît évident. Il s’agit de construire chez les apprenant·e·s la capacité d’une réappropriation (à la fois productrice et critique) de l’art de (se) raconter des histoires. On ne peut dès lors que regretter le fait que la narratologie apparaisse aux yeux de certains comme une science appartenant au passé, alors que l’empire du récit n’a peut-être jamais été aussi immense et que la question de la gouvernance des mythocraties se pose avec une urgence renouvelée (Baroni 2016b).
Il demeure très difficile de savoir quelle est, concrètement, la place occupée par la théorie du récit dans l’enseignement de la littérature, que ce soit aux niveaux de l’école obligatoire ou post-obligatoire, surtout à une époque où le problème, beaucoup plus basique, des compétences rédactionnelles se pose de manière de plus en plus aiguë. Il est tout aussi difficile de savoir quelles sont les véritables difficultés que rencontrent les enseignant·e·s et les apprenant·e·s lorsqu’il s’agit de mobiliser telle ou telle notion pour commenter telle ou telle œuvre, et quelles solutions ont été développées, au sein même des pratiques des enseignant·e·s, pour tenter d’y remédier. Seule une étude de terrain pourrait répondre à ces questions, ce qui permettrait de sélectionner et d’affiner les concepts mis au service de l’enseignement, voire d’en élaborer de nouveaux. En attendant qu’une telle étude puisse voir le jour, l’analyse des ouvrages de synthèse et des manuels scolaires s’avère une piste praticable pour tenter de lever des difficultés conceptuelles identifiées depuis de nombreuses années, sans que cela n’ait débouché sur une véritable remise en question des définitions standardisées.
J’ai essayé de montrer dans cet article la nécessité de faire avancer la théorie du récit de manière à ce que cette dernière soit en mesure d’offrir des ressources utiles pour l’enseignement. Le chantier est énorme et j’aurais pu orienter l’analyse sur bien d’autres notions24, mais le choix de traiter la focalisation, le point de vue et l’intrigue a été motivé par le caractère incontournable de ces paramètres du récit, et par le désir de mettre en évidence leurs liens profonds, alors que les approches antérieures ont eu généralement tendance à les traiter de manière complètement séparée. Nous avons vu qu’au prix d’une mise à jour relativement simple de leur définition, ces notions étaient susceptibles de gagner en clarté et en pouvoir heuristique, tout en rendant plus claire leur interconnexion profonde, leur valeur esthétique et leurs manifestations concrètes dans la littérature aussi bien que dans d’autres médias.
La définition rhétorique de l’intrigue apparaît notamment en mesure d’attirer l’attention sur des phénomènes qui éclairent non seulement la façon dont les récits se structurent, mais également la façon dont ils intéressent leur public en les tenant en haleine jusqu’à un éventuel dénouement25. L’étude de la progression dans le récit, couplée à une discussion sur les incertitudes et les virtualités de l’histoire à un point donné de son développement, permet ainsi d’entamer une réflexion sur le plaisir esthétique engendré par la fiction, ainsi que sur sa valeur éthique26. Cette réflexion peut aussi être associée à des dispositifs médiatiques tels que le cliffhanger ou les arcs narratifs des formes sérielles qui dominent notre horizon culturel, ce qui permet de renforcer le développement de ce que l’on appelle aujourd’hui une «littératie médiatique multimodale» (Lebrun, Lacelle & Boutin 2012). Enfin, l’intrigue renvoyant à l’organisation du discours narratif, elle repose de manière fondamentale sur la gestion de l’information narrative et elle est donc directement liée aux questions de focalisation et de point de vue. La perspective rhétorique permet ainsi une approche intégrée de différents phénomènes évidemment solidaires, mais autrefois mal articulés par des approches trop parcellaires.
Par ailleurs, étant donné que tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance de la construction narrative de la «posture immersive» du lecteur (Schaeffer 1999 : 244), la confusion longuement entretenue entre focalisation et point de vue doit absolument être évitée, d’autant plus que des outils efficaces permettant de décrire l’un et l’autre phénomènes existent depuis longtemps. Les étudiant·e·s en cinéma n’ont généralement aucun mal à distinguer les trois régimes de focalisation des phénomènes d’ancrage du point de vue audiovisuel dans la subjectivité d’un personnage, ainsi que les y invite, depuis une trentaine d’années, l’ouvrage de synthèse le plus largement cité dans le domaine francophone (Gaudreault & Jost 2017, première édition en 1990). Il n’y a aucune raison de penser que ces phénomènes soient beaucoup plus complexes dans les fictions littéraires, même si ces dernières recourent à d’autres vecteurs d’immersion et mettent en avant d’autres paramètres de la subjectivité27.
Grâce à la redéfinition que j’ai proposée, on constate qu’il est possible d’exploiter une approche comparée des médias, que Jost appelle de ses vœux depuis une quarantaine d’années (1989 ; 2017), tout en tenant compte de la spécificité des moyens par lesquels les phénomènes narratifs s’incarnent dans la matérialité de leur support, que ce dernier soit verbal, graphique, scénique ou audio-visuel. Sur ce point, j’aimerais insister sur le fait que le travail d’analyse littéraire devrait toujours déboucher sur une prise de conscience de la manière spécifiquement verbale par laquelle les phénomènes narratifs se concrétisent, ce qui est aussi une façon de mieux saisir la complexité du paysage médiatique dans lequel nous vivons.
Bibliographie
Abbott, H. Porter (2007), « Story, Plot, and Narration », in Herman, David (éd.), The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge, Cambridge University Press, p. 39-51.
Adam, Jean-Michel (1997), Les Textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris, Nathan.
Adam, Jean-Michel (1996 [1984]), Le Récit, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 3e édition.
Adam, Jean-Michel, Gilles Lugrin & Françoise Revaz (1998), « Pour en finir avec le couple Récit / Discours », Pratiques, n° 100, p. 81-98.
Adam, Jean-Michel & Françoise Revaz (1996), L'Analyse des récits, Paris, Seuil, coll. « Mémo ».
Bal, Mieke (1977), Narratologie. Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes, Paris, Klincksieck.
Baroni, Raphaël (2018), « Dynamique de l’intrigue, improvisation et segmentation : nouvelles perspectives pour l’enseignement de la littérature »,Forumlecture suisse. Littératie dans la recherche et la pratique, n° 1. URL : http://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/619/2018-1-baroni.pdf
Baroni, Raphaël (2017a), Les Rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël (2017b), « Pour une narratologie transmédiale », Poétique, n° 182, p. 155-175.
Baroni, Raphaël (2016a), « Dramatized Analepsis and Fadings in Verbal Narratives », Narrative, n° 24 (3), p. 311-329.
Baroni, Raphaël (2016b), « L’empire de la narratologie contemporaine, ses défis et ses faiblesses », Questions de communication, n° 30, p. 219-239.
Baroni, Raphaël (2009), L’Œuvre du temps, Paris, Seuil.
Baroni, Raphaël (2007), La Tension narrative. Suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Barthes, Roland (1970), S/Z, Paris, Seuil.
Barthes Roland (1966), « Introduction à l'analyse structurale des récits », Communications, n° 8, p. 1-27.
Bemporad, Chiara (2014), « Lectures et plaisirs : pour une reconceptualisation des modes et des types de lecture littéraire », Études de Lettres, n° 295, p. 65-83.
Benveniste, Émile (1966), « Les relations de temps dans le verbe français », in Problèmes de linguistique générale I, (dir.), Paris, Gallimard, p. 237-250.
Bronckart, Jean-Paul (1996), Activité langagière, textes et discours, Lausanne & Paris, Delachaux & Niestlé.
Bronckart, Jean-Paul (1985), Le Fonctionnement des discours, Neuchâtel & Paris, Delachaux & Niestlé.
Brooks, Peter (1992), Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative, Cambridge & London, Harvard University Press.
Chalonge, Florence de (2003), « Poétique et phénoménologie : le point de vue et la perception », Littérature, n° 132, p. 71-84.
Citton, Yves (2010), Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Paris, Éditions Amsterdam.
Compagnon, Antoine (2001), Le Démon de la théorie, Paris, Seuil.
Crane, R. S. (1952), « The Concept of Plot and the Plot of Tom Jones », in Critics and Criticism: Ancient and Modern, Chicago, University of Chicago Press, p. 62-93.
Daunay, Bertrand (2007), « Le sujet lecteur : une question pour la didactique du français », Le Français aujourd'hui, n° 157 p. 43-51.
Daunay, Bertrand (2002), Éloge de la paraphrase, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincenne.
Daunay Bertrand (1999), « La "lecture littéraire" : les risques d’une mystification », Recherches, n° 30, p. 29-59.
Daunay, Bertrand & Jean-Louis Dufays (2016), « La lecture littéraire en débat, pour en finir ? », in Enseigner les littératures dans le souci de la langue, C. Ronveaux (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 211-232.
David, Jérôme (2012), « Le premier degré de la littérature », LHT, n° 9. Consulté le 26 novembre 2014. URL : http://www.fabula.org/lht/9/index.php?id=304
David, Jérôme, Mathias Ecoeur & Anne-Frédérique Schläpfer (dir.) (2017), «Justifier l’enseignement de la littérature», Transpositio n°1. Consulté le 15 janvier 2019. URL : http://www.transpositio.org/categories/view/n-1-justifier-l-enseignement-de-la-litterature
Duchan, Judith F., Gail A. Bruder & Lynn E. Hewitt (1995), Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates.
Dufays, Jean-Louis (2017), « La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique », Tréma, n° 45. Consulté le 17 janvier 2019. URL : http://trema.revues.org/3486
Eco, Umberto (1979), L’Œuvre ouverte, Paris, Seuil.
Escola, Marc (dir.) (2012), Théorie des textes possibles, Amsterdam & New York, Rodopi.
Flaubert, Gustave (1999), Trois Contes, Paris, coll. « Le Livre de Poche ».
Fludernik, Monika (1996), Towards a "Natural" Narratology, London, Routledge.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature. La relation esthétique dans l’enseignement des textes littéraires, Rennes, PUR.
Gaudreault, André & Jost, François (2017 [1990]), Le Récit cinématographique, Films et séries télévisées, Armand Colin Cinéma, Paris, Armand Colin, 3e édition.
Genette, Gérard (2007 [1972 et 1983]), Discours du récit, Paris, Seuil.
Jost, François (2017), « À quelles conditions est-il possible de faire une narratologie comparée? », Questions de communication, n° 31 p. 265-278.
Jost, François (2016), « Repenser le futur avec les séries. Essai de narratologie comparée », Télévision, n° 7, p. 13-29.
Jost, François (1989 [1987]), L'Œil-caméra. Entre film et roman, Lyon, PUL.
Jouve, Vincent (2001), Poétique des valeurs, Paris, PUF.
Korthals Altes, Liesbeth (1999), « Le tournant éthique dans la théorie littéraire : impasse ou ouverture ? », Études littéraires, n° 31 (3), p. 39-56.
Kukkonen, Karin (2014a), « Bayesian Narrative: Probability, Plot and the Shape of the Fictional World », Anglia, n°132 (4), p. 720-739.
Kukkonen, Karin (2014b), « Plot », in Handbook of Narratology, P. Hühn, J. C. Meister, J. Pier, W. Schmid (dir.), Berlin & New York, Walter de Gruyter, p. 706-719.
Larivaille, Paul (1974), « L'analyse (morpho)logique du récit », Poétique, n° 19 p. 368-388.
Laugier, Sandra (2006), Ethique, littérature, vie humaine, Paris, Presses Universitaires de France.
Lavocat, Françoise (2016), Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La Littératie médiatique multimodale, Québec, Presses Universitaires du Québec.
Legallois, Dominique & Céline Poudat (2008), « Comment parler des livres que l'on a lus ? Discours et axiologie des avis des Internautes »,Semen, n° 26, en ligne, consulté le 2 avril 2019. URL : https://journals.openedition.org/semen/8444
Niederhoff, Burkhard (2011), « Focalization », The Living Handbook of Narratology. Consulté le 15 janvier 2018.URL : http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/focalization
Patron, Sylvie (2018), Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Patron, Sylvie (2009), Le Narrateur, Paris, Armand Colin.
Pedot, Richard (2008), « Intriguer au-delà de l’intrigue », Tropismes, n° 15 p. 23-48.
Phelan, James (1989), Reading People, Reading Plots: Character, Progression, and the Interpretation of Narrative, Chicago, University of Chicago Press.
Philippe, Gilles (1997), Le Roman. Des théories aux analyses, Paris, Seuil, coll. « Memo ».
Pouillon, Jean (1946), Temps et roman, Paris, Gallimard.
Propp, Vladimir (1970), Morphologie du conte, Paris, Seuil.
Rabatel, Alain (2014), « Empathie, points de vue, méta-représentation et dimension cognitive du dialogisme », Études de linguistique appliquée, n°173, p. 27-45.
Rabatel, Alain (2009), Homo Narrans, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2 vol.
Rabatel, Alain (2000), « Un, deux, trois points de vue ? Pour une approche unifiante des points de vue narratif et discursif », La Lecture littéraire, p.195-254.
Rabatel, Alain (1998), La Construction textuelle du point de vue, Lausanne & Paris, Delachaux & Niestlé.
Rabatel, Alain (1997), « L'introuvable focalisation externe. De la subordination de la vision externe au point de vue du personnage ou au point de vue du narrateur », Littérature, n° 107 p. 88-113.
Ramuz, Charles-Ferdinand (2013), Romans, Genève, Slatkine, tome 9.
Reuter, Yves (2016 [1997]), L’Analyse du récit, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », 3e édition.
Reuter, Yves (2000), « Narratologie, enseignement du récit et didactique du français », Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n° 21 p. 7-22.
Revaz, Françoise (1997), Les Textes d’action, Metz, Klincksieck.
Revaz, Françoise (2009), Introduction à la narratologie. Action et narration, Bruxelles, De Boeck & Duculot.
Rimmon-Kenan, Shlomith (2002 [1983]), Narrative Fiction, Londres & New York, Routledge.
Ronveaux, Christophe, Bernard Schneuwly & GRAFElitt (2019), «Discipliner par la littérature», in Approches didactiques de la littérature, N. Denizot, J.-L. Dufays & B. Louichon (dir.), Namur, PUN, p. 139-156.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (dir.) (2004), Le Sujet lecteur. Lectures subjectives et enseignement de la littérature, Rennes, P.U.R.
Salmon, Christian (2007), Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil.
Stanzel, Franz-K. (1981), « Teller-Characters and Reflector-Characters in Narrative Theory », Poetics Today, n° 2 (2), p. 5-15.
Sternberg, Meir (1992), « Telling in time (II) : Chronology, Teleology, Narrativity », Poetics Today, n° 13 (3), p. 463-541.
Todorov, Tzvetan (2007), La Littérature en péril, Paris, Flammarion.
Todorov, Tzvetan (1969), Grammaire du Décaméron, The Hague, Paris, Mouton.
Todorov, Tzvetan (1966), « Les catégories du récit littéraire », Communication, n° 8, p. 125-151.
Villeneuve, Johanne (2004), Le Sens de l’intrigue, ou la narrativité, le jeu et l'invention du diable, Québec, Presses Universitaires de Laval.
Weinrich, Harald (1973), Le Temps, Paris, Seuil.
Pour citer l'article
Raphaël Baroni, "Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement : schéma quinaire et focalisation en débat", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/pour-des-concepts-narratologiques-intelligibles-et-utiles-pour-l-enseignement-schema-quinaire-et-focalisation-en-debat
Voir également :
Entre dialogue et contraintes : interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique
Vouloir interroger « les modalités de circulation des savoirs entre la recherche et les pratiques enseignantes », objectif des dix-neuvièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature et du présent dossier qui en est issu, relève d’une intention dont peu d’acteurs ou d’actrices de ce champ contesteront la pertinence – sans qu’aucun·e, assurément, ne suppose que cette question soit neuve. De même que « la question de savoir si la philosophie peut devenir pratique est aussi ancienne que la philosophie » (Habermas 2008 : 487), de même que les sciences humaines et sociales sont, depuis leur constitution au XIXe siècle, confrontées à « la problématique de l’intervention » (Bronckart 2001 : 133), de même on peut aisément dire qu’il n’y a pas eu d’époque où le problème des relations entre recherche et pratique dans le domaine de l’éducation n’ait pas été posée, en général d’ailleurs d’une manière négative – des deux côtés. Comme le dit Huberman (1992 : 69) :
Entre dialogue et contraintes : interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique
Introduction
Vouloir interroger «les modalités de circulation des savoirs entre la recherche et les pratiques enseignantes», objectif des dix-neuvièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature et du présent dossier qui en est issu, relève d’une intention dont peu d’acteurs ou d’actrices de ce champ contesteront la pertinence – sans qu’aucun·e, assurément, ne suppose que cette question soit neuve. De même que «la question de savoir si la philosophie peut devenir pratique est aussi ancienne que la philosophie» (Habermas 2008 : 487), de même que les sciences humaines et sociales sont, depuis leur constitution au XIXe siècle, confrontées à «la problématique de l’intervention» (Bronckart 2001 : 133), de même on peut aisément dire qu’il n’y a pas eu d’époque où le problème des relations entre recherche et pratique dans le domaine de l’éducation n’ait pas été posé, en général d’ailleurs d’une manière négative –des deux côtés. Comme le dit Huberman:
Le fossé entre l'univers de la recherche scientifique et celui de la pratique éducative a toujours passionné les esprits. Dans la plupart des cas, nous constatons ce phénomène à travers les litanies d'une communauté à l'égard de l'autre. (Huberman 1992 : 69)
D’une certaine manière, cette question a la caractéristique paradoxale des questions vives: par définition, elle ne donne pas lieu à des réponses consensuelles, mais en même temps on sent bien qu’elle a quelque chose de convenu, qui facilite sa répétition. Et il y a tout lieu de croire que, s’agissant des relations entre la recherche et l’enseignement, la question restera éternellement programmatique comme dans l’appel de Pastiaux-Thiriat et Berbain (1990) «pour une interactivité entre la recherche et les enseignants».
C’est sans doute en fait qu’une telle question contribue à façonner l’identité des acteurs qui (se) la posent. Et c’est ce qui explique sa constante reprise –et particulièrement dans des disciplines dont l’identité se questionne, comme c’est le cas de la didactique de la littérature. Car c’est bien à son identité que l’on touche quand on (re)pose cette question et qu’on la pose en des termes toujours identiques et toujours renouvelés: toujours identiques, car il suffit de lire des textes de notre champ des dernières décennies pour que la question d’aujourd’hui ne fasse pas l’effet d’une découverte; toujours renouvelés, parce que les contextes changent et se chargent de donner un écho particulier à nos discours, qui, de ce seul fait, se renouvèlent.
C’est dans cette optique je me propose ici d’identifier les questions identitaires qui sont en jeu dans la didactique de la littérature. Au reste, celle-ci existe-t-elle comme discipline? On peut voir là une manière de parler, pour désigner les approches didactiques de la littérature comme un contenu spécifique, de la même manière que l’on peut parler de la didactique de la grammaire, du nombre, de la danse, etc. On peut aussi entendre l’expression comme le nom d’une discipline de recherche autonome, comme on parle de didactique des mathématiques, de didactique de l’EPS, de didactique du français. Dans les deux cas, la question se pose de savoir quels sont les liens –d’appartenance, de concurrence, de complémentarité– que la didactique de la littérature peut entretenir avec la didactique du français, avec d’autres didactiques et/ou avec la didactique comme champ de recherche à la fois unifié et parcellisé.
Je me propose ici, en m’inspirant d’anciens de mes travaux sur la question (ce qui entrainera malheureusement quelque excès dans l’autocitation), de réfléchir assez librement, mais dans un classique plan ternaire, au statut de ce que pourrait être une discipline intitulée «didactique de la littérature», pour interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique (la recherche, l’Institution, la pratique effective), liens que j’envisagerai comme dialogue et/ou contrainte, comme mon titre le laissait entendre.
Une discipline didactique ?
La question disciplinaire, si l’on peut dire, est ancienne, s’agissant de la didactique de la littérature – et elle concerne directement la question qui nous occupe ici des relations entre recherche et pratiques enseignantes. Elle prend en fait sa source dans l’histoire de la didactique du français et dans la relation complexe de cette discipline avec la matière scolaire enseignée. La configuration initiale de la didactique du français, dans les années 1970-1980, s’est faite dans un souci de ne pas reproduire sur le terrain académique la subordination de l’enseignement du français à la littérature. Cette dernière s’observait institutionnellement dans le secondaire, mais était également le fait de l’enseignement primaire, de deux manières : d’une part par la valorisation de la langue littéraire, promue comme modèle de la langue à enseigner, d’autre part par la logique de l’orientation qui amenait, dès ces années-là, tous les élèves du primaire à un cursus secondaire au moins partiel. D’où le choix des didacticien·ne·s, à l’origine, de ne pas isoler la littérature d’autres objets d’enseignement et d’apprentissage, choix revendiqué même par celles et ceux qui, s’inscrivant, par leurs travaux universitaires, dans le champ des études littéraires, se désignaient comme spécialistes de l’enseignement (et plus tard comme didacticien·ne·s) du français, non de la littérature. Ces chercheur·e·s reproduisaient là, d’ailleurs, la revendication d’acteurs et d’actrices de l’enseignement de l’époque, qui tenaient à se dire enseignant·e·s de français et non de lettres, cette distinction de dénomination marquant bien une différenciation de positionnement (vécu comme idéologique) dans la conception de l’enseignement du français. Petitjean, en 1998, 25 ans après la naissance de Pratiques, écrivait que les membres du collectif, dans les années 1970, «ont contribué […] à l’invention collective […] d’une nouvelle discipline (le français vs les Lettres) et d’un champ théorique : la didactique» (1998 : 3).
On voit ici, plus sur le terrain des valeurs que des savoirs, une double circulation entre la recherche et les pratiques enseignantes: celles-ci, dans leur version militante, ont contribué à façonner un champ de recherche; ce dernier a cherché en retour à construire une nouvelle matière scolaire sur le terrain des pratiques. La question qui se posait était celle de la place de la littérature dans l’approche didactique de l’enseignement du français et cette question pouvait être considérée comme relativement vive. En témoigne cet essai de synthèse –ou de compromis?– de 1998, dans le texte d’orientation de l’Association internationale pour la recherche en didactique du français langue maternelle (DFLM), l’ancêtre de l’AIRDF, Association internationale pour la recherche en didactique du français:
Les spécificités du fait littéraire justifient-elles une autonomisation plus radicale de son champ, ou bien plutôt un va-et-vient dialectique entre les démarches centrées sur l’appropriation du fait littéraire et celles qui privilégient le développement de la lecture et de l’écriture. (DFLM 1998 : 31)
Là encore, la question est indissociable de celle de l’unité de la matière enseignée, qui fait l’objet des recherches didactiques. On sait qu’historiquement, la didactique du français a voulu penser de manière intégrative les contenus de la matière français, en la concevant de façon ouverte comme lieu de la construction des compétences (méta)langagières, ce que permettait la mise en avant des notions de textes et de discours (voir Halté 1992). Mais l’unification des problématiques didactiques au sein de la didactique du français ne voulait pas dire que ces dernières étaient indifférenciées : si penser les différences et les liens entre les contenus permet d’éviter les essentialisations hâtives qui sont parfois le fait de croyance débordantes, la vigilance théorique des didacticien·ne·s à l’égard des contenus est assez vive pour qu’elle oblige à se demander ce qu’il peut y avoir de spécifique au traitement respectif de contenus comme la littérature.
Comme le dit Bernard Schneuwly, «la littérature est un objet culturel qui a des discours de référence multiples, mais disciplinairement relativement bien définis, c’est-à-dire avec des disciplines académiques de référence» et on peut identifier le «mode de penser et de parler particulier des pratiques littéraires qui se fondent sur des savoirs tout à fait spécifiques» (Schneuwly 1998 : 271). Ce sont finalement là des questions dont le traitement est rendu possible par les théories qui pensent, de diverses manières, la transposition didactique des savoirs, des pratiques ou des discours de référence.
Encore faut-il ne pas supposer le contenu préalable à sa théorisation didactique ; car quelle consistance épistémologique serait celle d’une discipline qui supposerait tel objet –au hasard: la littérature– susceptible d’un traitement scientifique sans être constamment construit et reconstruit théoriquement par ce même traitement scientifique ? Si la question vaut évidemment pour toutes les didactiques (cf. à cet égard Chevallard 2014), elle intéresse au plus haut point la didactique de la littérature. Pour reprendre les mots de Yann Vuillet, la désignation même de «didactique de la littérature» a quelque chose de surprenant, «eu égard à l’absence de définition conceptuelle “du” littéraire» (Vuillet 2017 : 326). Il y voit comme un «nœud idéologique», sorte de cristallisation «de processus d’évaluations sociales ne pouvant se “trancher” par des savoirs» (Vuillet 2017 : 234). Les travaux genevois sur la réputation littéraire ont apporté des éclairages importants à cet égard (Ronveaux & Schneuwly (dir.) 2019).
Je suis parti, dans l’élaboration de mon questionnement, d’une évocation de la didactique du français et de l’émergence en son sein de questions spécifiques à la littérature. Or il semble qu’il existe peu de débats théoriques, dans les approches didactiques de la littérature, sur les liens possibles entre didactique du français et didactique de la littérature, même si la question est posée de manière claire et intéressante dans la synthèse récente du champ par Sylviane Ahr (2015). Plus encore, il semble que soit peu traitée la question des liens possibles entre didactique de la littérature et autres didactiques, si ce n’est dans une perspective de réflexion transdisciplinaire entre didactique de la littérature et des arts (voir Chabanne 2016). Cela m’a conduit naguère, à l’issue des treizièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature à Gennevilliers en 2012, à m’interroger sur la faible utilisation de concepts élaborés dans d’autres didactiques (Daunay 2015).
S’il est intéressant de penser la spécificité d’une didactique, encore faut-il précisément la penser en faisant le même travail que celui que suscite la récurrence de la «question vive» que mettait à l’honneur la dix-huitième école d’été de didactique des mathématiques: «La didactique ou les didactiques?» (voir Matheron et al. 2016 ; Éducation & didactique 2014). De fait, la question qui se pose entre didactique de la littérature et didactique du français est finalement de même nature que la relation entre les diverses didactiques et c’est à la condition de renouveler constamment ce débat théorique qu’il est possible de prétendre, en respectant toutes les spécificités et les frontières qu’on voudra, construire comme champ spécifique la didactique, «dont l’unité et la diversité se conjuguent» (Daunay 2016 : 318).
Une discipline aux croisements
Pour interroger le processus de disciplinarisation et/ou d’autonomisation de la didactique de la littérature, je me propose de présenter une petite formalisation de la didactique, que j’ai réalisée en m’inspirant librement de deux textes anciens, écrits la même année, de Halté (1992) et de Reuter (dans Brassard & Reuter 1992) –pour suivre le fil historique que j’ai commencé à tendre.
Cette formalisation (dont une première version se trouve dans Daunay 2017) identifie trois possibles orientations de la didactique (de la littérature), complémentaires et non exclusives évidemment, qui se réalisent en dominantes, pour reprendre le terme d’Halté (Halté 1992 : 16). Ces orientations engagent des relations particulières avec des lieux de théories ou de pratiques.
Une première orientation de la didactique concerne le travail qu’elle réalise sur les contenus disciplinaires, en l’occurrence les contenus qui ont trait aux questions de littérature. La didactique est alors liée aux théories de références qui concernent les contenus, pour nous les théories littéraires, mais aussi l’analyse du discours, entre autres.
Orientation épistémologique
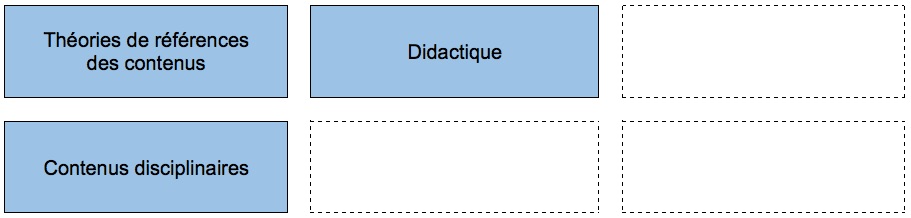
Une deuxième orientation que je nommerai subjectiviste renvoie à la préoccupation de la didactique (de la littérature, entre autres) pour les sujets didactiques (élèves comme enseignant·e·s) et les diverses institutions qui les assujettissent. Cette préoccupation théorique engage des relations avec des disciplines qui, sans nécessairement prêter d’attention aux contenus, s’intéressent aux sujets et aux institutions, de la psychologie à la sociologie, en passant par l’histoire, l’anthropologie, la philosophie, etc.
Orientation subjectiviste
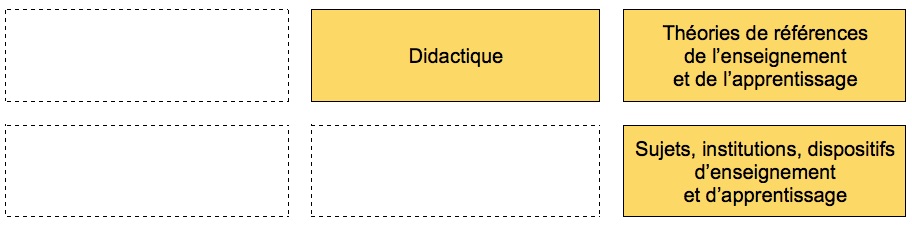
Une troisième orientation serait celle qu’Halté appelait praxéologique, qui établit une relation entre la didactique de la littérature et les pratiques disciplinaires, c’est-à-dire celles qui concernent cette discipline scolaire «littérature», quelle que soit sa relation aux autres disciplines de la matière «français»:
Orientation praxéologique
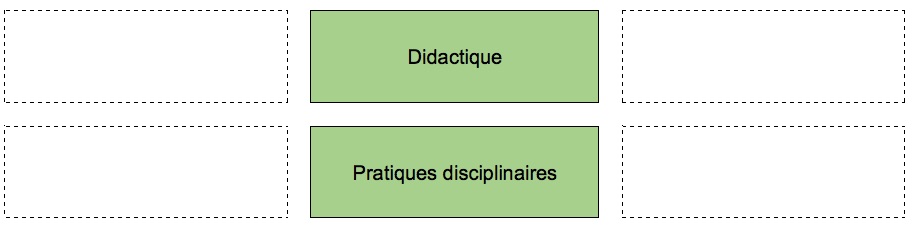
Bien sûr, cette orientation est indissociable des sujets et des contenus et il vaudrait mieux identifier ainsi la dimension praxéologique:
Orientation praxéologique (2)
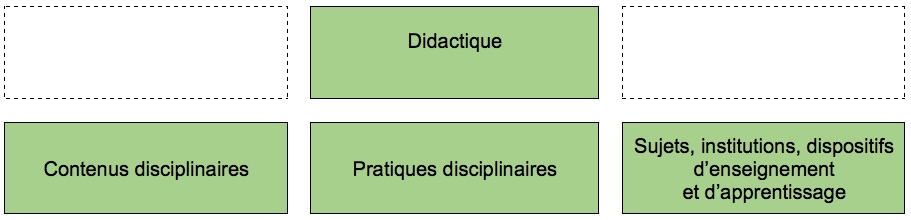
Rappelons les cases disparues et nous retrouvons l’ensemble des relations spécifiques que la didactique noue avec d’autres lieux.
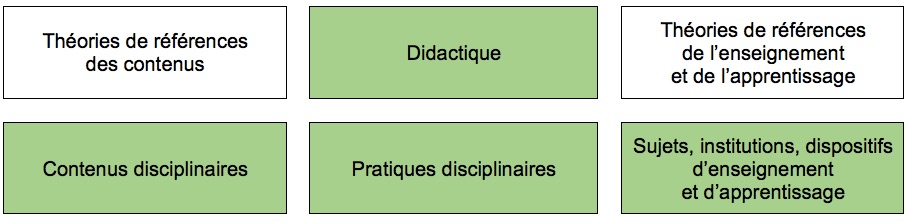
Ce schéma dit bien la dimension systémique de la didactique (Halté 1992), mais aussi sa fragilité, qui tient à ses relations multiples avec des lieux variés, qui ont pu longtemps rendre difficile son autonomie, gage de sa disciplinarisation. C’est sur ce point que je voudrais m’arrêter maintenant, en interrogeant plus spécifiquement, au-delà du caractère généraliste de cette formalisation, la didactique de la littérature.
Les conditions d’une autonomie
La question de la disciplinarisation de la didactique de la littérature n’est pas sans rappeler celle qui s’est posée historiquement dans le processus de construction de la didactique du français comme discipline de recherche, faites de «tensions constitutives» que j’ai analysées ailleurs (Daunay 2007b: 21-28). Sans pouvoir reprendre cette histoire, rappelons que la didactique du français s’est constituée en cherchant à se libérer d’un paradigme applicationniste, qui pouvait se caractériser par une triple dépendance de la recherche : à l’égard des théories dites de référence (la linguistique essentiellement), à l’égard de l’Institution scolaire à travers ses réseaux décisionnaires ou militants, à l’égard de la pratique de terrain, matière qu’il s’agissait souvent de transformer avant de vraiment la connaitre… Le mouvement d’émancipation de la didactique du français, en quoi consiste son processus de disciplinarisation, n’est pas propre à la didactique du français mais concerne, mutatis mutandis, toutes les didactiques. La didactique de la littérature permet-elle d’observer ce même mouvement d’émancipation? Rien ne permet d’en douter, mais j’aimerais interroger, dans ce qui est encore une phase d’émergence, les modalités des relations entre la didactique de la littérature et ces trois lieux, en faisant jouer des dichotomies sans subtilité, mais utiles pour un débat : soumission ou parité? Dialogue ou contrainte?
Relation entre didactique de la littérature et théorie littéraire
Prenons pour commencer la relation entre la didactique de la littérature et la théorie littéraire, que l’on peut placer dans la case en haut à gauche de notre schéma:
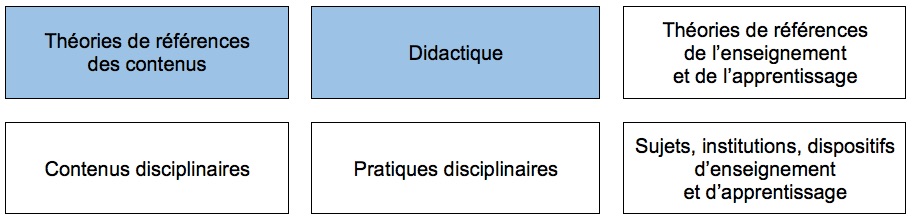
La théorie littéraire est-elle, dans la pratique de recherche effective, essentiellement perçue comme une discipline contributoire ou comme une discipline en surplomb ? Qu’il y ait dialogue entre didactique de la littérature et théorie littéraire est assez naturel. Mais, comme cela a pu être le cas avec la linguistique aux débuts de la didactique du français, la référence vaut parfois révérence : qu’on pense, anciennement, aux théories de Picard (et de Jouve) –peut-être se rappelle-t-on que j’avais, naguère, mis en cause de manière polémique les travaux de Picard, précisément parce que je voyais dans l’usage qui en était fait par certain·e·s didacticien·ne·s, une bévue, dans la mesure où, tout au respect des propositions théoriques de l’auteur, elles ou ils ne voyaient pas ce qui pourtant, dans son discours, était idéologiquement contradictoire avec leur propre projet (Daunay 2007b : 39). Je me demande si l’on n’assiste pas au même phénomène de révérence avec un Pierre Bayard ou un Yves Citton… Pour interroger la possible subordination de la didactique de la littérature aux théories littéraires, on peut se saisir de trois indicateurs, que j’avais utilisés il y a dix ans (Daunay 2007a ; 2007b), pour interroger le statut de la didactique de la littérature:
– l’absence ou la parcimonie des références aux recherches didactiques dans les écrits des théoriciens de la littérature cités par les didacticien·ne·s;
– la rareté des discussions théoriques, en didactique, des propositions de ces mêmes auteurs;
– la primauté accordée à ces derniers en tant que théoriciens, visible particulièrement dans l’usage des syntagmes «théorique et didactique» ou «universitaire et didactique» (voir le titre de la dernière livraison de Pratiques, en 2018 : Poésie et langue : aspects théoriques et didactiques), qui laisse supposer que la didactique n’aurait pas la même vertu conceptuelle que la théorie littéraire instituée comme discipline de référence.
Ces trois indicateurs (qui gagneraient à être actualisés par une étude empirique d’un corpus récent, même si l’on peut intuitivement penser qu’elle donnerait les mêmes résultats) permettent au moins d’interroger une forme de relation de dépendance de la didactique à la théorie littéraire.
J’évoquais plus haut la place encore congrue faite aux autres didactiques –ou encore, entre autres, aux travaux de sociologie des apprentissages ou des usages– dans nombre de travaux de didactique de la littérature. Or la délimitation d’un espace propre de travail ne veut pas dire se priver des dialogues possibles avec les contenus pensés par d’autres disciplines et, au rebours de l’illusion de son irréductibilité, interroger ce qui est commun à l’enseignement de la littérature et de la langue, par exemple en redéfinissant à nouveaux frais le double processus de subjectivation et d’assujettissement que suppose la prise en compte du sujet parlant (donc écrivant, lisant, pensant…) –ce que permet du reste le concept de sujet lecteur ou scripteur, quand il est utilisé de manière ouverte (pensons ici à la question d’«enseigner les littératures dans le souci de la langue», pour reprendre le titre des onzièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique des littératures de Genève : voir Ronveaux 2016). Le projet de didactique comparée peut aider à faire ressortir, dans l’étude d’un phénomène didactique, des «dimensions spécifiques (liées aux objets de savoirs) et génériques (liées à un fonctionnement indépendant de ces objets)», pour reprendre les termes que Florence Ligozat (2016 : 305) emprunte au vocabulaire propre des recherches en didactique comparée, et qu’elle illustre brillamment avec le cas de la lecture-compréhension littéraire dans le cadre des cercles de lecture.
Un rapprochement plus net avec les autres didactiques permettrait de mieux percevoir et de décrire, du point de vue didactique, les limites conceptuelles de certaines constructions théoriques littéraires et surtout l’inanité des propositions prétendument didactiques, c’est-à-dire, sous leur plume, pratiques, de certain·e·s théoricien·ne·s de la littérature, si peu aveuglé·e·s par le travail des didacticien·ne·s qu’ils peuvent gloser sur leurs objets en les ignorant… Cela permettrait de penser, indépendamment, l’origine et le devenir, en didactique de la littérature, de concepts propres, quand bien même ils seraient initialement empruntés : concernant l’emblématique lecture littéraire, on peut citer le travail de synthèse théorique de Brigitte Louichon (2011) et le programme de travail théorique que propose Jean-Louis Dufays (2016) pour affermir le concept, dans le double souci d’une clarification théorique et d’une mise à l’épreuve empirique –même si elle mérite d’être encore discutée (Gabathuler, Védrines & Vuillet 2019).
Finalement, pour parvenir à se discipliner, sans doute faudrait-il que la didactique de la littérature se fasse moins littéraire et plus didactique…
Relation entre didactique de la littérature et Institution scolaire
Qu’en est-il des relations de la didactique de la littérature avec l’Institution scolaire? Celle qui prend sa place dans la partie en bas à droite de notre schéma initial –que l’on peut finalement identifier comme un des champs de réalisation de la didactique:
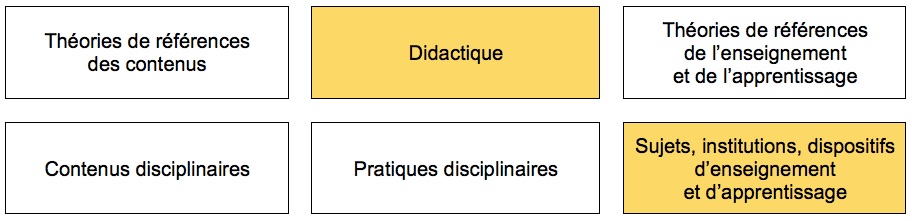
La contrainte peut se voir notamment par l’identification fréquente du discours officiel comme source et non comme corpus de l’étude: pour prendre des exemples en France, nombreux sont les travaux qui supposent l’écriture d’invention inventée par les instructions officielles de 2002 ou qui –au contraire– parlent de la «lecture méthodique», de la «lecture analytique», de la «lecture cursive», de la «lecture d’images», comme si ces choses-là existaient en dehors de leur lieu d’institution, à savoir les programmes.
Ce qui peut sembler une soumission à l’Institution, dans le domaine de l’enseignement de la littérature, me semble avoir été observé, en France, au tournant des années 2000, au moment de l’élaboration de nouveaux programmes (pour le primaire comme pour le secondaire) où la question de l’enseignement de la littérature n’a pas été mineure. Observons d’ailleurs que c’est à cette époque qu’a eu lieu la première édition des Rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature (2000).
La relation entre didactique et Institution ne s’opère alors pas seulement par le mélange des acteurs mais aussi par celui des genres de discours tenus sur les programmes : ainsi, un même contenu peut en effet être écrit par les mêmes personnes dans le cadre des documents d’accompagnement des programmes (sphère institutionnelle) et dans le cadre d’un article théorique (sphère de la recherche) (pour un développement, voir Daunay 2007b: 43). Depuis cette époque, la participation régulière d’inspecteurs ou d’inspectrices à des colloques de didactique de la littérature, qui pourrait être des occasions de confrontation, est plutôt le signe d’une sorte de consensus. Qu’on pense du reste à l’usage du terme didactique pour désigner des épreuves de concours en France ou des prescriptions de bonnes pratiques. Là encore, cette relation avec les représentants de l’Institution scolaire est placée sous le double signe de la contrainte et du dialogue: certes, on voit bien la volonté de penser la prescription comme moyen de diffusion de la recherche, mais ne doit-on pas plutôt y voir le signe d’un cadrage du champ qui réponde à ce qui est légitimement audible pour des représentants de l’Institution?
Que des didacticien·ne·s, en France comme ailleurs, aient participé à l’élaboration de certains programmes n’est un souci pour personne : on peut jouer un rôle de conseil et de proposition ingénierique sans pour autant abdiquer une indépendance théorique par rapport à l’Institution. Le problème est de s’assurer de cette indépendance, du moins si l’on considère que le propre d’une discipline de recherche est de se donner ses propres outils de pensée et d’analyse, ce qui suppose une forte distance avec ce qui existe déjà. Il est intéressant de noter qu’il semble que la didactique de la littérature, dans sa relation avec l’Institution, ait vu se reproduire le même phénomène de relation étroite entre l’Institution et la recherche qu’a connu la didactique du français, puisqu’on peut dire qu’en France, c’est dans des travaux réalisés dans le cadre du plan officiel de rénovation, sous la conduite d’Hélène Romian, qu’émergea la didactique du français. Mais je n’ai pas le souvenir, au début du XXIe siècle, de fortes tensions entre recherche et Institution, comme celle que connut la didactique du français à la sortie des programmes issus du Plan de rénovation, en 1972 (sur ce point, voir Romian 2014).
Relation entre didactique de la littérature et pratiques de classes
L’une des conséquences de ce suivisme à l’égard de l’Institution peut se voir dans la relation à la pratique dans les classes, cette case au centre de notre schéma, autre champ de réalisation de la didactique:
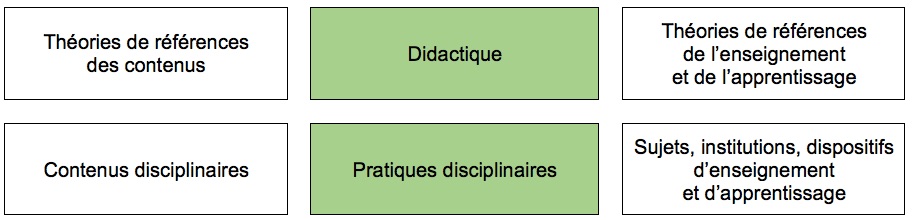
Interroger le lien entre les deux champs permet d’identifier la posture prescriptive parfois prise dans des travaux en didactique. Est-on sûr par exemple de toujours s’interdire de reprocher aux enseignant·e·s de ne pas respecter les instructions officielles, sans s’interroger sur les limites de ces dernières ? Est-on sûr aussi de ne pas privilégier ce qui est perçu comme innovant, reproduisant ainsi «l’anti-traditionalisme affiché par la didactique du français» dont parlait Claude Simard, qui plaidait pour un «un point de vue plus ouvert et plus explicatif face à la tradition» (Simard 2001 : 37) ?
En dehors des dérives évaluatives de certains discours didactiques (voir Daunay 2007c), la question de la soumission aux pratiques est plus sérieuse et, partant, plus complexe, puisque l’on sait le rôle que les pratiques d’enseignement et de formation ont pu jouer dans la construction des didactiques. Comme le dit Bernard Schneuwly, «le champ scientifique “didactique” nait [d’un] large fondement de la didactique pratique et normative» (Schneuwly 2014 : 18). De fait, on peut dire que toute didactique a suivi un processus de «disciplinarisation à dominante secondaire», qui caractérise plus généralement le champ des sciences de l’éducation (Hofstetter & Schneuwly 1998/2001). Il n’est pas inutile de préciser ici que si tou·te·s les didacticien·ne·s ne relèvent pas du champ institutionnel des sciences de l’éducation, la didactique est, par définition, une science de l’éducation et a partie liée, de ce fait, avec ce champ institutionnel.
La didactique de la littérature, comme la didactique du français, dans son processus de disciplinarisation, a dû «transformer des problématiques pratiques et théorico-pratiques en questionnement scientifique», c’est-à-dire «définir des problématiques, sous forme d’un appareil conceptuel cohérent, sous une forme qui permet de fournir des réponses à travers des méthodes de recherche systématiques et explicites» (Schneuwly 2014 : 18).
La didactique de la littérature, comme les autres didactiques, a encore à s’interroger sur les formes d’hybridation bien spécifiques qu’engendre le frottement d’une théorie et d’une pratique : car sauf à se contenter d’un applicationnisme qui montre vite ses limites théoriques et cantonne le discours qui le réalise dans une vision idéaliste et peu productive d’un point de vue scientifique, la relation entre théorie et pratique ne peut pas ne pas se penser au sein même de la discipline, au prix d’une mise en doute des évidences partagées. Il ne s’agit pas, pour emprunter ses mots à Marc Bru, qui parle plus généralement des sciences de l’éducation, d’«abandonner toute mise en relation des recherches et des pratiques», mais de «modéliser ces relations sans les réduire à une visée applicationniste ou à une version idéalisée, étrangères à ce que sont les pratiques en situation» (Bru 1998 : 54). Une telle modélisation, c’est-à-dire la pensée théorique de ces relations entre théorie et pratique, ne semble pas avoir fait l’objet d’une réflexion systématique au sein de la didactique de la littérature et c’est sans doute ce qui rend encore plus légitime la thématique des dix-neuvièmes rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature.
J’aimerais à cet égard, pour finir, reprendre les mots de Jean-Paul Bronckart (2001) qui montrait qu’en sciences humaines et sociales, l’opposition entre recherche fondamentale et intervention pratique n’est pas un donné de départ mais l’effet d’une élaboration progressive, qui a abouti au dualisme actuel:
Entre les sciences humaines fondamentales et le domaine de l’éducation, se sont établis les rapports hiérarchiques et descendants de l’applicationnisme : les données scientifiques étaient injectées dans le champ pratique, la plupart du temps sans réelle prise en compte des multiples paramètres qui régissent ce dernier. (Bronckart 2001 : 136)
Et l’on voit bien les effets possibles pour la didactique : du fait de l’orientation praxéologique qui la définit en partie (représentée dans les derniers schémas de la formalisation présentée plus haut), l’applicationnisme est un risque possible.
Bronckart fait la critique de cette conception applicationniste pour en suggérer une autre:
Une telle position s’adosse en réalité à l’idéologie selon laquelle l’éducation-formation constituerait une démarche non problématique de transmission de savoirs non discutables, et c’est bien cette idéologie qui oriente la logique applicationniste préconisée par Piaget aussi bien que par Skinner. Mais si l’on considère que les savoirs, même savants, sont toujours discutables, que les processus de transmission sont complexes et problématiques, et que les enjeux sont en permanence à repenser à la lumière des évolutions réelles des sociétés, alors il y a place pour une science véritable, dont l’objet est constitué par les processus de médiation formative, tels qu’ils sont conçus, gérés et mis en place par les sociétés humaines. (Bronckart 2001 : 138)
Dans sa disciplinarisation, la didactique de la littérature gagnerait sans doute à continuer à penser cette question des relations entre recherches et pratiques, en s’interdisant l’applicationnisme que pourfend si bien Bronckart, sans pour autant se soumettre aux pratiques, autre risque possible que les réflexions de ce dernier minimisent peut-être.
Conclusion
Ce travail de disciplinarisation s’accompagnera nécessairement – et c’est ici le sens de mon propos – d’une identification des risques d’un applicationnisme à trois faces que représente la soumission à des instances extérieures (la théorie littéraire, l’Institution, la pratique). C’est à ce prix que la didactique de la littérature pourra se forger une véritable identité qui la fasse reconnaitre comme un champ théorique à part entière.
Mais si l’on peut trouver un avantage à établir des frontières, c’est à la condition de se rappeler qu’une frontière marque autant la séparation que la continuité : si une discipline gagne à être autonome, c’est pour n’être pas diluée dans un espace qu’elle ne peut pas penser, mais c’est aussi pour pouvoir mieux dialoguer avec d’autres dans cet espace – ce que les schémas initiaux voulaient proposer. Autrement dit, on peut supposer que le processus d’autonomisation de la didactique de la littérature, s’il est mené à son terme, pourra l’amener à se penser comme un «espace dynamique», pour emprunter leur expression à Florey, Ronveaux et Cordonier (2015). Se penser comme «espace dynamique», c’est, loin de toute contrainte de dépendance, se penser dans le dialogue avec d’autres champs de recherche et de pratiques.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2015), Enseigner la littérature aujourd’hui : « disputes » françaises, Paris, Honoré Champion.
Brassart, Dominique Guy & Yves Reuter (1992), « Former des maîtres en français : éléments pour une didactique de la didactique du français », Études de linguistique appliquée, n° 87, p. 11-24.
Bronckart, Jean-Paul (2001), « S’entendre pour agir et agir pour s’entendre », Théories de l’action et éducation, J.-M.Baudouin & J. Friedrich (dir.), Bruxelles, De Boeck Université éd., p. 133-154.
Bru, Marc (1998), « Qu’y a-t-il à prouver, quand il s’agit d’éducation ? La validation scientifique des propos et discours sur les pratiques d’enseignement : après les illusions perdues », in Recherche et éducation. Vers une « nouvelle alliance ». La démarche de preuve en 10 questions, C. Hadji, J. Baillé (dir.), Paris-Bruxelles, De Boeck, p. 45-65.
Chabanne, Jean-Charles (2016), « Langue, littérature, art(s), langage(s) : Didactique de la littérature et didactiques des arts, un dialogue fécond à entretenir et à renouveler », in Didactiques du français et de la littérature, A. Petitjean (dir.), Metz, Université de Lorraine, p. 157-176.
Chevallard, Yves (2014), « Des didactiques des disciplines scolaires à la didactique comme science anthropologique. Sur un obstacle épistémologique, psychologique et institutionnel », Éducation & didactique, n°8 (1), p. 35-44.
Daunay, Bertrand (2007a), « État des recherches en didactique de la littérature », Revue française de pédagogie, n° 159, p. 139-189.
Daunay, Bertrand (2007b), Invention d’une écriture de recherche en didactique du français, Dossier pour l'habilitation à diriger des recherches, soutenue le 29 mai 2007 à l'université Lille 3 (https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01365868/document)
Daunay, Bertrand (2007c), « Comment la recherche didactique évalue les pratiques d’enseignement de la littérature », in Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ? Sens, utilité, évaluation, J.-L. Dufays (dir.), Louvain, Presses Universitaires de Louvain, p. 35-43.
Daunay, Bertrand (2015), « La didactique de la littérature, un patrimoine théorique en construction », in Les patrimoines littéraires à l’école. Tensions et débats actuels, M.-F. Bishop & A. Belhadjin (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 403-407.
Daunay, Bertrand (2016), « Didactix ? Manières, termes et enjeux d’un débat didactique », in Enjeux et débats en didactique des mathématiques, Y. Matheron et al. (dir.), Grenoble, La Pensée Sauvage, p. 311-320.
Daunay, Bertrand (2017), « Didactique du français et didactiques des disciplines : une interdisciplinarité contrainte », in Pluridisciplinarité en sciences humaines. Hommage à Leila Messaoudi, A. Reguigui, H. El Amrani, H. Bendahmane, Ontario, Série monographique en sciences humaines, p. 189-204.
DFLM (1998), « Texte d’orientation de l’association », La lettre de la DFLM, n° 23, p. 28-31.
Dufays, Jean-Louis (2016), « La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique », Tréma, n° 45, p. 9-17.
Éducation & didactique (2014), n°8, (1), Didactiques et/ou didactique ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Florey, Sonya, Noël Cordonier, Christophe Ronveaux & Soumya El Harmassi (dir.) (2015), Enseigner la littérature au début du XXIe siècle. Enjeux, pratiques, formation, Bruxelles, Peter Lang.
Gabathuler, Chloé, Bruno Védrines & Yann Vuillet (2019), « Didactique, réputation littéraire et connivences », Recherches, n° 70, p. 137-162.
Habermas, Jürgen (2008), « Sur le rapport de la théorie et de la pratique », Les Études philosophiques, n° 87, p. 487 à 498.
Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, Presses universitaires de France.
Hofstetter, Rita & Schneuwly Bernard (1998/2001), « Sciences de l’éducation entre champs disciplinaires et champs professionnels », in Le pari des sciences de l’éducation, R. Hofstetter & B. Schneuwly (dir.), De Boeck, Bruxelles, p. 7-25.
Huberman, Michael (1992), « De la recherche à la pratique : comment atteindre des retombées “fortes” ? », Revue Française de Pédagogie, n° 98, Paris, INRP, p. 69-82
Ligozat, Florence (2016), « Didactique comparée : quels enjeux pour la construction d’un champ de recherches en didactique ? Une étude de cas en classe de français », in Enjeux et débats en didactique des mathématiques, Y. Matheron et al. (dir.), Grenoble, La Pensée Sauvage, p. 277-310.
Louichon, Brigitte (2011), « La lecture littéraire est-elle un concept didactique ? » in Les concepts et les méthodes en didactique du français, B. Daunay, Y. Reuter & B. Schneuwly (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 195-216.
Matheron, Yves et al. (dir.)(2016), Enjeux et débats en didactique des mathématiques, Grenoble, La Pensée Sauvage.
Petitjean, André (1990), « Pour une didactique de la littérature », in Perspectives didactiques en français, D. G. Brassart & A., Petitjean, Metz, Université de Metz, p. 101- 127.
Petitjean, André (1998), « Pratiques a 25 ans », Pratiques, n° 97‑98, p. 3‑5.
Pastiaux-Thiriat, Georgette & Jean-Marie Berbain (1990), « Pour une interactivité entre la recherche et les enseignants », Perspectives documentaires en éducation, n° 21, p. 107-123.
Petitjean, André (1998), « Pratiques a 25 ans », Pratiques, n° 97‑98, p. 3‑5.
Romian, Hélène (2014), « Un “plan de rénovation” de l’enseignement du Français à l’école élémentaire en 1970 », La Lettre de l’AIRDF, n° 56, p. 33-44.
Ronveaux, Christophe (dir.) (2016), Enseigner les littératures dans le souci de la langue, Bruxelles, Peter Lang.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (2019), Lire des textes réputés littéraires au fil des degrés scolaires : disciplination et sédimentation. Une enquête dans les classes de Suisse romande, Bruxelles : Peter Lang.
Schneuwly, Bernard (1998), « Tout n’est pas métalangagier dans l’enseignement du français », in Activités métalangagières et enseignement du français, J. Dolz, J.-C. Meyer (dir.), Berne, Peter Lang, p. 267-272.
Schneuwly, Bernard (2014), « Didactique : construction d’un champ disciplinaire », Éducation & didactique, n°8 (1), p. 13-22.
Vuillet, Yann (2017), À la recherche didactique de concepts pour penser, dire et agir le littéraire, Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, sous la direction de J. Dolz-Mestre, soutenue à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
Pour citer l'article
Bertrand Daunay, "Entre dialogue et contraintes : interroger les liens entre divers champs de réalisation de la didactique", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/entre-dialogue-et-contraintes-interroger-les-liens-entre-divers-champs-de-realisation-de-la-didactique
Voir également :
L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)
Le plan d’études romand actuel (2010){{https://www.plandetudes.ch/francais}}, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline « français », au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale{{La voie gymnasiale aboutit au certificat de maturité (l’équivalent pour la France du baccalauréat général).}} s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.
L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)
1. Introduction
Le plan d’études romand actuel (2010)1, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline «français», au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale2 s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.
Mais qu’entend-on par «littérature» ici? L’étude de Caron (1992) nous rappelle que le mot littérature dérive du latin litteratura qui désigne au départ le fait de savoir lire et écrire et, par extension métonymique, la connaissance des grands textes qui permet de bien lire et de bien écrire. Avec les lexicographes du XVIIe siècle, le terme désigne avant tout une compétence. Ainsi, dans le dictionnaire de l’Académie de 1694, on trouve l’expression avoir de la littérature, le terme littérature renvoyant ici aussi bien à des textes scientifiques qu'artistiques. Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle que la littérature va se restreindre progressivement aux ouvrages à visée esthétique, devenant un synonyme de Belles Lettres, avant de s’en démarquer définitivement:
Belles Lettres affirmait une préoccupation prédominante du bien-dire dans l’étude des objets de langage. La multiplication des occurrences de littérature, non marqué à cet égard, ne traduirait-elle pas un recul de cette «utilisation» du texte? Autrement dit, n’assiste-t-on pas au passage d’un commentaire voué à l’acquisition d’un art langagier vers un discours plus «désintéressé», moins «instrumental» que savant, spéculatif, érudit, voire scientifique avant la lettre? (Caron 1992, : 189)
Le passage des Belles Lettres à la littérature se répercute dans le champ scolaire à la fin du XIXe siècle (Houdart-Mérot 1998). Ce processus va de pair avec le déclin des humanités classiques et la disparition du cours de rhétorique, supplanté par une discipline nouvelle, le «français». Savatovsky (1999) rappelle en effet qu’en France le «français» tel que nous le concevons aujourd’hui se met en place à cette période autour de trois principes:
- dans les collèges et les lycées, l’inversion de subordination entre les langues anciennes (grec et latin) et le français, ce dernier n’étant plus un auxiliaire des langues classiques mais une langue étudiée pour elle-même3;
- à l’école primaire, l’enrichissement progressif de la «formule des apprentissages fondamentaux» (Savatovsky 1999 : 37) –lire et écrire– par l’introduction de nouveaux savoirs liés à la langue nationale: projet scolaire d’acculturation et projet politique de francisation, en lieu et place des patois;
- dans les deux ordres d’enseignement, la mise en place de nouveaux exercices, «véritables éléments fédérateurs de la discipline en voie de constitution, et qui permettent d’allier à nouveaux frais la connaissance de la langue et celle de la littérature» (Savatovsky 1999 : 37).
Qu’en est-il en Suisse romande? Quand la littérature française entre-t-elle dans la sphère scolaire et sous l’influence de quels facteurs? Que recouvre alors cette notion et que vient-elle éventuellement remplacer? Par quels exercices est-elle abordée en classe? Et quels acteurs de la sphère scolaire jouent un rôle dans ce processus?
2. Précisions méthodologiques
Pour traiter ces questions, cette recherche prend appui sur la démarche historique et mobilise donc les outils de l’historien: recueil de sources, constitution de corpus et recours à la périodisation pour saisir le développement de la discipline observée. Ainsi, cette étude, tout en se centrant sur un empan temporel circonscrit –du milieu du XIXe au premier tiers du XXe siècle– s’appuie sur un vaste corpus archivistique (plans d’études, programmes, manuels scolaires, revues professionnelles) recueilli dans trois cantons: Genève (GE), Vaud (VD) et Fribourg (FR).
L’analyse de ces sources se fait ensuite sous deux angles complémentaires: d’une part, la place et les finalités assignées par les différents acteurs du monde politique et scolaire à la littérature dans l’enseignement du «français» au primaire et au secondaire; d’autre part, le choix des corpus, ainsi que celui des exercices et des approches privilégiées pour aborder ce corpus. Pour ce faire, deux concepts didactiques sont mobilisés. Il s’agit d’abord de la disciplinarisation, qui désigne le processus d’organisation progressive des savoirs en disciplines scolaires en lien avec la généralisation de la forme scolaire moderne qui s’opère tout au long du XIXe siècle (Hofstetter & Schneuwly 1998/2001)4. Il s’agit ensuite de la sédimentation des pratiques, selon laquelle l’enseignement est toujours le produit de pratiques provenant de différentes strates historiques (Schneuwly & Dolz 2009 ; Ronveaux & Schneuwly 2018).
Qui plus est, cette recherche prend en compte les deux ordres d’enseignement, primaire et secondaire. Elle se centre cependant pour le primaire sur les degrés intermédiaires et supérieurs (élèves de 9 à 15 ans environ), et pour le secondaire, sur le collège (élèves de 10 à 15 ans environ) et le gymnase (élèves de 16 à 18 ans environ)5, afin de mieux saisir quand la littérature française entre dans les classes et ce qu’elle vient éventuellement remplacer6.
Enfin, cette étude recourt à un jeu d’échelles. Tout en se situant au niveau de la Suisse romande, elle met en lumière certaines spécificités cantonales7, en lien avec deux facteurs : canton catholique (FR) versus cantons protestants (VD et GE) ; canton ville (GE) versus cantons ruraux (VD, FR). De même, des comparaisons ponctuelles avec la France permettent de mettre en exergue les spécificités de la Suisse romande en ce qui concerne l’avènement de la littérature dans la sphère scolaire au cours de cette période, mais aussi les circulations d’idées entre les deux contrées francophones.
Dans le texte qui suit, nous retraçons le processus d’entrée de la littérature au primaire et au secondaire en nous focalisant successivement sur trois périodes significatives. Nous nous centrons dans un premier temps sur les années 1850-1870, qui se caractérisent par le cloisonnement des ordres primaire et secondaire, chacun poursuivant des finalités très différentes, avec toutefois une ouverture à de nouveaux exercices et objets d’enseignement. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1870 aux années 1910, marquée par l’entrée du texte littéraire dans les corpus des deux ordres d’enseignement et l’émergence de l’explication de texte. Nous terminons avec une focale sur les années 1910-1930, période à laquelle les corpus et les exercices relatifs à la littérature se stabilisent. Enfin, notre propos est illustré par la présentation d’un ouvrage scolaire représentatif de chacune des périodes susmentionnées.
3. Les prémices d’un enseignement de la littérature (1850-1870)
Au début du XIXe siècle, le primaire et le secondaire ne sont pas destinés aux mêmes publics d’élèves. La plupart des écoliers –filles et garçons– effectuent leur scolarité à l’école primaire, centrée sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le collège accueille, quant à lui, les garçons issus des familles aisées. Son programme, fidèle à l’idéal humaniste, est centré sur l’apprentissage du grec et du latin. Après 15 ans, les jeunes gens ont la possibilité de continuer leurs études à l’Académie.
Ce qui tient alors lieu de littérature française dans les collèges, ce sont, comme en France8, les Belles Lettres, soit un «corpus d’auteurs français, essentiellement des dramaturges, des historiens et des prédicateurs du XVIIe» (Gabathuler & Védrines 2018 : 44). L’enseignement prodigué au primaire vise l’acquisition des rudiments et ne laisse pas de place à la littérature.
Or, dès les années 1850, cette situation change sous la pression de facteurs à la fois politiques et sociaux (Hofstetter & Monnier 2015). En effet, l’instruction publique se met en place dès les années 1830, par le biais d’une série de règlements et de lois, au sein de chaque canton. Ce processus est renforcé par la Constitution fédérale de 1848 qui confère officiellement la responsabilité de l’instruction publique aux autorités cantonales. Dans ce contexte, la prise de pouvoir des Radicaux à cette même période, aussi bien dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, est déterminante. Ceux-ci ont en effet la volonté de développer l’instruction publique et de la faire progresser, pour l’ajuster aux nouveaux besoins d’une société elle-même en évolution. Ainsi, la construction des systèmes scolaires en Suisse romande va se traduire, dès les années 1850, par une remise en cause du paradigme des humanités classiques, non sans impact sur la nature et la fonction des textes littéraires.
3.1. Une esquisse d’ouverture vers la compréhension des textes au primaire
Au milieu du XIXe siècle, l’enseignement primaire est encore très orienté vers la maîtrise des rudiments9. Ainsi, l’enseignement de la lecture reste principalement focalisé sur l’apprentissage du mécanisme pour parvenir à une lecture courante. En guise d’illustration, les analyses de Barras (1988) font état, pour le canton de Fribourg, de pratiques de lecture centrées sur les aspects mécaniques de l’apprentissage de la lecture, «l’intelligence» du texte, pour reprendre le terme usité à l’époque, n’important guère. Les recommandations exposées par A. Biolley dans la revue pédagogique l’Educateur en 1866 vont également dans ce sens : la lecture courante doit essentiellement porter sur la prononciation, l’observation de la ponctuation et les liaisons. Cependant, la série d’articles proposée par Biolley (1866) ne se limite pas à la lecture courante, ce dernier y ajoutant parmi les «espèces principales de lecture» (Biolley 1866 : 300), la lecture intelligente et la lecture expressive. Ces formes de lecture portent sur la compréhension du texte par l’élève qui se matérialise dans les programmes (ou équivalents10) par la prescription d’«explications» et de «comptes rendus».
Les prescriptions contenues dans les programmes sont très succinctes mais laissent à supposer que les explications sont essentiellement données par le maître. A titre d’exemple, dans le plan d’études vaudois paru en 1868, la leçon de lecture devient raisonnée et comporte des exercices d’intuition qui sont avant tout des questions précises posées par l’enseignant11 qui permettent aux élèves de mieux comprendre les textes.
Concernant les supports, les indications sont également vagues, comme en témoignent les prescriptions du programme genevois de 1852-1853 : des «livres élémentaires» pour les élèves de deuxième et troisième année ; des «livres moins faciles» pour les élèves de quatrième année ; enfin, des «livres plus difficiles» pour les élèves de cinquième année.
Néanmoins, l’analyse du corpus d’ouvrages pour l’enseignement de la lecture en usage à cette époque12 met en évidence que l’apprentissage du mécanisme s’effectue sur des tableaux de lecture, les élèves pratiquant ensuite la lecture courante sur des romans adaptés à la jeunesse dans les cantons protestants (Tinembart 2015), ou encore sur des textes religieux (Bible et catéchismes) dans le canton de Fribourg. C’est une visée instructive qui prédomine alors, la lecture courante se pratiquant sur des textes au caractère encyclopédique, moralisant ou éducatif, permettant à l’élève d’acquérir des connaissances utiles à son éducation.
Les différentes autorités cantonales sont à la recherche active d’ouvrages répondant à cette visée. Le canton de Vaud organise tout au long du XIXe siècle une série de concours pour doter les maîtres d’ouvrages scolaires de lecture destinés à l’enseignement. Les programmes de concours permettent aux auteurs d’alors de connaître les attentes des autorités et aux chercheurs d’aujourd’hui de mieux saisir la conception de la lecture et de la littérature des divers acteurs de l’époque.
Ainsi, dans l’école primaire vaudoise, la première trace laissée par les autorités scolaires relative à une préoccupation liée à la littérature remonte au Programme des concours pour la publication de livres élémentaires(1840)13. En effet, il s’agit pour les futurs auteurs de «conduire les jeunes élèves à lire couramment un livre quelconque, en leur offrant des exercices gradués de prononciation, et des lectures progressives, en accord avec les premiers développements de l'intelligence des enfants» (p. 44), mais aussi de leur apporter «toutes les choses bonnes, utiles, propres à concourir au but de l’éducation populaire» (p. 50). De plus, «on ne se fera pas un point d'honneur de n'offrir que des morceaux neufs et originaux: les grands écrivains présentent des pages aussi bien appropriées aux besoins des élèves d'une école primaire qu'elles sont admirées par l'homme du goût le plus cultivé» (p. 53). Enfin, les futurs auteurs sont également encouragés à s’inspirer de la Chrestomathie (1829, 1e éd.) d’Alexandre Vinet14, car son ouvrage offre des «modèles pour la composition» aux écoles primaires. Cette recommandation dénote une influence de l’ordre secondaire sur le primaire, la Chrestomathie de Vinet étant, comme nous allons le voir, un ouvrage conçu pour les élèves du secondaire.
La seconde trace remonte au 25 janvier 1859. En effet, suite à l’expertise d’un ouvrage de lecture, le rapport du Département donne l’autorisation d’éditer l’opuscule bien qu’«on ne saurait lui trouver un mérite réel, ni au point de vue philosophique ou scientifique, ni au point de vue littéraire»15. Certes, il était conseillé aux potentiels auteurs d’ouvrages scolaires de s’inspirer d’«exemples puisés dans les meilleurs écrivains»16, mais c’est encore avant tout le caractère encyclopédique et progressif des textes contenus dans les ouvrages de lecture qui régit le choix des autorités.
Il s’avère que les représentations liées à ce que devrait contenir un ouvrage de lecture destiné à l’école primaire changent dans la décennie suivante. Une volonté institutionnelle de faire entrer la littérature dans les ouvrages scolaires primaires s’exprime alors. En 1865, les cantons romands organisent une seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers, choisis notamment dans la littérature, au degré supérieur.
3.2. Entre Belles Lettres et littérature
Qu’en est-il au collège et au gymnase? L’analyse des programmes de ces deux institutions montre que les années 1850 se situent dans un entre-deux, où l’ancien côtoie le nouveau.
Jusqu’alors centré sur les humanités classiques, le curriculum du collège s’ouvre à des disciplines nouvelles, dont le français, qui s’autonomise par rapport aux langues anciennes et comprend une véritable progression. Ainsi, à Genève (programme de 1859), le jeune homme commence dans les petits degrés par la récitation de morceaux choisis «dans le Manuel»17, pour finir par des exercices de composition en lien avec des «exercices d’analyse grammaticale et littéraire de morceaux en prose et en vers». Ces derniers sont tirés des tomes 1 et 2 de la Chrestomathie de Vinet. De même, dans le canton de Vaud, le programme de «langue française» de 1853 commence dans les premiers degrés par la lecture d’ouvrages d’Histoire adaptés aux enfants18, pour aller vers la «lecture analytique» et la «lecture cursive» de morceaux de la Chrestomathie de Vinet (tome 1, puis 2, puis 3), avec en dernière année l’introduction du Cinna de Corneille. Il n’en demeure pas moins que la lecture de ces morceaux reste au service de la composition qui constitue la finalité de cet enseignement, en vue de l’entrée au gymnase sur lequel souffle cependant également un vent nouveau.
Au gymnase, le cours de rhétorique à Genève (programme de 1859) s’intitule «rhétorique et littérature française». Le programme, sur deux ans, est le suivant : rhétorique et histoire abrégée des principaux genres de prose et de poésie, exercices de composition française, récitation de morceaux choisis tirés du tome 2 de la Chrestomathie de Vinet et récitation de l’Art poétique de Boileau. De même, à Fribourg, les programmes du gymnase de l’Ecole cantonale19 de 1849 et 1857 prescrivent pour le cours de «langue française» le recours aux deux premiers volumes de la Chrestomathie de Vinet20, auxquels s’ajoutent quelques auteurs du XVIIe (Boileau, La Fontaine, Fénélon), utilisés comme supports pour l’«analyse»21, et pour les exercices constitutifs du cours de rhétorique –«étude de modèles» ou encore «essais oratoires».
Ainsi, bien que l’on reste dans un enseignement très imprégné par la rhétorique, l’omniprésence de la Chrestomathie de Vinet dans les programmes des collèges et gymnases des trois cantons inscrit ceux-ci sans conteste dans une ère nouvelle. Dans l’Avant-propos du tome 1 de sa Chrestomathie (1829a), Vinet annonce la singularité de son projet qu’il met en regard des Leçons de Littérature et de morale de Noël et Delaplace (1804-1805):
Aussi les morceaux qui composent le recueil de MM. Noël et Delaplace paraissent-ils avoir été destinés surtout à des exercices de mémoire et de déclamation ; et ils y conviennent parfaitement. [...] Nous voudrions une chrestomathie qui renfermât sinon des ouvrages, du moins des morceaux assez considérables pour qu’on y pût voir déployés une grande partie des procédés nécessaires pour la confection totale de l’ouvrage auquel ces morceaux appartiennent (Vinet 1829a : 8)
L’ouvrage de Noël et Delaplace est un manuel de rhétorique (Douay-Soublin 1997). La littérature, bien que présente dans le titre, est encore un synonyme de «Belles Lettres», dans la mesure où, comme le rappelle Chervel «elle n’est pas en prise sur des ‘œuvres’ ; elle n’a besoin que de morceaux choisis à titre d’illustrations [qui] n’ont pas vocation à être ‘expliqués’ au sens moderne du terme, mais à être appris par cœur et imités» (Chervel 2006 : 488-489).
Or, le projet de Vinet est tout autre, même si sa visée reste rhétorique, car au service d’une composition centrée sur l’elocutio qui «seule a du prix à nos yeux» (Vinet 1829a : 7). Son point de départ est en effet l’enseignement de la langue française et de la littérature, non pas en contexte francophone, mais en contexte germanophone. Il s’agit d’abord pour Vinet, qui enseigne à Bâle, de proposer à ses élèves d’apprendre le français en lisant et en traduisant des extraits issus des grands textes de la littérature française. Le tome premier, La Littérature de l’Enfance, est d’ailleurs accompagné d’un lexique français-allemand fait par un ami de l’auteur. Dans ce cadre «expliquer» signifie donc «traduire».
Comme le rappelle Rambert (1930) cependant, Vinet a aussi songé aux écoles françaises en élaborant son anthologie. Plaçant sa réflexion sur l’enseignement de la littérature «à la croisée d’une visée morale de l’éducation, d’une ambition progressiste de l’école et d’une attention patiente aux textes» (David 2017 : 12), Vinet a l’ambition de faire lire en classe les auteurs classiques du XVIIe, mais aussi certains auteurs contemporains «avec les soins attentifs et la précieuse lenteur qu’on apporte à celle des classiques anciens» (Rambert 1930 : 174). Vinet s’en explique lui-même dans la préface de la première édition du tome 2 intitulé Lectures pour l’adolescence:
On a lieu de s’étonner que la méthode suivie dans nos écoles pour la lecture des auteurs latins et grecs ne soit appliquée, avec les modifications convenables, à la lecture des classiques de la langue maternelle. [...] Les circonstances qui m’ont porté à faire usage de cette méthode dans l’enseignement de la littérature française à de jeunes étrangers m’ont fourni l’occasion de me convaincre qu’elle est applicable, dans ce qu’elle a d’essentiel, au cas de jeunes gens lisant sous la direction d’un maître les chefs-d’œuvre de leur propre langue. (Vinet 1829b : 1-2)
Dans cette première édition, il ne développe cependant pas sa propre méthode, mais invite les enseignants à recourir avec leurs élèves à la méthode de Rollin22.
La Chrestomathie de Vinet comprendra 30 rééditions successives jusqu’en 1930. Dès la deuxième édition de 1833, elle devient rapidement un «best-seller». Intéressons-nous à présent à ses contenus.
3.3. La Chrestomathie de Vinet
Vinet, passionné d’œuvres littéraires, a à cœur de rédiger une Chrestomathie dont les extraits sont tirés «des chefs-d’œuvre classiques» (Vinet 1829a : IX). Ceux-ci doivent permettre «d’apprendre à les imiter sous le triple rapport de la langue, du style et de la composition générale, en un mot sous le rapport de l’art d’écrire, tel que Buffon le concevait» (Vinet 1829a : IX). La première édition du Tome 1 de 1829 destinée aux collégiens de 12-14 ans se compose de neuf parties ayant pour titres : narrations fictives (6 extraits), biographies (4 extraits), histoire (7 extraits), voyages (3 extraits), descriptions (2 extraits), genre didactique (3 extraits), dialogues (8 extraits), lettres (4 extraits) et poésies réparties en fables (25 fables), narrations (6 extraits) et scènes (2 extraits). La plupart des auteurs23 sont présentés sous la forme d’une courte biographie.
Si Vinet sélectionne des morceaux, c’est parce qu’un ouvrage complet «est hors de proportion avec la capacité de l’enfant ou le degré de ses connaissances philosophiques» (Vinet 1829a : V). Cela évite aussi à l’instituteur de devoir lui-même choisir les extraits. Ceux qu’il propose sont courts (en moyenne dix pages pour les textes narratifs et descriptifs) car «dans la jeunesse, ce sont les détails qui nous frappent et nous séduisent ; des figures neuves, des images éblouissantes, des expressions originales nous paraissent l’essentiel de l’art d’écrire» (Vinet 1829a : VII). Le grand choix de lectures proposé peut être «coordonné à l’enseignement grammatical» (Vinet 1829a : VIII) et permet de «retrouver dans un morceau d’histoire la plupart des éléments du talent de l’historien, dans un morceau d’éloquence les principales conditions qui constituent l’orateur, et ainsi des autres genres» (Vinet 1829a : VIII). Enfin, les morceaux sont organisés afin que «la marche du facile au difficile, du simple au composé, y fût suivie autant que possible, soit à l’égard du style, soit à l’égard des idées» (Vinet 1829a : IX) ; pour ce faire, une table des matières particulière permet à l’enseignant de concevoir la progression entre les textes. Enfin, Vinet a porté son choix sur les écrivains «qui font autorité en fait de langage et de style» (Vinet 1829a : IX) et les «talents contemporains» dans le but de «présenter la langue française avec toutes les acquisitions qu’elle a faites jusqu’à nos jours» (Vinet 1829a : X).
Vinet ajoute à la seconde édition (1833) 26 nouveaux extraits dont neuf appartiennent à une nouvelle sous-partie intitulée «poésie lyrique». Ces ajouts concernent tous les thèmes, mais essentiellement les lettres et les fables. Sur les 114 extraits que contient la deuxième édition de la Chrestomathie, Tome 1, les auteurs sont essentiellement français (seulement quatre Suisses figurent parmi eux). Un tiers des textes sont de Fénélon, La Fontaine, Florian et Madame de Sévigné. Nous trouvons 48 extraits d’auteurs du XVIIe siècle, 33 extraits du XVIIIe siècle et 28 extraits émanent de contemporains de Vinet encore vivants, dont 15 ajoutés dans la deuxième édition. Cet ajout démontre que l’auteur s’informe des nouveautés littéraires de son époque et souhaite que son ouvrage reste d’actualité.
4. Littérature et disciplinarisation du «français» (1870-1910)
La période couvrant la fin du XIXe et le début du XXe siècle se caractérise par l’avènement des «Etats enseignants» (Hofstetter 2012) qui, suite à la Constitution fédérale de 1874, vont entériner l’obligation scolaire jusqu’à 15 ans. Cette obligation entraîne alors la création d’institutions et de filières au niveau secondaire, d’enseignement général, mais aussi professionnel. Il s’agit en effet d’une part de répondre aux besoins de l’industrie qui se développe en Suisse et qui requiert des ouvriers qualifiés, d’autre part de préparer une élite à l’entrée dans les universités et les écoles polytechniques qui sont créées à cette période.
Chaque canton institue de fait un système scolaire, avec un ordre secondaire, constitué d’un degré inférieur et d’un degré supérieur, et désormais articulé à l’ordre primaire. Cette première phase de démocratisation de l’enseignement (Hofstetter & Monnier 2015), qui se traduit par l’ouverture du secondaire à tous les publics d’élèves, entraîne de fait la mise au rebut officielle des humanités classiques, au profit de disciplines nouvelles, dont le «français». Cette dernière s’étend rapidement sur l’ensemble du système, entraînant progressivement la montée vers le secondaire de certains manuels de lecture conçus pour le primaire supérieur, ces derniers étant élaborés sur le modèle de la Chrestomathie de Vinet.
4.1. Vers l’explication de texte (littéraire) au primaire
L’enseignement de la lecture au primaire prend une autre dimension à partir des années 1870. Les trois dernières décennies du XIXe siècle voient en effet s’amplifier le processus de disciplinarisation du «français» amorcé dans les années 1850, processus qui se caractérise notamment par une articulation de la lecture et des éléments relatifs à la langue (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire) dans un dispositif dont l’aboutissement est la composition. Dans ce processus, en partie influencé par les proposition du Père Girard, pédagogue fribourgeois, le livre de lecture devient progressivement central24, comme l’illustre ce propos tenu dans l’Educateur :
Le livre de lecture doit donc devenir désormais le point de départ, le centre de l’enseignement de la langue maternelle comme cet enseignement lui-même doit être le centre des études primaires. C’est à l’étude raisonnée du livre de lecture, que doit se rapporter le résumé grammatical ; c’est sur ce livre de lecture, que doit se régler aussi le cours de style et enfin le cours de composition. (Bourqui 1870 : 336)
Au niveau des prescriptions, on observe une diversification des formes de lecture : à la lecture courante est ainsi ajoutée la lecture expressive25 et le «compte rendu» évolue progressivement vers l’explication, processus qui s’achèvera avec l’avènement de la lecture expliquée dans les premières décennies du XXe siècle.
En continuité avec les prescriptions des années 1850-1860, le compte rendu s’inscrit tout d’abord dans le paradigme de la lecture instructive et morale. Ainsi, le règlement scolaire fribourgeois de 187626 préconise, pour le deuxième cours (élèves de 10-12 ans), d’effectuer le compte rendu «par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et propres à orner la mémoire de l’enfant de connaissances utiles et à diriger son éducation morale» (Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg, 1876). La visée morale de la lecture perdure ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle, comme en témoignent également les prescriptions vaudoises de 1899 : «Sujets en rapport avec les autres leçons. Analyse du contenu, énoncé des faits principaux, comparaison ; préceptes moraux et applications pratiques. Récitation de morceaux choisis» (Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1899, degré intermédiaire 2e année).
Cependant, tout en s’inscrivant dans la continuité des pratiques en place, le compte rendu s’oriente progressivement vers la compréhension du texte pour lui-même. On trouve ainsi dans le Programme prescrit pour les écoles primaires du canton de Fribourg de 1886 : «compte-rendu par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et de nature à obtenir l’expression claire et correcte des principales idées du texte» pour le premier cours du degré supérieur ; «compte-rendu libre et constituant le résumé oral et correct des idées renfermées dans le texte» pour le deuxième cours du même degré. Le compte rendu s’y effectue essentiellement oralement: d’abord à partir des interrogations du maître, puis librement. Bien que les prescriptions varient en fonction des cantons, une tendance commune semble se dégager : une partie de l’explication porte sur le vocabulaire et la grammaire, une autre partie est consacrée à la compréhension du texte (dégager l’idée générale, énoncer les faits principaux, rechercher le plan, etc.).
Enfin, les mentions relatives aux supports sont très succinctes dans les programmes : morceaux simples (pour les petits degrés), prose et poésie pour la récitation. Cette période voit cependant la parution de deux livres de lecture qui, comme nous allons le voir, annoncent l’entrée des textes littéraires au primaire.
4.2. Un ouvrage primaire et secondaire
En 1865, les cantons romands organisent une Seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers au degré supérieur, choisis notamment dans la littérature. Les premiers livres de lecture adoptés par la Suisse romande (Renz 1871 ; Dussaud & Gavard 1871) en sont de parfaits exemples.
Le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard27 (1871) est destiné à la fois aux degrés supérieurs de l’école primaire vaudoise et genevoise. Les courts morceaux choisis par les auteurs, tous deux enseignants, sont numérotés et regroupés par thématiques qui se répartissent en neuf parties28: histoire naturelle (120 extraits descriptifs dont une moitié est anonyme), descriptions et voyages (16 récits), histoire (15 morceaux), biographies (huit portraits), anecdotes, traits moraux, caractères (21 extraits), style épistolaire (10 extraits de lettres), dialogues en prose (trois extraits de pièces théâtrales), dialogue en vers (trois extraits) et poésie narrative et lyrique (31 extraits).
Force est de constater que les thèmes de science naturelle prennent une grande place dans cet ouvrage annonçant la «leçon de chose», tout en offrant cependant également une place importante à la littérature de Suisse romande (Schneuwly & Darme 2015 ; Gabathuler 2017). Il y a en effet 32 textes d’écrivains suisses essentiellement vaudois et genevois (Agassiz, Vuillemin, Monnard, Porchat ou Töpffer) contre 75 auteurs français. Parmi eux, nous retrouvons certains auteurs déjà présents dans la Chrestomathie de Vinet (1833)29 (Fénélon, Florian, La Fontaine, Molière, Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand ou Buffon). Fribourg renonce dans un premier temps à utiliser ce livre de lecture à l’école primaire, mais décide d’en éditer une adaptation en 1882. Celle-ci se divise alors en deux parties clairement identifiées, la partie scientifique et la partie littéraire, dont :
Les morceaux ne sont point choisis au hasard. Ils forment un petit cours de composition donnant des modèles de tous les genres de style, en même temps qu’une histoire littéraire, très succincte sans doute, mais bien suffisante pour les élèves auxquels ce livre est destiné. (Dussaud & Gavard adapté par Fribourg 1882 : 7)
Par l’observation de ces deux éditions, nous pouvons relever un processus de sédimentation : une grande part des auteurs choisis par Vinet (1833) sont repris par Dussaud et Gavard (1871); l’ouvrage propose ainsi une histoire de la littérature adaptée à l’âge des élèves, mais sur le modèle proposé dans le secondaire supérieur qui reste au service de l’enseignement de la composition selon le modèle rhétorique. Les textes sont numérotés, classés par catégories et organisés selon leur complexité.
4.3. Un corpus littéraire au service de nouvelles finalités
L’articulation progressive des degrés inférieurs et supérieurs du secondaire facilite la mise en place d’un «français» unifié sur l’ensemble du secondaire, qui va se caractériser avant tout par un corpus littéraire spécifique. En effet, contrairement à la période précédente où les enseignants s’appuient très largement sur la Chrestomathie de Vinet, le dernier tiers du XIXe siècle peut être considéré comme un moment clé dans l’élaboration de ce qu’on entend aujourd’hui par «littérature» en classe de français.
L’analyse des programmes du Collège cantonal de Vaud (1877, 1891) et des degrés inférieurs du Collège de Genève (1877, 1889) montre que, outre l’ouvrage de Dussaud et Gavard (1871) introduit dans les premiers degrés, la Chrestomathie de Vinet continue à être présente dans les derniers degrés30. Avec l’ouverture du secondaire à un nouveau public d’élèves, le nombre de classe augmente et l’utilisation d’un manuel qui a fait ses preuves permet de garantir une certaine harmonisation dans les pratiques.
Il n’en est cependant pas de même au secondaire supérieur, où les anthologies tendent à disparaître au profit d’une liste d’auteurs et de textes, élaborée par les enseignants eux-mêmes. Très succincts dans le dernier tiers du XIXe, et limités aux œuvres travaillées en classe de français, ces inventaires s’étoffent au tournant du XXe siècle pour devenir de véritables listes qui comprennent deux sections: les lectures à faire en classe, et –pratique nouvelle– un choix de lectures à domicile:
Les lectures faites à domicile et contrôlées en classe ne sont pas tout à fait une innovation. La plupart de nos établissements possèdent une bibliothèque où les élèves puisent abondamment. Ils continueront, espérons-le. Mais on veut qu’il y ait un plan de lecture graduée, commençant par des morceaux choisis et continuant par des fragments plus étendus des grands écrivains, par des pièces de théâtre, par des morceaux de poésie caractéristiques, de façon que l’enseignement de la littérature, venant à son heure, s’appuie sur des souvenirs précis, sur la connaissance de quelques textes. (Plan d’études pour les collèges et gymnases du canton de Vaud 1910 : 7-8)
Ce phénomène est particulièrement visible dans le programme du Collège de Genève de 1900 (cf. Annexe 1). Le corpus des lectures en classe, tout en conférant une large place aux auteurs du XVIIe siècle –Corneille, Racine, Molière, mais aussi Boileau, Fénélon et Bossuet– est organisé désormais selon une progression chronologique, qui va de la Chanson de Roland aux auteurs du XIXe (Chateaubriand, Musset, Gautier). Ce corpus sert avant tout de support au cours d’histoire de la littérature qui figure désormais à l’épreuve orale de maturité, laquelle comporte trois parties : grammaire française, histoire de la langue française et histoire de la littérature française31.
Le choix des textes proposés en lecture à domicile fait, quant à lui, état d’une sédimentation des pratiques. Ce corpus garde en effet des traces des Belles Lettres, avec une large place donnée aux textes historiques et rhétoriques du XVIIe siècle (Dialogues sur l’éloquence de Fénélon). Pourtant, au sein de cette continuité, le corpus comprend également une très large sélection de textes d’auteurs du XIXe, et offre une place de choix à la nouvelle, avec notamment Les Lettres de mon Moulin et Contes du lundi d’Alphonse Daudet, et au roman, avec par exemple François le Champi et La Mare au Diable de George Sand. Par ailleurs, les auteurs suisses romands (Eugène Rambert), voire genevois (Victor Cherbuliez, John Petit-Senn, Marc Monnier, Rodolphe Töpffer), sont largement représentés, dans la ligne directe du corpus proposé dans le Dussaud et Gavard (1871). On trouve ainsi des poètes, mais aussi des scientifiques (Horace Bénédict de Saussure) et des philosophes (Charles Secrétan).
Autrement dit, on sort avec ce double corpus du paradigme rhétorique où le texte littéraire est là pour être appris par cœur et imité, même si ce dernier perdure à titre résiduel. La lecture de ces textes, en classe ou à domicile, obéit désormais à de nouvelles finalités : l’acquisition d’une culture littéraire large, qui n’est cependant pas détachée de la construction d’une identité helvétique.
En 1911, Henri Mercier32 n’hésite pas à placer la Suisse romande en avance sur la France dans l’élaboration d’un corpus littéraire spécifique au «français» : «dans notre pays, nous n’avons pas certes attendu jusqu’en 1880 pour autoriser les Provinciales, pour donner un laisser-passer à Victor Hugo» (Mercier 1911 : 195). Il n’en demeure pas moins que l’ouverture du corpus aux auteurs modernes ne fait pas l’unanimité au sein du corps enseignant, comme le met en évidence cet article de Charles Favez33, publié la même année dans la Gazette de Lausanne, et qui porte le débat sur la place publique :
Dans l’étude faite au Collège et au Gymnase des grands écrivains français, M. Sensine34, comme M. Bouvier35, donne la préférence à ceux du XIXe siècle, parce, dit-il, que les grands maîtres du siècle de Louis XIV, «tout remarquables qu’ils sont, ont le défaut, au point de vue pédagogique, d’exprimer une autre âme que la nôtre et de parler une langue que nous n’employons plus, tandis que ceux du XIXe expriment notre vie, notre âme, et emploient vraiment notre idiome moderne». Je demande au distingué professeur la permission de discuter ici cette idée. […] A notre époque […] quoi de plus actuel que le caractère de Phèdre ou celui d’Oreste? […] Ce n’est pas tout : il y a encore la langue. […] Certes, personne n’admire plus que moi la prodigieuse invention verbale de Victor Hugo […]. Mais pour la pureté de la langue, il me paraît cependant qu’il faut donner la préférence aux écrivains du siècle de Louis XIV. (Favez 1911).
Au cœur du débat en réalité, la langue : faut-il privilégier les auteurs du XVIIe siècle, qui incarnent un certain idéal de la langue française, ou plutôt les auteurs du XIXe, qui s’expriment avec la même langue que les élèves? Et si l’on maintient les classiques du XVIIe siècle, ne doit-on pas imaginer de nouveaux exercices permettant aux élèves, toujours plus nombreux avec la création d’un secondaire pour tous, de comprendre ces textes, dont la langue n’est plus la leur?
5. De la lecture expliquée à l’explication de texte (1910-1930)
Le début du XXe siècle est marqué par la stabilisation des systèmes scolaires cantonaux qui va de pair avec la stabilisation des disciplines scolaires. Ainsi, le «français» s’organise désormais autour de composantes – grammaire, littérature, lecture, composition – et d’exercices spécifiques. C’est dans ce contexte qu’apparaît un nouvel exercice de lecture – la lecture expliquée – qui va s’étendre sur le primaire et le secondaire.
5.1. Avènement de la lecture expliquée au primaire
A partir des années 1920, l’orientation donnée à la lecture dans le dernier tiers du XIXe siècle s’affirme et se stabilise. Elle se caractérise notamment par la place centrale du texte littéraire dans la composante lecture et la lecture expliquée36 comme exercice phare au primaire (voir également les analyses de Schneuwly & Darme 2015).
Ainsi, en adéquation avec les recommandations figurant dans les préfaces des livres de lecture, les prescriptions recentrent clairement les exercices d’explication sur le texte littéraire. A titre anecdotique, mais révélateur de ce mouvement au niveau romand, on voit apparaître dans la partie pédagogique de l’Educateur une rubrique «Texte littéraire». En outre, on observe l’entrée du terme littéraire, jusqu’ici absent des prescriptions37, dans les programmes des trois cantons parus dans les années 1920-193038. Enfin, on y note l’apparition de la «lecture expliquée»39, qui résulte de la progressive stabilisation des exercices d’explication et de comptes rendus prescrits dès le dernier tiers du XIXe siècle.
Cette nouvelle forme de lecture a été amorcée dans différents articles spécialisés parus dans les revues pédagogiques dans les années 1910, à l’instar de La lecture expliquée par Henri Mercier (1911) et Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée par Henri Duchosal40 (1918). Fait significatif de l’articulation entre le primaire et le secondaire, ces deux écrits sont rédigés par des enseignants du secondaire. Celui de Duchosal est même une adaptation pour le primaire supérieur d’un article que ce dernier a publié dans l’Educateur en 1917 pour le secondaire inférieur:
Pensant que notre article sur la lecture expliquée paru dans L’Educateur, au mois de février 1917, et destiné aux établissements d’instruction secondaire, pourrait être aussi de quelque utilité pour les écoles primaires, le Département de l’Instruction publique a bien voulu nous demander de l’adapter à ce degré de l’enseignement en le simplifiant et en le faisant suivre d’exemples concrets qui lui donneraient un caractère pratique (Duchosal 1918 : Avant-propos).
De ces articles se dégagent quelques traits fondamentaux de la lecture expliquée au primaire. Ainsi, pour Mercier, une première phase de l’explication devrait être centrée sur le vocabulaire : «Un autre service de ces premières lectures expliquées devrait être d’enrichir le vocabulaire, le vocabulaire concret s’entend, encore si pauvre» (Mercier 1911 : 199). L’explication devrait être ensuite consacrée à l’étude du plan et à la compréhension des idées contenues dans le texte. La marche à suivre proposée par Duchosal (1918) est différente de celle de Mercier, mais on y retrouve les mêmes composantes, à savoir un travail sur le fond et un travail sur la forme (comprenant la grammaire en sus du vocabulaire). L’ordre des étapes est le suivant:
1. lire le morceau
2. donner le sujet du morceau et préciser le but de l’auteur
3. retrouver le plan
4. expliquer les idées du texte
5. discuter la valeur de celles-ci
6. dégager les caractéristiques formelles du morceau avec une centration sur le vocabulaire et la grammaire
7. procéder au compte rendu, soit à la synthèse de l’explication.
A noter que ce compte rendu pour Duchosal doit être effectué par un élève, les autres étapes de la leçon devant être réalisées sous la forme d’une leçon dialoguée entre maître et élèves.
Dans les prescriptions du primaire toutefois, il n’est pas aussi aisé de saisir en quoi consiste la lecture expliquée dans le détail ni la manière de procéder. En effet, certaines préconisations figurant dans les programmes restent assez vagues, à l’instar des exemples suivants : «Étude élémentaire du contenu et de la forme» (Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932, degré moyen) ; «Remarques littéraires élémentaires» (Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Vaud, 1926 : degré supérieur). Qui plus est, on relève la persistance d’une dimension morale, présente cependant explicitement chez Duchosal (1918), dans le programme fribourgeois de 1932 : «Exciter et développer le goût de la lecture saine et réconfortante par des lectures faites par le maître de pages littéraires et morales captivantes [...]» (p. 32).
5.2. Une nouvelle génération d’ouvrages de lecture
Si la littérature devient prépondérante dans les manuels de lecture au primaire comme au secondaire, désormais, c’est le type de littérature à privilégier qui sera discuté. En 1893, Le Département de l’Instruction publique et des cultes vaudois mandate Louis Dupraz et Emile Bonjour41 pour rédiger deux ouvrages afin de remplacer le Renz (1871) et le Dussaud et Gavard (1871). Non seulement les autorités vaudoises se désolidarisent des autres cantons romands, mais demandent en outre aux auteurs de faire une large place à la littérature nationale. Deux nouveaux ouvrages sont édités : le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1895) et le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire (Dupraz & Bonjour 1903).
Ces deux livres de lecture annoncent un changement quant aux morceaux choisis qui se confirme dans la seconde édition de l’opuscule destiné au degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1899, 2e éd.). L’ouvrage comporte désormais un quart de textes d’auteurs suisses, dont la plupart sont francophones, et sept traductions. Nous constatons également que les textes descriptifs sur les sciences naturelles disparaissent au profit de textes littéraires dont le thème est la nature. Enfin, les morceaux choisis traitent de thématiques proches de l’environnement de l’enfant et de l’adolescent, ce qui permettrait, selon les auteurs, d’inscrire leur apprentissage dans leur quotidien (Tinembart 2018).
Dix ans plus tard, Dupraz et Bonjour, en collaboration cette fois-ci avec Henri Mercier, rédigent une Anthologie scolaire (1908) destinée aux collèges secondaires et aux écoles primaires supérieures (élèves de 13 à 15 ans) et adoptée par le canton de Genève. Cette anthologie comporte 259 extraits de textes répartis en dix parties. Non seulement elle contient des auteurs qui ne figurent pas dans le livre de lecture écrit pour les écoles primaires (Fénélon, Stendhal, Zola, Descartes, Flaubert, Flammarion, Montaigne, La Bruyère, Musset, etc.), mais une partie «études littéraires» et une partie «théâtre» sont intégrées. Dans la première, les élèves apprennent les caractéristiques de la langue française, les particularités de l’orthographe et de la ponctuation. Dans la seconde, ils font entre autres la connaissance de Corneille et retrouvent Racine et Molière. Enfin, l’ouvrage se termine par 26 pages regroupant des biographies succinctes des 159 auteurs présents dans ce manuel.
A la mort de Dupraz, Bonjour édite deux nouveaux manuels : Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire (1925) et Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur (1931). Les morceaux choisis abordent des thématiques qui concernent encore davantage les élèves telles que l’observation des animaux, les récits d’aventure, les qualités et les défauts, la vie quotidienne, etc. Celles-ci répondent plus aux intérêts des enfants et à leurs goûts personnels. L’influence de l’École nouvelle42 pourrait expliquer ce changement. La plupart des morceaux choisis écrits par des auteurs français ne figurent pas dans les ouvrages précédents de Bonjour. Celui-ci fait également entrer de nouveaux auteurs suisses tels que Maurice Porta, René Morax, Gonzague de Reynold ou encore Charles Ferdinand Ramuz. Sont également privilégiés les auteurs contemporains (sur les 244 textes présents dans l’ouvrage, 93 auteurs sont nés au XIXe siècle et 41 au XXe siècle). Le livre de lecture n’est désormais plus encyclopédique, mais il offre une grande diversité littéraire. Il propose ainsi des textes proches du vécu de l’enfant et ses extraits proviennent de la littérature suisse et française.
En 1910, Henri Mercier résume bien ce renouveau dans les ouvrages de lecture : «Gardons ce qui est substantiel en littérature, en morale, en histoire. Préoccupons-nous de la vie. Ornons les esprits, mais tâchons d’abord de les faire réalistes et pratiques» (Mercier 1910 : 90-91) ; «[…] Le manuel, lui aussi, s’est mis au ton du jour. Il suit le mot d’ordre : “Tout par les textes !”» (Mercier 1910 : 94).
5.3. De l’institutionnalisation de l’explication de texte au secondaire
Les années 1910-1920 peuvent être considérées pour le secondaire comme le moment clé où le «français» devient une discipline organisée désormais autour de trois piliers : un corpus littéraire spécifique et deux exercices progressivement placés à égalité. Il s’agit de la dissertation, présente dans les programmes dès la fin du XIXe, et de l’explication de texte, qui entre dans les pratiques à cette période, non sans débats cependant, comme le laisse entendre Mercier:
L'explication française, officiellement instituée partout ou peu s'en faut, n'est-elle qu'un vain ornement sur la façade des programmes? Est-ce une expression creuse et sonore? N'est-ce pas plutôt le bon sens même et une pièce essentielle de l'enseignement? Des livres excellents, de nombreux articles, des discussions courtoises ou vives nous prouvent l’intérêt, l’importance et la nouveauté de ce sujet. Oui, sa nouveauté. (Mercier 1911 :198)
Sur la scène romande en effet, si les pédagogues s’accordent sur la nécessité de travailler à partir de morceaux tirés d’anthologies, les approches pour aborder ceux-ci diffèrent. Ainsi, Bouvier, dans une conférence adressée aux futurs ou jeunes maîtres de français en 1910 à Zurich, défend la «lecture analytique», qu’il centre sur les auteurs du XIXe, et qu’il distingue de «l’explication française» (Bouvier 1910 : 16). Sa méthode, expérimentée à l’Université de Genève dans son séminaire de français moderne, est envisagée ici au niveau secondaire, pour «un maître idéal et un élève idéal, affranchis de la surveillance administrative et du souci des examens» (Bouvier 1910 : 2). Celle-ci s’organise autour de deux questions : «qu’est-ce que l’auteur a voulu faire? Par quels moyens l’a-t-il réalisé?» (Bouvier 1910 : 12). Son but? «Faire saisir à notre élève l’individualité de chaque écrivain» (Bouvier 1910 : 10).
Mercier (1911), quant à lui, prône la lecture expliquée selon la méthode proposée par Ch.-M. Des Granges43 dans son manuel Morceaux choisis des auteurs français du Moyen-Âge à nos jours préparés en vue de la lecture expliquée de (1910/1920). Celle-ci comprend les étapes suivantes : replacer, s’il y a lieu, le morceau dans l’ensemble dont il a été détaché ; le lire à haute voix, établir son plan; le commenter phrase par phrase sans tomber dans la paraphrase, en s’arrêtant sur la propriété des termes et sur les figures de style ; terminer par une conclusion philosophique et morale. Mercier précise néanmoins : «Y a-t-il pour expliquer un auteur français une seule méthode? Non pas. Qui ne sent qu’on ne commente pas Boileau comme Lamartine. […] Cela dépend aussi de la préparation de l’élève» (Mercier 1911 : 204).
C’est la lecture expliquée qui l’emporte. Présente dans les programmes du collège de Genève dès 1914 au secondaire inférieur, celle-ci se répand dès 1918 au secondaire supérieur et, comme nous l’avons vu, au niveau du primaire supérieur, suite à des propositions pédagogiques publiées au niveau romand (Duchosal 1918). Corollairement, alors que la fin du XIXe se caractérise au niveau de la voie gymnasiale par une absence des manuels, dès les années 1920, le manuel de Ch.-M. Des Granges (1910/1920) est cité dans les programmes aussi bien à Genève (1925) qu’à Fribourg (1926). Cela est d’autant plus intriguant qu’à Fribourg, on reste au secondaire dans un enseignement de la «langue française» très influencé par la rhétorique, centré dans les petits degrés sur la grammaire et qui aboutit en dernière année à la «rhétorique» avec, comme exercices, le discours, les analyses et critiques littéraires et les plaidoyers.
Le choix de l’anthologie de Des Granges, loin d’être le produit du hasard, signe en réalité une ère nouvelle dans l’enseignement du «français» en Suisse romande. Cette anthologie est en effet prescrite dans la voie gymnasiale en lien avec le cours d’histoire de la littérature qui procède désormais par siècles : Moyen-Âge et XVIe siècle en 1e année, XVIIe siècle en 2e, XVIIIe siècle en 3e et XIXe siècle en 4e. Contrairement aux anthologies précédentes, celle de Des Granges a en effet l’avantage de proposer une série de morceaux d’auteurs allant du Moyen-Âge à 1900, classés par siècles, et à l’intérieur de chaque siècle, par genres. Mais surtout, comme le relève un critique belge de l’époque, «cette anthologie est particulièrement intéressante pour les professeurs, car plus de vingt textes commentés donnent des modèles d’explication littéraire et constituent une véritable méthode» (Hombert 1932), plaçant de fait le texte littéraire au centre de l’enseignement du «français».
L’institutionnalisation de la lecture expliquée sur l’ensemble du secondaire en Suisse romande semble donc s’opérer plus tardivement qu’en France où «c’est […] des premières années du XXe siècle que date la pratique régulière de l’explication française dans les classes» (Chervel 2006 : 531). Elle se réalise in fine par le biais de l’épreuve orale de maturité qui devient, dans les années 1920, une «explication de texte»44, aux côtés de l’épreuve écrite de français, qui est une «composition sur un sujet littéraire ou scientifique», soit une dissertation45. Avec cette nouvelle épreuve, l’interprétation des morceaux littéraires va alors s’imposer dans les pratiques, au point de devenir «à l’école secondaire, la branche la plus importante de l’enseignement du français» (Robadey 1933 : 193).
6. Conclusion
Que retient-on de ce parcours historique? Dans les classes de Suisse romande, il apparaît que l’avènement du texte littéraire en «français» s’opère entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, en lien avec la disciplinarisation du «français» au primaire et au secondaire. A l’intérieur de ce processus cependant, le modèle rhétorique perdure dans les pratiques sous forme de traces, et ce dans les trois cantons, même si les cantons protestants de Genève et de Vaud apparaissent comme plus avant-gardistes que Fribourg. En tant que canton catholique, ce dernier continue en effet sur cette période à privilégier les manuels français du XIXe siècle, au détriment de ceux édités sur la scène romande par les cantons protestants.
Dans les grandes lignes du processus que nous avons retracé, la Suisse romande ne se distingue pas de la France vers laquelle les professeurs de l’époque se tournent largement pour repenser leurs pratiques. Rollin, Des Granges, pour ne citer que quelques noms, constituent en effet des références incontournables pour les pédagogues romands. Cependant, cette histoire comprend des spécificités liées notamment au fait que la Suisse est constituée de plusieurs régions linguistiques, dans lesquelles le «Français» a le statut, soit de langue maternelle, soit de langue étrangère. La Chrestomathie de Vinet est emblématique de la circulation des idées pédagogiques entre les cantons suisses, mais aussi entre les pays à cette période. L’originalité de cette anthologie –lire les auteurs de langue française en suivant la méthode utilisée alors pour les auteurs de l’Antiquité– tient au fait qu’elle est prévue au départ pour l’enseignement de la langue et de la littérature française à Bâle (canton germanophone). Or, elle va non seulement s’imposer dans l’ensemble du secondaire en Suisse romande, mais elle sera également imprimée en France et en Belgique.
Par ailleurs, cette étude montre que les professeurs du secondaire, dont certains ont été au début de leur carrière instituteurs, ont joué un rôle majeur dans l’avènement du texte littéraire à l’école. Ce sont eux qui façonnent les contours de la littérature française dans les classes de Suisse romande, et qui élaborent de nouveaux exercices pour lire, comprendre et interpréter ces textes, selon une progression qui va du primaire à la fin du secondaire supérieur. Ainsi, au primaire, les auteurs contemporains sont plus présents qu’au secondaire où, dès le début du XXe siècle, l’approche de la littérature est désormais chronologique, allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. De plus, au primaire, les morceaux choisis sont également plus proches de l’enfance au niveau des thèmes abordés. Corollairement, la manière d’approcher ceux-ci s’inscrit dès les années 1920 dans une progression, qui va de la lecture expliquée de type littérale (axée sur le vocabulaire et la grammaire) au primaire à l’explication de texte qui laisse une large place au commentaire (axé sur les figures de style et visant à dégager le style particulier de l’auteur) au secondaire supérieur.
Les choix qui ont été faits par les acteurs du système scolaire à cette période ont été décisifs. Ils constituent encore la base de la discipline «français» aujourd’hui. Dans les Directives pour l’examen suisse de maturité (2012), il est en effet précisé que, pour le «français» langue première, le candidat sera évalué par le biais d’une épreuve écrite, soit une dissertation, et d’une épreuve orale, soit une analyse d’un extrait tiré d’une œuvre littéraire. Cependant, aussi bien au secondaire qu’au primaire, les plans d’études ne prescrivent pas un corpus littéraire précis, se limitant à des indications en ce qui concerne les genres à travailler et les siècles à couvrir pour chaque année. Le choix de telle ou telle œuvre et la manière de la travailler en classe relève de l’expertise de l’enseignant. Ce dernier, comme ceux d’hier, contribue ainsi, à son échelle, à la définition de ce qu’est la littérature scolaire aujourd’hui.
Bibliographie
Balibar, Renée (1985), L’institution du français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République, Paris, Presses Universitaires de France.
Barras, Jean-Marie (1988), Deux siècles d’apprentissage de la lecture dans le canton de Fribourg, Fribourg, Auteur.
Bishop, Marie-France (2019), « Quelle didactique de la littérature dans les manuels de l’enseignement primaire en France de 1880 à nos jours? », in N. Denizot, J.-L. Dufays & B. Louichon (Ed.), Approches didactiques de la littérature, Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 33-48.
Caron, Philippe (1992), Des « Belles Lettres » à la « Littérature ». Une archéologie des signes du savoir profane en langue française (1680-1760), Louvain/Paris, Peeters.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Darme, Anouk (2018), Enseigner la grammaire pour développer l’expression de la pensée ? Eléments d’histoire de la grammaire scolaire en Suisse romande, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
David, Jérôme (2017), « Enseigner la littérature : une approche par les justifications (XIXe -XXIe siècles) », Transpositio, 1 [Page web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-une-approche-par-les-justifications-xixe-xxie-siecles
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Denizot, Nathalie (2015), « Les humanités, la culture humaniste et la culture scolaire », Tréma, 43 [Page Web]. URL : https://journals.openedition.org/trema/3301
Douay-Soublin, Françoise (1997), « Les recueils de discours français pour la classe de rhétorique », in M.-M. Compère & A. Chervel (Ed.), Les Humanités classiques, Paris, INRP, p. 151-185.
Gabathuler, Chloé (2017), « Manuel de lecture genevois au début du XXe siècle », Transpositio, 1 [Page Web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/manuels-de-lecture-genevois-au-debut-du-xxe-siecle
Gabathuler, Chloé & Bruno Védrines(2018), « Des pratiques d’enseignement de la littérature : quelques jalons historiques et analyses de pratiques effectives », in Ch. Ronveaux et B. Schneuwly (Ed.), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang, p. 43-66
Hofstetter, Rita (2012), « La Suisse et l’enseignement aux XIXe -XXe siècles. Le prototype d’une ‘Fédération d’États enseignants’ », Histoire de l’Éducation, n°134, p. 59-80.
Hofstetter, Rita & Anne Monnier (2015), « Construction de l'instruction publique et démocratisations contrastées », in G. Durand, R. Hofstetter, G. Pasquier, L. Palandella & Syndicat des enseignants romands (Ed.), Les Bâtisseurs de l'école romande. 150 ans du Syndicat des enseignants romands et de l'Educateur, Genève, Georg, p. 134-177.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (1998/2001), « Introduction », in R. Hofstetter & B. Schneuwly (Ed.), Le Pari des sciences de l’éducation, Bruxelles, De Boeck, p. 7-28
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (à paraître), « Les manuels comme emblèmes des reconfigurations disciplinaires de la forme école au 19e siècle ? Essai historiographique », in S. Wagnon (Ed.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : Enjeux actuels et perspectives, Berne, Peter Lang.
Houdart-Mérot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Monnier, Anne (2018). Le temps des dissertations. Chronique de l'accès des jeunes filles aux études supérieures (Genève, XIXe -XXe), Genève, Droz.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (Ed.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang.
Rouiller, Viviane. (2018), « Apprendre la langue de la majorité des Confédérés ». Une discipline scolaire, entre enjeux pédagogiques, politiques, pratiques et culturels (1830-1990), Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
Savatovsky, Dan (1999), « Le français: genèse d’une discipline », in A. Collinot & F. Mazière (Ed.), Le français à l’école: un enjeu historique et politique, Paris, Hatier, p. 36-76
Schneuwly, Bernard (2016), « Forme-t-on au même rapport à la langue des deux côtés de la Sarine ? Premières explorations dans les livres de lecture durant un siècle », Forumlecture, 2/2016 [Page Web]. URL : https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/573/2016_2_Schneuwly.pdf
Schneuwly, Bernard & Anouk Darme (2015), « La lecture dans la discipline Français. Analyse des plans d’études et des manuels de lecture de 1870 à 1990 dans le Canton de Genève », in L. Perret-Truchot (Ed.), Analyser les manuels scolaires. Questions de méthodes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.109-128
Schneuwly, Bernard & Joaquim Dolz (Ed.) (2009), Des objets enseignés en classe de français : le travail de l'enseignant sur la rédaction de textes argumentatifs et sur la subordonnée relative, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
Tinembart, Sylviane (2018), « La littérature fait son entrée en classe primaire (1830-1990). Illustration de sa présence dans les plans d’études et les manuels de lecture du canton de Vaud », Forumlecture, 3/2018 [Page Web]. URL : https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/650/2018_3_fr_tinembart.pdf
Sources imprimées
Biolley, Alexis (1866), « Quelques mots sur la lecture et l’enseignement de cette branche du programme de l’école primaire », Educateur, 2(18), p. 298-302.
Bourqui, Auguste (1870), « Encore l’enseignement de la composition à l’école primaire », Educateur, 6(21), 328-340.
Duchosal, Henri (1918), Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée (2e éd), Genève : Imprimerie Atar.
Favez, Charles (1911, 19 février), « Classiques ou modernes ? », Gazette de Lausanne, 49 [Page Web]. URL : https://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1911_02_19/1/article/1309269/Favez
Hombert Joseph (1932), « Des Granges (Ch.-M), Morceaux choisis des auteurs français du moyen âge à nos jours », Revue belge de philologie et d'histoire, 11(1-2) [Page Web]. URL : https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1932_num_11_1_1371_t1_0181_0000_2
Mercier, Henri (1910), « L’Année littéraire », Annuaire de l’Instruction publique, 1, 83-108 [Page Web]. URL : http://doi.org/10.5169/seals-109043
Mercier, Henri (1911), « La lecture expliquée », Annuaire de l’Instruction publique, 2, p. 195-209 [Page Web]. URL : https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=aip-001:1911:2::10#256
Rambert, Eugène (1930), Alexandre Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, Lausanne : Payot.
Robadey, Louis (1933), « La lecture expliquée et, par elle, la culture littéraire », Bulletin pédagogique, 62 (13), p. 193-200.
Manuels et ouvrages scolaires
Emile, Bonjour (1925), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire, Lausanne, Payot.
Emile, Bonjour (1931), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur, Lausanne, Payot.
Des Granges, Charles-Marc (1910/1920), Morceaux choisis des auteurs français du moyen-âge à nos jours en vue de la lecture expliquée (842-1900). Classes de Lettres. 2e cycle, (14e éd.) Paris, Hatier.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1895/1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Adrien Borgeaud, imprimeur-éditeur.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (avec Mercier H.). (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises, Lausanne, Payot.
Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.
Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1882), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg, Lausanne, Imprimerie Lucien Vincent.
Noël, François & François Delaplace (1804-1805), Leçons de littérature et de morale (2e éd., vol. 1-2), Paris, Le Normant.
Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.
Vinet, Alexandre (1829a), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1829b), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 2, Lectures pour l’adolescence, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1830), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 3, Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1833, 2e éd.), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.
Textes institutionnels
Commission suisse de maturité (CSM) (2012), Directives pour l’examen suisse de maturité, Confédération suisse. Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [Page Web]. URL : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2006), Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations, Neuchâtel : CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010), Plan d’études romand, Neuchâtel : CIIP[Page Web]. URL : https://www.plandetudes.ch/per
Canton de Genève
Programmes de l’enseignement primaire (1852, 1875, 1889 1912, 1923) : Bibliothèque de Genève (BGE).
Programmes d’enseignement du Gymnase (1848-1886) : BGE.
Programmes d’enseignement et plans d’études du Collège de Genève (1855, 1877, 1889, 1900, 1925) : BGE.
Canton de Fribourg
Programmes et plans d’études pour l’enseignement primaire (1886, 1899, 1932) : Office du matériel scolaire Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire de l’Etat de Fribourg (BCUEF).
Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg (1850, 1876) : Archives d’Etat de Fribourg.
Programme général des cours de l’école cantonale de Fribourg (1848, 1856) : BCUEF.
Programme des études du collège et du lycée de Fribourg et de l’école normale d’Hauterive (1871) : BCUEF.
Programme des études du collège Saint-Michel (1887, 1926) : BCUEF.
Canton de Vaud
Catalogue des élèves du collège cantonal et de l’école préparatoire. Objets d’enseignement. (Année scolaire 1853-1854). Lausanne : Imprimerie Pache-Simmen.
Plan d’études pour l’enseignement primaire (1868, 1899, 1926) : Archives cantonales vaudoises (ACV)
Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud (1910) : ACV.
Programme des cours du Collège cantonal (1877, 1890) : ACV.
Annexe 1 : Contenus des parties qui composent le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard (1871)
- Histoire naturelle comprenant la zoologie, l’étude des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles et batraciens, poissons, insectes, mollusques, crustacés, zoophytes), la botanique (fleurs, herbes, arbres, arbres exotiques, arbustes) et l’industrie (machine à vapeur, imprimerie). De nombreuses illustrations accompagnent ces textes descriptifs. Parmi les 120 extraits, 23 sont d’Adam Vuillet et 20 de Milne-Edwards. La moitié sont anonymes.
- Descriptions et voyages qui reprend 16 récits d’auteurs différents, mais parmi lesquels nous retrouvons huit descriptions de voyages en Suisse.
- Histoire qui contient 15 morceaux dont « Regulus » de Chateaubriand déjà présent dans la Chrestomathie de Vinet. Là encore, la moitié des textes concerne l’histoire suisse.
- Biographies : parmi les huit portraits, certains mettent notamment à l’honneur deux pédagogues suisses (Pestalozzi et le père Grégoire Girard de Fribourg), mais également un inventeur (Jean-Marie Jacquard), un géologue (Esther de la Linth), un général d’empire (Antoine Drouot)
- Anecdotes-traits moraux-caractères : 21 extraits hétéroclites au niveau des sujets composent cette partie. Parmi eux figurent quatre textes de Fénélon et deux de La Bruyère.
- Style épistolaire : Mme de Sévigné côtoie Racine, Voltaire, Rousseau, Constant et Montesquieu, mais d’autres comme Joseph Joubert ou Paul-Louis Courrier sont également présents.
- Dialogues en prose sont constitués de trois extraits de théâtre dont un de Molière (Don Juan) et deux de Brueys et Palaprat (Patelin).
- Dialogues en vers au nombre de trois dans lesquels figure également Molière (Tartuffe), un extrait d’Edmé Boursault (Le Mercure Galant) et Petit-Senn.
- Poésie narrative et lyrique : sur les 31 extraits, il n’y a que trois fables de La Fontaine et deux de Florian. Par contre, nous trouvons deux textes de Lamartine et deux de Hugo.
Annexe 2 : La littérature prescrite en « français » dans la voie gymnasiale à Genève, 1900
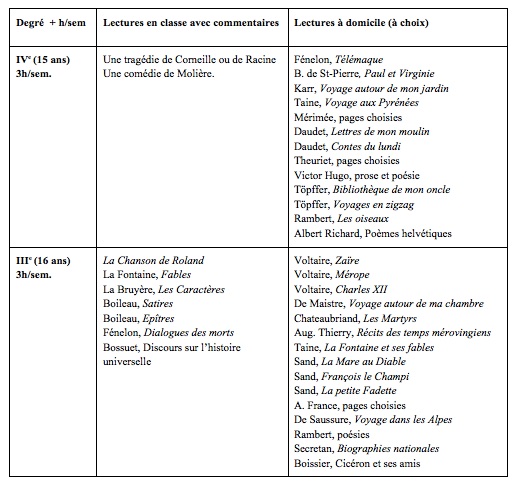
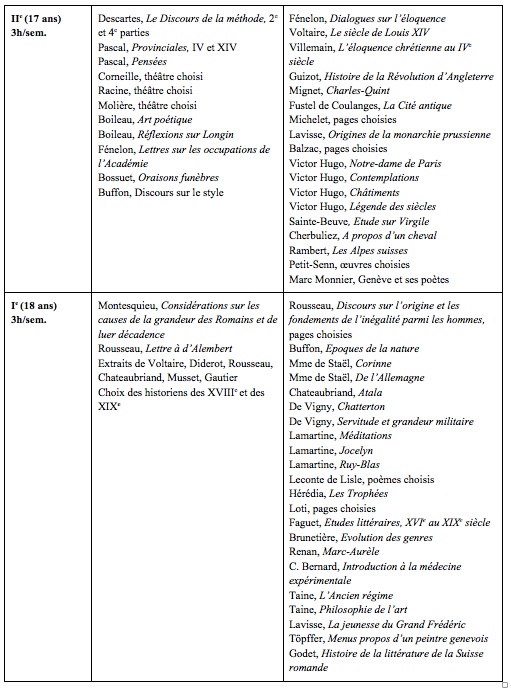
Alexandre Gavard (1845-1898): régent, puis professeur du collège, cet homme politique genevois sera désigné conseiller d’Etat en charge du Département des travaux publics, puis du Département de l’Instruction publique.
Louis Dupraz (1852-1920) : instituteur, puis maître de français au collège de Payerne, il complète sa formation en Lettres à Paris. Il est désigné professeur de français à l’école supérieure de jeunes filles de Lausanne en 1881. En 1893, il est nommé chef bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Il en devient le directeur en 1898.
[Page Web]. URL : https://data.bnf.fr/14301685/charles-marc_des_granges/
Pour citer l'article
Anouk Darme-Xu, Anne Monnier & Sylviane Tinembart , "L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/l-approche-historico-didactique-pour-penser-l-avenement-du-texte-litteraire-dans-l-enseignement-du-francais-suisse-romande-1850-1930
Voir également :
La lecture littéraire professionnelle : une configuration dynamique de textes de lecteurs
Le concept de « texte du lecteur » est aujourd’hui assez usuel dans le champ de la didactique de la littérature. Nous interrogerons ici son intérêt et sa pertinence pour décrire les séances de littérature dès lors que les cadres théoriques mobilisés croisent ceux de la didactique de la littérature avec l’analyse de l’activité, de la vidéoformation (Barbier & Durand 2003 ; Flandin, Leblanc & Muller 2015), de la didactique professionnelle (Pastré 2011 ; Bucheton & Soulé 2009).
La lecture littéraire professionnelle : une configuration dynamique de textes de lecteurs
Le concept de «texte du lecteur» est aujourd’hui assez usuel dans le champ de la didactique de la littérature. Nous interrogerons ici son intérêt et sa pertinence pour décrire les séances de littérature dès lors que les cadres théoriques mobilisés croisent ceux de la didactique de la littérature avec l’analyse de l’activité, de la vidéoformation (Barbier & Durand 2003 ; Flandin, Leblanc & Muller 2015), de la didactique professionnelle (Pastré 2011 ; Bucheton & Soulé 2009).
Ce questionnement s’appuie sur un projet de recherche, «Du texte à la classe» (projet TALC1), qui entend documenter les pratiques effectives et ordinaires de l’enseignement de la littérature en cycle 3. Pour ce faire, nous avons soumis un extrait d’œuvre à des enseignant·e·s. Les séances de travail sur ces textes dans les classes ont été filmées ainsi qu’une autoconfrontation et un entretien. Quelques semaines plus tard, les enseignant·e·s ont participé à trois journées de formation. Les échanges ont été enregistrés et transcrits.
Notre contribution s’articulera en trois temps. D’abord, nous présenterons le projet de recherche et le recueil de données sur lesquels s’appuie cette contribution et nous reviendrons sur le concept de «texte de lecteur» (dorénavant TdL). Ensuite, nous décrirons une séance à l’aide du concept de TdL pour conclure sur son intérêt au regard des compétences de lecture professionnelle dont la formation doit doter les enseignant·e·s de littérature.
1. Cadrage
1.1. Le projet TALC
Le projet TALC (du Texte à La Classe) s’inscrit dans une dynamique à l’œuvre dans le champ de la didactique de la littérature qui voit se développer des projets visant à la description des pratiques ordinaires en s’appuyant sur un collectif de chercheur·e·s. On songe ici par exemple aux travaux du Grafelit (Schneuwly & Ronveaux 2019) ou au projet GARY (Capt et al., 2018) regroupant des chercheurs de plusieurs pays francophones; ou encore au projet PELAS (Plissonneau et al., 2017).
TALC s’intéresse aux pratiques effectives ordinaires des enseignant·e·s de littérature de cycle 3. Ce projet est lié à la mise en place, en France, en 2016, de nouveaux programmes présentant deux nouveautés (MEN 2015). La première, curriculaire, reconfigure le cycle 3. Anciennement composé des trois dernières classes de l’école élémentaire (CE2-CM1 et CM2), le CE2 est dorénavant intégré au cycle 2 et la classe de 6ème au cycle 3. Ce dernier conjoint donc les deux derniers niveaux de l’école primaire et la première classe du collège (élèves de 11-12 ans) avec l’objectif de faciliter la transition entre l’école, où les élèves ont un·e seul·e enseignant·e, polyvalent·e, et le collège où les enseignements sont dispensés par les différent·e·s spécialistes d’une discipline. La seconde nouveauté concerne les objectifs assignés à l’enseignement de la littérature puisque celui-ci vise des enjeux de «formation littéraire» et de «formation personnelle» (Brinker & Di Rosa 2018).
Au regard de cette double évolution, nos hypothèses sont que, d’une part, même si un programme commun couvre l’ensemble du cycle, les pratiques sont différentes suivant les structures: l’école (niveau primaire) vs le collège (niveau secondaire I) ; d’autre part que les pratiques sont différentes suivant le genre littéraire2 auquel appartient l’œuvre (ou l’extrait) lue.
L’essentiel du recueil de données s’est déroulé en 2017-2018. Des enseignant·e·s volontaires3 (12 en CM et 7 en 6ème) sont répartis en binômes. Une œuvre littéraire, choisie par les chercheur·e·s, leur est imposée ainsi qu’un extrait. Aucune induction didactique n’est donnée, et le projet de recherche est présenté de manière minimale. Seule la séance durant laquelle les classes lisent et étudient l’extrait est filmée (19 séances). À sa suite, un entretien d’auto-confrontation est mené avec l’enseignant·e (18 entretiens) ainsi qu’un entretien croisé entre les deux enseignant·e·s du binôme (5 entretiens). Les séances et les entretiens ont été retranscrits.
Ce matériau a nourri un stage de formation4 se déroulant en février 2018 et auquel certain·e·s enseignant·e·s ont participé. Durant deux jours, nous sommes revenus sur le projet de recherche, avons relu les textes et analysé les pratiques observées. Le stage a été filmé et les échanges retranscrits.
La spécificité du projet tient à sa dimension interdisciplinaire qui permet une multiplicité de regards croisés. Le collectif de chercheur·e·s regroupe en effet des didacticien·ne·s de la littérature, des linguistes et des spécialistes des gestes professionnels et de l’analyse de l’activité. Nous essayons ensemble de comprendre comment la lecture et l’appropriation des textes littéraires (en tant qu’objets sémiotiques et/ou culturels et/ou esthétiques et/ou scolaires et enjeux d’apprentissages) participent des préoccupations des enseignant·e·s, de manière éventuellement différenciée, suivant le niveau (CM ou 6ème) et le genre littéraire du texte. La pluralité de ces points de vue enrichit, dans différents temps du projet, les échanges entre terrain et recherche.
Dans la classe de littérature, «la lecture (de manière littéraire) d’un texte (réputé) littéraire» constitue l’objet à enseigner (Ronveaux & Schneuwly 2018 : 90). «L’objet enseigné est […] le résultat sans cesse retravaillé de l’action de l’enseignant, suivant sa propre logique, articulé continuellement à cette autre action, l’apprentissage scolaire, qui suit la logique des élèves» (Schneuwly 2009 : 24).
Nous considérons que la lecture professionnelle de l’enseignant·e se situe à l’interface de l’objet à enseigner –le texte donné à lire– et de l’objet enseigné –le texte lu. Et pour l’appréhender, nous convoquons le concept de «texte du lecteur».
1.2. « Le texte du lecteur »
Dans le champ de la didactique de la littérature, le «texte du lecteur» est un concept usuel depuis qu’en 2008, un colloque lui a été consacré, lequel a donné lieu à deux publications (Mazauric, Fourtanier & Langlade 2011a ; 2011b). Dans le premier de ces volumes, Vincent Jouve propose une clarification du concept qui, selon lui, peut avoir deux sens possibles, celui de «compétence» ou celui de «performance». C’est la première acception que lui donnent Barthes dans S/Z (1970), Otten (1987) parlant des «codes» du lecteur, Eco (1985) de «l’encyclopédie du lecteur» ou Dufays des «systèmes de savoirs» du lecteur (1994). La seconde acception renvoie au résultat de la lecture, à la recréation toujours singulière et toujours originale que représente toute lecture. C’est la conception que l’on trouve chez Bellemin-Noël : «le trajet de lecture qui est tissé de la combinaison fluctuante de la chaine de ma vie avec la trame des énoncés une fois pour toutes combinés par l’auteur mériterait d’être appelé texte» (2001 : 21) ou chez Pierre Bayard : «le texte se constitu[e] pour une part non négligeable des réactions individuelles de tous ceux qui le rencontrent et l’animent de leur présence» (1998 : 130).
Pour autant, si l’on reprend ces discours relevant du champ de la théorie de la lecture, il existe aussi des convergences et l’on peut considérer que pour Barthes, Eco, Otten, Dufays, Jouve, Bellemin-Noël et Bayard, il y a bien toujours un texte à lire, des compétences et une performance.
Pour ce qui concerne le texte à lire, si Jouve affirme qu’«il existe ne serait-ce qu’au niveau dénotatif un contenu objectif que l’on peut toujours reconstruire» (Jouve 2011 : 59), Otten parle lui de «lieux de certitude», Dufays, reprenant la proposition d’Hamon (1977 : 264), préfère la notion «d’éléments de lisibilité». Mais nous avons noté que Bellemin-Noël affirme bien qu’il existe une «trame des énoncés une fois pour toutes combinés par l’auteur». Quant à Bayard, dans la préface au volume Texte du lecteur et dans la veine de «fiction critique» qu’il affectionne, il se demande si Julien Sorel était noir. Mais il prend bien soin de conclure, à propos de cette lecture, «si elle est énoncée par quelqu’un qui n’a jamais lu Stendhal, il y a toutes les chances qu’il s’agisse d’un contresens par rapport à ce que dit le texte et ce qu’a voulu faire Stendhal» (2011 : 15). Autrement dit, le texte à lire existe et ses droits ne peuvent être ignorés, comme l’écrit Eco: «l’univers du discours intervient pour limiter le format de l’encyclopédie» (1985 : 74).
Pour ce qui concerne les compétences du lecteur, la différence tient à la nature de ce avec quoi le lecteur lit5. Au «lecteur-texte» d’Otten, aux codes et encyclopédie d’Eco, Barthes ou Dufays répondent la «chaîne de ma vie» (Bellemin-Noël 2001: 21), l’inconscient (Bayard 2011; Bellemin-Noël 2001), les «angoisses, fantasmes, rêveries […] la part de subjectivité» (Bayard 2011 : 15).
Pour ce qui concerne la performance, il y a bien, selon Jouve, un «résultat de la lecture» (Jouve 2011 : 52), un «trajet de lecture» (Bellemin-Noël 2001 : 21), voire une recréation originale comme le propose comme le propose Marc Escola (2003) dans la perspective tracée par Michel Charles (2003).
On peut donc considérer que, dans le champ des théories de la lecture, il existe un certain nombre de convergences et que finalement, c’est l’accent mis sur tel ou tel aspect de l’activité de lecture avec plus ou moins de virulence (Jouve) ou de malice (Bayard) qui diffère, eu égard à des finalités liées aussi aux situations dans lesquelles la lecture s’exerce et le discours sur la lecture s’énonce6. Comme l’écrit Bayard, «Tout accès à un texte est marqué en profondeur […] par la situation de celui qui le rencontre» (Bayard 2011 : 14).
1.3. Le « texte du lecteur » dans la classe
Sur la base des travaux des didacticiens du sujet lecteur (Rouxel & Langlade 2004), le concept de TdL a été introduit dans le champ de la didactique (Mazauric, Fourtanier & Langlade 2008a ; 2008b). Dépassant la simple métaphore, il va souvent devenir un objet à produire, un véritable «texte écrit […]mettant en jeu une expérience subjective de lecture» (Fourtanier 2017 : 79). Dès lors, le «texte du lecteur» relève assez largement des «écritures de la réception» (Le Goff & Fourtanier 2017). Dans cette logique, il s’agit plus de faire advenir le TdL que de le mettre au jour. Nul doute que les dispositifs mis en place amènent un TdL différent de celui que la simple lecture aurait généré. Gagnant en efficacité ingénierique, il perd cependant de sa pertinence conceptuelle car le texte du lecteur, «le résultat de la lecture» (Jouve) est, stricto sensu, un «texte fantôme, sans matérialité»7. Et, de fait, «la saisie du texte du lecteur n’est […] pas chose simple» (Goulet 2008).
Cependant, dans le cadre intersubjectif de la classe, ce texte fantôme se donne à lire, non pas dans sa matérialité et son intégralité, mais de manière indirecte et fragmentaire, à travers les énoncés langagiers, ceux-ci devenant «l’ensemble des données permettant la description de l’activité réelle de lecture sous un vocable commun et unique»(Louichon 2016: 392).
En situation scolaire, le texte à lire va générer plusieurs textes du lecteur: celui de l’enseignant·e, celui de chacun·e des élèves ou «textes singuliers»(Goulet 2011 : 65-66), celui de la classe ou «texte commun»(Goulet 2011: 65).
Notre propos est maintenant de réfléchir à ce que peut signifier «texte du lecteur» en situation d’enseignement/apprentissage de formation à la lecture littéraire.
Nous considérons que dans cette situation co-existent ou peuvent co-exister parallèlement et/ou chronologiquement:
- Un texte (à lire).
- Un «texte du lecteur de l’enseignant». Il s’agit de ce texte que l’enseignant donne à lire à ses élèves, ce jour-là, en fonction (entre autres) des compétences supposées de ses élèves et de ses objectifs. Ainsi, à partir du texte mais aussi de la situation, l’enseignant va supposer des lieux de certitude ou des îlots de certitude et des lieux de lisibilité ou d’illisibilité. Il va aussi (éventuellement) neutraliser des lieux d’incertitude, voire des lieux de certitude. Dans une classe, le support de lecture du texte, les activités proposées aux élèves, les interactions sont des révélateurs de ce «texte du lecteur de l’enseignant», que l’on peut aussi désigner comme «le texte donné à lire aux élèves». Et d’une certaine manière, ce texte-donné-à-lire-aux-élèves programme sa réception, un peu comme un texte programme son Lecteur Modèle. Le TdL de l’enseignant est le résultat de sa lecture professionnelle.
- Un «texte du lecteur de chaque élève». Les lieux de certitude ou d’incertitude, les îlots de lisibilité ou d’illisibilité vont plus ou moins coïncider avec les suppositions de l’enseignant·e. Les élèves vont investir de manière singulière le texte. Ce sont les diverses tâches réalisées par les élèves et les interactions qui vont révéler les performances théoriquement et potentiellement toutes différentes des élèves. Ces «textes du lecteur de chaque élève» vont co-exister dans la classe même s’il est difficile d’y accéder.
- Un «texte du lecteur de la classe». Il s’agit d’une performance de lecture acceptable pour chacun·e et acceptée par tou·te·s. Elle constitue une forme de stabilisation du texte donné à lire aux élèves. Elle peut s’énoncer en cours de séance mais relève souvent du bouclage, voire de l’institutionnalisation.
Nous faisons l’hypothèse que la centration sur ces divers textes ainsi définis est un outil théorique susceptible de nous aider à décrire et comprendre ce qui se passe dans la classe de littérature, particulièrement du point de vue de l’enseignant·e.
2. Analyse d'une séance de littérature
Pour décrire avec précision ce que nous pouvons observer et comprendre, nous choisissons de restreindre l’analyse à une seule classe. Il s’agit d’une classe de 6ème d’un collège d’une petite ville des Pyrénées Orientales. Les élèves appartiennent à un milieu socio-professionnel hétérogène. L’enseignante a dix-huit ans d’expérience mais n’a jamais exercé de fonction ou de mission de formation. Elle construit ses séquences et séances de littérature conformément aux prescriptions officielles sans problème notable. Nous avons choisi cette séance car les TdL y sont lisibles, particulièrement le TdL de la classe que l’on a parfois du mal à identifier dans d’autres séances. Autrement dit, le choix de cette classe relève de préoccupations méthodologiques, il ne prête à cette séance aucun caractère exemplaire ou représentatif. Il vise à permettre l’exploration théorique proposée.
2.1. Le texte à lire
Il s’agit d’un extrait de la pièce de théâtre Le Petit Chaperon Uf, de Jean-Claude Grumberg, auteur présent dans les listes de cycle 3 depuis 2002 (annexe 1). La pièce est parue en 2005 chez Actes Sud et est rééditée dans la collection «Étonnants classiques collège» chez Flammarion en 2015, dénotant ainsi son actuelle légitimité scolaire. Réécriture du célèbre conte, l’œuvre s’ouvre sur un court texte signé de l’auteur : «Connaître l’histoire, les histoires, la vraie Histoire, à quoi cela sert-il aujourd’hui? Sinon à alerter les chaperons d’aujourd’hui, à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois […] n’est jamais définitivement acquise» (Grumberg 2005 :7). Le loup s’y nomme Wolf, porte un uniforme, s’exprime dans un français mâtiné d’allemand fortement stéréotypique8, interdit au petit chaperon de porter du rouge et, par la ruse, est sur le point d’arrêter la Mère-Grand. Tout cela jusqu’à ce que la petite fille refuse d’aller plus loin, l’oblige à cesser le jeu et à réintégrer «la vraie histoire» du Petit Chaperon Rouge9.
Par-delà son intérêt littéraire, cette œuvre a été choisie d’une part du fait de sa légitimité scolaire et d’autre part de sa plasticité au regard des objectifs potentiels des enseignant·e·s et des entrées du programme de cycle 3 (MEN, 2015). L’extrait sélectionné se situe au début de la pièce. La situation et les relations entre les personnages se mettent en place.
2.2. Le texte du lecteur de l'enseignante
Nous allons dans un premier temps tenter de mettre au jour ce texte que nous avons désigné comme «le texte donné à lire aux élèves». Ce texte-là peut être déduit et reconstruit à partir des activités proposées et du discours adressé aux élèves dans le cadre de la séance décrite en annexe 2 d’après la fiche de préparation de l’enseignante et les observations réalisées en classe.
Le tableau ci-dessous fait correspondre les éléments du texte donné à lire par l’enseignante et les moments de la séance, que l’on peut retrouver plus détaillés en annexe 2.
Éléments donnés à lire | Extraits du verbatim | Phase concernée |
Le texte est une réécriture du conte | Activité à faire antérieurement à la maison : points communs avec le conte | Phase 0 |
Projet de lecture : « Premièrement on va essayer, pour faire un point d’appui, de voir ce qu’on trouve comme différences entre ce texte et le Petit Chaperon Rouge (410) » | Début phase 1 | |
Synthèse écrite intermédiaire : « les différences avec le conte traditionnel » (122) | Fin de la phase 4 | |
Le loup incarne le fort et la petite fille le faible, mais elle résiste au loup et se moque même de lui | Problématique notée au tableau et lue par l’enseignante : « Donc, la question qu'on va se poser – quelles sont les ressources du faible pour résister au fort ? (1) | Phase 1 |
« vous avez bien perçu le rapport de force entre le loup … et la petite fille » (4), « elle se laisse pas faire … quand elle dit non, c’est non » (10) | Phase 3 | |
« Le Petit Chaperon Rouge se défend très bien » (70) | Phase 4.2 | |
Synthèse écrite intermédiaire (lecture du titre de la séance au tableau, à noter par les élèves) : « quelles sont les ressources du faible pour résister au plus fort ? » (122) | Phase 4.4 | |
« On verra comment, dans sa manière de se comporter, le Petit Chaperon Uf résiste à ce racket, à cette injustice, au comportement bête et méchant du loup » (154) | Phase 6 | |
(après lecture des élèves) : « vous avez montré que le Petit Chaperon Rouge était toujours agacé par le loup » (172) | Phase 7 | |
« Est-ce qu’elle se laisse faire la petite ? » (178) | ||
« Alors donnez-moi des exemples qui montrent qu'elle se laisse pas faire » (180) | ||
« Elle se moque un peu de lui ou pas ? » (186). | ||
« Moi, quand on lit le texte, j’ai l’impression que ce Petit Chaperon Uf il prend plus de place que celui qui est dessiné sur l’image. Vous trouvez pas ? » (188) | ||
Activité : Valider ou invalider une affirmation en justifiant par relevé dans le texte. Affirmation : « Le Petit Chaperon Rouge ne se laisse pas faire, elle est maligne, elle conteste ce que dit le loup » (189) | Phase 8 | |
« Elle est pas intimidée » (204) | ||
Bilan final oral de l’enseignante : « dans le langage théâtral, le loup est ridiculisé et la petite fille plus forte que lui, finalement, dans la manière de s’exprimer » (217) | Phase 9 | |
Le loup s’exprime dans un registre particulier | « Comment on appelle un registre de langue où on enlève certains mots ? » (44) | Phase 4.2.1 |
« Alors là est-ce qu'on pourrait relever une phrase qui montre qu'il a un langage soit brutal, soit incorrect et qu'en plus il est ridicule » (210) | Phase 8 | |
Le texte fait référence au contexte historique du nazisme | « Ça vous fait penser à un élément de l’Histoire qui s’est passé en réalité ? Un événement historique qui s’est vraiment passé où on obligeait les gens à porter des trucs jaunes (58) | Phase 4.2.2 |
« Oui, ça fait penser à la Seconde Guerre mondiale où les nazis, les Allemands […] les Juifs, ils devaient porter une étoile jaune » (68) | ||
« il y a un petit lien dans ce texte entre le conte traditionnel et l’événement historique » (68) | ||
(en allusion à la couverture du livre) : « Oui, il est habillé carrément comme les nazis. Dans l'illustration, c'est montré … il est habillé comme un officier avec un long manteau, des bottes, quelque chose de militaire » (188) | Phase 8 | |
Le texte est une parodie | « Comment ça s’appelait ce type de conte qui reprenait des éléments du conte et qui les transformait en étant comique ? » (74) | Phase 4.2.3 |
« Oui, … Donc ce texte c’est un peu pareil, c’est aussi une parodie (82). | ||
Synthèse écrite intermédiaire : « vous pouvez noter que ce texte est une parodie » (122) | ||
Le texte appartient au genre théâtral | Activité à faire antérieurement à la maison : « est-ce que vous pouvez me dire tous les éléments qui font que ce texte est du théâtre » (102) | Phase 4.4 |
« Là c’est du théâtre, à quoi avez-vous reconnu que c’est du théâtre ? » (102) | ||
Synthèse photocopiée des éléments caractéristiques du texte théâtral : « L'idée c'est qu'on prenne un petit bilan pour qu'on redise ce qu’on a dit sur le texte théâtral » (218) | Phase 9 |
Les données listées donnent forme et lisibilité au texte du lecteur de l’enseignante, autrement dit au texte donné à lire aux élèves, que l’on peut ainsi caractériser. C’est un texte littéraire qui fait écho à une mémoire didactique collective. En tant que texte théâtral, en tant que parodie et réécriture, en tant que texte relevant d’un registre de langue particulier, il permet potentiellement de réactiver des savoirs génériques, intertextuels ou linguistiques. Pour autant, ces dimensions ne sont pas centrales. De même, la référence historique, nécessaire pour que le lecteur comprenne l’allusion que l’on peut imputer à l’auteur est certes mentionnée, mais de manière marginale. Le TdL de l’enseignante porte sur les relations entre les deux personnages. Tout au long de la séance, le texte enseigné, celui que l’enseignante donne à lire à ses élèves, met en scène un loup ridicule et un Petit Chaperon Rouge moqueur.
2.3. L’accueil des TdL des élèves par l’enseignante
Dans la mesure où une partie importante de la séance relève du cours dialogué, les productions orales des élèves constituent le matériau à partir duquel l’enseignante produit un TdL de la classe, c’est-à-dire un TdL articulant le TdL de l’enseignant et le TdL des élèves dans une énonciation collective. Pour articuler un TdL de la classe qui ne se réduise pas à l’énoncé du TdL de l’enseignant, il faut que les élèves y mettent du leur et que l’enseignante noue l’ensemble.
On observera quatre configurations différentes :
a) Dans la première, TdL de l’élève et TdL de l’enseignante sont compatibles et celui de l’élève est intégré au TdL de la classe. Au début de la séance, l’enseignante demande de relever les points communs et les différences entre la version «connue» du Petit Chaperon Rouge et Le Petit Chaperon Uf :
17. Élève : Ça se passe dans la forêt ?
L’enseignante réplique :
18. Enseignante: Ça se passe dans…Hmm, ça se passe dans la forêt, c’est indiqué ou pas ? On sait pas trop. Mais t’as raison, il dit «Faire respecter loi dans bois parc jardin»11. J’y avais pas pensé mais ça indique, ça induit que ça se passe dans un parc. Bon, donc on retrouve les personnages, le contenu et puis le décor…
Ici le TdL de l’élève («Ça se passe dans la forêt?») réactive et oriente le TdL de l’enseignante («J’y avais pas pensé mais ça indique, ça induit que ça se passe dans une parc.») et peut devenir un élément du TdL de la classe («Bon, donc on retrouve les personnages, le contenu et puis le décor…»).
On voit comment fonctionne, entre acculturation scolaire (mettre les textes en réseau à partir d’un relevé d’indices) et caractéristiques du genre (l’utilisation du langage comme spécificité du théâtre), le jeu des sollicitations et des attentes entre les acteurs. Quand l’élève déclare: «Ça se passe dans la forêt?», il est difficile de savoir si l’élève répond à une question du type «Où se passe (traditionnellement) l’histoire du Petit Chaperon Rouge?» ou s’il a inféré le mot «forêt» de la formule utilisée par le loup dans la pièce : «bois parc jardin». Après une reprise dubitative («Ça se passe dans…Hmm, ça se passe dans la forêt, c’est indiqué ou pas? On sait pas trop»), l’enseignante valorise la réponse de l’élève. Elle agira de même avec une autre élève :
25. Élève : Ben que là elle est pressée alors que l’autre elle cueille des fleurs
26. Enseignante : Ah oui, très bien ! La petite fille est pressée, tiens j’avais pas pensé à ça, j’avais pas noté cette différence…
Dans ces deux cas de figure, les propositions des élèves sont explicitement ajoutées au TdL de l’enseignante. Elles sont accueillies positivement, valorisées et permettent aussi de construire une représentation du TdL de la classe effectivement nourrie des apports des élèves. Ici, le TdL de la première élève et le TdL de la seconde, qui ne contreviennent pas au TdL de l’enseignante, sont intégrés au TdL de la classe: il s’agit ici de lire le Le Petit Chaperon Uf comme une réécriture du Petit Chaperon Rouge.
b) La deuxième situation exemplifie un moment où TdL de l’élève et TdL de l’enseignante sont compatibles (le TdL de l’élève est acceptée par l’enseignante) mais le TdL de l’élève n’est pas intégré au TdL de la classe. La question de la référence historique, on l’a vu, est fortement minorée dans le TdL de l’enseignante. Et elle n’est pas présente dans les propos des élèves sauf à la fin de la séance, quand les élèves ont le livre entre les mains. L’échange s’instaure d’ailleurs à l’initiative d’un élève.
187. Élève : [montrant une illustration du livre] Madame, il est habillé un peu comme les nazis.
188. Enseignante : Oui, il est habillé carrément comme les nazis. Dans l'illustration, c'est montré … il est habillé comme un officier avec un long manteau, des bottes, quelque chose de militaire. Moi quand on lit le texte, j'ai l'impression que ce Petit Chaperon Uf il prend plus de place que celui qui est dessiné sur l'image – vous trouvez pas ? Alors, avant de mettre … Enfin vous collez votre petit texte et vous mettez … Qui est fort qui est faible, finalement. On colle ça et on se dépêche, allez !
Dans cet échange, l’élève accède potentiellement à une lecture du texte prenant en compte la référence historique. L’enseignante, tout en validant sa lecture de l’image («Oui, il est habillé carrément comme les nazis. Dans l'illustration, c'est montré»), ne propose pas de lecture du texte et n’intègre pas le propos dans un TdL de la classe. Elle ignore le TdL de l’élève (Wolf est un nazi) et va lui substituer son TdL, qui s’exprime dans la suite de l’échange. D’une part, elle l’oppose à celui de l’illustrateur en affirmant une lecture singulière («Moi, j’ai l’impression»). D’autre part, elle institutionnalise la question du rapport fort/faible. La proposition de l’élève ne nourrit pas le texte collectif parce que le TdL de l’élève entre en concurrence avec le TdL de l’enseignante. Sans être totalement rejeté, cette interprétation n’est pas discutée, elle est ignorée, parce que ce qui importe pour l’enseignante –conformément à ce que l’analyse de son TdL nous a appris– ce n’est pas la référence historique mais le rapport fort/faible.
c) Dans la troisième situation, le TdL de l’élève devient le TdL la classe.
192. Enseignante : Bon, est-ce que ce texte il dit ça, est-ce qu'il met ça en scène12 ?
193. Élèves : Non.
194. Enseignante : Non, pourquoi ?
195. Élève : La loi déjà, c'est pas vrai …
196. Enseignante : Ah, c'est pas vrai, le loup en fait abuse de quelque chose. D'accord, moi je l'avais pas vu comme ça, pour moi dans le texte c'était vrai ça. Mais vous avez raison de dire que c'est plutôt aux yeux du loup … Le loup impose une loi injuste mais qui n'est pas la vérité. D'accord. Pourquoi pas. Donc on le souligne ou pas ?
197. Élèves : Non Oui
198. Enseignante : Vous vous l'avez souligné ? Moi je l'aurais souligné. Quand j'ai fait l'exercice, je l'ai fait comme ça dans ma tête. Mais vous vous le lisez autrement, vous voyez que les lois du loup sont … Pas des lois partagées par tous mais juste les siennes, finalement.
Autrement dit, le TdL de l’enseignante, la lecture programmée du texte est contredite par la lecture de l’élève qui affirme qu’il n’existe pas de loi et que le loup l’a inventée pour abuser la petite fille. «Vous le lisez autrement» dit l’enseignante, semblant attribuer à l’élève la capacité à mettre en mots le TdL de tous les élèves, lors même qu’en 197, on observe justement que les élèves ne sont pas tous d’accord. De fait, à la toute fin de la séance, un autre élève affirme: «Pour moi, il détient pas la loi parce que c’est une fausse loi».
Les deux entretiens permettent de revenir sur ce qui se passe à ce moment-là. Durant l’entretien d’autoconfrontation, l’enseignante propose une lecture du texte bien différente de celle qu’elle a acceptée: «La loi existe, affirme-t-elle, et il en est l'exécutant et il applique … Il est l'exécutant d'une loi injuste mais qui…». Elle continue: «Donc là c'est intéressant parce que, finalement, ils mettent en cause le bien-fondé d'une loi même si elle est injuste. Enfin, ils remettent en cause le système quoi? Donc moi je trouvais ça intéressant comme hypothèse, finalement, aussi dans leur bouche».
Dans l’entretien croisé avec une jeune enseignante de CM2, la question revient et l’on observe que dans les deux classes, les élèves ont dit la même chose : «son code d’Uf, c’est même pas une vraie loi, c’est lui qui l’a inventée». «J’avais l’impression, dit la professeure des Écoles, que cette loi, elle était tellement impensable et inimaginable pour eux». Mais l’enseignante de 6ème va plus loin :«C’est une façon de la désamorcer, de la mettre à distance. Comme insupportable. De pouvoir en parler d’une façon ou d’une autre». On comprend ainsi que l’enseignante valide la mécompréhension de l’élève en 196, soit en réécrivant son TdL («ils mettent en cause le bien-fondé d’une loi») soit en le justifiant («c’est une façon de la mettre à distance»). Dans le meilleur des cas, cette validation de la lecture de l’élève relève du malentendu et conduit au malentendu, pour ne pas dire au contresens.
Quoi qu’il en soit, c’est le TdL de l’élève qui devient TdL de la classe parce qu’il est compatible avec le TdL de l’enseignante. En effet, ce qui importe c’est le rapport fort/faible. Que le loup soit un nazi ou un escroc ne change finalement pas la donne.
d) Or, et c’est notre quatrième situation, il est assez évident que les élèves rechignent un peu à cette lecture. L’échange suivant intervient à la fin de la séance, juste avant le bouclage qui va s’effectuer par le biais d’affirmations qu’il faut valider ou invalider (annexe 2). Se formule par le biais de cette activité un discours commun, un TdL de la classe. Il n’est pas étonnant que l’enseignante veuille s’assurer de la compréhension de ce qui est orienté par son TdL.
172. Enseignante : Comment il apparait dans ce deuxième extrait ? Comment … Quels traits de caractère il a, quels défauts il a ?
173. Élève : Méchant.
174. Enseignante : Méchant, oui. Continue, explique pourquoi ?
175. Élève : Parce qu'il prend ce qu'elle veut donner à sa grand-mère.
176. Enseignante : Ok, d'accord. Voleur, méchant, ok. Alexandra ?
177. Élève : Ben en fait, il fait croire que … Au Petit Chaperon Rouge que le beurre c'est interdit et en fait il en profite pour … Il en profite pour manger …
178. Enseignante : voilà, pour son intérêt personnel, comme on dit. Très bien. Il fait vraiment … C'est vraiment un fort, mais il utilise pas sa force, son autorité pour le bien. Il utilise sa force, son autorité pour son intérêt personnel. Et est-ce qu'elle se laisse faire la petite ?
179. Élèves : Non.
180. Enseignante : Pas du tout. Alors donnez-moi des exemples qui montrent qu'elle se laisse pas faire.
181. Élève : Elle dit « non non non, c'est pour mère-grand ».
182. Enseignante : D'accord, donc elle se défend, elle défend son bien. Elle insiste euh … Elle se moque un peu de lui ou pas ?
183. Élève : Non.
184. Enseignante : Non ?
185. Élève : Elle est plutôt sérieuse.
186. Enseignante : Elle est sérieuse, donc elle se moque pas de lui ? Alors ça c'est un point qu'on va travailler.
Des répliques 174 à 183, l’enseignante valide les réponses des élèves par des «oui», «OK», «d’accord»… Un consensus s’opère autour du loup incarnant la force : «c’est vraiment un fort». La question concerne ensuite la manière dont réagit la fillette. Un nouveau consensus apparait concernant le fait qu’elle tente de se défendre «D’accord, elle se défend». En 182, l’enseignante pose la question centrale : «elle se moque un peu de lui ou pas?». Une élève répond clairement négativement et, malgré l’interrogation rhétorique de l’enseignante, développe son propos : «Elle est plutôt sérieuse». L’enseignante parait surprise de la réponse et nous sommes en toute fin de séance. Quoi qu’il en soit, on observe une forme de dissensus interprétatif que l’enseignante n’accepte pas. Le TdL de l’élève est ici incompatible avec le TdL de l’enseignante.
Si l’on se situe dans une perspective strictement pédagogique ou même didactique, il est difficile de comprendre pourquoi à certains moments l’enseignante accueille la parole des élèves et les engage dans une co-construction des significations tandis qu’à d’autres moments elle va l’ignorer ou même la rejeter. Le recours au concept de TdL permet de comprendre que l’enseignante accueille le TdL des élèves au regard de son TdL.
Mais l’orientation des échanges s’opère au risque, nous l’avons vu, du malentendu voire du contresens. Or, nous l’avons vu aussi grâce à l’entretien, ce contresens accepté («il a inventé la loi») ne l’est pas au regard de la lecture de l’enseignante. Elle-même lit parfaitement le texte («la loi existe, il en est l’exécutant, il l’applique»). On peut expliquer le phénomène parce que cette lecture-là («il est l’exécutant de la loi nazie») ne correspond pas au TdL de l’enseignante, dans le sens que nous avons proposé, c’est-à-dire du texte donné à lire aux élèves.
Ainsi, le recours au concept de TdL décliné dans ses trois modalités (TdL des élèves, TdL de l’enseignant·e, TdL de la classe) permet de comprendre ce qui se joue dans la séance. De manière plus hypothétique13, on peut envisager que le jeu entre les TdL soit une des pistes de compréhension de ce qui se joue dans la classe de littérature. La mise au jour du TdL de l’enseignant·e apparait alors comme une nécessité méthodologique.
Quoiqu’il en soit, nous proposons d’en tirer quelques éléments susceptibles de circonscrire les contours de la lecture littéraire professionnelle.
3. La lecture littéraire professionnelle
3.1. La gestion des TdL comme marqueur d’expertise
Les quatre situations décrites dans la séance analysée montrent que la lecture littéraire dans la classe engage la professionnalité de l’enseignant dans sa capacité à trouver ou non des compromis entre les différents TdL. Qu’il soit plus ou moins accepté et compatible avec le TdL de l’enseignant, c’est le Tdl des élèves qui conditionne la dynamique de la lecture. Autrement dit, c’est la prise en compte de la parole des élèves et la régulation de cette parole qui décide de la co-construction d’un TdL de la classe.
De fait, la lecture d’un texte littéraire en classe s’organise autour d’un ensemble de possibles : les possibles du texte (ce qu’il donne à lire), de l’enseignant·e (ce qu’il lit dans le texte et décide de mettre au travail dans la classe), des élèves (leurs propositions de lecture), de la situation de lecture (ce que les activités proposées à partir du texte et les interactions produisent). La gestion de ces possibles, plus ou moins ajustés et explicités, implique quatre niveaux d’expertise. Le premier consiste à avoir une lecture du texte et de son exploitation pédagogique et didactique la plus précise possible. Pour autant, le deuxième niveau d’expertise doit éviter d’imposer le TdL de l’enseignant·e car il vise d’abord l’émergence du TdL des élèves en anticipant les problèmes de compréhension, en ouvrant des espaces d’interprétation et de débat. D’où la difficulté, troisième niveau d’expertise, de mesurer précisément et constamment au cours de la séance les écarts entre le TdL de l’enseignant·e et le TdL des élèves et d’ajuster, quatrième niveau d’expertise, ces différents TdL par un jeu de valorisation, de refus ou de négociation pour parvenir à élaborer un TdL de la classe.
Cette expertise ne se réduit donc ni à une expertise littéraire, à l’instar de ce que proposait l’Association Française pour la Lecture (AFL) avec ses «lectures expertes», ni à une expertise pédagogique susceptible d’accueillir la parole des élèves. Elle opère à partir d’un savoir-faire didactique qui conçoit la lecture littéraire comme plurielle et située.
3.2. Les TdL… comme « possibles d’action »
Cette caractérisation nous conduit à faire trois remarques. La première consiste à reconnaitre qu’il est problématique de dissocier ou de prioriser la part proprement personnelle que laisse entendre l’expression texte du lecteur de… et la part scolaire, toujours dépendante d’un contexte de lecture fortement situé. Il nous parait difficile, au regard de l’analyse proposée, d’adhérer totalement à la proposition formulée par les promoteurs du concept de TdL en contexte didactique:
Pour ces derniers [les enseignants], il s'avère plus que jamais nécessaire d'admettre que les sujets lecteurs qu'ils sont investissent des parts notables de cette subjectivité dans leur pratique enseignante, apportant et fabriquant, dans l'espace intersubjectif de la classe et à travers les interactions vivantes qui s'y jouent, des textes de lecteurs dont il convient d'explorer la texture (Fourtanier, Langlade & Mazauric 2011 :13).
C’est précisément parce que l’espace est irréductiblement «intersubjectif» que dans l’entrelacs des «interactions vivantes», les «réalisations» effectives produisent certes des TdL mais des textes dont «les parts notables de subjectivité» se diluent dans ce qui apparait alors comme un interdiscours flottant (amalgame de TdL sans véritable cohérence, sans véritable partage, sans manifestation de l’intime), radical (seul s’éprouve et se vérifie le TdL de l’enseignant), coupé de toute subjectivité (le TdL de la classe comme institutionnalisation programmée) ou fédérateur (le TdL de la classe venant en quelque sorte subsumer toutes les subjectivités).
Le verbatim de la séance et des entretiens montre à quel point il est difficile d’isoler les traces d’une activité de lecture subjective contraintes du genre discursif scolaire auxquelles cette subjectivité est soumise (Maingueneau 1991).
Cela vaut pour l’enseignant : sa lecture subjective du texte (le rapport de force entre le loup et le Petit Chaperon Uf) influence, mais peut aussi être influencée par ce qui se passe en classe (le problème de la loi). Cela vaut aussi pour les élèves : leur lecture subjective influence et peut être influencée par les modalités du travail qui leur est proposé14.
La deuxième remarque met également en question la notion de sujet didactique. Parlant de l’élève, Reuter le situe «dans le système didactique, c’est-à-dire dans une relation explicite, formelle, institutionnelle, à des savoirs disciplinairement médiés par le maitre» (Reuter 2007 : 92). Reprenant cette définition, Daunay (2007 : 43) rappelle que «ce sujet ne saurait être un simple calque du sujet épistémique (concerné par le seul rapport au savoir) mais intègre d’autres dimensions, sociales, affectives, psychologiques, cognitives» et propose la notion de «sujet lecteur en didactique». Pour autant, faut-il s’en tenir à la seule emprise didactique? Même si l’on adopte cette conception intégratrice de la didactique, une séance de lecture littéraire, comme toute séance d’enseignement, comporte à côté des «déterminants didactiques» des «déterminants pédagogiques» (Mauroux, David & Garcia-Debanc 2015) impliquant différents niveaux de gestion, du temps, des tâches, du climat de classe, des interactions…, qui débordent la part didactique autant qu’ils impactent la formation des TdL.
La troisième remarque tient aux cadres théoriques mobilisés dans le projet TALC, qui ont comme objet l’analyse de l’activité. Il s’agit d’abord de penser avec Clot que «le réel de l’activité possède un volume dont l’activité réalisée par un opérateur n’est jamais que la surface» (2004 : 31), ce qui, sans l’annuler, limite toute interprétation sur la constitution de tel ou tel texte du lecteur. On peut aussi envisager la lecture littéraire comme «cours d’action» (Theureau 2004), combinant des actions individuelles de l’enseignant et des élèves soumises à des préoccupations –c’est-à-dire à «ce que l’acteur cherche à faire à un instant t», «selon ce qui fait signe pour lui»– et reconnaitre que «le lien entre l’accomplissement situé de l’action et ses composantes intentionnelles est conçu comme ouvert et indéterminé» (Veyrunes, Gal-Petifaux & Durand 2007 : 61), ce qui là encore fragilise une conception trop figée des textes de lecteur ou de la notion de sujet lecteur en contexte scolaire! On peut enfin souligner, s'agissant du texte de lecteur de l'enseignant et de la possibilité de définir le professeur comme «sujet lecteur professionnel», que ce texte est fortement dépendant de la manière dont la séance est menée et par conséquent dont l'action est, dans chaque situation de lecture, conceptualisée (Pastré, 2011 : 149-181).
Caractéristique de la lecture littéraire comme lecture professionnelle, la dynamique de l’activité résiderait donc bien dans l’articulation des «possibles d’action» (Veyrunes, Gal-Petifaux & Durand 2007 : 61) où s’originent les différents TdL, dès lors que chaque acteur adopte telle ou telle posture définie comme «schème préconstruit du “penser-dire-faire” que le sujet convoque en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée», posture par conséquent «relative à la tâche mais construite dans l’histoire sociale, personnelle et scolaire du sujet» (Bucheton & Soulé : 2009 : 38).
Bibliographie
Barbier, Jean-Marie & Marc Durand (2003), « L’activité : un objet intégrateur pour les sciences sociales ? », Recherche & Formation, n°42, p. 99-117.
Barthes, Roland (1970), S/Z, Paris, Le Seuil, « Points ».
Bayard, Pierre (2011) « Julien Sorel était-il noir ? » in F. Legoff et M.-J. Fourtanier (dir.), Les formes plurielles des écritures de la réception, Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 11-17.
Bellemin-Noël, Jean (2001), Plaisirs de vampire, Paris, Presses Universitaires de France.
Brinker, Virginie & Geneviève Di Rosa (2018), « Les enjeux d’un enseignement de la littérature avec et au-delà des programmes », Le français aujourd'hui, n°202(3), pp. 5-10. DOI : 10.3917/lfa.202.0005.
Bucheton, Dominique & Yves Soulé (2009), « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Éducation & Didactique, n°3(3), pp. 29-48.
Capt, Vincent, Brunel, Magali & Sonya Florey (2018), « Les valeurs éthiques en jeu dans les classes francophones de littérature », Repères, n°58, p. 99-118.
Clot, Yves (2004), « Action et connaissance en clinique de l’activité », Activités, n°1(1), en ligne, consulté le 27 novembre 2019, URL : http://journals.openedition.org/activites/1145 ; DOI : 10.4000/activites.1145.
Daunay, Bertrand (2007), « Le sujet lecteur : une question pour la didactique du français », Le français aujourd'hui, n°157(2), p. 43-51. DOI :10.3917/lfa.157.0043.
Dufays, Jean-Louis (1994), Stéréotype et lecture, Liège, Mardaga.
Eco, Umberto (1985), Lector in fabula, Paris, Grasset.
Escola, Marc (2003), Lupus in fabula. Six façons d’affabuler La Fontaine, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes.
Flandin, Simon, Leblanc, Serge & Alain Muller (2015), « Vidéoformation "orientée-activité" : quelles utilisations pour quels effets sur les enseignants », Raisons Éducatives, p. 179-198.
Fourtanier, Marie-José, Gérard Langlade & Catherine Mazauric (dir.) (2011a), Textes du lecteur en formation, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Théo’Crit ».
Fourtanier, Marie-José, Gérard Langlade & Catherine Mazauric (dir.) (2011b), Le texte du lecteur, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Théo’Crit ».
Fourtanier, Marie-José (2017), « "Sujet lecteur", "texte du lecteur" : des concepts dynamiques pour la formation d’enseignants », in Le Sujet lecteur-scripteur de l’école à l’université, J.-F. Massol (dir),Grenoble, UGA, p. 75-87.
Goulet, Marcel (2011), « Textes singuliers et texte commun », in Le texte du lecteur, M.-J., Fourtanier, G. Langlade & C. Mazauric (dir.),Bruxelles, Peter Lang, coll. « Théo’Crit », p. 65-75.
Grumberg, Jean-Claude (2005), Le petit chaperon Uf, Arles, Actes-Sud / théâtre de Sartrouville.
Hamon, Philippe (1977), « Texte littéraire et métalangage », Poétique, n°31, p. 261-284.
Le Goff, François & Marie-José Fourtanier (dir.) (2017), Les formes plurielles des écritures de la réception, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2 vol..
Louichon, Brigitte (2016), « Dix ans de Sujet lecteur » in Didactique du français et de la littérature, « Recherches Textuelles », n°14, p. 403-422.
Maingueneau, Dominique (1991), L'Analyse de discours, Paris, Hachette.
Mauroux, Florence, David, Jacques & Claudine Garcia-Debanc (2015), «Analyse des actions et interactions didactiques en production écrite au Cours préparatoire », Repères, n° 52, p. 112-142.
Ministère de l’Éducation Nationale (2007), La Littérature à l’école. Liste d’œuvres pour le cycle 3.
Ministère de l’Éducation Nationale (2015), Programmes cycle 2, 3 et 4.
Otten, M. (1990), « Sémiologie de la lecture », in Méthodes du texte, M. Delcroix & F. Hallyn (dir.), Louvain-La-Neuve, Duculot, p. 340-350.
Pastré, Pierre (2011), La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes, Paris, Presses Universitaires de France, « Formation et pratiques professionnelles ».
Piacentini, M. (2015), « Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg : écrire pour alerter les chaperons d’aujourd’hui », Recherches & Travaux, n°87, p. 105-116.
Plissonneau, Gersende, Bazile, Sandrine & Christine Boutevin (2017), La lecture analytique à la fin du collège : un exercice de lecture littéraire ? Points de vue d’enseignants, regards d’élèves. Repères, n°56, p. 91–108.
Reuter, Yves (2007), Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Bruxelles, De Boeck.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bern, Peter Lang, coll. « ThéoCrit ».
Rouxel, Anne & Gérard Langlade (dir.) (2004), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Schawlky-Milcent, Bénédicte (2017), « Écriture d’une lecture et lecture de soi : du texte du lecteur à la création du lecteur », in Les formes plurielles des écritures de la réception, F. Le Goff & M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses Universitaires de Namur, vol. 2, p. 35-47.
Schneuwly, Bernard (2009), « L’objet enseigné », in Des objets enseignés en classe de français, B. Schneuwly & J. Dolz (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 17-28.
Theureau, Jacques (2004), Le cours d’action : méthode élémentaire, Toulouse, Octarès.
Veyrunes, Philippe, Gal-Petitfaux, Nathalie & Marc Durand (2007), « La lecture orale au cycle 2 : configuration et viabilité de l'activité collective dans la classe », Repères, n°36, p. 59-76.
Annexe 1: Le Petit Chaperon Uf, J.-C. Grumberg, édition Flammarion « Étonnantissimes », p. 31-40
Demande en cours pour l'obtention des droits de reproduction auprès de la maison Flammarion.
Annexe 2 : Déroulé synthétique de la séance Le Petit Chaperon Uf, J.-C. Grumberg, édition Flammarion « Étonnantissimes», p. 31-40 – durée : 48 minutes.
La lecture analytique de l’extrait est la deuxième séance d’une séquence autour de l’entrée du programme « Résister au plus fort » menée au mois de janvier. Le titre donné par l’enseignante à la séance, « Le plus faible a des ressources », semble ouvertement programmatique. La fiche de préparation a pour objectif déclaré d’« observer comment le langage (genre théâtral) permet de mettre à distance la puissance mal placée du plus fort et de donner une place au faible » ; les compétences visées sont essentiellement liées à la découverte du genre hybride de l’œuvre : « lire et comprendre un texte théâtral / Se préparer à l’écriture théâtrale / Lire et comprendre une parodie ».
L’activité réalisée antérieurement à la maison par les élèves (phase 0) consiste en la lecture personnelle d’une partie de l’extrait (seule les pages 31- 34 ont été photocopiées) assortie de trois questions : il s’agit d’abord de retrouver les « ingrédients du conte dans ce texte et comment ils sont revisités » et de chercher dans un dictionnaire de langue vivante le « mot LOUP en anglais / allemand / catalan / espagnol » ; une question générale porte également sur le genre : « à quoi reconnait-on un texte de théâtre ? »
Déroulement de la séance :
Phase 1 – Présentation de la séance par l’enseignante. Le titre et la problématique apparaissent vidéoprojetés : « quelles ressources trouve le plus faible face au plus fort ? » – (1’) Tours de parole 1 à 2.
Phase 2 – Lecture oralisée (prise en charge par les élèves) de la première partie de la scène à « Qu’est-ce que mademoiselle Uf transporte dissimulé dans petit panier osier ? » – (2’) Tour de parole 3.
Phase 3 – Annonce par l’enseignante du déroulé de la séance autour de deux axes forts qui correspondent à un double projet de lecture : percevoir « les différences avec le conte traditionnel » et comprendre « comment s’organise le rapport de force entre les deux » personnages, premières questions portant sur les impressions de lecture des élèves sur les personnages – (2’) Tours de parole 4 à 10.
Phase 4 – Cours dialogué avec synthèse écrite intermédiaire sous la forme d’une prise de note partielle en fin de phase, retour sur le travail préparatoire réalisé par les élèves à la maison – (15’) Tours de parole 10 à 122 :
- 4.1 L’enseignante consigne et vidéoprojette les points communs et différences entre hypotexte et hypertexte au fur et à mesure des propositions des élèves (tours de parole 10 à 38) ;
- 4.2 À partir des réponses des élèves, l’enseignante oriente la réflexion des élèves sur trois points qu’elle commente : le langage de Wolf (4.2.1 tours de parole 39 à 56), le contexte historique (4.2.2 tours de parole 56 à 70) et la notion de parodie (4.2.3 tours de parole 74 à 82) ;
- 4.3 L’enseignante note au tableau blanc les propositions de traduction du mot « loup » dans différentes langues (tours de parole 84 à 102) ;
- 4.4 L’enseignante note au tableau blanc les caractéristiques de la forme théâtrale énumérées par les élèves (tours de parole 102 à 122).
Phase 5 –Réfléchir « mentalement » à ce qui va se passer après le passage (après la découverte de ce que cache le Petit chaperon Uf) et mise en commun – (6’) Tours de parole 122 à 157.
Phase 6 – Lecture oralisée (prise en charge par les élèves) de la suite de l’extrait après distribution du livre – (7’) Tours de parole 158 à 165.
Phase 7 – Cours dialogué centré sur les personnages (« langage » du loup, « traits de caractère », intentions, force / faiblesse) – (2’) Tours de parole 166 à 188.
Phase 8 – Activité, distribution d’une feuille comportant cinq affirmations, avec la consigne : « surligne celles qui correspondent bien au texte et recopie un exemple tiré du texte pour les justifier » – (11’ dont 6’ de recherche individuelle) Tours de parole 188 à 216.
Affirmations proposées par l’enseignante :
- Le Petit Chaperon fait partie d’un groupe, les Ufs, qui n’ont aucun droit
- Le Petit Chaperon ne se laisse pas faire : elle est maline, elle conteste ce que dit le loup
- Le loup intimide le Petit Chaperon qui n’a qu’une envie, fuir
- Le loup est méchant et bête ce qui est visible dans ses paroles : il est fort car il détient la loi mais l’utilise pour intimider et se satisfaire lui-même
- Le ton est comique : le loup est glouton, bavard, il s’exprime dans un langage brutal et incorrect
Phase 9 – (Après la sonnerie) Distribution d’une feuille photocopiée faisant la synthèse des éléments caractéristiques du texte théâtral, tentative avortée de bilan final oral de l’enseignante sur le rapport de force entre les deux personnages, prise de note du travail à faire pour le mardi suivant : « Imaginez quelques répliques de théâtre quand le loup arrive chez la mère-grand. Gardez le même ton. » – (2’) Tour de parole 217.
Pour citer l'article
Brigitte Louichon, Sandrine Bazile & Yves Soulé, "La lecture littéraire professionnelle : une configuration dynamique de textes de lecteurs", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/la-lecture-litteraire-professionnelle-une-configuration-dynamique-de-textes-de-lecteurs
Voir également :
Introduction n°2 - La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
Le présent numéro fait état de plusieurs études qui témoignent d’une circulation réussie entre la recherche et l’enseignement, au sein des approches didactiques de la littérature. Les disciplines didactiques, en raison de leur double destinataire – les praticiens de l’enseignement et les chercheurs –, sont enrichies par la collaboration possible de deux corps aux méthodes et aux finalités distinctes. Les textes présents dans ce numéro esquissent des solutions pour permettre la circulation des savoirs, en invitant les différents acteurs impliqués à dialoguer. Les modalités de ce dialogue convoquent dans ce numéro des apports prioritairement théoriques, pour recenser, décrire et analyser des pratiques enseignantes, dans un rapport d’égalité et de réciprocité{{Un prochain numéro de Transpositio, coordonné par Vincent Capt et Antje Kolde, traitera de la thématique de la circulation des savoirs, en privilégiant le point de vue des pratiques enseignantes : il portera plus spécifiquement sur les outils que les chercheurs et les enseignants ont mis en place pour concrétiser une forme de collaboration entre recherche et pratiques enseignantes.}}.
Introduction n°2 - La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
Didactique de la littérature : quand théorie et savoirs pratiques contribuent à la construction des savoirs
Le présent numéro fait état de plusieurs études qui témoignent d’une circulation réussie entre la recherche et l’enseignement, au sein des approches didactiques de la littérature. Les disciplines didactiques, en raison de leur double destinataire –les professionnels de l’enseignement et de la recherche–, sont enrichies par la collaboration possible de deux corps aux méthodes et aux finalités distinctes. Les textes présents dans ce numéro esquissent des solutions pour permettre la circulation des savoirs, en invitant les différents acteurs impliqués à dialoguer. Les modalités de ce dialogue convoquent des apports prioritairement théoriques, pour recenser, décrire et analyser des pratiques enseignantes, dans un rapport d’égalité et de réciprocité1.
Quatre orientations ont été choisies par nos auteurs. La réflexion méthodologique autour de la notion de disciplinarisation de la didactique de la littérature en relation avec d’autres disciplines (notamment les sciences de l’éducation et la didactique du français) (Daunay); le parcours historique visant à redécouvrir et à discuter des pratiques enseignantes d’antan dans l’enseignement de la langue et de la littérature (Darme, Monnier & Tinembart pour le français langue première et Raimond pour le français langue étrangère); la convocation de savoirs en théorie littéraire mis à contribution de l’enseignement pour repenser les modèles d’analyse littéraire utilisés par les enseignant·e·s (Baroni); enfin la description d’une modalité de recherche collaborative entre chercheuses et enseignantes qui vise à analyser la mobilisation de la notion théorique de texte du lecteur dans les pratiques de classe (Louichon, Bazile & Soulé).
Du clivage à la circulation
Les articles sont issus d’une sélection de communications présentées lors des 19e Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature qui se sont déroulées à Lausanne du 21 au 23 juin 2018. Partant du constat décrit par Bertrand Daunay et Yves Reuter (2008) qu’un malentendu historique existe relativement à la dimension praxéologique de la didactique, souvent ramenée à un avatar de l’applicationnisme, «entre les savoirs (construits ou convoqués) pour la recherche didactique (qui ne sont pas censés quitter le cadre théorique où ils prennent sens) et les savoirs pour l’enseignement» (Daunay & Reuter 2008 : 57), ce colloque visait à questionner les modalités qui permettent d’engendrer une circulation entre la recherche et les pratiques enseignantes.
Si un consensus existe sur les avantages d’un dialogue réciproque entre les deux corps professionnels, les résultats d’études récentes en didactique du français ont montré que peu de travaux de didacticiens sont exploités par les enseignant·e·s dans la classe de français (Garcia-Debanc & Dufays 2008 ; Chartrand & Lord 2013). Les résultats documentés par la recherche ne seraient que rarement lus par le corps enseignant et ne conduiraient guère à faire évoluer certaines pratiques considérées comme inefficientes. Inversement, certaines questions des enseignants n’intéresseraient pas les chercheurs, ou encore, les besoins identifiés par le terrain seraient parfois compris et traduits de manière erronée par la recherche, dont les réappropriations deviennent alors les réécritures infidèles des problèmes observés dans la classe.
Le risque d’un possible éloignement entre la recherche et la pratique nous invite ainsi à interroger ce qui permet et favorise la circulation des savoirs: au-delà des orientations, des finalités et des perspectives que se donne la discipline, quel partage de savoirs, de concepts, d’objets et de méthodes observe-t-on entre la pratique enseignante et la recherche en didactique de la littérature? Pour le dire autrement, si le lectorat escompté des résultats de la recherche en didactique de la littérature est composé autant de chercheurs et de chercheuses que d'enseignant·e·s, le lectorat réel des mêmes textes correspond-il à cette ambition?
Plusieurs indices nous ont effectivement laissé penser que ce double destinataire des recherches en didactique était parfois atteint, à différents niveaux, contribuant ainsi à créer les conditions d’une possible circulation. D’où notre volonté de questionner ces conditions mêmes, par l’analyse de leurs modalités, de leurs objectifs, de leurs réussites ou de leurs échecs. Les objets d’étude, s’ils ont été souvent définis par les chercheurs et chercheuses, sont de plus en plus choisis en fonction des tensions signalées par les enseignant·e·s, voire même déterminés avec ces derniers, équilibrant ainsi les dimensions théoriques et praxéologiques (Dufays 2001). Certains dispositifs de recherche, tels que la recherche-action (Kervyn 2011) ou la recherche orientée par la conception (Sanchez & Monod-Ansaldi 2015), associent les professionnels de l’enseignement et de la recherche à toutes les étapes du processus: organisés autour de problèmes identifiés par les enseignant·e·s, ces deux dispositifs articulent des phases de conception de séquences d’enseignement relatives à un objet de savoir, par exemple, et des phases de mise en œuvre, enrichies par une logique itérative et des analyses critiques censées faire évoluer la séquence d’enseignement vers une réponse au problème posé.
Autre exemple, les recherches théoriques en didactique de la littérature, qui ont dominé le champ disciplinaire depuis les années 1990, laissent la place, depuis une dizaine d’années, à des recherches qui s’intéressent plus intensément aux pratiques réelles et non plus seulement aux pratiques déclarées ou supposées (Daunay & Dufays 2007 ; Dufays & Brunel 2016): les recherches dites descriptives se posent en condition nécessaire pour réfléchir, de manière pertinente et scientifique, aux enjeux de la didactique de la littérature. Enfin, s’intéressant aux innovations pédagogiques et aux facteurs favorisant leur intégration heureuse en contexte scolaire, autrement dit au trajet d’un résultat de recherche à sa réappropriation dans la classe, Goigoux (2017) cite une étude anglo-saxonne (Tyack & Cuban 1995) qui définit un subtil équilibre entre la compatibilité de l’élément nouveau avec les schèmes professionnels des enseignant·e·s et l’efficience de l’intervention.
Dans les pistes esquissées pour que recherches et pratiques dialoguent, on peut en citer deux qui semblent tout particulièrement pertinentes pour notre problématique: la première consiste à «construire un partenariat structuré et soutenu entre les praticiens et les chercheurs» et la seconde propose de «partir des préoccupations des praticiens pour déterminer les problématiques de recherche» (Goigoux 2017 : 137). Ces principes recommandent de considérer les apports de chaque groupe d’acteurs comme d’égale valeur et de connaître le contexte et les exigences du terrain de l’autre, ainsi que de valoriser les démarches ascendantes, faisant émerger de nouvelles questions de recherche à partir des problèmes professionnels rencontrés par les enseignant·e·s.
À un certain niveau, donc, les conditions semblent réunies pour favoriser un partage de savoirs théoriques ou praxéologiques entre les enseignant·e·s et les chercheurs. Les contributions des 19e Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature –dont ce numéro n’est qu’un petit aperçu– nous ont montré que cette circulation est possible, qu’elle est même déjà active à plusieurs niveaux et selon des modalités variées, et que les acteurs en présence la souhaitent et s’investissent pour la poursuivre.
Les articles qui suivent explorent et dépassent les écarts supposés entre les différents acteurs, contextes et visées du champ de recherche et permettent ainsi d’instaurer et d’analyser une circulation entre trois instances et trois groupes d’acteurs: les recherches en didactique des littératures, les recherches dans les savoirs fondamentaux en littérature et les pratiques enseignantes.
La question de la circulation entre recherche et pratiques enseignantes est posée d’emblée par le texte de Daunay, qui, en guise d’introduction au numéro, en élargit le point de vue à l’identité même de la discipline. Pour l’auteur, la question a accompagné de manière récurrente l’émergence et l’histoire de la didactique de la littérature, parce qu’elle participe à construire l’identité des didacticiens. Ainsi, Daunay interroge et contextualise l’autonomie de la didactique en décrivant ses relations à trois instances extérieures (les théories de référence, l’institution scolaire et la pratique enseignante). S’il montre successivement les risques d’une subordination aveugle à ces dernières, il évoque également l’intérêt d’une autonomie adéquatement pensée dans chacun de ces trois espaces.
Les deux articles suivants témoignent de l’importance de recourir à une perspective historique pour analyser textes, outils et moyens pour l’enseignement. L’article de Darme, Monnier et Tinembart met en relation les savoirs en littérature et les pratiques enseignantes et propose une analyse détaillée des moyens d’enseignement adoptés en Suisse francophone entre 1850 et 1930. À travers des citations des manuels de l’époque, il est possible de reconstruire les discours sur la littérature et sur son enseignement, leurs enjeux et leurs évolutions. Cette perspective historique permet de prendre conscience de l’origine des pratiques et des représentations encore actuelles concernant l’enseignement du français et son rapport au corpus littéraire, au moins celles qu’on peut inférer des outils et des prescriptions publiées.
Le texte de Raimond, inscrit en didactique du français langue étrangère, analyse les documents officiels et les descriptifs des programmes de formation conçus au sein du Bureau d’études pour les langues et les cultures (BELC), l’instance financée par le gouvernement français chargée de former les enseignant·e·s de français des Instituts internationaux de l’Alliance française. Il est possible ainsi de découvrir la place et le rôle de la littérature dans les enseignements du FLE, sa conception, la valeur qu’on lui attribue, et son rôle dans l’appropriation du français comme langue étrangère. En même temps, ces textes témoignent d’une circulation avérée entre les recherches en didactique du français langue étrangère et l’enseignement. Le FLE se révèle donc ici une discipline pionnière dans la circulation entre recherches et pratiques enseignantes.
L’article de Baroni problématise, quant à lui, une circulation entre des concepts de théorie de la littérature et la didactique, entendue à la fois comme pratique d’enseignement et comme champ de recherche. Le texte se fonde sur des outils de la narratologie contemporaine, notamment en revisitant les notions d’intrigue et de focalisation, appelant à les repenser tant au niveau de l’enseignement que de la recherche. Les dernières recherches en analyse littéraire sont ainsi mises au service des pratiques enseignantes, du renouvellement aussi bien des outils pour enseigner la littérature que des corpus littéraires.
Enfin, l’article de Louichon, Bazile et Soulé analyse la circulation entre la recherche en didactique de la littérature et l’enseignement à travers la description d’une recherche collaborative qui a concerné d’emblée des chercheurs et des enseignant·e·s. En partant de la notion de «texte du lecteur» et de l’analyse de sa mise en œuvre en classe, les auteurs ouvrent la voie à différentes manières de concevoir et de réaliser un enrichissement mutuel entre recherches et enseignement.
La question de la circulation des savoirs conduit à une pluralité d’interrogations que ce numéro ne fait qu'effleurer. Plusieurs autres questions restent ouvertes et mériteraient d’être approfondies. Celles-ci pourraient notamment porter sur les connaissances acquises sur les pratiques en classe, sur les questions que se posent les enseignant·e·s, sur la manière de construire une réelle collaboration dans la recherche ou encore sur les effets des dimensions plus administratives de l’univers de la recherche sur les questions des enseignant·e·s.
Bibliographie
Chartrand, Suzane & Marie-Andrée Lord (2013), « L’enseignement du français au secondaire a peu changé depuis 25 ans », Québec français, n°168, p. 86-88.
Daunay, Bertrand & Jean-Louis Dufays (2007), « Méthodes de recherche en didactique de la littérature », Lettre de l’AiRDF, n°40, p. 8-13.
Daunay, Bertrand & Yves Reuter (2008), « La didactique du français : questions d’enjeux et de méthodes », Pratiques [En ligne], n°137-138, p.57-78, 2008, consulté le 12 novembre 2019. URL : http://pratiques.revues.org/1152 ; DOI : 10.4000/pratiques.1152
Dufays, Jean-Louis (2001), « Quelles(s) méthodologie(s) pour les recherches en didactique de la littérature ? », Enjeux, n° 51/52, Namur, p. 7-39.
Dufays, Jean-Louis (2006), « Chapitre 8. Au carrefour de trois méthodologies : une recherche en didactique de la lecture littéraire », in L'analyse qualitative en éducation: Des pratiques de recherche aux critères de qualité L. Paquay (dir.) Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, p. 143-164. DOI:10.3917/dbu.paqua.2006.01.0143.
Garcia-Debanc, Claudine & Jean-Louis Dufays (2008), « Les pratiques enseignantes en français et leurs effets sur les apprentissages des élèves », Lettre de l’AIRDF, n°43, p. 3-6.
Goigoux, Roland (2017), « Associer chercheurs et praticiens à la conception d’outils didactiques ou de dispositifs innovants pour améliorer l’enseignement, Éducation & didactique, n°11(3), p. 135-142. Consulté le 28 août 2020, URL: https://www.cairn.info/revue-education-et-didactique-2017-3-page-135.htm.
Kervyn, Bernadette (2011), « Caractéristiques et pertinence de la recherche-action en didactique du français », in Les concepts et les méthodes en didactique du français, B. Daunay, Y. Reuter & B. Schneuwly (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, (Recherches en didactique du français ; 4), p. 219-250.
Sanchez, Éric & Réjane Monod-Ansaldi (2015), « Recherche collaborative orientée par la conception », Éducation et didactique, n°9 (2), p.73-94. Consulté le 13 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/educationdidactique/2288 ; DOI : 10.4000/educationdidactique.2288
Schneuwly, Bernard & Chistophe Ronveaux (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bern, Peter Lang.
Pour citer l'article
Sonya Florey & Chiara Bemporad , "Introduction n°2 - La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-2-la-circulation-des-savoirs-entre-recherches-et-pratiques-enseignantes
Voir également :
Articulations entre pratiques et recherches en sciences du langage et didactique de la littérature dans la formation des enseignants de FLE
Alors que l’émergence d’une approche nouvelle – dite communicative – dans l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère (FLE) succède, au début des années 1980, à des méthodologies centrées uniquement sur l’oral, le texte littéraire se trouve réintroduit en classe. Confrontés aux pratiques pédagogiques, les travaux scientifiques et didactiques menés sur l’enseignement de la littérature en FLE vont permettre une articulation entre la recherche et le terrain. Nous nous intéresserons plus précisément à celui de la formation continue, qui constitue un espace de rencontre(s) entre chercheurs et praticiens, à travers l’exemple du stage proposé par le Bureau d’études pour les langues et les cultures (BELC{{Le Bureau d’études et de liaison pour l’enseignement du français dans le monde (BEL), relevant conjointement de l’enseignement secondaire et du Ministère des affaires étrangères, fut créé en 1959 et dirigé par Guy Capelle (ce n’est que lors de son rattachement au Centre international d’études pédagogiques –CIEP, en 1966, qu’il prendra le nom de Bureau d’enseignement de la langue et de la civilisation françaises à l’étranger puis, en 1992, celui de Bureau d’études pour les langues et les cultures –Belc).
Articulations entre pratiques et recherches en sciences du langage et didactique de la littérature dans la formation des enseignants de FLE
Alors que l’émergence d’une approche nouvelle –dite communicative– dans l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère (FLE) succède, au début des années 1980, à des méthodologies centrées uniquement sur l’oral, le texte littéraire se trouve réintroduit en classe. Confrontés aux pratiques pédagogiques, les travaux scientifiques et didactiques menés sur l’enseignement de la littérature en FLE vont permettre une articulation entre la recherche et le terrain. Nous nous intéresserons plus précisément à celui de la formation continue, qui constitue un espace de rencontre(s) entre chercheurs et praticiens, à travers l’exemple du stage proposé par le Bureau d’études pour les langues et les cultures (BELC1), opérateur légitime du Ministère de l’Éducation nationale français pour le FLE, qui propose depuis cinquante ans des modules de formation autour de la littérature à des enseignants exerçant auprès de publics variés (enfants, adolescents, adultes) pour qui le français n’est pas la langue maternelle ou première2.
Lieu de découverte de supports, d’outils, d’activités ou de méthodes pour ces formateurs, ce stage est également, pour ses animateurs, un lieu d’expérimentation qui permet d’éprouver leurs propositions pédagogiques à travers des simulations de pratiques. Lorsque ces «formateurs de formateurs» sont également des chercheurs qui s’intéressent à la didactique de la littérature, ces stages leur permettent alors de nourrir une réflexion théorique, de les aider à mieux saisir les interactions entre contextes variés d’enseignement (du FLE et/ou du Français Langue Seconde) et textes littéraires, grâce aux échanges avec les stagiaires (témoignages, comptes rendus d’expérience, etc.). Ils peuvent également leur inspirer des activités pratiques, esquissées au cours de la formation en collaboration avec les stagiaires, en lien avec les domaines scientifiques : linguistique, sémiotique du texte, stylistique, pragmatique de la lecture ou esthétique de la réception3. Quels liens existe-t-il entre les notions, concepts et théories que ces chercheurs-formateurs déclinent ou promeuvent dans les publications scientifiques de référence du champ auxquelles il leur arrive de contribuer et les propositions pédagogiques qu’ils préconisent durant leurs formations? Quelles sont les priorités que se fixent les «formateurs de formateurs» pour la sélection des supports littéraires (genres, auteurs, types de texte, etc.) et dans l’élaboration des activités pédagogiques proposées?
S’appuyant sur l’étude des programmes des stages du BELC, sur les articles, ouvrages écrits par les formateurs eux-mêmes et les chercheurs auxquels ils se réfèrent, notre analyse permettra de nous interroger sur l’évolution du choix des corpus littéraires au regard des pratiques que les formateurs du BELC préconisent et des références théoriques sur lesquelles ceux-ci s’appuient en sciences du langage comme en didactique de la littérature, depuis plus de trente ans.
1. Contexte et corpus de référence
Initialement «Institut de recherche en linguistique appliquée», le BELC, acteur incontournable dans le domaine de la formation de formateurs en FLE, crée, il y a cinquante ans, un stage d’été4 dont l’objectif consiste à présenter et promouvoir des pratiques nouvelles aux enseignants de français du monde entier. Né à Besançon, il a été itinérant, faisant le tour des universités françaises: transféré à Aix en Provence puis à Grenoble, à Saint-Nazaire, à Marseille Luminy, au Mans, à Strasbourg, à Caen et à Nantes. Fait marquant, des modules de formation centrés sur la littérature y ont toujours été dispensés, alors même que celle-ci se trouvait délaissée au fil des approches méthodologiques dominantes dans le champ du FLE, et dans les manuels (XX, 2018). Une littérature qui, bien que «tombée de son piédestal» n’aura pas vraiment «pour autant disparu de la réalité de l’enseignement», constataient déjà Denis Bertrand et Françoise Ploquin en 1988 (Bertrand, Ploquin 1988 : 2).
Pourquoi choisir la fin des années 1980 comme focale de départ de cette analyse? Ce choix s’explique légitimement par le tournant méthodologique qui s’opéra à une période marquée par l’avènement d’une approche communicative en didactique du FLE ; période particulièrement féconde en publications scientifiques autour de l’enseignement de la littérature et le retour du texte littéraire en classe et dans les manuels de langue qui se réclament de cette nouvelle approche. Alors qu’une première méthodologie (XVIe siècle – 1950) dans l’histoire de la didactique du FLE avait privilégié l’écrit et le texte littéraire, en particulier en favorisant un enseignement grammatical, les méthodologies qui lui ont succédé (audio-orales, audio-visuelles et structuro-globales audio-visuelles), centrées sur le développement de compétences orales, ont renoncé à la littérature. Il faudra attendre les années 1980 et l’avènement d’une nouvelle méthodologie, l’approche communicative qui développe une compétence de communication orale et écrite, pour que soit réhabilité le texte littéraire. Il entre alors en concurrence, comme support d’apprentissage, avec d’autres documents, dits «authentiques»5, issus le plus souvent de la vie quotidienne (articles de presse, publicités, recettes de cuisine…). C’est dans ces conditions que se trouvera réintroduit le texte littéraire, permettant de «développer la compréhension de l’écrit et comme déclencheur de l’expression orale», alors même que celui-ci était considéré jusqu’à la fin du XIXe siècle, comme un corpus idéal «véhicul[ant] la norme, réuniss[ant] les objectifs linguistiques, rhétoriques et culturels d’un enseignement qui favorisait l’écrit, et offrait un regard intériorisé sur la civilisation française» (Cuq 2003 : 158).
Dans la mesure où l’histoire du stage du BELC se confond avec l’évolution de la recherche en didactique du FLE6, on peut poser l’hypothèse que les formations proposées auront été un terrain privilégié de réflexions, d’expérimentations et de confrontations entre la recherche en didactique du FLE et ses praticiens, sachant que les linguistes et «méthodologues» y intervenaient souvent en qualité de formateurs et même parfois de «formés» ; ce stage accueille non seulement des enseignants mais aussi des conseillers pédagogiques, coordinateurs institutionnels et universitaires français et étrangers7. Il s’agira d’analyser les initiatives adoptées par les formateurs, dans leur tentative de répondre aux besoins ou attentes des enseignants de FLE, à partir des contenus et objectifs des modules de formation dispensés dans les stages d’été du BELC depuis 1988 jusqu’à 2018, mais aussi des supports de formation, bibliographies et articles rédigés par les formateurs eux-mêmes dont certains revêtaient par ailleurs la «casquette» de chercheur en sciences du langage, spécialiste de littérature ou didacticien.
Pour interroger le lien entre recherche et application, deux ouvrages écrits en grande majorité par les animateurs des deux principaux centres de recherches pédagogiques et linguistiques (le BELC et le CRÉDIF8), «orchestre[ront] l’actualité de réflexions qui font pressentir des lignes de forces susceptibles d’ouvrir à la littérature les voies d’une légitimité renouvelée en didactique des langues» (Bertrand & Ploquin 1988 : 2) à partir des années 1980 et continuent d’ailleurs à faire référence aujourd’hui en didactique du FLE. Cités par les formateurs dans leur bibliographie9, dès le début des années 1990 (M1, M2, M3), il s’agit de l'ouvrage coordonné par Jean Peytard (Littérature et classe de langue, français langue étrangère, 1982) et du numéro spécial du Français dans le monde, Recherches et applications («Littérature et enseignement. La perspective du lecteur», coord. Denis Bertrand et Françoise Ploquin, 1988).
Dès octobre 1978, le CRÉDIF ouvre un champ de recherche sur l’enseignement de la littérature en classe de FLE. Sur un projet de Louis Porcher et de Jacques Cortès, un séminaire dont la direction est confiée à Jean Peytard se tiendra mensuellement durant trois années, ayant pour but «de parvenir à comprendre plus clairement la place et la fonction de la littérature dans l’enseignement du FLE» (Peytard 1988 : 10). Il donnera lieu à la publication, en 1982, de l’ouvrage, Littérature en classe de langue, «produit d’une équipe de chercheurs appartenant au CRÉDIF et au BELC, ainsi que le résultat d’une réflexion collective» (Ibid.). Coordonnée par J. Peytard, de l’université de Franche-Comté, cette publication accueille les contributions d’universitaires qui vont participer à la constitution de ce champ du FLE comme Henri Besse, Daniel Coste ou encore Louis Porcher.
Après une description de la place actuelle du littéraire dans les ensembles pédagogiques, les méthodes d’enseignement et les choix d’apprentissage, la deuxième partie de cet ouvrage pose un regard plus sociologique et étudie des discours d’enseignants sur leurs pratiques. Enfin, une troisième partie, propose divers instruments et exemples d’analyse sémiotiques pour une pratique des textes littéraires en classe de langue, du poème à la nouvelle et au roman. (Peytard 1982a : 4e couv.)
On retrouve également dans le Numéro spécial du Français dans le monde une partie des chercheurs ayant contribué à l’ouvrage de 1982: Henri Besse, Jean Peytard mais aussi Denis Bertrand qui est, comme Marie-Laure Poletti, formateur dans le stage du BELC.
L’axe directeur de cet ouvrage est le contact entre le texte et son lecteur. Autour de cet axe, les notions clés utilisées par les auteurs sont celles de «culture», de «plaisir du texte», de «sujet lecteur» et d’«intersubjectivité», rappelant et soulignant que cette méthodologie en vigueur plaide pour la «centration sur l’apprenant», qui cesse d’être perçu comme un simple objet de formation, mais comme un acteur de son apprentissage. Les théories convoquées sont la «pragmatique de la lecture, l’esthétique de la réception et la sémiotique du texte» (Bertrand, Ploquin 1988 : 3).
Notre corpus de références théoriques est également composé d’articles rédigés par des formateurs au BELC, comme M.-L. Poletti10 qui sont pour certains devenus des universitaires (Abdelmadjid Ali Bouacha, D. Bertrand) mais aussi d’écrits de chercheurs cités en bibliographie dans les programmes des modules sur l’enseignement de la littérature en FLE qui n’ont pas - ou furtivement — participé au BELC, à l’instar de Francine Cicurel11. Plusieurs articles publiés dans la version du Français dans le monde destinée aux enseignants de FLE ont été convoqués dans la mesure où les personnels de rédaction faisaient partie du BELC, mais «[…] avai[ent] une très large autonomie pour qu[e la revue] ne soit ni l’expression officielle, ni l’organe du BELC ; et pour qu’elle s’ouvre à tous les courants, à tous les groupes travaillant sur la didactique du français» (Debyser 2007 : 14).
2. Des modules centrés sur le choix des supports littéraires
2.1. Des classiques aux œuvres contemporaines
Outre la question des pratiques pédagogiques à partir des textes littéraires, celle du choix du corpus apparaît comme centrale dans l’ensemble des formations qui semblent naviguer entre deux visions : une perspective ségrégationniste qui repose sur un corpus exclusif, ancien et stable et une perspective intégrationniste qui accueille des textes d’appartenance générique variée, de différents siècles et prend en compte la littérature dans sa sphère de production large. Le chercheur J.-P. Goldenstein en résume ainsi les enjeux qui pourraient correspondre aux questions que semblent se poser les formateurs du BELC :
Notre enseignement va-t-il s’attacher à la transmission d’un corpus reconnu qui répondrait à une sorte de SMIG culturel? Un Savoir Minimum Intellectuel Garanti donc. Privilégierons-nous les grandes œuvres du passé jugées incontournables, l’étude des Grandes-Têtes-Molles pour parler comme Isidore Ducasse*12, ou bien tenterons-nous d’aborder des productions moins valorisées mais reconnues elles aussi comme littéraires? (Goldenstein 1991 : 5)
Après une période durant laquelle la littérature est présentée dans sa généralité - on remarque d’ailleurs que les termes de «littérature», «texte littéraire» (M4, M1, M5, M6, M7) sont les dénominations privilégiées dans les titres des modules des années 1980 et au début des années 1990 -, des genres littéraires spécifiques vont peu à peu apparaître avec un accent mis sur la littérature contemporaine notamment à travers des modules qui lui sont exclusivement consacrés (M8 à M12). On relève ainsi, au fil des années de nouveaux supports, parfois destinés à un public spécifique, alors que l’offre de formation du BELC se diversifie et se précise à travers un nombre croissant de modules. Certains formateurs mettent l’accent sur les genres canoniques (poésie, théâtre, roman (M1 et M13)) et des sous-genres (contes, le genre autobiographique (M14, M15 et M16)), d’autres, moins nombreux, privilégient des mouvements littéraires (M17). Le recours à la littérature contemporaine ne s’accompagne pas pour autant d’une disparition des classiques. Certains formateurs les réunissent d’ailleurs sans les distinguer ou les hiérarchiser: des fragments de Chateaubriand, Flaubert et Zola côtoient ainsi un extrait du Chercheur d’or de Le Clézio et un texte de Sefrioui (M1).
Si certains modules restent exclusivement centrés sur la littérature patrimoniale, d’autres supports qui sont le plus souvent perçus comme paralittéraires font leur apparition comme la bande dessinée (M19) et la littérature de jeunesse (M20 à M24). L’introduction de ces deux corpus comme celui de l’album pour enfants s’explique par la présence des images qui en fait «un support motivant pour un public d’enfants ou d’adolescents» tout en facilitant l’entrée dans le texte et l’accès à son sens. Autres arguments invoqués : la littérature jeunesse «associe, le plus souvent avec beaucoup d’inventivité et de réussite, texte et illustration», et la brièveté de ses ouvrages offre «l’occasion d’aborder la lecture individuelle de textes complets» et représente une «passerelle» vers d’autres textes littéraires (M20).
En 1997, M.-L. Poletti plaide pour l’introduction de ce qu’elle nomme les «mauvais genres» littéraires en classe de FLE ; genres plébiscités dans ses modules du BELC «qui appartiennent à la littérature traditionnellement non reconnue par l’institution scolaire- littérature de jeunesse ou littérature policière par exemple». Elle justifie ce choix qui témoigne d’une conception «extensive»13et «intégrationniste» ou «relativiste» de la culture, considérant la littérature dans sa sphère de production large incluant aussi bien les genres mineurs que les genres traditionnellement reconnus : «parce que le " mauvais " livre peut, quelquefois, être le plus important pour déclencher un désir de lecture ou comprendre une autre culture» (Poletti 1997 : 38).
La tendance intégrationniste est accentuée par l’ouverture de certains modules à la littérature internationale. Si l’accent est effectivement mis sur les auteurs et textes français, certains formateurs élargissent leur corpus à celui des littératures francophones (M25 à M29) ou internationales traduites (M30), comme l’album pour enfant d’Anthony Brown, Une Histoire à quatre voix (M24).
Les termes «approches», «entrées», «panorama» (M19, 22, 31) présents dans le titre du module ou dans celui des différentes séances qui le composent dévoilent l’objectif que se fixent les formateurs en introduisant des supports littéraires variés. Leur priorité est de faire découvrir des textes méconnus par les enseignants notamment parce qu’ils ne sont guère diffusés dans les outils pédagogiques proposés par les éditeurs spécialisés en FLE : manuels de langue ou collections d’œuvres littéraires réécrites en français facile, dans une version abrégée adaptée aux différents niveaux linguistiques des apprenants de FLE14(M9 2000).
Plutôt que de se limiter à quelques textes, certains formateurs souhaitent présenter aux stagiaires un «large corpus d’ouvrages» (M20 1996). Ils ne se contentent pas toutefois de leur fournir une «banque de textes» (M16), mais cherchent à leur donner des éléments critiques sur un corpus contemporain qu’ils méconnaissent et pour lequel «les ouvrages de synthèse en langue française sont presque inexistants, [et] même les revues ne l’aident guère» (M8 1994) comme c’est le cas pour le Nouveau Roman durant les quinze dernières années (M11).
Tout en permettant de «mieux se repérer dans la littérature contemporaine», la visée du formateur est également d’inciter les apprenants, et peut-être les enseignants, à lire cette littérature qui n’est pas transmise dans les manuels, tout en s’interrogeant à partir de l’ouvrage de Pierre Bayard cité en bibliographie et paru l’année du module, «comment parler des livres qu’on n’a pas lus?» (M32)
Aider les enseignants à se détacher des manuels de langue apparaît comme une vocation partagée par les formateurs du BELC, comme le rappelle D. Bertrand évoquant un article marquant de F. Debyser en 1973 dans lequel était annoncée la mort du manuel de langue15. Dans le sillage de cet article16, les formateurs se démarquent des auteurs de manuels, qui introduisent le texte littéraire à un niveau intermédiaire ou avancé d’apprentissage, et invitent les enseignants à l’exploiter dès un niveau débutant (M30, M33, M34).J. Peytard prône également d’en faire usage «dès l’origine du cours de langue» car celui-ci constitue «un document d’observation et d’analyse des effets polysémiques» (Peytard 1982b : 102). Les formateurs critiquent parfois les dialogues fabriqués dans les manuels et incitent les enseignants à les remplacer par d’autres, issus de la littérature contemporaine «de bonne qualité, parfois aussi linguistiquement plus simples que ceux des manuels» (M35).
2.2. Du fragment à l’œuvre complète
Si, pour des raisons pratiques, qui relèvent à la fois de contraintes temporelles et de la tradition scolaire, certains formateurs privilégient le fragment, issu d’un roman moderne ou d’une pièce de théâtre, on perçoit également une volonté de renoncer au format scolaire du texte littéraire tel qu’on peut le trouver dans les manuels scolaires (c’est-à-dire à l’extrait d’une dizaine de lignes). Cette tendance fait écho aux préconisations d’Isabelle Gruca (2004) et de Francine Cicurel, chercheuses en Didactique du FLE qui plaident pour le recours au texte bref complet. Comme à une époque antérieure dans l’enseignement secondaire du français langue maternelle (FLM), dans le chapitre consacré à la lecture littéraire de son ouvrage Lectures interactives, F. Cicurel (1991) recommande aux enseignants de FLE de préférer aux «morceaux choisis» les «textes intégraux», non tronqués ou simplifiés, non détachés de l’œuvre, ne privant pas l’apprenant du début et/ou de la fin du texte. Elle se fonde alors sur les théories de la lecture –en particulier celle de la coopération du lecteur d’Umberto Eco– pour décrire l’implication du lecteur et les manières dont il participe à la construction du monde qu’il est en train de lire (Godard 2015 : 41). «Un véritable apprentissage de la lecture passe par une lecture intégrale afin que l’apprenant puisse suivre le déroulement du récit et s’appuyer sur les indices successifs du texte pour en voir la signification» (Cicurel 1991 : 130), explique-t-elle.
À la recherche de formats adaptés aux cours de français langue étrangère, l’utilisation d’œuvres littéraires brèves «dont la durée de lecture ne risque pas de démotiver l’étudiant comme pour le roman» (Cicurel 1983 : 62) sera privilégiée dans les stages du BELC (1992-1994 particulièrement).
Au-delà des extraits, des fragments pour lesquels «l’artifice scolaire» sera évoqué par I. Gruca et F. Cicurel, le livre représente également un support de choix pour les formateurs. «Lire un livre, c’est investir toutes nos habitudes et nos comportements de lecture, y compris les plus inavouables en situation scolaire : sauter des pages, aimer, ne pas aimer…» (M36)
Comparé à l’extrait qui, détaché de l’œuvre, prive le lecteur du début et/ou de la fin du texte, le livre représente un véritable document authentique qui, dès le survol de sa couverture, offre des informations précieuses sur l’œuvre, permettant d’anticiper son contenu et de faciliter l’entrée dans le texte. L’un des objectifs, qui représente parfois la visée principale du module, consiste à faire découvrir des textes, à permettre aux stagiaires de «se repérer dans le vaste champ de la littérature» mais la finalité première de la majorité des formations est en réalité d’ordre méthodologique. Il s’agit en effet de permettre aux stagiaires de construire des séquences pédagogiques autour d’un texte littéraire.
3. Les fonctions de la littérature
Jean Peytard explique en 1988 que «deux attitudes, adverses apparemment, mais en réalité complémentaires, font figure dominante dans le champ didactique de la littérature en classe de FLE : une ‶attitude fondatrice″ et des ‶attitudes libérées″» (Peytard 1988 : 12); ces deux attitudes se retrouvent dans les programmes du BELC à travers des propositions pédagogiques centrées soit sur le texte soit sur l’apprenant qui est perçu avant tout comme un lecteur ou un écrivain,voire un créateur.
3.1 Centration sur le texte comme document authentique et/ou objet d’analyse
«L’attitude fondatrice», la plus ancienne «est homologue absolument aux pratiques de l’école et de l’université françaises: la lecture est régie par l’exercice d’explication de texte; l’écriture, par celui de la dissertation.» (Peytard 1988 : 12). Dans ce sillage, certains modules affichent leur centration sur les exercices de lecture analytique issus de l’enseignement du FLM - l’analyse méthodique des textes ou du commentaire de texte -, avec pour objectifs d’«approfondir et [de] partager différentes méthodes d’analyse de textes littéraires» (M3) avec les stagiaires. Leur dessein est dès lors d’adapter ces exercices à l’enseignement du FLE. Une formatrice choisit d’«inscrire l’apprentissage de la grammaire dans les objectifs de lecture analytique» (M27), la décrivant dans son programme comme un outil souple et efficace. Une autre s’interroge sur la manière de l’évaluer et propose aux stagiaires d’élaborer un questionnement efficace.
Jusqu’au début des années 1990, on constate la prédominance de la linguistique et plus précisément de la sémiotique dans les modules centrés sur la littérature. Cette tendance fait écho aux principes partagés par Michel Benamou (1971), J.Peytard (1982a)et une grande majorité des auteurs ayant contribué au numéro spécial du Français dans le monde (1988).
Dès 1971, M. Benamou, dans ses propositions pédagogiques, mettait en garde les enseignants de FLE contre «la pédagogie d’autorité de l’explication de texte» en prônant une pédagogie de la découverte. Convoquant Greimas et proposant néanmoins de conduire une analyse structurale d’un texte, il évoquait «le ̏risque de dogmatisme̋ que courait l’enseignant en choisissant un texte n’ayant qu’une structure possible» (Benamou 1971 : 26-27). Quelques années plus tard, J. Peyard cherche également à se détacher de la pratique scolaire du texte littéraire en FLM en proposant pour l’enseignement du FLE une démarche de découverte fondée sur le repérage des «entailles»17 du texte, en lien avec les propositions didactiques de l’approche globale ou approche communicative de la lecture, exposées par Sophie Moirand dans Situations d’écrits en 1979. Centrée sur la sémiotique, la démarche de J. Peytard «n’est pas de conduire les praticiens à l’usage d’une méthode d’analyse du texte littéraire mais de les inciter à une réflexion –marquée par la prise en compte d’une sémiotique de l’écriture– sur la spécificité langagière de la littérature, pour trouver en elle un stimulant à pratiquer la langue en son fonctionnement optimal.» (Peytard 1988 : 11).
«L’attitude fondatrice» est plus rarement suivie par les formateurs du BELC que la deuxième attitude, qualifiée de «libérée», qui apparaît dans l’usage du texte littéraire comme «authentique» ou ressenti comme tel. Reprenant l’expression utilisée par J. Peytard dans l’ouvrage qu’il coordonne en 1982 et en 1988, certains formateurs (M37) considèrent le texte littéraire comme un «laboratoire langagier, où l’on a la chance d’observer et de comprendre ce que c’est qu’une langue» (Peytard 1988 : 11). Support prétexte à la réalisation d’activités «techniques» de la langue, il offre aux apprenants des modèles de régularité morphosyntaxique. Mais en le considérant comme «fournisseur de mots et de phrases, pour une exploitation du lexique et de la syntaxe», J. Peytard affirme que l’enseignant court le risque de le banaliser en en faisant l’égal de tout document non littéraire authentique (journal, affiche ou notice) que l’on sollicite «par extraction échantillonnée […] afin de soutenir une analyse de la langue. Ce faisant tout caractère propre du texte littéraire est gommé. Toute "littérarité" est occultée.» (Ibid. : 14). Appelée par l’auteur «effet réservoir», cette tendance que l’on retrouve fréquemment dans les manuels de FLE semble partagée par certains formateurs du BELC pour qui «le texte littéraire recèle des trésors langagiers que l’enseignant peut exploiter, même avec un public de débutants» et qui «utilise[nt] les genres littéraires les plus connus, non pour en étudier la spécificité, mais plutôt comme prétextes à un grand nombre d’activités de langue» (M33 2000).
De la même manière, le texte littéraire est également perçu comme un support permettant d’aborder des objectifs culturels et anthropologiques. Les formateurs le perçoivent comme un «miroir de la société» (M2), un «formidable réservoir de documentation culturelle» (Bertrand, Ploquin 1988 : 4). Certains d’entre eux choisissent ainsi des œuvres contemporaines (romans, BD ou littérature de jeunesse) parce qu’elles offrent «une vision de la société française» à une période donnée (M9 1999). Cherchant à multiplier les approches interdisciplinaires, ils s’appuient dès lors sur l’anthropologie culturelle ou suivent une approche sociolinguistique, «à partir des notions de dialogisme, d’hétérogénéité, de plurilinguisme, d’hétérolinguisme et de métissage textuel» (M28).
Outre l’effet réservoir, J. Peytard évoque «l’effet communion», autre conséquence de la désacralisation du texte littéraire qui repose sur la notion de plaisir. Dépouillée d’appareil pédagogique, non guidée par l’enseignant qui ne cherche pas à conduire une analyse de texte, la lecture du fragment littéraire représente un temps de repos pour les enseignants et de récréation pour les apprenants (Peytard 1988 : 14). Cette tendance se retrouve dans plusieurs manuels édités dans les années 1980 et 1990 qui proposent en fin d’unité un texte littéraire sans consignes ni questions ni activités, invitant ainsi l’apprenant à réaliser une lecture autonome proche d’une pratique privée, non médiatisée18.
3.2 Centration sur l’apprenant, pour le plaisir de lire, écrire et créer
Les formateurs choisissent le texte littéraire avant tout comme support pour mener des activités de lecture et travailler donc des compétences en «compréhension écrite». L’accent n’est ainsi plus mis sur le texte mais sur l’apprenant que l’enseignant doit «apprivoiser», dont il doit «soutenir la motivation» et la compétence de lecture sans oublier la compétence linguistique. Les approches proposées doivent avant tout faciliter la lecture, l’accès au sens (M6 1992).
Conformément à ce que recommande F. Cicurel dans Lectures interactives (1991), ouvrage fréquemment cité dans les bibliographies des formateurs, l’accent est mis sur l’apprentissage de «stratégies» pour apprivoiser «les obstacles, en particulier lexicaux, [qui] y sont effrayants» (M36). Alléger la lecture en donnant ou en faisant découvrir des indices visuels, la structuration du texte, la reconnaissance du thème permet de maintenir la motivation de l’apprenant, de le rendre actif car il coopère avec l’enseignant et avec les autres apprenants pour construire un sens. Déjà en 1979, S. Moirand dans Situations d’écrits encourageait les enseignants à offrir aux élèves les moyens de parvenir à une compréhension non pas exhaustive, mais globale du texte, reposant sur le repérage d’indices et non sur le déchiffrage intégral du document19 : jeux de rôles, simulations, dramatisations ou jeux de créativité langagière, notamment issus de l’Oulipo dont F. Debyser, formateur et directeur du BELC (1967-1987), était membre, car ils considèrent que ceux-ci peuvent servir les objectifs d’enseignement-apprentissage du littéraire en classe de langue.
Dans son célèbre article de 1973, F. Debyser défendait l’introduction d’«une pédagogie de la simulation» qui était alors peu familière des enseignants mais déjà présentée dans les formations du BELC car, «impliquante pour les participants», elle avait pour «but de permettre l’action (simulée) et l’expérimentation (réelle)» (Debyser 1973 : 67-68) en s’appropriant les situations de communication.
Dans la tradition des modules animés par F. Debyser, Jean-Marc Caré et Christian Estrade et dans le sillage de leurs publications20, un module de simulation globale21 adapté au fait littéraire en 2004 (M39) puis un autre, trois ans plus tard centré sur les jeux de rôle, sont ainsi proposés, ayant pour objectif de développer la créativité des enseignants face aux textes littéraires tout «en conservant une rigueur didactique», cherchant ainsi à concilier analyses littéraires et techniques de créativité en «montr[ant] que certaines techniques […] permettent, à travers la création de situations cadre, de désenclaver le littéraire de son académisme pour en faire un objet d’apprentissage vivant et interactif» (M40). Faire naître le plaisir d’apprendre apparaît également comme un facteur déterminant qui justifie l’utilisation des jeux de langage en 2001 (M41) comme en 2007 (M40).
Conclusion
En privilégiant une perspective intégrationniste plutôt que ségrégationniste par l’introduction d’œuvres contemporaines aussi bien que de classiques, de genres mineurs (bande dessinée, littérature de jeunesse, romans policiers…) et de genres reconnus, les formations dispensées dans les stages du BELC tout au long de ces trente dernières années auront, sans aucun doute, chercher à renouveler, à modifier les représentations parfois réductrices de la littérature et du traitement pédagogique qui en est fait dans les manuels de langue.
Si ces stages ont reflété les orientations didactiques qui étaient mentionnées dans les articles publiés notamment entre 1971 et 1991 en didactique de la littérature en FLE (accent mis sur la sémiotique littéraire à travers les écrits de J. Peytard et D. Bertrand, sur les théories de la lecture en FLE de S. Moirand ou F. Cicurel, et sur le plaisir de jouer et de créer en classe de langue défendu notamment par J-M. Caré, F. Debyser), il est plus difficile d’affirmer que c’est encore le cas aujourd’hui, notamment parce qu’il ne reste désormais de cet «Institut de recherche en linguistique appliquée», qu’un stage bi-annuel dans lequel peu de chercheurs interviennent. Au regard des bibliographies sur lesquelles s’appuient les modules de littérature actuels, on constate que des références très diverses sont centrées davantage sur les outils pour enseignants que sur les publications de chercheurs. La réflexion sur la didactique de la littérature est pourtant bien vivante comme en témoigne le numéro de Recherches et applications de janvier 201922. Les stages de formation en FLE sont aujourd’hui certes moins des lieux de circulation entre théories et pratiques, chercheurs et formateurs qu’il y a vingt ou trente ans ; mais cette circulation se déploie à présent au sein d’équipes de recherche, dans les universités, qui conduisent des projets collaboratifs avec les acteurs du terrain (enseignants, inspecteurs, conseillers pédagogiques, formateurs) et dans des espaces de dialogues comme les colloques scientifiques dédiés à l’enseignement/apprentissage des langues. Autrefois centrée sur l’enseignement du français langue première, conformément à son ancienne dénomination (DFLM), l’Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF) a accueilli, au fil des années, un nombre croissant de chercheurs en FLE dans les Rencontres des chercheur·e·s en didactique de la littérature qu’elle organise chaque année depuis 2000. Dans le cadre de recherches sur la formation des enseignants et en prolongement de notre étude, peut-être conviendrait-il de se focaliser désormais sur la manière dont l’expérience que les enseignants-stagiaires, de formations et de contextes divers internationaux, apportent dans la construction et le développement de ces stages, nourrit et/ou influence aujourd’hui l’articulation entre réflexions théoriques et pratiques de classes opérée par les «formateurs de formateurs».
Bibliographie
Benamou, Michel (1971), Pour une nouvelle pédagogie du texte littéraire, Paris, Hachette/Larousse (Le français dans le monde/BELC).
Bertrand, Denis & Françoise Ploquin (1988), « Présentation : la perspective du lecteur », Le Français dans le monde. Recherches et applications, n° spécial : « Littérature et enseignement, la perspective du lecteur », p. 2-4.
Bertrand, Denis & Juliette Salabert (2018), « Le BELC, un laboratoire du langage. Entretien » dans H. Portine et alii, (coord.), Expertise au service des acteurs du français dans le monde. Mélanges pour les 50 ans du Belc, Sèvres, CIEP, p. 43-52 [réédité en 2019 dans Le BELC 50 ans d’expertise au service de l’enseignement du français dans le monde, Paris, Hachette Français langue étrangère, pp. 45-58.]
Chartier, Roger (1993), « Du livre au lire » dans R. Chartier (dir.), Pratiques de la lecture, Paris, Éditions Payot et Rivages (Petite Bibliothèque Payot) (éd. orig. : 1985), p. 79-113.
Cicurel, Francine (1983), « Lecture de la nouvelle », Le Français dans le monde, n°176, p. 62-68.
Cicurel, Francine (1991), Lectures interactives en langue étrangère, Paris, Hachette Français langue étrangère.
Cuq, Jean-Pierre (dir.) (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, Clé international.
Debyser, Francis (1973), « La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique », Le Français dans le monde, n°100, p. 63-68.
Debyser, Francis (1996), « Éloge du savoir-vivre… Et pour tordre le cou au ̏savoir-être ̋», Le Français dans le monde, n°282, p. 40-41.
Debyser, Francis (2007), « Le BELC : un entretien avec Francis Debyser », Le Belc a 40 ans, Sèvres, CIEP, p. 9-22.
Godard, Anne (2015), « La littérature dans la didactique du français et des langues : histoires et théories » in A. Godard (dir.), La Littérature dans l’enseignement du FLE, Paris, Didier, p. 14-55.
Goldenstein, Jean-Pierre (1991), « Quels enseignements pour quelles littératures », Les Cahiers de l’Asdifle, n°3, p. 4-9.
Gruca, Isabelle (2004), « Le conte : pour le plaisir de lire, pour le plaisir d’écrire », Dialogues et cultures, n°49, p.73-77
Peytard, Jean (éd.) (1982a), Littérature et classe de langue : Français langue étrangère, Paris, Hatier-Crédif, coll. « LAL ».
Peytard, Jean (1982b), « Sémiotique du texte littéraire et didactique du F.L.E. », Études de linguistique appliquée, n°45, p. 91-103.
Peytard, Jean (1988), « Des usages de la littérature en classe de langue », Le français dans le monde, n° spécial, « Littérature et enseignement », p. 8-17.
Poletti, Marie-Laure (1997), « Ne lisez pas entre les lignes », Le français dans le monde, n° 290 « 1967-1997 : 30 ans de stages BELC », p. 37-38.
La lecture est également étroitement liée à l’écriture dans «un va-et-vient» (M22) où sont intégrées des activités créatives et artistiques comme la fabrication d’un livre destiné à la jeunesse (M21). Dans un autre module, l’objectif est en quelque sorte de désacraliser la littérature en découvrant et en acquérant «de multiples techniques d’écriture spécifiquement liées au roman, à la nouvelle, au conte, afin d’explorer sa propre créativité» (M7 2000). Des formateurs introduisent dans leurs modules différentes techniques de créativité{{«[…] cette créativité est devenue une sorte de label maison» pour D. Bertrand (Bertrand & Salabert 2018 : 47).
Pour citer l'article
Anne-Claire Raimond, "Articulations entre pratiques et recherches en sciences du langage et didactique de la littérature dans la formation des enseignants de FLE", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/articulations-entre-pratiques-et-recherches-en-sciences-du-langage-et-didactique-de-la-litterature-dans-la-formation-des-enseignants-de-fle
Voir également :
Ingénierie didactique collaborative de seconde génération: le cas de l'articulation langue-texte
Dans quelles conditions la conception, l’expérimentation et la validation de dispositifs didactiques peuvent-elles rapprocher chercheurs et praticiens? Comment des enseignants peuvent-ils s’approprier et mettre en œuvre des dispositifs construits à la fois par des chercheurs et des collègues enseignants? Le présent article tente, à partir de données de recherche, de répondre à ces questions. L’angle que nous choisissons de développer ici est résolument méthodologique: il s’agit de montrer comment s’opérationnalise concrètement une recherche à travers laquelle cohabitent deux logiques d’agir et de penser: celle du chercheur et celle du praticien qu’est l’enseignant.
Ingénierie didactique collaborative de seconde génération: le cas de l'articulation langue-texte
Notre projet de recherche
Dans quelles conditions la conception, l’expérimentation et la validation de dispositifs didactiques peuvent-elles rapprocher chercheurs et praticiens? Comment des enseignants peuvent-ils s’approprier et mettre en œuvre des dispositifs construits à la fois par des chercheurs et des collègues enseignants? Le présent article tente, à partir de données de recherche, de répondre à ces questions. L’angle que nous choisissons de développer ici est résolument méthodologique: il s’agit de montrer comment s’opérationnalise concrètement une recherche à travers laquelle cohabitent deux logiques d’agir et de penser: celle du chercheur et celle du praticien qu’est l’enseignant.
Les réflexions à la source de cet article découlent d’un projet de recherche doctoral qui porte sur l’articulation langue-texte dans la classe de français au Québec et en Suisse romande. Le volet québécois de ce projet s’inscrit, en partie, dans une autre recherche menée dans la région de Québec sur l’approche de l’articulation lecture-grammaire-écriture1. Dans le cadre de notre recherche doctorale, nous avons coélaboré, avec des enseignantes du secondaire dans le canton de Genève, et mis en œuvre une séquence d’enseignement articulant l’étude de la langue à celle des textes littéraires à travers un genre dont l’enseignement est relativement récent: le slam. Au Québec, toujours dans l’idée d’articuler langue et texte, nous avons, à partir d’un genre plutôt patrimonial –la fable– fait expérimenter à des enseignantes du secondaire une séquence didactique qu’elles n’ont pas coélaborée2. Précisons que ce second dispositif a fait l’objet d’une coélaboration et d’une première expérimentation avec une enseignante du secondaire dans le cadre de la première phase de la recherche menée par Marie-Andrée Lord. Nous n’avons pas retenu les données de cette première phase. Nous avons fait le choix de retenir uniquement les données de la double expérimentation3 de la fable, car nous voulions analyser les différentes conditions de mise en œuvre de nos deux séquences: double expérimentation pour la fable et toutes les expérimentations pour le slam.
Quatre grandes questions ont orienté les réflexions de l'un d'entre nous (Florent Biao) dans le cadre de son projet doctoral4: (1) Quelles sont les dimensions textuelles et langagières impliquées dans la compréhension des textes étudiés? (2) Quels dispositifs5 favoriseraient l’articulation langue-texte? (3) Comment juger de la validité de tels dispositifs? (4) Quelles sont les conditions qui facilitent l’appropriation de ces dispositifs par les enseignantes-participantes? Ce projet de recherche s’est articulé autour de deux axes: l’un théorique et l’autre méthodologique. En effet, il s’agissait de voir dans quelles conditions la mise en œuvre d’une démarche de recherche d’ingénierie didactique collaborative avec des enseignants faciliterait l’opérationnalisation d’une approche théorique aussi complexe que l’articulation. En raison de la complexité de cette mise en œuvre (Biao, 2015), il nous apparait pertinent d’expliciter dans cet article notre démarche méthodologique: l’ingénierie didactique collaborative.
Cadrage conceptuel
Pour répondre aux questions que nous nous sommes posées et ainsi atteindre nos objectifs de recherche, nous avons opté pour l’approche méthodologique d’ingénierie didactique collaborative. Cette dernière se construit sur les fondements de l’ingénierie didactique telle que théorisée par Douady (1994), Artigue (1996) et Chevallard (2009) d’une part et des recherches dites collaboratives d’autre part (Desgagné, 1997; Mercier, 2010; Bednarz, 2013). Elle implique:
- - la conception de dispositifs qui tiennent compte des contraintes du milieu;
- - la formation et la médiation du chercheur qui apporte un appui théorique aux praticiens pour nourrir leur réflexion;
- - une activité de recherche et de formation.
Dans le domaine de l’éducation, la notion d’ingénierie didactique émerge en premier en didactique des mathématiques (Artigue, 1989). Les didacticiens cherchent alors à établir des liens entre le travail didactique et celui de l’ingénieur: réaliser un projet en s’appuyant sur des connaissances scientifiques, en exerçant un contrôle rigoureux de l’ensemble de la démarche de réalisation du projet, tout en acceptant une part d’incertitude en raison de la complexité du contexte humain dans lequel se construisent les activités. L’ingénierie didactique a donc pour principaux objectifs l’élaboration de dispositifs pour l’enseignement d’un contenu, l’étude d’une notion spécifique et la mise en place de stratégies globales d’enseignement.
Musial, Pradère et Trucot (2012), dans une acception plus large, assimilent l’ingénierie didactique à ce que les anglo-saxons appellent instructional design. À l’instar de Chevallard (2009),ils définissent l’ingénierie comme une activité rationnelle de conception de dispositifs d’enseignement communicables et reproductibles, ce qui fait dire à ces auteurs que l’ingénierie didactique implique nécessairement une description et une justification précises des choix didactiques qui sont faits. Chevellard (2009) distingue deux types d’ingénierie didactique: celle de développement et celle de recherche. L’ingénierie didactique de recherche vise à créer un contexte d’observation propice à l’étude et à la compréhension du fonctionnement didactique alors que l’ingénierie didactique de développement viserait davantage la conception et la validation de contenus d’enseignement en proposant des solutions à un problème didactique identifié. Toutefois, nous pensons que ces deux types d’ingénierie ne s’excluent pas dans les recherches de type collaboratif qui visent à la fois l’analyse et la compréhension d’un objet didactique et le développement professionnel des participants.
Artigue (1996), quant à elle, conçoit l’ingénierie didactique comme une méthodologie de recherche qui se caractérise d’abord par un schéma expérimental fondé sur des réalisations didactiques en classe: la conception, la réalisation, l’observation et l’analyse de séquences d’enseignement. Même si l’ingénierie didactique s’inscrit dans la grande famille des recherches expérimentales, elle se distingue fondamentalement de celles-ci en ce que, contrairement à ces autres types de recherches basées sur l’expérimentation, elle s’appuie sur un processus de validation interne fondée sur l’analyse. En effet, comme le soutient Artigue (1989), les autres types de recherches adoptent très souvent une approche comparative qui repose sur un processus de validation externe. Autrement dit, ces recherches dites expérimentales minimisent l’analyse interne en accordant une primauté à la comparaison entre elles, alors que l’ingénierie didactique vise à analyser et à comprendre, pour chaque séquence d’enseignement, les conditions qui facilitent la transposition des savoirs et leur appropriation par les élèves.
Douady (1994), Artigue (1996), Brousseau (2008) et Chevallard (2009) reconnaissent deux grands pôles à l’ingénierie didactique: le pôle de la conception des dispositifs et celui de l’analyse des pratiques.
Musial et alii. (2012) appréhendent le pôle de la conception dans un sens large, car ils conçoivent la conception comme une tâche cognitive complexe qui relève de la résolution de problèmes. Dans un sens plus didactique, la conception renverrait à l’ensemble du processus de planification d’un enseignement. Le pôle de conception prendrait donc en compte les dimensions épistémologique, psycho-socio-institutionnelle et psycho-socio-cognitive, qui renvoient respectivement aux trois pôles du triangle didactique: savoirs, enseignant et élève (Simard, Dufays, Dolz & Garcia-DeBanc, 2010 : 13).
Le second pôle de l’ingénierie didactique renvoie à l’analyse des pratiques d’enseignement. Sur le plan scientifique, cette analyse permet de rendre compte de la manière dont s’enseigne véritablement la discipline. Une telle perspective permettrait aussi, selon ces chercheurs, d’aider à «mieux comprendre comment et par où changent les pratiques d’enseignement et de voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer à déterminer des axes stratégiques pour le travail en formation» (Garcia-Debanc & Lordat, 2007 : 43). Dolz & Simard (2009) dressent une liste d’éléments que l’on pourrait rattacher à ces pratiques:
- - les contenus réellement enseignés;
- - l’organisation et la transformation de ces contenus;
- - l’épistémologie qui fonde le choix des objets traités;
- - les démarches et modes d’interventions des enseignants;
- - les supports, les types d’activités et les formes de travail exploités.
Quelques précisions sur les recherches dites collaboratives
Ces dernières années, beaucoup de recherches de type collaboratif ont émergé en sciences de l’éducation. Même si l’on distingue diverses formes de collaboration, ce type de recherche s’appuie originellement sur la volonté de prendre en compte les points de vue des acteurs sociaux, soit pour produire des connaissances nouvelles, soit pour éclairer des problématiques complexes qui les concernent (Morissette, 2013). Ainsi, lorsqu’il est question de ce type de recherche, on distingue principalement deux catégories. Il y a d’un côté les recherches-actions qui, selon Savoie-Zajc (2001), renverraient à une approche de changement planifié dans le but de résoudre un problème que vit une communauté. D’un autre côté, il y a la recherche dite collaborative, qui renvoie essentiellement à une démarche d’exploration d’un objet et qui conduit à la coconstruction de savoirs autour d’une pratique professionnelle (Desgagné, 1997). Toutefois, même si nous nous inspirons des travaux fondateurs de Desgagné (1997), la perspective que nous adoptons diffère fondamentalement de l’approche traditionnelle de la recherche collaborative telle qu’il l’a théorisée puisque nous adoptons une perspective où le chercheur joue un rôle de formation et de médiation: celui-ci fait des apports théoriques qui orientent la recherche et il suggère des ajustements au fur et à mesure de l’élaboration du dispositif, à la lumière d’un savoir théorique dont ne disposent pas forcément les enseignants-participants.
Nous ne nous inscrivons pas dans la perspective de Desgagné où l’objet de la recherche doit se construire dans l’interaction et où chercheurs et praticiens sont sur un pied d’égalité. Il nous semble ainsi plus pertinent de parler d’une collaboration-médiation entre le chercheur et l’enseignant puisque le premier joue un rôle prédominant dans la structuration des objectifs de recherche avec, dans notre cas, des a priori théoriques (Biao, 2016) par rapport à l’articulation. D’ailleurs, ce sont nous, chercheurs, qui avons prédéterminé l’objet de la recherche, à savoir l’articulation langue-texte. Il s’agit dans notre cas d’une recherche fortement orientée, car le choix de l’objet et l’orientation théorique ne sont pas à négocier dans le partenariat collaboratif. Une telle perspective implique aussi que le chercheur assure une formation préalable aux enseignants sur l’objet choisi. Il y a donc un apport d’expertise du chercheur avant le début de l’élaboration des séquences, laquelle constitue le cœur du projet de collaboration. Il est toutefois important de préciser que les apports sont complémentaires, car l’enseignant apporte une connaissance du terrain et des élèves que n’a pas le chercheur.
Choix méthodologiques
Notre étude s’est déroulée au Québec et en Suisse romande. Au Québec, nous avons choisi deux zones géographiques: la région de Chaudières-Appalaches et celle de la Capitale-Nationale. En Suisse, les études ont été menées dans deux écoles secondaires du Canton de Genève, à Pinchat et à Meyrin.
Afin de réduire les risques d’abandon, compte tenu de la lourdeur de notre démarche, et aussi en vue de favoriser une plus grande implication des enseignants, nous avions prévu de mener cette recherche avec des enseignantes d’expérience6. Cela n’a toutefois pas été possible pour les deux participantes suisses en raison des modalités du recrutement des enseignantes. En effet, dans le Canton de Genève, c’est le Département de l’instruction publique (DIP) qui assure le lien entre les chercheurs et les enseignants. Nous avons soumis notre projet à ce département, qui s’est ensuite chargé de nous mettre en relation avec des enseignantes volontaires. Nous n’avons donc pas eu d’emprise dans ce processus. Toutefois, comme les deux enseignantes de Genève étaient volontaires et très intéressées par notre objet de recherche, le critère d’ancienneté a perdu sa pertinence. Au Québec, la situation a été différente. Toutes les enseignantes qui ont participé au projet avaient entre huit et vingt ans d’expérience.
Au Québec, trois enseignantes7 d’une même école ont participé à la recherche: Nadine, Karelle, Jade8. Toutes enseignaient dans le secteur régulier9 à des élèves de 13-14 ans. Ces enseignantes, qui cumulent plusieurs années d’expérience, ont témoigné dès le départ un grand intérêt à la fois pour l’approche d’articulation et pour la démarche que nous leur avons présentée. Ainsi, dès les premières rencontres, un rapport de confiance s’est créé. Nous étions certains d’une implication soutenue de ces participantes, ce qui constituait pour nous une condition de réussite étant donné le type de recherche que nous menons. Ces enseignantes avaient toutes une formation initiale en enseignement du français au secondaire et enseignaient depuis quelques années le français. Ce second élément constituait aussi pour nous une condition indispensable en raison de la complexité de la mise en œuvre de l’approche d’articulation. Il était donc nécessaire que les participantes aient une bonne connaissance des objets d’enseignement prescrits.
Dans le canton de Genève, deux enseignantes ont participé à la recherche: Estelle et Gisèle10 qui avaient respectivement neuf et quatre ans d’expérience. Ces deux enseignantes interviennent à la fois au secondaire I et au secondaire II, soit auprès d’élèves de 12 à 15 ans, dans deux écoles de Genève. Là aussi, ces participantes ont témoigné, dès le départ, un fort intérêt pour la recherche, ce qui a constitué pour nous un élément facilitateur. Toutefois, contrairement aux participantes de Québec qui avaient un profil plutôt orienté vers l’enseignement de la langue, Estelle et Gisèle étaient des littéraires avant d’être enseignantes de français.
Les principales phases de la recherche
Que ce soit à Québec ou à Genève, notre recherche s’est déroulée en respectant les quatre phases de l’ingénierie didactique: cadrage théorique, conception, observation et analyse des données.
La phase de cadrage théorique intervient au tout début du processus de la recherche, avant même la conception, et vise à mener une réflexion théorique et épistémologique qui s’appuie sur les connaissances didactiques déjà acquises dans le domaine. Cette phase, encore dite «d’analyses préalables», constitue le socle sur lequel reposent les dispositifs à construire. Concrètement, durant cette phase, nous avons eu plusieurs rencontres avec les participantes pour discuter à la fois de la notion d’articulation et des modalités de collaboration. Les premières rencontres ont été consacrées aux entretiens pré-expérimentaux qui visaient à dégager les représentations et les pratiques déclarées des enseignantes-participantes sur l’enseignement de la langue et des textes littéraires. Les autres rencontres de cette phase nous ont permis de préciser avec ces participantes certains aspects théoriques en lien avec la notion d’articulation, entre autres l’idée que le travail sur la langue et celui sur les textes doivent se nourrir mutuellement.
La seconde phase a été celle de la conception des dispositifs didactiques. Ainsi, pour l’élaboration de la séquence sur le slam avec les enseignantes-participantes de Genève, nous avons déterminé un corpus, discuté des notions à travailler, délimité la durée de l’expérimentation, fixé des objectifs didactiques et élaboré les différentes activités. Cette phase a fait de la négociation le socle de l’ingénierie didactique collaborative, puisque nous avons dû tenir compte à la fois des impératifs de notre recherche et de ceux des classes : contenus à enseigner et contraintes institutionnelles (nombres d’heures consacrées à la discipline, sorties pédagogiques, examens prévus de longue date, etc.). Toutefois, il parait important de préciser qu’en raison de la lourdeur des tâches des enseignantes, nous avons joué un rôle de médiation et d’organisation pour donner forme aux pistes que nous dégagions avec elles. Ainsi, après les rencontres, nous nous chargions d’élaborer les différents modules11 d’enseignement et de les soumettre ensuite à l’appréciation des participantes. Elles formulaient des commentaires que nous intégrions par la suite dans ces modules. Le processus était donc itératif et spiralaire puisque les enseignantes avaient même la possibilité de modifier les dispositifs avant et pendant l’expérimentation. Lorsque cela se produisait, nous en discutions pour connaitre les raisons de ces changements et intégrions, par la suite, les ajustements dans le dispositif final qui, lui, ferait l’objet d’une double expérimentation par des enseignantes non auteures des séquences d’enseignement.
La troisième phase, dite d’observation, est consacrée à l’expérimentation des dispositifs construits. Nous l’avons subdivisée en deux phases: expérimentation et double expérimentation. Dans un premier temps, nous avons filmé la mise en œuvre des séquences dans les classes sans intervenir. Toutefois, puisqu’elles en avaient le droit, certaines participantes ont refusé d’être filmées lors de l’expérimentation des dispositifs. Ainsi, à Genève, nous avons pu filmer deux expérimentations sur les trois prévues12. Au Québec, pour la séquence sur la fable, ce sont deux enseignantes sur quatre qui ont été filmées. Que ce soit à Genève ou au Québec, les enseignantes dont les expérimentations n’ont pas fait l’objet de captations vidéo ont rempli un journal de bord détaillé que nous avions préparé à cet effet. Après ces premières expérimentations, nous avons réalisé avec les participantes des entretiens post-expérimentations qui visaient à faire un bilan de la mise en œuvre des séquences pour y apporter les derniers ajustements avant la double expérimentation avec d’autres enseignantes. Ces entretiens post-expérimentations se voulaient aussi le cadre d’une démarche réflexive à travers laquelle nous entendions amener les enseignantes à porter un regard méta sur l’ensemble de la collaboration: qu’est-ce que le fait de coélaborer avec nous les séquences leur a apporté de plus lors de leur mise en œuvre, mais aussi dans leurs pratiques? Considèrent-elles qu’elles se sont mieux approprié de cette façon les contenus et démarches?
Après les ajustements apportés aux séquences à la suite du bilan réalisé avec les enseignantes participantes de la première expérimentation de la séquence sur le slam à Genève, nous avons fait expérimenter cette séquence au Québec par quatre autres enseignantes afin de voir dans quelle mesure elles s’appropriaient des dispositifs qu’elles n’avaient pas coélaborés. En clair, cette double expérimentation visait à apporter une réponse à une de nos questions de recherche: que se passe-t-il pour l’expérimentation de séquences didactiques avec des conditions d’élaboration et de mise en œuvre différentes? Nous avons suivi le même processus pour la séquence portant sur la fable coélaborée avec une enseignante de Québec: nous l’avons soumise à trois enseignantes de la région de Québec et à Estelle13 du canton de Genève pour une double expérimentation après les ajustements apportés à la suite de la première expérimentation. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des différentes expérimentations que nous avons réalisées.
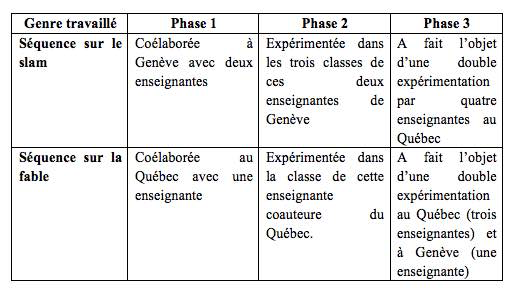 Finalement, la dernière phase est consacrée à l’analyse des données proprement dite. Nous n’abordons cependant pas cette question dans cet article puisque son objet est tout autre. Nous limitons notre réflexion à l’apport de l’ingénierie didactique collaborative dans le processus d’élaboration, d’appropriation et de mise en œuvre de dispositifs didactiques.
Finalement, la dernière phase est consacrée à l’analyse des données proprement dite. Nous n’abordons cependant pas cette question dans cet article puisque son objet est tout autre. Nous limitons notre réflexion à l’apport de l’ingénierie didactique collaborative dans le processus d’élaboration, d’appropriation et de mise en œuvre de dispositifs didactiques.
Les critères de validation des dispositifs
À terme, nous voulions rendre disponibles des dispositifs éprouvés et validés qui seraient alors transposables dans des classes de français. Pour ce faire, il nous a semblé important de définir des critères qui permettraient de valider ces dispositifs. En nous référant aux réflexions de Dolz et alii. (2001) sur l’ingénierie didactique et en prenant en compte les trois pôles du triangle didactique (Halté, 1992), nous avons déterminé trois critères de validation.
Le premier critère est lié aux objets enseignés. Rattaché aux savoirs dans le triangle didactique, ce critère vise à répondre à une question : est-ce que la transposition des savoirs a été possible? Nous avons choisi d’étudier ce pôle objet par le biais de l’analyse du travail enseignant (Schneuwly & Dolz, 2010): comment les enseignants s’approprient-ils et mettent-ils en œuvre des séquences d’enseignement portant sur une approche aussi difficilement appréhendable que celle de l’articulation?
Le second critère est lié aux élèves. Ce critère visait à répondre à la question: est-ce que les élèves progressent dans leurs apprentissages? Nous avons étudié ce critère avec le regard des enseignants lors du bilan collaboratif et des productions finales que nous avons observées. En effet, dans la séquence sur le slam, tant lors des premières expérimentations qu’au moment des doubles-expérimentations, les élèves ont produit des textes, que nous avons considérés comme des productions initiales (Dolz et alii., 2001). Ceux-ci ont été réalisés en début de séquence, donc avant même le début des apprentissages. Au terme de la séquence, ils ont produit un autre texte en s’appuyant sur les différentes notions travaillées. Entre ces deux productions, il y a eu des écrits intermédiaires qui consistaient pour les élèves à bonifier leur production initiale en y intégrant au fur et à mesure les notions travaillées dans les différents modules. Même si notre focale n’était pas le travail des élèves, il s’agissait notamment pour nous, sans nécessairement attester de profonds changements, de voir, à partir de ces productions et des observations des enseignants, dans quelle mesure le travail effectué dans le cadre de l’expérimentation a aidé, ou pas, les élèves dans leurs apprentissages.
Le troisième critère qui nous permet de conférer une validité à nos dispositifs est la double-expérimentation. Ce critère, qui renvoie au pôle enseignant dans le triangle didactique, visait à voir dans quelle mesure des enseignants, différents de ceux ayant collaboré à l’élaboration des dispositifs, étaient eux aussi capables de s’approprier ces dispositifs et de les mettre en œuvre dans leur classe. Pour ce faire, nous avons défini trois indicateurs à partir desquels nous analysons cette double expérimentation: la mise en œuvre complète ou non de la séquence, l’ampleur des modifications apportées pour conduire à terme la séquence (activités, outils et divers obstacles didactiques ou cognitifs) et le point de vue des enseignants recueilli lors de l’entretien post-expérimentation.
Les apports et les défis d’une telle méthodologie
L’approche méthodologique que nous avons adoptée dans le cadre de cette recherche permet d’apporter une dimension nouvelle à la recherche collaborative en éducation. Tous les choix que nous avons faits ont été concertés, négociés et validés par l’ensemble des intervenants. Nous pouvons ainsi, à la lumière du parcours qui a été le nôtre dans cette recherche, focaliser notre attention sur quatre points que nous qualifierons de saillants.
D’abord, notre position nous permet de porter un regard méta sur l’ensemble de la démarche. Tout au long du processus, quelle que soit la phase en question, quel que soit le pays et quelles que soient les enseignants impliqués, la recherche a été marquée par des allers et retours visant à faire des ajustements mélioratifs avant, pendant et après leur mise en œuvre dans les classes. Il y avait ainsi une ouverture de notre part et de la part des enseignantes tant sur les notions enseignées que sur les modalités pédagogiques. Chaque étape s’est déroulée dans la négociation et la concertation. Cela a d’ailleurs permis de surmonter certains obstacles et défis14 qui émergent lorsqu’un enseignant doit planifier ou concevoir seul des séquences d’enseignement. Autrement dit, le travail d’équipe induit une réflexion qui enrichit les objets enseignés et les modalités de travail. Cette collaboration, telle qu’elle a été menée, est donc de nature à contribuer au développement professionnel des enseignants-participants comme le soulignent Richard, Carignan, Gauthier & Bissonnette (2015). Ces chercheurs, au terme d’une méta-analyse sur les modèles de formation continue efficaces, soutiennent en effet que le travail collaboratif constitue un des principes clés de l’efficacité du développement professionnel, car il induit une démarche de pratique réflexive à travers les échanges.
Le second point est en lien avec la mise en œuvre des séquences. En effet, du point de vue des enseignantes qui ont participé à cette recherche, leur implication dans toutes les phases de la recherche (du choix du corpus à celui des modalités pédagogiques aidantes) a permis d’ancrer la recherche dans leur quotidien et de réduire considérablement les barrières (réticence des enseignants à ouvrir leurs portes aux chercheurs, perception selon laquelle les recherches seraient déconnectées des réalités de terrain, etc.) qu’elles avaient jusqu’alors perçues entre les chercheurs et elles. Elles soutiennent donc que cette implication a amoindri l’effort d’appropriation qu’elles auraient dû déployer et que, finalement, cela représente des gains en termes d’apprentissage parce que les objets d’enseignement et les démarches pédagogiques sont mieux maitrisés.
Le troisième point saillant repose sur la double expérimentation qui constitue un test de validité des dispositifs expérimentés. En comparaison avec les enseignants-coauteurs, ceux qui réalisent la double expérimentation déploient un effort plus grand pour s’approprier les séquences d’enseignement. Cet effort d’adaptation peut constituer un réel obstacle, notamment quand il est question d’approche complexe comme celle de l’articulation des composantes de la discipline français.
Les entretiens post-expérimentation que nous avons effectués permettent de dégager comme quatrième point saillant la façon dont les enseignantes se sont senties respectées et valorisées durant tout le processus. Loin d’être anodin, ce sentiment de valorisation constitue un facteur important dans la réduction de l’écart qui a toujours existé entre le monde de la recherche et celui des praticiens. Un tel rapprochement peut contribuer à l’amélioration des pratiques d’enseignement, car il pousse davantage les enseignants à intégrer les résultats de recherche dans leurs pratiques comme le fait remarquer le Conseil supérieur de l’Éducation (2006). Dans son rapport, le Conseil en arrive d’ailleurs à la conclusion qu’il existe un lien positif entre le rapprochement milieu de recherche – milieu de pratique et la mise en place par les enseignants de pratiques d’enseignement innovantes issues de la recherche. Le Conseil note aussi que les enseignants qui utilisent le plus les données issues de la recherche sont ceux qui y sont associés ou exposés d’une manière ou d’une autre.
Conclusion
Cet article avait pour objet de décrire la dynamique de la démarche d’ingénierie didactique collaborative que nous avons mise en œuvre dans une recherche portant sur l’articulation langue-texte au secondaire. Pour connaitre la manière dont des enseignants peuvent s’approprier et mettre en œuvre des séquences didactiques fondées sur l’approche de l’articulation langue-texte, nous avons fait le choix de les associer à l’ensemble du processus de conception de ces séquences. Puis, d’autres enseignants sont venus tester ces dispositifs pour, entre autres, nous permettre d’en mesurer la validité. La démarche d’ingénierie didactique à double perspective que nous avons ainsi adoptée présente, selon nous, plusieurs intérêts:
- - le chercheur est moins perçu par les enseignants comme le savant qui apporterait sa vérité;
- - les dispositifs élaborés et testés répondent à des problématiques qui sont au cœur de la pratique enseignante;
- - le développement professionnel des enseignantes-participantes est favorisé;
- - l’enrichissement de notre expertise en tant que chercheur est aussi favorisé puisque celle-ci se nourrit des réalités du terrain.
De façon générale, nous constatons que la forme de collaboration établie, dans notre recherche, avec les enseignantes-participantes a grandement facilité le déploiement des objets d’enseignement choisis et notre intégration dans le milieu, puisque ces enseignantes se sont senties parties prenantes, donc beaucoup plus investies que nous ne l’avions imaginé. Il y aurait donc une nécessité à creuser cette avenue en donnant plus de place aux praticiens que sont les enseignants dans nos recherches si nous voulons que celles-ci atteignent leurs finalités.
Bibliographie
Adam, Jean-Michel (1991). Langue et littérature: analyses pragmatiques et textuelles. Paris, Hachette.
Aeby Daghé, Sandrine (dir.) (2011). Enseigner la langue et la littérature: des dispositifs pour penser leur articulation. Collection «Diptyque». Namur, Presses universitaires de Namur.
Armand, Anne, Descottes, Michel, Jordy, Jean et Langlade, Gérard (1992). La séquence didactique en français. Toulouse, Bertrand-Lacoste.
Aron, Paul, et Viala, Alain (2005). L'enseignement littéraire. Paris, Presses Universitaires de France. (Que sais-je?).
Artigue, Michèle (1996). «Ingénierie didactique». Publications mathématiques et informatiques de Rennes, S6, 124-128.
Artigue, Michèle (1996). «Ingénierie didactique». Dans Brun, J. (dir.) Didactique des mathématiques (p. 243-274). Lausanne, Paris, Delachaux et Niestlé.
Bednarz, Nadine (dir.) (2013). Recherche collaborative et pratique enseignante: regarder ensemble autrement. Paris, L’Harmattan.
Besson, Marie-Josèphe, Genoud, Rose-Marie, Lipp, Bertrand et Nussbaum, Roger (1979). Maitrise du français. Lausanne, Office romand des éditions et du matériel scolaire.
Biao, Florent (2016). «L’articulation langue-littérature : effet de mode ou véritable solution pour le développement des compétences langagières des élèves du secondaire?» Dans Formation et Profession, hors série.
Biao, Florent (2015). Articulation de l’étude de la langue à l’étude des textes littéraires: analyse critique de manuels du secondaire québécois. Mémoire de maitrise non publié, Québec, Université Laval, 202 p. [En ligne] https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/26218
Bilodeau, Sylvain (2005). Le décloisonnement des activités dans la classe de français: analyse d'écrits didactiques. Mémoire de maitrise non publié, Québec, Université Laval, 136 p.
Bilodeau, Sylvain et Chartrand, Suzanne. (2009). «Décloisonner les différentes sous-disciplines du français: conception et pratiques». Québec français, 153, 79-81.
Bronckart, Jean-Paul (2001). Enseigner la grammaire dans le cadre de l’enseignement rénové de la langue. Genève, DIP, Cahier du secteur des langues, 75.
Bronckart, Jean-Paul. (2014). «Le rapport du Groupe Bally. Le projet de rénovation de l’enseignement du français en Suisse romande». Recherches en didactiques. Les cahiers Théodile, 17, 67-91.
Bronckart, Jean-Paul (2016). «Éléments d’histoire des réformes de l’enseignement grammatical depuis un demi-siècle». Dans Chartrand, S.-G. (dir.), Mieux enseigner la grammaire (p. 7-25). Montréal, Erpi Éducation.
Chevallard, Yves (2009). «La notion d’ingénierie didactique, un concept à refonder». 15e école d’été de didactique des mathématiques. En ligne http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/article.php3?id_article=144
Coirault, Déborah et David, Jacques (2011). «Interactions langue-littérature et approches didactiques: étude de manuels de troisième du collège». Le français aujourd'hui, 175, 25-34.
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (2006). Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations. Neuchâtel, CIIP.
Conseil supérieur de l’Éducation. (2006). Le dialogue entre la recherche et la pratique en éducation : une clé pour la réussite. Québec, Conseil supérieur de l’Éducation.
Desgagné, Serge (1997). «Le concept de recherche collaborative: l'idée d'un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants». Revue des sciences de l'éducation, 23(2), 371-393.
Desgagné, Serge, Bednarz, Nadine, Lebuis, Pierre, Poirier, Louise et Couture, Christine (2001). «L’approche collaborative de recherche en éducation: un rapport nouveau à établir entre recherche et formation». Revue des sciences de l’éducation, 27, 33-64.
Dolz, Joaquim et Simard, Claude (2009). Pratiques d’enseignement grammatical : points de vue de l’enseignant et de l’élève. Québec, Les Presses de l’Université Laval.
Dolz, Joaquim et Gagnon, Roxane (2008). «Le genre du texte, un outil didactique pour développer le langage oral et écrit». Pratiques, 137/138, 179-198.
Dolz, Joaquim, Noverraz, Michèle et Schneuwly, Bernard (2001). S’exprimer en français: séquences didactiques pour l’oral et l’écrit. Bruxelles, De Boeck.
Douady, Régine (1994). «Ingénierie didactique et évolution du rapport au savoir». Repères, 15, 1-25
Dufays, Jean-Louis., Gemenne, Louis et Ledur, Dominique (2005). Pour une lecture littéraire : histoire, théories, pistes pour la classe (3e éd). Bruxelles, De Boeck.
Falardeau, Érick, Fisher, Carole, Simard, Claude et Sorin N. (dir.) (2007). La didactique du français. Les voies actuelles de la recherche. Québec, Les Presses de l’Université Laval.
Falardeau, Érick (2010). La compétence langagière des étudiants au collégial et à l’université: essai de définition didactique. Québec, Réseau Fernand-Dumont en ligne : www.rfd.fse.ulaval.ca
Falardeau, Érick et Simard, Denis (2011). La culture dans la classe de français : témoignages d'enseignants. Québec, Les Presses de l’Université Laval.
Lebrun, Marlène, Rouxel, Annie et Vargas, Claude (2007). La littérature et l’école: enjeux, résistances, perspectives. Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence.
Lessard-Hébert, Michelle (1997). Recherche-action en milieu éducatif. Guide méthodologique pour la réalisation de projets individuels. Montréal: Éditions Nouvelles.
Marmy Cusin, Véronique (2012). Développer et comprendre des pratiques d'enseignement de la grammaire, intégrées à la production textuelle : entre les dires et les faires. (Thèse de doctorat). Université de Genève.
Martineau, Stéphane (2005). «L'observation en situation: enjeux, possibilités et limites». Recherches qualitatives, hors série (2), 5-17
Mercier, Julien (2010). Collaborative and individual learning in teaching: a trajectory to expertise in pedagogical reasoning. Hauppauge, NY, Nova Science Publishers.
Miaralet, Gaston (2004). Les méthodes de recherche en science de l’éducation. Paris : PUF.
Morissette, Joëlle (2013). «Recherche-action et recherche collaborative: quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs?» Nouvelles pratiques sociales, 25, 35-49.
Musial, Manuel, Pradère, Fabienne et Tricot, André (2012). «L’ingénierie didactique, une démarche pour enseigner rationnellement». Technologie, 180, 54-59.
Reuter, Yves (1992). «Enseigner la littérature?» Recherches, 16, 55-70.
Reuter, Yves (2007). «Conscience disciplinaire. Présentation d’un concept.» Éducation et didactique, 2 (1), 55-71.
Richard, Mario, Carignan, Isabelle, Gauthier, Clermont et Bissonnette, Steve (2015). Quels sont les modèles de formation continue les plus efficaces pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire? Une synthèse des connaissances. Rapport de recherche. Québec, Fonds de recherche société et culture.
Simard, Claude (1997). Éléments de didactique du français langue première. Montréal, Erpi.
Simard, Claude, Dufays, Jean-Louis, Dolz, Joaquim et Garcia-Debanc, Claudine (2010). Didactique du français langue première. Bruxelles, De Boeck.
Schneuwly, Bernard et Dolz, Joaquim (2010). Des objets enseignés en classe de français. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Vermesh, Pierre (2010). L’entretien d’explicitation (6e éd., enrichie d’un glossaire). Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur.
Pour citer l'article
Florent Biao, Érick Falardeau & Marie-Andrée Lord , "Ingénierie didactique collaborative de seconde génération: le cas de l'articulation langue-texte", Transpositio, n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/ingenierie-didactique-collaborative-de-seconde-generation-le-cas-de-l-articulation-langue-texte
Voir également :
La recherche de type collaboratif: un espace de formation à et par la recherche
La recherche qui fait l’objet de la présente étude, et que nous analyserons du point de vue du groupe formé par les enseignant-e-s, les enseignant.e.s-formateurs.trices et l’enseignante-chercheure qui la dirigeait, s’est déroulée pendant quatre ans, de 2009 à 2013{{Les réunions se sont tenues quatre ou cinq fois par année scolaire (dix-huit réunions avec toute l’équipe), pour une durée de trois ou quatre heures chacune.}}, dans le cadre de l’IUFM{{Institut Universitaire de Formation des Maîtres, devenu Espé (École Supérieure du Professorat et de l’Education) en 2013.}} de l’académie de Versailles. Sa visée consistait à expérimenter des démarches didactiques de lecture littéraire qui articulent écritures individuelles diverses de réception et échanges oraux collectifs sous la forme de cercles de lecture et/ou de débats interprétatifs.
La recherche de type collaboratif: un espace de formation à et par la recherche
La recherche qui fait l’objet de la présente étude, et que nous analyserons du point de vue du groupe formé par les enseignant.e.s, les enseignant.e.s-formateurs.trices et l’enseignante-chercheure qui la dirigeait, s’est déroulée pendant quatre ans, de 2009 à 20131, dans le cadre de l’IUFM2 de l’académie de Versailles. Sa visée consistait à expérimenter des démarches didactiques de lecture littéraire qui articulent écritures individuelles diverses de réception et échanges oraux collectifs sous la forme de cercles de lecture et/ou de débats interprétatifs. Elle a permis, d’une part, de mettre au jour les effets, sur les apprentissages des élèves, de ces démarches expérimentées dans les classes avant la publication des programmes français actuels des cycles 3 et 4 (MENESR 2015), et, d’autre part, d’identifier les gestes professionnels susceptibles de favoriser ces apprentissages. Elle a donné lieu à une publication collective en 2013, sous la direction de Sylviane Ahr : Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée –Expérimentations et réflexions, CRPD de Grenoble3.
Définissant et analysant les enjeux d’une recherche-action et ceux d’une recherche collaborative, Joëlle Morissette établit la distinction suivante:
La recherche-action consiste en une stratégie de changement planifié s’exerçant au cœur d’un processus de résolution de problèmes [Savoie-Zajc 2001], alors que la recherche collaborative renvoie plutôt à une démarche d’exploration d’un objet qui conduit à la coconstruction de savoirs autour d’une pratique professionnelle [Desgagné 1998]. (Morrissette 2013 : 36-37)
Selon cette définition, la recherche qui nous occupe se trouve à la croisée de la recherche-action –pour sa visée de transformation des pratiques enseignantes– et de la recherche collaborative –comme coconstruction de savoirs rapprochant monde de la recherche et monde de la pratique professionnelle autour de l’expérimentation des cahiers de lecture et des débats interprétatifs comme outils pour former les élèves à la lecture littéraire. Le point commun de ces deux formes de recherche est leur «visée praxéologique» (Dufays 2006 : 147) qui permet de faire des enseignant.e.s qui s’y engagent des actrices et des acteurs de la production des savoirs, et non de simples «exécutants […] d’un savoir produit par la recherche» (Morrissette 2013 : 47).
De plus, l’expérience de la recherche s’inscrit alors dans un espace commun éphémère –mais prolongeable par des travaux qui le considèrent sous un angle renouvelé– défini par une temporalité limitée et partagée de façon globalement synchrone par les différents membres du groupe. Pour ces derniers, l’espace créé se matérialise simultanément à plusieurs niveaux (celui du travail avec la classe, celui du travail avec l’équipe de recherche) par des rencontres physiques et la circulation de communications écrites (cahiers de lecture, courriers électroniques, articles) et orales (débats interprétatifs, discussions, présentations), où se découvrent, s’échangent et s’enrichissent les paroles d’élèves, d’enseignant.e.s, de chercheur.e.s. Superposant ainsi, d’une part, les différents espaces professionnels physiques que sont le terrain (la salle de classe) et les lieux de travail (dont le domicile personnel, les salles de réunion), et, d’autre part, le réseau immatériel des réflexions que chacun.e sollicite et au sein duquel chacun.e rend compte de ses expérimentations, l’espace de recherche se redimensionne au fur et à mesure des avancées du travail personnel et commun et engendre divers types de formalisations pratiques et théoriques. Il permet la constitution d’un répertoire commun de références à travers lequel se développe une dynamique collective créatrice de nouveaux savoirs et savoir-faire.
Il y a donc lieu de se demander comment ce type de recherche constitue, pour les enseignant.e.s et formateurs.trices, un espace de formation à et par la recherche: dans quelle mesure cette expérience de recherche-action/recherche collaborative a-t-elle non seulement transformé nos pratiques professionnelles, mais a-t-elle aussi fait de nous des enseignant.e.s qui cherchent, des praticiennes et des praticiens réflexifs? Quels dispositifs ont favorisé ces transformations conceptuelles et praxéologiques? C’est ce que nous nous proposons d’analyser ici en privilégiant le point de vue enseignant, et en présentant d’abord le corpus et la méthodologie adoptés, avant d’examiner en quoi ce type de recherche est au service d’une articulation de la théorie et de la pratique en vue de former enseignant.e.s-chercheur.e.s, puis d’en évoquer les limites et les perspectives.
Corpus et méthodologie
Après avoir résumé l’objet de la recherche collaborative à laquelle nous avons participé, nous présenterons le corpus retenu pour la présente étude.
Objet et objectif de la recherche
Cette recherche, menée pendant quatre ans, visait à mettre en œuvre des démarches d’enseignement de la lecture littéraire fondées sur les théories de la réception des textes4 en permettant l’expression des lectures subjectives des élèves pour construire des compétences de lecture distanciée, via l’usage d’un cahier de lecture et la pratique des débats interprétatifs. Les propositions établies par l’équipe ont consisté d’abord à poser des questions analogiques ou axiologiques5 auxquelles les élèves répondaient dans leur cahier après une première lecture du texte en autonomie. Prenant connaissance des réponses des élèves, l’enseignant.e pouvait alors formuler des interrogations propres à nourrir la confrontation des interprétations lors du débat en classe. Un temps de synthèse était enfin ménagé pour permettre le retour individuel au cahier et la construction de lectures plus distanciées. Le blog, comme autre outil propice, par le biais d’échanges écrits asynchrones, à la confrontation des lectures subjectives et à la coconstruction de lectures distanciées, a également été expérimenté par certain.e.s enseignant.e.s 6.
L’enquête-bilan
Afin de recueillir le bilan, cinq ans après, de l’expérience telle qu’elle a été vécue par les enseignant.e.s du groupe de recherche, je leur ai adressé, au printemps 2018, par courriel, les questions suivantes:
- - Quelles étaient vos motivations pour participer à cette expérimentation?
- - Que vous a apporté cette expérience de recherche-action?
- - A-t-elle changé quelque chose dans votre posture professionnelle, dans votre conception de la littérature et de l’enseignement/de la formation?
- - Quels manques pourriez-vous identifier pour que le dispositif puisse être plus productif?
Cet envoi a donné lieu à sept retours sur neuf participant.e.s, qui seront analysés dans cet article, et auxquels je mêlerai ponctuellement mon propre témoignage du point de vue enseignant.
Les articles de l’enseignante-chercheure
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux collectifs, l’enseignante-chercheure dirigeant cette recherche collaborative a publié plusieurs articles, dont trois font également partie de mon corpus, dans la mesure où ils fournissent des témoignages des participant.e.s, recueillis et analysés pendant l’expérimentation, ainsi que le point de vue de l’enseignante-chercheure sur son rôle auprès de l’équipe: un article de 2010 coécrit avec Patrick Joole, intitulé «Débattre et tenir un carnet à l’école et au collège» et paru dans la revue Le Français Aujourd’hui; un article de 2011, «Le carnet de lecteur de littérature au collège et au lycée: un dispositif expérimental misant sur une nouvelle approche de l’interaction lecture-écriture» paru dans la revue Dyptique; et un article de 2012 coécrit avec Patrick Joole, intitulé «Une recherche-action comme espace de reconfiguration des savoirs disciplinaires et didactiques et comme lieu de formation professionnelle», paru dans l’ouvrage Les didactiques en questions, états des lieux et perspectives pour la recherche et la formation.
Nous nous appuierons sur ces différents témoignages, analyses et auto-analyses pour déterminer en quoi ce type de recherche, au service de l’articulation entre pratique et théorie, constitue un espace de formation à la recherche et par la recherche, permettant aux enseignant.e.s d’approfondir et de consolider leur rapport réflexif à la discipline enseignée.
Un espace de formation à la recherche
Un regard sur le profil des participant.e.s et sur leurs motivations initiales permettra de mieux saisir en quoi, grâce à cette recherche, ils/elles ont pu découvrir ou mieux connaître le champ de recherche spécifique de la didactique de la littérature, ainsi que les méthodes qui lui sont associées.
Le profil des participant.e.s7
L’équipe travaillant sous la direction de l’enseignante-chercheure était constituée de dix enseignant.e.s et formateurs.trices8 (et cinq contributrices occasionnelles), la moitié en poste en collège et la moitié en lycée, de la sixième à la terminale, dans des établissements de types différents, du classement en zone prioritaire à l’établissement de centre-ville.
Les formateurs.trices engagé.e.s dans la recherche se sont rencontré.e.s au sein de l’IUFM. Les enseignantes qui ont été invitées à y participer ont été recrutées dans le cadre de leur formation initiale et continue: l’une (E3) lors d’un stage sur l’usage des blogs, l’autre (E2) lors de son Master 2 de formation de formateurs; la troisième (E1) était en lien avec l’enseignante-chercheure depuis son année de stage. À l’exception d’une participante (E3), tou.te.s connaissaient donc l’enseignante-chercheure menant la recherche avant de s’y engager, et les formateurs.trices se connaissaient déjà entre elles/eux.
Leurs motivations
La confiance ou l’estime à l’égard de l’enseignante-chercheure est d’ailleurs mentionnée dans les bilans par quatre participant.e.s (E1, EF1, EF6, EF7). Quatre d’entre elles/eux (E1, EF5, EF6, EF7) évoquent explicitement comme motivation leurs questionnements sur l’enseignement de la lecture et l’insatisfaction qu’il leur causait:
Mes motivations: le constat d'un manque d'intérêt assez généralisé des élèves de lycée pour les textes littéraires si on ne leur donnait pas l'occasion de se les approprier. (EF5)
Je n’étais pas satisfaite des séances de questions sur les textes, sans parvenir à aborder les choses autrement. Pour les lectures cursives, j’avais pris des idées sur la liste de discussion de Weblettres, mais pour la lecture analytique, je ne trouvais pas de solutions satisfaisantes. (E1)
Quatre participant.e.s (E2, EF1, EF4, EF7) mentionnent leur désir d’échanger sur leur pratique:
Mes motivations étaient de pouvoir échanger avec des collègues autour de pratiques pédagogiques, alors que je débutais encore dans l'enseignement (3e année) et que j'avais besoin de me nourrir des expériences apportées par les uns et les autres. (E2)
Motivations: le groupe constitué, que je connaissais par la formation continue et que j'avais trouvé porteur pour se sentir stimulé et continuer à bouger... profiter de la force des échanges, ne pas s'encrouter, avoir un regard bienveillant sur ses propres pratiques (échanges quasi-impossibles dans les établissements). (EF1)
Deux enseignant.e.s-formateurs.trices (EF4, EF7) parlent d’un désir déjà présent en amont «d'accéder à des connaissances en didactique de la littérature» ou de les «approfondir».
Deux participantes (E1, E3) soulèvent des difficultés rencontrées au début de l’expérimentation, l’une parce qu’elle avait pris la recherche en cours: «Il a fallu que je m'adapte avant de comprendre les enjeux», et l’autre parce qu’elle avait connu l’équipe des formateurs.trices de l’IUFM alors qu’elle était elle-même stagiaire, ce qui l’amenait à s’interroger sur sa légitimité à leurs côtés. Toutefois, ces difficultés se sont révélées solubles dans le caractère expérimental lui-même de la recherche collaborative, puisque chacun.e s’y voit placé.e sur un pied d’égalité en termes de mise en œuvre avec ses classes, a fortiori dans le cadre d’une recherche liée à des théories récentes comme celles de la réception des textes littéraires et du sujet lecteur. Serge Desgagné le rappelle d’ailleurs, c’est le «concept même de collaboration» qui permet que chacun.e trouve sa place depuis ses questionnements propres:
[…]chaque type de partenaires [peut] s'y engager à partir de ses préoccupations et de ses intérêts respectifs (St-Arnaud 1986), des préoccupations et des intérêts qui sont mobilisés, entre autres, par les exigences mêmes de la fonction qu'ils exercent, chacun de leur côté, et qui les réunit dans le projet collaboratif. (Desgagné 1997 : 377)
La découverte d’un champ de recherche spécifique
Les enseignant.e.s, selon leurs «préoccupations» et leurs «intérêts respectifs», ont tou.te.s, grâce à cette recherche collaborative, découvert la recherche en didactique de la littérature avec ses spécificités propres, ou approfondi leur approche de ses enjeux et de ses méthodologies.
Ce sont les apports théoriques de l’enseignante-chercheure, notamment sur la réception des textes littéraires et sur les concepts de sujet lecteur et de lecture littéraire, qui ont d’abord marqué les participant.e.s. Ils/elles ont ainsi pu renouveler les conceptions et les fondements épistémologiques sur lesquels s’appuyait leur enseignement de la littérature, et se familiariser avec les autres champs des sciences humaines et sociales abordés dans les articles et ouvrages proposés –sociologie de la lecture, philosophie esthétique, sciences cognitives–, alors que leur formation universitaire avait été principalement fondée sur les théories du texte et les effets programmés par le texte. L’importance de cette dimension était soulignée par les enseignant.e.s dès 2011, dans les questionnaires analysés par l’enseignante-chercheure:
L’ancrage théorique proposé a été essentiel. Les nombreux articles, lectures, comptes rendus de recherches… régulièrement communiqués m’ont été extrêmement précieux,parce que j’ai peu de temps à consacrer à ce travail en cours d’année, et, bien sûr, en raison de leur intérêt.
Un membre de l’équipe déclare avoir acquis “une perception plus précise de démarches pour faire interpréter des élèves grâce à l’épaississement de la notion d’interprétation elle-même”. (Ahr & Joole 2012 : 96 et 93)
Ces apports ont constitué la possibilité pour les participant.e.s d’enrichir leur pratique par une meilleure connaissance des théories actuelles sur lesquelles est appelé à se fonder l’enseignement de la littérature. En outre, la recherche ayant pris place dans le cadre de l’IUFM, elle se trouvait ainsi, dès les premières réflexions du groupe et les premiers essais en classe, légitimée par l’Institution. Ce double étayage scientifique et institutionnel a donc garanti aux enseignant.e.s préservation et protection de leur identité professionnelle, leur permettant de se sentir autorisé.e.s à expérimenter des démarches qui ne figuraient pas encore dans les textes officiels, comme l’enseignante-chercheure le souligne:
[Il] est difficile de modifier frontalement des conceptions liées à des croyances installées. Des propositions pédagogiques inhabituelles ou différentes apparaissent en effet aux professeurs comme autant de remises en cause de leur identité professionnelle. C’est pourquoi, il est nécessaire, dans le cadre de la formation, de porter à la connaissance des enseignants un certain nombre de savoirs de référence liés à la lecture de la littérature. (Ahr & Joole 2010 : 79)
Plus de sept ans après les premiers questionnaires, cinq participant.e.s (E1, E2, EF1, EF4, EF7) mentionnent la place décisive de ces apports, comme le fait, de façon très positive, l’une des enseignantes:
Cette expérience de recherche-action m'a permis d'opérer des allers-retours entre théorie et pratique, et de conceptualiser les postures de lecteurs dans mes classes. Cela m'a permis aussi de réaliser que les postures de lecteurs présentes dans la vie réelle existent dans nos classes. (E2)
Cette dernière remarque sur les postures de lecteurs «dans la vie réelle» et «dans nos classes» montre combien ces éclaircissements théoriques, loin d’éloigner les participant.e.s des enjeux praxéologiques, ont pu au contraire ancrer davantage leur pratique dans la prise en compte des élèves comme sujets lecteurs réels et combien, lorsqu’elle est actualisée par l’expérimentation, la théorie prend tout son sens : «de quoi réconcilier avec le jargon de la didactique/pédagogie...», note ainsi EF1.
La découverte de méthodes de recherche spécifiques
L’apprentissage de l’interprétation concernait en effet à la fois les élèves et les enseignant.e.s: pour les un.e.s, l’interprétation d’un texte littéraire, pour les autres, celle des différents types de données utilisées lors de la recherche –captations vidéo de séances, écrits des élèves (extraits des cahiers de lecture, réponses à un questionnaire en fin d’année), comptes rendus d’expérimentation des autres enseignant.e.s. Il s’agissait d’intégrer le regard distancié des chercheur.e.s, notamment par un «effet miroir» (Ahr 2011) avec l’enseignante-chercheure qui dirigeait la recherche, puisque l’une des visées était de se former, par la recherche, à la recherche et de devenir à notre tour des «enseignants-chercheurs» (Elliott 1990). Par l’intériorisation du regard critique, l’objectif était d’acquérir la capacité d’évaluer de façon autonome l’efficacité et la pertinence de nos gestes professionnels et d’adopter un ethos de «praticien réflexif, qui aborde sa pratique dans une perspective de perfectionnement continu» (Desgagné 1997 : 376). Joëlle Morrissette, expliquant le modèle d’acteur de Schön, parle à ce propos d’«une épistémologie de l’agir» selon laquelle se construit chez les praticien.ne.s «un répertoire d’actions» au fur et à mesure qu’ils/elles analysent des situations problématiques (Morrissette 2013 : 38).
Un exemple d’échange avec l’enseignante-chercheure mettra en évidence ce processus. Au fil de l’expérimentation, cette dernière nous fournissait, à côté de nombreuses références concernant la lecture littéraire, les articles qu’elle était amenée à rédiger. Ainsi ai-je lu dans l’un d’eux l’analyse d’une des réactions que j’avais eue en classe lors d’un débat sur un poème de Cocteau (et que j’avais décrite dans un compte rendu), à propos de diverses analogies sonores proposées par les élèves:
Comme il aurait été aisé* de s’appuyer sur ces «impressions fugaces» pour mener un débat interprétatif particulièrement ouvert!
* Le professeur n’a hélas pas perçu, à la lecture des carnets, cette voie qui s’offrait à lui. (Ahr 2011 : 165)
Deux ans plus tard, comme en témoigne un écrit datant de février 2012 préparatoire à la rédaction d’une partie de l’ouvrage collectif, j’étais en capacité d’analyser la situation de classe tout comme d’articuler les problèmes qui se posent dans l’immédiateté de la pratique et les avancées méthodologiques effectuées au sein de l’équipe:
J’ai voulu trop orienter les élèves en partant d’une problématique déjà intellectualisée, au lieu de m’appuyer sur la diversité de leurs impressions sonores par exemple. […] Ce qui m’a empêché de saisir cette opportunité, mise à part la crainte de ne pas maîtriser ce qui se dirait […], a été de ne pas prévoir de retour au classeur après le débat. En effet, je me suis aperçue ensuite qu’il était de ce point de vue libérateur de laisser émerger les problématiques lors du débat, puis de les canaliser et les organiser dans le cadre d’un cours noté dans le classeur […]. Si je ne le fais pas, cela revient à chercher à faire dire aux élèves lors du débat ce que j’aurais voulu traiter en cours [...] et je ne laisserai donc pas le débat avoir lieu9.
Cet exemple met en évidence la circulation entre savoirs en construction et savoirs institués. L’acquisition d’une plus grande réflexivité professionnelle et de la capacité à articuler théorie et pratique dans le cadre de la recherche collaborative entraîne en effet une formulation plus distanciée des analyses, à son tour productrice de nouveaux savoirs et savoir-faire à la fois dans la pratique de classe et dans la recherche. L’approfondissement de la réflexion sur la pratique, étayée par de nouvelles références théoriques, rend possible la poursuite de la formation et la circulation des savoirs construits.
Un espace de formation par la recherche
La recherche comme espace de partage en acte, au sein duquel s’opèrent des déplacements personnels et professionnels, collectifs et individuels, constitue une formation menant à la redéfinition du sujet enseignant comme «enseignant.e-chercheur.e» capable de transmettre aux pairs et à la communauté scientifique les savoirs et savoir-faire élaborés, grâce à une réflexion sur les critères et les conditions de validité des démarches expérimentées.
La recherche comme espace de partage
Comme nous l’avons vu plus haut, participer à un échange sur les pratiques était une des premières motivations de plusieurs des enseignant.e.s engagé.e.s dans la recherche. Ainsi, deux d’entre elles disent y avoir trouvé un «partage de pratiques […] très précieux » (E3) et «beaucoup de points de vue innovants sur l'enseignement» (EF1). L’importance des réunions au cours desquelles les participant.e.s rendaient compte et discutaient de leurs expérimentations et interrogations, sous la houlette de l’enseignante-chercheure, est apparue également dès le début de la recherche, ainsi que le note cette dernière en 2012:
La mutualisation des expériences et les échanges que celle-ci a engendrés ont nourri la réflexion collective. Un membre de l’équipe confie:
J’ai beaucoup apprécié la réunion de samedi, je l’ai trouvée passionnante et j’apprécie énormément le fait que nous partagions tous nos certitudes, nos doutes et nos réticences. Plus on avance, plus l’horizon s’éclaircit. (Ahr & Joole 2012 : 94)
Joëlle Morrissette explique le processus à l’œuvre lors de ces rencontres, qui fait pleinement écho à l’effet de distanciation permis par le débat interprétatif autour des lectures subjectives tel qu’il a été expérimenté dans les classes par l’équipe:
[Les] moments de rencontres collectives revêtent une grande importance puisqu’ils servent de lieu d’objectivation de la démarche et des pratiques, les échanges favorisant le croisement de différents points de vue qui se transforment et s’approfondissent dans l’intersubjectivité. (Morrissette 2013 : 40)
Le rôle déterminant des échanges entre pairs –enseignant.e.s comme élèves– s’explique, comme le souligne Dominique Bucheton, et suivant les travaux de l’interactionnisme social, par le fait que le «langage est un système d’ajustement de la dynamique de la pensée à celle des échanges avec les autres» (Bucheton 2002 : 2) et que la réflexivité se forme par les échanges de points de vue et la distanciation qu’ils permettent de construire collectivement.
Une redéfinition du sujet
Dans ce processus, le rôle de l’écrit individuel est de permettre au sujet de ne pas se diluer dans les échanges collectifs. Les enseignant.e.s rédigeaient ainsi, pour la majorité d’entre eux/elles, des comptes rendus d’expérimentation envoyés régulièrement à l’enseignante-chercheure, comprenant des descriptions de séances, avec leur perception des effets de la démarche sur la classe et sur eux/elles-mêmes. Les impressions et les sensations des enseignant.e.s avaient donc toute leur place, comme l’avaient celles des élèves, avant et après le débat, via leurs réponses individuelles aux questions dans le cahier de lecture, ce dernier devenant «un outil cognitif favorisant l’activité interprétative d’un sujet non pas seulement épistémique mais aussi social et affectif (Javerzat 2009)» (Ahr & Joole 2012 : 90).
Le déplacement de focalisation de «l’objet lu» à «la réception empirique des textes par les sujets lecteurs» et aux activités permettant la construction d’une «lecture subjective argumentée» (Ahr & Joole 2012 : 91) a donc d’abord été un déplacement conceptuel expérimenté par les enseignant.e.s eux/elles-mêmes dans leurs représentations les plus ancrées : représentations de la littérature, de la place de l’élève et du/de la professeur.e, de la domination des savoirs cognitifs sur les émotions et les perceptions. Une enseignante devenue psychologue décrit ce déplacement fondamental:
Je pense que j'ai joint à ma fonction de transmission en tant qu'enseignante celle de réception, sans jugement a priori, des sensations, sentiments et points de vue des élèves. Je continue à avoir une fonction de formation d'adultes dans une école de psychothérapie et au fond je fais des liens pour ce qui est de l'écoute, de la réception de la parole avec ce que nous avons mis en place pour la lecture littéraire. (EF5)
Et cette primauté de la réception est l’inverse d’une passivité, puisque le propre de la parole scolaire, c’est d’apprendre à «être auteur», comme l’explique Dominique Bucheton:
Le propre de la parole scolaire, c’est que ce n’est ni la parole de la rue, ni de la famille, c’est une parole du travail intellectuel. […]
J’écris, je lis un peu, je parle un peu, je réécris, je relis, je reformule, je déplace et de tout ce magma va finir par émerger quelque chose d’un peu plus clair. […]
C’est tout ce tâtonnement, ce dosage entre enseigner et faire apprendre qui construit une identité de sujet scolaire. Et être un sujet scolaire, c’est avoir construit le sens de ce qu’on fait à l’école, c’est l’avoir accepté, c’est participer avec des émotions, des affects, un langage, un parcours, la capacité à avoir un point de vue, à être auteur. (Bucheton 2002 : 6)
Qu’on soit élève ou enseignant.e, devenir auteur.e de sa parole, en tant qu’on s’y investit, qu’on s’y renouvelle et qu’on s’en approprie réflexivement les enjeux, permet de transposer et transmettre les savoirs et les savoir-faire acquis et construits.
La capacité à transposer les savoirs
La capacité pour le sujet qui les possède à transposer les savoirs, à les réinvestir dans d’autres contextes et avec d’autres outils, garantit, à partir de ces déplacements, la circulation des savoirs et la création de nouveaux savoirs. De tels déplacements et réajustements des conceptions et des gestes professionnels apparaissent dans les réponses de 2018:
Concernant ma posture professionnelle, cela a changé beaucoup de choses... J'ai généralisé le débat interprétatif, je ne vois pas comment faire autrement maintenant. (E3)
J'ai ensuite décidé de transposer ce que j'avais expérimenté à l'échelle d'une œuvre (portraits chinois dans les cahiers de lecture) dans mon quotidien pour chaque séance de découverte d'un texte (lectures analytiques, questions "portraits chinois" pour partir du sujet lecteur afin de construire des interprétations des extraits). (E2)
La circulation et la transposition des savoirs produits par les participant.e.s lors de la recherche ont également été induites par la transmission aux pairs des nouveaux gestes professionnels acquis ou en cours de construction et se sont mises en place dès le début de la recherche, via les situations nées de l’expérimentation elle-même ainsi que par le biais des activités de formation de plusieurs participant.e.s, comme le montrent les témoignages recueillis alors par l’enseignante-chercheure:
J’en ai parlé à mes stagiaires de nombreuses fois, en particulier dans l’accompagnement des mémoires professionnels qui s’y prêtaient et dans des séances de formation sur la lecture ou qui évoquaient plus généralement l’autonomie à construire dans les démarches des élèves. […]
J’en ai parlé à des collègues de français et à d’autres collègues intrigués par les carnets lorsque je les photocopiais par exemple, […] en leur expliquant qu’il s’agissait de carnets de lecteurs visant à donner aux élèves un espace pour rendre compte, de façon plus personnelle, de leur lecture des textes et préparant les débats en classe. Je leur disais que ces derniers constituaient un moment très plaisant, au cours duquel les élèves avaient l’occasion de donner des interprétations très intéressantes, par lesquelles j’avais plus d’une fois été très positivement surprise. […]
Mes stagiaires ont été très intéressés et se sont mis à pratiquer pour certains. Ils ont bien compris que c’était une véritable pédagogie de la mise en activité des élèves pouvant remplacer le faux-semblant de méthode inductive, qui est le plus souvent un jeu de questions-réponses à la question «devine ce que j’ai dans la tête !» (Ahr & Joole 2012 : 91-92)
Le «défi» tel qu’énoncé par Serge Desgagné est en effet de «faire en sorte que recherche et formation se coconstituent» (Desgagné 1997 : 378); l’objectif est explicitement mentionné comme atteint par sept des neuf participant.e.s dans les questionnaires-bilans:
[Cette recherche action] m'a permis aussi de faire l'expérience d'une autre manière de se former (et de former) stimulant la réflexion et favorisant l'autonomie grâce au temps laissé à l'expérimentation. (EF7)
On souhaiterait que toutes les formations articulent ainsi le faire, l’expérimental et la réflexion théorique, l’individuel et le collectif… (EF4)
Aujourd'hui, je continue à utiliser cette expérience au sein de mes formations (stages, réunions, actions pédagogiques […], mise en place d'un prix littéraire pour les écoliers et les collégiens «Lire et élire»). (E2)
J'ai également transmis puisqu'une de nos collègues […] a lu notre production et a créé un petit groupe de travail autour de cette nouvelle expérience. (EF5)
La légitimation des savoirs construits
L’expérience même de la recherche et de ses méthodes a donc permis aux enseignant.e.s d’effectuer les déplacements praxéologiques et conceptuels nécessaires pour devenir des praticiennes et des praticiens réflexifs, en mesure de transposer les méthodologies explorées et de transmettre les résultats obtenus. Par conséquent, la recherche a également constitué un espace de légitimation et d’institutionnalisation des savoirs construits au sein de l’équipe, grâce à la possibilité de les partager, de les communiquer, auprès de la communauté scientifique. Ainsi une enseignante (E3) note-t-elle les étapes de l’appropriation des savoirs générée par ce processus:
Écrire pour un article rendant compte de son expérience était très nouveau pour moi : cela m'obligeait à mettre à distance et à adopter une terminologie que je ne connaissais pas. J'avais l'impression de recommencer à zéro. Cela m'a demandé un gros effort. Mais, quand je relis l'ouvrage produit, je retrouve des repères, je trouve que cela constitue une étape tangible à partir de laquelle je peux avancer.
Le rôle joué par l’enseignante-chercheure a été de permettre ce passage de la réflexion sur la pratique, commune à tou.te.s les enseignant.e.s, à des compétences confirmées d’analyse, par l’accès qu’elle a offert aux savoirs et aux codes rendant possible la reconnaissance scientifique des travaux menés par l’équipe, ainsi qu’elle le souligne dans l’un de ses articles:
[Il] revient à l’enseignant-chercheur de transformer l’analyse des situations expérimentées, la réflexion sur les nouvelles pratiques professionnelles que la recherche fait émerger en objet de connaissance reconnu par la communauté scientifique. (Ahr & Joole 2012 : 95)
Or, dans la perspective de communiquer les résultats d’une recherche en didactique de la littérature portant sur la lecture et la prise en compte des réceptions subjectives, la question de la scientificité des résultats, et donc des critères de validité à adopter, revêt une complexité particulière; ce questionnement a nourri les échanges et les interrogations relatifs tant à l’élaboration et à la mise en œuvre de démarches avec les élèves qu’à leur potentielle valeur scientifique, formant l’équipe aux multiples enjeux, scientifiques mais aussi politiques10 au sens large, de leur expérimentation collective.
Une formation aux enjeux scientifiques et politiques des choix effectués dans le cadre de la recherche
Jean-Louis Dufays, à propos d’une autre recherche sur la lecture littéraire, retient comme critère de validité les visées de crédibilité plutôt que d’objectivité, et de transférabilité plutôt que de «généralisabilité»:
Soulignons toutefois que, dans la mesure où la recherche était à la fois interprétative et « engagée », sa visée n’était pas l’objectivité, mais la crédibilité, laquelle reposait sur les quatre critères définis par Marielle Tousignant (1989) :
- la présence prolongée du chercheur dans le milieu concerné,
- la recherche des aspects qui comptent vraiment pour les participants,
- l’utilisation et le recoupement de sources d’informations diversifiées,
- la corroboration, ou vérification des hypothèses auprès des participants (c’est-à-dire ici des enseignants et des élèves). […]
Ajoutons […] ceci avec Marielle Tousignant (1989) : «Pour les chercheurs qualitatifs, il s’agit avant tout de fournir des descriptions riches et détaillées du milieu étudié et de laisser le lecteur décider si les caractéristiques sont suffisamment semblables pour que les résultats obtenus et les tentatives d’explication générées soient transférables dans un milieu comparable». Plutôt que de parler de généralisabilité, mieux vaut donc parler de transférabilité. (Dufays 2006 : 162-163)
En effet, la recherche de type collaboratif avec expérimentation sur le terrain par les participant.e.s eux/elles-mêmes reconnait de fait au contexte de la pratique et aux outils (caractéristiques de la classe, de l’établissement, du niveau des élèves, de la place dans la progression annuelle, du support utilisé, etc.) un rôle déterminant dans la discrimination des échecs et des réussites et dans la construction des savoirs. La recherche à laquelle nous avons participé s’est révélée d’autant plus formatrice sur ces questionnements propres aux sciences humaines et sociales que l’ouverture théorique en ce sens était un choix affirmé de l’enseignante-chercheure, qui avait souhaité «une approche culturelle et anthropologique de la didactique, qui s’intéresse "aux personnes et non à des sujets seulement épistémiques" (Bucheton 2008 : 40)» et qui se trouve «au carrefour de diverses théories (pragmatique, interactionnisme sociodiscursif, psychologie sociale, ergonomie du métier enseignant…)» (Ahr & Joole 2012 : 90).
Ce rôle primordial joué par les contextes et les conditions d’expérimentation mène à d’autres interrogations concernant les enjeux de pouvoir à l’œuvre dans l’organisation de la recherche comme dans son objet, redoublé ici par le fait qu’elle impliquait des débats interprétatifs sur les lectures subjectives des élèves. Les questions de l’autorité, du contrôle, de la place des savoirs académiques se sont donc trouvées posées de façon très concrète, au sein du groupe et au sein de la classe, comme le souligne une participante:
[Ma] posture en a été modifiée sur plusieurs points : ma tendance au contrôle remise en question, la position centrale du prof questionnée […], la question de la coconstruction déplacée pour une vraie émergence de la pensée de l'élève. […] Le groupe [de recherche] était à la fois porteur et sécurisant dans le cadre libérateur d'un autre lâcher-prise. En aucune manière je ne me suis sentie poussée à faire telle ou telle chose et ma liberté a permis la libération des élèves par contrecoup. C'est pour moi la force double de la formation : nourriture partagée, encadrement rassurant et autorisation à oser... (EF1)
La forme même de la recherche incitait à ces remises en cause. En effet, l’absence, soulignée ici, de sentiment d’obligation va dans le sens des définitions de la recherche collaborative telles que développées par Serge Desgagné, comme «approche collaborative [qui] nous semble plutôt miser, concernant le développement des connaissances liées à la pratique, sur une "prise de pouvoir" partagée entre chercheurs universitaires et praticiens» (Desgagné 2006 : 388), et par Joëlle Morrissette, parlant d’une «démocratie délibérative, ayant pour finalité l’émancipation individuelle et collective, afin de faire face aux problèmes contemporains» (Morrissette 2013 : 36).
Limites et perspectives
Si les bilans des participant.e.s s’avèrent très positifs dans l’ensemble, certaines limites s’y font jour, ouvrant des pistes de réflexion pour améliorer le dispositif. Les idées formulées témoignent d’un souci constant de maintenir des liens entre recherche et formation, puisqu’elles appellent à développer les activités «favoris[ant] ladiscursivité du savoir d’action, tenu pour tacite» (Morrissette 2013 : 42) et à mettre en place des prolongements sous forme d’échanges:
Systématiser les observations mutuelles entre participants. Recourir à la vidéo pour susciter des auto-confrontations. (EF7)
Pour les manques, difficile à dire : je dirais un prolongement qui évite de retomber dans sa routine... un espace de partage pour la suite, au moins par petits groupes (des binômes de travail ?). (EF1)
J'aurais bien voulu que cela continue… ! Car je poursuis une réflexion sur la réception comme l'avait suggéré [l’enseignante-chercheure] mais je me sens seule !!! et je ne trouve pas le moteur que j'avais trouvé lors de nos échanges du mercredi après-midi. (E3)
Pour un autre participant, les prolongements possibles se situent du côté du type d’écrits de réception demandés aux élèves:
Il me semble que la lecture doit être fortement liée à l’écriture, dans sa sensualité ou sensibilité... L’expérience devrait porter sur les écrits de toutes formes qui permettent de mieux lire. Mais c’était pour partie l’objet de ce dispositif […]. (EF6)
Ce point de vue fait écho à la forte inclination de l’enseignant pour la fiction et à une prise de distance affirmée vis-à-vis des discours théoriques:
Je ne SAIS PAS lire des textes théoriques. […] La froideur, la sécheresse de la théorie me bloquent. (EF6)
Si ce dernier cas tend à montrer que ce type de recherche collaborative, qui articule apports théoriques et expérimentation, ne convient pas à toutes les sensibilités professionnelles, cinq participant.e.s déclarent avoir durablement modifié leur pratique et leurs conceptions de la lecture littéraire. Quatre d’entre elles/eux affirment avoir pris goût à la recherche en didactique (E1, E3, EF4, EF7), et quatre avoir réinvesti dans des formations menées ultérieurement les savoirs et les savoir-faire acquis (E2, EF4, EF5, EF7). Une enseignante décrit même l’expérience comme «une façon de se réaliser au sens fort du mot, devenir le prof réel qu'on peut être» (EF1).
De plus, un regard sur le parcours des dix enseignant.e.s qui ont pris part à la recherche montre un développement professionnel ou une évolution de carrière, pendant la recherche ou dans les deux ans qui ont suivi, pour les deux tiers du groupe, dans les domaines de la formation et de la recherche en didactique de la littérature: une enseignante (E2) est devenue formatrice, une enseignante (E1) a passé un master 2 de recherche en didactique et une autre (EF1) un master 2 de formation de formateurs, deux enseignant.e.s (E1, EF7) ont entrepris un travail de thèse, une enseignante (EF4) a dirigé la réalisation d’un manuel scolaire pour la réforme de 2015, une enseignante (EF3) est devenue inspectrice.
Un renforcement et une multiplication des dispositifs associant les enseignant.e.s à la recherche universitaire apparaît donc fortement souhaitable, qu’il serait bon d’associer à des aménagements dans les services de celles et ceux qui s’y engagent. En effet, si le site éduscol présente plusieurs initiatives d’envergure en ce sens11, ce type d’expérimentation requiert toujours de la part des participant.e.s un fort investissement personnel en termes de temps et de quantité de travail, puisqu’il s’ajoute à leur activité professionnelle.
Conclusion
La recherche collaborative construit un espace d’échanges au sein duquel la question formulée par Dominique Bucheton en 2002, et qui s’est posée dans les classes entre les enseignant.e.s et leurs élèves comme au sein de l’équipe entre chercheure et enseignant.e.s, peut trouver une réponse positive:
Sommes-nous prêts à faire construire la parole de manière égalitaire, à permettre que tous les enfants, les adolescents, les apprenants puissent s’emparer de ce pouvoir ? (Bucheton 2002 : 1)
En d’autres termes, comment pouvons-nous favoriser des modes d’organisation et des démarches qui permettent de contrecarrer les hiérarchies et les ordres figés, peu propices à nos disciplines littéraires, qui requièrent de laisser à la réflexion individuelle et collective du jeu, des espaces d’indétermination, de la place pour exprimer et créer de nouvelles interprétations? La recherche coopérative entre pairs et avec l’enseignant.e-chercheur.e permet une telle forme de liberté dans la mesure où, en leur offrant les moyens théoriques et méthodologiques d’une coconstruction de savoirs professionnels fondée sur leur propre pratique, elle forme les enseignant.e.s, quelles que soient leurs conditions d’exercice –niveaux et types d’établissement différents– à devenir des praticiennes et des praticiens réflexifs. Elle rend possible «une appropriation personnelle des savoirs issus de la recherche» qui mène à «la conceptualisation de nouvelles pratiques professionnelles» (Ahr & Joole 2012 : 89). Dans le même mouvement, elle ménage l’espace nécessaire à l’élaboration collective de savoirs et de savoir-faire communicables à la communauté enseignante comme à la communauté scientifique. Elle met en commun et en circulation les expérimentations et les réflexions pour nourrir des dynamiques personnelles et professionnelles, individuelles et collectives, propres à engendrer à leur tour de nouvelles pratiques et de nouveaux savoirs.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (dir.) (2018 [2013], Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée – Expérimentations et réflexions, Grenoble, CRPD de Grenoble.
Ahr, Sylviane (dir.), Former à la lecture littéraire, Éditions Canopé.
Ahr, Sylviane (2011), «Le carnet de lecteur de littérature au collège et au lycée: un dispositif expérimental misant sur une nouvelle approche de l’interaction lecture-écriture», Diptyque, n° 21, «Enseigner la langue et la littérature – Des dispositifs pour penser leur articulation», Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 157-175.
Ahr, Sylviane, Agnès Brunet, Cécile Couteaux, Françoise Ravez (2013), «Carnet/journal de lecteur / de lecture: quels usages, pour quels enjeux, de l'école à l'université?», Dyptique, n°25, Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 129-145.
Ahr, Sylviane, Patrick Joole, Françoise Ravez (2012). «Une recherche-action comme espace de reconfiguration des savoirs disciplinaires et didactiques et comme lieu de formation professionnelle», in Les didactiques en question(s). État des lieux et perspectives pour la recherche et la formation, M.-L. Elalouf, A. Robert, A. Belhadjin & M.-F. Bishop (dir.), Bruxelles, De Boeck, p. 89-97.
Ahr, Sylviane, Patrick Joole (2010), «Débats et carnets de lecteurs, de l’école au collège», Le Français Aujourd’hui, n° 168, Paris, Armand Colin, p. 69-82.
Bucheton, Dominique (2002), «Devenir l’auteur de sa parole». En ligne, consulté le 31 décembre 2020, URL : http://langage.ac-creteil.fr/IMG/pdf/devenir_auteur_de_sa_parole_bucheton-2.pdf.
Bucheton, Dominique, Olivier Dezutter (2008), Le développement des gestes professionnels dans l’enseignement du français – Un défi pour la recherche et la formation, Bruxelles, De Boeck Université.
Desgagné, Serge (1998), «La position du chercheur en recherche collaborative: illustration d’une démarche de médiation entre culture universitaire et culture scolaire», Recherches qualitatives, n°18, p. 77-105.
Desgagné, Serge (1997), «Le concept de recherche collaborative: l’idée d’un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants», Revue des sciences de l’éducation, n°23 (2), p. 371-393.
Dufays, Jean-Louis (2006), «Chapitre 8. Au carrefour de trois méthodologies: une recherche en didactique de la lecture littéraire», in L'analyse qualitative en éducation, L. Paquay et al., Bruxelles, De Boeck Supérieur, p. 143-164.
Elliott, John (1990), «Teachers as researchers: Implications for supervision and for teacher education», Teaching and Teacher Education, n°6 (1), p. 1-26.
Javerzat, Marie-Claude (2009), «Lire en constellation pour apprendre à l’école», in La littérature en corpus, Corpus implicites, explicites, virtuels, B. Louichon et A. Rouxel (Éds), Paris, SCEREN.
Morrissette, Joëlle (2013), «Recherche-action et recherche collaborative: Quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs?», Nouvelles pratiques sociales, volume 25, n°2, p. 35-49.
Saint-Arnaud, Yves (1986), «La prise en charge de ses relations interpersonnelles», Revue québécoise de psychologie, n°7 (1-2), p. 11-25.
Savoie-Zajc, Lorraine (2001), «La recherche-action en éducation: ses cadres épistémologiques, sa pertinence, ses limites», in Nouvelles dynamiques de recherche en éducation, M. Anadón et M. L’Hostie (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, p. 15-49.
Tousignant, Marielle (1989), Vers l’identification de critères d’évaluation et de moyens d’améliorer la qualité d’une recherche qualitative, Québec, Université de Laval.
Pour citer l'article
Cécile Couteaux, "La recherche de type collaboratif: un espace de formation à et par la recherche", Transpositio, n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/la-recherche-de-type-collaboratif-un-espace-de-formation-a-et-par-la-recherche
Voir également :
La recherche de type collaboratif: méthodologie pertinente? espace de circulation des savoirs et de formation?
La recherche de type collaboratif ou design based research tend à rapprocher «communauté de recherche et communauté de pratique» (Desgagné 1997 : 380) autour de questionnements communs d’ordre à la fois épistémologique et pragmatique. Pour les chercheurs en didactique de la littérature, il s’agit de construire leur objet de recherche dans l’ensemble de ses dimensions, en prenant en compte les interactions et les tensions entre les savoirs issus de la recherche et ceux issus du terrain. Pour les enseignants, il s’agit de questionner à la lumière des recherches récentes leurs pratiques et les effets de celles-ci sur les apprentissages réalisés par leurs élèves, de se former à et par la recherche (Vinatier 2016).
La recherche de type collaboratif: méthodologie pertinente? espace de circulation des savoirs et de formation?
La recherche de type collaboratif ou design based research tend à rapprocher «communauté de recherche et communauté de pratique» (Desgagné 1997 : 380) autour de questionnements communs d’ordre à la fois épistémologique et pragmatique. Pour les chercheurs en didactique de la littérature, il s’agit de construire leur objet de recherche dans l’ensemble de ses dimensions, en prenant en compte les interactions et les tensions entre les savoirs issus de la recherche et ceux issus du terrain. Pour les enseignants, il s’agit de questionner à la lumière des recherches récentes leurs pratiques et les effets de celles-ci sur les apprentissages réalisés par leurs élèves, de se former à et par la recherche (Vinatier 2016). Ce croisement entre recherche et terrain favorise la coconstruction de connaissances répondant à des besoins d’enseignement et d’apprentissage généralement identifiés comme prioritaires (Morrissette 2013).
L’article visera à mettre au jour les atouts, voire les limites, de ce type de recherche. Il prendra appui sur certaines des données recueillies dans le cadre du programme de recherche quinquennal (2014-2019) PELAS (Pratiques Effectives de la Lecture Analytique dans le Secondaire1), auquel collaborent une douzaine de chercheurs en didactique de la littérature2 ainsi qu’une trentaine de professeurs de collège et de lycée français et belges. Après une rapide présentation des enjeux et des modalités de la collaboration entre chercheurs et praticiens, l’article rendra compte, à travers l’analyse des discours tenus par ces derniers, des déplacements conceptuels que ceux-ci ont opérés lors de cette recherche collaborative, mais aussi des difficultés observées en termes de circulation des savoirs et de développement professionnel.
Enjeux et modalités de la collaboration entre praticiens et chercheurs dans le cadre du programme de recherche PELAS
Lestensions qui ont alimenté et qui alimentent encore aujourd’hui les discours de déploration concernant l’enseignement de la littérature dans le secondaire (Ahr 2015) proviennent en partie d’une connaissance très approximative de la réalité effective des classes. En effet, l’analyse des textes officiels et des outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants, tels que les manuels, ne rend compte que très partiellement de la réalité effective, à un moment T, de l’enseignement de la littérature dans le secondaire, que structurent également des données contextuelles, intervenant comme contraintes ou ressources (Desgagné 1997 : 273). Or, si l’on veut identifier les lieux de transformation possible des pratiques d’enseignement en vue d’envisager l’adaptation de la discipline à la culture et à la société de notre temps, il est indispensable de savoir non seulement ce qui s’enseigne réellement aujourd’hui en matière de littérature mais aussi comment on enseigne et on apprend dans les classes de français. Deux facteurs ont déterminé les limites du champ d’observation et d’analyse retenu par l’équipe de recherche: d’une part, la priorité accordée aux approches analytiques de la lecture de la littérature dans les grandes classes du secondaire; d’autre part, les difficultés que les élèves rencontrent lors de leur passage au lycée, soit, pour ce qui concerne la France, lorsqu’ils entrent en classe de seconde, difficultés que l’institution souligne en ces termes:
Les élèves de seconde expriment souvent leur étonnement devant les tâches qui leur sont proposées en français. Ils se sentent démunis, mal préparés. Beaucoup ont le sentiment d’être livrés à eux-mêmes et, en particulier, de ne pas savoir comment aborder une lecture analytique sans un questionnaire détaillé tel qu’il leur était souvent fourni au collège. (Ministère de l'éducation nationale 2012 : 1)
La recherche s’intéresse donc prioritairement aux niveaux de troisième (fin de collège) et de seconde (première année du lycée).
Cette recherche descriptive à visée «herméneutique» (Dufays 2001) tend ainsi non seulement à analyser les effets des pratiques professorales sur les apprentissages que les élèves réalisent ou non, mais également à cerner les conceptions de la littérature et de son enseignement sur lesquelles ces pratiques s’appuient, explicitement ou implicitement. Il faut entendre par «pratiques professorales» l’ensemble des «composants didactiques et pédagogiques des pratiques d’enseignement» (Goigoux 2014 : 2) qui reconfigurent les objets à enseigner inscrits dans les programmes en «objets enseignés» (Schneuwly, Dolz & Ronveaux 2006 : 176) puis en objets réellement appris. Il s’agit donc d’analyser, d’une part, les situations d’enseignement et d’apprentissage de la littérature (formes de travail proposées, places et rôles respectifs de l’enseignant et des élèves, tâches discursives orales et écrites, rapports texte/enseignant/élèves, questionnements professoraux, activités des élèves, etc.) ainsi que les corpus et outils pédagogiques (dont les outils numériques) privilégiés par les enseignants; et, d’autre part, les effets de ces choix didactiques sur les apprentissages réalisés (ou non) par les élèves.
Sans pour autant prétendre à une étude quantitative, l’équipe s’est donné pour contrainte de diversifier les terrains d’enquête. Deux critères ont présidé au choix des établissements. Le premier est d’ordre géographique et sociologique (zones urbaine, périurbaine, rurale; contextes socioéconomique, socioculturel, socioprofessionnel; taux de réussite au diplôme national du brevet et au baccalauréat, etc.). Le second –et c’est cet aspect qui est retenu dans le présent article– concerne l’implication des professeurs dans le projet de recherche.
Afin d’approcher au mieux la réalité effective des classes, il est en effet nécessaire que les enseignants soient partie prenante du projet. Celui-ci peut de la sorte répondre à un double enjeu: offrir aux chercheurs un terrain d’enquête; permettre aux professeurs de bénéficier, à terme et grâce à un travail collaboratif, d’une formation par et à la recherche. C’est en effet par «la réflexion collective des acteurs qu’on peut trouver des solutions» (Flandin 2014) répondant à la nécessité d’adapter l’enseignement de la littérature dans le secondaire à la réalité actuelle. Et c’est à cette condition que peuvent être menées les démarches empiriques indispensables à la recherche en didactique de la littérature et à la formation des enseignants, qui lui est étroitement liée, et que l’on peut «contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles au profit de tous les élèves» (Goigoux 2007 : 47).
Les membres de l’équipe ont donné des formes différentes à ce volet collaboratif de la recherche. Selon les données du protocole, cette collaboration a consisté en un investissement et une réflexivité qui se sont manifestés de diverses manières: par la transmission des descriptifs de séquences, par le choix des séances de lecture analytique significatives, par l’enregistrement des analyses «à chaud» de ces séances, par la remise des travaux avant, pendant et après la séance pour les élèves correspondant aux profils identifiés par les chercheurs. Dans un bassin défavorisé de l’académie de Versailles, ce volet collaboratif a pris la forme d’une action de formation; dans l’académie de Lille, la composante collaborativea été prise en charge dans un séminaire de recherche à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ3), sur le site d’Arras. Ce sont ces deux formes de la recherche collaborative qui sont étudiées ici dans le contexte de la recherche PELAS.
Une recherche-formation collaborative dans l’académie de Versailles
La recherche collaborative liée à une action de formation à destination des enseignants de français des collèges et des lycées d’un même bassin a nécessité non seulement l’investissement assuré de l’un d’entre eux, mais aussi l’aval et le soutien de la part des chefs des établissements concernés ainsi que du service de la formation continue du Rectorat, auprès duquel le professeur, porteur de cette initiative locale, a déposé une demande de formation se déroulant sur quatre demi-journées de quatre heures réparties dans l’année scolaire. Il a été précisé alors que cette action, «adossée à un projet de recherche sur les pratiques effectives visant à former des lecteurs de littérature du collège au lycée (libellé du stage la première année)», était à inscrire dans la durée (trois années: de 2015/2016, année de la collecte des données, à 2018) et visait à répondre à un objectif général, précisé en ces termes dans le plan de formation:
Le programme de formation/recherche se propose d'explorer les effets des pratiques d'enseignement sur les apprentissages réalisés par les élèves, en particulier de troisième et de seconde. L'objectif est de comprendre comment les élèves s'impliquent dans la lecture et l'interprétation.
Les modalités de travail, validées par le Rectorat, étaient également présentées ainsi :
Trois modalités de travail alterneront:
Les analyses des mises en œuvre et des transactions effectives en classe et/ou en ligne pour interroger les apprentissages des élèves.
Les mutualisations de pratiques de la lecture analytique en collège et en lycée menant à des réflexions et synthèses collaboratives sur les dispositifs et les situations de travail.
Des temps dédiés à l’actualisation des savoirs, à partir d’apports théoriques sur les théories didactiques de la lecture et pour nommer les pratiques (en appui sur des extraits choisis d’articles ou d’ouvrages récents).
Globalement, les modalités de travail ont été les mêmes durant les trois années, mais l’accent a été mis progressivement sur l’appropriation d’une posture de praticien réflexif, celle-ci requérant l’actualisation des savoirs issus de la recherche. Enfin, ce stage a regroupé au cours des trois années et selon des variations importantes d’une séance à l’autre entre 8 et 15 enseignants4, constat qui conduit à s’interroger sur les atouts et les limites de cette recherche-formation collaborative, comme nous le verrons plus loin.
Un séminaire pour accompagner la recherche collaborative dans l’académie de Lille
L’équipe du bassin d’Arras en lycée et en collège, constituée par sollicitation directe et par cooptation, a réuni quatre enseignants représentant un panel d’établissements à recrutements socio-culturellement contrastés: trois d’entre eux, expérimentés; le quatrième, en début de carrière à Fourmies, ville en restructuration industrielle. Cette équipe, soutenue par l’ÉSPÉ Lille Nord de France et par l’université d’Artois, a bénéficié d’un soutien financier pour ses travaux.
Pour les praticiens, le contrat prévoyait, outre l’enregistrement audiovisuel de séances de lecture analytique et la transmission des données prévues par le protocole (cf. ci-dessus), la participation à un séminaire, selon deux temporalités: de juin 2015 à juin 2016, durant la phase de collecte des données, les trois demi-journées de séminaire avaient pour finalités de soutenir cette collecte, de favoriser l’autoquestionnement, la confrontation des interrogations, ainsi que la mutualisation des pratiques et des références, sans intervention du chercheur. L’année suivante, les deux dernières séances du séminaire ont été consacrées à la préparation de deux tables rondes pour deux journées d’étude (au plan national et régional), dans le cadre d’un dialogue entre praticiens et chercheurs (cf. ci-dessous).
Afin d’identifier l’influence de cette recherche collaborative sur les conceptions et les pratiques professorales en matière d’approches analytiques des textes littéraires, plusieurs données ont été recueillies et analysées : les questionnaires et les entretiens semi-directifs collectés en début de recherche PELAS (2015) auprès des enseignants des deux groupes; les échanges enregistrés lors de certaines des séances de formation, notamment lors de la séance bilan proposée en avril 2018 pour l’académie de Versailles; les interventions de deux représentants de l’équipe de Versailles et de trois représentantes de l’équipe de l’académie de Lille dans le cadre d’une journée d’étude organisée par l’équipe PELAS à l’Institut français de l’Éducation en octobre 2017; ainsi que, pour Lille, les verbatims des séminaires et l’enregistrement de la réunion préparatoire à cette journée comme à celle d’avril 20175.
La recherche collaborative : un espace de développement professionnel
La recherche collaborative menée dans le cadre du programme PELAS a été envisagée conformément au concept élaboré par Desgagné il y a plus de vingt ans. Trois dimensions caractérisent ce type d’action:
- - Les «praticiens s'engagent, avec le chercheur, à explorer un aspect de leur pratique» et «l'objet même de la recherche porte sur leur compréhension en contexte du phénomène exploré». Dans le cas présent, cet «aspect de leur pratique» concerne les approches analytiques des textes littéraires.
- - Cette activité de recherche offre aux praticiens «une occasion de perfectionnement, elle est activité de formation».
- - Les connaissances construites au cours de cette recherche collaborative sont «le produit d'un processus de rapprochement, voire de médiation entre théorie et pratique et entre culture de recherche et culture de pratique» (1997 : 383-384).
L’analyse des données recueillies dans l’académie de Versailles montre que ce type de recherche favorise chez les enseignants un déplacement de posture dans la mesure où, comme l’un des professeurs concernés le précise, ils «apprennent à réfléchir» sur leur pratique, à actualiser les savoirs sur lesquels cette pratique repose et à percevoir l’intérêt que cette actualisation représente pour leur pratique au quotidien.
Plusieurs facteurs favorisent ce déplacement de posture. Cependant, comme le confie l’un des enseignants, «on devient des praticiens réflexifs» une fois que l’on a accepté, comme le précise un autre, de «se remettre en posture d’apprenant». Et cet «apprentissage» ne peut se réaliser que sous certaines conditions: il faut accepter de confronter sa pratique à celle des autres, de la voir questionnée par les chercheurs mais aussi par les pairs et bien évidemment par soi-même, ce qui conduit à accepter d’ouvrir les portes de sa classe. Il faut accepter de «douter» (verbe qui revient fréquemment lors des échanges) de la validité de sa pratique, qu’avec l’expérience on croyait efficace et efficiente. Il faut percevoir l’intérêt que certains écrits de recherche peuvent présenter pour sa pratique au quotidien. Une fois ce «mal nécessaire» accepté –pour reprendre l’expression d’un des enseignants–, l’intérêt d’un tel travail collaboratif est multiple: non seulement les échanges entre pairs donnent envie d’approfondir la réflexion engagée, mais les rencontres avec le/les chercheur(s)-formateur(s) impulsent et entretiennent «le processus de réflexion», comme le soulignent les verbatims suivants6:
P1 : À chaque fois j’ai l’impression qu’il y a un niveau qui se développe […] ça entretient le processus de réflexion.
P2 : Ça maintient dans une dynamique et c’est très stimulant intellectuellement, c’est gratifiant car ça permet de sortir de la routine.
P3 : Ça permet d’intellectualiser notre approche de notre métier, ça m’a aidée à dépasser ces moments où je trouvais que je commençais à entrer dans cette routine.
Quant aux écrits de recherche que le chercheur invite et «aide» à lire, ils permettent de «mettre des mots sur des difficultés ressenties» mais non encore verbalisées, d’éclairer certaines notions et certains concepts (par exemple, «Qu’est-ce qu’une lecture analytique ?», «Qu’est-ce qu’un sujet lecteur ?»), sachant que l’intérêt pour le professeur «ne porte pas sur la notion elle-même mais sur ce que ça veut dire pour sa pratique au quotidien». Ces éclairages théoriques donnent également «envie d’approfondir, d’aller plus loin» et favorisent aussi une meilleure compréhension des prescriptions institutionnelles. Comme l’avoue un enseignant, lire ces écrits de recherche d’un premier abord complexes, c’est «se mettre dans la situation de l’élève». Il y a comme «un effet de miroir» car la lecture de ces écrits est au départ, selon les professeurs, aussi compliquée que celle des textes littéraires qu’ils soumettent à leurs élèves: l’un d’eux précise que l’on peut ainsi «percevoir la difficulté de l’apprenant que l’on a face à nous tout le temps et justement son angoisse par rapport à nos exigences». Et ce même professeur ajoute qu’il peut de la sorte «garder en mémoire ce qu’est, ce qu’a été [son] parcours d’apprenant».
Il y a cependant consensus sur la nécessité de prévoir une «phase d’adaptation», car la collaboration est dans un premier temps «déstabilisante». Et il faut du temps pour entrer dans les écrits de recherche, permettre à chacun de percevoir l’intérêt de telle notion, de tel concept (une fois compris·e) pour sa pratique au quotidien. L’un des enseignants confie : «Avant je n’en voyais pas l’intérêt, ça n’avait pas de sens pour moi, mais maintenant…»
Par ailleurs, cette recherche collaborative apparait comme un espace où les tensions perçues dans la classe, les difficultés éprouvées sont «théorisées». Cette «mise en discours des tensions», éclairée par les écrits des chercheurs, est perçue comme un processus «salvateur», ce que les verbatims suivants confirment :
P4 : Des gens pensent à ça, et donc ça légitime mes inquiétudes et en plus on essaie de trouver une solution.
P5 : C’est rassurant car on n’est pas seul à partager ces doutes.
Le «groupe de recherche», aussi désigné par le syntagme «groupe de travail» (ce qui confirme l’implication réelle des enseignants dans le processus de recherche), offre donc du temps pour «verbaliser», «partager», «réfléchir», «construire des savoirs sur le long terme» et, par conséquent, opérer un déplacement de posture qui repose sur une conception ouverte du métier d’enseignant. Deux stagiaires confient sur ce point:
P6 : Le professeur n’est pas nécessairement celui qui a la solution, ça le replace comme quelqu’un qui tâtonne.
P7 : On devient aussi un peu nous-mêmes chercheurs, modestement, très modestement. C’est déstabilisant, voire très déstabilisant, mais c’est déculpabilisant.
Adopter la posture de chercheur pour ces enseignants impliqués dans cette recherche collaborative, c’est «prendre du recul par rapport à un échec constaté» (une situation de classe qui n’a pas donné les résultats escomptés), «échec que jusqu’alors on se contentait de constater comme tel», c’est «chercher autre chose», se demander ce que l’on peut faire d’autre pour atteindre l’objectif visé. Et pour ce qui concerne les approches analytiques des textes littéraires, adopter cette nouvelle posture conduit à s’accorder des libertés par rapport à ce que l’on croyait être imposé par l’institution. C’est par exemple admettre qu’«il y a mille façons de faire des lectures analytiques, qu’il ne faut pas se limiter, qu’il ne faut pas s’enfermer, surtout pas s’enfermer dans les représentations que l’[on s’en fait] à la lecture des programmes». C’est considérer que le plus important est de réfléchir au «processus» par lequel les élèves s’approprient le texte et parviennent progressivement à parler de la lecture qu’ils en ont faite. C’est considérer «la classe comme un laboratoire» et donc, en matière de lecture analytique, c’est «oser», «s’autoriser», «tester», «essayer» de nouvelles approches, les «varier», les «diversifier». La lecture analytique ne consiste plus seulement dès lors à «comprendre et analyser les mécanismes à l’œuvre dans un texte», comme la définissent certains des enseignants dans le questionnaire renseigné au début de la recherche. Effectivement, alors qu’initialement tous estiment que la lecture analytique vise à apprendre aux collégiens à «déstructurer» les textes et aux lycéens à les «restructurer», cette conception des enjeux de l’enseignement de la littérature ne fait plus consensus trois ans plus tard dans la mesure où cette modalité de lecture scolaire est désormais perçue comme «un processus à entretenir sur le long terme», où elle est à envisager «dans un continuum» dans la formation des élèves lecteurs.
Cette collaboration favorise également la circulation voire la production de savoirs, comme en témoignent les évolutions apportées aux descriptifs présentant l’action de formation menée dans un bassin de l’académie de Versailles et soumis à l’administration. Les verbes «explorer», «questionner», «interroger», «réfléchir sur», «chercher à repérer», «éclairer» y sont de plus en plus présents et, la troisième année, sont clairement annoncés «des temps d’actualisation des connaissances théoriques dans les champs de la didactique du français et de la didactique de la littérature» afin d’éclairer les questions soulevées lors de l’analyse des données recueillies par les professeurs eux-mêmes (séances filmées, écrits et oraux d’élèves).
La recherche collaborative : complexités et limites
Le dispositif conçu dans l’académie de Lille montre les complexités et les difficultés de l’articulation entre les enjeux de la recherche et ceux de la formation dans la recherche collaborative, telle qu’actuellement définie. Comment en effet faire en sorte qu’ils ne se développent pas simplement en parallèle, ou l’un au détriment de l’autre? Comment, dans une recherche de type «écologique» qui cherche à approcher le plus possible les pratiques professorales ordinaires dans leurs contextes, ne pas influer sur celles-ci dans les enjeux de formation? Comment prendre en compte, dès la conception du protocole de recherche, les modalités d’évaluation des effets de la collaboration avec les chercheurs sur le développement professionnel des praticiens? Ce sont donc ces complexités et ces difficultés que met au jour l’analyse réflexive de la recherche collaborative telle qu’elle a été mise en place dans cette académie, à Arras.
L’organisation du séminaire évoqué plus haut a découlé des enjeux et modalités de la recherche PELAS, dans le sens où les enseignants et les classes concernées ne pouvaient être considérés comme de simples terrains d’observation. Selon le contrat établi au départ, il s’agissait pour les enseignants de bénéficier non seulement d’un soutien logistique pour le suivi de la collecte durant l’année du recueil des données, mais également de bénéficier de l’appui du groupe au moment où ils acceptaient de livrer leur pratique au regard du chercheur. Le séminaire leur offrait également un espace pour échanger sur leur pratique, afin de nourrir, par la coformation, un processus de développement professionnel. Le contrat stipulait également qu’au-delà d’une bibliographie sur la didactique de la lecture littéraire fournie par le chercheur, celui-ci n’interviendrait pas dans les débats, du moins dans la période de collecte des données, c’est-à-dire durant la première année du séminaire. Des prolongements pour la formation étaient envisagés, notamment par la participation aux deux journées d’étude, mais sans qu’ils aient été, à ce moment-là, davantage précisés.
Les membres de ce groupe avaient bénéficié, avant la recherche et dans le cadre de la formation initiale ou continue, d’apports sur la lecture littéraire et sur la prise en compte du sujet lecteur dans la conduite des séances. L’un d’eux s’était également engagé dans une démarche d’autoformation, nourrie par de nombreuses lectures de revues et d’ouvrages didactiques. Dans sa contribution à la préparation à la journée d’étude à Arras (28 avril 2017), il explique ainsi:
C’est la fréquentation du CRDP qui m’a fait changer. Au départ, j’y allais pour trouver des idées de cours et puis, j’ai emprunté L’École des Lettres Lycée avec des articles d’Yves Stalloni, la revue Didactique, des ouvrages de Jordy, d’Annie Rouxel… La constitution de corpus, la didactique des textes m’intéressaient beaucoup. Se libérer des contraintes que s’imposent finalement les professeurs eux-mêmes me semblait indispensable. Mais cela n’allait pas sans friction avec les collègues en place!
De fait, dans cet espace de discussion ouvert par le séminaire, s’est exprimée l’adhésion forte de ces praticiens à la prise en compte du sujet lecteur, lors des séances de lecture analytique, dans un processus de construction collective du sens à l’oral. Cette conception centrée sur le lecteur a accru, selon eux, leurs motivations pour ces séances et, parallèlement, celles des élèves, comme en témoignent les verbatims suivants d’enseignants de collège, puis de lycée:
P 1 […] elle permet à chacun de se dire: je peux dire quelque chose du texte, je peux comprendre quelque chose […].
P 2 : C’est là que la classe prend tout son sens […] c’est un chemin énorme qu’ils doivent entreprendre dans le texte et à la limite, les autres sont là pour contredire.
Et l’enseignant de lycée ajoute que «c’est ce passage qui est compliqué».
Le séminaire a également favorisé, dans un climat très libre, les échanges sur les difficultés liées à la prise en compte du sujet lecteur dans les approches analytiques des textes, notamment dans la perspective de la liaison entre le collège et le lycée. Pour les enseignants de collège du groupe, comme pour le ministère, c’est bien l’écart entre le niveau des élèves en collège (compétences lecturales, lexicales et syntaxiques faibles; élèves en difficulté par rapport à des analyses métatextuelles écrites) et les exigences des instructions officielles du lycée qui est source de nombreuses interrogations. Celles-ci paraissent difficiles à surmonter. Au lycée, les difficultés tiennent à l’effectif des classes (autour de 35 élèves), à la diversité des pratiques enseignantes et des représentations des élèves à leur sujet, aux contradictions entre la prise en compte de l’élève comme lecteur et le poids des épreuves du baccalauréat, ou même plus généralement, au passage des premières réactions des élèves face à un texte à des analyses plus outillées et plus approfondies, s’appuyant sur l’acquisition de connaissances, comme l’analyse cet enseignant de lycée:
[Dans certaines classes], ils attendent que ce soit moi qui donne le savoir savant, ils veulent bien embrayer le travail, mais dès qu’ils doivent chercher par eux-mêmes, cela leur déplait. Ils veulent bien réagir, ils aiment bien qu’on les sollicite, mais quand la sollicitation devient exigence de lecture, ils voudraient bien que ce soit le professeur qui la leur propose, qui donne davantage de choses, les savoirs savants. […] Cela ne veut pas dire que tout vient des élèves, bien sûr…mais est-ce que je suis trop exigeante, ou est-ce que je suis maladroite, parfois, je me pose la question. On ne peut en rester au stade de la réaction de l’élève. Il faut qu’on construise quelque chose, le savoir, et c’est cette deuxième phase, l’interprétation ou la construction du sens qui est difficile à mettre en place avec certaines classes.
Par ailleurs, la forme orale du cours, qui est la conception de référence des praticiens du groupe pour les séances de lecture analytique, se révèle, dans ces échanges, entrer en contradiction avec le développement des compétences d’analyses métatextuelles requises par le commentaire littéraire au baccalauréat. Un enseignant de lycée précise ainsi que «le réinvestissement de ces compétences travaillées à l’oral est décevant dans la première étape du commentaire écrit». Ce qui rejoint les analyses de l’un de ses collègues de collège:
[…] mais est-ce que des choses systématiques… ça ne pourrait pas aider de temps en temps les élèves qui ont du mal ? Parce qu’on ne part plus de cela, mais on leur demande d’utiliser cela. […] il manque quelque chose dans nos façons de faire pour leur permettre à tous d’aller plus loin dans la compréhension, d’être capables d’écrire un bilan seuls, de développer une question, de l’enrichir, de l’interpréter: tout seuls, ils n’y arrivent pas.
La verbalisation de ces difficultés amène le groupe à s’interroger sur la nécessité d’une trace écrite en cours (perte de temps ou nécessité? lieu de développement de l’écrit ou non? par qui? et qu’en est-il pour les élèves des repérages, surlignages et notes à même le texte: sont-ils des outils suffisants? Quels usages du tableau blanc interactif (TBI)? etc.).
L’un des enseignants du groupe, nourri de nombreuses lectures personnelles (cf. ci-dessus) ouvre une perspective:
Mais la lecture analytique n’est peut-être pas le moment de travailler l’écrit, il y a peut-être une place pour la lecture analytique et une place pour la rédaction. Il ne faut peut-être pas les lier tous les deux tout le temps.
À l’inverse, un autre enseignant de lycée propose de passer davantage par l’écrit pour entrer dans la lecture analytique. Toutefois, ces pistes n’ont pas été durablement reprises dans les échanges du groupe et n’ont pas fait l’objet d’une ouverture vers des lectures théoriques.
Enfin, comme le souligne le verbatim suivant, ce sont également les questions de la différenciation et de la progression à établir au lycée sur deux ans qui ont été objets de débats et non la progression entre collège et lycée:
La difficulté que je rencontre concerne la différenciation. Comment faire attention et accompagner les élèves en difficulté dans leur apprentissage dans une classe de 36 élèves? Comment veiller sur leur progression et leur fixer des objectifs simples qui les mettent en confiance sans cesser d’être exigeante et tout en continuant à les intéresser? Comment mettre cette progression en place sur deux ans?
Ces questionnements ont été soumis à discussion durant les deux journées d’études l’année suivant la collecte des données: ils ont été confrontés à des analyses et à des apports théoriques7. Toutefois aucune évaluation finale de ces confrontations ne permet d’en mesurer plus précisément les apports. Deux autres demi-journées de séminaire, en aval de ces journées, consacrées à l’analyse de ces apports auraient sans doute été nécessaires. Outre cette lacune dans l’anticipation de ce volet de la formation, la dimension collaborative s’est heurtée au décalage entre la temporalité du séminaire et celle du dépouillement des données qui aurait pu permettre aux chercheurs de mieux répondre aux questions posées et de renvoyer à la théorie et à de nouvelles lectures.
Jusqu’où ce séminaire et la participation aux journées d’étude ont-ils permis ce développement professionnel? Ont-ils favorisé la circulation des savoirs et des apports de la recherche? Les données recueillies, faute de mesures précises, ne permettent pas de répondre plus avant à ces questions, même si, à l’heure actuelle, on peut observer que le processus se traduit, pour deux des enseignants impliqués dans la recherche, par une démarche d’engagement dans une formation de formateurs à l’INSPÉ.
Cette collaboration entre chercheurs et praticiens confirme cependant la prégnance du modèle de l’explication de textes à l’oral en situation collective et met au jour les confusions ou les contradictions entre prise en compte du sujet lecteur dans la lecture analytique et commentaire littéraire à l’écrit du baccalauréat de français. La prise en compte du sujet lecteur remet en cause la conception de la discipline, la solidarisation de ses exercices, les distributions entre modalités orales ou écrites des apprentissages et la place des outils d’analyse et des connaissances littéraires dans ce processus d’enseignement et d’apprentissage, particulièrement dans le contexte scolaire français. Les gestes professionnels des enseignants au service de ce que Jean-Pierre Astolfi (2008) désigne comme «le processus enseigner» sont par là même fortement questionnés.
En conclusion, ces deux études montrent les atouts mais aussi les difficultés et les complexités des recherches collaboratives lorsqu’elles visent également le développement professionnel des praticiens. Recherche et formation se déploient en effet dans des temporalités différentes. Une telle recherche collaborative requiert par conséquent une double planification et une double structuration (de recherche et de formation) avec des outils différents, du moins si l’on veut en mesurer de façon précise les effets.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2015), Enseigner la littérature aujourd’hui : «disputes» françaises, Paris, Honoré Champion, coll. «Didactique des lettres et des cultures».
Ahr, Sylviane (dir.) (2018), Former à la lecture littéraire au lycée – Réflexions et expérimentations, Poitiers Futuroscope, Éditions Canopé.
Astolfi, Jean-Pierre (2008), La Saveur des savoirs, Issy-les-Moulineaux, ESF Éditeurs.
Desgagné, Serge (1997), «Le concept de recherche collaborative: l’idée d’un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants», Revue des sciences de l'éducation, n° 23, p. 271-393. En ligne, URL : http://id.erudit.org/iderudit/031921ar
Dufays, Jean-Louis (2001), «Quelle(s) méthodologie(s) pour les recherches en didactique de la littérature? Esquisse de typologie et réflexions exploratoires», Enjeux, n° 51-52, p. 7-29.
Flandin, Simon (2014), «La vidéoformation dans tous ses états: Quelles options théoriques? Quels scénarios? Pour quels effets?», Conférence de consensus, Chaire UNESCO, «Former les enseignants au XXIe siècle». En ligne, URL : http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/Conference-La-videoformation-dans
Goigoux, Roland (2014), «Lire et écrire à l’école primaire», Bulletin de la Recherche, n° 31. En ligne, URL : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/ bulletins/2014/bulletin-nb031
Goigoux, Roland (2007), «Un modèle d’analyse de l’activité des enseignants», Éducation et didactique, n° 1- 3, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 47-69.
Ministère de l’Éducation nationale (2012), «Ressources mises en ligne par le ministère concernant la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé en classe de seconde». En ligne, URL : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise/30/3/LyceeGT_Ressource_AP_fiche_liaison_3eme_2de_en_francais_216303.pdf
Ministère de l’Éducation nationale (2010), «Programme de l'enseignement commun de français en classe de seconde générale et technologique et en classe de première des séries générales et programme de l'enseignement de littérature en classe de première littéraire», Bulletin officiel spécial, n° 9. En ligne, URL : http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html
Morrissette, Joëlle (2013), «Recherche-action et recherche collaborative: quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs?», Nouvelles pratiques sociales, n° 25, p. 35-49.
Schneuwly Bernard, Joaquim Dolz & Christophe Ronveaux (2006), «Le synopsis: un outil pour analyser les objets enseignés», in Les méthodes de recherche en didactiques, M.-J. Perrin-Glorian & Y. Reuter (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 175-189.
Vinatier, Isabelle (2016), «Recherche collaborative avec des conseillers pédagogiques: quels effets formatifs?», Communiquer, n° 18. En ligne, URL http://journals.openedition.org/communiquer/2097
Pour citer l'article
Sylvianne Ahr & Isabelle de Peretti, "La recherche de type collaboratif: méthodologie pertinente? espace de circulation des savoirs et de formation?", Transpositio, n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/la-recherche-de-type-collaboratif-methodologie-pertinente-espace-de-circulation-des-savoirs-et-de-formation
Voir également :
De la classe à la recherche et de la recherche à la classe, quelle circulation des savoirs ? Observations et analyses au départ du projet « Gary »
Quelle image les enseignants ont-ils de la recherche universitaire? Comment se situent-ils à son égard, et comment envisagent-il une collaboration avec des chercheurs? Et quelle circulation des concepts et des méthodes en résulte-t-il entre chercheurs et enseignants? Ces questions qui figuraient au cœur des 19es rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, nous nous les sommes posées à propos d’un projet qui a débuté voici quatre ans, le «projet Gary».
De la classe à la recherche et de la recherche à la classe, quelle circulation des savoirs ? Observations et analyses au départ du projet « Gary »
Quelle image les enseignants ont-ils de la recherche universitaire? Comment se situent-ils à son égard, et comment envisagent-il une collaboration avec des chercheurs? Et quelle circulation des concepts et des méthodes en résulte-t-il entre chercheurs et enseignants? Ces questions qui figuraient au cœur des 19es rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, nous nous les sommes posées à propos d’un projet qui a débuté voici quatre ans, le «projet Gary».
Le « projet Gary » en deux mots
Mené par une équipe internationale de huit chercheurs1, ce projet, qui a déjà donné lieu à cinq contributions (Dufays & Brunel, 2016; Brunel & Dufays, 2017; Brunel, Dufays & émery-Bruneau, 2017; Brunel, Dufays, Capt, Florey & émery-Bruneau, 2018; Brunel, Dufays, émery-Bruneau, Florey & Capt, à paraitre), s’intéresse à trois questions de recherche: Comment les compétences de lecture des élèves évoluent-elles au fil de la scolarité? Comment les pratiques enseignantes évoluent-elles en parallèle? Et enfin quelles relations réciproques peut-on établir entre ces deux ensembles2?
Pour traiter ces questions, nous recueillons des données à trois stades du curriculum, les niveaux 4 (âge moyen: 9 ans), 7 (12 ans) et 10 (15 ans), dans quatre pays francophones, la Belgique, la France, le Québec et la Suisse, et dans une centaine de classes de milieu socioéconomique moyen. Appuyé sur la nouvelle de Romain Gary «J’ai soif d’innocence» (8 pages), notre protocole comporte deux temps. Lors d’une première séance (de 45 à 50 min.), les élèves lisent le texte et répondent en autonomie à trois questions, qui portent sur la compréhension du texte, sur son appréciation et sur son interprétation; puis, lors d’une seconde séance (de même durée), les enseignants exploitent le texte librement en classe. Nous disposons ainsi de deux ensembles de données: les réponses des élèves au questionnaire et les verbatims des séances d’enseignement filmées.
La nouvelle de Gary relate l’histoire d’un narrateur occidental qui débarque en Polynésie avec le désir d’échapper au matérialisme de sa société d’origine mais qui va rapidement retomber dans ses vieux démons en se laissant piéger par l’indigène Taratonga qui lui laisse croire qu’elle lui offre gratuitement des toiles de Gauguin.
Question de recherche et méthodologie
Notre objectif dans la présente contribution est triple: nous voulons analyser ce que nous disent les enseignants impliqués dans le projet de leurs pratiques (objectifs, finalités...) et de leur rapport aux savoirs, mais aussi observer dans quelle mesure cette expérience favorise une meilleure circulation des savoirs entre chercheurs et enseignants, enfin envisager les moyens d’optimiser cette circulation.
Pour fonder cette analyse, nous avons réalisé dix entretiens avec cinq enseignantes belges et cinq enseignantes françaises réparties comme suit:
- 4 enseignantes du niveau 4 (élèves de 9 ans) (B : 4e primaire, F : CM1) : 2 F, 2 B;
- 3 enseignantes du niveau 7 (élèves de 12 ans) (B : 1re secondaire, F : 5e collège) : 2 F, 1 B;
- 3 enseignantes du niveau 10 (élèves de 15 ans) (B : 5e secondaire, F : 2de lycée) : 1 F, 2 B.
Ces entretiens ont été centrés sur sept thématiques, à partir du guide d’entretien ad hoc suivant (Beaud & Weber, 2003; Blanchet & Gotman, 2007; De Ketele & Roegiers, 2009):
1. Sur l’intérêt à priori de cette recherche pour les enseignants : Cette recherche a-t-elle suscité de l’intérêt quand on vous l’a proposée? Lequel? Pourquoi?
2. Sur le texte proposé : Quels commentaires souhaiteriez-vous en faire? Vos élèves font- ils souvent des lectures longues (de romans ou de longues nouvelles)?
3. Sur les compétences des élèves : Que diriez-vous des compétences de vos élèves, en général? Dans quelle mesure les avez-vous prises en compte dans l’élaboration de votre séance?
4. Sur la séance : Sur la réflexion avant la séance : quels objectifs vous êtes-vous fixés? Après la séance : comment avez-vous mis en œuvre ces objectifs? Pourquoi avoir choisi ce dispositif? Quels aspects de la lecture avez-vous privilégiés? Quel type de lecteur souhaitez-vous former? Avez-vous souhaité mettre en œuvre certaines recommandations didactiques ou prescriptions institutionnelles? Quelle évaluation faites-vous de votre séance?
5. Sur les pratiques : Avez-vous eu l’impression de faire « comme d’habitude » ou au contraire d’avoir modifié vos pratiques pour l’expérimentation? Vous êtes-vous inspiré·e d’un «modèle» (lequel?) portant sur l’approche d’un texte long? Consultez-vous des revues de didactique? Chez vous? Dans votre établissement? Lesquelles?
6. Sur les résultats de la recherche : Que vous a apporté cette expérimentation? Souhaiteriez-vous la poursuivre? Aimeriez-vous avoir un « retour » sur cette recherche? Si oui, quelle forme pourrait-il prendre? Que pourrait vous apporter la communication des résultats? Celle-ci pourrait-elle intéresser d’autres collègues que vous?
7. Sur le travail des chercheurs : Auriez-vous des questions à poser aux chercheurs?Lesquelles? Sur leurs modes de travail? (recueil et traitement des données, analyse, collaboration, communication des résultats) Auriez-vous des réserves ou des réticences à émettre à l'égard de cette recherche?
Si les entretiens ont été un outil précieux pour accéder aux perceptions des enseignants, la première démarche que nous nous devions de mettre en œuvre à leur égard a été de favoriser les conditions d’un accueil favorable de leur part à notre projet. Pour ce faire, nous avons d’abord veillé à consacrer un certain temps à expliciter les objectifs généraux de la recherche, sans pour autant entrer dans des détails qui auraient altéré le caractère écologique (ancré dans l’activité ordinaire) des pratiques que nous voulions observer. Notre souci, ce faisant, était tout à la fois de rassurer les enseignants et de les motiver à contribuer au projet. Ce temps préalable a été particulièrement important en France, où il s’est agi de contacter les chefs d’établissement de collège et de lycée, puis les inspecteurs et les conseillers pédagogiques des circonscriptions d’accueil de notre recherche. Ces démarches n’ont pas été requises en Belgique, où l’accord de l’enseignant et un entretien préalable avec lui ont suffi.
Ces contacts en amont ont permis d’expliciter le protocole de passation de l’expérience (texte, séance, captation vidéo), mais aussi de négocier le temps d’entretien qui suivrait et de préciser que les séances comme les entretiens feraient l’objet d’une transcription et d’une analyse.
Enfin, nous nous sommes chaque fois engagés vis-à-vis des enseignants à leur adresser un rendu de la recherche sous la forme d’une présentation des résultats, de telle sorte que le partage des expériences soit prolongé par le partage des résultats, ce qui contribue à renforcer la confiance entre les acteurs dans une perspective collaborative (Bednarz, 2013).
D’une manière générale, au-delà des nécessités déontologiques, nous avons veillé à aborder les enseignants avec modestie et bienveillance, en cherchant à limiter au maximum la position verticale qui est souvent attribuée au chercheur à l’égard du terrain scolaire.
Quelles réactions et implications des enseignants?
Comment ces enseignants ont-ils accueilli la proposition de collaboration qui leur a été adressée et comment se sont-ils engagés dans l’expérience?
En premier lieu, nous avons pu constater, notamment par le témoignage des chefs d’établissements, que les enseignants qui ont répondu positivement à notre demande étaient pour la plupart très impliqués dans leur profession et qu’ils accueillaient généralement avec intérêt les projets qui leur étaient proposés. Ainsi, en dehors de quelques questions témoignant de leur volonté de respecter le dispositif proposé, ils nous ont peu interrogés sur la recherche en elle-même et se sont engagés avec enthousiasme dans l’expérience, manifestant une attitude explicite de confiance envers les chercheurs. La confidentialité des données recueillies n’a ainsi pas suscité de demande de garanties de leur part. Qui plus est, la plupart d’entre eux se sont dits à la fois surpris et flattés parl’intérêt que nous leur portions («J’ai d’abord été surprise par votre proposition... mais je trouve ça chouette !» – Oriane, B4); certains nous ont d’ailleurs dit découvrir à cette occasion l’existence de la recherche en didactique de la littérature («je n’e savais pas que l’université s’intéressait à ce que nous faisons dans nos classes» – Pascale, B 10).
Quant à ceux qui ont refusé de participer à l’expérience, ils ont justifié leurs réticences par le manque de temps (argument le plus fréquent), par le désir de préserver un espace personnel ou encore par la crainte d’un regard extérieur, perçu comme la source d’une possible remise en question. Certains ont également invoqué la difficulté de combiner cette expérience avec la gestion de leur classe, jugée trop problématique dans une école «difficile».
Pour en revenir à nos enseignants partenaires, les consignes que nous leur avons données les invitaient à mettre en œuvre leurs pratiques ordinaires d’enseignement de la lecture. Leurs choix se sont cependant révélés assez variés à cet égard puisque, si la plupart des enseignants du niveau 10 (élèves de 15 ans) nous ont affirmé avoir procédé «comme d’habitude», les autres nous ont précisé qu’ils avaient malgré tout cherché à faire «de leur mieux», d’une part en raison du contexte universitaire et du cadre international de cette recherche, d’autre part en raison de la nature des activités mises en œuvre au cours de l’expérimentation. En effet, la méthode consistant à commencer par inviter les élèves à lire en autonomie une nouvelle de huit pages, puis à répondre à un questionnaire portant sur trois processus de lecture –la compréhension, l’appréciation et l’interprétation– a été perçue par bon nombre de maitres comme des démarches «nouvelles» ou «rares» par rapport à leurs pratiques ordinaires, en particulier dans les classes du niveau 4 (élèves de 9 ans). Ils ont dès lors perçu la conjonction de ces éléments comme une invitation à «se dépasser» et à faire montre d’exemplarité.
Par ailleurs, lorsque nous les avons interrogés sur les raisons de leur engagement dans l’expérience, les maitres ont fait état de trois intérêts. Le premier était d’être informés des résultats de leurs élèves afin de mieux connaitre leur niveau d’autonomie, analyse qui «n’est pas possible dans les pratiques quotidiennes» (Élisabeth, F 73), et de pouvoir ainsi mieux saisir leurs compétences, «voir où ils en sont» (Maxime, B 4). Parallèlement, plusieurs ont manifesté le souhait de pouvoir analyser leurs pratiques pédagogiques avec les chercheurs, afin de pouvoir mieux «se positionner», «discuter sur la pédagogie, avancer» (Marine, F 4), et de savoir «si les méthodes utilisées sont cohérentes, logiques, pertinentes» (Marie, F 10). Enfin plusieurs enseignants ont également fait part de leur désir de prendre connaissance des résultats nationaux et internationaux de la recherche afin de pouvoir situer leurs pratiques d’enseignement par rapport à celles de leurs pairs d’autres niveaux et d’autres pays et de pouvoir envisager, le cas échéant, l’adoption «d’autres façons de faire» (Catherine, F7). L’intérêt manifesté était donc lié clairement à une dynamique d’évolution des pratiques.
Quelle circulation des concepts et des méthodes entre chercheurs et enseignants ?
Si l’analyse qui précède permet déjà de mesurer l’intérêt des enseignants envers le monde de la recherche, en accord avec d’autres chercheurs (Gather Thurler, 1993; Bucheton, 2005; Desgagne, Serge & Larouche, 2010; Vinatier & Morrissette, 2015), nous émettons l’hypothèse que la circulation des savoirs entre les sphères scientifique et enseignante n’a de chance d’être efficace que lorsqu’elle se fait dans les deux sens, c’est-à-dire non seulement dans un mouvement qui va du terrain vers la recherche, mais aussi dans le mouvement inverse, qui va des chercheurs vers les enseignants, ce qui suppose cependant qu’on se montre attentifs aux modalités de cette circulation et qu’on commence par identifier précisément les concepts et les processus sur lesquels un échange fécond semble possible.
Une diversité de positionnements à propos de la compréhension
à cet égard, que nous apprennent les entretiens sur les représentations des enseignants à propos de leurs pratiques? Ils font état de représentations bien ancrées de l’activité de lecture: les pratiques décrites par les enseignants semblent moins interrogées que posées en termes de fidélité à un modèle implicite à trois composantes majeures, au moins pour le primaire et le collège : l’accès à la compréhension, le choix du cours dialogué et la succession de l’oral et de l’écrit (on interagit à l’oral avant de faire écrire), qui relèvent pour eux d’une routine professionnelle. Les entretiens font également apparaitre une diversité de positionnements à propos de la compréhension, et en particulier des attentes et des réponses qui varient selon les niveaux scolaires.
En l’occurrence, les enseignants du primaire et du collège insistent sur l’importance de former des lecteurs qui comprennent (Claire, F 4; Maxime et Oriane, B 4). La compréhension est ainsi source chez eux de nombreux développements :
«Le but premier, en fait, c’est qu’ils aient compris l’histoire… mais de façon globale parce que le gros problème qu’ils ont à cet âge-là c’est de s’arrêter vraiment mot à mot, dès qu’ils ont un mot compliqué ils sont bloqués» (Oriane, B 4);
«On ne s’autorise pas assez de temps sur la compréhension, il faudrait pouvoir faire une lecture-compréhension individuelle dans un premier temps et s’accorder un second temps de relecture, or ce n’est pas ce que l’on fait en classe» (Catherine, F 7).
A cet égard, le questionnaire de lecture est apparu à plusieurs enseignants comme un premier temps offert aux élèves pour mener une lecture attentive et compréhensive du texte.
En revanche, il ressort des entretiens avec les enseignants de lycée, que, chez eux, la compréhension n’est plus questionnée, car elle est perçue comme «allant de soi» (Marie, F 10). Ces enseignants privilégient plutôt l’interprétation (Céline, B 10), la perception du travail de l’écrivain (Pascale, B 10) ou encore les spécificités génériques de la nouvelle, comme sa longueur et sa chute.
Du collège au lycée, les entretiens révèlent en outre une différenciation des positionnements, qui vont d’une centration sur les apprentissages des élèves à un questionnement sur les méthodes d’enseignement.
Face à cette focalisation différenciée sur les processus de lecture et sur les pratiques d’enseignement, le chercheur est perçu par les enseignants tantôt comme un interprète expert, tantôt comme un didacticien, et il est sollicité pour identifier «quels points mettre en lumière» ou pour proposer des approches diversifiées de la nouvelle. «Comment aborder un texte long de façon originale ?» demande ainsi une enseignante du lycée au chercheur qui l’interroge (Marie, F 10).
Un regard à priori peu problématisé sur les concepts et les méthodes: le rôle de l’entretien
Certes, à l’issue de la séance qu’ils ont menée, les enseignants formulent peu de commentaires spontanés sur les savoirs et les concepts enseignés (comme la notion de littérature ou les genres littéraires), sur les processus de lecture et même sur les méthodes d’enseignement, car ilss’intéressent avant tout à laparticipation de leurs élèves et à la qualité des échanges qu’ils ont obtenus. Néanmoins, si cette focalisation sur les élèves est quasi exclusive chez les professeurs du primaire, chez ceux du collège elle se combine à l’émergence d’une préoccupation relative à la diversité des approches et des interprétations envisageables (ex. : Pol, B 7; Catherine, F7), qui devient ensuite centrale dans les entretiens avec les enseignants de lycée. Ce sont cependant les questions que nous posons au cours de l’entretien qui favorisent la clarification des choix opérés au cours de la séance, provoquent des questionnements sur les processus de lecture (comment développer la compréhension, l’interprétation et l’appréciation? quelle relation instaurer entre ces trois processus? quelle priorité à donner à l’une ou à l’autre? quelles interprétations et quelles appréciations privilégier? comment guider leur mise en œuvre?) et suscitent une première réflexion sur la relation entre concepts enseignés et méthodes.
L’entretien fut ainsi l’occasion de confronter les discours et les pratiques des enseignants à la distinction que les chercheurs établissent entre la compréhension, l’interprétation et l’appréciation (voir notamment Falardeau, 2003; Dufays, 2010; Gabathuler, 2016), quand bien même nos témoins n’utilisaient pas ces termes exacts : les élèves lisent en effet tous les jours des œuvres (compréhension), les discutent (interprétation), donnent leur avis ou se font évaluer sur leur interprétation (appréciation). L’un des enjeux de la recherche «Gary» est justement de penser ce triangle sur le plan didactique, et plus précisément en matière de progression des curricula au fil de la scolarité: à cet égard, nos entretiens avec les enseignants ont confirmé à la fois la prégnance des trois opérations dans leurs pratiques quotidiennes et le flou conceptuel et terminologique dont elles font souvent l’objet.
Une circulation de savoirs de la recherche vers le terrain... et inversement
Par ailleurs, au cours des entretiens, il n’est pas rare que le chercheur soit sollicité pour fournir des apports didactiques (une enseignante nous a par exemple demandé conseil sur «la dictée à l’adulte» comme moyen de produire une trace écrite de la séance) ou des références bibliographiques qui le conduisent alors à présenter des articles ou des revues de didactique peu connus des enseignants. L’entretien est ainsi pour certains enseignants une occasion de découvertes («On peut donc donner un texte long et compliqué à lire en autonomie à des élèves de CM !», Marine, F 4) et il constitue un temps de transmission informelle de savoirs susceptible d’avoir un certain impact sur les pratiques.
à l’inverse, si le questionnaire proposé aux élèves n’était pas supposé susciter un intérêt particulier chez les enseignants, plusieurs d’entre eux ont manifesté leur intention de l’utiliser pour aborder d’autres textes. Malgré les réserves que suscite souvent ce genre d’outil scolaire, ce questionnaire les a séduits parce qu’il a favorisé leur prise de conscience d’un travail possible sur l’articulation des trois processus de lecture que sont la compréhension, l’interprétation et l’appréciation:
«Les trois pôles du questionnaire pourraient structurer mon travail. On peut donc mener ces trois pôles lors de la même séance ? Ou bien se focaliser sur un seul, ou les traiter successivement ?» (Catherine, F 7)
De telles déclarations attestent d’une circulation inattendue de savoirs issus de la recherche vers le terrain en matière d’enseignement de la lecture. Elles nous semblent, d’une part, inverser la vectorisation habituelle du modèle implicite de l’activité de lecture, qui va de l’oral vers l’écrit (du cours dialogué vers la trace écrite, cf. Chiss, 2012), et d’autre part, suggérer un possible renouvèlement des pratiques de lecture en classe par l’incitation à une interaction oral-écrit et à un travail des trois processus de lecture. Le simple fait de participer à l’expérience «Gary» a donc amené plusieurs enseignants à s’interroger avec le chercheur sur une évolution possible de leurs pratiques susceptible d’être analysée par la recherche.
Mais la circulation des savoirs ne s’est pas faite seulement des chercheurs vers les enseignants: les premiers ont en effet pu dégager de ces entretiens d’une part une validation didactique de la pertinence de leur protocole d’enquête et d’autre part une compréhension affinée des difficultés d’enseignement et d’apprentissage des opérations de lecture et des points d’appuis précieux pour en clarifier la définition et l’articulation.
Quelles relations entre la sphère de la recherche et celle de l’enseignement?
Un autre thème abordé lors de nos entretiens avec les enseignants concernait leurs perceptions des relations entre les sphères de la recherche et de l’enseignement.
Les réponses reçues permettent d’abord de constater que le contact entre les deux sphères s’établit dans trois contextes distincts. Le premier est, bien naturellement, celui des relations directes entre les chercheurs et les enseignants (à l’occasion de la récolte des données, bien sûr, mais aussi à l’occasion des entretiens «pré» et «post»), mais les rapports entre recherche et enseignement deviennent aussi un thème de réflexion entre les différents enseignants engagés dans le projet (deuxième contexte), et plus largement entre différents enseignants dès lors que l’un ou l’autre est engagé dans tel ou tel projet qui implique une dimension de recherche et qu’il en a parlé avec ses collègues (troisième contexte).
Ces contacts se faisant le plus souvent de façon informelle, il est utile de réfléchir aux dispositifs qui paraitraient les plus à même de favoriser une articulation optimale entre les sphères de l’enseignement et de la recherche. La première chose à envisager est bien entendu la communication des résultats de la recherche auxenseignants qui y ont participé, mais aussi à d’autres enseignants à qui ces résultats sont susceptibles d’apporter des éclairages précieux tant sur leurs pratiques que sur les compétences de leurs élèves.
Une autre modalité plus exigeante consiste à revenir avec les enseignants partenaires sur leurs pratiques à partir d’extraits de séances et /ou de verbatims de la séance qu’ils ont mise en œuvre en suscitant une auto-confrontation qui les amène à prendre un recul propice à l’intégration de données issues de la recherche. Corollairement, l’occasion est belle pour le chercheur de profiter de ce partenariat avec des enseignants pour leur communiquer des articles de recherche et les familiariser avec des revues de didactique.
Enfin, plusieurs enseignants se sont montrés disponibles au prolongement d’un partenariat avec le chercheur qui leur permettrait d’expérimenter dans leurs classes des dispositifs déjà validés par les résultats du projet. Certains se sont même dits prêts à co-intervenir avec le chercheur lors de réunions scientifiques (séminaires, journées d’études) pour présenter l’expérience qu’ils ont permis de réaliser et l’analyse qui en résulte. Ce sont là deux modalités de ce qu’il est convenu d’appeler la recherche collaborative (Bednarz, 2013).
Des résultats exploitables en formation?
Parallèlement à l’établissement de relations plus ou moins structurelles entre des enseignants et des chercheurs, le contexte le plus évident pour la communication des résultats de la recherche aux enseignants est celui des formations initiale et continue. Les résultats du projet Gary ont ainsi déjà pu être présentés à des enseignants en formation en vue de les sensibiliser aux enjeux et aux modalités des trois processus de lecture abordés par le projet que sont la compréhension, l’appréciation et l’interprétation. Par ailleurs, pour autant que cela ait fait l’objet d’un accord formel de la part des enseignants partenaires, la base de données constituée par les séances vidéos de professeurs expérimentés et par les verbatims pourrait servir de supports exploitables en formation. Enfin, nous avons déjà eu l’occasion d’inviter plusieurs jeunes enseignants à participer eux-mêmes à l’expérimentation «Gary» au cours de leur formation initiale, ce qui a permis à la fois de les exercer à l’analyse des pratiques enseignantes et de susciter chez eux l’adoption de pratiques nouvelles.
Conclure?
La réflexion sur la circulation des savoirsentre la recherche et le terrain n’est certes pas nouvelle. On se souvient qu’elle a déjà fait l’objet d’analyses stimulantes, notamment de la part de Dominique Bucheton (2005) et de Roland Goigoux (2018). Notre objectif premier dans cette contribution était d’en interroger les possibilités au départ d’un projet précis, qui vise à mieux comprendre les compétences des élèves et les pratiques des enseignants au fil de la scolarité, et au-delà, à identifier les pratiques qui aident le plus les élèves à mieux lire. Cette analyse nous a permis de montrer comment nous avons pu arriver, modestement, à impliquer des enseignants mobilisés par le projet –et à partir d’eux, d’autres enseignants– dans une dynamique de questionnement, de recherche et même de changement.
Bibliographie
Beaud, Stéphane & Florence Weber (2003), Guide de l'enquête de terrain, Paris, La Découverte «Repères».
Bednarz, Nadine (2013), Recherche collaborative et pratique enseignante. Regarder ensemble autrement, Paris, L’Harmattan.
Blanchet, Alain & Anne Gotman (2007), L'entretien, Paris, Armand Colin «128».
Brunel, Magali & Jean-Louis Dufays (2017), «Comment des élèves de 9 à 15 ans lisent-ils un même texte littéraire et comment leurs enseignants le didactisent-ils? Une comparaison France-Belgique», in L’enseignement et l’apprentissage de la lecture aux différents niveaux de la scolarité, M. Brunel et al. (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur (Diptyque), p. 103-136.
Brunel, Magali et al.(2017), «Lire un même texte littéraire de 12 à 15 ans: quels apprentissages et quels dispositifs? Regards croisés France, Belgique, Québec», Ibid., p. 137-162.
Brunel, Magali et al.(2018), «Le discours des élèves sur les valeurs du texte littéraire et leur exploitation didactique par les enseignants: quelles variations selon les classes d’âge et selon les pays?», in Enseigner la littérature en questionnant les valeurs, N. Rouvière (dir.), Berlin, Peter Lang, p. 279-302.
Brunel, Magali et al. (à paraitre), «Lire en classe l’altérité: quelle progression entre 12 et 15 ans? Deux analyses à partir de la nouvelle "J’ai soif d’innocence" de Romain Gary», in Littérature de l’altérité, altérités de la littérature: moi, nous, les autres, le monde, M. Jeannin et A. Schneider (dir.).
Bucheton, Dominique (2005),«Au carrefour des métiers d’enseignant, de formateur, de chercheur», in Didactique du français. Fondements d’une discipline, J.-L. Chiss et al., (dir.), Bruxelles, De Boeck «Savoirs en pratique», p. 193-210.
Chiss, Jean-Louis (2012), L'écrit, la lecture et l'écriture. Théories et didactiques, Paris, L’Harmattan.
Cordonier, Noël (2014), «Questions critiques, et donc constructives, sur la recherche en didactique du français», in Littérature, langue et didactique. Hommages à Jean-Louis Dumortier, J. Van Beveren (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur «Diptyque»), p. 11-26.
Desgagne, Serge & Hélène Larouche (2010), «Quand la collaboration de recherche sert la légitimation d’un savoir d'expérience», in Recherches en éducation, Hors série n°1, p.7-18.
De Ketele,Jean-Marie & Xavier Roegiers, (1996, 4e éd. 2009), Méthodologie du recueil d'informations, Bruxelles-Paris, De Boeck Université.
Dufays, Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang « ThéoCrit ».
Dufays, Jean-Louis & Magali Brunel (2016), «La didactique de la lecture et de la littérature à l’aube du XXIe siècle. État des recherches en cours et focus sur la perspective curriculaire», in Didactiques du français et de la littérature, A. Petitjean (dir.), Metz, CREM « Recherches textuelles », p. 233-266.
Falardeau, Erick (2003), «Compréhension et interprétation : deux composantes complémentaires de la lecture littéraire», in Revue des sciences de l’éducation, 29, n°3, p. 673-694.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature. La relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Gather Thurler, Monica (1993), «Amener les enseignants vers une construction active du changement. Pour une nouvelle conception de la gestion de l'innovation», in Education et Recherche, 1993, n° 2, p. 218-235. En ligne, URL : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/gather-thurler/Textes/Textes%201993/MGT-1993-02.html
Goigoux, Roland (2018), «Quels savoirs utiles aux formateurs?» Conférence en ligne, URL: http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/formateurs/roland-goigoux-quels-savoirs-pour-les-formateurs
Vinatier, Isabelle & Joëlle Morrissette (2015), «Les recherches collaboratives: enjeux et perspectives», in Carrefours de l'éducation, n° 39, p. 137-170. En ligne, URL:
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2015-1-page-137.htm
Pour citer l'article
Isabelle Brun-Lacour & Jean-Louis Dufays, "De la classe à la recherche et de la recherche à la classe, quelle circulation des savoirs ? Observations et analyses au départ du projet « Gary »", Transpositio, n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/de-la-classe-a-la-recherche-et-de-la-recherche-a-la-classe-quelle-circulation-des-savoirs-observations-et-analyses-au-depart-du-projet-gary
Voir également :
Circulation bidirectionnelle des savoirs : les interventions didactiques et pédagogiques en classe de littérature
Née dans un contexte militant qui voulait rénover les pratiques d’enseignement, la didactique est traversée depuis son origine par une orientation praxéologique, qui consiste en des « recherches sur l’intervention didactique » (Halté 1992 : 16). Or, selon Daunay et Reuter, «[l]’approche scientifique s’est séparée de l’intervention, créant une “dualité d’approche”» (2008 : 61). En 2019, la didactique du français est devenue autonome, aussi s’est-elle attachée à stabiliser son appareillage théorique et méthodologique, ainsi qu’à consolider les acquis de recherches, comme le montrent les thématiques de colloques récents : «Les concepts dans la recherche en didactique du français. Émergence et création d'un champ épistémique» (AIRDF, Lyon, 2019), «Didactique des langues & plurilinguisme(s) : 30 ans de recherches» (LIDILEM, Grenoble, 2019), «Littérature(s) et langue(s) en classe: quelle circulation entre méthodologies de recherche et pratiques enseignantes?» (19es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, Lausanne, 2018). Ce dernier colloque se penche sur le clivage entre recherche et pratique, qui implique, dans son mouvement descendant, le risque d’applicationnisme et, dans le sens inverse, celui d’institutionnaliser en savoirs didactiques des savoirs pratiques non pertinents.
Circulation bidirectionnelle des savoirs : les interventions didactiques et pédagogiques en classe de littérature
Entre recherche et pratique
Née dans un contexte militant qui voulait rénover les pratiques d’enseignement, la didactique est traversée depuis son origine par une orientation praxéologique, qui consiste en des « recherches sur l’intervention didactique » (Halté 1992 : 16). Or, selon Daunay et Reuter, «[l]’approche scientifique s’est séparée de l’intervention, créant une “dualité d’approche”» (2008 : 61). En 2019, la didactique du français est devenue autonome, aussi s’est-elle attachée à stabiliser son appareillage théorique et méthodologique, ainsi qu’à consolider les acquis de recherches, comme le montrent les thématiques de colloques récents : «Les concepts dans la recherche en didactique du français. Émergence et création d'un champ épistémique» (AIRDF, Lyon, 2019), «Didactique des langues & plurilinguisme(s) : 30 ans de recherches» (LIDILEM, Grenoble, 2019), «Littérature(s) et langue(s) en classe: quelle circulation entre méthodologies de recherche et pratiques enseignantes?» (19es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature, Lausanne, 2018). Ce dernier colloque se penche sur le clivage entre recherche et pratique, qui implique, dans son mouvement descendant, le risque d’applicationnisme et, dans le sens inverse, celui d’institutionnaliser en savoirs didactiques des savoirs pratiques non pertinents.
La circulation bidirectionnelle des savoirs se présente comme une solution méthodologique à ce dualisme. Elle suppose une causalité circulaire (Marcel, Olry, Rothier-Bautzer & Sonntag 2002) vue dans une approche systémique. La recherche est orientée, pour les chercheurs, vers la production de connaissances et, pour les enseignants, vers le développement professionnel (Bednarz, Rinaudo & Roditi 2015).
Nous avons développé la Démarche stratégique d’enseignement de la littérature (désormais DSEL) dans le cadre d’une recherche collaborative qui s’est échelonnée sur plusieurs années, de 2006 à 2010, année de la publication d’un guide pédagogique et didactique (Lecavalier & Richard 2010). Nous tentons dans cet article, dans une démarche de théorisation a posteriori (Chouinard & Caron 2015), d’éclairer le sens de la notion d’intervention didactique et, corollairement, de la notion d’intervention pédagogique, qui constituent des catégories émergentes de nos résultats de recherche. Avant d’exposer nos résultats, qui concernent les échanges observés entre intervention didactique et intervention pédagogique, nous tenterons de dissiper certains malentendus terminologiques, en précisant le sens que nous donnerons en particulier à la notion d’intervention pédagogique. Le problème est que, même si la notion d’intervention didactique apparait dans les écrits de presque tous les chercheurs et chercheuses reconnus de notre discipline, presque personne ne la définit. La banque de données OpenEdition recense 119 publications en didactique du français, entre 1970 et 2019, contenant la notion d’intervention didactique. Nous avons consulté 82 de ces textes, choisis pour leur pertinence, sans trouver de définition claire de l’intervention didactique.
La notion d’intervention en pédagogie et en didactique du français
La notion d’intervention pédagogique ne semble pas plus définie en sciences de l’éducation que celle d’intervention didactique en didactique du français.Notons cependant que la première expression étant plus fréquente, le flottement définitionnel est plus difficile à établir dans le second cas: dans OpenEdition on trouve 414 occurrences pour «intervention pédagogique» comme expression exacte dans le texte intégral, alors qu’il n’y a que 231 occurrences pour «intervention didactique1». Deux publications (Dezutter, Thomas & Deaudelin 2011; Vincent & Lefrançois 2013) de notre corpus de 82 textes de didactique du français utilisent aussi la notion d’intervention pédagogique, de manière interchangeable avec celle d’intervention éducative. Or, celle-ci semble un peu mieux définie2. Les chercheurs en pédagogie (Lenoir et al. 2002) distinguent six niveaux de sens pour la notion d’intervention éducative. Le niveau 1 est celui de l’intervention de l’État dans l’éducation. Au niveau 2, l’intervention porte sur la pratique professionnelle vue comme l’exercice de la profession enseignante. Un 3e niveau de sens considère l’intervention globalement, comme un acte professionnel. Le niveau 4 concerne «l'intervention en tant que processus interactif entre un intervenant et un sujet client» (Lenoir et al. 2002 : n.p.), alors que le niveau 5 désigne les opérations qui s’effectuent dans ce processus, la réalisation «de l'action d'intervention dans l'ensemble (complexe) de ses dimensions» (Lenoir et al. 2002 : n.p.). Le niveau 6 a trait aux «différents gestes mis en œuvre, aux actes posés au cours de la mise en œuvre de l'intervention. Il s'agit ici de la pratique effective au sens strict du terme» (Lenoir et al. 2002: n.p.).
Dans un corpus de 30 textes en pédagogie et en didactique utilisant les notions d’intervention éducative ou d’intervention pédagogique, nous n’avons pas trouvé, pour cette dernière notion, d’occurrence où elle était employée conformément aux niveaux de sens 1 et 2. Il semble donc que l’intervention éducative puisse prendre un sens plus abstrait que l’intervention pédagogique. Cependant, pour les niveaux de sens 3 à 5, nous avons pu recenser des exemples d’emploi, moins pour l’intervention pédagogique que pour l’intervention didactique. Un corpus plus étoffé aurait peut-être donné des résultats plus complets. Ces extraits sont consignés dans le tableau 1.
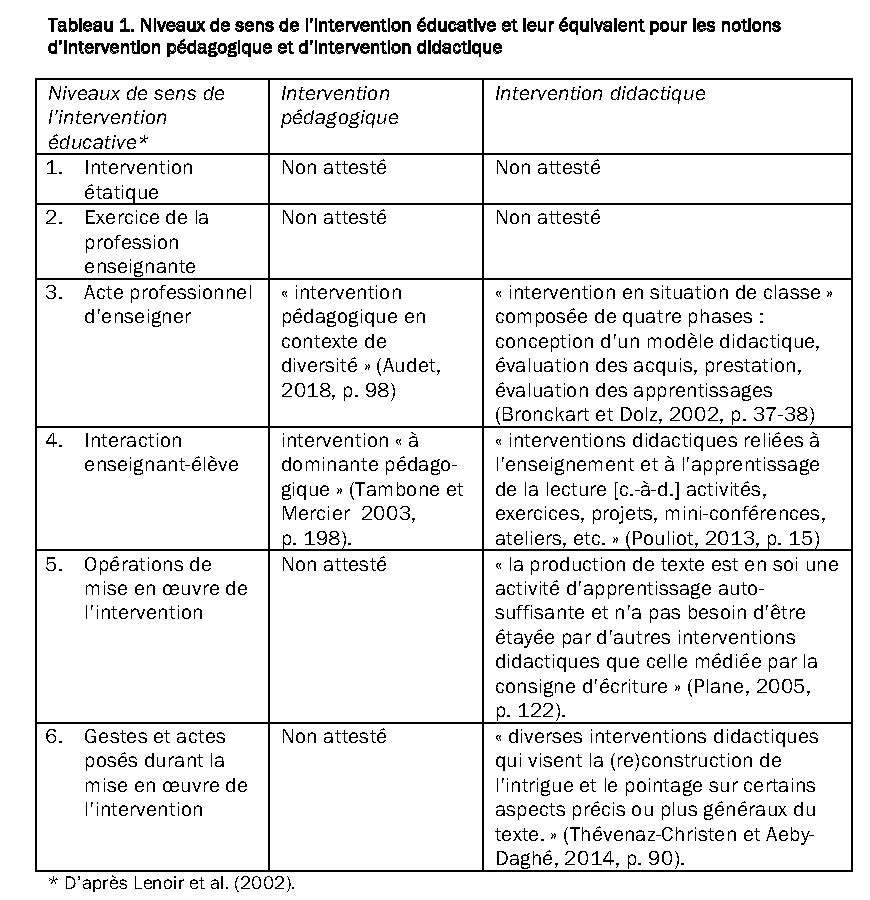
L’objectif qui sous-tend ce tableau est de dissiper une partie du flou conceptuel entourant la notion d’intervention didactique. En montrant que la notion est employée à des niveaux d’abstraction différents, il ne s’agit pas de privilégier l’usage d’un niveau en particulier, mais d’inviter les auteurs et autrices à préciser à quel niveau ils ou elles se situent lorsqu’ils ou elles utilisent la notion. Ce serait une étape logique dans le processus de définition de cette notion. Pour notre part, ce sont les niveaux 5 et 6 qui conviennent à nos objectifs de recherche. Avant de présenter certaines des interventions didactiques et pédagogiques que nous avons observées, il importe au préalable d’exposer la méthodologie utilisée.
La recherche collaborative : intervenir autrement
Le courant de recherche collaborative développé au Québec depuis les années 1990 a suivi un processus d’autonomisation scientifique semblable à celui de la didactique du français. Il s’est démarqué de la recherche-action, qui entretenait des objectifs de changement social ou éducatif (Dolbec & Prud’homme 2009), afin de viser une meilleure compréhension des phénomènes. Ainsi que l’expliquent Bednarz, Rinaudo et Roditi: «Le développement professionnel des enseignants est une retombée, mais pas un objectif de recherche» (2015 : 171). Cette situation de départ offre un double intérêt, pour les chercheurs et pour les enseignants. Le lieu de collecte des données sert aussi de lieu de questionnement de la pratique pour les enseignants. Les résultats doivent être doublement féconds, tant pour la théorisation disciplinaire que pour le développement professionnel.
Au cœur de la DSEL se trouve un dispositif didactique qui développe une lecture authentique, personnelle et autonome chez les élèves, suivant les principes du socioconstructivisme, de la construction des savoirs (Barth 1993), de l’enseignement stratégique (Tardif 1992) et de la théorie du sujet lecteur (Rouxel & Langlade 2004; Langlade, 2007 ; 2008; Langlade & Fourtanier 2007). Elle se déroule en quatre phases: 1) préparation à la lecture d’une œuvre complète; 2) lecture accompagnée; 3) analyse et interprétation; 4) validation des résultats. Le sens de l’œuvre n’est pas donné à l’avance, mais constitue le but de la recherche collective. Cette approche inductive change l’orientation du dialogue en classe, qui ne vise plus à deviner une réponse, mais à construire ensemble une interprétation et à la soutenir. La théorie littéraire, comme l’information sur l’auteur ou le genre, n’est pas fournie d’emblée, mais seulement au besoin, durant les échanges, et à l’étape finale, pour confirmer les interprétations. Dans le cas rapporté ici, pour l’étape d’analyse, l’enseignante avait réparti entre les huit équipes quatre thèmes, dont elles devaient relever les indices. Au cours suivant, chaque membre d’une équipe rencontrait trois élèves de trois autres équipes et leur faisait rapport des résultats de son équipe. Les équipes de base se reformaient le lendemain.
La DSEL a été développée et validée par une équipe formée de quatre enseignantes du secondaire3 et deux enseignants du collégial4 (dont l’un des deux chercheurs), sous la supervision des deux chercheurs. Un canevas de quelques pages préexistait à ce développement, mais il avait été conçu par un va-et-vient de conception théorique et d’expérimentation sur le terrain par le chercheur-enseignant, supervisé par sa collègue chercheuse. La même circulation bidirectionnelle a prévalu durant la conception et la validation de la DSEL avec l’équipe d’enseignants-expérimentateurs, en 2005-2006. À partir de 2010, la mise au point de la DSEL a plutôt pris la forme d’un encadrement d’enseignants qui utilisaient la démarche dans leurs cours et qui recevaient nos conseils, tout en nous communiquant leurs observations, qui enrichissaient ou modifiaient le dispositif. À ce jour, une trentaine d’enseignants, en grande majorité du secondaire, nous ont transmis une rétroaction sur leur usage de la DSEL. Nous distinguons les activités de formation où nous agissons l’une comme conseillère pédagogique, l’autre comme enseignant, ou les deux en tant que directeurs de mémoire (et les enseignants comme nos étudiants), des activités de recherche où les enseignants (en partie les mêmes) collaborent avec nous, qui portons alors le chapeau de chercheurs.
Quelques interventions observées et analysées
Nous avons analysé les interventions d’accompagnement de la lecture en classe de littérature effectuée par deux enseignantes de français formées à l’utilisation de la DSEL et constitué un corpus de 200 interventions. Par «interventions», nous entendons les énoncés linguistiques ou les gestes, accompagnés de déplacements, de regards, de mimiques, d’intonations de l’enseignant, exprimés dans un même tour de parole. Ces interventions ont été classées par grappes en 23 interventions didactiques et 36 interventions pédagogiques, réunies en 14 catégories, elles-mêmes groupées en 5 ordres supérieurs. Ce classement, toujours provisoire, qui a été présenté de façon détaillée dans une autre publication (Lecavalier & Richard 2017), est aussi reproduit dans la figure 1 ci-dessous.
Les résultats de la présente recherche sont exposés sous la forme d’interventions d’une enseignante, observées, analysées et classées. Nous en présentons seulement quelques-unes. L’extrait choisi provient d’un échange dans une équipe d’élèves de 5e secondaire formée d’un garçon et de trois filles. Voici le contexte du roman Héloïse, d’Anne Hébert, qui motive leur discussion, transcrite dans le Tableau 2. À Paris, vers 1970, deux jeunes, Bernard et Christine, s’aiment sans faire encore vie commune. Ils prennent le métro ensemble, mais Christine doit partir la première pour aller chez elle. Bernard entend chanter une voix féminine. Il distingue les paroles, qui parlent d’une femme qu’on n’attendait pas et qui sort de l’ombre. Le métro tombe en panne et c’est le noir. Lorsque l’éclairage revient, une jeune femme «incroyablement belle et pâle» se tient devant lui et «l’observe avec insistance» (Hébert 1980 : 21).
L’échange se résume à la confirmation d’une hypothèse du garçon qui soutient, à l’encontre des filles de son équipe, que la chanson d’Héloïse évoque le chant envoutant d’une sirène, et à la confirmation partielle d’une autre hypothèse, soit qu’Héloïse contrôle Bernard.
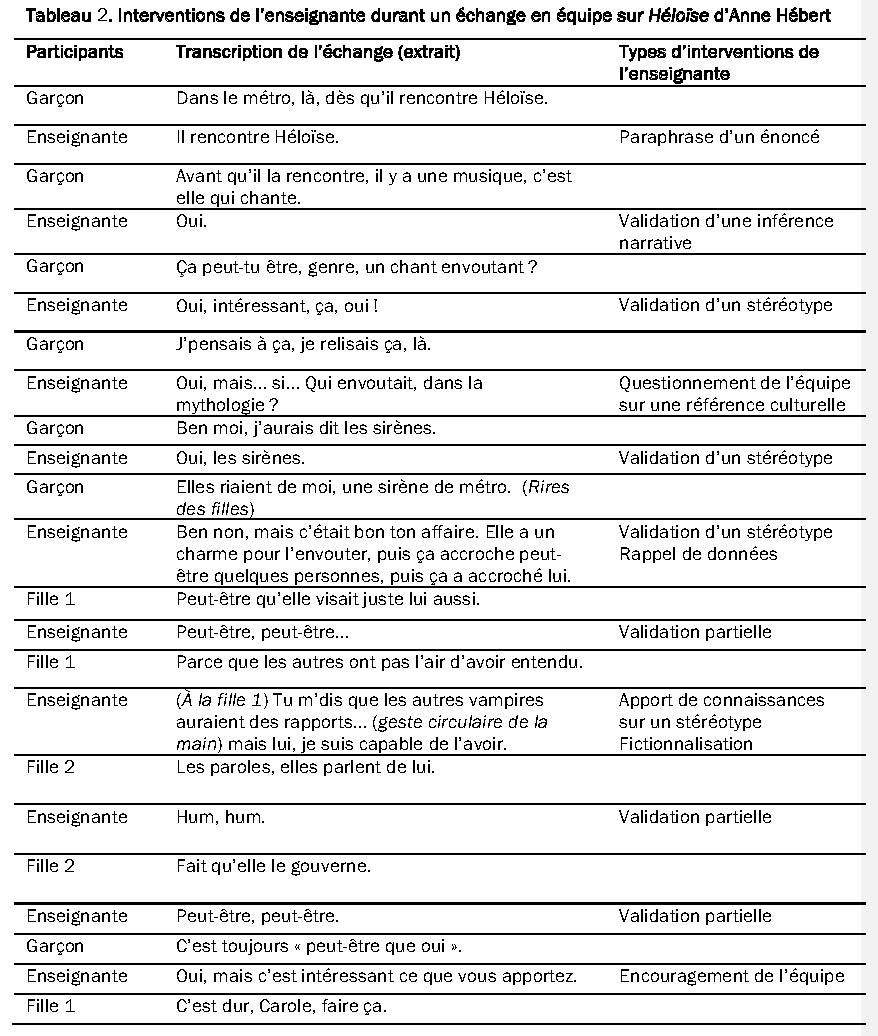
L’analyse et le classement des interventions des enseignantes ont été effectués de manière inductive. Une première répartition est réalisée selon que l’intervention porte principalement sur les données tirées du texte littéraire ou qu’elle porte en priorité sur le travail de l’équipe. En nous inspirant de Tambone & Mercier (2003), nous désignons la première catégorie d’interventions comme à dominante didactique et la seconde, comme à dominante pédagogique. Dans l’extrait choisi, la première intervention de l’enseignante, une paraphrase à fonction phatique, ne sert pas à commenter le sens des propos répétés, mais à confirmer l’établissement du contact langagier avec l’équipe. Il s’agit donc d’une intervention à caractère principalement pédagogique, même si la base de l’entente correspond à un évènement du texte littéraire. Ce type d’intervention est classé dans la catégorie «Discussion avec l’équipe5». De même, les deux interventions suivantes consistent en deux validations, celle d’une inférence narrative et celle d’un stéréotype. Bien que ces deux éléments soient des contenus didactiques, l’opération qui prédomine est la validation; l’enseignante ne développe pas un propos personnel sur ces sujets, elle se borne à indiquer que ce qu’en disent les élèves est juste. En fait, ce sont les élèves qui exposent leur compréhension du texte. Les interventions se situent donc surtout sur le plan pédagogique et elles se classent cette fois dans la catégorie de l’Évaluation des résultats, elle-même une sous-catégorie de l’Évaluation de l’équipe.
Figure 1. Classement des interventions didactiques et pédagogiques observées
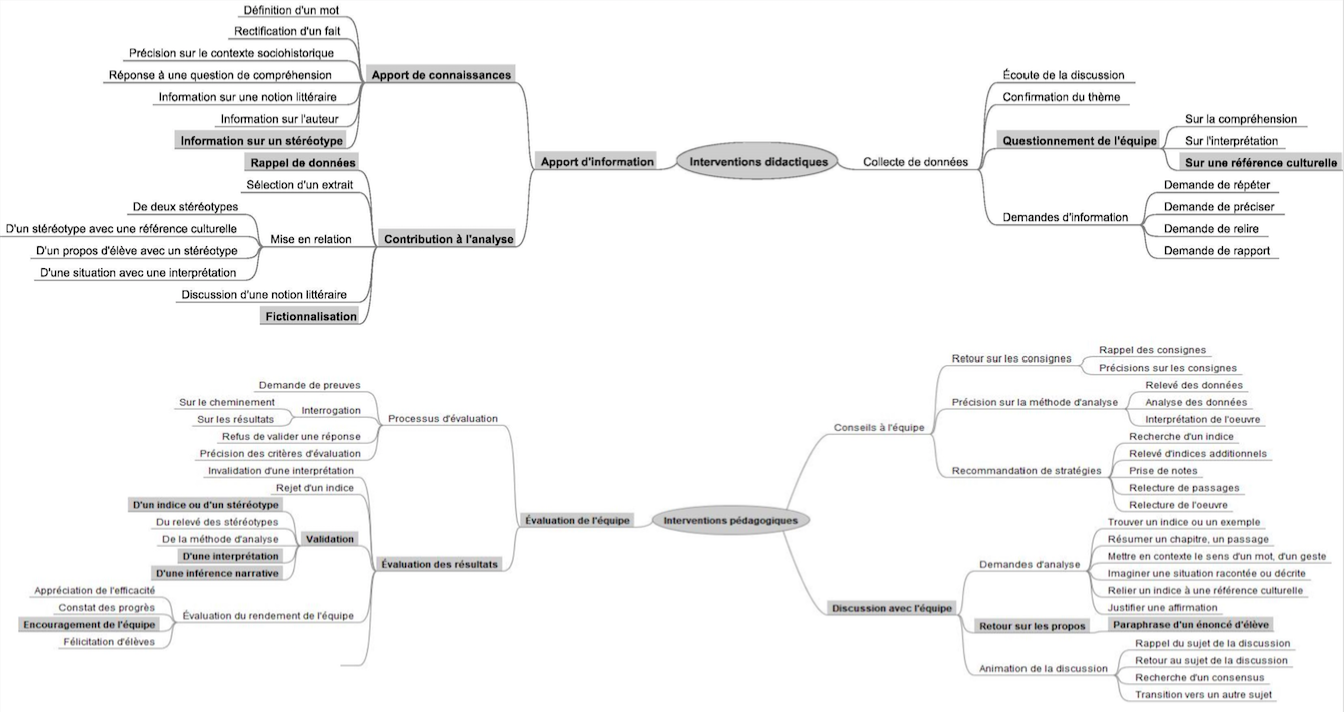 C’est seulement à l’occasion de sa quatrième intervention que l’enseignante passe sur le plan didactique, au moyen d’une question à l’équipe sur une référence culturelle (les sirènes). La question vise à faire relier un personnage du récit avec un personnage mythologique, afin d’aider les élèves à trouver par eux-mêmes un stéréotype qu’elle suppose connu. Son attente est satisfaite par le garçon, dont elle valide la réponse. Apprenant de sa part que les filles sont sceptiques à l’égard des sirènes, elle effectue une autre intervention didactique, cette fois un rappel de données provenant des pages du roman en discussion, intervention classée sous la catégorie «Apport d’information» et la sous-catégorie «Contribution à l’analyse». Puis, à propos de la stratégie d’Héloïse, l’enseignante se contente d’une validation partielle. Il faut dire que cet échange survient à la phase 2 de la DSEL, que la validation complète n’est prévue qu’à la phase 4 et que la découverte du contrôle de Bernard par Héloïse est capitale. Cependant, l’enseignante accepte d’informer l’équipe sur un stéréotype en évoquant la croyance que les vampires peuvent avoir des «rapports», mot qu’elle laisse en suspens et qu’elle accompagne d’un geste circulaire de la main, pour faire sous-entendre une sorte de sexualité. Ensuite, l’enseignante contribue encore à l’analyse, mais sous la forme d’une fictionnalisation (Langlade 2008), puisque l’enseignante se met à la place d’Héloïse. Pressée de valider l’hypothèse du contrôle, elle revient sur le plan pédagogique pour encourager l’équipe à poursuivre dans le même sens.
C’est seulement à l’occasion de sa quatrième intervention que l’enseignante passe sur le plan didactique, au moyen d’une question à l’équipe sur une référence culturelle (les sirènes). La question vise à faire relier un personnage du récit avec un personnage mythologique, afin d’aider les élèves à trouver par eux-mêmes un stéréotype qu’elle suppose connu. Son attente est satisfaite par le garçon, dont elle valide la réponse. Apprenant de sa part que les filles sont sceptiques à l’égard des sirènes, elle effectue une autre intervention didactique, cette fois un rappel de données provenant des pages du roman en discussion, intervention classée sous la catégorie «Apport d’information» et la sous-catégorie «Contribution à l’analyse». Puis, à propos de la stratégie d’Héloïse, l’enseignante se contente d’une validation partielle. Il faut dire que cet échange survient à la phase 2 de la DSEL, que la validation complète n’est prévue qu’à la phase 4 et que la découverte du contrôle de Bernard par Héloïse est capitale. Cependant, l’enseignante accepte d’informer l’équipe sur un stéréotype en évoquant la croyance que les vampires peuvent avoir des «rapports», mot qu’elle laisse en suspens et qu’elle accompagne d’un geste circulaire de la main, pour faire sous-entendre une sorte de sexualité. Ensuite, l’enseignante contribue encore à l’analyse, mais sous la forme d’une fictionnalisation (Langlade 2008), puisque l’enseignante se met à la place d’Héloïse. Pressée de valider l’hypothèse du contrôle, elle revient sur le plan pédagogique pour encourager l’équipe à poursuivre dans le même sens.
Après son départ, même si le garçon a l’occasion de démontrer la correspondance entre le texte de la chanson et le triangle amoureux qui se dessine entre Bernard et les deux femmes, l’échange entre les filles de l’équipe révèle que celles-ci n’adhèrent toujours pas à l’hypothèse de la sirène :
Fille 1 : On marque-tu une sirène pour vrai? Elle [l’enseignante] a dit que c’était bon.
Fille 2 : On dit une sorte de sirène… de métro. (Pause) On dit juste qu’elle est envoutante.
Cette autocorrection nous fait supposer que l’image stéréotypée que les filles se font des sirènes n’inclut pas leur chant envoutant, mais seulement leur aspect de femmes-poissons, davantage véhiculé dans la culture de masse (films La petite sirène 1 et 2 de Disney). Dans ce cas, l’expression «sirène de métro» a dû signifier pour elles un signal d’alarme, un bruit absent du roman. Une intervention didactique aurait été requise afin de dissiper cette ambigüité qui n’a pu être décelée que par nos observations à posteriori.
La thèse du caractère prophétique de la chanson d’Héloïse a continué à circuler dans la classe le lendemain. En effet, quand les équipes ont été reformées de façon que les élèves fassent rapport aux autres de leurs résultats de la veille, notre caméra a filmé deux des membres de l’équipe ci-dessus, le garçon et la fille 3, en train de présenter leur explication de la chanson à deux équipes distinctes6. Contrairement au garçon, la fille 3 n’a pas présenté Héloïse comme une sirène et c’est une autre image qui s’est formée dans cette équipe provisoire, à partir des paroles de la chanson : «Celle qu’on n’attendait pas […] / Creuse sa galerie profonde […] / Pour venir jusqu’à toi» (Hébert 1980 : 20).
Fille 3 : C’est comme si elle sortait de son trou pour aller jusqu’à Bernard. (Rires des filles)
Fille 4 : Elle sort de son (mot inaudible) pour aller le chercher. Allez, viens mon lapin! (Rires)
La réduction de la «galerie» au «trou» trahit chez la fille 3 un rabaissement d’Héloïse à un animal prédateur et sournois. Le rapport avec un renard ou un loup se précise dans l’association de Bernard avec un lapin. Il y a fonctionnalisation, accompagnée d’une identification avec Héloïse, ce qui crée une gêne que les rires viennent soulager. En effet, le fantasme qui vient d’être évoqué renverse la domination traditionnelle de l’homme sur la femme. Ce n’est pas tant le choix du stéréotype qui importe, sirène ou mammifère prédateur, que le fait que ces images permettent aux élèves de coconstruire leur perception des personnages et de leur relation.
L’analyse qui précède montre qu’il faut prendre en compte les interactions avec les élèves et les problèmes de compréhension et d’interprétation de l’œuvre littéraire afin de cerner la nature des interventions pédagogiques et didactiques. Cela posé, l’analyse conversationnelle (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974 ; Mondada & Pekarek Doehler 2000) peut aussi apporter une information complémentaire à leur propos. Puisque l’intervention y est définie comme centrée sur un acte de langage (Roulet 1991), il est possible de réanalyser certaines de nos interventions: ainsi, la validation du stéréotype de la sirène peut apparaitre comme un acte perlocutoire, qui met fin au traitement des informations par les élèves. Une validation partielle correspondrait plutôt à un acte illocutoire, puisque c’est une incitation à poursuivre le traitement dans le sens déjà entrepris. Par ailleurs, la notion de négociation empruntée à Roulet (1991) rend compte des réactions du garçon et de la fille 1 aux validations partielles répétées de l’enseignante et souligne la pression effectuée pour recevoir plus d’aide. Étant donné que la DSEL prescrit de ne pas valider les interprétations avant la phase finale et qu’il semble que l’enseignante n’ait pas trouvé, lors de la découverte imprévisible du lien entre Héloïse et une sirène, une manière plus épistémique de relancer le travail des élèves, elle compense par un encouragement de l’équipe, une intervention pédagogique qui évalue le rendement des élèves. Cette analyse à postériori nous amène à ajouter à la DSEL une intervention de validation conditionnelle, consistant à confirmer une hypothèse au moyen de la vérification d’une hypothèse corollaire de la précédente. Dans le cas présent, l’hypothèse de la sirène séductrice aurait pu être validée en demandant aux élèves de vérifier que Christine jouait effectivement un rôle opposé.
L’analyse conversationnelle révèle aussi le pouvoir réparateur des rires des filles, dans une intervention non verbale à caractère restitutif, lorsque le garçon se plaint à l’enseignante qu’elles ont rejeté sa thèse de la sirène. La justification peut alors être excusée à cause d’un manque d’entrainement, ce qui évite aux filles de perdre davantage la face. Toutefois, ce que l’analyse conversationnelle n’explique pas, c’est que, malgré cette réparation et la validation complète apportée par l’enseignante à l’envoutement par les sirènes, les filles n’acceptent toujours pas d’associer Héloïse à une sirène. Cela montre que la persuasion ne se déroule pas seulement sur le plan des interactions sociales, mais aussi sur celui de la cognition, dont rend compte notre analyse du discours, pour la suite des échanges. Les limites de l’analyse conversationnelle nous ramènent à l’analyse du discours, mais vue dans une «logique interlocutoire» (Gehin 2005 : 255), qui rappelle la notion de circulation bidirectionnelle. Dans cette optique, les interventions comme l’apport d’informations et le rappel de données prennent une fonction indicative quand le sens qu’elles proposent est négocié dans l’interaction didactique et transformé en une signification utile à la compréhension du contexte. L’analyse de discours peut donc suivre, d’une intervention à l’autre, la reprise et la modification des mots, le degré de prise en charge énonciative et d’autres indicateurs semblables, qui échappent à l’analyse conversationnelle.
Bilan et limites de notre recherche
Bien que nous n’ayons pas la place ici pour présenter les 24 interventions didactiques et les 37 interventions pédagogiques classées à la Figure 1, un commentaire s’impose sur la notion même d’intervention. Celle-ci constitue un acte professionnel qui prend son sens non seulement dans le milieu scolaire, mais dans une conception de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour nous et les enseignants participant à nos recherches, il s’agit de la Démarche d’enseignement stratégique de la littérature. Pour qu’un énoncé quelconque, une mimique, un geste, un déplacement, la consultation du roman, du dictionnaire, ou une combinaison de tout cela prenne un sens didactique ou pédagogique à nos yeux, nous devons être en mesure de percevoir son influence sur le milieu. La désignation des interventions didactiques et pédagogiques recourt à des notions comme «stéréotype», «indice», «fictionnalisation», rattachées à la DSEL, ainsi qu’à des termes plus courants, tels que «relecture» et «interprétation», mais qui sont réactualisés dans la DSEL. Semblablement, les noms d’action («demande», «apport», «questionnement», «discussion», etc.) renvoient à des stratégies d’enseignement de la démarche. Autrement dit, notre classement ne prend sa valeur qu’en fonction du modèle d’enseignement et d’apprentissage qui l’a inspiré et il n’est transférable que dans la mesure où d’autres chercheurs et chercheuses y voient des similitudes avec leurs propres préoccupations.
Du point de vue méthodologique, la détection des interventions résulte d’une observation très fine, guidée au départ par les paramètres ci-dessus et tournée ensuite vers le langage verbal et non verbal de l’enseignant et des élèves, à la manière de l’analyse de discours. Cependant, celui-ci n’est pas la base de la recherche de régularités formelles, contrairement à la méthode usuelle (Eisenhart & Johnstone 2012), car ce sont les éléments de contenu, comme la chanson d’Héloïse, qui servent de critère de choix pour les échanges analysés. Il ressort aussi que les interactions avec les élèves, et même les interactions entre les élèves sans l’enseignant, représentent une donnée essentielle pour l’étude des interventions pédagogiques et didactiques. Or, dans le discours que les élèves coconstruisent afin de se représenter la signification de l’œuvre littéraire, ils font interagir des personnages dont ils cherchent à s’expliquer les agissements, faisant preuve d’une activité fictionnalisante (Langlade 2008) où ils se projettent comme lecteurs. À cela s’ajoute le palier de la recherche collaborative enseignant/chercheurs, marquée par d’autres interactions, d’où un modèle à quatre niveaux d’interaction7, sans compter les échanges entre chercheurs dans les colloques et au moyen des publications, qui se répercutent aussi sur les milieux d’enseignement.
Par rapport aux objectifs de cette contribution, qui visaient à mieux définir la notion d’intervention didactique et pédagogique tant par la théorie que par l’observation, il semble bien que les interventions identifiées se situent au niveau de sens numéro 6, celui des actes très concrets, posés en appui à des gestes didactiques professionnels (Aeby-Daghé & Dolz 2008), lesquels sont classés au niveau 5. De plus, ces interventions sont analysées dans un cadre didactique disciplinaire propre à la didactique de la littérature, en lien avec le dispositif qui, le plus souvent, les a inspirées ou les a rendues possibles. Elles ne sont pas décrites et regroupées afin de créer un système exhaustif ou normatif, modélisant un enseignement bien fait, mais à titre de productions de la «cognition créatrice» (Varela, Thompson & Rosch 1993, cités par Gehin 2005 : 248) d’enseignants capables de multiplier des interventions similaires ou différentes, tout en restant cohérentes par rapport au dispositif d’enseignement qu’elles ont assimilé.
Par ailleurs, nous n’avons pas défini les précautions théoriques et méthodologiques qui empêchent qu’une intervention observée soit automatiquement institutionnalisée, considérée comme un savoir digne d’être incorporé dans la formation des enseignants. Ici encore, la DSEL sert de repère. Même si le développement professionnel des enseignants constitue une retombée et non un objectif de la recherche collaborative, la validation des interventions exerce néanmoins un effet formateur sur les choix pédagogiques et les pratiques didactiques des enseignants, de même que sur leur évaluation de l’activité fictionnalisante des élèves. Elle conduit à définir des besoins de formation professionnelle.
Malgré un corpus de 200 interventions observées, il faut bien davantage que deux enseignantes participantes et des moyens plus considérables que les nôtres pour constituer un répertoire crédible d’interventions. Il nous reste aussi à étudier les séquences d’interventions dans les échanges, de même que leur fréquence. Les interventions didactiques et pédagogiques, comme des stratégies, ne possèdent aucune valeur absolue et ne prennent leur pertinence qu’en contexte. Leur analyse s’effectue donc en action située, mais aussi en fonction du dispositif didactique utilisé, des théories qui l’ont inspiré, des objectifs de recherche et des finalités de l’enseignement de la littérature. C’est seulement en précisant un tel cadre qu’il sera possible de définir plus précisément la notion d’intervention didactique. Circulation bidirectionnelle, avons-nous dit? Devant la complexité du modèle qui ne fait que s’esquisser, c’est de circulation multidirectionnelle qu’il s’agit plutôt.
Bibliographie
Aeby-Daghé, Sandrine & Joaquim Dolz (2008), «Des gestes didactiques fondateurs aux gestes spécifiques à l’enseignement-apprentissage du texte d’opinion», in Perspectives en éducation et formation, D. Bucheton & O. Dezutter (dir.), Bruxelles, de Boeck Supérieur, p. 83-105.
Audet, Geneviève (2018), «Intervention pédagogique et diversité ethnoculturelle : théorisation de récits de pratique d’enseignantes et d’enseignants, et défis de formation», Éducation et Francophonie, n° 46, p. 92-108.
Barth, Britt-Maryi (1993), Le Savoir en construction, Paris, Retz.
Bednarz, Nadine, Jean-Luc Rinaudo & Éric Roditi, (2015), «La recherche collaborative», Carrefours de l’éducation, n° 39, p. 171-184. En ligne, URL : http://doi.org/10.3917/cdle.039.0171
Bronckart, Jean-Paul & Joaquim Dolz (2002), «La notion de compétence: quelle pertinence pour l’étude de l’apprentissage des actions langagières?» L’énigme de la compétence en éducation, p. 25-44. En ligne, URL : http://doi.org/10.3917/dbu.dolz.2002.01.0025
Chouinard, Isavelle & Jessie Caron (2015), «Le recours aux approches réflexives dans les métiers relationnels: modélisation des conceptions de la réflexivité», Phronesis, 4 (3), 11-21. Repéré à http://doi.org/10.7202/1035269ar
Daunay, Bertrand & Yves Reuter (2008), «La didactique du français: questions d’enjeux et de méthodes», Pratiques, n° 137-138, p. 57-78.
Dezutter, Olivier, Lynn Thomas & Colette Deaudelin (2011), «Les gestes soutenant la régulation des apprentissages en classe de français langue première et d’anglais langue seconde, quels éléments de stabilité et de variation?» in Les gestes de régulation des apprentissages dans la classe de français, J.-C. Chabanne (dir.), Bruxelles, De Boeck Supérieur, p. 63–81. En ligne, URL : http://doi.org/10.3917/dbu.chaba.2011.01.0063
Dolbec, André & Luc Prud’homme (2009), «La recherche-action», in Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données, B. Gauthier (dir.), Québecm Presses de l’Université du Québec, p. 531–549.
Dufays, Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture : Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang, 2e édition.
Eisenhart, Christophe & Barbara Johnstone (2012), «L’analyse du discours et les études rhétoriques», Argumentation et Analyse du discours, n° 9. En ligne, URL : http://journals.openedition.org/aad/1415
Gehin, Betty-Anne (2005), «Synthèse: cognition, communication et action: intrication du dire et du faire», Revue internationale de psychosociologie, n° XI (25), p. 245-262. En ligne, URL : https://doi.org/10.3917/rips.025.0245
Halté, Jean-François (1992), La Didactique du français, Paris, Presses universitaires de France.
Hébert, Anne (1980), Héloïse, Paris, Seuil.
Langlade, Gérard (2007), «La lecture subjective», Québec Français, n° 145, p.71-73.
Langlade, Gérard (2008), «Activité fictionnalisante du lecteur et dispositif de l’imaginaire», Figura, n° 20, p. 45-65.
Langlade, Gérard & Marie-José Fourtanier (2007), «La question du sujet lecteur en didactique de la lecture littéraire», in La didactique du français. Les voies actuelles de la recherche, É. Falardeau, C. Fisher, C. Simard & N. Sorin (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, p. 101-124.
Lecavalier, Jacques & Suzanne Richard (2010), Enseigner la littérature au secondaire et au collégial: une démarche stratégique, Montréal, Chenelière Éducation.
Lecavalier, Jacques & Suzanne Richard (2017), «Accompagner la compréhension en lecture littéraire», in Actes du colloque d’hiver de Beni Mellal «Les pratiques innovantes en classe de français», A. Azouine & A. Martah (dir.), Rabat, Association marocaine des enseignants de français, p. 35-76
Lecavalier, Jacques & Suzanne Richard (à paraitre), «Fouille d’un site à la recherche de sens ou travail collectif de compréhension et d’interprétation en classe de littérature et accompagnement didactique», in Chercher ensemble: approches didactiques, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Lenoir, Yves, François Larose, Colette Daudelin, Jean-Claude Kalubi & Gérard-Ryamond Roy (2002), «L’intervention éducative: clarifications conceptuelles et enjeux sociaux. Pour une reconceptualisation des pratiques d’intervention en enseignement et en formation à l’enseignement», Esprit critique, n°4 (4). En ligne, URL : http://www.espritcritique.org/0404/article06.html
Marcel, Jean-François, Paul Olry, Eliane Rothier-Bautzer & Michel Sonntag (2002), «Les pratiques comme objet d’analyse», Revue française de pédagogie, n° 138(2), p. 135-170. En ligne, URL : http://doi.org/10.3406/rfp.2002.2872
Mondada, Lorenza & Simona Pekarek Doehler (2000), «Interaction sociale et cognition située : quels modèles pour la recherche sur l’acquisition des langues ?», Acquisition et interaction en langue étrangère, n° 12. En ligne, URL : https://doi.org/10.4000/aile.947
Plane, Sylvie (2005), «Fiction, utopie et représentation du monde et de l’école dans des écrits sur le collège rédigés par des élèves en difficulté», Langage et Société, n° 1(111), p. 119-148. En ligne, URL : http://doi.org/10.3917/ls.111.0119
Pouliot, Suzanne (2005), «Les pratiques de lecture identifiées par les stagiaires en formation initiale», Nouveaux Cahiers de la recherche en éducation, n° 8(1), p.11-13. En ligne, URL : http://doi.org/10.7202/1018155ar
Roulet, Eddie (1991), «Structures hiérarchiques et polyphoniques du discours», in L’Articulation du discours en français contemporain, E. Roulet, A. Auchlin, J. Moeschler, C. Rubattel & M. Schelling (dir.), Berne, Peter Lang, 3e édition, p. 9-84.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (2004), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes & Paris, Presses universitaires de Rennes & de Boeck Supérieur.
Sacks, Harvey, Emmanuel A. Schegloff & Gail Jefferson (1974), «A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking in Conversation», Language, n° 50(4), p. 696-753. En ligne, URL : https://www.jstor.org/stable/412243
Tambone, Jeanette & Alain Mercier (2003), «L’articulation entre classe et groupe d’adaptation de l’aide à dominante pédagogique, en France, pose questions sur la notion de système didactique Aix-Marseille», in Éducation et enseignement spécialisés: ruptures et intégrations, G. Chatelanat (dir.), Paris, De Boeck Supérieur, p. 195-213. En ligne, URL : https://www.cairn.info/education-et-enseignement-specialises--9782804144050-page-195.htm
Tardif, Jacques (1992), Pour un enseignement stratégique. L’apport de la psychologie cognitive, Montréal, Les Éditions Logiques.
Thévenaz-Christen, Thérèse & Sandrine Aeby-Daghé (2014), «L’activité résumante dans la lecture de “La fée carabine” en classe de français: un point de vue sur le ressort des processus interactionnels didactiques», in Processus interactionnels et situations éducatives, L. Filliettaz & M.-L. Schubauer-Leoni (dir.), Paris, De Boeck Supérieur, p. 89-112. En ligne, URL : http://doi.org/10.3917/dbu.filli.2008.01.0089
Vincent, François & Pascale Lefrançois (2013), «L’opposition inductif/déductif en enseignement de la grammaire: un débat à nuancer», Revue des sciences de l’éducation, n° 39(3), p. 471-490. En ligne, URL : https://doi.org/10.7202/1026309ar
Pour citer l'article
Suzanne Richard & Jacques Lecavalier, "Circulation bidirectionnelle des savoirs : les interventions didactiques et pédagogiques en classe de littérature", Transpositio, n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/circulation-bidirectionnelle-des-savoirs-les-interventions-didactiques-et-pedagogiques-en-classe-de-litterature
Voir également :
Introduction n°3: quelles circulations entre recherches didactiques et pratiques enseignantes en littérature ?
Quels sont aujourd’hui les outils théoriques, les méthodes de recherche et les canaux de diffusion que mobilisent les chercheur.e.s{{Dans ce numéro, le choix de l’écriture inclusive ou non a été laissé libre aux aux auteur.e.s de chaque article.}} en littérature pour penser et nourrir le lien qui les unit à l’enseignement effectif de cet objet ? Pour rappel sont ici réunies certaines contributions des 19èmes Rencontres des chercheur.e.s en didactique de la littérature, tenues à la HEP-Vaud à Lausanne en juin 2018, qui avaient pour titre: Littérature(s) et langue(s) en classe: quelle circulation entre méthodologies de recherche et pratiques enseignantes?
Introduction n°3: quelles circulations entre recherches didactiques et pratiques enseignantes en littérature ?
[I]l ne suffit pas que les enseignants soient informés ni même convaincus de la pertinence des résultats produits pour qu’ils changent leurs pratiques.
Sylvie Cèbe & Roland Goigoux (2018)
Le constat d’un écart entre recherches et pratiques
C’est par cette citation –a priori peu réjouissante– que nous souhaitons commencer la présente introduction. Non pour entamer un propos défaitiste, mais au contraire pour interroger les pratiques de recherche à l’œuvre en didactique pour ce qui concerne leurs rapports aux pratiques enseignantes de la littérature. Quels sont aujourd’hui les outils théoriques, les méthodes de recherche et les canaux de diffusion que mobilisent les chercheur.e.s1 en littérature pour penser et nourrir le lien qui les unit à l’enseignement effectif de cet objet ? Pour rappel sont ici réunies certaines contributions des 19èmes Rencontres des chercheur.e.s en didactique de la littérature, tenues à la HEP-Vaud à Lausanne en juin 2018, qui avaient pour titre: Littérature(s) et langue(s) en classe: quelle circulation entre méthodologies de recherche et pratiques enseignantes? Le texte de cadrage de la manifestation rappelait les éditions 2000 et 2001, qui avaient vu l’émergence de débats fondateurs relatifs au statut, aux modalités et aux effets de la recherche en didactique de la littérature. On se souvient que ces questions avaient aussi fait l’objet un peu plus tard d’analyses stimulantes, notamment de la part de Bucheton (2005).
Si la didactique de la littérature a abordé cette question à plusieurs occasions déjà, il est nécessaire de la considérer à nouveaux frais, tant les recherches –en particulier en ergonomie du travail, comme Béguin (2013) ou Barcellini et alii (2013)– ont avancé sur le sujet et continuent de rendre compte de la difficulté pour la recherche à faire circuler ses résultats en dehors de sa propre sphère et, de surcroît, à faire intégrer ces mêmes résultats dans les pratiques ordinaires des professionnels du champ concerné. Ce sont là des points connus depuis longtemps des démarches d’accompagnement et de conceptions participatives de projets. Le constat a déjà été identifié aussi en didactique du français (Dufays, 2001; Reuter, 2007; Daunay & Dufays, 2007; Daunay & Reuteur, 2008; Cèbe & Goigoux, 2018). Il concerne autant l’éloignement entre chercheur.e.s et enseignant.e.s que l’absence d’adoption dans les pratiques enseignantes de nombre de dispositifs didactiques pourtant éprouvés. En somme, la transposition et l’intégration des résultats de recherche ne sont pas satisfaisantes. Cette observation est souvent partagée –et généralement regrettée. Mais il n’en reste pas moins vrai qu’interroger les formes de circulation entre les méthodologies de recherche en didactique de la littérature et les pratiques enseignantes peut signifier pour le champ «mettre le doigt où ça fait mal». Une part importante de l’organisation de l’activité des chercheur.e.s ainsi que la diffusion de leurs propositions en dehors de leur sphère se trouvent en effet interrogées... À se considérer autant comme activité théorique que comme pratique de médiation et d’implémentation de contenus et de dispositifs d’enseignement, la didactique de la littérature a tout intérêt à ouvrir et à approfondir le dialogue avec les travaux en analyse du travail, tout comme à les prendre sérieusement en considération afin de ne pas creuser l’écart qui la sépare trop souvent encore des acteurs de la littérature en classe.
De multiples tentatives de rapprochement
Divers facteurs peuvent expliquer cette malheureuse distance, parmi lesquels la culture persistante des modèles verticaux de recherche, dits applicationnistes, qui ont longtemps été hégémoniques. Depuis bientôt une trentaine d’années, les méthodologies de recherche sur l’activité professionnelle ont énormément évolué, en particulier en analyse du travail, notamment en médecine et en sciences de l’éducation. Les evidence-based research sont bien sûr légion aujourd’hui en didactique, mais plusieurs études, notamment Gentaz et alii (2013), se montrent très prudentes, voire critiques. «Une fois mises en place et évaluées en contexte ordinaire, ces méthodes ne produisent pas les effets positifs attendus» (Cèbe & Goigoux, 2018: 79). Depuis une quinzaine d’années, une orientation voisine est mobilisée en didactique du français (notamment Kervyn, 2011): la recherche-action qui, selon Savoie-Zajc (2001), renvoie à une approche de changement planifié dans le but de résoudre un problème que rencontre une communauté. Enfin, l’offre s’est encore étoffée avec la recherche dite collaborative (Design-Based-Research-Collective, 2003), qui renvoie essentiellement à une démarche d’exploration d’un objet et qui conduit à la coconstruction de savoirs autour d’une problématique professionnelle donnée (Desgagné, 1997).
Bien que les recherches théoriques et descriptives soient encore dominantes en didactique du français (Dufays & Brunel, 2016), des projets (comme Gagnon & Laurens, 2016 ou Sénéchal, 2018), ainsi que de nombreux colloques et numéros de revue se proposent désormais de repenser les relations entre recherche et pratiques à l’aune de ce paradigme2, dont le présent numéro, centré sur des recherches en didactique de la littérature. L’interrogation porte sur la capacité du champ à infléchir significativement (durablement et globalement) les pratiques enseignantes et, partant, les apprentissages des élèves. Comme les tentatives de rapprochement entre recherches et pratiques se multiplient, il est important de donner à voir dans quelle mesure la didactique de la littérature manifeste elle aussi le souci de faire intégrer par les praticien.ne.s sur le long terme ses résultats et ses dispositifs. Concrètement, quel positionnement adopter pour les didacticien.ne.s de plus en plus situé.e.s à l’interface entre la recherche et les exigences des acteurs et actrices du terrain? Entre chercheur.e.s, formateurs et formatrices, enseignant.e.s ou médiateurs et médiatrices, quelle répartition des rôles concevoir dans un tel contexte de reconfiguration de certains rôles? La réflexion proposée ici et dans le numéro de Transpositio précédent (dirigé par Chiara Bemporad & Sonya Florey) rend compte d’une forte diversité des formats et il convient d’annoncer que l’objet «Littérature» pourra parfois paraître neutralisé par l’orientation méthodologique fortement marquée de ces deux livraisons.
Recherches ou… formations?
Le terme aujourd’hui en vogue de «recherche collaborative» (récemment Vinatier & Morrissette, 2015 ou Bednarz 2013 & 2015) masque –peut-être excessivement– des mises en œuvre hétérogènes. C’est à cette diversité que le présent numéro s’intéresse. Le fait de réunir ici des recherches dont le rapport au terrain constitue un enjeu fort sinon central permet de présenter et de décrire une ébauche de panorama des modalités actuelles que peut adopter la circulation entre pratiques enseignantes et recherches en didactique de la littérature.
Si l’on prend un peu de recul relativement à la désignation «recherche collaborative», il apparaît qu’il n’a pas fallu attendre l’émergence du terme pour que la recherche en didactique de la littérature s’interroge sur les modalités de son rapport au terrain. Comme rappelé supra, la thématique n’est pas investiguée ici pour la première fois, mais elle semble prendre une tournure qui paraît déjà significative dans la mesure où les modèles verticaux de la recherche, exclusivement «top-down», sont de moins en moins légitimes, faute d’intégration ou de transfert vers le terrain. Dans le prolongement, l’équilibre et la répartition des rôles entre enseignant.e.s et chercheur.e.s, longtemps bien délimités (on pense par exemple aux figures du «chercheur savant» et de «l’enseignant artisan»), perdent de leur stabilité. L’accent est mis sur une prise en compte mutuelle des expertises respectives (scientifique d’une part, expérientielle d’autre part). Toute l’idéologie du «didacticien éclairé» se trouve ébranlée.
Une multitude de tentatives de rapprochement se font ainsi jour, laissant place à un moment particulièrement heuristique de la recherche sur le plan méthodologique. C’est aussi le cas pour ce que Class & Schneider ont nommé en 2013 «recherche design». Dans un entretien, Boutin en parle récemment aussi, en ces termes:
La recherche design est une perspective méthodologique récente. Proche de la recherche collaborative, de la recherche développement et de la recherche action, elle réunit des chercheurs, des formateurs, des praticiens autour d’un problème rencontré par des enseignants. A grands traits, la démarche consiste à créer collectivement un dispositif d’enseignement, de le dessiner, de l’éprouver «sur le terrain», puis de revenir, après la mise à l’essai, et de débriefer pour voir ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré, en tenant compte bien sûr des résultats de la recherche et des théories scientifiques qui concernent la question. (Boutin, 2019)
Dans cette autre configuration, un principe s’impose: associer les enseignant.e.s à la démarche de conception. Le processus de validation de la recherche est alors interne à la recherche elle-même. Cela n’est pas sans conséquence: «Dans le modèle de partenariat qui en découle, les chercheurs doivent faire l’effort de connaitre les réalités de la pratique, les praticiens d’identifier la rigueur et les exigences de la recherche. Les problèmes rencontrés sont, en effet, à résoudre ensemble» (Cèbe & Goigoux, 2018: 92). Pour que cette «action conjointe» porte ses fruits, sont primordiales la prise en compte des contextes concrets d’enseignement et celle des habitus professionnels des enseignant.e.s concerné.e.s.
Les chercheur.e.s sont donc face à un défi de taille: il faut à la fois paramétrer ses propositions relativement à des pratiques ordinaires documentées… et les dépasser. Le jeu d’équilibre consiste d’une part à déboucher sur des propositions suffisamment proches des pratiques ordinaires pour être intégrées sans coûts excessifs dans le quotidien d’un enseignement et d’autre part à ouvrir à une certaine nouveauté qui puisse donner le goût d’infléchir dans le long terme et in fine sans soutien externe certaines habitudes vers une direction encore inexplorée. En somme les propositions didactiques ne devraient être ni trop proches ni trop éloignées de ce qu’on pourrait nommer, après d’autres, la zone proximale de développement professionnel des enseignant.e.s.
Il faut en outre accepter les contraintes qu’impose la logique collective à la constitution progressive de la recherche. D’une part un work in progress potentiellement infini, une conception continuée et modifiée dans l’usage, une théorisation a posteriori du modèle ou des risques d’essoufflement voire d’abandon… D’autre part, un calendrier souvent long, rythmé par des phases d’accompagnement, d’expérimentation, d’amélioration, d’adaptation, de modifications, de communications diverses...
Dans les recherches proposées ici, les modalités de dialogue avec les enseignant.e.s prennent différentes formes (linéaire, alternée, cyclique, itérative…) et il est passionnant d’entrer dans le détail de chacune de ces collaborations pour apprécier les avantages ou au contraire les inconvénients, voire les difficultés rencontrées autant sur le plan logistique que didactique, du côté des enseignant.e.s et/ou de celui des chercheur.e.s. Parfois la recherche semble se rapprocher de dispositifs de formation. Selon Cèbe & Goigoux (2018) à nouveau,
La formation apparait comme un facteur décisif dans la capacité des enseignants à s’approprier un outil et à s’impliquer dans un dispositif […]. Les formations ponctuelles n’entrain[e]nt généralement pas de changement durable dans la pratique ou l’adoption d’une innovation […]. Le plus souvent cependant, la formation ne suffit pas à transformer les pratiques de manière durable, c’est pourquoi un accompagnement prolongé et régulier est préconisé.
Nous voilà informé.e.s… Un pan de la réflexion méthodologique devrait inévitablement concerner le suivi prolongé des propositions élaborées. Se présente une grande diversité de formats (formations négociée, continue, communautés de pratiques…). Évidemment le «cahier de charges» d’un.e chercheur.e est ici vite dépassé et il convient d’interroger aussi les limites du travail des didacticien.ne.s et d’identifier les modalités possibles d’accompagnement des enseignant.e.s dans leur rencontre et leur usage des dispositifs didactiques.
Une diversité d’acteurs dans la chaine de circulation des savoirs didactiques
Les chercheur.e.s en didactique de la littérature sont généralement en lien (à des degrés divers) avec une diversité d’acteurs (étudiant.e.s en formation, enseignant.e.s, inspecteurs et inspectrices, conseillers et conseillères pédagogiques, praticiens-formateurs et praticiennes-formatrices, concepteur.e.s de manuels…) qui rencontrent certaines de leurs propositions. C’est là une bonne nouvelle. En revanche, très rares sont les didacticien.ne.s qui parviennent à élargir leur sphère d’influence pour concevoir des manuels, modifier des programmes, des plans d’études… ou certaines décisions politiques en éducation. Bien sûr la question varie grandement selon les contextes (institutionnels, régionaux, nationaux). Il n’en demeure pas moins vrai qu’au-delà de la formation (initiale ou continue), les didacticien.ne.s n’ont guère de prise «directe» sur le développement professionnel des enseignant.e.s (à considérer que cette prise soit adéquate…).
Dans la chaine d’acteurs et d’actrices qui traitent des savoirs didactiques, les didacticien.ne.s forment un maillon qui doit se préoccuper des retombées et des limites de leurs recherches. La collaboration avec les enseignant.e.s devrait assurer un débouché win-win... Se posent, partant, des questions très concrètes: Comment solliciter les enseignant.e.s pour leur donner confiance et envie de coconstruire un projet? À quels moments de la recherche, à quelle fréquence et dans quels buts? Quelles formes d’interactions privilégier? Quelles sont les portes ouvertes à l’innovation durant ces négociations (Thurler, 2000)? Quels enjeux expliciter ou désamorcer lors des rencontres? Quelle répartition de rôles organiser? Comment décristalliser certaines représentations enseignantes et didactiques? Quel support pour capitaliser les échanges? Qui rédige quoi? Comment visibiliser le projet? Comment équilibrer les objectifs de recherche et ceux de formation? Quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs? (Morrissette, 2013)? Quels outils didactiques retenir et pourquoi? À quel objet ou produit finalement aboutir? Quels formats celui-ci doit-il prendre?… C’est à ces interrogations que les contributions réunies ici se proposent moins de répondre que de donner des exemples concrets de réalisation, toujours guidés par des principes méthodologiques explicites qui entrent en dialogue dans l’entier de ce numéro.
Malgré le peu de recul sur le sujet, on a pourtant déjà l’impression d’assister et de participer à un moment autocritique de la recherche didactique pour ce qui concerne son rapport au «terrain». La présente livraison propose ainsi une sorte d’ethnographie des pratiques actuelles de la recherche en didactique de la littérature pour ce qui concerne leur lien avec les pratiques enseignantes. Une promesse déjà: d’intéressants changement de postures professionnelles se font jour… autant chez les enseignant.e.s que chez les didacticien.ne.s!
Les contributions réunies dans le présent numéro
Comme s’ils s’étaient donné le mot, les auteur.e.s des cinq articles de ce numéro se penchent ainsi tou.te.s sur la recherche de type collaboratif comme théâtre de la circulation des savoirs entre chercheur.e.s et enseignant.e.s, l’éclairant chacun.e d’un point-de-vue différent. Travaillant sur des projets qui impliquent des enseignant.e.s en didactique de la littérature en français L1 au degré secondaire, certains sont de jeunes chercheur.e.s, d’autres des chercheur.e.s confirmé.e.s.
Sylviane Ahr et Isabelle De Peretti se proposent de détecter les atouts et les limites que la recherche collaborative peut avoir aux yeux des praticien.ne.s. À cette fin, elles laissent la parole aux enseignant.e.s qui ont participé aux côtés de chercheur.e.s à deux projets portant sur les pratiques effectives de la lecture analytique dans le secondaire, à savoir une recherche formation collaborative réalisée au sein de l’académie de Versailles (2015-2018) et une recherche collaborative menée à Lille (2015-2017). Dans leurs témoignages, les deux groupes d’enseignant.e.s soulignent de quelle manière ils ont changé de posture au cours des recherches, actualisé leur savoirs et modifié leur pratique quotidienne. À l’issue de l’analyse des données recueillies auprès des enseignant.e.s, Ahr et De Peretti insistent sur la complexité des recherches collaboratives lorsque le développement professionnel des praticien.ne.s s’inscrit parmi leurs objectifs. De fait, recherche et formation se déployant dans deux temporalités différentes, il convient alors d’élaborer une double planification et une double structuration.
Cinq ans après une recherche de type collaboratif qui a réuni de 2009 à 2013 dix enseignant.e.s formateurs et formatrices de collège et de lycée d’établissements de types variés dans l’académie de Versailles autour de démarches didactiques de lecture littéraire, Cécile Couteaux propose d’en tirer le bilan relatif à la manière dont les participant.e.s ont vécu cette collaboration, et ce sur la base de questions ciblées et des articles rédigés par l’enseignante-chercheure responsable du projet de la recherche. L’analyse des réponses qu’elle a reçues lui permet d’aboutir à la conclusion suivante: amenés à coconstruire les savoirs professionnels à l’aide de leur propre pratique et des moyens théoriques et méthodologiques offerts par la recherche collaborative, les enseignant.e.s sont entrés dans des analyses réflexives et ont modifié leurs pratiques enseignantes et leur rapport à la recherche.
Florent Biao, Érick Falardeau et Marie-Andrée Lord appuient leur contribution sur une recherche doctorale portant sur l’articulation grammaire-texte en classe de français au Québec et en Suisse romande et s’intéressent précisément à la question de savoir comment s’opérationnalise une recherche qui vise à faire collaborer deux logiques d’agir et de penser, à savoir celle de la recherche et celle du terrain. Comme ils le constatent dans leur conclusion, leur démarche d’ingénierie didactique à double perspective – les séquences abordant des problématiques au cœur de la pratique enseignante ont été testées une première fois par les enseignant.e.s qui les ont coconstruites, puis une seconde fois par d’autres enseignant.e.s – leur a permis d’atteindre plusieurs buts : le/la chercheur.e est moins perçu.e comme le savant détenteur/la savante détentrice de vérité par les enseignant.e.s, qui sont davantage investi.e.s dans tout le processus, le développement professionnel des enseignant.e.s est favorisé, tout comme l’enrichissement de l’expertise des chercheur.e.s, et cela grâce aux apports des réalités du terrain.
C’est également un projet international qui se trouve à la source de l’article d’Isabelle Brun-Lacour et Jean-Louis Dufays, à savoir le projet «Gary», qui a déjà donné lieu à de nombreuses publications. Cette recherche s’interroge sur l’évolution tant des compétences de lecture des élèves que des pratiques enseignantes et sur les relations réciproques entre ces deux pôles à trois stades du curriculum et dans un milieu socio-économique moyen, en Belgique, France, Québec et Suisse. Dans le présent article, les auteurs analysent les réponses que les enseignant.e.s impliqué·e·s ont données aux questions suivantes: Quels sont les objectifs et finalités de leur pratique et quel est leur rapport au savoir? L’expérience a-t-elle favorisé une meilleure circulation des savoirs entre chercheur.e.s et enseignant.e.s? Comment optimiser cette circulation? Et de constater que les enseignant.e.s qui ont participé à la recherche collaborative sont entré.e.s dans une dynamique de questionnement, de recherche et de changement.
Après avoir formé une trentaine d’enseignant.e.s à la DSEL (Démarche stratégique d’enseignement de la littérature) développée dans le cadre d’une recherche collaborative entre 2006 et 2010 au Québec, Suzanne Richard et Jacques Lecavalier ont rassemblé dans un corpus les interventions par lesquelles deux enseignantes ont accompagné leurs élèves lors d’une lecture en classe de littérature. Définissant et distinguant dans un premier temps l’intervention didactique et l’intervention pédagogique, les auteurs illustrent ensuite leurs propos théoriques à l’aide d’un exemple précis où ils analysent les interventions de l’enseignante et les classent dans l’une ou l’autre catégorie. Ils soulignent en guise de conclusion que même si le matériau sur lequel ils s’appuient est sans doute insuffisant, leur recherche aboutit à l’esquisse d’un modèle complexe laissant entrevoir une circulation multidirectionnelle entre recherche et terrain.
Comme on peut le constater, les cinq articles de ce numéro insistent sur les modifications que la recherche de type collaboratif induit sur les postures et pratiques des enseignant.e.s associé.e.s, même si, comme le soulignent Richard et Lecavalier, « le développement des enseignants est une retombée, mais pas un objectif de la recherche », en renvoyant à Bednarz, Rinaudo & Roditi (2015 : 171). Plusieurs chercheur.e.s, notamment Biao et alii et Couteaux, démarquent par ailleurs explicitement les dispositifs de recherche collaborative qu’ils analysent des recherches-actions, «qui entretenai[en]t des objectifs de changement social ou éducatif» (Richard & Lecavalier). Si les acteurs et actrices du terrain sortent changé.e.s de ces expériences, il en va de même des chercheur.e.s. Et dans cette circulation des savoirs, insiste entre autres Couteaux, un rôle-clé revient au(x) responsable(s) du projet. Il s’ensuit, pour le dire avec les mots de Biao et alii, qu’«il y aurait donc une nécessité à creuser cette avenue en donnant plus de place aux praticiens que sont les enseignants dans nos recherches si nous voulons que celles-ci atteignent leur finalité».
Bibliographie
Barcellini Barcellini, Flore, Van Belleghem, Laurent & Daniellou, François (2013), «Les projets de conception comme opportunité de développement des activités», Dans P. Falzon (Ed.) Ergonomie constructive (p. 191-206). Paris, PUF.
Bednarz, Nadine (2013, éd.), Recherche collaborative et pratique enseignante: regarder ensemble autrement, Paris, L’Harmattan.
Bednarz, Nadine, Rinaudo, Jean-Luc. & Roditi, Éric (2015), «La recherche collaborative», Carrefours de l’éducation, 39, p.171-184. Repéré à http://doi.org/10.3917/cdle.039.0171
Béguin, Pascal (2013), «La conception des instruments comme processus dialogique d’apprentissages mutuels», Dans: P. Falzon (Ed.). Ergonomie constructive (p. 147-160). Paris, PUF.
Bucheton, Dominique (2005), «Au carrefour des métiers d’enseignant, de formateur, de chercheur», Dans: J.-L. Chiss, J. David & Y. Reuter (dir.). Didactique du français. Fondements d’une discipline (p. 193-210), Bruxelles, de Boeck.
Boutin Jeau-François (2019), Entretien. Voie Livres. Repéré à https://www.voielivres.ch/2450-2/
Cèbe, Sylvie & Goigoux, Roland (2018), «Lutter contre les inégalités: outiller pour former les enseignants», Recherche & formation, 87, p.77-96.
Class, Barbara & Schneider, Daniel (2013), «La Recherche Design en Éducation: vers une nouvelle approche ?» Frantice.net, 7, p.5-16.
Daunay, Bertrand & Dufays, Jean-Louis (2007), «Méthodes de recherche en didactique de la littérature», La Lettre de l'AIRDF, 40, p.8-13. Répéré à https://doi.org/10.3406/airdf.2007.1730
Daunay, Bertrand & Reuter, Yves (2008), «La didactique du français: questions d’enjeux et de méthodes», Pratiques, 137-138, p.57-78.
Desgagné, Serge (1997), «Le concept de recherche collaborative: l’idée d’un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants», Revue des sciences de l’éducation, 23, p.371-393.
Design-Based-Research-Collective (2003), «Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry», Educational researcher, 32, p.5-8.
Dufays, Jean-Louis. (2001), «Quelle(s) méthodologie(s) pour les recherches en didactique de la littérature ? Esquisse de typologie et réflexions exploratoires», Enjeux, 51-52, p.7-29.
Dufays, Jean-Louis & Brunel, Magali (2016), «La didactique de la lecture et de la littérature à l’aube du XXIe siècle. État des recherches en cours et focus sur la perspective curriculaire», Dans: A. Petitjean (dir.). Didactiques du français et de la littérature (p. 233-266), CREM, Université de Lorraine.
Gagnon, Roxane & Laurens, Véronique (2016), «Circulation de savoirs entre institution de formation et terrains scolaires: analyse de dispositifs de formation à l’enseignement de la production écrite en Suisse romande», Phronesis, 5 (3-4), p.69-86.
Gentaz, Edouard, Sprenger-Charolles, Liliane, Colé, Pascale, Theurel, Anne & Gurgan, Marc (2013), «Évaluation quantitative d’un entrainement à la lecture à grande échelle pour des enfants de CP scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire: apports et limites», Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant,123, p-172-181.
Kervyn, Bernadette (2011), «Caractéristiques et pertinence de la recherche-action en didactique du français», Dans: B. Daunay & B. Schneuwly (dir.) Les concepts et les méthodes en didactique du français (p. 194-224). Namur, Presses Universitaires de Namur.
Morrissette, Joëlle (2013), «Recherche-action et recherche collaborative: quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs?» Nouvelles pratiques sociales, 25, p.35-49.
Reuter, Yves (2007), «Les méthodes de recherche en didactique du français», La Lettre de l’AIRDF, 40, p.3-5.
Savoie-Zajc, Lorraine (2001), «La recherche-action en éducation: ses cadres épistémologiques, sa pertinence, ses limites», Dans M. Anadon & M. L’Hostie (dir.). Nouvelles dynamiques de recherche en éducation, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, p.15-49.
Sénéchal, Kathleen (2018), «Impacts d’une collaboration avec des enseignants sur l’élaboration et la validation du produit d’une ingénierie didactique», Recherches qualitatives, 37 (2), p.128-149.
Thurler, Moniac Gather (2000), «L’innovation négociée: une porte étroite», Revue française de pédagogie, 130, p.29-42.
Vinatier, Isabelle & Morrissette, Joëlle (2015), «Les recherches collaboratives : enjeux et perspectives», Carrefours de l’éducation, 39, p.137-170.
Pour citer l'article
Vincent Capt & Antje Kolde, "Introduction n°3: quelles circulations entre recherches didactiques et pratiques enseignantes en littérature ?", Transpositio, n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-3-quelles-circulations-entre-recherches-didactiques-et-pratiques-enseignantes-en-litterature
Voir également :
Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020
Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle{{Voir par exemple: Gustave Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément – D’après l’édition de 1851, éditions 2024, 2013; Gustave Doré, Les Travaux d’Hercule, éditions 2024, 2018; George Herriman, Intégrale Krazy Kat, tome 1 (1925-1934), tome 2 (1935-1944), 2018, éd. Les Rêveurs}}, constituent des marqueurs élitaires forts.
Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020
1. Introduction
Depuis les années 2010, la bande dessinée connaît des mutations sociales et culturelles sans précédents. En 2017, au regard d’une légitimité devenue incontestable dans les médias, dans les musées et sur le marché de l’art, la revue Le Débat titre sur «le sacre» du médium. Dix ans après la publication de son ouvrage Un objet culturel non identifié (2006), Thierry Groensteen fait le compte des handicaps symboliques et institutionnels qui ont été levés et constate la percée de la bande dessinée dans le champ universitaire (2016). L’apparition de nouveaux genres comme l’autobiographie, la BD-reportage, l’essai scientifique, le succès de nouveaux formats éditoriaux comme le roman graphique, ainsi que la publication d’œuvres méconnues du patrimoine du XIXe et du premier XXe siècle1, constituent des marqueurs élitaires forts. Le passage au numérique, qui s’est accéléré à partir de 2009-2010 (Baudry 2012), a généré une interactivité nouvelle à travers les blogs BD, tandis que le turbomédia2 transforme les contours sémiotiques d’un mode d’expression qui se réinvente avec une plasticité et des propositions multimodales inédites (Robert 2016).
L’ensemble de ces transformations a conduit la recherche sur la bande dessinée à réinterroger ses catégories et ses paradigmes d’analyse. Je souhaiterais ainsi revenir sur trois tournants théoriques importants survenus dans la décennie 2010-2020. Le premier concerne un changement de conception dans la sociologie des champs culturels, avec le passage d’une théorie de la légitimation à celle d’une culture post-légitime de la BD. Le second tournant concerne la sémiologie et l’histoire du médium, à travers le passage d’une théorie de la BD comme littérature séquentielle à la conception élargie d’une généalogie polygraphique du médium. Enfin le troisième tournant concerne la réflexion pédagogique et didactique sur la bande dessinée. La légitimation culturelle de la bande dessinée, ainsi que son intégration scolaire ne se sont pas accompagnées d’une théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe. Après avoir assigné à la BD, dans les années 1970 et 1980, un rôle de démocratisation de la lecture, voire un rôle de remédiation aux difficultés pour lire et écrire (sans véritablement questionner ce présupposé), on s’est ponctuellement avisé des difficultés spécifiques et des malentendus sociocognitifs qui pouvaient accompagner son étude. Au début des années 2010, la réflexion s’est surtout développée dans une perspective programmatique et ingéniérique, alors que manquait encore une description précise et compréhensive des pratiques effectives. Dans les situations ordinaires de classe, quelles finalités chaque discipline scolaire assigne-t-elle au médium? Comment ce dernier est-il reconfiguré comme objet disciplinaire? Ce chaînon manquant d’une didactique descriptive semble désormais en passe de se combler pour la discipline du français. Or cette évolution intervient au moment même où les tournants théoriques dans la compréhension culturelle, sémiotique et historique de l’objet BD pourraient bien rebattre les cartes.
2. Du paradigme de la légitimation au paradigme de la culture post-légitime
L’histoire de la reconnaissance socio-culturelle et socio-institutionnelle de la bande dessinée a été en premier lieu décrite et analysée par les spécialistes comme un processus de légitimation prenant naissance dans les années 1960. En 1975, dans un article intitulé «La Constitution du champ de la bande dessinée», le sociologue Luc Boltanski décrit un phénomène d’autonomisation, «sur le modèle des champs de la culture savante», selon un processus à quatre niveaux: changement dans les caractéristiques des producteurs, conquête d’un nouveau public, apparition d’un nouveau rapport avec les œuvres débouchant sur des instances de médiation et de célébration, enfin double polarisation entre grande production et production restreinte, conservateurs et novateurs. Les faits semblent donner raison à cette théorie classique de la légitimité culturelle d’inspiration bourdieusienne (1979; 1992), qui voit la création d’un centre d’intérêt commun se transformer en champ, à travers un transfert de légitimité et d’habitus académique par les producteurs majeurs et les intellectuels. Les grandes étapes en ont été largement décrites pour la sphère francophone (Groensteen 2006; Ory et al. 2012; Heinich 2017; Raux 2019): créations en 1962 d’un club de collectionneurs, d’une revue spécialisée, ainsi que d’un «Centre d’étude des littératures graphiques» animé par le journaliste Francis Lacassin, le cinéaste Alain Resnais et la sociologue Evelyne Sullerot; classification de la BD comme neuvième art en 1964 par le critique de cinéma Claude Beylie; première anthologie des Chefs d’œuvre de la bande dessinée et première exposition au musée des arts décoratifs en 1967; apparition d’une génération d’avant-garde (souvent issue du journal Pilote) revendiquant des ambitions artistiques, et création d’une édition indépendante (L’Echo des savanes en 1972, Futuropolis en 1974, Métal Hurlant en 1975); création en 1974 du salon d’Angoulême et de la collection «les maîtres de la bande dessinée» chez Hachette; apparition en 1978 du Mensuel A suivre, ambitionnant de faire concurrence à la littérature à travers de grands romans graphiques en noir et blanc. Durant la décennie 1970, la bande dessinée francophone européenne se recompose ainsi complètement dans ses styles, ses genres, ses supports, ses formats et ses publics. Elle ne s’adresse plus exclusivement à la jeunesse et s’affranchit progressivement de la presse pour devenir un phénomène de librairie à destination d’un public de connaisseurs plus adultes. La polarisation du champ analysée par Boltanski semble se vérifier avec l’apparition d’un «modèle de lecture savante et distanciée» (Lesage 2019): l’année 1984 en marque sans doute la date symbolique avec la création des Cahiers de la bande dessinée (sur le modèle des Cahiers du cinéma) et celle de l’ACBD, l’association des critiques de bandes dessinées, regroupant journalistes et essayistes spécialisés. Différentes enquêtes sur les pratiques culturelles des français (BPI & DEPS 20113) mettent non seulement en évidence le fait que les lecteurs de BD sont aussi des lecteurs de littérature en général, mais associent également cette pratique au capital culturel des classes moyennes et supérieures (Evans 2015; Maigret 2015). La dernière étape du processus de légitimation est l’entrée dans les musées (l’exposition d’Hugo Pratt au Grand Palais en 1986 ouvrant la voie à la multiplication des expositions dans les années 2000 et 2010), l’intégration de la BD par l’art contemporain (FIAC 2009) et la cotation sans cesse à la hausse des auteurs de référence sur le marché de l’art. Pour Nathalie Heinich (2017), il ne s’agit plus d’une simple ascension linéaire dans la hiérarchie des genres, mais d’un changement profond, qu’elle nomme «artification».
Ce paradigme interprétatif d’un processus continu de légitimation a pu être nuancé et complété. Harry Morgan (2003; 2012) a montré comment une première théorie du médium s’est en réalité construite en négatif dans les discours de réaction, dès le début du XXe siècle, et situe dans le courant des années 1950 les toutes premières analyses légitimantes en ce qui concerne la France. Matteo Stefanelli, dans son archéologie internationale des discours sur la BD (2012), rappelle que le médium devient un objet de discours intellectuel et scientifique dès les années 1920 aux États-Unis et que la sédimentation s’est interrompue dans les années 1950 à cause de la psychiatrisation des discours de réaction.
Cependant ce paradigme bourdieusien de la légitimation fait désormais l’objet de critiques de la part des historiens et des sociologues, en ce qu’il constitue un cadre limité voire contre-productif pour appréhender le phénomène social et culturel de la bande dessinée. Éric Maigret et Matteo Stefanelli (2012) constatent qu’il a engendré une critique «légitimiste» qui s’est enferrée dans un discours essentialiste, excessivement sémio-centré, sur la BD «en soi» et ses caractéristiques. Ce sont les débats sur son statut «séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), son appartenance à la littérature (Morgan 2003), sa multimodalité (Frezza 1999; Boutin 2012), ou les discours sur son «ontologie visuelle» (Lefèvre 2007). Éric Maigret constate de surcroît que cette quête d’un langage BD s’est doublée de la recherche historique d’un point de départ originel (Töpffer chez Thierry Groensteen et chez Benoît Peeters), pour définir et légitimer «un quasi-invariant» sémiotique (2012: 7).
Une seconde critique porte sur les effets d’exclusion de la critique «légitimiste». Nathalie Heinich (2017) note que la reconnaissance pleine et entière de la BD au titre d’art est ralentie voire bloquée par deux facteurs: le maintien d’un large secteur destiné à la jeunesse et d’autre part un mode de production et de diffusion industriel. Chaque étape de la consécration d’une certaine bande dessinée adulte novatrice s’accompagne alors de la reconduction de discours de dévalorisation à l’égard de productions émanant du pôle opposé du marché éditorial, celui de l’industrie culturelle. Éric Maigret invite à ne jamais sous-estimer cette «stratégie de minoration» (Maigret 2012b: 143), la plus spectaculaire ayant été les discours de condamnation des mangas durant les années 1990, dans des polémiques, note Sylvain Lesage, «qui ne sont pas sans rappeler celles des années 1940» sur l’encadrement des lectures pour la jeunesse (2018: 20). A l’autre bout de l’échelle, la valorisation éditoriale du «roman graphique» procède elle aussi d’une pure logique de distinction, afin de considérer inversement une certaine bande dessinée comme de la littérature à part entière (Groensteen 2012: 12). Pour l’historien Sylvain Lesage, ces mécanismes de sélection et de distinction de la critique ont conduit à fabriquer un canon qui finit par déformer la connaissance historique du neuvième art, en déniant l’intérêt de certaines productions: par exemple les publications «trop communistes» comme Vaillant, ou «trop populaires» comme Le Journal de Mickey, ou les «petits formats» type Comics pocket (2018: 14).
Plusieurs auteurs montrent du reste que la réalité du champ contredit en partie cette vision classique d’un processus linéaire de légitimation, où la BD serait appelée au sein de la hiérarchie des arts, à rejoindre les champs dominants. Thierry Groensteen (2006; 2017), pointe des déficiences persistantes en médiation, qu’elles soient institutionnelles ou culturelles, en particulier dans le domaine scolaire. Jean-Matthieu Méon (2015) montre que la légitimation médiatique de la BD consiste encore à la défendre pour ce qu’elle n’est pas, en lui prêtant les qualités de la littérature, du cinéma ou de la peinture, c’est à dire en important les critères de domaines artistiques plus légitimes. Eric Maigret pointe les «retours de bâtons» violents dont elle fait l’objet de la part de fractions culturelles qui se sentent menacées par la montée d’un nouveau régime multiculturel. Il montre aussi comment la réalité contredit les hiérarchisations au sein du champ: des chefs de file de l’avant-garde, à l’instar d’Art Spiegelman, sapent délibérément les effets d’hermétisme du schéma distinctif classique et revendiquent l’héritage de la bande dessinée populaire; réciproquement des séries jeunesse grand public (Astérix, Titeuf, Le Petit Spirou) subvertissent certains discours idéologiques, que ces derniers portent sur l’enfance, l’identité nationale ou le choc des civilisations.
Le sociologue propose ainsi de revisiter l’histoire socio-culturelle et socio institutionnelle de la BD à l’aune d’un second paradigme, celui de la post-légitimité, pensé sur le mode des théories postcoloniales. Pour lui l’émancipation des nouveaux arts ne peut être qu’en «demi-teinte», dans un monde ou l’enjeu de légitimité culturelle est moins central. Car les sociétés occidentales contemporaines ne croient plus entièrement au mythe moderniste du XIXe siècle fondé sur le grand partage entre «Haute Culture» et «culture de masse». Le nouveau régime multiculturel ne signifie pas pour autant un abandon de la hiérarchisation, mais «sa translation progressive vers une distinction intra-genre […] reposant sur une pluralité des ordres culturels» (Maigret 2012b: 140). Il prône ainsi un «travail de défense des multiples cultures» qui composent la culture de la BD, «notamment celles qu’on labellise comme "populaires", "juvéniles", "féminines", voire "étrangères", en distinguant non plus seulement des valeurs, mais des mondes et des échelles.» (Maigret 2012b: 146-147)
Une seconde recommandation de Maigret, qui s’adresse aux comics studies, est de cesser de «réclamer l’instauration d’un champ autonome, sur le mode dur, dix-neuviémiste», mais d’accepter au contraire «l’incomplétude, l’impossibilité de se délimiter, d’être un Art, c’est-à-dire une entité quasi-métaphysique» (2012b: 146). Car une conséquence paradoxale du nouveau régime multiculturel est que si la reconnaissance des ex-cultures populaires se généralise, elle ne peut advenir que partiellement, en l’absence d’une clé de voûte unique à la légitimation. Si le champ de la BD doit faire le deuil d’une complète légitimité, il y gagne en retour une transitivité nouvelle pour être pensé comme processus vivant de l’échange culturel. Éric Maigret prend ainsi acte du passage à la BD numérique, de la culture participative qu’elle entraîne, brouillant les frontières de la création et de la réception, ainsi que du décloisonnement des activités artistiques qui touche tous les ensembles historiquement constitués. De même Matteo Stefanelli considère la marginalité de la BD comme une ressource stratégique pour son développement en tant que «cas paradigmatique de la culture de la participation» (2012: 256). La finalité dernière du champ, dans le paradigme d’une culture post-légitime, c’est-à-dire ayant dépassé le stade premier du différentialisme, étant de «permettre à un nombre toujours croissant d’individus, de vivre mieux et de s’accepter» (Maigret 2012b: 147).
Le paradigme de la post-légitimité place ainsi au centre des considérations la plasticité culturelle de la BD, plutôt que sa plastique propre et son rapport aux arts légitimes. Ce déplacement théorique, qui est intervenu dans le courant des années 2010, s’est accompagné d’une autre modification d’importance dans la compréhension de sa nature médiatique. Afin d’en cerner toute la portée, il convient de retracer les différentes approches des liens entre BD et littérature.
3. La BD, une littérature dessinée? De la paralittérature à la culture polygraphique
Les travaux théoriques qui envisagent les relations de la bande dessinée et de la littérature peuvent être résumés autour de quatre orientations principales.
La première est de considérer la BD comme une production littéraire de masse. C’est dans ce cadre qu’elle est abordée en 1967 dans le colloque de Cerisy dirigé par Noël Arnaud, ou encore en 1992 dans l’ouvrage de Daniel Couégnas sur la paralittérature. Selon cette catégorisation, la BD serait le vecteur de formes textuelles dégradées ainsi que d’un imaginaire moins domestiqué. La classification comme «littérature populaire» accrédite l’idée d’une hiérarchisation entre une lecture «dominante» distanciée, celle du public cultivé, et une lecture «dominée», celle du grand public, conçue comme un délassement sans recul critique. Elle ne prend pas en compte la bande dessinée élitaire de production restreinte ni ne permet de s’intéresser au fonctionnement spécifique du média considéré. Pour sortir de cette impasse, les recherches sur la littérature de grande diffusion4, dans les années 1990, ont repensé l’approche du champ littéraire en l’élargissant à la notion de «culture médiatique». Il s’agit de considérer que l’imaginaire narratif d’une collectivité s’inscrit autant dans les fictions de masse que dans la production restreinte de la littérature légitimée, en puisant dans un répertoire commun de pratiques symboliques, d’événements culturels, historiques, politiques, sociaux, appréhendé selon des schèmes spécifiques (Quéfellec-Dumasy 1997). De nombreuses études ont ainsi donné une résonance nouvelle aux récits en bande dessinée, pour en montrer la portée inédite dans des champs aussi variés que la psychanalyse (Tisseron 2000; Rouvière 2014), la sociologie historique (Gabilliet 2005) ou l’anthropologie politique (Rouvière 2006). Parallèlement, le développement d’œuvres exigeantes, de même que l’apparition de genres nouveaux (autobiographie, romans graphiques, BD-reportage, essais) ont définitivement sorti la BD du cadre conceptuel des paralittératures.
La seconde approche, essentiellement sémiotique, est de considérer la BD comme une forme de langage médiatique visuel, successivement appréhendé comme une grammaire dérivée de modèles linguistiques (Eco 1964; 1972; Fresnault-Deruelle 1972), comme un «art séquentiel» (Eisner 1985; Mc Cloud 1993), comme un «système» narratif spatialisé (Groensteen 1999) ou comme une «littérature dessinée» (Morgan 2003). La longue histoire de ces recherches sémiotiques a bien été résumée par Stefanelli et Maigret (2012), avec ses premières impasses (rechercher des unités élémentaires de l’image qui relèveraient d’une double articulation, comme dans la langue) et ses différents concepts (arthrologie, spatio-topie, multicadre, site, graphiation, récitant, monstrateur, etc.). S’appuyant sur les travaux de Groensteen, Harry Morgan définit ainsi la bande dessinée selon les caractéristiques suivantes:
- - la présence d’un dispositif spatio-topique, comme une distribution de vignettes en bandeaux, ou une page compartimentée distribuant texte et images, impliquant un travail de mise en page spécifique et surtout un ancrage permanent de la lecture par l’image (contrairement à la littérature illustrée où l’ancrage demeure le texte écrit);
- - le caractère volontiers narratif des images, lorsque celles-ci induisent en elles-mêmes un avant et un après, un lien de causalité et de consécution;
- - enfin la séquentialité, c’est à dire la présence de ce même lien de causalité et de consécution dans une séquence d’au moins trois images par page. La triade constituée par la vignette en train d’être lue, celle qui précède et celle qui suit, constitue une micro-chaîne qui se déplace tout au long de la lecture. C’est un plan de signifiance à part entière, au même titre que la vignette isolée et le dispositif spatio-topique à l’échelle de la page ou de la double-page.
Cette définition minimale, qui écarte les notions de bulle, de case ainsi que les rapports texte-image, considérés comme non définitoires, a le mérite d’ouvrir les représentations du médium en intégrant une très grande variété de dispositifs graphiques. Elle donne toute sa place au pilotage par l’image et rompt avec l’influence des théories du cinéma, pour affirmer clairement que la maîtrise du temps par le récepteur place la BD dans le monde de la lecture. C’est à ce titre que le médium bande dessinée est considéré comme l’une des branches des « littératures dessinées », au côté des cycles de dessins ou de gravures, auxquels on peut ajouter les albums pour enfant (Rouvière 2008a).
La troisième façon d’envisager les liens entre BD et littérature se développe à travers une approche comparative, fondée sur l’idée que les deux arts ont en commun le fait de raconter une histoire (Groensteen 1999; 2010) et qu’ils partagent des liens intertextuels. L’étude de l’adaptation occupe alors une place privilégiée (Gaudreault & Groensteen 1998; Rouvière 2008; Baetens 2009; Mitaine et al. 2015). Plusieurs auteurs s’inquiètent d’un usage «marchepied» de la BD, au service de la compréhension du texte source. Jean-Paul Meyer (2012) s’affranchit du débat sur la fidélité des adaptations, pour montrer combien l’intérêt d’une transposition en bande dessinée est de «donner à voir», littéralement, les particularités sémiotiques, narratives et énonciatives selon lesquelles une BD raconte une histoire. De même, Jan Baetens (2009) invite à analyser les œuvres adaptées en elles-mêmes pour juger de l’utilisation qu’elles font du langage BD et de ses potentialités «médiagéniques» (Gaudreault et Marion, 2013). C’est alors que peuvent s’éclairer comparativement, dans un second temps, les ressources propres à chaque médium. Une sémiotique comparative peut faire apparaître par exemple une plus grande polyphonie de l’instance énonciative en bande dessinée (qui se partage entre récitant, monstrateur et narrateur fondamental) que dans le texte littéraire d’origine. Sur le plan axiologique, cette polyphonie peut conduire à créer des contrastes, voire des renversements de système de valeurs par rapport à l’œuvre source (Rouvière 2008b; Garric 2014). Enfin, dans une perspective métaculturelle, la bande dessinée peut en profiter aussi pour dire quelque chose de sa position dans le champ artistique à l’égard de la littérature et développer un discours ironique et critique sur son statut d’œuvre seconde (Garric 2014).
Cependant, comme le regrette Hélène Raux, «une certaine inféodation de la bande dessinée à la littérature semble toujours à l’œuvre dans le domaine des études littéraires» (2019: 22). Elle critique ainsi le fait que l’essai de Jacques Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature (2013), soit structuré autour d’intitulés trahissant un dialogue asymétrique entre les deux arts: «être ou ne pas être de la littérature», «s’emparer de la littérature», «représenter la littérature», «rivaliser avec la littérature». Plus problématique encore, l’auteur cèderait selon elle à une logique de segmentation au sein du champ de la BD, usant du qualificatif de «littéraire» comme d’une marque de distinction plutôt que comme une véritable catégorie d’analyse.
La quatrième façon d’envisager les liens entre BD et littérature est de réinscrire la BD dans une généalogie culturelle croisée. Cette approche, qui est celle de Thierry Smolderen (2010), rompt avec la vision de David Kunzle (1990), Benoît Peeters et Thierry Groensteen (1994), selon laquelle Rodolphe Töpffer, dans les années 1830, serait l’inventeur de la bande dessinée, parce qu’il aurait créé à la fois l’album autographié, le dispositif spatial de la planche et le héros graphique moderne. Pour Peeters, les «histoires en estampes» de Töpffer s’affranchiraient ainsi de la prééminence du littéraire, en ce que l’histoire naîtrait entièrement de la logique propre engendrée par le dessin. Pour Smolderen (2012) il s’agit là d’une vision rétrospective qui procède d’une définition contemporaine purement axiomatique de la BD comme art séquentiel. Elle empêche de comprendre le rapport de la bande dessinée avec le très riche passé des histoires en images au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour lui, la croyance dans une essence ontologique du médium conduit à un contresens sur le projet de Töpffer, qui n’est pas de promouvoir l’art séquentiel, mais au contraire de critiquer les théories de Lessing prétendant refonder la poésie comme description d’une action progressive. Töpffer s’emploie à donner une traduction graphique caricaturale de ces principes, en s’appuyant sur les illustrations des manuels de gestualité dramatique, qu’il parodie et enchaîne. Il invente cette forme pour se moquer de la mécanique stupide à laquelle aboutirait la rhétorique du progrès. En s’inspirant des écrits de Bakhtine sur la polyphonie et le dialogisme, Smolderen montre comment le dispositif de Töpffer s’inscrit dans une culture polygraphique antérieure beaucoup plus vaste, contemporaine du caricaturiste William Hogarth et des romans d’avant-garde anglais humoristiques du XVIIIe siècle. Hogarth, dans ses cycles narratifs de gravures, détourne et télescope des diagrammes visuels appartenant à différents registres, populaires ou archaïsants. Il s’inscrit dans une veine parallèle au «roman arabesque», dont le Tristram Shandy de Laurence Sterne est emblématique. Le novel humoristique anglais et la caricature procèderaient ainsi du même creuset culturel fondé sur l’hybridation stylistique, la parodie d’idiomes préexistants, l’ironie, la mise en abyme. Pour les contemporains de Töpffer, comme Goethe, ou pour ses successeurs comme Cham ou Gustave Doré, les récits séquentiels du Genevois relèvent à l’évidence des dispositifs ironiques du roman excentrique, à la fois polyphonique et polygraphe.
A travers le prisme de la culture polygraphique proposé par Smolderen, c’est soudain une généalogie de la BD beaucoup plus complexe qui apparaît, où la linéarité visuelle de la bande n’est pas première. Ce dispositif séquentiel ne trouve de postérité, dans les décennies suivantes, qu’à la faveur du support presse et d’autres gestes polygraphiques, comme la transposition de scripts sociaux, la schématisation inspirée des recherches chronophotographiques sur la décomposition du mouvement, le détournement de la fonction emblématique du phylactère (détournement concomitant à l’invention du phonographe), l’attraction de l’affiche publicitaire, ou encore la reprise de la culture foraine des images déformantes. Le travail d’historien de Smolderen, en rompant avec un «cycle essentialiste» sémio-centré (Stefanelli, 2012) au profit d’une approche culturaliste, a entraîné dans son sillage un déplacement prometteur des questions théoriques au sein des recherches sur la BD.
Le premier est porté par Henri Garric (2013) et concerne «l’engendrement des images en bande dessinée». Il s’agit de réfléchir aux moyens par lesquels une BD se constitue à partir de la seule répétition et métamorphose des formes et des objets, selon un jeu libre de l’image avec elle-même. Toute bande dessinée illustre une «plasticité métamorphique des images» (Garric 2013: 44), des jeux de genèse et de combinaisons des dessins, selon un bricolage qui se nourrit aux sources les plus éclectiques. Ce processus «déborde» la séquentialité chronologique des cases, pour s’exercer à l’échelle de la planche, de l’album, voire d’un genre tout entier. Il s’exerce également dans la BD numérique, à travers le déroulement vertical et la circulation hypertextuelle. Henri Garric fait ainsi une relecture des gags de Gaston Lagaffe à l’aune de l’opposition entre raideur et souplesse, entre trait rectiligne et ligne serpentine, diagrammes mécaniques et jeux d’arabesques (2013b). Il montre comment ces formes sont frappées de valeurs (la raideur mécanique et productiviste d’un côté, la liberté subjectivante du vivant de l’autre), dans un jeu d’échange dialectique qui engendre littéralement le scénario du gag. Cet axe de lecture permet de saisir simultanément, dans le mouvement de naissance de l’image, l’imaginaire particulier de l’auteur qui le porte, mais aussi le pouvoir de perturbation critique du dessin, «ouvrant à partir de n’importe quel prémice, n’importe quelle situation narrative, un récit qui vient défaire la cohérence et la linéarité temporelles» (Garric 2013b: 14-15). On toucherait là un noyau central de l’expression en bande dessinée, au point que «l’engendrement des images est ce qui reste de la BD quand elle tente une radicalisation et une concentration expérimentale de ses moyens», et constituerait pour certains un «idéal créatif» (Garric 2013b: 14).
Cette attention au jeu des auteurs sur l’apparition des images, en particulier à partir du creuset que constituent la mémoire, les rêves et les fantasmes (Rostam 2013), trouve son pendant dans un questionnement renouvelé sur les images que se forme le lecteur. Ce déplacement vers la réception est déjà présent dans la théorie de l’art invisible de Mc Cloud (1993), qui s’intéresse au jeu mental du lecteur avec l’espace inter-iconique (le blanc entre les cases), mais dans un paradigme où l’activité imageante du récepteur est prédéterminée, par les effets de cadrage, d’ellipse et de temporalité du récit. De même, les différentes théories sémio-structurales qui s’intéressent à la navigation du regard, traitent la page comme un objet statique en relation avec la théorie de la narration (Taylor 2004; Nakazawa 2005; Ingulsrud & Allen 2009), où l’ordonnancement est supposé introduire un balisage du sens de lecture. Or, si l’on considère que le processus d’engendrement des images fuit, déborde ou échappe en réalité à cet ordonnancement, leur puissance de surgissement invite à considérer autrement l’expérience lectorale. Eric Maigret, qui se dit particulièrement attaché aux principes d’autonomie de la réception, refuse de réduire les cheminements internes du lecteur au seul décodage ou pré-cadrage d’un parcours du regard. Il invite au contraire à considérer que les assemblages de sens effectués par le lecteur peuvent être «décentrés, faiblement cohérents, non hiérarchiques, sans but narratif ultime, partager des frontières floues avec d’autres formes d’expression» (2012a: 57). Matteo Stefanelli (2011; 2012) questionne quant à lui les relations entre réception et corporalité. Tout d’abord l’énonciation graphique, définie comme «graphiation» par Philippe Marion (1993: 31) est une trace idiosyncrasique, une empreinte-signature qui entraîne une relation subjective, fantasmatique du lecteur avec un corps-dessinant. Cette corporéité permet d’embrasser sur un plan idéel et mental le regard de l’artiste comme corps visionnaire. D’autre part, l’interface matérielle de la page et des écrans dépasse la modalité de la simple vision et appelle à prendre en compte l’engagement corporel du lecteur dans l’expérience de lecture. La matérialité de cette expérience immersive est du reste également prise en compte par les études sociologiques qui s’intéressent aux usages sociaux des comics ou des mangas, comme le cosplay 5 ou le scanlation6. La BD s’insère alors dans la vie quotidienne comme ressource identitaire, à travers un réseau de pratiques performatives et de communautés online, comme le montrent les recherches sur la dimension participative des médiacultures (Jenkins 2006; Ito 2008; Lunning, 2010).
Enfin les premières recherches sur la bande dessinée numérique remettent en cause le partage établi par Harry Morgan (2003) entre les arts qui pilotent la durée et qui l’imposent au récepteur (en particulier les arts audiovisuels), et les arts de la lecture qui laissent le récepteur gérer le temps (peinture, gravure, dessins, littérature dessinée). Anthony Rageul (2014) propose le concept de «lectacture» pour indiquer que la modalité de réception n’est plus seulement la lecture:
«lire» une bande dessinée numérique, c’est lire et agir ou lire et visionner. La lecture et l’action ou la lecture et le visionnage peuvent apparaître alternativement (ex: bande dessinée entrecoupée de passages jouables ou animés) ou se faire en même temps et ne faire qu’une (ex: explorer l’image avec la souris ou l’écran tactile). C’est une nouvelle modalité que j’appelle lectacture, en détournant la notion de Weissberg. En bande dessinée numérique, il y a deux axes, un qui va chercher du côté de l’animation, l’autre du côté du jeu vidéo. (cité dans Baudry 2015)
Rageul reprend le concept de «narrateur-arbitre» issu des recherches de Dominique Arsenault sur le jeu vidéo (2006), pour concilier une approche narratologique et une approche ludologique. Il établit ainsi un embryon de narratologie de la bande dessinée numérique qui tient compte de la participation du «lectacteur». Pour lui l'expérience de l'œuvre se joue sur le mode du gameplay et cela a des répercussions sur la narration, qui doit intégrer ces modalités particulières. Le récit ne reposerait plus seulement sur les mécanismes de la narration. Il exhiberait toute sa matérialité au lectacteur et reposerait en grande partie sur des mécanismes d'ordre poétique.
L’état des lieux qui précède sur les réflexions et les connaissances au sein des comics studies, dessine un objet culturel complexe et permet de mieux cerner les spécificités et les décalages avec la situation scolaire du médium dans les classes de français, telle qu’en rend compte la littérature pédagogique et didactique.
4. La reconfiguration scolaire de la BD
4.1. Un processus parallèle à celui de la légitimation culturelle
L’intégration scolaire de la BD s’est développée en parallèle de son intégration sociale, de façon assez autonome et sans recouper tout à fait cette dernière. Plusieurs synthèses historiques (Rouvière 2012; Raux 2019) en ont retracé en France les étapes successives, qui ont abouti à une forme de normalisation dans le courant des années 2000. À partir des programmes de 1972 pour l’école primaire, l’intégration de la BD se fait de façon d’abord résignée et méfiante. La volonté de valoriser les intérêts des élèves coexiste avec un discours de réprobation des mauvaises lectures, ce qui reflète les tensions qui entourent la rénovation de la discipline et plus largement de l’école. La BD reste alors en marge de ce qui est pleinement considéré comme lecture. Par la suite un deuxième mouvement se fait à la croisée des disciplines, par la lecture de l’image dans les programmes de collège de 1985 puis de 1996. De même, dans les programmes de 2008, la BD est évoquée au titre de l’histoire des arts (sans toutefois que les objectifs d’apprentissage soient clairement définis dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire). Le troisième mouvement est celui d’une intégration progressive aux lectures scolaires à partir des programmes de 1996 pour le collège. On passe d’une perspective d’exploitation instrumentale au service de la maîtrise de la langue et des discours (1996) à la reconnaissance de la BD comme support de la lecture interprétative, en particulier grâce au saut décisif des programmes de 2002 pour l’étude de la littérature jeunesse à l’école primaire. On note à ce titre la diversification croissante, depuis 1996, des œuvres conseillées pour l’école et le collège, sur le plan des genres, des styles, des univers fictionnels et des auteurs.
Ce processus n’est pas linéaire. Ainsi, les programmes de français de 2008 pour le collège tendent à évacuer la BD en recentrant la lecture sur la littérature classique et patrimoniale. De même, le réaménagement en 2018 des programmes de 2015 retire la BD de la liste des «genres» pour la compétence «comprendre un texte littéraire» en fin de cycle 3. Par ailleurs l’intégration de la BD reste segmentée selon les niveaux de classe et les filières. Comme le rappelle Hélène Raux, alors que la référence au médium dans les programmes de français du lycée professionnel est continue depuis 1987, celle-ci reste extrêmement marginale dans ceux du lycée général et technologique (malgré l’ouverture qu’avaient constitué les programmes de 1970 et 1981). Pour la chercheuse, c’est le signe que l’institution scolaire continue de conférer à la BD un rôle de remédiation ou de marchepied vers la lecture. Plusieurs auteurs pointent ainsi les limites du processus d’intégration, évoquant une forme de «trompe-l’oeil» (Rouvière 2012), de «réversibilité» (Aquatias 2017), ou de «décalage» avec les pratiques (Depaire 2019). Plusieurs enquêtes tendent à montrer que l’on n’étudie pas de BD en œuvre intégrale à l’école et au collège (Louichon 2008; Massol & Plissonneau 2009; Bonnéry et al. 2015). Pour Hélène Raux (2019), les usages scolaires de la bande dessinée restent minoritaires, périphériques et possiblement sujets à des malentendus sociocognitifs, tandis que manque une véritable théorisation didactique du médium.
Ce paradoxe pourrait s’expliquer selon le paradigme de la culture post-légitime développé par Eric Maigret (1994): à l’image de ce qui se produit en dehors de la sphère scolaire, l’intégration de la BD serait vouée à demeurer partielle et contradictoire, l’école reproduisant en interne, dans le choix et l’étude des corpus, des logiques de distinction extérieures. Cependant, les travaux sur l’histoire de l’enseignement (Chervel 1998) et la scolarisation des genres (Denizot 2013) offrent un autre modèle explicatif: en effet, la culture scolaire a la particularité de reconfigurer ses objets de façon autonome pour ses besoins propres.
Hélène Raux (2019) en fait la démonstration pour la bande dessinée à travers l’étude historico-didactique de 120 articles mentionnant la BD, qui ont été publiés entre 1968 et 2018 dans trois revues didactiques de référence (Repères, Pratiques, Le français aujourd’hui) ainsi que dans une revue professionnelle plus ancrée sur les pratiques enseignantes (la Nouvelle Revue Pédagogique). Durant la période de rénovation de l’enseignement et jusqu’au milieu des années quatre-vingt, la BD est appréhendée comme mass média, étant donné que, dans une logique communicationnelle, tout est discours parmi les langages présents dans l’environnement social. De façon inattendue, certains discours hostiles à la BD émanent alors de rénovateurs de l’enseignement, pour des raisons essentiellement idéologiques: en tant que production de masse, la BD est soupçonnée de diffuser les valeurs de la classe dominante et de véhiculer des stéréotypes sociaux. S’il faut l’étudier, c’est alors comme support propédeutique pour développer l’esprit critique face aux médias. Lorsque la BD est appréhendée de façon complètement positive par les rénovateurs, c’est cette fois-ci au détriment de sa spécificité médiatique, le plus souvent comme support d’une analyse structurale du récit. Dans les deux cas, Raux pointe le risque de renforcer les hiérarchies culturelles et les effets d’exclusion à l’égard de la culture privée qu’on prétend intégrer.
À partir de la fin des années 1980, Raux décrit une période marquée par une transition vers la reconnaissance de la BD comme lecture à part entière. Avant les années 1990, le support est pensé comme facilitateur pour la lecture, puis reconnu comme art complexe après les années 2000. De la paralittérature (Reuter 1986) à la lecture littéraire, la chercheuse retrouve les logiques de distinction qui conduisent à prendre en considération surtout des œuvres éloignées des lectures prisées des élèves (Bruno 1995), voire de minorer la complexité de ces lectures. L’ouverture aux lectures privées est toujours ambivalente, avec la volonté de leur faire prendre une distance critique par rapport aux productions qu’ils plébiscitent et de valoriser des œuvres fortement mises à distance des productions les plus populaires. Par ailleurs, la lecture de BD évolue, d’une lecture narratologique à une lecture sémiotique, via la lecture de l’image, jusqu’à esquisser une lecture didacticienne de productions d’élèves, par le travail sur l’adaptation. Raux montre surtout à quel point la didactisation de la BD est quasiment absente des articles. La présence de la BD reste incidente au profit d’objectifs variés. Elle n’est pas interrogée comme objet disciplinaire et son rôle supposé de remédiation n’est guère questionné. Rares sont les articles qui mettent en garde contre une sous-estimation de sa complexité (Huyhn 1991; Bautier et al. 2012). On s’en tient à des esquisses de pistes pédagogiques possibles (Bomel-Rainelli & Demarco 2011), tandis que l’analyse de productions d’élèves reste l’exception (Hesse-Weber 2017). Par ailleurs, la production de planches n’est pas mise en relation avec la lecture d’œuvre. Pour expliquer ce déficit, la chercheuse évoque la position «satellitaire» du médium par rapport à la littérature et fait le constat plus général d’un retard de la réflexion didactique sur l’image. Dans ce domaine, elle pointe les limites d’une approche qui est restée formaliste et elle critique un isomorphisme supposé entre image et texte (Raux 2019: 109-113).
4.2. Lever des présupposés non questionnés: d’une didactique programmatique à une didactique descriptive et compréhensive
Lorsqu’en 2010 est organisé à Grenoble le colloque international «Lire et produire des bandes dessinées à l’école», il s’est agi d’impulser dans le champ de la didactique de la littérature une réflexion pédagogique qui, depuis la fin des années 1970 et le colloque de la Roque d’Anthéron «Bande dessinée et éducation» (1977), ne s’était poursuivie de loin en loin que dans le champ disciplinaire de l’histoire. Les actes Bande dessinée et enseignement des humanités, publiés en 2012, proposent ainsi un état des lieux et une perspective programmatique pour envisager comment la BD pourrait contribuer à la construction de compétences de lecture. Ces actes incluent aussi des récits d’expériences de classe, principalement orientés vers l’ingénierie. Rétrospectivement, en 2020, apparaissent les limites de certains discours fondés sur des présupposés non toujours démontrés. Certains reposent sur des déclarations d’intention qui n’ont pas été suivis par des expérimentations attendues; d’autres prônent des mises en œuvre, qui n’ont pas été suivies de recueils et d’analyses de données suffisants, sur la situation scolaire du médium et la représentation comme objet disciplinaire que s’en font les acteurs institutionnels. D’autres enfin relèvent d’une praxéologie empirique, sans que l’on puisse véritablement tirer de conclusion générale sur les effets de cette dernière.
Les études qui se sont poursuivies dans la décennie 2010-2020 se sont appuyées sur une méthodologie et des données plus conséquentes pour lever un certain nombre de méprises sur la lecture de BD en classe. Tout d’abord, l’étude de Beaudoin et al. (2015), qui porte sur l’enseignement explicite de stratégies de compréhension en lecture, tend à montrer qu’il n’y a pas d’effet significatif du recours à la BD sur l’habileté à produire des inférences ou à développer la conscience métacognitive. Par ailleurs, le postulat selon lequel la bande dessinée serait facile d’accès est battu en brèche par plusieurs recherches. Sur des supports aussi variés que la BD historique ou le roman graphique, Virginie Martel et Jean-François Boutin (2015), ainsi que Nathalie Lacelle (2015), montrent que la prise d’information visuelle fait souvent défaut, en articulation avec la modalité textuelle, pour produire une interprétation générale. Les auteurs plaident donc pour une formation spécifique des élèves aux compétences de lecture multimodale. La bande dessinée peut même nuire aux apprentissages, lorsque les difficultés de réception du médium sont sous-estimées, comme le montrent Bautier et al. (2012) dans une séance de lecture en CP, à partir d’une planche présentant une pluralité de codes sémiotiques. Polo et Rouvière (2019) montrent qu’en classe de Première Sciences économiques et sociales, le choix d’un récit biographique de sept planches, donné comme support d’évaluation sans travail préalable sur les compétences spécifiques de lecture, suscite des erreurs de compréhension imputables au médium choisi, quel que soit le ressenti positif ou négatif des élèves. Le décalage qu’ils pointent entre l’effet subjectif plutôt positif du médium sur les élèves et les effets objectifs sur leur compréhension recoupe sur ce plan les analyses de Beaudoin et al. (2015).
Par ailleurs, loin de faciliter la compréhension et les apprentissages, la persistance de malentendus peut réduire l’étude de la bande dessinée à un simple vecteur de motivation. Hélène Raux (2019), qui a mené une étude sur les pratiques ordinaires des enseignants, incluant une série d’entretiens avec les praticiens, montre que la BD est essentiellement perçue comme une lecture plaisir, susceptible de raccrocher les petits lecteurs, a fortiori dans des démarches de projet supposées créer de la motivation et bonifier le climat de classe. La méconnaissance du domaine BD par les enseignants surdétermine le choix de corpus connus au graphisme accessible. Hélène Raux montre par ailleurs le décalage entre les premières représentations des professeurs et les fragilités qu’ils éprouvent ensuite face à l’objet. Ils disent leur manque d’outils pour travailler la BD dans le champ de la littérature. De fait, l’étude par la chercheuse de vingt-six séquences de français au sein du réseau «communauté des profs blogueurs» montre une très faible didactisation du médium dans la discipline. En l’absence d’une approche interdisciplinaire qui articule texte et image dans une démarche interprétative, l’usage de la BD oscille d’une part entre un outillage technique sur les codes sémiotiques, sans mise en relation avec l’effet de sens, et d’autre part une focalisation sur le texte et les enjeux globaux du récit, au détriment de la dimension visuelle.
Hélène Raux montre malgré tout que certaines pratiques «ordinaires» qu’elle a observées mettent en œuvre, avec la BD, des modalités de lecture interprétative et de questionnement ouvert, à partir d’éléments «résistants» dans des compositions visuelles polysémiques. Le cadre de l’observation, qui est celui du projet TALC (Du texte à la classe), est cependant spécifique7. Il s’agit d’enseignants volontaires sollicités à l’occasion d’une formation consacrée à l’enseignement de la littérature, tandis que le choix de la BD a été imposé. De façon significative, elle met cependant en évidence des embarras liés à l’intégration du médium, par exemple le besoin de faire un cadrage liminaire sur les codes de la BD, ou encore des logiques centrifuges symptomatiques à travers des activités de langue extérieures aux activités de lecture. Comparativement aux autres «genres» proposés dans le projet TALC, les enseignants demandent surtout très peu aux élèves de justifier leur lecture par des prises d’indices dans la BD.
Il en va différemment lorsque l’expérimentation en classe vise à tester un scénario pédagogique spécialement conçu par un didacticien pour embrasser les différentes composantes du médium et mettre les élèves en situation de questionnement (Rouvière 2012b; 2013). A travers la mise en évidence d’analogies de composition, les élèves peuvent parvenir à quitter le simple niveau de la fiction pour passer à l’examen plus distancié de procédés narratifs «littéralement visibles». Ils découvrent alors que le pilotage du récit par l’image est lourd d'effets implicites, ouvrant la voie à une lecture symbolique.
Il est à noter dans les recherches de Raux et Rouvière que ce sont les planches ou les scènes muettes qui donnent lieu à un travail interprétatif mobilisant l’analyse de compositions visuelles «résistantes». Cela rejoint le paradoxe pointé par Baetens (2012) à propos du roman graphique: le rapprochement avec la lecture dite «littéraire» serait plus grand lorsque le pilotage du récit n’est pas d’abord textuel.
Alors qu’un déplacement vers la question de la réception subjective s’amorce dans les comics studies et que les théories du sujet-lecteur informent depuis 2004 les réflexions en didactique de la littérature, il est à noter qu’aucune recherche d’envergure n’a été menée sur ce plan avec la BD, contrairement à d’autres genres et médium (album pour enfants, poésie, théâtre, genres narratifs).
4.3. La production de planches de BD en classe: de l’observation de pratiques «ordinaires» à l’expérimentation d’un dispositif spécifique
On doit à nouveau à Hélène Raux (2019) d’avoir mené un travail descriptif et compréhensif des pratiques ordinaires de production de BD en classe. La chercheuse a ainsi observé différents ateliers en CE2 et en classe de sixième dans le cadre d’une pédagogie de projet assortie, dans l’un des cas, de l’intervention d’une artiste. Son analyse s’appuie sur un ensemble de productions d’élèves des différentes classes et des entretiens menés avec chacune des enseignantes. La chercheuse retrouve dans les modalités de travail inspirées de la pédagogie de projet un certain nombre de limites déjà pointées par des sociologues de l’apprentissage comme Bonnéry (2007) ou Bautier et Rochex (2007): un investissement variable des élèves, des phénomènes de division du travail, une finalisation étroite des activités, une réduction chez certains élèves de la compréhension des enjeux de la tâche. L’atelier BD est valorisé par les enseignants au nom d’une pédagogie de la réussite supposée restaurer l’estime de soi, selon le présupposé d’un pouvoir remédiant du médium ou des vertus mêmes du détour. Mais cette réalité ne vaut que pour une poignée d’élèves, tandis que la démobilisation des autres est acceptée par les professeurs au nom de l’inédit, l’essentiel étant de sortir des sentiers battus de la discipline.
Les enjeux cognitifs passant au second plan, non seulement les résultats décevants entretiennent les difficultés, mais paradoxalement, l’activité s’avère surtout porteuse pour les bons élèves. Sur un plan plus technique, la chercheuse constate que la capacité à créer un enchaînement narratif visuel n’est pas enseignée comme une compétence. Le découpage du récit en images est pensé comme naturel et allant de soi. Pour y parvenir, les élèves sentent qu’il serait possible de faire un découpage dessiné, mais comme il leur est demandé de faire un découpage écrit, l’activité se mue au mieux en une segmentation de texte à illustrer, où le dessin ne pilote pas le récit. Hélène Raux montre le flou des représentations enseignantes sur la notion de scénario, elle montre comment une partie des élèves dessine malgré tout et insère du texte transformé, enfin comment le découpage scénaristique peut se trouver délégué à un intervenant extérieur, annihilant l’intérêt pédagogique de l’activité pour les élèves.
De fait, si l’écriture d’un synopsis mobilise des compétences d’écriture scolaires traditionnelles, le découpage, en revanche, suppose que les élèves aient la capacité spécifique de pré-visualiser ce qu’ils racontent et mettent en scène: le site, la taille et la forme des cases, les types de plans, le contenu figuratif, etc. Or, cette compétence particulière, qui consiste véritablement à «penser en images» devrait faire l’objet d’un apprentissage préalable. Ainsi, des élèves performants dans l’écriture du synopsis peuvent-ils se trouver démunis lorsqu’il s’agit de passer à l’étape suivante. C’est pour remédier à ce problème qu’a été inventé le dispositif collaboratif de «l’écriture post-it», qui a été expérimenté avec succès (Rouvière 2015; 2017). Le principe «1 post-it = 1 action» permet de créer une histoire pré-découpée selon l’équivalence implicite «1 post-it = 1 case». A quoi s’ajoute ensuite deux autres couches de post-it de deux couleurs différentes, l’une pour le texte, l’autre pour décrire le visuel. Le synopsis s’invente ainsi ou se réinvente en même temps que le scénario s’écrit, case après case. Planification, mise en texte et révision ne sont plus des étapes chronologiques, mais se fondent dans un seul et même processus dynamique. Ainsi certains élèves en difficulté dans des productions écrites traditionnelles se découvrent une capacité à pré-visualiser et mettre en scène avec ces petits papiers ce qu’ils veulent raconter.
4.4. L’étude des adaptations: une porte d’entrée incontournable de la BD en classe?
Dans son étude historico-didactique, Hélène Raux (2019) montre que l’étude de l’adaptation en BD des classiques de la littérature se situe à un point d’équilibre des tensions culturelles qui entourent la légitimation du médium et, à ce titre, constitue une porte d’entrée possible pour une didactique de la BD en classe. C’est ce que pourrait laisser espérer l’article de Hesse-Weber (2017), qui s’appuie sur l’analyse de productions d’élèves pour étudier les enjeux de l’adaptation d’une pièce de théâtre en bande dessinée. La place donnée à la BD reste cependant celle d’un «satellite gravitant autour des œuvres littéraires» (Raux 2019: 107). D’autres études confirment que la production en classe d’adaptation en BD reste subordonnée pour le professeur à des objectifs d’appropriation subjective, de compréhension et d’interprétation du texte littéraire (Lacelle & Lebrun 2015). Il en ressort tout de même que l’adaptation par les élèves peut donner une réelle impulsion à l’exploration du texte source pour construire la compréhension (Rouvière 2015). Elle oblige les élèves à plonger dans le texte, à le découper, à distinguer les différentes factures de discours et les instances énonciatives, à séquencer les actions, les dialogues ou les passages descriptifs. Le processus engage par ailleurs chez les élèves un effort d'élucidation lexicale et de représentation mentale pour se forger des images. Effort qui est souvent étayé par des recherches documentaires pour enrichir la lecture et nourrir le projet.
Cependant, en ce qui concerne la lecture proprement littéraire, le bénéfice pour l’interprétation du texte source semble limité. Dans une expérimentation que j’ai pu mener (Rouvière 2017), il est apparu qu’une fois que les élèves ont dégagé une note d’intention, le texte source servait de réservoir utile à d'autres fins qu'à sa propre lecture, dans le sens d’'une réduction et d'une simplification. Lors de la présentation ultérieure des planches, le travail comparatif s’est avéré également assez pauvre et n'a pas enrichi véritablement la lecture littéraire. Les élèves ont vu le texte original à travers le prisme de leur propre adaptation, pour étayer leur projet. L'activité fictionnalisante du lecteur (Langlade 2004) a certes été mise en mouvement, mais en amont du processus de l’adaptation lui-même, après la lecture-découverte, lorsqu’était suscité par exemple un jeu d’images associatives. La transmodalisation a apporté en aval peu de gain supplémentaire sur ce plan. Par contre l'analyse que les élèves ont faite de leur planche a montré le plus souvent une articulation explicite entre une intention signifiante, des procédés de composition et des effets de sens (même s’il s’agissait d’un discours reconstruit). La BD m’apparaît comme un médium particulièrement propice à l'adoption de cette posture, pour peu que l’on exerce le regard des élèves sur quelques procédés (choix d’un multicadre, taille, forme et site des vignettes, jeux d’échelle sur l’échelle des plans ou sur les angles de vue, etc.). Ce résultat peut du reste être obtenu en lui-même, sans le détour par l’adaptation d’un texte littéraire.
En ce qui concerne la lecture en classe de bandes dessinées adaptées d’œuvres littéraires, la réflexion didactique, quoi qu’elle en dise, parvient également difficilement à s’affranchir d’une approche «marche-pied», car l’objectif est de contribuer à la formation d’une lecture littéraire de l’œuvre source. Les adaptations BD sont envisagées comme des «textes de lecteurs», et à ce titre, fournissent l’exemple de lectures subjectives (Fourtanier 2012) et sensibles (Ahr 2012). Cependant Brigitte Louichon (2012) montre que l’étude de la reproduction intégrale du texte source peut aussi avoir pour effet de questionner les particularités sémiotiques du langage BD et s’avère une modalité porteuse pour problématiser la lecture.
4.5. Vers une didactique de la culture polygraphique?
Le paradigme de la culture polygraphique proposé par Thierry Smolderen (2009; 2012) pour cerner le creuset où prend naissance et se réinvente la bande dessinée, invite sans doute à élargir les perspectives pour une didactique du médium.
Cela concerne d’abord les frontières d’une acculturation générale au média: ouvrir les représentations des élèves à la diversité des univers de fiction, des genres, des styles graphiques et des esthétiques semble une nécessité, de même que les ouvrir au processus de création, à l’histoire du médium et à ses différentes sphères culturelles à travers le monde. Mais il semblerait fructueux également de questionner en classe les frontières sémiotiques du médium avec d’autres formes d’expression: le dessin de presse, les caricatures séquentielles, le roman-photo, la peinture d’images itératives (profanes ou religieuses), les albums pour enfants, les recueils d’illustrations ou de caricatures, l’art de l’affiche, du vitrail ou de la fresque, dans une approche véritablement interdisciplinaire avec les arts plastiques.
Lorsqu’il s’agit d’étudier le «langage» de la BD, le concept de culture polygraphique invite également à décloisonner l’approche des codes formels. Rencontrer un même procédé (cadre, site, plan, angle de vue…) dans des contextes stylistiques et compositionnels diversifiés éviterait de figer les représentations sur les effets induits, tout en développant la culture du regard et la sensibilité.
En ce qui concerne la production de planches par les élèves, l’intégration d’éléments composites (photogrammes, détails grossis ou inversés de reproductions de tableaux, diagrammes divers) apparaît comme une pratique légitime, de même que le détournement, le collage et l’invention patchwork de planches à partir d’emprunts à d’autres BD ou différentes banques d’images disponibles (Rouvière 2015; 2017). A ce titre, les directions de recherche impulsées depuis 2016 par l’association Stimuli et le laboratoire de didactique André-Revuz de l’Université Denis-Diderot, dans le champ de la didactique des sciences, s’avèrent tout à fait prometteuses. Les enseignants et les chercheurs qui utilisent les arts narratifs et visuels pour faire vivre la science dans leur classe ou médiatiser leurs recherches en laboratoire, utilisent des dispositifs icono-textuels qui s’inspirent de la BD autant qu’ils la nourrissent: par exemple certains organisent la page comme un champ panoptique et insèrent des photogrammes qu’ils traitent comme des vignettes de BD (avec récitatifs et bulles), en les recadrant, en estompant les éléments non discutés, en épurant les éléments importants avec des dessins aux lignes claires, et en les complétant d’annotations graphiques (Goujon 2020); d’autres font produire aux élèves des narrations graphiques codées à partir d’albums pour enfant (Moulin & Hache 2020) et des cartes dites «sensibles» (Gaujal 2020), pour favoriser l’appropriation de savoirs disciplinaires en cours d’acquisition8.Thierry Smolderen (2012) rappelle à quel point toute forme de modélisation théorique peut se révéler stimulante pour l’imagination d’un dessinateur polygraphique. Il y voit l’une des clés du dynamisme de la bande dessinée, qui trouve historiquement sa source dans un imaginaire diagrammatique et spéculatif. Ce propos est confirmé par différentes expériences universitaires récentes, qui invitent les jeunes chercheurs à transposer leur recherche en BD9.
Sur le plan de la lecture, la notion de culture polygraphique invite par ailleurs à sortir d’une approche strictement séquentielle du médium. En contrepoint d’une approche scénaristique de la BD (telle qu’induite par exemple par la narratologie ou le dispositif de l’écriture post-it), il est sans doute possible de promouvoir une approche non linéaire axée sur l’engendrement des images. A la suite des approches tracées par Marion Rostam et Henri Garric à propos des œuvres de David B. et de Franquin, il s’agirait par exemple de rechercher avec les élèves, parmi le flux et l’entrelacement des formes et des figures au sein de certaines œuvres graphiques, un possible dispositif dialectique. Tout se passe parfois comme si la tension entre certaines formes ou certains motifs (la droite vs la courbe, le contour vs le détour, le noir vs le blanc, le vide vs le plein, le texte vs l’image, le figuratif vs l’emblématique) recouvrait un conflit de valeurs et se prêtait à des jeux de combinaison réversibles.
Une autre source d’engendrement des images est l’imaginaire linguistique. Roland Barthes (1982) l’avait montré à propos de l’art du peintre Arcimboldo fondé sur un jeu de métaphores, de métonymies et d’expressions langagières transposés dans une composition visuelle. On retrouve cette direction dans une proposition de Tatiana Blanco Cordon (2012), en classe d’espagnol langue étrangère, qui consiste à effectuer une lecture «littérale» de certains motifs, pour en déduire des expressions linguistiques. Cette méthode semble approcher d’assez près le nœud d’imaginaire où la création iconique parfois s’origine. Il est possible en effet que l’image ait sa source dans un «texte souterrain», qu’elle procède de certaines expressions de la langue qui la parle à l’avance (Rouvière 2012a: 373). On sait par exemple qu’il s’agit chez René Goscinny de l’un des ressorts de l’invention du gag visuel (Kaufmann 1983) ou du cryptage symbolique (le sang-lier). On aboutit alors à des énoncés littéraux, une «lettre» de l’image qui redonne toute leur profondeur aux mises en scène par la bande.
Enfin, au regard de l’hybridation stylistique et de la distanciation ironique partagées par le roman comique et la culture polygraphique, les travaux de Thierry Smolderen légitimeraient d’inscrire dans les programmes de Lycée la culture du roman arabesque et du récit excentrique, au XVIIIe et au XIXe siècle, en incluant les œuvres de Töpffer, Cham ou Doré. Ce serait là le signe d’un saut véritablement «post-légitime» dans l’appréhension du médium BD.
5. Conclusion
Les trois champs théoriques qui ont été mis en regard peuvent sembler relativement hermétiques les uns vis-à-vis des autres, en particulier celui de la recherche en éducation. Intuitivement, on pourrait penser à l’inverse qu’il existe socialement une logique descendante, qui va de la légitimation culturelle du médium à la connaissance savante de son langage et de son histoire, pour aboutir à son intégration scolaire. Mais en raison de logiques de scolarisation propres à la discipline (Chervel 1998; Denizot 2013; Raux 2019), la trajectoire scolaire de l’objet BD tend à se développer en parallèle de son histoire sociale, sans la recouper totalement. Par ailleurs, alors que l’on semble progresser vers une théorisation didactique du médium, jamais la plasticité culturelle de ce dernier n’est apparue aussi grande, du roman arabesque au jeu vidéo, bouleversant les catégories préexistantes à travers lesquelles l’objet était pensé. La notion de culture polygraphique ou encore de dispositif d’images en flux, pourrait à moyen terme faire apparaître comme daté le dispositif de la bande dessinée tel qu’il s’est stabilisé au XXe siècle sur support papier. A moins que cette muséification progressive soit précisément l’une des conditions culturelles et institutionnelles d’une intégration scolaire à venir plus forte encore. L’inscription d’une bande dessinée au programme de Lettres du baccalauréat constituerait sans doute une étape majeure en ce sens. Mais la recherche en didactique sur l’étude de la BD doit encore progresser, en s’intéressant en particulier à la lecture subjective, pour répondre aux besoins qui se feraient jour et accompagner favorablement les pratiques de classe.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bandes dessinées: sacrilège ou tremplin?», in Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. De Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 197-208.
Aquatias, Sylvain (2017), «La bande dessinée à l’école hier et aujourd’hui», Deuxièmes rencontres nationales de la bande dessinée, Angoulême. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.etatsgenerauxbd.org/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/2017_rencontres_nationales_bd_02_v00c2.pdf
Arsenault, Dominic (2006), Jeux et enjeux du récit vidéoludique: la narration dans le jeu vidéo, mémoire, Université de Montréal. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.le-ludophile.com/Files/Dominic%20Arsenault%20-%20Memoire.pdf
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n° 16. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/narratologie/974
Barthes, Roland (1982) «Arcimboldo ou Rhétoriqueur et Magicien», in L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil.
Baudry, Julien (2015), «Entretien jeune recherche en bande dessinée: Antony Rageul», Phylacterium. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.phylacterium.fr/?p=2162
Baudry, Julien (2012), Cases Pixels. Une histoire de la bande dessinée numérique en France, Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Bautier, Elisabeth, Jacques Crinon, Catherine Delarue-Breton & Brigitte Marin (2012), «Les textes composites: des exigences de travail peu enseignées?», Repères, n° 45, p. 63-79.
Bautier, Elisabeth & Jean-Yves Rochex (2007), «Apprendre: des malentendus qui font la différence», in Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, J. Deauvieau & J.-P. Terrail (dir.), Paris, La Dispute, p. 227-241.
Beaudoin, Isabelle, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Nathalie Lemieux, Martin Gendron (2015), «Consolider ses compétences de compréhension en lecture par la BD», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/consolider-ses-competences-de-comprehension-en-lecture-par-la-bd
Blanchard Marianne, Hélène Raux (dir.) (2019), «Usages didactiques de la bande dessinée», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 1er novembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/trema/4803
Boltanski, Luc, (1975), «La Constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, p. 37-59. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2448
Bomell-Rainelli, Béatrice & Alain Demarco (2011), «La BD au collège depuis 1995: entre instrumentalisation et reconnaissance d’un art», Le Français aujourd’hui, n° 172, p. 81-92.
Bonnéry, Stéphane (2007), Comprendre l’échec scolaire, Paris, La Dispute.
Bourdieu, Pierre (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, éditions de Minuit.
Bourdieu, Pierre (1992), Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littérature médiatique multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec.
Bruno, Pierre (1995), «La culture jeune», Le Français aujourd’hui, n° 111, p. 19-28.
Chervel, André (1998), La Culture scolaire: une approche historique, Paris, Belin.
Couégnas, Daniel (1992), Introduction à la paralittérature, Paris, Seuil.
Dacheux, Eric (2009), «La bande dessinée, art reconnu, média méconnu», Hermès, n° 54, p. 11-17.
Dardaillon, Sylvie (2009), «Quelle place pour l’iconotexte dans les pratiques des enseignants du cycle 3?» in La Littérature en corpus. Corpus implicites, explicites, virtuels, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Dijon, Scéren-CRDP de Bourgogne, p. 85-95.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires 1802-2010, Bruxelles, Bern & Berlin, Peter Lang.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: la place de la bande dessinée dans l’enseignement, Syndicat national de l’édition. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL:https://www.sne.fr/app/uploads/2019/02/SNE-PictureThis_etat-des-lieux-BD-ecole_janv2019_2.pdf
Queffélec-Dumasy, Lise (1997), «De quelques problèmes méthodologiques concernant l’étude du roman populaire», in Problèmes de l’écriture populaire au XIXe siècle, R.Bellet & Ph. Régnier, Limoges, Pulim, p. 229-266.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Garnier.
Eco, Umberto (1972), La Structure absente, Paris, Mercure de France.
Eco, Umberto (1970), «Sémiologie des messages visuels», Communications, n° 15, p. 11-51.
Eco, Umberto (1964), Apocaliticci e integrati. Communicazioni di massa e theori della cultura di massa, Milan, Bompiani.
Eisner, Will (1985), Comics and Sequential Art, Tamarac, FL, Poorhouse Press.
Evans, Christophe (2015), «Profils de lecteurs, profils de lecture », in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, éditions de la Bibliothèque publique d’information, p. 17-44.
Fourtanier, Marie-José (2013), «Lire et faire lire des œuvres littéraires adaptées en BD: "ravauder" le patrimoine ou l’inventer?», in Les Patrimoines littéraires à l’école, S. Ahr & N. Denizot (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 33-50.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1972), La Bande dessinée. Essai d’analyse sémiotique, Paris, Hachette.
Frezza, Gino (1999), Fumetti, anime del visibile, Roma, Meltemi.
Gabilliet, Jean-Paul (2005), Des Comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États-Unis, Nantes, éd. du Temps.
Garric, Henri (dir.) (2013), L’Engendrement des images, Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Garric, Henri (2014), «Ce que la bande dessinée pense de la littérature: à propos de gemma Bovery de Posy Simonds», Neuvième Art 2.0. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article806
Gaudreault, André & Thierry Groensteen (dir.) (1998), La transécriture. Pour une théorie de l’adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip, Quebec & Angoulême, Editions Nota Bene / CNBDI.
Gaujal, Sophie (2020), «Géo-graphier», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 111-118.
Goujon, Catherine (2020), «La bande dessinée dans les écrits scientifiques en sciences de l’éducation, un cas en didactique des sciences», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 26-31.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (2006), La bande dessinée, un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Hache, Christophe & Marianne Moulin (2020), «Codage d’album et activité mathématique?», in Actes de la 2e édition du colloque Telling Science Drawing Science, 15-17 mai 2019 Angoulême (TSDS # 2), C. de Hosson, L. Bordenave, P.-L. Dautès & N. Décamp (dir.), Paris, Irem, p. 82-85.
Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 10-15.
Hesse-Weber, Armelle (2017), «Du théâtre à la bande dessinée », Pratiques, n° 175-176. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/pratiques.3617
Huynh, Jeanne-Antide (1991), «La synthèse de documents», Le Français aujourd’hui, n° 96, p. 26-35.
Ingulsrud, John E. & Kate Allen (2009), Reading Japan Cool. Patterns of Manga Literacy and Discourse, Lanham, Lexington Books.
Ito, Mizuko (2008), «Mobilizing the Imagination in Everyday Play: The Case of Japanese Media Mixes», in International Handbook of Children, Media and Culture, D. Livingstone & K. Drotner (dir.), New York, Sage. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http://www.itofisher.com/mito/publications/mobilizing_the.html
Kaufmann, Judith (1983), «Astérix, humour pictural et verbal», Cahier comique et communication, n°1, p. 67-109.
Kunzle David (1990), History of the comic strip, vol. 2, The ninetheenth century, Berkeley, University of California Press.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses universitaires du Québec, p. 125-140.
Lacelle, Nathalie & Monique Lebrun (2015), «L’écriture transmédiatique dans le processus s’appropriation d’univers narratifs», in Les Formes plurielles des écritures de la réception, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 237-257.
Langlade, Gérard (2004), «Le sujet lecteur auteur de la singularité de l’œuvre», in Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, A. Rouxel & G. Langlade (dir.), Rennes, PUR, p. 81-91.
Louichon, Brigitte (2012) «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.
Lunning, Frenchy (dir.) (2010), Fanthropologies, Minneapolis, University of Minessota Press.
Jenkins, Henry (2006), Convergence culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press.
Lefèvre, Pascal (2007), «Incompatible Visual Ontologies: The Problematic Adapatation of Drawn Images», in Film and Comic Books, I. Gordon, M. Jancovitch & M. McAllister (dir.), Jackson, University Press of Mississippi.
Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée: les éditeurs franco-belges et l’album, 1950-1990, Lyon, Presses de l’Enssib.
Lesage Sylvain (2019), «Une bande dessinée adulte? Usages et mésusages de la légitimation», Belphégor, n° 17 (1). En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: http: //journals.openedition.org/belphegor/1607
Louichon, Brigitte (2012), «Fables en BD: la contrainte du texte», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 171-182.
Louichon, Brigitte (2008), «Enquête sur le rapport des enseignants aux programmes de 2002 et les pratiques d’enseignement de la littérature au cycle 3», Repères, n°37, p. 51-68. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.420
McCloud, Scott (1993), Understanding Comics. The Invisible Art, Northampton, Tundra Publishing.
Maigret, Eric (2015), «La bande dessinée dans le régime du divertissement: reconnaissance et banalisation d’une culture», in La Bande dessinée, quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Editions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://books.openedition.org/bibpompidou/1677
Maigret Eric (2012a), «Théories des bandes débordées», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 50-70.
Maigret Eric (2012b), «bande dessinée et postlégitimité», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 130-148.
Maigret, Eric (1994), «La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée», Réseaux, n° 67, p. 113-140. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1994_num_12_67_2742
Maigret Eric, Matteo Stefanelli (dir.) (2012), La Bande dessinée: une médiaculture, Paris, Armand Colin.
Marion, Philippe (1993), Traces en cases, Louvain-la-Neuve, Académia.
Martel, Virginie & Jean-François Boutin (2015), «Intégrer la lecture multimodale et critique en classe d’histoire: étude de cas exploratoire», Revue de recherche sur la littératie médiatique multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2015-v1-rechercheslmm03759/1047801ar.pdf
Massol, Jean-François & Gersende Plissonneau (2008), «La littérature lue en 6e et 5e: continuités et progressions», Repères, n° 37, p. 69-103. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.4000/reperes.422
Méon, Jean-Matthieu (2015), «Bande dessinée: une légitimité sous condition», Informations Sociales, n° 190 (4), p. 84-91.
Mitaine Benoît, David Roche & Isabelle Schmitt-Pitiot (dir.) (2015), Bande dessinée et adaptation (littérature, cinéma, TV), Clermont-Ferrand. Presses universitaires Blaise Pascal.
Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Éditions de l’An 2.
Morgan, Harry (2012), «De l’éradication de "l’illustré gangster" à l’analyse de bandes dessinées en classe (1929-2009): ruptures et continuité», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 55-77.
Nakazawa, Jun (2005), «Development of manga (Comic Book) Literacy in Children », in Applied Developmental Psychology. Theory, Practice and Research from Japan, D, W. Schwalb, J. Nakazawa & B. Schwalb (dir.), Charlotte, Information Age Publishing.
Ory, Pascal, Laurent Martin, Jean-Pierre Mercier & Sylvain Venayre (2012), L’Art de la bande dessinée, Paris, Citadelle & Mazenod.
Polo, Claire & Rouvière, Nicolas (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51, p. 166-190.
Rageul, Anthony (2014), La bande dessinée saisie par le numérique: formes et enjeux du récit reconfiguré par l’interactivité, thèse de doctorat, Université Rennes 2.
Raux, Hélène (2019), La Bande dessinée en classe de français: un objet disciplinaire non identifié, thèse de doctorat, Université de Montpellier.
Reuter, Yves (1986), «Les Paralittératures: problèmes théoriques et pédagogiques», Pratiques, n° 50, p. 3-21.
Robert, Pascal (2016), Bande dessinée et numérique, Paris, CNRS éditions.
Rostam, Marion (2013), «Naissance d’un imaginaire graphique dans L’Ascension du Haut Mal de David B.», in L’Engendrement des images, Garric H. (dir.), Tours, Presses Universitaires François Rabelais, p. 19-41.
Rouvière, Nicolas (2017), «Adapter en classe des extraits de roman sous forme de BD: quels apports pour la lecture littéraire?», Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale, n° 6. En ligne, consukté le 11 septembre 2020, URL: https://litmedmod.ca/adapter-en-classe-des-extraits-de-roman-sous-forme-de-bd-quels-apports-pour-la-lecture-litteraire
Rouvière, Nicolas (2015), «Produire des planches pour apprendre à lire la BD: quelques dispositifs et leurs effets dans des classes de cycle 3», Revue de Recherches En Littératie Médiatique Multimodale, n° 1. En ligne, consulté le 11 septembre 2020, URL: https://doi.org/10.7202/1047792ar
Rouvière, Nicolas (2014), Le Complexe d’Obélix, Paris, PUF.
Rouvière Nicolas (dir.) (2012a), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, Ellug,
Rouvière Nicolas (2012b), «Étudier une œuvre intégrale en bande dessinée au cycle 3: quelles spécificités didactiques?», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 103-121.
Rouvière, Nicolas (2008a), «L’influence de la bande dessinée sur les albums pour enfants: histoire, esthétique et thématiques», Modernités, n° 28, p. 17-28.
Rouvière, Nicolas (2008b), «Adapter les classiques. Présentation de la collection "les grandes aventures racontées aux enfants"», Les Cahiers de Lire écrire à l’Ecole, n° 2, p. 45-65.
Rouvière, Nicolas (2006), Astérix ou les lumières de la civilisation, Paris, PUF.
Stefanelli, Matteo (2012), «Un siècle de recherches sur la bande dessinée», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 17-49.
Smolderen, Thierry (2009), Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à Winsor McCay, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
Smolderen, Thierry (2012), «Histoire de la bande dessinée: questions de méthodologie», in La Bande dessinée: une médiaculture, E. Maigret & M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, p. 71-90.
Taylor, Laurie (2004), «Compromised Divisions, Thresholds in Comic Books and Video Games», ImageText, n°1 (1). En ligne, consulté le 28 août 2021, URL: http://www.english.ufl.edu/imagetext/
Tisseron, Serge (2000), Psychanalyse de la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Tisseron, Serge (1993), Tintin et le secret de Hergé, Paris, Hors collection.
Pour citer l'article
Nicolas Rouvière, "Quelle didactique pour la bande dessinée? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/quelle-didactique-pour-la-bande-dessinee-retour-sur-trois-tournants-theoriques-de-la-decennie-2010-2020
Voir également :
La bande dessinée dans les manuels de FLE (1919-2020)
Dans ce numéro consacré au rapport entre didactique et bande dessinée, la réflexion que nous allons présenter se situe dans le champ du français langue étrangère (FLE) avec une perspective historique. Nous nous poserons la question de savoir quelle est et quelle a été la place de la BD dans l’enseignement du FLE, et nous nous demanderons en particulier quel(s) rôle(s) elle a joué en relation avec les méthodologies dans lesquelles elle s’insère. Pour répondre à ces questions on cherchera à retrouver dans les manuels de FLE les traces de son exploitation et à étudier son évolution, de manière à se faire une idée des changements de représentations et de pratiques dans le discours méthodologique.
La bande dessinée dans les manuels de FLE (1919-2020)
Dans ce numéro consacré au rapport entre didactique et bande dessinée, la réflexion que nous allons présenter se situe dans le champ du français langue étrangère (FLE) avec une perspective historique. Nous nous poserons la question de savoir quelle est et quelle a été la place de la BD dans l’enseignement du FLE, et nous nous demanderons en particulier quel(s) rôle(s) elle a joué en relation avec les méthodologies dans lesquelles elle s’insère. Pour répondre à ces questions on cherchera à retrouver dans les manuels de FLE les traces de son exploitation et à étudier son évolution, de manière à se faire une idée des changements de représentations et de pratiques dans le discours méthodologique. Des parallèles peuvent être esquissées entre les champs de la didactique du FLE et du français langue dite maternelle (FLM), par exemple sous l’angle historique de la situation de la BD dans l’enseignement au siècle dernier1. Nous en rappellerons quelques-uns sous forme de déficits:
- - la BD est peu présente dans l’enseignement;
- - elle manque de travaux de recherche académique;
- - elle manque d’instruments didactiques pour l’exploitation en classe;
- - elle manque de formation initiale ou continue pour les enseignants;
- - elle souffre encore d’un déficit de légitimité et les corpus enseignés peinent à s’émanciper du cadre étroit de la BD pour enfants;
- - elle est majoritairement instrumentalisée à des fins d’apprentissage pour d’autres savoirs (en particulier linguistique, mais aussi culturels, historiques, etc.).
Mais des nuances importantes doivent être prises en compte, notamment concernant la nature des documents exploités et leur fonction dans l’espace social. L’influence des différents courants méthodologiques dans le domaine de la didactique des langues étrangères joue sans doute un rôle essentiel dans l’intégration de la BD dans les manuels d’enseignement selon les époques. Pour clarifier ces nuances, il convient aussi de préciser une distinction fondamentale dans le champ de la didactique du FLE concernant le type de BD dont il sera question. En effet, il faut rappeler l’importance, dans le champ de la didactique des langues étrangères, depuis les années 1970, du débat sur la distinction entre document authentique (entendu comme objet de discours circulant dans la société-cible) et document fabriqué (entendu comme objet de discours fabriqué pour l’enseignement de la langue).
En général, le document fabriqué s’oppose au document authentique en ce qu’il présente une langue artificielle, et qu’il perd les éléments contextuels, les implicites et tous les éléments susceptibles d’être jugés trop difficiles pour le niveau des apprenants. Il y a donc les pour et les contre et le débat est vif (Boyer & Butzbach 1990). Mais de manière générale, l’utilisation du document authentique est fortement recommandée par les didacticiens des langues depuis les années 1980 et l’arrivée de l’approche communicative (Cuq & Gruca 2003: 392). Ce type de documents va s’imposer dans les manuels et progressivement envahir l’espace visuel dans les méthodes actionnelles des années 2000: publicités, affiches, tracts, brochures, etc. Toutefois, cette profusion de documents authentiques concerne surtout les textes écrits, les documents oraux authentiques étant souvent considérés comme trop difficiles pour l’accès au sens.
Pour ce qui est de la BD, nous utiliserons cette distinction entre BD fabriquée pour l’enseignement de la langue étrangère et BD authentique circulant dans la société-cible (désormais BDF et BDA) pour rendre compte des usages dans les manuels de FLE: jusqu’aux années 1980, la BDA y est absente, puis elle apparait timidement dans les suppléments culturels. Pourtant, Rouvière (2012: 283) mentionnait une «très large présence» de la BD dans les manuels de langue et civilisation depuis les années 1970. Cuq et Gruca (2003) font le même constat2, mais ces affirmations sont contraires aux résultats de notre recherche si l’on prend en compte seulement les BDA, qui s’avèrent rares dans les manuels que nous avons observés. En effet, ces supports graphiques semblent faire l’objet des mêmes résistances que les documents authentiques oraux: ils sont généralement jugées trop difficiles et n’apparaissent que dans les niveaux plus avancés. En revanche, le dessin assimilable à des BDF est massivement exploité sous toutes ses formes, avec une densification dans les premiers niveaux.
Toutefois, la frontière entre BDA et BDF n’est pas toujours claire: les illustrations fabriquées adoptent plus ou moins les caractéristiques spécifiques de la bande dessinée authentique, comme on le verra, selon les objectifs à traiter. Nous en viendrons par la suite à relativiser cette distinction, qui repose surtout sur un critère éditorial. En lien avec cette question d’authenticité, si l’on veut rendre compte de la place de la BD dans les manuels de FLE, on doit également tenir compte de la dimension sérielle et du nombre de cases dessinées, avec plusieurs cas de figure:
- Des BD allant de une à trois vignettes pour illustrer et faire comprendre un contenu: dans ce cas, l’utilisation de dessins fabriqués est omniprésente, mais cette proportion diminue à mesure que l’on progresse dans les niveaux de langue. La BD fonctionne alors comme support et illustration d’un discours autre: celui de la méthode. Les dessins authentiques de ce type, beaucoup plus rares dans notre corpus, s’apparentent au dessin de presse, souvent satirique, mettant l’accent sur la dimension critique ou humoristique.
- Des séquences de BDA tronquées, sous forme de vignettes sorties de leur contexte: dans cette configuration, on peut se demander si l’on est encore en présence d’un document authentique. Les planches complètes sont très rares.
- Une ou deux pages de BDA: ce type d’usage s’observe rarement dans les manuels, la BD étant considérée comme un objet discursif en tant que tel. L’activité est alors rangée dans les objectifs socioculturels des manuels3.
Mais que recouvre exactement le terme de «bande dessinée» quand il est utilisé dans le cadre de la didactique du FLE? Dans une perspective historique, nous avons eu recours aux deux principaux dictionnaires francophones de didactique des langues. Dans celui de Cuq (2003), il n’y a pas d’entrée BD. Dans celui de Galisson & Coste (1976), on trouve une page consacrée à la bande dessinée et deux pages concernant l’image (à l’époque, les méthodes audiovisuelles dominent encore et utilisent systématiquement une certaine forme de BDF, comme on le verra). La définition proposée est la suivante:
Mode d’exposition d’une histoire (encore appelée «figuration narrative») au moyen de dessins accolés en bandes, qui se lisent de gauche à droite et de haut en bas, comme l’écriture, et qui représentent des étapes successives de l’histoire. (Galisson & Coste 1976: 64)
Plus loin, il est fait allusion à la dimension cognitive de la lecture de BD:
Pour rétablir la continuité d’un dessin à l’autre, le lecteur doit mentalement «boucher les trous». Les paroles du personnage qui parle s’inscrivent généralement dans une bulle (appelée "phylactère") reliée à sa bouche et contenu dans l’image. (Galisson & Coste 1976: 64)
Sont mentionnés ensuite rapidement les «procédés graphiques» et les «divers codes» qui expriment «les éléments prosodiques» et «les valeurs affectives du langage». Dans la rubrique Remarques, les auteurs opèrent une distinction (sans employer le terme de «document authentique») entre les BD construites à des fins pédagogiques et les «bandes dessinées du commerce». Pour ces dernières, les auteurs remarquent que leur «utilisation immédiate» est «pratiquement impossible», sans toutefois expliciter les raisons de cette impossibilité. Nous y reviendrons. Notons cependant qu’entre 1976 et aujourd’hui, le statut culturel et didactique de la BDA a beaucoup évolué dans les milieux de l’éducation (cf. Rouvière 2012), en même temps que ses formes d’expression et ses publics se sont diversifiés (Berthou 2017).
L’objet de notre recherche étant ainsi plus ou moins circonscrit, il nous faut maintenant préciser notre méthodologie de recherche. Il s’agissait d’effectuer une analyse qualitative des supports BD dans un corpus de 33 manuels de FLE pour adultes et grands adolescents, de niveau A1 à C1. Le choix des ouvrages visait à offrir un échantillonnage significatif de manuels souvent considérés comme représentatifs de leur époque et couvrant un siècle d’enseignement (1919 à 2020). Pour étudier ce corpus, nous avons envisagé plusieurs questions de recherche: quel est le rôle joué par la BD (BDA et BDF) dans les manuels? comment est-elle utilisée et dans quel but? son usage varie-t-il en fonction de l’époque et des évolutions méthodologiques?
En observant les manuels, on peut ainsi attester, par des exemples concrets, de certains usages différenciés de la BD selon les époques, sans que ce corpus restreint nous autorise à produire une représentation statistique de l’ensemble de ce qui s’est produit dans le monde francophone. Disposant actuellement de peu de publications théoriques sur ce sujet, il demeure ainsi difficile d’avoir une vision d’ensemble du phénomène. La BD, apparemment, a peu intéressé les didacticiens4, soit parce son exploitation a été considérée comme problématique (cf. l’«impossibilité» évoquée par Galisson & Coste), soit à cause de l’influence des représentations que l’on se fait de ce médium (la réputation de manque de sérieux qui s’attache encore à la BD), soit encore pour d’autres raisons, que nous serons amenée à discuter plus loin.
Nous allons présenter les résultats de notre analyse en lien étroit avec l’évolution historique des méthodologies d’enseignement du FLE5. Nous distinguerons deux époques, celle d’avant les années 1980, avec les méthodes directes, mixtes, audiovisuelles et audio-orales, et celle postérieure, avec les méthodes communicatives et actionnelles. Dans la première période, on ne trouve pas de BDA dans les manuels de FLE, mais on constate cependant une évolution de la fonction attribuée à la BDF en fonction des méthodologies.
Avant 1980: dessins fabriqués uniquement
Méthode Directe
Le dessin est présent dans les manuels les plus anciens de notre corpus, qui relèvent de la Méthode Directe. C’est une des caractéristiques importantes de cette méthodologie novatrice apparue à la fin du XIXe siècle. Le dessin devient un élément décisif de la leçon, en permettant un accès «direct» au sens, il évite de passer par la traduction. Il présente des situations, des objets, il sert aussi à l’apprentissage des structures, à travers des activités de description des images et des exercices questions/réponses liés aux dessins.
Dans Le français pour tous (1919), par exemple, on voit pour chaque leçon l’adoption systématique d’un dessin muet qui fonctionne comme décor, mais aussi comme support pour les actions et les interactions dans la classe.

Figure 1 Le français pour tous (1919: 2)
On trouve également dans certains manuels une ébauche de bande dessinée (telle que définie plus haut), sous la forme de dessins alignés sans paroles. Un exemple particulièrement intéressant est reproduit dans Puren (1988), pour un cours d’allemand pour débutants. Les dessins y suggèrent l’idée d’action pour l’enseignement des conjugaisons du présent. L’emploi de la BD souligne ainsi l’aspect performatif des verbes et de la langue (le Faire) et sert de guidage pour les exercices. La dimension dynamique de la langue est suggérée par le mouvement représenté par la succession des images.
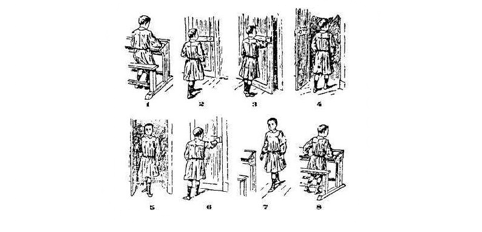
Figure 2 Cours d’allemand. Grands commençants (1923: 49)
Ces exemples relèvent ainsi d’une fonction d’illustration de la situation et des éléments de la leçon. Ils ont pour points communs d’intégrer un contexte, de faciliter l’accès au sens, de mettre l’accent sur le sens et la dynamique de la communication6, en favorisant la dimension praxéologique de la communication: cela permet de travailler l’emploi des verbes, les suites d’actions, le mouvement, le mime, le dialogue.
Méthode mixtes (traditionnelles)
La méthodologie Directe a représenté une rupture dans l’enseignement des langues en Europe, elle fonctionnait sans recours à la langue maternelle, sans explications grammaticales, et d’abord à l’oral. Trop révolutionnaire pour l’époque et abandonnée dès les années 1920-1930, cette option méthodologique a laissé des traces dans les manuels de FLE dits «mixtes» des années suivantes, qui reviennent à une méthodologie plus ancienne, «traditionnelle», en gardant l’influence des méthodes directes: davantage de dessins, pas de traduction, davantage d’oral, etc. On y voit l’apparition de personnages dessinés, très stéréotypés, comme par exemple, dans cette méthode célèbre des années 1950-1980, le Cours de langue et de civilisation françaises,communément appelée le Mauger bleu, où les dialogues sont supposés être tous prononcés par deux familles.
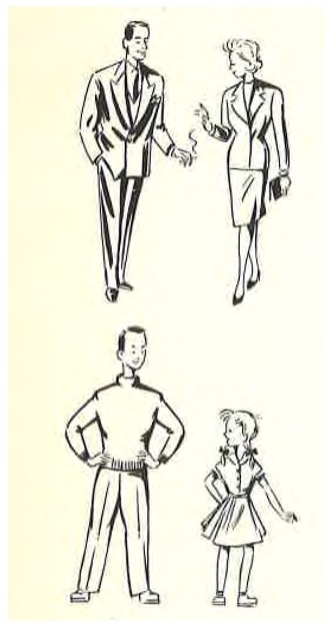
Figure 3 Cours de langue et de civilisation françaises 1 (1957: 72)
Méthodes audiovisuelles et audio-orales
Toutefois, une nouvelle forme de BD apparait dans les années 1950 au sein du courant des méthodes audio-visuelles et audio-orales: la présentation systématique de «bandes dessinées»7 avec des phylactères qui reproduisent les répliques orales (et audio) des personnages. La BD est associée au son comme adjuvant pour la compréhension et la mémorisation «en situation» (en contexte); elle est également un support pour des exercices structuraux.
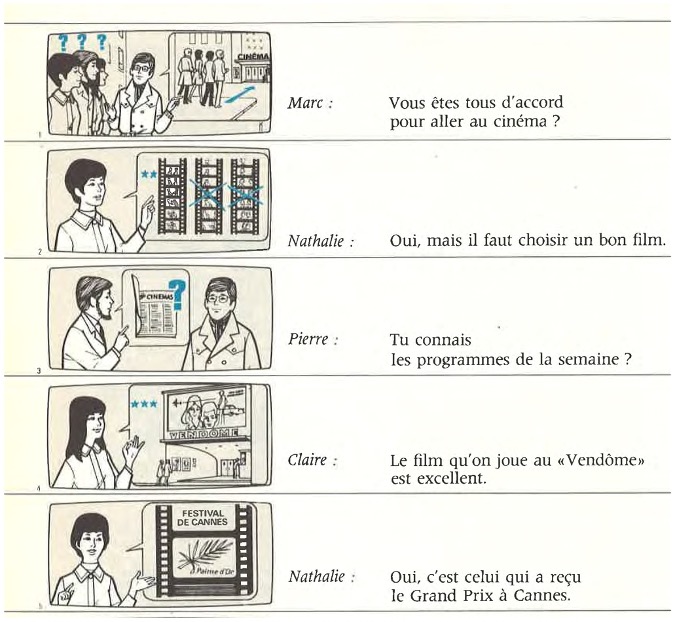
Figure 4 La France en direct (1971: 66).
L’image prend un rôle très important, elle est un objet de débats au sein de la communauté scientifique8 et se caractérise assez vite par des règles strictes:
- Une image pour chaque réplique du dialogue central de la leçon (en cas de passage monologué, les énoncés sont morcelés en petits groupes rythmiques).
- L’image doit apparaitre avant le son (le texte du dialogue n’étant pas visible au début).
- Les phylactères sont souvent représentés par des cercles ou des rectangles pouvant contenir des pictogrammes divers, de nouveaux dessins, des marques de ponctuation et du texte «dessiné».
Ainsi, on plaque une image codée sur un énoncé oral: cela fonctionne sur l’illusion qu’on peut transcoder la langue en segments imagés fixes. De fait, on peut douter que l’image favorise vraiment la compréhension. Cela convient plus ou moins bien pour le niveau débutant avec une langue simplifiée, artificielle et débarrassée des caractéristiques de l’oral authentique. Mais cette médiation crée des problèmes d’interprétation dès que l’énoncé est un peu plus complexe, comme dans l’image suivante.

Figure 5 La France en direct (1971: 66).
Dans le guide méthodologique du manuel, l’image fait l’objet de plusieurs commentaires significatifs: elle «doit communiquer tout le contenu de sens» (1971: 5). Pour ce faire, précisent les auteurs, elle doit obéir à certaines contraintes:
- - il faut privilégier l’image dessinée à la photo, car elle est «plus sélective, plus lisible et plus facile à structurer»;
- - la schématisation du dessin «ne doit cependant pas nuire à l’authenticité culturelle»;
- - la couleur doit remplir un «rôle fonctionnel et non décoratif».
(La France en direct, 1971: 5)
Parmi les conventions, on mentionne les «bulles», qui sont là, nous dit-on, «pour représenter la pensée». On peut trouver curieux d’associer les phylactères à la pensée et non à la langue, et du reste, bien que les images soient surcodées, les problèmes d’interprétation apparaissent inévitables. On constate les mêmes problèmes dans une autre méthode parue la même année, que l’on doit encore à Gaston Mauger. Issue du Mauger bleu (donc d’une méthode mixte, mais influencée cette fois par la méthodologie audiovisuelle), Le Français et la vie (1971) est un manuel utilisé à l’Alliance Française, et dans le passage qui nous intéresse, nous pouvons «lire» un dialogue «de 20 répliques, illustrées chacune par un dessin expressif et simple, où le personnage qui parle est cerné d’un trait gras» (1971: V). On peut apprécier diversement ces qualités dans l’illustration ci-dessous, où l’accès au sens est loin d’être immédiat (M. Roche: Tout cela est très intéressant).

Figure 6 Le Français et la vie (1971: 218)
On voit que ce type d’usage de la BD se heurte aussi à la difficulté de représenter le langage abstrait, même quand l’énoncé est simple du point de vue syntaxique. Le problème est omniprésent dans la méthode et repose sur une deuxième méprise: l’illustration est supposée faciliter l’accès au sens, qui deviendrait transparent et rapidement accessible. On voit dans l’exemple suivant l’impasse que peut représenter a posteriori cette codification iconographique du discours9.
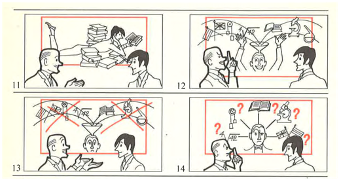
Figure 7 Le Français et la vie (1971: 220)
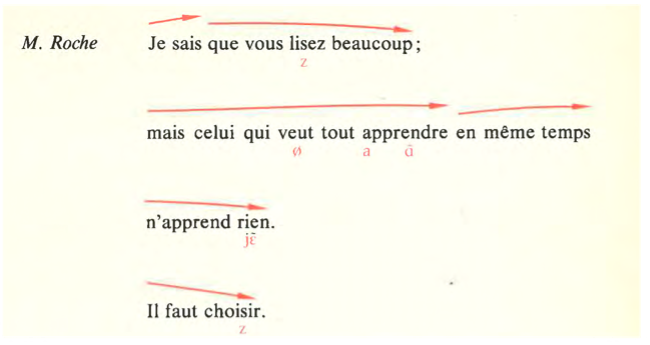
Figure 8 Le Français et la vie (1971: 221)
Au fil du temps, les méthodes audiovisuelles et audio-orales ont évolué dans leur manière de présenter les dialogues. Les BD se modifient progressivement et sont associées à plusieurs répliques, puis à la situation entière (une seule image par dialogue) et vers 1980, elles peuvent renvoyer à une multiplicité de dialogues et de situations, présentées dans chaque unité du manuel. On est là à une charnière importante en didactique du FLE, dont on peut donner deux exemples.
Dans la méthode audio-orale tardive Le Français par objectifs (1980)10, les bulles ont disparu et le texte du dialogue est présenté sous l’image, qui montre les locuteurs en interaction (ou bien représente le contenu illustré de leurs propos). On voit qu’une image peut concerner deux répliques et que la couleur est utilisée de manière réaliste. Surtout, cette méthode présente les premières BDA de notre corpus. C’est là sans doute l’influence de l’époque, qui voit la légitimité culturelle de la BD s’affirmer de plus en plus, en même temps que se renforce la mode des documents authentiques dans le champ de la didactique des langues étrangères. Mais les principes méthodologiques structuralistes de la méthodologie audio-orale restent les mêmes: les documents sont exploités comme supports à des fins linguistiques, notamment par des exercices structuraux. On y trouve par exemple une BD muette de Sempé, complète mais accompagnée d’un dialogue (fabriqué) racontant l’histoire représentée par le support, ainsi que d’un récit écrit, qui serviront de base à toute une série d’activités linguistiques.
Exemple de consignes: «Travaillez à deux. L’un pose les questions avec le livre ouvert et l’autre répond à l’aide des images. Ensuite, changez de rôle. Finalement, refaites l’exercice uniquement avec les images» (Le Français par objectifs, 1980: 174). Les questions à poser servent à vérifier la compréhension du récit fictif qui accompagne la BD. Puis on demande de faire l’exercice par écrit. Il s’agit d’un bon exemple de ce qui se faisait dans les méthodes structuralistes des années 1950-80: la BD est ici considérée comme une série d’images séparées venant illustrer un enregistrement audio et servant de base à l’enseignement, lequel repose sur une série de questions/réponses visant à vérifier la compréhension, sur une transformation syntaxique, sur des changements énonciatifs (de «je» à «il»), etc. La consigne, qui exige parfois de travailler «uniquement à l’aide des images», montre aussi le rôle de l’illustration comme soutien au travail en autonomie en sous-groupe et comme outil de mémorisation. En fin de compte, cette méthode audio-orale tardive pourrait être cataloguée comme une méthode mixte (audio-orale et communicative).
Le deuxième exemple de méthode «charnière» est représenté par Archipel (1982), qui est souvent considérée comme la dernière méthode audiovisuelle et la première méthode communicative pour le FLE. Sa première unité (niveau débutants) commence par une BD pour illustrer une partie d’un dialogue présenté plus tard dans l’unité. On voit dans l’illustration que le contexte a gagné en importance: l’attention est portée sur la situation socioculturelle, les détails sont travaillés, les personnages sont plus réalistes. Les bulles sont remplacées par un encadré présentant la réplique d’un personnage. La mise en page est aussi très différente des anciennes méthodes audiovisuelles, avec un grand phylactère de forme géométrique au milieu de la page, représentant une scène illustrée.
On remarque que le manuel porte une attention toute particulière à l’illustration et qu’il intègre de nombreux documents authentiques, en majorité écrits ou visuels. Dans Archipel 2, paru en 1983, apparaissent les premières BDA : au nombre de cinq, elles sont toutes complètes, non destinées aux enfants, produites par des auteurs célèbres (Bretécher, Sempé, Bosc, Reiser) et sont en majorité classées dans les suppléments aux leçons. L’aspect ludique et culturel est privilégié et aucun travail particulier n’est demandé aux apprenants. Sur cette marginalisation au début des années 1980, nous faisons l’hypothèse d’une influence des recherches en didactique des langues étrangères de l’époque (le Dictionnaire de didactique est publié en 1976), car nous avons vu qu’on y présentait l’exploitation de la BDA comme impossible. On verra en effet qu’elle sera réservée dans un premier temps aux suppléments culturels des manuels.
Pour tirer une synthèse de cette première partie, rappelons que le principe de la BD est de représenter par l’image une suite d’actions d’un même personnage. Les BD sont donc bien présentes dans les manuels, mais elles sont éloignées des productions authentiques. À l’origine de ces illustrations fabriquées pour l’enseignement de la langue étrangère, on trouve une nouvelle méthodologie, la Méthode Directe, qui confère à l’image une fonction illustrative, facilitant l’accès au sens, ainsi qu’une fonction performative, comme déclencheur d’actions langagières et support à la mémorisation. Avec l’arrivée du son, on trouve une nouvelle méthodologie, la méthode audiovisuelle, dotée d’une vision structuraliste du langage, qui a pour effet de découper la langue en petites unités visant à atteindre idéalement (mais, dans les faits, elle y parvient assez rarement) une correspondance univoque entre image, son et bulle. Il faut attendre les années 1980 et l’arrivée de l’approche communicative pour observer l’usage plus récurrent des BDA.
Depuis 1980: dessins fabriqués et authentiques
Approches communicatives
Avec l’émergence des méthodes relevant de l’approche communicative, on observe un engouement pour le document authentique, une ouverture aux genres les plus divers et aux supports multimodaux, qui s’accompagnent d’une mise en avant de la dimension socioculturelle des discours. Concernant la BD, on peut distinguer deux tendances dans cette nouvelle approche. D’un côté, on observe l’introduction timide de la BDA à des fins d’enseignement de la langue et de la culture. D’un autre côté, on constate l’introduction massive de séquences de BD fabriquées pour un usage didactique, à des fins d’enseignement de la langue: vocabulaire, registres de langue, grammaire de l’oral et de l’écrit, grammaire textuelle, actes de parole, production orale et écrite, et surtout, la BDF comme aide à la compréhension.
Dans cette partie, nous limiterons nos commentaires aux BD dites authentiques, tronquées ou non. Nous avons cherché à savoir quelles étaient les fonctions de la BDA dans les manuels post 1980, en nous appuyant sur les données de notre corpus et sur les recherches existantes. Or, à notre connaissance, il existe très peu de publications sur le sujet, à part quelques articles isolés. Le seul ouvrage théorique consacré à la BD dans la classe de FLE et destiné aux enseignants est un livre qui vise à exploiter le dessin de presse satirique. Ce manuel publié en 1987 et rédigé par Annette Runge et Jacqueline Sword est intéressant parce qu’il donne accès aux représentations de l’époque: on y trouve des conseils et des suggestions d’activités représentatives de l’approche communicative. Les autrices proposent ainsi quatre pistes d’utilisation du dessin humoristique (Runge & Sword, 1987: 5):
- - Montrer «simplement» des dessins qui ont un thème proche de celui de la leçon «dans un esprit de détente»: il s’agit là de la fonction «décorative» de la BD que nous avons retrouvée dans les méthodes 1980-90 analysées. Dans ce cas, une seule vignette peut suffir à illustrer le sujet traité, sans consignes.
- - Faire «ressortir les éléments de civilisation» et «analyser les clichés qui en découlent»: cette fonction de supplément culturel est aussi largement présente dans les manuels que nous avons observés, qu’ils relèvent de l’approche communicative ou actionnelle.
- - Faire décrire le «contenu» de la BD, c’est-à-dire produire du discours dans un but linguistique et non pas communicatif: les auteurs précisent que c’est une activité «très artificielle si tous les apprenants ont le dessin sous les yeux». Pourtant, cet usage de la BD est très souvent proposé dans les activités des manuels de notre corpus.
- - Supprimer la légende ou la bulle pour les «faire imaginer» par l’apprenant. À nos yeux, il s’agit là encore d’une réduction de l’exploitation de la BD à une fonction linguistique: le support authentique est modifié pour faire produire un certain type de discours, plus ou moins contraint selon les objectifs de la leçon.
Les autrices proposent un tableau instructif des différentes possibilités de didactisation. De toute évidence, il montre un parti pris d’instrumentalisation de la BD à des fins pédagogiques.
.png)
(Runge & Sword 1987: 9)
En parcourant de manière plus transversale notre corpus, nous sommes parvenue à dégager une typologie des usages de la BDA dans les méthodes communicatives en considérant en particulier le rôle décisif des consignes qui accompagnent les supports visuels, orientent la lecture du document et conditionnent l’activité de l’apprenant. Nous proposons de distinguer ces usages en les corrélant à quatre fonctions différenciées11.
A. Fonction illustrative (ou décorative): la visée est de comprendre;
B. Fonction performative à visée linguistique ou textuelle: la visée est de faire;
C. Fonction informative: le but est de s’informer, de s’acculturer;
D. Fonction créative: le but est d’imaginer et de produire.
A. La fonction illustrative était déjà à l’œuvre dans les manuels d’avant 1980 avec les BD fabriquées. Il s’agit aussi de favoriser l’accès au sens dans des conditions de détente. De la planche complète à la case unique, les BDA accompagnent par exemple le thème de la leçon. Dans la Grammaire des premiers temps 1 (1996; 2014), les autrices utilisent une planche de Reiser pour illustrer, sur un mode comique, la notion de pronoms possessifs. Aucun travail particulier n’est demandé à l’apprenant, il n’y a pas de consignes, la fonction décorative et illustrative est ainsi exploitée systématiquement à chaque début de leçon.
B. La fonction performative à visée linguistique est une des catégories les plus répandues. Il s’agit de faire produire des éléments de la langue. Le manuel L'Exercisier (1980: 154) propose par exemple un travail sur l’acte de parole «proposer12», à partir d’un extrait de deux cases de Pétillon. Les consignes orientent l’apprenant d’abord vers la lecture des bulles: «Observez les vignettes suivantes. De quelle façon les personnages expriment-ils leurs propositions?». Les bulles en question présentent deux réalisations différentes du même échange d’actes: proposer / répondre. Puis l’apprenant est prié de produire oralement des actes de proposition: «À votre tour, faites des suggestions.»
Par ailleurs, les manuels qui exploitent des BD muettes le font tous avec une visée linguistique. Sempé semble être le dessinateur le plus fréquemment mobilisé. On trouve par exemple, dans le manuel précité, une BDA associée à la consigne suivante: «Racontez cette bande dessinée en utilisant le maximum de verbes pronominaux.»
La fonction performative à visée textuelle permet de travailler sur les aspects discursifs des documents, par exemple quand il est demandé de reconstituer l’ordre original des vignettes. On le voit notamment dans le manuel Studio+ (2004: 52) avec des cases de Tintin que l’on demande de mettre dans l’ordre chronologique en justifiant son choix13.
C. Pour la fonction informative, les BDA dans les manuels s’orientent en majorité vers la constitution d’un apport socioculturel pour l’apprenant, qui témoigne du gain de légitimité de cette forme d’expression, en particulier dans le contexte de la langue-cible. Des éléments culturels associés à la BD franco-belge sont ainsi pris en compte dans certains manuels. Par exemple, dans le manuel Rond-Point 2, trois personnages de BDA, dont Gaston Lagaffe, font l’objet d’un éclairage dans le supplément culturel «Regards croisés», qui est présenté dans l’introduction du manuel comme le réservoir «des "échantillons" de culture» (2004: 74-75). Dans ce cas, c’est bien l’aspect socioculturel qui est mis en avant, sans qu’un travail à but linguistique ne soit demandé: la consigne est d’observer les personnages et de dire si on les reconnait (ce qui relève de la compétence socioculturelle).
D. On peut enfin exemplifier la fonction créative en citant le manuel À propos (2005: 133), qui présente une planche de Bretécher où des convives discutent à table. La consigne «Vous avez été acteur de cette scène, racontez» nécessite de la part de l’apprenant l’adoption d’un point de vue différent et nouveau sur la discussion des personnages, ainsi que la production d’un discours narratif; la BD est ici un support pour l’imagination et la recréation, ainsi qu’un moteur de créativité langagière: il faut être «acteur», c’est-à-dire être dans l’Agir14.
Parmi ces différents usages de la BD dans les manuels de FLE post 1980, en lien avec l’évolution des méthodologies d’enseignement, deux hypothèses peuvent être émises. Premièrement, la dimension textuelle spécifique à la BDA nous semble être importante et favorable à l’apprentissage «par les genres». Il s’agit de dégager les effets qui produisent du sens et suscitent des réactions chez les lecteurs (notamment par l’esthétique et la construction de la planche) et de s’interroger sur les différents niveaux de lecture du document. On peut poser, par exemple, la question du «pourquoi est-ce que c’est drôle?» ou interroger les blancs entre les cases, ces questions visant à amener l’apprenant à une observation attentive de la BD. Deuxièmement, ces différentes fonctions peuvent évidemment se combiner dans une approche plus ou moins intégrée, en tenant compte du genre discursif spécifique et de ses caractéristiques propres. Ainsi, la fonction créative, qui agit comme déclencheur de l’imagination, nous semble pouvoir être intégrée avec profit aux autres fonctions.
Afin de montrer plus précisément la manière dont la BDA est didactisée respectivement dans les méthodes communicatives, puis actionnelles, nous allons maintenant reprendre cette catégorisation des fonctions de la BDA pour décrire les manuels de notre corpus. Nous rappelons que l’emploi de ce médium reste rare, parfois absent dans les niveaux destinés aux débutants. Nous relèverons, parmi ses occurrences, les propositions pédagogiques qui nous semblent justifiées par la spécificité de ce genre de discours.
Les fonctions de la BD dans les méthodes communicatives:
- - Fonction illustrative: sur un plan quantitatif, les BDA sont rarement utilisées pour illustrer ou faire comprendre des éléments de la langue, cette place étant prioritairement occupée par les BDF, très nombreuses et quasi-systématiques dans certains manuels.
- - Fonction performative à but linguistique: elle est largement mise à l’œuvre dans les rares BDA des manuels et concerne la production de tous les aspects linguistiques de la communication, mais surtout la grammaire et les actes de parole (représentatifs de l’époque). La BDA est prétexte à la production orale ou écrite, les consignes impliquent de reformuler, raconter et imiter.
- - Fonction performative à but textuel: le souci de traiter la BDA par le genre (discursif) apparait dans les années 1990 dans notre corpus, ce qui coïncide avec l’arrivée de la grammaire textuelle dans l’enseignement du FLE, sous l’influence des recherches sur l’enseignement de la langue maternelle. D’autre part, et sous l’influence également des recherches en didactique du FLM, on assiste dans les années 1970-80 à la naissance de nouveaux modèles en lecture (modèle bottom-up, lecture globale, etc.) avec notamment, en FLE, la lecture «interactive» (voir Cicurel 1991). Dans ce dernier contexte, on considère que le sens se construit dans l’interaction entre le texte et le lecteur, ce qui nous semble d’autant plus vrai pour la BD.
- - Fonction informative: la majorité des BDA rencontrées dans les manuels communicatifs est réservée aux suppléments culturels, en lien avec d’autres documents visuels authentiques.
- - Fonction créative: les BD muettes sont mises à contribution pour stimuler l’imagination et les BD «parlantes» sont souvent transformées (suppression du texte des phylactères, des récitatifs, suppression de vignettes, etc.).
On retrouve dans les BDA des manuels communicatifs les principales pistes de didactisation présentées par Runge & Sword à la même époque. Les activités recensées présentent des points communs et la BDA est non seulement exploitée dans un but linguistique et pragmatique, mais aussi, avec le développement de l’usage des documents authentiques, dans une visée socioculturelle. Il s’agit d’apporter des contenus multimodaux, de travailler sur la lecture d’images dans ses relations avec l’oral et/ou l’écrit.
Méthodes actionnelles
Malgré la profusion de documents authentiques, force est de constater que peu de manuels de FLE s’inscrivant dans le paradigme des approches actionnelles intègrent des activités autour de la BDA. La place du dessin a globalement diminué, pour laisser plus de place aux photos et aux textes, authentiques ou non, et les planches complètes sont rares. Malgré tout, il semble qu’on se dirige vers une légitimation de la BDA dans les manuels. Nous allons en montrer quelques exemples.
Tout d’abord, la BD semble à présent faire partie de la culture officielle. Dans les suppléments culturels ou les espaces «à lire et à découvrir», par exemple, les BDA sont traitées au même titre que les autres genres de documents authentiques. Il s’agit de donner «des informations qui vont vous permettre de mieux connaitre et comprendre les valeurs culturelles» (Rond Point 2, 2004: 5). La BD est ainsi explicitement revendiquée comme une valeur.
Dans le même ordre d’idées, la BD peut, de nos jours, être le sujet d’un article critique ou faire l’objet d’un débat. Dans Défi 4 (2020: 26), par exemple, l’une des deux activités recensées est une lecture présentant deux vignettes tirées d’une BDA ainsi que la photo de la couverture de l’album Mars horizon, comportant une référence bibliographique. Ces documents sont accompagnés d’un texte écrit (argumentatif), qui consiste en une critique positive de l’album en question. Deux consignes sont proposées avant de lire le texte. Elles doivent déclencher un échange sur les genres (mangas et BD d’aventures sont donnés en exemple): «Aimez-vous la bande dessinée? Si oui, quel genre de bande dessinée lisez-vous?», «Observez la couverture et la planche de bande dessinée. De quoi parle la BD?». On remarque aussi un petit encadré qui a pour effet de légitimer la BD comme valeur culturelle et fait de société: «Depuis 1974, le plus grand festival international de la bande dessinée d’Europe a lieu chaque année à Angoulême. Dans les rues, on voit des vignettes de bandes dessinées sur les murs.»
La BD peut aussi être comparée aux autres genres discursifs. Le manuel Tempo 2 (1997: 124) met côte à côte un extrait tiré d’un texte de Beaumarchais et une BD signée portant sur le même thème, la rumeur. La consigne demande à l’apprenant d’établir une comparaison entre les deux genres. Dans le texte littéraire, le cheminement de la rumeur est signifié par une succession de verbes juxtaposés («s’élance, étend son envol, tourbillonne, enveloppe, arrache», etc.), alors que dans la BD, le dessinateur J.-M. Renard représente graphiquement la rumeur dans la succession des cases par l’augmentation du volume des bulles, par la modification du lettrage, l’allongement des syllabes, etc. La consigne renvoie explicitement au médium graphique, en contraste avec le médium littéraire: «Regardez la bande dessinée et dites si elle illustre ou non le texte.» Elle induit un travail en profondeur sur les caractéristiques spécifiques du médium BD15.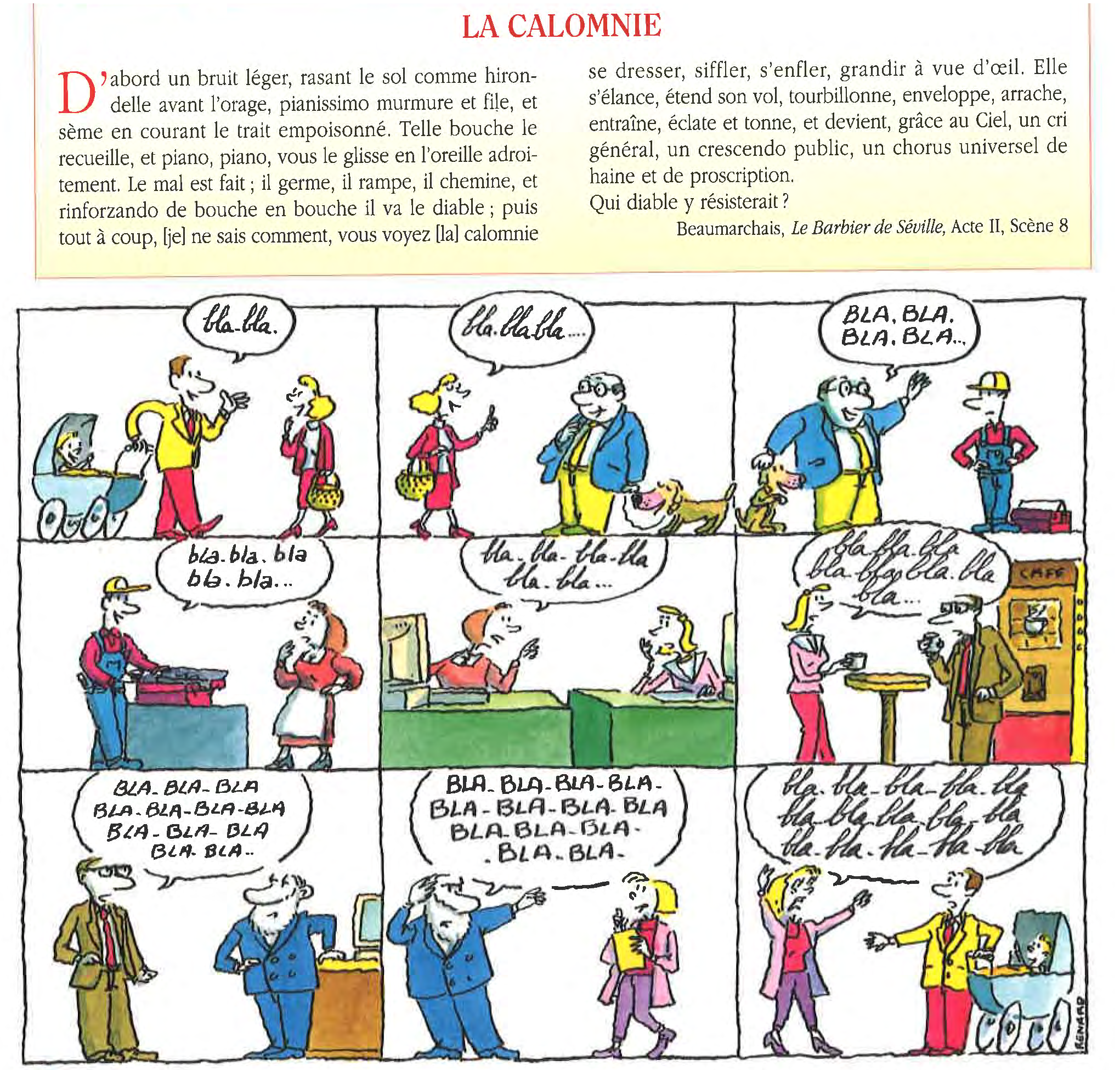
Figure 9 Tempo 2 (1997: 124)
La BD peut même être intégrée à d’autres genres, ce qui constitue un signe supplémentaire de légitimation. On le voit clairement dans une activité du manuel Alter ego 4 (2007: 110), qui intègre un extrait de trois vignettes d’une planche de Bretécher, à l’intérieur d’une séquence visant la production d’une synthèse à partir de cette BD et de deux autres documents écrits. Il est intéressant de noter que dans cette activité de synthèse, le document BD semble présenter la même légitimité que les deux autres, qui sont référencés et datés de la même manière. Le support de la BD est thématisé comme tel dans un tableau à remplir, ce qui le met sur un pied d’égalité avec des articles de la presse écrite. Ainsi, même si le manuel n’exploite pas beaucoup le médium, il participe à sa légitimation progressive dans un travail d’apprentissage du FLE dit «sérieux».
Enfin, on voit apparaitre des BD fabriquées et généralement anonymes, mais qui deviennent pratiquement indifférenciables des BDA. On peut lire paradoxalement, dans l’apparition de ces BD produites à des fins d’enseignement, un signe de légitimation du médium, car les planches se réfèrent ostensiblement aux codes visuels de la BD «du commerce». On remarque d’ailleurs l’usage explicite du mot «bande dessinée» dans les consignes, comme dans le manuel Activités pour le cadre commun B1 (2006: 32): «Observez la bande dessinée. Racontez ce qui s’est passé. Imaginez ce qui a pu se passer ensuite.» Suivent des détails sur la manière de construire son récit, que nous reproduisons ici parce qu’ils sont représentatifs d’un travail sur BD souvent demandé aux apprenants: raconter une BD muette (dans sa forme originale ou bien présentée dans une version où le texte des phylactères a été masqué).
Vous pouvez:
- - situer l’évènement: quand, où, dans quelles circonstances s’est-il produit?
- - décrire le personnage principal,
- - dire comment il vous apparait: inquiet, irréfléchi, courageux …
- - décrire les différentes actions et les réactions –surprenantes, inattendues, exagérées, ou naturelles– qu’elles ont provoquées,
- - imaginer une fin … heureuse?
(Activités pour le cadre commun B1, 2006: 32)
Le but est clairement linguistique, puisqu’il s’agit, comme bien souvent, de faire produire un discours narratif au passé ou au présent. Néanmoins, le médium est maintenant reconnu comme un genre spécifique de document écrit, digne d’intérêt et d’apprentissage, bien que dans ces manuels, les activités ayant comme support des BDA non modifiées restent rares, même aux niveaux avancés. Par ailleurs, nous n’avons observé que deux activités visant à familiariser l’apprenant avec la terminologie spécifique au genre, notamment dans Défi 4 (2020: 97), avec un exercice de vocabulaire («s’approprier les mots»), où la consigne demande de légender une planche de BDF avec les étiquettes appropriées («bulle», «case», etc.). L’objectif est de fournir des outils de base pour travailler avec la BD, ce qui parait essentiel. Pourtant, cette terminologie semble aller de soi dans les autres manuels, où elle n’est jamais explicitée.
En reprenant notre proposition de typologie, voici à présent les résultats pour les méthodes actionnelles de notre corpus.
- - Fonction illustrative: cette fonction semble avoir diminué dans les manuels actionnels et ce sont davantage les photos qui remplissent le rôle d’accès au sens.
- - Fonction performative à but linguistique: cette fonction est toujours majoritaire. Comme on vient de le voir, des BDF imitant les codes des BDA sont apparues à des fins de production de discours, notamment de genre narratif. Tout dépend alors de la qualité de l’imitation: on observe ainsi parfois des activités où la médiocrité du support fait obstacle à son exploitation sur le plan graphique et visuel. Dans le manuel Version originale 3 (2011: 93). par exemple, on trouve une seule apparition explicite d’une «BD» (non signée), manifestement fabriquée pour travailler sur le discours rapporté. Ici, le support BD n’apporte rien, avec peu d’indices contextuels, très peu d’expressivité, un lettrage qui relève des normes de l’écrit imprimé, sur lequel le lecteur se focalise. Cette BD sert seulement à faire produire une narration orientée vers un but grammatical.
- - Fonction performative à but textuel: on voit rarement (moins d’une dizaine d’occurrences dans le corpus de manuels relevant de l’approche actionnelle) l’apparition d’activités prenant en compte les spécificités du langage de la BD. Le manuel Connexions 3 (2005) par exemple, offre quatre ou cinq exploitations de BDA. L’approche est intégrée: les spécificités du médium sont prises en compte (en tant qu’objet discursif, mais aussi linguistique et socioculturel), c’est le cas par exemple, dans une double page autour d’une planche de Cabu, dans la partie Arrêt sur Image (2005: 50-51). L’activité proposée consiste en une série de questions portant sur le support, et elle intègre un travail sur la lecture d’images: lien entre texte et dessins, informations apportées par le dessin, repérages lexicaux dans les bulles, introduction du lexème beauf avec recours au dictionnaire, inférences culturelles, etc. On trouve par exemple les questions suivantes: «Où se trouve le personnage dans chaque image? Quelles sont les informations qui permettent de le savoir?»; «Quelle est l’importance du texte par rapport aux images?»; «Peut-on regarder les images et comprendre l’histoire sans lire le texte? Peut-on lire et comprendre le texte sans regarder les images?»
- - Fonction informative: la BD devient un objet culturel plus légitime, mais il est encore souvent réservé aux suppléments civilisationnels des manuels. Certaines activités prennent pour thème la BD et ses différents genres, mais on se retrouve devant un paradoxe: le médium BD est maintenant reconnu comme un genre spécifique de document écrit, digne d’intérêt et d’apprentissage, mais il est peu utilisé comme outil d’enseignement. Notons que dans le manuel Alter ego 3 (2009), où l’on trouve très peu de dessins et pas de BDA, le genre n’a pas d’entrée dans «l ’abécédaire culturel» du manuel, qui traite néanmoins, à travers l’entrée «caricaturistes», du dessin de presse.
- - Fonction créative: quelques innovations pédagogiques dans les manuels actionnels nous semblent des pistes intéressantes à creuser. Ce sont généralement des activités qui combinent plusieurs des fonctions que nous avons définies dans une approche intégrée. Nous allons terminer notre réflexion sur des exemples relevant de cette optique.
Pistes pour une approche intégrée exploitant la fonction créative de la BD
Créativité lexicale
Les onomatopées peuvent servir de prétexte à l’invention de nouveaux mots, mêlant ainsi la fonction performative à but linguistique et la fonction créative de la BD, comme dans cette activité de vocabulaire du manuel À propos (2005: 79), où l’on présente des vignettes isolées (sans doute fabriquées, comportant toutes des onomatopées en gros plan) regroupées sous un thème commun: on a choisi de présenter non pas une BDA, mais un des traits caractéristiques de la BD (les onomatopées), comme déclencheur d’imagination et de créativité langagière. La consigne précise: «Choisissez une onomatopée, rajoutez un suffixe (Exemple: Tic Tac + eur = tictacteur / Tic Tac + logue = tictacologue») et ajoute: «Il ne vous reste plus qu’à définir cette nouvelle fonction!» On se sert ici d’une caractéristique importante de la BD – les onomatopées – pour inventer des mots et des définitions de ces mots; la BD combine dans ce cas toutes les fonctions, illustrative, performative, informative et créative.
Créativité narrative
Comme on l’a vu, les BDF qui imitent les codes des BDA visent des buts linguistiques et communicationnels, souvent liés à l’activité de «raconter». Dans Latitudes 3 (2010: 12-13), la seule occurrence d’une planche de BD présente une histoire fabriquée mais complète. Elle se rattache au genre de l’enquête policière, l’aspect graphique est soigné, l’ambiance imite un peu le style d’Hergé. L’aspect novateur dans cet exemple se trouve dans la tâche demandée: il s’agit de compléter le carnet du policier (le support inclut le dessin d’un carnet sur lequel on doit indiquer les détails de l’enquête) à partir de la lecture de la BD (travail de repérage et de synthèse des informations importantes pour l’enquête), puis de comparer ses notes avec un autre apprenant et de trouver qui est le voleur. On voit que la lecture d’images est surtout orientée vers la compréhension des phylactères et néglige, au moins au niveau des consignes explicites, les aspects graphiques (liens entre les images, cadrage, dessin, couleurs, etc.), mais cet exemple montre qu’il est possible d’imaginer, dans l’exploitation d’une BD en classe, des tâches interactionnelles de recherche et de partage d’informations, de comparaison et de synthèse, mettant en évidence une fonction créative que l’on peut associer à ce type de document.
Créativité graphique
La méthode actionnelle la plus récente du corpus Défi 4 (2020) présente une approche intégrée dans un dossier À découvrir sur la langue française (2020: 100). Les vignettes ont été séparées puis réalignées en surimpression, mais elles semblent figurer une séquence complète et la source est référencée. Les cases ont la particularité d’être dépourvues de décor (fond blanc) et de laisser une grande place au texte. La lecture du document «Des difficultés d’apprendre le français» est préparée par des «échanges» sur le thème, qui visent à faire émerger des idées qu’il s’agit de «retrouver» dans la BD; il s’agit d’abord de repérer des éléments de contenus. Suivent des questions de compréhension classiques sur le titre, le repérage des étapes, le lexique et son aspect culturel. Mais d’autres consignes présentent à nouveau des aspects spécifiques à la bd. La question 7, par exemple, renvoie au personnage dessiné de la dernière case avec ses spécificités graphiques: «est-ce que vous vous identifiez au personnage?».
La question suivante consiste en une tâche en binôme d’un genre nouveau: après un échange sur les difficultés de leur propre langue, les apprenants sont invités à «faire un dessin pour en illustrer une». On voit ainsi que, dans l’optique actionnelle, les tâches peuvent même aller jusqu’à adopter le code de la BD, non pas pour imiter ce dernier, mais pour exprimer une idée dans un nouveau cadre formel déjà établi. La proposition est courageuse quand on pense aux probables réticences des enseignants et des apprenants devant ce changement d’habitude. Mais n’est-ce pas là une manière d’aller jusqu’au bout de la logique praxéologique de la théorie actionnelle?
Créativité métacognitive
Pour terminer, nous souhaitons mentionner ici les manuels de Cartes sur Table qui occupent une place à part dans les méthodes de FLE. Publiés à la charnière des années 1980, ils relèvent bien de l’approche communicative et sont particulièrement centrés sur l’autonomie de l’apprenant. À plusieurs reprises, les auteurs ont fait appel à l’illustrateur Plantu, devenu célèbre en France en tant que dessinateur du journal Le Monde, où il a officié pendant 50 ans. L’objectif était de conscientiser des stratégies d’apprentissage sur la base d’une réflexion métacognitive autour des dessins.
Dans le manuel 2 pour les débutants, une première planche montre un personnage qui écoute un bulletin d’information météo à la radio sans rien comprendre; il fait des efforts, puis s’énerve, pour finalement saisir un mot-clé (pluie); tout content, il sort en prenant son parapluie. Cette activité sert aux apprenants d’un niveau encore faible à mieux comprendre comment écouter du discours, en portant l’attention sur ce qui est connu plutôt que sur ce qui est inconnu, etc. Les marques graphiques qui signalent l’affectivité sont mises en avant et l’écriture manuscrite dans les phylactères représente le discours de la radio du point de vue de l’apprenant: gribouillis, mots-clé, etc.

Figure 10: Cartes sur table 2 (1983: 36)
Le caractère authentique du document, ajouté au talent de Plantu, donne tout son intérêt à cette activité de réflexion sur les stratégies d’apprentissage, caractéristique de cette méthode plutôt avant-gardiste.
Dans le manuel niveau 2, un autre exemple nous semble encore plus significatif car il utilise aussi l’humour. La planche, qui comprend seulement deux vignettes occupant une page entière du manuel, est accompagnée de la seule consigne: «Regardez.» On peut imaginer une activité de lecture d’images mise en commun et un débat sur le texte et son statut, le changement de destinataire, la tyrannie de l’école, etc. Là encore, les qualités iconographiques du support favorisent un engagement de l’apprenant dans la tâche. Le changement de statut du texte est signifié par le changement de support (d’abord le poème rédigé sur un parchemin, ensuite il est inscrit dans une bulle) et le changement de lettrage, particulièrement expressif dans le phylactère.
Page suivante, une seconde consigne oriente la lecture sur un plan plus personnel: «Et vous? Pour apprendre le français, recherchez ensemble des genres de texte que vous pouvez utiliser "autrement" que dans l’idée de l’auteur.» Cette consigne est suivie d’un tableau à remplir en trois colonnes: «genre de texte» / «texte écrit pour…» / «texte lu pour…» avec un exemple manuscrit qui invite l’apprenant à s’engager personnellement.

Figure 11: Cartes sur table 2 (1983: 60)
L’activité prévue consiste ensuite à réfléchir sur les genres de textes, définis par leur but, mais aussi sur les stratégies d’apprentissage à adopter, à travers une mise en abyme où la situation d’apprentissage est thématisée: les textes sont instrumentalisés dans le but d’apprendre, comme la BD en classe de langue et comme celle de Plantu dans cette méthode particulière.
Avec cet exemple, on constate l’intérêt de recourir à une BD comme facteur de motivation et comme vecteur d’apprentissage langagier. Les personnages, le décor et tous les signes iconographiques contribuent à mettre en scène de manière très efficace les paramètres de la situation de production d’un discours, l’un écrit et l’autre oral, qui conditionnent sa réalisation aussi bien que sa réception.
A y regarder de plus près, on constate que les auteurs de ce manuel attachent beaucoup d’importance à l’illustration et utilisent une dizaine de dessinateurs différents (Plantu est le seul qui soit connu comme dessinateur de presse). Les BD relèvent-elles encore de la distinction entre document authentique et document fabriqué? En fait, la frontière entre BDA et BDF se neutralise. Déjà, Coste en 1970 relativisait la distinction:
«Authentique» – comme «libre» – entre dans la série de ces adjectifs valorisants, trop connotés pour être honnêtes, et parait opposer la pureté native du texte à l’obscure perversion de tout ce qui n’est pas lui. (Coste 1970: 88)
L’exemple de collaboration entre les auteurs de Cartes sur table et le dessinateur Plantu témoigne d’une réflexion approfondie sur ce qu’est l’apprentissage d’une langue dite étrangère. Pour avoir une chance d’intégrer efficacement la BD comme support d’enseignement, les collaborations de ce genre devraient être multipliées. A ce titre, le manuel Bulles de France occupe un espace à part dans notre corpus. En effet, c’est le seul ouvrage entièrement consacré à la BD, avec une orientation socioculturelle revendiquée, la méthode étant sous-titrée «Les stéréotypes et l’interculturel en BD». On y précise en quatrième de couverture que le dessinateur est l’auteur de plusieurs bandes dessinées. Les planches, rangées par thèmes, sont complètes et toutes du même format (une page), donnant lieu à des activités prévues pour les niveaux A1 à C2.
Dans l’introduction, les auteurs commencent par inventorier les différents avantages de la BD pour l’apprentissage des langues, en reprenant l’argument de la facilité de la compréhension: «Grâce à l’image, il [l’apprenant] peut construire sa compréhension par des hypothèses, en dépit des limites de son niveau linguistique.» Mais il est précisé aussi, en caractères gras, signe du débat toujours en cours, que les « planches proposées sont absolument inédites et authentiques », et qu’il «ne s’agit en aucun cas de textes et d’histoires fabriquées à des fins pédagogiques». L’insistance des auteurs à nier le caractère fabriqué des BD renvoie à la citation de Coste: le document fabriqué est utilisé comme repoussoir dans le méta-discours de promotion du manuel.
Force est de constater malgré tout que les planches manquent de variété, même s’il est vrai qu’on peut identifier un style, renvoyant à une forme d’auctorialité. Mais on s’aperçoit vite, à la lecture du manuel, que les aspects iconographiques sont assez peu mis en avant. Dans un premier temps, on demande d’observer rapidement la planche sans lire le texte, ou de lire le titre. Suivent les habituelles questions de compréhension, basées sur les parties écrites et les indices visuels. Une troisième partie «Imaginer / s’exprimer» peut porter sur le thème de l’unité, sur un point spécifique de vocabulaire ou sur la lecture d’une case particulière. Mais d’une manière générale, les consignes orientées vers les aspects iconographiques ou visuels sont minoritaires. Une partie «pour aller plus loin» apporte des informations socioculturelles (sur la société française uniquement) et un encadré lexical termine chaque unité. De fait, la lecture d’images est exploitée plus régulièrement (par exemple observer le geste d’un personnage ou son expression faciale) que dans les autres manuels du corpus. Mais dans un ouvrage dont le support est intégralement lié à la BD, peut-on se contenter de ce maigre rendement? Le manque de réflexion théorique sur la pédagogie de la BD en FLE se fait sentir dans cette tentative d’en faire un support de base de l’enseignement. Pourtant, le principe est exemplaire et mérite d’être approfondi. Des bandes dessinées des méthodes audiovisuelles aux Bulles de France, on mesure le chemin parcouru, même si beaucoup reste à faire.
Conclusion
Premier enseignement de notre recherche, à l’échelle de chacun des ouvrages que nous avons consultés, l’emploi de la BDA est rare, sinon rarissime: généralement une ou deux occurrences, jusqu’à cinq ou six dans certains manuels, sur des centaines d’activités proposées. Souvent tronquées ou modifiées, les planches présentées sont décontextualisées, les aspects graphiques sont négligés au profit d’un intérêt quasi exclusif pour le contenu des phylactères. Mais il arrive aussi que la BD soit présentée comme un objet culturel à part entière et elle est alors généralement rangée dans les suppléments culturels. On peut percevoir néanmoins des changements dans les usages pédagogiques de la BD, notamment dans les consignes et les tâches à effectuer, plusieurs innovations pédagogiques se dégageant au fil du temps et de l’évolution des méthodes. Il semble également clair que les représentations sur la légitimité culturelle de la BD, dans un contexte d’apprentissage scolaire ou universitaire, ont changé et continuent à se modifier: elle peut être non seulement un support à des activités linguistiques ou communicatives, mais elle peut aussi être étudiée (trop rarement) en tant qu’objet culturel ayant ses spécificités sémiotiques et discursives.
Dans le champ du FLE, on a assisté au cours du siècle dernier à une lente évolution qui conduit d’un usage presque exclusif de la BD fabriquée à la lente reconquête de la BD dite authentique. Autrefois utilisée pour l’accès au sens, la construction de schémas syntaxiques et la mémorisation, la BDF sert aujourd’hui surtout à illustrer les manuels. Depuis les années 1980, on utilise la BD issue de la presse satirique comme support à des fins d’apprentissage de la compétence de communication. Elle sert à faire comprendre, à faire produire ou à faire imaginer, en plus de son rôle d’apport civilisationnel. Elle progresse depuis lors avec une légitimation croissante, jusqu’à devenir le support exclusif d’un manuel complet en 2015.
Dans les vingt dernières années, on a vu apparaitre des activités prenant en compte les spécificités du genre, parallèlement au développement des recherches en linguistique textuelle et des approches didactiques par les genres. Il faudrait interroger ce phénomène en lien avec ce qui se passe en FLM dans la période récente16. Maintenant que la BD a gagné sa place dans l’enseignement de la langue / culture, des besoins énormes se font sentir en termes d’appareillage didactique pour l’exploitation en classe et en termes de formation des enseignants.
Nous avons vu que la présence de la BDA reste faible, que ce soit en ce qui concerne son importance socioculturelle dans le cadre de l’enseignement du français ou en tant qu’objet de discours spécifique. Dans le Cadre européen commun de référence (CECR), qui sert de guide à l’élaboration des manuels postérieurs à 2000, aucune mention n’est faite de la BD. Sophie Béguin (ce numéro) fait l’hypothèse que l’importance spécifique de ce médium dans la culture francophone a fait les frais de la normalisation européenne du CECR. De fait, à notre connaissance, dans les portfolios pour adultes, aucun descripteur ne renvoie au genre BD, qui n’est pas considéré comme essentiel à la compétence de communication.
Revenons-en à la sentence publiée dans le Dictionnaire de didactique des langues étrangères que nous avions évoquée dans notre introduction: l’exploitation de la BD «du commerce» serait «pratiquement impossible». Cette affirmation articulée en 1976 semble prophétiser la rareté des BD dans les manuels de FLE d’aujourd’hui. L’adverbe «pratiquement» pourrait renvoyer à deux significations: presque impossible ou concrètement (logistiquement) impossible. Il est vrai que des difficultés concrètes existent et s’avèrent fondamentales pour exploiter la BD en classe de langue. Il faut trouver des documents qui soient adaptés à l’objectif de la leçon et au niveau de langue des apprenants, accessibles à la compréhension et ne présentant pas trop d’implicites culturels. Il convient aussi de dénicher des planches courtes publiables dans un espace restreint. Il est enfin nécessaire de régler la question des droits d’auteur, de négocier des autorisations, ce point étant particulièrement épineux pour un médium relativement récent, dont les œuvres ne sont donc pas tombées dans le domaine public, et qui ne connaît pas le droit automatique de citation17. Par ailleurs, on se rend compte que beaucoup de supports tirés de BDA doivent être écartés car ils ne présentent pas le fameux aspect facilitateur ou motivationnel véhiculé par les représentations communes sur la BD.
Tous ces éléments peuvent expliquer la faible présence de la BDA dans les manuels. Et même lorsque ce médium se trouve au fondement de l’enseignement, comme dans Bulles de France, il lui manque souvent un arrière-plan didactique solide qui pourrait permettre de voir émerger des manières de travailler innovantes, relevant d’une pédagogie spécifique au genre. De ce point de vue, la didactique du FLE aurait tout à gagner à collaborer avec les chercheurs en FLM, à intégrer les avancées en didactique de la lecture et en didactique de la bande dessinée, avec une réflexion théorique approfondie sur le genre BD et son fonctionnement.
Bibliographie
Bannier, Augustin (2014), La bande dessinée en classe de FLE, Master 2, Université d’Angers.
Berthou, Benoît (2017), «Une nouvelle légitimité culturelle. Le cas de la bande dessinée», in Le Statut culturel de la bande dessinée, A. Maaheen, S. Delneste & J.-L. Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 221-232.
Blanchard, Marianne & Hélène Raux (dir.) (2019), «Usages didactiques de la bande dessinée», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 18 septembre 2020.URL: http://journals.openedition.org/trema/4803 DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4803
Butzbach-Rivera, Michèle, Henri Boyer & Michèle Pendanx (1990), Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Paris, CLE International.
Cicurel, Francine (1991), Lectures interactives en langues étrangères, Paris, Hachette.
Coste, Daniel (1970), «Textes et documents authentiques au niveau 2», Le Français dans le monde, n° 73, p. 88-95.
Cuq, Jean-Pierre (dir.) (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International.
Cuq, Jean-Pierre & Isabelle Gruca (2009), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
De Man-De Vriendt, Marie-Jeanne (dir.) (2000), Apprentissage d'une langue étrangère /seconde, Vol. 1. Parcours et procédures de construction du sens, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Galisson, Robert & Daniel Coste (dir.) (1976), Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette, Collection F.
Gilmore, Alex (2007), «Authentic materials and authenticity in foreign language learning», Language teaching, n° 40 (2), p. 97-118.
Germain, Claude (1993), Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire, Paris, CLE International.
Giroud, Anick & Christian Surcouf (2016), «De "Pierre, combien de membres avez-vous?" à "Nous nous appelons Marc et Christian": réflexions autour de l’authenticité dans les documents oraux des manuels de FLE pour débutants», SHS Web of Conferences, n° 27. En ligne, consulté le 24 mai 2021. URL : https://serval.unil.ch/fr/notice/serval:BIB_3E3D334CF7EC
Puren, Christian (1988), Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Paris, CLE International.
Polo, Claire & Nicolas Rouvière (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 14 mai 2021. URL: http://journals.openedition.org/trema/5003, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.5003
Rouvière, Nicolas (2012), «L’étude de la bande dessinée en cours de langue et civilisation», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug, p. 281-286.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, Ellug.
Runge, Annette & Jacqueline Sword (1987), La BD, Paris, CLE International, Collection Techniques de classe.
Tabuce, Bernard (2012), «Une urgence iconologique qui dure: l’enseignement de la BD dans les manuels de collège», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, Ellug.
Corpus (ordre chronologique)
- Le français pour tous (1919): Dubrule, N. & Pierce, W.H., Boston, Ginn and Company.
- Cours d’allemand. Grands commençants (1923): Meneau, F. & Chabas, P., Paris, Didier.
- Cours de langue et de civilisation françaises I (1953, 1967): Mauger, G., Paris, Hachette.
- La France en direct (1971): Capelle, J. & G., Paris, Hachette.
- Le français et la vie (1971): Mauger, G. & Bruézière, M., Paris, Hachette.
- Le français par objectifs 7-9 (1980): Renié J.-C., Genève, CEEL.
- Archipel 1 (1982): Courtillon, J. & Raillard, S., Paris, Didier.
- Archipel 2 (1983): Courtillon, J. & Raillard, S., Paris, Didier.
- Cartes sur table 1 (1981): Richterich, R. & Suter, B., Paris, Hachette.
- Cartes sur table 2 (1983): Richterich, R. & Suter, B., Paris, Hachette.
- L’Exercisier (1993): Descotes-Genon, C., Morsel, M.-H. & Richou, C., Presses universitaires de Grenoble.
- Tempo 2 (1997): Bérard, E., Canier, Y. & Lavenne, C., Paris, Didier.
- Café-crème 1 (1997): Kaneman-Pougatch, M., Trevisi. S., Beacco di Giora, M. & Jennepin, D., Paris, Hachette Français langue étrangère.
- Rond-Point 1 (2004): Labascoule, J. , Lause, C. & Royer, C., Barcelone, Difusion Français langue étrangère.
- Rond-Point 2 (2004): Flumian, C., Labascoule, J. & Royer, C., Barcelone, Difusion Français langue étrangère.
- Studio + (2004):Bérard, É., Breton, G., Canier, Y & Tagliante, C., Paris, Didier.
- Connexions 1 (2004): Mérieux, R. & Loiseau, Y., Paris. Didier.
- Connexions 3 (2005): Mérieux, J., Loiseau, Y. & Bouvier, B., Paris, Didier.
- Compréhension orale 2 (2005): Barféty, M. & Beaujouin, P., Paris, CLE International.
- À propos B1-B2 (2005): Andant, C. & Chalaron, M.-L., Presses universitaires de Grenoble.
- Alter ego 3 (2006): Dollez, C. & Pons, S., Paris, Hachette.
- Activités pour le cadre européen commun de référence B1 (2006): Parizet, M.-L., Grandet, É. & Corsain, M., Paris, CLE International.
- Alter ego 4 (2007): Dollez, C. & Pons, S., Paris, Hachette.
- Latitudes 3 (2010): Loiseau, Y., Cocton, M.-N., Landier, M. & Dinthilac, A., Paris, Didier.
- Écho B1 (vol.1) (2010): Girardet, J. & Pêcheur, J., Paris, CLE International.
- Écho B1 (vol.2) (2010): Girardet, J. & Pêcheur, J., Paris, CLE International.
- Version originale 3 (2011): Denyer, M., Ollivier, C. & Perrichon, É., Paris, Éditions Maison des langues.
- Alter Ego+ B1 (2013): Dollez, C. & Pons, S., Paris, Hachette Français langue étrangère.
- Zénith 3 (2013): Barthélémy, F., Sousa, S. & Spreriando, C., Paris, CLE international.
- La grammaire des premiers temps (2014): Abry, D. & Chalaron, M.-L., Presses universitaires de Grenoble.
- Bulles de France (2015): Jeffroy, G. & Unter, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
- Défi 3 (2019): Biras, P., Chevrier, A. & Witta, S., Éditions Maison des langues.
- Défi 4 (2020): Biras, P., Chevrier, A., Jade, C. & Witta, S., Éditions Maison des langues.
Pour citer l'article
Anick Giroud, "La bande dessinée dans les manuels de FLE (1919-2020)", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-dans-les-manuels-de-fle-1919-2020
Voir également :
La bande dessinée dans les classes de littérature: entre prescription et pratique
Si les vertus pédagogiques de la bande dessinée sont depuis longtemps reconnues par les milieux de l’éducation, les rapports entre le neuvième art et l’institution scolaire demeurent à ce jour problématiques. À l’intersection de différentes disciplines, dépourvue d’un corpus canonique consensuel et sous-représentée dans la formation des enseignants, la bande dessinée reste «le parent pauvre» (Rouvière 2012: 10) des programmes scolaires, alors même que son utilisation est attestée dans la pratique. Cet article propose de dresser l’historique de la place que le média occupe dans les prescriptions de l’Éducation nationale française depuis les années 1950, en particulier dans le lien qu’il entretient avec l’enseignement littéraire, afin d’éclairer les raisons de l’écart qui subsiste entre sa reconnaissance institutionnelle et sa présence effective dans les classes de littérature.
La bande dessinée dans les classes de littérature: entre prescription et pratique
1. Introduction
Lorsqu’il publie ses premières histoires en estampes et qu’il en théorise les principes dans son Essai de Physiognomonie (1845), Rodolphe Töpffer semble considérer la dimension pédagogique de cette littérature dessinée comme une évidence. Parce «qu’il y a bien plus de gens qui regardent que de gens qui lisent», ce que nous appelons aujourd’hui la bande dessinée permettrait, selon le Genevois, d’infléchir positivement le comportement des enfants et du peuple en fournissant une littérature morale accessible à tous par l’intermédiaire du rapport texte-image (Töpffer 1845: 1). Sept générations plus tard, les rapports entre bande dessinée et éducation demeurent pourtant ambigus et soulèvent encore de nombreuses interrogations. Faut-il enseigner la bande dessinée à l’École? À quelle(s) fin(s) et dans quel cadre? Doit-on l’envisager sous l’angle de la littérature ou de l’histoire de l’art? Quel corpus faut-il choisir? De quelle façon doit-on l’appréhender? Si ces questions se posent, c’est aussi parce que la bande dessinée dispose aujourd’hui d’une légitimité croissante dans les autres domaines culturels, économiques et politiques: elle est une pratique de lecture reconnue, elle a des musées qui lui sont consacrés, de multiples festivals; en 2018, elle représentait à elle seule 12% du chiffre d’affaire des librairies françaises et constituait la plus forte progression du secteur1; on lui consacre des colloques, des ouvrages, des anthologies et de nombreux travaux de recherche académiques. 2020 a même été décrétée Année de la bande dessinée par le gouvernement Macron, une décision politique pour mettre en lumière, entre autres, les richesses mais aussi les difficultés du secteur2. Pourtant, la place de la bande dessinée à l’École reste précaire. Quand on l’étudie, c’est le plus souvent sur la base d’une initiative personnelle de l’enseignant et cela peut même susciter la méfiance de ses collègues. Sans la qualifier de totalement inexistante, la présence de la bande dessinée en classe de littérature ne va de loin pas encore de soi et l’institution scolaire apparaît comme le dernier critère de reconnaissance auquel le «neuvième art» aurait le droit de prétendre.
L’histoire de la bande dessinée explique en partie cette situation: le XXe siècle a été pour la bande dessinée une longue route vers la recherche de légitimation. Après la loi de censure de juillet 1949, la BD a dû progressivement regagner ses lettres de noblesse et s’affranchir des clichés qui lui collaient à la peau. Jugée amorale, abrutissante, indigne et simpliste, elle était également considérée comme un pur produit de consommation, dépourvue du capital symbolique qu’on conférait alors à la littérature. Or, cette dernière aussi a eu son lot de crises dans le contexte sociétal mouvementé du siècle dernier: le canon littéraire a été remis en question et a perdu sa prépondérance face à l’émergence des pratiques culturelles de masse comme le cinéma et la télévision. Dans cette dynamique, le neuvième art s’est également émancipé; quant à l’institution scolaire, les changements culturels et démographiques l’ont obligée à se transformer. Tout ceci aurait pu modifier en profondeur les pratiques d’enseignement et favoriser l'émergence de pratiques intermédiales, davantage en phase avec la culture de l'image dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Pourtant, la place de la bande dessinée au sein des classes continue d’être questionnée et le présent travail cherche, entre autres, à expliquer pourquoi il en est ainsi. Car il serait réducteur de penser que, d’un point de vue historique, la bande dessinée aurait été simplement victime d’une rivalité avec une littérature «classique» tentant de conserver son hégémonie dans les programmes scolaires. Notre parcours chronologique montrera en effet que la responsabilité est partagée: les transformations de l’institution scolaire ont ouvert par instant des brèches dans lesquelles les acteurs du champ de la bande dessinée n’ont pas forcément voulu s’engouffrer. Quant à l’École, si elle a tenté de ménager durant un temps une place à des objets culturels alternatifs, leur enseignement a été entravé parce que les outils nécessaires à leur transposition didactique faisaient souvent défaut.
Dans cet article, nous proposons donc de dresser un parcours historique de l’enseignement littéraire en France et de la place occupée par la bande dessinée dans ces pratiques. Depuis la loi de censure de 1949 jusqu’à nos jours, nous montrerons que la nature hybride de la bande dessinée rend complexe son rattachement à une branche scolaire particulière et explique en partie sa difficile intégration dans les corpus. Nous verrons en outre qu’il existe un écart entre ce que les textes officiels préconisent et la réalité du terrain: entre manque de moyens budgétaires et lacunes dans les formations initiales du corps enseignant, la bande dessinée reste, à ce jour, encore peu présente dans l’enseignement, alors même qu’elle figure dans les textes officiels (programmes scolaires, décrets, arrêtés ministériels) et que ses vertus pédagogiques sont souvent reconnues. Nous verrons enfin que la scolarisation de la bande dessinée suscite parfois la méfiance de ce milieu culturel, qui y voit un risque de formatage des formes et des contenus. Aussi nous semble-t-il nécessaire d’ouvrir une réflexion sur la bande dessinée comme objet didactique, non seulement pour envisager comment tirer le meilleur profit de son enseignement pour les apprenants et comment en répandre l’usage, mais aussi pour évaluer comme cette transposition peut se faire au profit symbolique du média et non à son détriment.
2. L’enseignement littéraire: un pivot institutionnel
Si la question de la formation littéraire est un enjeu majeur en France depuis la démocratisation de l’École décrétée par les lois Ferry de la fin du XIXe, la massification générale de l’enseignement dès les années 1960 entraine une forte remise en question de la structure, du contenu et des objectifs de la transmission de la littérature, dont l’écho se fait encore entendre aujourd’hui. Des revendications sociétales de Mai 68 à la crise de la littérature, en passant par le développement des théories de la réception, l’objet littéraire occupe une place de choix dans les nouveaux rapports de force qui s’instaurent entre les différents champs de la société française alors en pleine mutation. Facteur de cohésion et d’identification nationales, marqueur de classes et de positions sociales dans les champs de pouvoir, canal de diffusion de valeurs parfois contradictoires, le littéraire polarise constamment les éléments de sa propre définition, nécessitant la remise en question quasi perpétuelle de ses modes d’enseignement. Au cœur de la crise, les travaux de Jacques Dubois (1978) ont permis de reconnaître le caractère fortement institutionnalisé de la littérature et l’importance des rapports entre les deux pôles de la production littéraire: d’un côté la sphère restreinte et dominante, qui acquiert un certain prestige esthétique lié à l’autonomie qu’elle revendique, laquelle corroborée par un discours d’escorte institutionnalisé; de l’autre côté, la sphère élargie, qui s’inscrit dans une logique économique et prône des pratiques moins élitistes (Bourdieu 1971). Longtemps considérés séparément, les deux pôles sont mis en dialogue par l’analyse institutionnelle de Dubois. Il n’est ainsi plus question d’envisager uniquement un corpus canonique considéré comme prestigieux, établi par une institution toute-puissante et réservé uniquement à une élite. Au contraire, il s’agit de prendre acte de la mouvance et de la variété des corpus, en envisageant leurs rapports à des institutions tout aussi variées, et de révéler des processus de reconnaissance des œuvres, devenues perméables aux changements de statut à l’intérieur du champ. Il s’agit ainsi d’établir de fait la relativité de l’objet littéraire, son inscription nécessaire dans une historicité et une forme de saine désacralisation.
Dans cette perspective, par sa position centrale entre sphère restreinte et sphère élargie, l’École apparaît comme un pivot de l’appareil institutionnel: à la fois porte d’entrée et de sortie, l’institution scolaire est autant subordonnée à certaines formes de pouvoir (politique, symbolique, etc.) qu’elle infléchit le comportement des futurs acteurs de ces mêmes pouvoirs, par la diffusion de valeurs qu’elle aura conservées, modélisées et entérinées. Bien entendu, il ne s’agit pas de considérer l’École comme le seul facteur de détermination sociale, ni d’ailleurs de s’attarder trop longuement sur un sujet qui dépasse notre propos. Mais la question du statut de l’objet qui nous occupe, par sa situation particulière vis-à-vis du champ littéraire, semble bien être profondément déterminée par l’institution scolaire. Roland Barthes l’affirme de manière radicale lorsqu’il définit la littérature comme «ce qui s’enseigne, un point c’est tout» (1971: 945). Sur la base de l’inventaire de ses souvenirs scolaires, Barthes énumère toutes les définitions du littéraire que l’École lui a inculquées par le biais matérialiste du manuel. Or, selon lui, ces définitions sont trop éloignées de la pratique réelle de la lecture et mériteraient d’être déconstruites et réenvisagées dans une perspective de démocratisation du savoir. In extremis, il est cependant intéressant que Barthes recentre sa critique sur l’enseignement de la littérature en tant que code et non comme pratique réelle des enseignants3, lesquels demeurent, in fine, les acteurs, plus ou moins conscients, d’un processus institutionnel. La formation, mais également le milieu social ainsi que la pratique et les passions personnelles d’un enseignant sont déterminants dans l’approche et le contenu de sa transmission, en dépit des cadres officiels posés par les directives politiques. Ainsi, une tension à la fois idéologique et temporelle peut s’instaurer entre ce qui se passe réellement dans les classes de littérature et ce que dicte la doxa, ce qui ne fait que confirmer le poids de l’École dans la définition de ce qu’est la littérature et le conservatisme dont elle peine à se défaire.
3. Prescriptions officielles et pratiques d’enseignement: des classiques à la bande dessinée
Les tensions qui peuvent régner entre la pratique enseignante et les prescriptions officielles sont particulièrement visibles lorsque l’on s’intéresse à la question des classiques. Si la définition de la littérature ne peut se réduire à celle du classique, il n’en demeure pas moins que les valeurs véhiculées par le corpus canonique, la façon dont il se constitue et se transmet, les œuvres qui s’y rattachent et celles qui en sont exclues, permettent d’évaluer l’écart qui peut exister entre différentes sphères culturelles. Comprendre le processus de «classicisation4», c’est comprendre l’importance de l’École dans la reconnaissance de certains genres littéraires, tout en prenant conscience du caractère relatif du processus. En 1850 déjà, Sainte-Beuve affirmait que les classiques étaient «ce fonds solide et imposant de richesse littéraire […] qui a suite et consistance, qui fait ensemble et tradition, qui se compose, se transmet et qui dure.» (Sainte-Beuve 1850: 35) Sans évoquer explicitement le rôle de l’institution scolaire et les conditions qui conduisent à sa pérennisation, le critique définit le corpus canonique comme un ensemble dont l’objectif est d’être transmissible.
Près d’un siècle et demi plus tard, Alain Viala (1992-1993) a précisé le rôle de l’enseignement dans la définition des classiques, leur caractère contingent et la nature du processus qui conduit à leur rattachement au canon. Alors que Sainte-Beuve insistait sur certaines qualités inhérentes aux classiques («une forme […] saine et belle en soi») pour expliquer en partie leur étonnante solidité, Viala pose d’emblée que le terme classique est polysémique et que «le noyau sémantique commun à tous les emplois du terme est l’idée qu’il s’agit de données reconnues, instituées en valeurs» (1992: 8). Pour lui, la perpétuation des classiques répond à un besoin (il parle même d’un «désir universel») et doit donc être envisagé sous l’angle de la réception des œuvres; une réception devant elle-même être abordée en tenant compte des institutions porteuses de valeurs, il s’agit ainsi de montrer comment se construisent «méthodiquement les objets à étudier» (1992: 8) ce qui exclut, au fond, tout critère littéraire ou esthétique intrinsèque. Dans ce processus, le rôle de l’institution scolaire se démarque rapidement: si une première légitimation passe par le cadre institutionnel littéraire (académies, prix, éditions, etc.), «avec l’entrée dans la doxa scolaire, on quitte l’espace propre du champ littéraire pour passer à une institution supra-littéraire, l’École, qui apporte la pérennisation par la divulgation» (1992: 10). À l’intersection de différents pouvoirs institutionnels, l’École est une fabrique à consensus dont «la puissance […] est restée un trait dominant de la structure du marché culturel en France» (1992: 10). Autrement dit, en dépit de sa subordination aux autres sphères du pouvoir public, l’institution scolaire sélectionne les textes et les auteurs qu’elle constitue en un corpus consensuel et transmissible, assurant ainsi sa circulation au-delà du champ strictement littéraire. À ce titre, elle joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des œuvres et des genres, dont elle influence la réception dans les autres sphères privées et publiques.
Les travaux de Viala montrent que le terrain de l’enseignement entérine une certaine vision du classicisme, marquée par «le repli sur un petit lot de valeurs communes bien établies» (1992: 9). La constitution des corpus serait alors le résultat d’un consensus inconscient entre prescripteurs, enseignants et élèves, visant à maintenir un ordre admis et à assurer une pratique basée sur un répertoire stabilisé, dont la reconnaissance hors du champ est garantie le plus largement possible. Puiser dans un répertoire canonique, c’est l’assurance de choisir une œuvre étudiée par l’enseignant durant sa propre formation, préconisée par les listes étatiques de référence et reconnue par l’élève et son entourage comme élément d’un bagage culturel valorisé et valorisant sur le plan symbolique que l’École se doit de transmettre. Le caractère consensuel de l’enseignement littéraire ainsi défini ne tient que si les différentes parties conservent leur position. Or, la place centrale de l’École dans l’appareil institutionnel la rend tributaire de l’évolution des autres champs. Ainsi, qu’il s’agisse de changements dans les politiques d’éducation, de l’émergence de nouvelles pratiques culturelles ou de l’évolution démographique, elle doit s’adapter et tenter de rétablir l’ordre dont elle est la garante. L’histoire des programmes d’études du français de la deuxième moitié du XXe siècle met en évidence ces ajustements.
Si le parcours historique que nous proposons révélera l’étendue des tensions régnant entre théorie et pratique, entre programmes prescrits et réalités de l’enseignement, il permettra aussi d’évaluer la place octroyée aux nouvelles pratiques de lecture, dont celle de l’objet qui nous intéresse: la bande dessinée. La constitution du champ de la bande dessinée intervient à une période durant laquelle on assiste à une remise en question profonde des institutions littéraires et scolaires, aussi, la question de son entrée à l’école s’est naturellement posée. Puisqu’elle se voit reconnaître, à partir de la fin des années 1960, des qualités littéraires et qu’elle gagne ainsi en valeur symbolique, l’intégration de la bande dessinée dans les programmes devenait presque inévitable dans une logique institutionnelle, mais ce rapprochement n’était pas dénué de dangers. On verra que si cet objet gagne en légitimité, c’est en partie en s’affranchissant de sa comparaison systématique avec la littérature. Par ailleurs, entrer dans la doxa scolaire suppose de subir une sélection, d’être restreinte à quelques auteurs et intégrée dans un corpus consensuel, sans pour autant garantir à ce corpus d’être étudié dans ses spécificités propres. Le risque est d’autant plus grand dans le cas des adaptations, qui sont réduites au rôle de marchepied pour faciliter l’accès au contenu narratif d’une œuvre jugée supérieure.
En outre, l’introduction d’un nouveau médium (et d’un corpus qui lui serait rattaché) implique une formation adéquate des enseignants qui, aujourd’hui encore, laisse à désirer. En dépit de l’existence de quelques ouvrages pionniers et la multiplication d’initiatives ponctuelles, le constat régulièrement brandit par les milieux académiques, pédagogiques mais aussi éditoriaux, reste le manque de recherches et de moyens en didactique de la bande dessinée, rendant compliquée son utilisation en classe:
En marge de […] projets médiatiques localisés dans un nombre restreint d’académies dynamiques, les enseignants osent peu aborder la bande dessinée faute de formation et d’accompagnement. Ils évoquent un réel manque de budget pour acquérir des livres, ainsi que l’absence de la BD dans les formations initiales, de plus en plus courtes. […] [L]es conseillers pédagogiques déplorent le manque d’outils à la disposition des professeurs qui souhaitent analyser des BD, alors que celles-ci sont présentes dans les recommandations des programmes. (Depaire 2019: 4-5)
Cette situation rend ainsi difficile l’enseignement de la bande dessinée dans ses spécificités formelles et historiques, cette dernière étant plutôt intégrée comme une médiation dans des pratiques interdisciplinaires qui négligent sa dimension à la fois graphique et narrative. Le parcours historique de la place de ce médium dans les programmes scolaires nous mènera ainsi du constat de son exclusion radicale à une multiplication de ses usages possibles qui caractérise le contexte actuel, sans que cela n’aboutisse à lever complètement les obstacles qui se dressent devant la reconnaissance institutionnelle qu’elle pourrait revendiquer dans le paysage culturel contemporain.
4. Histoire de l’intégration de la bande dessinée dans les programmes scolaires français
4.1. Sources et circonscription des objets
Afin de retracer l’évolution de la place de la bande dessinée au sein de l’institution scolaire française, nous avons procédé par recoupement de différentes informations. Pour chacune des phases décrites, nous n’avons pas toujours pu trouver à la fois les documents officiels de l’Éducation nationale et des études sur les pratiques réelles des enseignants, en particulier dans les périodes les plus éloignées chronologiquement. Pour ces dernières, nous nous sommes appuyés sur différents articles et ouvrages de didactisation. Deux enquêtes sur les pratiques d’enseignement, l’une menée au début des années 1990 et consacrée à la littérature au collège, l’autre parue en 2019 et dédiée à la place de la bande dessinée, nous ont permis de tisser des liens entre les périodes et de jalonner notre étude d’éléments permettant de saisir la mise en œuvre concrète des prescriptions officielles. Bien que forcément réduites à un échantillon d’enseignants, ces enquêtes précieuses révèlent les nombreux paradoxes et écarts qui subsistent entre les discours institutionnels et la réalité du terrain.
Le choix du découpage chronologique repose quant à lui sur des critères discutables mais nécessaires à la délimitation de notre recherche. D’abord, il ne s’agit pas, dans cette étude, de faire l’histoire des corpus scolaires depuis l’introduction de l’école publique, mais bien de mettre en parallèle l’évolution de ces corpus avec les prescriptions officielles portant sur l’introduction de la bande dessinée dans les classes. À ce titre, il nous paraît pertinent de démarrer notre observation en partant des bouleversements qui secouent conjointement le domaine de l’enseignement littéraire et celui de la bande dessinée à partir du milieu des années 1960. L’ouvrage de Dufays et al. (2005) consacre sa première partie à historiciser les discours sur la lecture littéraire et nous rappelle que de 1965 à 1980, l’enseignement de la littérature vit une crise profonde. Entre massification du public scolaire, augmentation de l’attrait pour les sciences dites dures et développement de la sphère privée et du culte du loisir, la période est en effet marquée par l’élargissement du corpus enseigné, mais dans une dynamique plus chaotique que systématique. Cette phase sera abordée dans la mesure où elle permet d’éclairer les suivantes.
De la même façon, si l’on ne peut pas parler de crise pour la bande dessinée, ces mêmes années correspondent en revanche à la constitution progressive de son champ, qui gagne en autonomie en s’émancipant progressivement de son image de produit commercial de la culture de masse. Des étapes telles que l’organisation des premiers congrès dédiés au médium, l’apparition de l’appellation de «neuvième art5» ou encore la création du festival d’Angoulême en 1974, traduisent l’émergence d’un nouveau statut pour la bande dessinée. Il s’agit aussi d’une phase durant laquelle apparaissent de nouvelles formes d’expression pour les auteurs, désormais dotés de «propriétés qui définissent la condition d’"artiste"» et d’un nouveau lectorat «plus âgé et plus scolarisé» (Boltansky 1975: 40). Par ailleurs, notre tentative de périodisation tient aussi compte des grandes refontes du système éducatif français de 2006 et 2015, qui coïncident avec l’augmentation progressive d’adaptations en bande dessinée d’œuvres classiques, notamment déclinées en collections spécifiques6. Cette synchronisation n’est certainement pas le fruit du hasard et il est aisé d’imaginer une corrélation entre le changement des prescriptions et l’émergence de nouvelles pratiques éditoriales. C’est sur cette période plus récente que nous nous attarderons en particulier, mais pour en saisir les enjeux, il faudra la situer par rapport au processus qui a conduit jusqu’à ce stade. Comme en témoigne le parcours historique que nous allons retracer, la place de la bande dessinée dans l’enseignement français ne s’est pas faite sans résistance. Sa présence actuelle, bien que fragile, lie néanmoins officiellement son destin à l’enseignement de l’histoire de l’art et du français dans le cadre de l’acquisition d’une culture littéraire et artistique.
4.2. Avant les années 1960: entre canon et répression
Jusque dans les années 1960, le rôle de la littérature en classe est essentiellement utilitaire. Sans refaire l’histoire de l’enseignement littéraire, nous pouvons rappeler que celui-ci est principalement orienté vers le développement de compétences rhétoriques, argumentatives ou historiques. Les exercices qui lui sont rattachés relèvent essentiellement de la technique de la langue et le canon est constitué de façon à servir les intentions pédagogiques. Il n’est d’ailleurs nul besoin de remettre en question ce corpus institué à partir du moment où ses qualités esthétiques, comme son actualité pour le lecteur, sont sans rapports directs avec les objectifs de formation. L’apprentissage de la lecture intéresse pourtant les milieux pédagogiques, eu égard notamment à la diversification progressive du public scolaire, mais elle reste une pratique guidée et orientée par l’idée que l’enseignant doit faire découvrir le sens du texte qui préexiste à l’interprétation.
Du côté de la bande dessinée, sa présence au sein de l’institution scolaire ne se discute alors même pas. Il faut dire que depuis la loi de 1949, le secteur a d’autres défis à relever. Dans le contexte de l’après-guerre et face à la montée d’un anti-américanisme fondé sur la recherche d’une cohésion nationale à la fois fragile et vitale, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est le résultat des pressions exercées par les garants de l’ordre moral de tout bord. Jugée responsable de la délinquance et de l’appauvrissement intellectuel des jeunes, la presse illustrée enfantine, principal support d’une bande dessinée souvent importée des États-Unis, est dès lors soumise à un contrôle étroit et régulier. La commission alors en place développe une stratégie d’intimidation et soumet les éditeurs à une telle pression que certains s’autocensurent d’office afin d’éviter le tracas des sanctions (Crépin 2003; Méon 2009). Les différents rapports élaborés par la commission posent d’ailleurs des recommandations en termes de représentation visuelle, de thématiques abordées et même de proportion entre textes et images, modelant de fait les productions des années à venir. Ainsi, en dépit de la résistance de quelques productions destinées aux adultes, la bande dessinée se cantonne globalement, jusque dans les années 1960, à cette dimension enfantine et à cette mission d’éducation morale, alors que continue de se développer un discours critique à son encontre. Entre le manque de reconnaissance culturelle et le cadre réducteur dans lequel la BD est alors produite, sa présence au sein de l’enseignement ne paraît simplement pas envisageable.
4.3. De 1960 à 1980: crise de la littérature et constitution du champ de la BD
Les années 1960 sont marquées par une «crise du français» (Viala 2005: 72) et par de profonds changements dans les structures scolaires. Les facteurs et l’historique de cette crise sont multiples et ne constituent pas ici le cœur de notre propos. Aussi, nous nous bornerons à en résumer les éléments les plus significatifs pour notre objet. Le premier élément important et quantifiable est la massification du public scolaire (Aron & Viala 2005). Le contexte d’expansion économique de l’après-guerre et l’augmentation, dès 1959, de la durée de la scolarité obligatoire, dont le terme passe de 14 à 16 ans, ont entraîné une forte augmentation du nombre d’élèves et le rallongement des études. La loi Haby de 1975 instaurant le collège unique7 achève le processus de démocratisation de l’institution scolaire. La croissance qui en découle s’accompagne alors d’une hétérogénéisation sociale et culturelle du groupe-classe, obligeant les enseignants à s’adapter, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Dans la pratique, on se concentre sur l’essentiel, sur l’utile, et, dans un premier temps, le corpus se replie sur ce qui constitue des valeurs sûres et traditionnelles.
Deuxième conséquence de la démocratisation du système scolaire, la «connivence culturelle» (Dufays 2005: 27) sur laquelle reposait l’enseignement de la littérature est mise à mal. On assiste alors à une montée des valeurs scientifiques et à un attrait de plus en plus marqué pour les filières ad hoc, moins dépendantes d’un partage culturel. La filière des Lettres est donc en perte de vitesse, alors que les tensions entre les tenants de la tradition et les adeptes de nouvelles approches finissent par provoquer ce que Viala nomme «l’éclatement de la discipline» (Viala 2005: 74). Or, c’est précisément à la faveur de cette période troublée que de nouveaux supports d’enseignement vont progressivement faire leur entrée en classe, l’éclatement de la discipline correspondant à l’éclatement des corpus et à l’élargissement de la notion de texte:
Dans les années 1970, tant en France qu’en Belgique, la situation de l’enseignement de la lecture semble donc caractérisée par l’éclatement du corpus, la diversité des théories de référence (sémiotiques, linguistiques, sociologiques, historiques, psychanalytiques, etc.) qui étudient le texte littéraire et mettent en évidence la pluralité des lectures possibles. Les programmes manifestent la prise de conscience de l’hétérogénéité sociale et culturelle des élèves mais ne s’interrogent pas sur les raisons qui poussent à lire ni sur les mécanismes de la compréhension des textes. (Dufays & al. 2005: 29)
Dans ce contexte, les paralittératures sont officiellement valorisées et les approches se diversifient dans un souci d’inscrire la discipline au plus près de la vie quotidienne des élèves et de la rendre utile. Le canon, quant à lui, se retrouve d’autant plus remis en question qu’il perd de sa pertinence, tant dans sa constitution que dans l’approche qui en est faite: les valeurs rhétoriques, nationalistes et esthétiques sous-jacentes à sa légitimité paraissent moins admissibles dans une société qui se modernise, s’ouvre au monde et se diversifie. D’ailleurs, l’utilisation même du terme œuvre canonique devient problématique dans les textes officiels, et le restera jusque dans les années 2000, remplacé par des qualificatifs moins connotés – mais aussi plus vagues, tels que: œuvre significative ou de référence.
L’enseignement traditionnel de la lecture littéraire n’est donc plus une évidence et l’élargissement du corpus qui en découle peut être perçu comme une tentative désespérée de lui redonner la place centrale qu’il occupait jusqu’alors. Parallèlement, le développement des théories de la réception déplace le curseur du texte vers le lecteur. Le sens de l’œuvre est décloisonné au profit de la variété des lectures et des interprétations possibles et la définition du récit, désormais liée aux intérêts des publics, s’en retrouve également enrichie, permettant l’introduction progressive de médias tels que le cinéma, la chanson, la publicité et, bien entendu, la bande dessinée. Pourtant, si les pratiques évoluent au gré des affinités et des compétences des enseignants, l’enseignement littéraire reste déchiré entre tradition et modernité. Or, en tant qu’institution, l’École, se doit précisément d’institutionnaliser ces changements de paradigme.
Du côté de la bande dessinée, la commission de contrôle chargée de faire respecter la loi de 1949 tend à perdre progressivement son pouvoir et est contrainte de s’adapter face aux évolutions sociales et politiques qui marquent cette période. Ainsi, toujours en vigueur de nos jours, la loi sur les publications à destination de la jeunesse s’est depuis pliée à une jurisprudence qui laisse une place beaucoup plus large à la liberté d’expression. Dès les années 1960, l’émergence d’un discours intellectuel et esthétique fondant les bases d’un processus de consécration de la bande dessinée achève de déplacer le courroux des critiques, qui se concentre désormais sur le nouvel ennemi de l’éducation: la télévision (Méon 2009: 48). Face au développement rapide d’une culture du loisir dont le petit écran incarne la dimension industrielle et abrutissante, la bande dessinée – comme d’autres littératures dévaluées jusqu’alors – retrouve du crédit auprès des milieux pédagogiques, qui y voient un moindre mal. Il faut ajouter que cette période est marquée par la démocratisation du format de l’album, qui éloigne la bande dessinée de la presse pour lier son destin au monde du livre, ce qui renforce sa légitimité culturelle (Lesage 2019). Sa reconnaissance progressive dans les milieux intellectuels et universitaires, mais également au sein de la famille, avec le développement d’une bande dessinée plus littéraire et plus adulte, ouvre ainsi la voie à son utilisation potentielle dans les classes de littérature.
La constitution du champ de la bande dessinée durant cette période repose sur des facteurs multiples, internes et externes au champ. Nous avons déjà mentionné la création du festival d’Angoulême et d’autres événements ou espaces consacrés au neuvième art comme des moments-clés de cette évolution. Dans les années 1970, la création ou la réorientation de revues élargissant leur public vers les adolescents et les adultes, comme Pilote, L’Écho des Savanes, Fluide Glacial, Métal Hurlant ou encore (À Suivre) fait émerger «une nouvelle génération de dessinateurs et de scénaristes» (Boltansky 1975: 39) qui, par leur orientation sociale et culturelle, contribuent à modifier en profondeur une production jusqu’ici bridée par la loi de 1949. Le champ se constitue alors progressivement, soutenu par un faisceau de forces productives, réceptives et réflexives. Parmi ces dernières, on voit apparaître les premières tentatives de didactisation de la bande dessinée, orientées par la nécessité de légitimer son utilisation en classe, de la sortir d’un carcan moralisateur et d’offrir les bases pédagogiques qui manquaient jusqu’ici aux enseignants audacieux prêts à introduire ce média dans leurs classes.
L’ouvrage fondateur d’Antoine Roux (1970) ouvre une brèche importante pour la reconnaissance des vertus éducatives de la bande dessinée. Construit en trois parties, il commence par un premier chapitre consistant essentiellement à dénoncer les préjugés que nourrissent les milieux pédagogiques à l’encontre de la BD. S’appuyant sur des études sociologiques, l’auteur prône la nécessité de reconnaître l’attirance des enfants pour la bande dessinée et insinue qu’elle pourrait être «l’un de ces ponts que l’on pourrait jeter entre deux mondes qui ont de plus en plus tendance à dériver l’un par rapport à l’autre, le monde de l’adulte et celui de l’enfant.» (Roux 1970: 6) Il affirme entre autres que les jeunes lecteurs d’aujourd’hui sont les lecteurs adultes de demain, et par conséquent, qu’il convient de former correctement leur goût en matière de neuvième art, afin que, devenus consommateurs exigeants, ils induisent des productions de meilleure qualité. Cette position est doublement originale, car elle vise autant à remettre en question les idées préconçues des milieux pédagogiques à l’encontre du médium, qu’elle les renvoie à leur propre responsabilité quant à la nécessaire formation des lecteurs.
Toutefois, la suite de l’ouvrage peine à se détacher de la nécessité constante de justifier le bien-fondé d’un propos pédagogique sur la bande dessinée. Le deuxième chapitre s’intitule Enseigner la bande dessinée et aborde donc des pistes d’étude visant à mettre en évidence les propriétés du médium. Pourtant, le premier réflexe de l’auteur reste de justifier cette approche par un parallèle avec les médias audiovisuels que sont le cinéma et la télévision:
Car la B.D. peut jouer un rôle de «révélateur», permettre un départ plus rapide de l’initiation à l’image cinématographique et télévisuelle. Certes la connaissance des «langages» du cinéma et de la télévision devra aller au-delà, mais du moins une exploitation de la B.D. peut-elle aider l’enfant à partir d’un bon pied… et d’un bon œil… (Roux 1970: 26)
Dans la suite de l’ouvrage, il précise à nouveau que cet enseignement «devra également avoir un but propre: apprendre la bande dessinée pour la bande dessinée» (26), mais le parallèle est tissé et soutient la suite du propos: l’étude des albums est mise au service d’une éducation aux médias audio-visuels. Enfin, la troisième et grande partie intitulée Enseigner avec la bande dessinée vise quant à elle à lister tous les liens que l’on peut tisser entre cette forme d’expression graphique et l’enseignement d’autres matières: lecture, orthographe, analyse de l’image, expression écrite et orale, et même histoire et éducation civique. Là encore, le chapitre commence par déconstruire l’éternelle accusation d’une bande dessinée jugée responsable de l’amoralité et de la pauvreté linguistique de la jeunesse. Sous la forme d’un «petit duel oratoire» (62), l’auteur reprend chaque argument d’un article paru en 1953 et intitulé Poison sans paroles (Brauner 1953), qui réunit les principaux griefs linguistiques formulés à l’époque contre la bande dessinée – dans le contexte, on le rappelle, de la loi de 1949. Un par un, il les déconstruit en apportant, images à l’appui, la preuve de leur caractère infondé. Et lorsqu’il ne peut qu’abonder dans le sens de l’accusation – comme par exemple pour le reproche lié à la pauvreté de la syntaxe et à l’omniprésence des fautes d’orthographe dans certains illustrés –, il dénonce le manque de valorisation de la bande dessinée francophone ainsi que le peu d’énergie et de budget alloués par les éditeurs à la correction des traductions: une fois encore, si le lectorat était mieux formé, il serait plus exigeant et le monde éditorial plus soucieux de proposer des créations originales de qualité.
Globalement, le livre d’Antoine Roux nous paraît particulièrement moderne dans son approche, éclairant de nombreux aspects rattachables à l’enseignement de la bande dessinée qui font encore aujourd’hui l’objet de discussions dans les milieux pédagogiques – l’éducation aux médias audio-visuels par le truchement de la bande dessinée fait écho, par exemple, aux travaux actuels qui associent ce média au champ de la littératie médiatique multimodale. Il réunit les bases d’une terminologie nécessaire à l’analyse du médium et propose de nombreuses idées à destination des enseignants. Toutefois, il ne parvient pas encore à s’émanciper d’un discours de légitimation. Roux reconnaît d’ailleurs que certains acteurs appartenant au champ de la bande dessinée pourraient avoir quelques réticences à une telle scolarisation de leur médium:
On en arrivera probablement à faire aimer la bande dessinée, en n’exigeant toutefois pas d’elle plus que ce qu’elle peut donner, mais en lui demandant «tout ce qu’elle est susceptible d’apporter»: plus qu’on ne le pense. Il me reste peut-être à freiner certains enthousiastes: prenez garde, après avoir déploré la B.D., n’allez pas maintenant la «déflorer»! En d’autres termes, s’il nous est loisible d’introduire la bande dessinée à l’école, gardons-nous de faire entrer l’école dans la bande dessinée. Ne l’utilisons qu’avec d’infinies précautions et pour ainsi dire… «par la bande»!... (Roux 1970: 112)
Deux ans plus tard, Pierre Fresnault-Deruelle (1972) publie un autre ouvrage important, tout en insistant de moins en moins sur le discours légitimant la valeur éducative de la bande dessinée, pour mettre en avant des pistes pratiques pour son enseignement. Mais c’est en 1977, avec Lecture et bande dessinée – Actes du 1er colloque international éducation et bande dessinée, que l’on peut mesurer le chemin parcouru dans le processus de légitimation du médium dans le champ de l’éducation. Tout d’abord, les textes rassemblés dans cet ouvrage sont des contributions d’intellectuels réunis pendant deux jours, pour discuter des liens entre école et neuvième art. Le propos y est très académique et très spécialisé. Il ne s’agit plus de défendre timidement la légitimité de la bande dessinée, mais d’affirmer haut et fort la spécificité de sa contribution à la formation des élèves.
Prenons par exemple la conférence introductive d’Antoine Roux qui, se paraphrasant lui-même, pose d’emblée: «La bande dessinée à l’école, bravo! Mais surtout pas l’école dans la bande dessinée!» (12). Comme postulat de départ d’un colloque consacré aux perspectives éducatives de la BD, il y a de quoi s’en trouver déconcerté. Pourtant, tout se passe comme si l’intégration de la bande dessinée dans la doxa scolaire ne pouvait se faire que si la première s’émancipait suffisamment de la seconde, mais aussi des autres arts auxquels elle est sans cesse comparée. Il est à ce titre intéressant de voir que la BD n’apparaît pas, cette fois, d’abord comme une bonne introduction au cinéma et à la télévision, mais que l’éducation à l’image que permet son enseignement permet de mieux comprendre l’iconosphère de manière générale. De simple moyen, elle devient fin.
L’intervention de P. Fresnault-Deruelle consacre d’ailleurs clairement la séparation entre la bande dessinée et le cinéma:
Depuis qu’on écrit sur la bande dessinée, on passe le plus clair de son temps à dire: «La bande dessinée, après tout, c’est comme le cinéma», c’est-à-dire que derrière cette idée-là il y a encore la fameuse volonté de valoriser la bande dessinée comme quelque chose de bâtard qui devrait exister à l’ombre d’une autorité supérieure, un grand Art: le cinéma. On a souvent fait des parallèles entre la bande dessinée et le cinéma pour ces raisons-là. C’est une idée qu’il faut combattre: la bande dessinée ne devient réellement elle-même qu’à partir du moment où elle s’émancipe, à partir du moment où elle va s’écarter du cinéma. (P. Fresnault-Deruelle in Faur 1977: 25)
Alors que lui-même – comme Antoine Roux d’ailleurs – avait tiré profit de la comparaison entre les deux arts, en mettant l’un sous l’aura protectrice de l’autre, la tutelle est ici contestée. Mais si l’on peut comprendre la nécessité de se démarquer des autres arts, pourquoi entretenir ce rapport d’amour-haine avec l’École? Et pourquoi craindre autant que désirer que des liens forts soient tissés entre les deux?
Depuis les années 1950, la bande dessinée se développe sous le joug d’une loi de censure, basée sur le fait qu’elle n’avait aucun message légitime à transmettre, qu’elle devait au mieux servir le discours moral ambiant, au pire qu’elle abrutissait la jeunesse et qu’elle devait, pour cela, être contrôlée (Dejasse 2014). Les années 1960-1970 sont marquées par l’apparition des phénomènes dits de contre-culture. Partis des États-Unis et s’étendant rapidement au reste du monde occidental, ils émergent en opposition à une société «technocratique» (Roszak 1969) et prônent l’émancipation individuelle dans tous les domaines, y compris culturels. Sur le plan thématique mais aussi graphique, narratif ou éditorial, la BD va alors «s’emparer de tout ce qui lui était jusqu’alors interdit» (Dejasse 2014), en cherchant à se débarrasser coûte que coûte de son assimilation stricte à la littérature jeunesse. Dans ce contexte, son entrée dans le système scolaire apparaît comme tout sauf un acte de contre-culture. Au contraire, l’École fait partie des premières institutions «technocratiques» qu’il s’agit de combattre, comme en témoigne le mouvement de Mai 68. Néanmoins, ces premières tentatives de didactisation des années 1970 montrent que les théoriciens du neuvième art, tout en œuvrant à son émancipation, ne demeurent pas moins conscients de l’importance de la reconnaissance, à terme, de l’institution scolaire. De même qu’ils ont conscience, eu égard à ce qui a été fait avec la littérature, que cette reconnaissance passera nécessairement par un processus de reconfiguration: en amont, la production devra s’adapter pour garantir la place de la bande dessinée dans les programmes scolaires; en aval, il s’agira de constituer des listes de référence qui détermineront le devenir d’un nombre restreint d’œuvres choisies et enseignées. Alors que la bande dessinée se libère tout juste des chaînes de la censure et des contraintes de la production de masse, il paraît compréhensible qu’elle soit peu encline à s’en créer de nouvelles.
Pour conclure sur cette double décennie, on peut avancer, sans l’y réduire, que la crise de la littérature et de son enseignement joue très certainement un rôle dans le processus d’émancipation de la bande dessinée et dans la place qui se forge progressivement pour elle dans les milieux scolaires. Le canon classique vit des heures difficiles et les conditions pour des changements de pratique semblent réunies. Mais, en période de troubles, il n’est pas rare de voir ces pratiques se recentrer d’autant plus sur ce qui, par essence, est solide, connu et maîtrisé. Les vingt années suivantes ne seront pas marquées par une révolution effective dans les classes de littérature mais constitueront une phase d’aménagement progressif accompagnant un changement de génération des enseignants. Quant à la bande dessinée, elle poursuit en parallèle son processus de reconnaissance institutionnelle, mais peine à trouver sa place dans les classes. Des années de répression ont sans doute rendu le secteur peu enclin à se concentrer sur l’institution scolaire. Auteurs et éditeurs ont certainement d’autres objectifs à atteindre, notamment celui d’en faire un média qui ne serait plus strictement réservé aux enfants pour élargir le réservoir de ses lecteurs. Quoi qu’il en soit, en laissant passer sa chance d’intégrer le cursus scolaire de manière pérenne, la bande dessinée a pris le risque de demeurer longtemps sur le banc des joueurs de second rang.
4.4. De 1980 à 2000: tâtonnements et listes de référence
Dès la fin des années 1970, la littérature en tant que discipline scolaire commence à se réaffirmer: on cesse progressivement de la remettre en cause de manière indifférenciée et on se souvient de l’importance des œuvres littéraires, notamment dans l’apprentissage de la lecture, compétence toujours aussi essentielle à la formation générale. Il n’est cependant plus possible de nier la diversité des contextes de cet enseignement disciplinaire, ni d’ignorer l’impact des théories de la réception, qui valorisent la place du lecteur et prônent le développement d’un goût pour la lecture. Une certaine tension s’agrandit ainsi entre les prescriptions officielles élargies et la pratique enseignante, qui fait preuve de frilosité face à la nouveauté. Sur un plan structurel, Viala et Aron parlent de «tâtonnements dans les cursus» (2005: 79). Les programmes proposés dans les années 1980 oscillent par exemple entre la mission de transmettre une culture adaptée au plus grand nombre – nécessitant l’ouverture du corpus enseigné – tout en travaillant au maintien d’un cadre traditionnel pour définir l’histoire littéraire, qui repose sur la classification chronologique d’œuvres canonisées; une autre recommandation émerge, celle d’aborder des œuvres intégrales, dans le but de développer une lecture cursive censée affiner l’attrait pour la lecture personnelle, alors que de l’autre côté, on renforce l’enseignement de la grammaire et de la rhétorique, laissant ainsi moins de temps pour une approche visant à traiter des œuvres complètes. Bref, ces années semblent marquées par «la multiplicité d’objectifs mis sur un même plan [qui] brouille la perception des enjeux essentiels» (Aron & Viala 2005: 81).
De ce flou émergent deux conséquences contradictoires dans la pratique de l’enseignement. Premièrement, les enseignants disposent, compte tenu des circonstances, d’une marge de manœuvre élargie pour le choix du corpus. Si des listes d’œuvres recommandées sont à disposition, elles ne sont pas – ou peu – imposées. Elles offrent pourtant, à partir de 1977, et en particulier dès 1985, un corpus ouvert à des genres jusqu’ici décriés tels que la littérature jeunesse, les documents de presse ou la littérature étrangère. Or, une enquête précieuse menée par Danièle Manesse et Isabelle Grellet entre 1989 et 1990 (publiée en 1994) montre qu’en dépit d’une réelle liberté d’action, les professeurs interrogés restent très attachés à un patrimoine stabilisé et consensuel. Parmi les œuvres constitutives de leur propre culture, scolaire et personnelle, ils puisent ce qui leur paraît le mieux adapté au nouvel enseignement qui s’impose, notamment en évacuant tous les textes présentant des difficultés de langue ou de contextualisation de l’œuvre8. Ce que les pouvoirs publics préconisent ne passe pas forcément la porte de la classe et, au fond, les professeurs restent les principaux vecteurs de la stabilité d’un patrimoine qu’ils ont eux-mêmes choisi de perpétuer. Deuxième conséquence donc, à l’aube des années 1990, l’heure n’est pas à l’innovation: en dépit d’un investissement très fort du corps enseignant dans la transmission de la littérature, celle-ci renvoie à «une configuration de textes assez semblable à celle qu’on pouvait enseigner dans les années 60.» (Manesse et al. 1994: 103).
Alors même que le contexte semble propice à l’introduction de nouveaux médias en classe de littérature, l’utilisation effective de la bande dessinée se fait donc attendre. L’enquête susmentionnée n’aborde que très peu cette question, se contentant d’indiquer qu’en 1990, la bande dessinée représente seulement 1% du corpus enseigné (Manesse et al. 1994: 54) et encore, principalement sous forme d’extraits. Pourtant, depuis 1987, les programmes scolaires ont introduit l’étude de l’image dans la plupart des cursus, dans l’objectif de répondre aux enjeux du collège unique et des pratiques réelles d’un nouveau public scolaire soumis à une iconosphère de plus en plus prégnante. Mais la bande dessinée sert alors plutôt de support pour l’enseignement d’autres thématiques et tarde à apparaître comme un objectif d’enseignement en soi dans les supports officiels. Entre 1990 et 1993, l’opération intitulée «100 livres pour les écoles» propose quelques albums de référence dans le cadre de la promotion des bibliothèques scolaires9. Mais il faudra attendre que l’éducation à la lecture d’images soit mieux installée et que les différentes étapes menant à la légitimation de la bande dessinée soient entérinées, pour qu’en 1996 les listes de référence proposent enfin aux enseignants 80 albums (sur un corpus de 750 ouvrages) recommandés pour une lecture intégrale, toutes classes confondues10 (Rouvière et al. 2012: 9). Ces 80 titres sont par ailleurs regroupés dans une rubrique distincte, car il s’agit de rendre visible l’ouverture de l’institution à la variété des genres, autant que de notifier clairement leur statut distinctif.
Prescription n’est pas obligation et, en l’absence de recherches effectives sur les pratiques enseignantes après 1996, il est difficile de savoir si et comment ces titres de référence ont été utilisés en classe de littérature. L’article de Bernard Tabuce (2012) permet toutefois de se forger une idée en se fondant sur l’analyse des manuels scolaires, si on les considère comme l’un des reflets possibles des pratiques réelles. En observant les ouvrages édités entre 1996 et 2002, l’auteur tire le constat que la présence de la BD est généralement rattachée à l’approche de notions extérieures à elle-même:
Par-delà les observations techniques sur les bulles, leurs proportions, les onomatopées, le lettrage et les symboles iconiques, il s’agit de discerner les fonctions du dialogue: exprimer les pensées et la personnalité des personnages, faire progresser l’intrigue, introduire une explication. La planche est totalement instrumentalisée au profit de cet objectif. La lecture de l’image semble plutôt réservée en priorité à d’autres formes d’expression (peinture, photographie) et leurs genres (publicité, peinture d’histoire, peinture mythologique, etc.). L’insertion ponctuelle d’une bande dessinée dans les manuels reste généralement subordonnée à des objectifs linguistiques. (Tabuce 2012: 31)
S’il y a donc, sur le plan officiel, une volonté d’inclure le médium dans l’enseignement de la littérature, sa présence reste encore largement soumise à des approches linguistique ou narratologique renvoyant à la logique du récit romanesque traditionnel. Certes, on introduit un lexique spécifique mais en l’absence de réflexions didactiques incluant l’analyse du style graphique ou de la composition de la planche, la bande dessinée n’est encore étudiée ni dans sa spécificité formelle, ni de manière globale. La présence d’extraits dans les manuels n’a rien de très révolutionnaire et va même à l’encontre des développements de la didactique valorisant la lecture cursive d’œuvres intégrales. On peut avancer à l’inverse que pour s’installer véritablement dans les pratiques scolaires, la bande dessinée devrait pouvoir être abordée comme le reste de la littérature. se présentant comme un objet auquel il faut prendre goût, qu’il faut apprendre à décoder, que l’on doit pouvoir rattacher aux univers des auteurs et des courants esthétiques qui se découvrent au fil des œuvres dans un processus de construction d’une «bibliothèque intérieure» (Bayard 2007), plutôt que d’être réduite à des anthologies d’extraits servant à faciliter la compréhension de notions narratologiques applicables à la littérature traditionnelle. En dépit de ces limites, une refonte en profondeur des programmes scolaires est en marche. Ces derniers s’ouvrent progressivement à une conception beaucoup plus large du bagage culturel de base que chaque élève se doit d’acquérir, dans lequel la littérature au sens traditionnel du terme occupe une place de moins en moins dominante.
4.5. De 2000 à 2008: vers une culture humaniste pour tous
À l’aube des années 2000, les discours officiels de l’Éducation nationale française au sujet de l’enseignement littéraire prennent petit à petit une position plus claire vis-à-vis de l’objet littérature. Alors qu’on naviguait jusqu’ici entre un élargissement théorique du corpus et un retour pratique aux valeurs sécurisantes des classiques, les nouvelles instructions de 2002 posent les bases de ce qui sera la tendance du nouveau millénaire: la construction d’une culture commune s’inscrivant dans une continuité des cycles d’apprentissage, et cela dès le cycle 311:
Une culture littéraire se constitue par la fréquentation régulière des œuvres. […] Elle est un réseau de références autour desquelles s’agrègent les nouvelles lectures. Bref, qu’il s’agisse de comprendre, d’expliquer ou d’interpréter, le véritable lecteur vient sans cesse puiser dans les matériaux riches et diversifiés qu’il a structurés dans sa mémoire et qui sont, à proprement parler, sa culture. Si l’on souhaite que les élèves du collège puissent adopter un premier regard réflexif sur ce qu’ils lisent, il est nécessaire que, dès l’école primaire, ils aient constitué un capital de lecture sans lequel l’explication resterait un exercice formel et stérile. (Document d’applications des programmes, Littérature 2002: 5)
L’enseignement littéraire doit alors servir à la constitution d’un capital culturel dont l’élève usera, tant pour enrichir ses pratiques individuelles que pour poursuivre sa formation. L’École renoue ici avec les principes démocratiques en prescrivant un corpus stabilisé et commun dans une logique d’égalité des chances:
En demandant aux enseignants du cycle 3 de choisir les œuvres qu’ils feront lire à leurs élèves parmi les titres d’une large bibliographie, on vise à ne pas restreindre leurs possibilités de construire un trajet de lecture, certes ambitieux, mais aussi véritablement adapté à leurs élèves. Ce trajet doit être varié et permettre la rencontre des différents genres littéraires et éditoriaux habituellement adressés à l’enfance (albums, bandes dessinées, contes, poésie, romans et récits illustrés, théâtre). En guidant leurs choix par une liste nationale d’œuvres de référence, on vise aussi à faire de la culture scolaire une culture partagée. Il importe en effet que tous les élèves aient eu la chance, dans leur scolarité, de rencontrer des œuvres — dont ils puissent parler entre eux, dont ils puissent discuter les valeurs esthétiques ou morales qui y sont mises à l’épreuve —, qui soient ce socle de références que personne ne peut ignorer. (Document d’applications des programmes, Littérature 2002: 5)
La force prescriptive de cet extrait est sans équivoque: la construction d’une culture littéraire commune est nécessaire, elle est le fruit d’un parcours que les enseignants sont sommés de construire à l’aide d’une liste préétablie qui, bien que qualifiée de «large», n’en restreint pas moins les choix individuels du personnel éducatif. Dans cette liste de 2002 pour le cycle 3, qui compte 180 titres, la bande dessinée est toujours représentée, même si l’on note une légère diminution par rapport aux listes des années 1990 (treize titres contre seize pour le même cycle12). En revanche, tant pour la BD que pour la littérature, les œuvres proposées sont souvent contemporaines, ce qui ne va pas sans créer quelques problèmes pour les enseignants, alors très attachés aux œuvres classiques et peu ou mal formés aux créations actuelles. S’agit-il pour l’École de valoriser la création contemporaine? De tenter un brassage complet du corpus canonique, tout en se rapprochant des habitudes individuelles des élèves? La revalorisation de la littérature jeunesse dans ces mêmes années participe sans doute de cette logique et, encore assimilée à une lecture réservée aux enfants, la bande dessinée s’inscrit naturellement dans ce processus, dont elle bénéficie.
Cependant, cette tentative de modernisation du corpus semble n’avoir pas eu de succès puisque, seulement deux années plus tard, une nouvelle liste est publiée. En 2004, cette liste propose 300 titres: par rapport à la version de 2002, elle compte 33 suppressions et 153 ajouts, répartis dans les différentes catégories. Selon le discours officiel, la nouvelle liste privilégie alors les catégories qui comptaient peu de références et «dont l’essor a été remarquable au cours de ces dernières années» (Documents d’application des programmes, Littérature (2) 2004: 5). Le corpus se diversifie donc et les deux plus importantes progressions concernent la bande dessinée et le théâtre (+200%). Quand bien même il faut relativiser leur poids vis-à-vis de l’ensemble – la liste compte 26 albums de bande dessinée et 22 pièces de théâtre pour un total de 300 références12 –, il est intéressant de constater que ces deux genres offrent des possibilités didactiques particulièrement variées et conformes aux nouveaux objectifs préconisés. Dans l’introduction du document d’application de 2002, les propositions de mises en œuvre pédagogiques de l’enseignement littéraire – sans dénier l’intérêt de la lecture cursive – font la part belle aux activités telles que la lecture de l’image, la lecture à voix haute, les procédés de mise en scène et de jeu théâtral, ou encore la réécriture. Théâtre et bande dessinée apparaissent dans ce cadre comme des supports privilégiés pour des approches sortant des sentiers battus, qui sont désormais encouragées. Par ailleurs, l’interdisciplinarité étant à la mode, ces deux genres permettent d’intégrer par exemple les arts visuels, la musique ou encore les outils informatiques.
L’autre élément fondamental de cette version remaniée de la liste est sans conteste l’introduction de deux nouvelles catégories: celle de classique et celle de patrimoine. Totalement absentes de la variante 2002, ces catégories sont étiquetées avec des pictogrammes sur quatre-vingt-trois titres et fonctionnent comme une prescription supplémentaire. La bande dessinée est également concernée et c’est ainsi qu’apparaissent dans la liste des titres estampillés «patrimoine» comme Zig et Puce de Saint-Ogan ou, plus étonnant encore, Max et Moritz de Busch et l’intégrale de Little Nemo de McCay, qui se rattachent respectivement à la bande dessinée allemande et américaine. Ces catégorisations permettent de faire entrer le médium bande dessinée de plain-pied dans le corpus canonique de l’institution scolaire en lui conférant une légitimité nouvelle par la place qui lui est reconnue dans la constitution d’une culture commune.
Sur le plan officiel, les objectifs liés à la constitution de ce répertoire se concrétisent en 2006 avec l’introduction du premier socle commun de connaissances et de compétences, qui modifie cette fois le code de l’éducation dans son ensemble. Le programme s’articule en sept piliers qui constituent ce que «nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé» (Décret du 11 juillet 2006, annexe de l’art. 5). Réponse «à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances» (idem), le socle est censé garantir une continuité dans les programmes et favoriser la dispensation d’un enseignement interdisciplinaire. Ce dernier est particulièrement représenté par le cinquième domaine étiqueté «culture humaniste», dont l’histoire et la géographie sont les fers de lance, mais pas seulement:
La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des œuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des œuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle. (Décret du 11 juillet 2006, art. 5)
Ainsi que l’indique le décret, ces «œuvres littéraires» (dont on notera l’éviction de la bande dessinée de la liste fermée) doivent permettre de préparer les élèves à partager une culture européenne. Si, plus loin, il est fait mention d’un patrimoine pouvant être aussi pictural, théâtral, musical, architectural et cinématographique, force est de constater que la bande dessinée ne figure pas non plus explicitement dans cette liste. La grille de référence qui accompagne ce nouveau domaine ne propose d’ailleurs aucune œuvre graphique. La bande dessinée continue cependant de figurer sur les listes relatives au premier pilier, celui de la maîtrise du français. Un domaine centré sur les compétences techniques de la langue telles que la grammaire et l’orthographe, et où la lecture est ramenée essentiellement à sa dimension utilitariste. C’est cependant le seul domaine auquel la bande dessinée est officiellement rattachée, sous la forme d’un corpus qui n’a pratiquement pas évolué depuis sa version 2004 (deux titres supplémentaires seulement).
Il est vraisemblable que cette éviction de la bande dessinée des prescriptions scolaires soit en corrélation avec la diffusion de Cadre Européen Commun de Référence pour les langues à partir de 200114. En réflexion depuis le début des années 1990, le CECR se présente comme un ensemble d’outils visant à l’élaboration d’une approche commune dans l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères au sein de l’Union européenne. En s'appuyant sur une certaine uniformisation des politiques linguistiques, il s’agit d’améliorer la communication entre les pays membres et de faciliter la mobilité de ses ressortissants. La création du socle commun de connaissances et de référence – qui reprend dans son appellation deux lexèmes popularisés par le CECR: «commun» et «référence» – semble ainsi s’inscrire dans une logique similaire visant une uniformisation des objectifs de formation à l’échelle européenne. On devine aussi que la référence à une «culture humaniste» renvoie implicitement à un horizon multiculturel européen, voire universel, plutôt que national ou francophone. Or, contrairement par exemple à la musique ou la littérature, qui peuvent être perçues comme des pratiques artistiques universelles, l’importance de la bande dessinée varie énormément au sein des cultures. Sur le sol européen, la bande dessinée est une pratique culturelle essentiellement rattachée à la francophonie, et plus particulièrement à l’histoire éditoriale de la production franco-belge. Si l’intégration de ce médium dans les cursus scolaires se discute âprement en France et en Belgique, patries du neuvième art, il en est certainement beaucoup moins question dans les autres pays de l’Union européenne. On peut donc faire l’hypothèse que la scolarisation de la bande dessinée en France a pu être freinée sous l’effet des efforts d’uniformisation des politiques linguistiques et culturelles européenne.
En 2008, l’introduction généralisée de l’enseignement de l’histoire de l’art devenant obligatoire dès l’école primaire, une nouvelle fenêtre d’opportunité s’ouvre pour la bande dessinée. Si cette dernière ne trouve pas sa place dans la «culture humaniste» – en dépit de l’élargissement du corpus des œuvres étudiées – et qu’elle reste confinée à l’étude de la langue dans le domaine du français, alors ce nouvel enseignement semble a priori propice pour une approche d’un corpus plus étoffé. Or, une fois encore, la bande dessinée est absente des documents d’accompagnement (qui se présentent ici, il est vrai, comme purement indicatifs). Dans la liste d’œuvres publiées en septembre 2008, seule la série Alix de Jacques Martin est suggérée pour aborder la période de l’Antiquité. Mentionnée dans la catégorie «arts du langage», elle reste la seule mention explicite de la bande dessinée dans tout le document.
À ce stade de nos observations, une synthèse s’impose: depuis les années 1990, l’enseignement de la littérature tente de se réadapter. Qu’il s’agisse de se centrer sur les pratiques individuelles des lecteurs, de s’ouvrir à différents supports ou d’élargir le corpus canonique, toutes ces évolutions visant à rendre l’enseignement cohérent, actuel et commun auraient pu conduire à ménager une place à la bande dessinée. Pourtant, alors que les disciplines se réorganisent et que les sciences humaines s’ouvrent volontiers à l’interdisciplinarité et aux nouveaux médias, la bande dessinée reste «le parent pauvre» dans les listes des œuvres prescrites et, quand elle est associée aux cursus, c’est le plus souvent «pour enseigner autre chose qu’elle-même» (Rouvière 2012: 10). Le domaine du français l’associe essentiellement à l’acquisition des compétence techniques liées à la langue, auxquelles on voit mal comment rattacher des œuvres comme Little Nemo, dont l’intérêt esthétique et patrimonial réside essentiellement dans sa spécificité de récit graphique.
Du côté de la nouvelle culture humaniste, qui vise à tisser des liens entre les disciplines de manière à accéder à un patrimoine culturel mondialisé, la bande dessinée n’occupe aucune place qui lui soit propre, alors que le cinéma, la peinture et même la chanson sont explicitement mentionnés. Bien sûr, les enseignants sont libres d’enseigner des rudiments d’histoire de la bande dessinée, par exemple, ou de proposer la lecture complète d’un roman graphique, mais cela suppose des compétences, des ressources et un sacrifice de temps dans un programme scolaire déjà chargé, de sorte que de telles initiatives demeurent rares. Absente des programmes officiels et toujours peu didactisée, la bande dessinée n’occupe concrètement qu’une place limitée dans l’enseignement. Son statut hybride, qui oscille entre la revendication de sa spécificité en tant qu’art graphique et un rapprochement stratégique de la littérature en vue d’asseoir sa légitimité culturelle, rend difficile son intégration dans l’un ou l’autre domaine de compétences, en dépit d’une définition toujours plus élargie de ceux-ci. Ainsi, la question se pose encore de savoir par quel biais disciplinaire ce médium doit être abordé.
Enfin, du côté de la littérature, alors que depuis les années 1970, les corpus avaient tendance à se détacher de leur fonction patrimoniale, jugée réductrice et clivante, la culture humaniste réintègre aujourd’hui le panthéon littéraire français. Les termes mêmes de «patrimoine» et de «classique», qui avaient été bannis des discours officiels, font leur retour. Le «socle commun» est présenté par les pouvoirs politiques comme le «ciment de la nation», comme le moyen «de faire partager aux élèves les valeurs de la République» (Décret du 11 juillet 2006, annexe de l’art. 5): dans ce contexte, une terminologie politiquement connotée et lourde de sens s’immisce discrètement, sans autre justification qu’une fin idéologique assumée et dont la littérature reste encore le vecteur principal.
4.6. De 2008 à nos jours: vers une pratique décomplexée
Si, dans sa variante de 2006, le socle commun confère aux œuvres littéraires un rôle central dans l’enseignement de la culture humaniste, en 2015 en revanche, la culture littéraire a été ramenée sans équivoque au niveau des autres pratiques artistiques, au point que le Ministère de l’Éducation s’est senti obligé de s’en justifier:
Pourquoi associer culture littéraire et artistique? La littérature a joué et continue de jouer un rôle important dans la constitution d’une culture commune. Mais les pratiques culturelles contemporaines sont diverses: les sons et les images font partie de notre environnement; le cinéma, la chanson, la bande dessinée associent différents modes d’expression: langue écrite, musique et travail du son, image, mise en scène ou en espace, etc.; enfin internet et les modes d’expression numérique offrent des possibilités illimitées de création qui mettent en jeu, pour les auteurs comme pour le public, les matériaux les plus variés. Associer, dès le cycle 3, une approche de la littérature et une culture artistique très large, c’est faire dialoguer autant que possible le langage écrit dans sa forme la plus élaborée avec toutes les autres formes d’expression et de création. Ce n’est pas absolument nouveau: le théâtre, le cinéma ou les albums illustrés sont déjà présents dans les classes. Il s’agit plutôt de généraliser les rapprochements entre la littérature et les autres modes d’expression.15
Le nouveau socle de 2015, désormais intitulé socle commun de connaissances, de compétences et de culture, poursuit globalement les mêmes objectifs que le précédent (continuité des cycles d’apprentissage et constitution d’un bagage commun). Cependant, il s’articule autour de cinq domaines au lieu de sept auparavant (Décret du 31 mars 2015, art.1). La culture humaniste est remplacée par le domaine «Les représentations du monde et de l’activité humaine», mais reprend les mêmes éléments que son prédécesseur: les œuvres artistiques sont toujours évoquées comme témoins d’un patrimoine national et mondial et sont abordées pour développer l’esprit critique et esthétique des élèves. Le changement le plus intéressant concerne le premier domaine: en 2006, la maîtrise du français constituait la première compétence à acquérir. Dans sa version de 2015, le domaine s’intitule «Les langages pour penser et communiquer» et recouvre des objectifs relatifs à la langue française mais aussi à la maîtrise d’une langue étrangère, du langage mathématique et scientifique et à celui des arts et du corps, dans lequel se retrouvent pêle-mêle activités physiques et créatives. L’art est donc un langage, qu’il s’agit de maîtriser et qui est rattaché au même domaine de compétence que la langue française.
Ce point nous semble particulièrement pertinent pour comprendre l’évolution de la place de la littérature et de la bande dessinée au sein du système scolaire: au fil des décennies, la littérature n’a cessé de perdre du terrain, tout en étant consolidée dans le rôle prépondérant qu’elle joue dans la constitution et la perpétuation d’un patrimoine culturel. Paradoxalement, d’un côté, elle semble mise sur un piédestal, dans le sens où elle constituerait un bien commun essentiel pour créer du lien dans une culture, d’un autre côté, elle est ramenée à sa dimension utilitaire dans le cadre de la maîtrise d’un langage ou d’une langue parmi d’autres. Alors que cette perte de prérogative aurait pu profiter à la bande dessinée – au sens où elle est souvent présentée comme suscitant une motivation et un plaisir esthétique fondés sur sa proximité avec les pratiques privée des élèves – celle-ci semble continuellement souffrir d’un problème de classification, et cela en dépit des différents changements reflétés par les décrets officiels. La ramener à l’objectif de la maîtrise de la langue française, c’est nier sa dimension graphique pour ne s’intéresser qu’au texte; s’en tenir à sa dimension visuelle, c’est en nier l’intérêt textuel et narratif. Enfin, si elle occupe très certainement une place importante dans le patrimoine francophone, sa légitimité culturelle est plus fragile sur une échelle mondialisée et elle tend à se fondre au sein d’une myriade d’autres déclinaisons médiatiques du champ esthétique, noyant une fois de plus ses spécificités et sa portée pédagogique particulière.
L’enseignement d’une culture littéraire et artistique, tel que mentionné plus haut, s’articule désormais autour de grandes entrées, de grandes thématiques, que l’on aborde à travers une combinaison plus ou moins équilibrée d’œuvres appartenant à différents arts ou médias. La bande dessinée y trouve sa place, au même titre que la peinture, le cinéma et la littérature. Mais comme pour les autres formes d’expression, elle se réduit à quelques titres illustrant la thématique étudiée. Par exemple, pour le cycle 3, une des entrées s’intitule «Vivre des aventures & récits d’aventure». La thématique se construit en un parcours progressif du début à la fin du cycle et le corpus qui lui est associé contient autant des œuvres cinématographiques que des albums de littérature jeunesse, en passant par la bande dessinée, le roman et le théâtre. Or, non seulement la liste des récits graphiques proposés pour ce thème ne contient que quatre références, mais on imagine bien la difficulté pour l’enseignant d’aborder indistinctement une pièce de théâtre, un film ou une bande dessinée. Quand bien même elles recouvriraient une thématique commune, chacune de ces œuvres nécessite une approche spécifique et si la formation de l’enseignant est lacunaire dans un média ou un autre, on imagine facilement que des catégories entières d’œuvres puissent être délaissées. En fait, dans cette volonté institutionnelle d’élargir les corpus et de varier les supports, il est fort à parier que les choix des enseignants se feront en fonction des codes médiatiques qu’ils maîtrisent, que cela soit lié à leur formation initiale ou à leurs pratiques personnelles. Dans cette logique, certains iront naturellement vers des œuvres en bande dessinée faisant partie intégrante de leur propre bagage culturel, quand d’autres se sentiront démunis face à l’enseignement de ce médium. Et nous pouvons faire l’hypothèse que, parmi ces derniers, certains s’inscriront dans une voie médiane, qui consiste à se montrer ouvert à l’introduction de la bande dessinée dans leur classe, à condition que l’œuvre sélectionnée soit préalablement didactisée, qu’elle soit accompagnée de supports pédagogiques permettant le déploiement d’une séquence complète d’enseignement.
En France, le socle commun de 2015 est toujours en vigueur et s’articule autour des mêmes cinq grands domaines de compétences. Le site officiel de l’Éducation nationale16 nous informe aussi sur les ressources à disposition des enseignants, en lien avec les exigences du socle. Ainsi, nous constatons que les corpus littéraires n’ont pratiquement pas évolué et qu’ils s’organisent toujours autour de compétences thématiques ou liées aux techniques de la langue. La bande dessinée est quant à elle rattachée à la page disciplinaire consacrée à l’histoire de l’art17, en tant que domaine artistique à part entière. Hormis une conférence sur son histoire, la page consacrée à la bande dessinée renvoie essentiellement au site internet de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême.
Inaugurée en 1990, la Cité est un établissement public qui agit comme un centre de compétences en proposant, entre autres, des congrès, des expositions, une bibliothèque et un musée. Son site offre un volet de médiation culturelle et plusieurs ressources à disposition du personnel éducatif. Celles-ci nous semblent toutefois compliquées d’accès pour un enseignant qui ne disposerait par d’une formation de base sur ce médium. Si certains dossiers pédagogiques proposent des activités presque clé en main, certains s’en tiennent à des éléments théoriques qui doivent encore être articulés en une séquence didactique cohérente. D’autres fiches thématiques restent très succinctes, comme celle consacrée au manga, qui tient sur moins de deux pages; par ailleurs, les œuvres mobilisées en exemple sont globalement peu variées. Ainsi, si la bande dessinée reste présente dans les programmes officiels, sa didactisation est confiée à un acteur qui, bien que légitime dans le champ de la bande dessinée, reste extérieur à l’institution scolaire. Si la Cité agit bien comme un organe de promotion et de mise en réseau des différentes initiatives locales – en offrant également des formations continues et en créant des partenariats avec le corps politique –, elle ne peut néanmoins combler à elle seule le fossé qui s’est creusé entre les pratiques réelles des enseignants et objectifs visés par les programmes.
En 2019, le groupe Bande dessinée du syndicat national de l’édition a publié un état des lieux sur les pratiques effectives au sein des écoles françaises. L’éditorial de son président relève d’emblée qu’en dépit du dynamisme éditorial du secteur et de sa reconnaissance attestée dans le monde culturel au sens large, la place de la bande dessinée dans les milieux scolaires reste modeste. Un sondage effectué auprès des enseignants montre que si 98,6% d’entre eux considèrent le médium comme pertinent sur le plan pédagogique, seule la moitié l’ont intégré dans leur enseignement (Depaire 2019: 11). Le manque de formation initiale, l’absence d’accompagnement et de ressources didactiques sont déplorés, mais pas seulement. L’enquête s’intéresse également aux autres professionnels de l’éducation, comme les responsables des centres de documentation et d’information (CDI) qui gèrent la politique d’acquisition des établissements. Là encore, le manque de connaissance du personnel en charge des acquisition dans les bibliothèques scolaires, mais aussi les contraintes budgétaires liées au prix des albums sont des obstacles de poids dans la mise à disposition de bandes dessinées pour un travail en classe. L’acquisition de bandes dessinées coûte cher et seuls les grands groupes d’éditions spécialisés dans les ouvrages pédagogiques sont en mesure de proposer des prix conformes aux budgets des institutions scolaires. Mais leur catalogue dans le domaine de la bande dessinée reste limité et les librairies spécialisées, dont le personnel serait susceptible d’offrir une expertise permettant de sortir des listes restreintes des best-sellers, sont rarement sollicitées. Parfois, les enseignants n’ont ainsi tout simplement pas les moyens de leurs ambitions.
Sur ce point, le rapport relève l’importance des initiatives locales et dépendantes d’enseignants passionnés. 47% des sondés affirment lire plus de dix bandes dessinées par année et 28% se disent lecteurs réguliers (Depaire 2019: 11). Soutenus par les autorités régionales, une génération d’enseignants, élevés dans un contexte où la lecture de bandes dessinées a été légitimée, fait preuve de créativité pour monter des projets autour du médium. Le résultat de l’enquête permet alors de dresser «un panorama des pratiques éducatives et des initiatives pédagogiques liées au neuvième art, en vue d’imaginer par la suite des leviers adéquats pour développer son utilisation dans les établissements scolaires» (Depaire 2019: 6). Autrement dit, le personnel éducatif pourrait devenir une force de prescription pour un changement en profondeur des programmes scolaires et de la formation initiale des enseignants tels qu'édicté par les autorités politiques. De nombreux projets sont décrits visant à offrir des modèles à systématiser à l’échelle nationale. L’avènement de la bande dessinée en classe pourrait alors venir directement de la pratique effective des enseignants.
5. Conclusion
Ce parcours historique nous a permis de retracer les principales étapes de l’évolution des programmes scolaires français depuis les années 1960 et de souligner les places respectives de la littérature et de la bande dessinée au sein de l’École. En ce qui concerne cette dernière, cette histoire nous semble marquée par une série de rendez-vous manqués: lorsque, dans les années 1970, la littérature est en crise et que les corpus s’élargissent, la bande dessinée entre dans un processus d’émancipation culturelle et se méfie d’une institution pourtant encline à l’accueillir. Les tâtonnements des années suivantes offraient à la bande dessinée l’occasion de se rendre incontournable; pour ce faire, il aurait fallu que les recherches dans le domaine de la didactisation de la bande dessinée soient plus nombreuses, dans la foulée de celles initiées dans les années 1970. Il aurait aussi fallu une plus grande ouverture de la part des enseignants eux-mêmes, les deux facteurs étant en corrélation. Dans les deux cas, on peut postuler que si des tentatives de didactisation sont venues des acteurs de la bande dessinée, avec notamment les ouvrages pionniers de Roux et de Fresnault-Deruelle, le manque de relai de la part des didacticiens et des enseignants pourrait expliquer la création d’un cercle vicieux conduisant à des déficits durables dans la formation initiale des formateurs. Finalement, lors des grands changements introduits en 2006 et en 2015, la redistribution des cartes ne nous apparait pas avoir été particulièrement favorable à l’étude de la bande dessinée. Au contraire, le problème de sa classification disciplinaire reste irrésolu. De plus, nous estimons qu’elle s’est vue formatée avant même d’avoir été pleinement admise au sein des corpus, ce qui entraîne une difficulté à l’inscrire dans un processus de sédimentation et de disciplination (Ronveaux & Schneuwly 2018). Réduite à quelques titres consensuels et à des approches qui ne tirent pas vraiment profit de ses spécificités médiatiques, les bénéfices que l’on aurait pu espérer tirer de sa reconnaissance institutionnelle pour la formation des élèves ont été fortement réduits, voire effacés. Pourtant, de tels bénéfices existent et nous pensons que littérature et bande dessinée récolteraient toutes deux bien des avantages à s’envisager comme complémentaires, chacune pouvant éclairer les spécificités de l’autre pour autant qu’on les envisage dans leur nature propre.
Bibliographie
Ahr, Sylviane & Max Butlen (2015), « Présence et usages de la littérature de jeunesse à l’école et au collège », Le français aujourd'hui, n° 189 (2), p. 37-54.
Aron, Paul & Alain Viala (2005), L'enseignement littéraire, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je? ».
Bayard, Pierre (2007), Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, Paris, Minuit, coll. Paradoxe.
Boltansky, Luc (1975), « La constitution du champ de la bande dessinée » Actes de la recherche en sciences sociales, n° 1 (1), p. 37-59.
Bourdieu, Pierre (1971), « Le marché des biens symboliques » L'Année sociologique, Troisième série, n° 22, p. 49-126.
Brauner, Alfred (1953), « Poison sans paroles », Enfance, n° 6 (5), p. 407-411. En ligne, URL : www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1953_num_6_5_1278.
Crépin, Thierry & Anne Crétois (2003), « La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure », Le Temps des médias, n° 1 (1), p. 55-64.
Dejasse, Erwin (2014), « Contre-culture », in Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée. En ligne, URL : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article722.
Dubois, Jacques (1978), L'institution de la littérature : introduction à une sociologie, Bruxelles, Bernan Natnan & Editions Labor.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2005), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Faur, Jean-Claude (dir.) (1977), Lecture et bande dessinée, actes du premier colloque international « Éducation et bande dessinée » (La Roque-d’Anthéron, 15-16 janvier 1977), Aix-en-Provence, Edisud.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1972), Dessins et bulles : la bande dessinée comme moyen d’expression, Paris, Bordas, coll. Thèmes et Enquêtes.
Groensteen, Thierry (2012), « Neuvième art », Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée. En ligne sur : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article451.
Lesage, Sylvain (2019), L’effet livre. Métamarphoses de la bande dessinée, Tours, Presses Universitaires François Rabelais.
Manesse, Danièle, Isabelle Grellet & Bernard Friot (1994), La littérature du collège, Paris, Nathan, coll. Perspectives didactiques.
Méon, Jean-Matthieu (2009), « L'illégitimité de la bande dessinée et son institutionnalisation : le rôle de la loi du 16 juillet 1949 », Hermès, n° 54 (2), p. 45-50.
Missiou, Marianna (2019 [2012]), « Un médium à la croisée des théories éducatives : bande dessinée et enjeux d’enseignement », in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, coll. Didaskein, p. 79-98.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (dir.) (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Roszak, Theodore (1969), The Making of a Counter Culture, New York, Anchor Books.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2019 [2012]), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, UGA Éditions, coll. Didaskein.
Roux, Antoine (1970), La bande dessinée peut être éducative, Paris, Éditions de l’École.
Sainte-Beuve, Charles-Augustin, (1887 [1850]), « Qu’est-ce qu’un classique? » in Causeries du lundi, tome 3, Paris, Garnier frères, p. 38-55.
Tabuce, Bernard (2019 [2012]), « Une urgence iconologique qui dure : l’enseignement de la BD dans les manuels de collège » in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, coll. Didaskein, p. 25-44.
Töpffer, Rodolphe (1845), Essai de Physiognomonie, Genève, Éditions Schmid.
Viala, Alain (1992), « Qu'est-ce qu'un classique? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 1, p. 6-15.
Textes de loi et décrets
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. En ligne sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068067&dateTexte=20100817.
Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation *Loi Haby* (abrogée en 2000). En ligne sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174.
Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation. En ligne sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/11/2006-830/jo/texte.
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En ligne sur : https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/31/2015-372/jo/texte.
Documents officiels du Ministère de l’Éducation nationale
Document d’application des programmes, Littérature – Cycle des approfondissements (cycle 3), (2002). En ligne sur : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/84/6/Cycle_3_-_Litterature_-_2002_MLFLF_1023846.pdf.
Document d’accompagnement des programmes Littérature (2) – Cycle des approfondissements (cycle 3), (2004). En ligne sur : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/84/8/Cycle_3_-Litterature-_notices2004_MLFLF_1023848.pdf.
Maîtrise de la langue française – Liste de référence 2007 des œuvres de littérature pour le cycle III, (2007). En ligne sur : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/84/2/Cycle_2-Litterature-2007_MLFLF_1023842.pdf.
Histoire des arts – Liste d’exemples d’œuvres (2009). En ligne sur : https://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf.
La littérature à l’École – Liste de référence cycle 3, (2013). En ligne sur : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/85/8/Cycle_3_Litterature_2013_MLFLF_1023858.pdf.
Divers
Depaire, Colombine (2019), « État des lieux : La place de la Bande dessinée dans l'enseignement », étude réalisée par l’agence Picture This ! à la demande du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition. En ligne, URL : https://www.sne.fr/app/uploads/2019/02/SNE-PictureThis_etat-des-lieux-BD-ecole_janv2019_2.pdf.
Rapports Ratier, 2000-2016 - Une année de bandes dessinées sur le territoire francophone européen © Gilles Ratier, secrétaire général de l’ACBD : www.acbd.fr.
Site internet officiel du gouvernement français pour « BD 2020 » : https://www.bd2020.culture.gouv.fr/
Site de références bibliographiques : https://www.bdgest.com/
Pour citer l'article
Sophie Béguin, "La bande dessinée dans les classes de littérature: entre prescription et pratique ", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-dans-les-classes-de-litterature-entre-prescription-et-pratique
Voir également :
Enseigner les mémoires graphiques au degré post-obligatoire: réflexions et pistes didactiques
L’étude de la bande dessinée, pour elle-même et en tant qu’objet d’enseignement et d’apprentissage à part entière, peine à se développer, particulièrement en contexte scolaire post-obligatoire (Rouvière 2012). Envisagée par certain·e·s comme une sous-littérature, la bande dessinée est en revanche, par d’autres, considérée comme faisant partie intégrante du panorama des productions littéraires contemporaines (Bomel-Rainelli & Demarco 2011). Pourtant, à l’heure où les pratiques culturelles ordinaires sont marquées par une forte présence de l’image, particulièrement en ce qui concerne la lecture, l’écriture et l’expression de soi des adolescent·e·s, l’enseignement d’objets littéraires hybrides en classe se justifie plus que jamais. En l’occurrence, par sa caution à la fois littéraire et artistique, le roman graphique présente un intérêt particulier pour l’enseignement du français. En effet, le choix de cet avatar de la bande dessinée répond à une conception dynamique des corpus scolaires qui, comme le suggère François Bon, gagnent à être renouvelés afin de permettre aux élèves de se construire et de se situer en tant que sujets contemporains.
Enseigner les mémoires graphiques au degré post-obligatoire: réflexions et pistes didactiques
Il faut renouveler le corpus de textes abordés dans les classes: se saisir de ce que la littérature peut avoir de plus contemporain (pour que résonne une expérience présente du monde) et de plus radical (pour que puissent advenir frictions, secousses, courts-circuits).
François Bon, Apprendre l’invention
L’étude de la bande dessinée, pour elle-même et en tant qu’objet d’enseignement et d’apprentissage à part entière, peine à se développer, particulièrement en contexte scolaire post-obligatoire (Rouvière 2012). Envisagée par certain·e·s comme une sous-littérature, la bande dessinée est en revanche, par d’autres, considérée comme faisant partie intégrante du panorama des productions littéraires contemporaines (Bomel-Rainelli & Demarco 2011). Pourtant, à l’heure où les pratiques culturelles ordinaires sont marquées par une forte présence de l’image, particulièrement en ce qui concerne la lecture, l’écriture et l’expression de soi des adolescent·e·s, l’enseignement d’objets littéraires hybrides en classe se justifie plus que jamais. En l’occurrence, par sa caution à la fois littéraire et artistique, le roman graphique présente un intérêt particulier pour l’enseignement du français. En effet, le choix de cet avatar de la bande dessinée répond à une conception dynamique des corpus scolaires qui, comme le suggère François Bon, gagnent à être renouvelés afin de permettre aux élèves de se construire et de se situer en tant que sujets contemporains.
Le terme «roman graphique» (graphic novel), en tant que label, s’installe dans les années 1980, dans un premier temps dans la culture anglo-saxonne, pour légitimer une production caractérisée par des récits longs non sériels (one shot), destinés à un public adulte, et qui se démarque de la bande dessinée américaine (comics1), à connotation souvent enfantine et divertissante. Le label désigne dès lors une bande dessinée d’auteur·trice, traitant de thématiques plus sérieuses et qui, pour ce faire, s’affranchit de certains standards éditoriaux pour se rapprocher du format plus libre du roman (Baetens 2012). À cela s’ajoute un style plus personnel, souvent en noir et blanc, soit une recherche d’authenticité par le biais du dessin. Les propriétés matérielles du roman graphique et son mode de diffusion poursuivent également une volonté de démarcation, puisque le format, la qualité du papier et le type de couverture s’éloignent des formes de publication traditionnellement associées à la bande dessinée, notamment par le choix de maisons d’éditions littéraires ou de microstructures d’autoédition (Baetens 2012: 204). Sans entrer dans le débat portant sur la légitimation littéraire de la bande dessinée, qui a été sans conteste atteinte avec Maus d’Art Spiegelman (Prix Pulitzer 1992), l’intérêt du roman graphique se situe dans sa manière de tisser des liens étroits entre bande dessinée et littérature, notamment par un régime narratif caractérisé par un dédoublement de l’énonciation. L’acte d’énonciation verbal est en effet accompagnéd’une énonciation graphique qui élargit les possibles en matière de narration, en dotant les images d’un pouvoir narratif aussi, voire plus, important (Baetens 2012: 214). Ainsi, l’instance narrative du roman graphique est davantage polysémique que celle d’un texte littéraire «classique», non visuel (Baetens 2009: 6).
En outre, il y a une prééminence de l’autobiographie au sein de la catégorie «roman graphique» (Baetens 2012). Les auteurs·trices s’en emparent en effet pour exploiter les subtilités narratives offertes par le support composite et ainsi enrichir le récit verbal d’un récit visuel porteur d’une authenticité autobiographique inédite. L’étiquetage roman graphique pose dès lors problème, dans le sens où l’appellation générique «roman» renvoie à une part fictionnelle qui n’est pas centrale dans ce type de production. Hillary Chute suggère d’user de l’appellation «récit graphique». Cette dernière a l’avantage de mettre en avant la dimension narrative de ces œuvres, en y incluant leur part non fictionnelle, ceci tout en les liant au label générique, plus vaste, du roman graphique (Chute 2008: 453). Elle ajoute notamment que la particularité des récits graphiques est leur manière de tisser des liens entre ce qui est dit et ce qui est montré, ceci en explorant les frontières entre histoire collective et histoire singulière. Nancy Pedri (2013) propose, quant à elle, l’usage du terme «mémoire graphique», qui reflète la dimension non fictionnelle, en même temps qu’il renvoie à la complexité de toute représentation graphique de soi (autoréflexivité, mémoire, identité). Notre proposition abordant un corpus de roman graphiques autobiographiques, dont la part non fictionnelle est assumée et revendiquée par les auteurs·trices, l’hyperonyme récit graphique et l’appellation plus spécifique mémoire graphique nous paraissent être les plus à même de rendre compte de leur richesse et singularité.
En y réfléchissant du point de vue de l’enseignement, il nous semble que le récit graphique, par la vision vivifiante qu’il offre de thématiques touchant à la fois au singulier et au collectif, a une certaine légitimité à figurer parmi les lectures qui permettent «de découvrir, dans toute sa diversité, la relation de l’homme à lui-même, à autrui, à la réalité sociale, politique et culturelle» (Plan d’étude vaudois pour l’école de maturité: 16). En outre, la narration simultanée et multimodale (modes textuel et iconique) demande au lecteur·trice «[d’opérer] des allers-retours entre lecture et contemplation du sens» (Chute 2008: 452). Il·elle est en effet appelé·e à interpréter le sens à partir de la combinaison simultanée des différents modes, en même temps qu’il·elle entre dans un plaisir contemplatif développant sa sensibilité esthétique à l’hybridation entre littérature et arts visuels (Schaeffer 2016). En ce sens, la littérarité du récit graphique dépasse une simple volonté de transposer certains procédés textuels présents dans les autobiographies littéraires. Au contraire, elle repose sur un pouvoir narratif nouveau accordé aux images, qui renverse la hiérarchie entre représentation textuelle et représentation visuelle, pour décloisonner et renouveler le genre de l’autobiographie (Baetens 2012).
Aborder le récit graphique au degré post-obligatoire est d’autant plus pertinent si l’on considère que la nature multimodale (Lebrun, Lacelle & Boutin 2012; 2017) du support fait écho aux pratiques culturelles ordinaires des adolescent·e·s. L’omniprésence de l’image dans leur quotidien – que ce soit dans la consommation de séries ou de plateformes vidéo, dans leurs moyens de communication ou de socialisation – légitime l’enseignement d’une production, qui en plus d’être extrêmement riche en possibilités de développer des compétences propres à la lecture littéraire (Simard, Dufays, Dolz & Garida-Debanc 2010), permet également de favoriser l’acquisition d’une compétence critique de l’image (Lewis 2001).
Ainsi, l’enseignement du récit graphique, peu présent en classe de littérature, permet de se rapprocher de la culture adolescente, pour favoriser le développement de la littératie multimodale, mais également pour forger une sensibilité esthétique problématisant l’exhibition de soi encouragée par le numérique (Han 2017). Face aux problèmes d’immersion ressentis par certain·e·s élèves à la lecture d’œuvres du patrimoine littéraire (Vandendorpe 2012), le récit graphique est un intermédiaire foisonnant, facilitant une lecture engagée et créant des ponts entre littérature, arts et usages ordinaires, enjeux soulignés notamment par Marianna Missiou:
Enseigner la bande dessinée est un défi que l’enseignement scolaire doit relever, en particulier pour établir les liens entre la littératie traditionnelle et les nouvelles formes de la culture médiatique. Mais il ne s’agit pas seulement de former des lecteurs experts et critiques, aussi bien à l’aise dans le monde des lettres que celui des représentations figuratives, pour démêler les productions discursives combinant des codes variés. Il s’agit aussi de former des lecteurs sensibles, impliqués, entrant en résonance symbolique avec les œuvres, pour s’accomplir à part entière comme sujets-interprètes. (Missiou 2012: 98)
Nous mènerons une réflexion sur l’apport du récit graphique à l’enseignement du français au degré post-obligatoire. Écrits à la première personne, avec une identification assumée entre auteur·trice, narrateur·trice et personnage, ce qui implique clairement la présence d’un pacte autobiographique (Lejeune 1975), ces récits abordent l’intime et des thématiques contemporaines complexes, qui résonnent avec l’expérience du monde actuel. De plus, les dimensions langagières et visuelles lient et confrontent les pratiques adolescentes de mise en scène de soi à un pendant littéraire qui dépasse les formes exhibitionnistes pour viser, au contraire, une esthétisation du vécu par un processus d’auto-construction de soi. Dans les pages qui suivent, nous tenterons d’explorer les richesses des mémoires graphiques dans une volonté d’en saisir le potentiel pour l’enseignement de la littérature, ceci en esquissant quelques pistes didactiques à partir d’un corpus composé de Fun Home (Bechdel 2006), Persepolis (Satrapi 2000-2003) et Wonderland (Tirabosco 2015)2.
Les spécificités du mémoire graphique
Pour comprendre l’intérêt du mémoire graphique pour l’enseignement de la littérature, il convient d’en expliciter les composantes narratives et les caractéristiques, par rapport à un récit autobiographique «traditionnel». En mettant en évidence ses éléments constitutifs3, nous souhaitons montrer la manière dont celui-ci engage les élèves dans une posture active de lecteur·trice·s-interprètes. Dès lors, nous abordons le récit graphique à la fois comme une lecture stimulante et motivante pour les élèves (lecture plaisir) et comme une lecture permettant de développer des compétences en lecture et interprétation littéraires (lecture savante) (Simard, Dufays, Dolz & Garida-Debanc 2010).
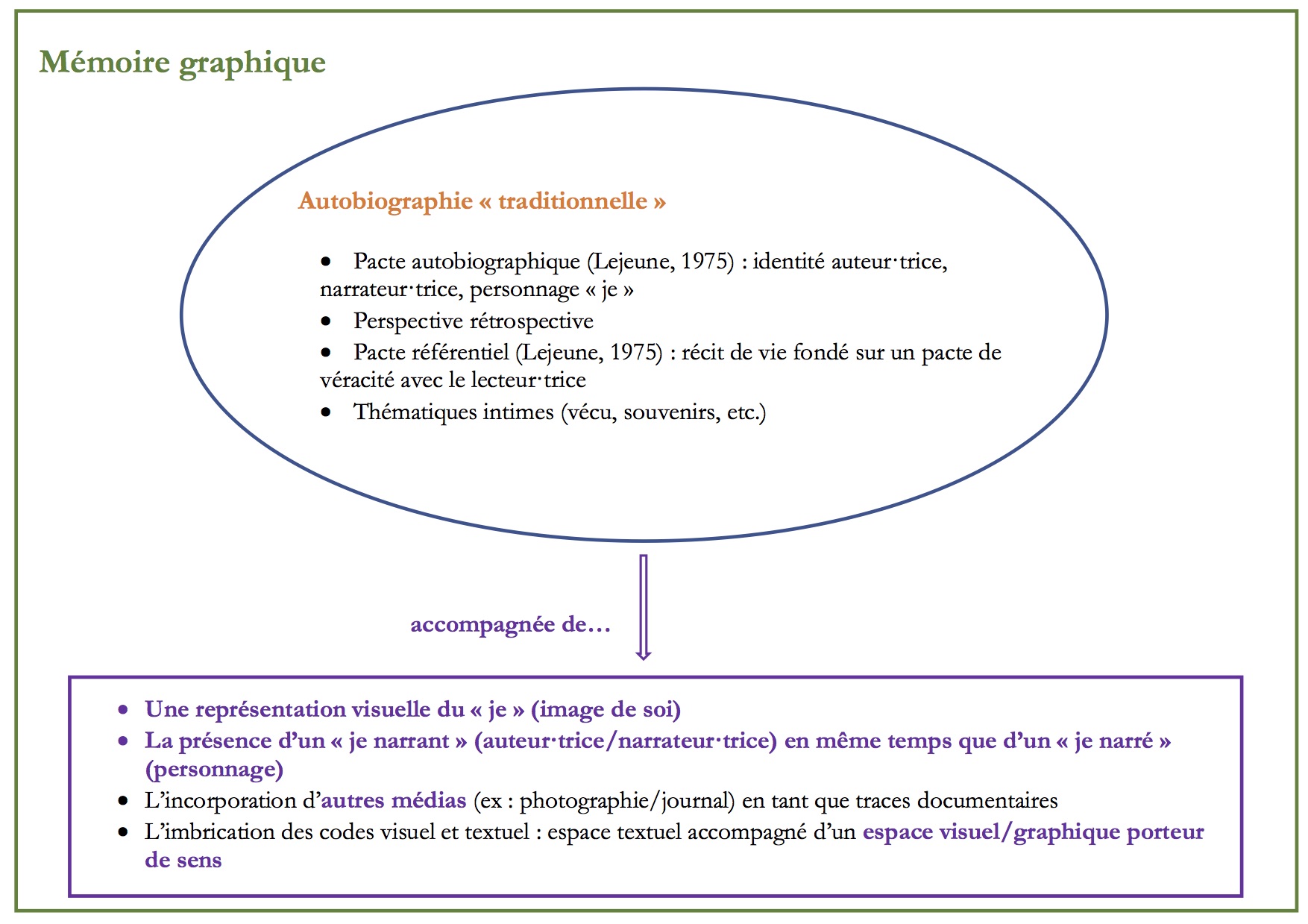 Figure 1: Les composantes narratives du mémoire graphique
Figure 1: Les composantes narratives du mémoire graphique
La bulle bleue regroupe les caractéristiques principales de la narration autobiographique traditionnelle. En plus du pacte autobiographique, déjà mentionné, ce genre se démarque par l’adoption d’une perspective rétrospective. Le narrateur homodiégétique (Genette 1972) est à la fois l’instance énonciative cadrant le récit et le personnage principal des événements relatés. Le «je» revient sur son passé pour y puiser souvenirs, anecdotes et expériences intimes vécues. Son récit est en outre fondé sur un pacte référentiel avec le lecteur·trice, par lequel est affirmée l’authenticité des faits narrés.
Le mémoire graphique (encadré vert) repose sur les mêmes rouages, qui sont augmentés et enrichis par le support graphique de la bande dessinée (en violet). Ainsi, en plus d’éléments descriptifs renvoyant aux perceptions, pensées et émotions – présentes ou passées – du «je» auteur·trice/narrateur·trice/personnage, le support graphique inclut également sa représentation physique à travers le temps (autoportrait du «je» enfant/adolescent·e/adulte). Cette instance cadre notamment le récit par le biais de récitatifs, tout en apparaissant sur les planches (représentation visuelle) et en étant le personnage principal des souvenirs exposés. Sur une même planche peuvent donc coexister un «je narrant» (auteur·trice/narrateur·trice) et un «je narré» (personnage). En ce sens, le support graphique permet de réunir les différents temps du récit, présent et passé, dans un espace-temps partagé (ou «spatio-topie» selon Groensteen 1999: 25-26). Lors de la lecture, la présence simultanée de textes et d’images a le potentiel de créer des effets de temporalité inédits où narrateur·trice et personnage coexistent au sein de l’espace-temps de la planche, tout en renvoyant chacun à une temporalité propre. Par ailleurs, le récit graphique permet l’imbrication ou la reproduction d’autres médias, tels que des photographies ou des extraits de sources secondaires (journal, page de livre, etc.), qui enrichissent le pacte référentiel ou la dimension historique du récit, par la présence d’éléments ayant une valeur documentaire. Au sein du support graphique, l’apparition visuelle d’autres médias crée des strates de significations originales et riches, identifiables et interprétables par le lecteur·trice, indépendamment des bulles (intradiégétiques) et des récitatifs (extradiégétiques) contenant du texte.
La particularité de la narration graphique, et plus largement de la bande dessinée, est donc qu’elle s’appuie autant sur le code textuel que sur le code iconique, les deux modes s’imbriquant dans une relation d’interdépendance pour produire le récit. Ainsi, les deux contribuent à la création d’effets de sens saisissables pour le lecteur·trice qui navigue, hiérarchise et interprète les images en même temps que le texte. En ce sens, le support de la bande dessinée place l’interprète dans une posture active, puisqu’il est appelé: à comprendre les enjeux de la narration multimodale, soit la combinaison intrinsèque de deux modes distincts produisant du sens (textuel et visuel); à décoder les effets du récit à partir du tissage entre les différentes unités de la bande dessinée intégrées dans une séquence (case, bande, planche, album); ainsi qu’à produire du sens sur la base des qualités esthétiques et expressives du dessin.
Les enjeux de la narration multimodale
Pour illustrer l’imbrication de différents modes au sein du récit graphique, nous proposons de partir d’un exemple de double planche tiré de Fun home: une tragicomédie familiale. Il s’agit d’un récit sur le passage de l’enfance à l’âge adulte (récit d’apprentissage ou coming-of-age) de l’autrice et illustratrice Alison Bechdel, qui retrace plus particulièrement les liens complexes entretenus avec son père, décédé à l’âge de quarante-quatre ans des suites d’un accident, aux allures de suicide. Ayant appris à l’âge adulte l’homosexualité cachée de son père, cette dernière part à la recherche des traces de ce secret familial dans ses souvenirs d’enfance et d’adolescence. Fun home est une autobiographie familiale aux thématiques multiples, telles que l’identité, la complexité des liens familiaux ou la découverte de la sexualité.
Cette double planche se situe au cœur du récit et se présente par le biais d’une mise en page «décorative», à l’intérieure de laquelle prime une organisation esthétique du contenu narratif (Peeters 2003). Elle intervient dans le récit d’un souvenir où la narratrice, alors étudiante, revient dans la maison de famille et découvre, dans une boîte, une photographie prise par son père, à un moment où l’orientation sexuelle de ce dernier lui était encore inconnue. La photographie représente Roy, l’ancien jardinier et baby-sitter de la famille, dans une posture dénudée permettant de comprendre la relation intime qui le liait à son père. Ce moment du récit est particulièrement intéressant à aborder: d’abord, parce qu’il se démarque de la mise en page rhétorique habituelle de Fun Home, composée de cases de tailles différentes dans le reste de l’album; mais également parce qu’il thématise l’homosexualité du père par l’incrustation et la reproduction visuelle du médium de la photographie, ainsi que par la juxtaposition de strates de temporalité au sein du même espace spatio-topique. La voix présente dans les récitatifs renvoie à Alison-adulte et au temps de la narration; la main à la temporalité du souvenir raconté, où le personnage Alison-adolescente découvre la boîte; et la photographie à une période antérieure où la protagoniste était une enfant. Ce feuilletage temporel est par ailleurs hiérarchisé, les récitatifs apparaissant au premier plan. Par le biais de l’organisation esthétique du contenu, la temporalité de l’instance narrative prend le dessus sur les temporalités racontées, montrant ainsi visuellement la primauté de la voix d’Alison-narratrice pour la compréhension et la perception des événements racontés.

Alison Bechdel, Fun Home: une tragicomédie familiale, p.104-105 © Éditions Denoël 2006.
À travers cette double planche, on peut s’attarder sur les effets d’immersion possibles à partir de l’hybridation entre le texte et l’image, impliquant les lecteur·trice·s dans une activité interprétative importante. L’immersion en question repose d’abord sur le cadrage, qui signale une rupture narrative. Cette double planche étant précédée et succédée par des planches «classiques» (avec une articulation entre plusieurs cases comprenant des dialogues), cet effet de rupture permet au lecteur·trice de comprendre qu’il s’agit d’un épisode central du récit. À cela s’ajoutent les trois strates de temporalités, lors de la lecture conjointe des illustrations et des récitatifs, qui cadrent le récit du souvenir en même temps qu’ils reproduisent les pensées et émotions de la narratrice. Il y a en effet une plongée dans la temporalité de la photographie, par le biais d’une technique d’«ocularisation interne primaire», plaçant le lecteur·trice dans la vision subjective du personnage (Jost 1989). L’ocularisation interne primaire «renvoie au point de vue interne du personnage sur lequel le récit est focalisé» (Baroni 2020: 9), soit dans cet exemple la main du personnage, qui permet au lecteur·trice de comprendre qu’il·elle est placé·e dans la subjectivité d’Alison-étudiante. Cette forme de complicité entre le lecteur·trice et le personnage est également encouragée par le plan rapproché et le placement physique de la main du lecteur·trice sur celle du personnage lors de la lecture de cette double planche.
Sur cette base, on peut entamer un travail de repérage, d’analyse et interprétation, en mettant l’accent sur les capacités inférentielles des élèves, convoquées par l’hybridation texte-image (multimodalité), ainsi que sur les codes spécifiques de la bande dessinée. En l’occurrence, cet exemple illustre les enjeux de l’utilisation co-dépendante des deux codes sémiotiques, invitant le lecteur·trice à interpréter l’homosexualité secrète du père. La rupture dans le tissage iconique (double planche, absence de cases et de dialogues, cadrage, etc.), la reproduction visuelle du médium de la photographie et le commentaire de la narratrice-adulte sur «la façon dont [son père] jonglait entre sa personne publique et sa réalité privée» se nourrissent simultanément pour suggérer le secret du père, sans que celui-ci soit verbalement explicité à ce moment du récit. Par ailleurs, la mise en page, et les multiples strates de profondeurs qu’elle recèle, suggèrent également la complexité de la thématique de l’homosexualité, qui se situe au cœur de l’œuvre.
Explorer les enjeux de l’utilisation conjointe des modes visuel et textuel dans Fun Home, et plus largement, dans le système de la bande dessinée, permet de saisir la manière unique dont ce médium produit du sens. En effet, la compréhension du système de la narration graphique ouvre la voie à une richesse interprétative spécifique au support, permettant de développer des compétences en analyse et interprétation inédites, que la littérature «classique» ne pourrait exprimer avec des moyens exclusivement verbaux. L’élève aurait dès lors le potentiel de développer à la fois des compétences en interprétation de texte et en interprétation d’images. L’album permet en ce sens de travailler à l’acquisition d’une littératie multimodale, à partir de la compréhension et de l’analyse des mécanismes énonciatifs du récit graphique.
Construction du sens à partir de la séquence
En parallèle des enjeux liés à sa nature plurisémiotique, nous souhaitons montrer comment le récit graphique construit des effets de sens à partir de la disposition spatio-topique, plus spécifiquement à partir des liens entre les images fixes et la séquence dans laquelle elles apparaissent (interrelations entre vignette, bandeau, planche, double planche, etc.). Afin d’illustrer cette dimension, nous proposons de commenter deux planches tirées de Persepolis de Marjane Satrapi (2000-2003). Persepolis est un mémoire graphique en noir et blanc, retraçant les étapes marquantes de la vie de la narratrice, Marji, de son enfance vécue à Téhéran durant la révolution islamique, jusqu’à son adolescence et début de vie d’adulte en Autriche. Cet extrait, qui apparaît dans la deuxième partie du récit (tome 2), se situe dans le contexte de la révolution iranienne. L’épisode retrace un souvenir d’enfance, en l’occurrence le retour de Marji-enfant et de sa mère dans leur quartier de Téhéran, après une série de bombardements. Découvrant les ruines de maisons et bâtiments détruits par les bombes, l’enfant questionne sa mère au sujet d’amis de la famille dont la maison a été visiblement détruite. Tandis que la mère tente de l’éloigner des lieux (les personnages se dirigent à droite, hors case), cette dernière découvre un bracelet appartenant à son amie Néda, qui lui confirme la mort probable de cette dernière.

Marjane Satrapi, Persepolis © L’Association 2007.
La narration, homodiégétique, est entièrement prise en charge par les récitatifs de la narratrice-adulte, qui raconte un épisode marquant de son enfance en Iran, en tentant de verbaliser son ressenti au moment des faits. Dans ce but, le foyer perceptif évolue pour adopter progressivement le point de vue du personnage (Marji-enfant). Le lecteur·trice passe donc d’un point de vue externe, qui correspond aux cadrages adoptés dans les quatre premières cases, vers un point de vue interne dans la toute dernière case (Baroni 2017b). Tandis que le développement du récit des cinq premières vignettes repose principalement sur les récitatifs de la narratrice-adulte, que les images illustrent, les trois cases en fin de séquence opèrent un glissement progressif vers le point de vue interne de l’enfant, d’abord en montrant ses émotions par des plans rapprochés sur son visage, puis par le biais d’une case noire, qui correspond à une ocularisation interne, puisque la fillette cache ses yeux pour ne pas voir le spectacle, l’image étant accompagnée du commentaire «aucun cri du monde n’aurait suffi à soulager ma souffrance et ma colère.». Par ailleurs, le moment où le récit adopte le point de vue interne du personnage, la prise en charge du récit est davantage déléguée à l’expressivité du dessin. Dès lors que l’héroïne (Marji-enfant) place ses mains sur les yeux, le lecteur·trice est invité à s’immerger dans le point de vue de l’enfant, par le biais d'une case noire qui exprime en quelque sorte l’indicible et incite à interpréter et ressentir ses émotions (souffrance, deuil, etc.). En d’autres termes, il s’agit d’un moment de débrayage du point de vue de la narratrice pour se réancrer dans le point de vue du personnage. La case noire, qui clôt le récit du souvenir, est située à la fin de la séquence et du chapitre «Le Shabbat» (tome 2). Elle peut être interprétée comme une ellipse, dont l’effet est de créer une rupture narrative servant, d’une part, à renforcer l’importance de ce souvenir traumatisant, d’autre part, à focaliser l’attention du lecteur·trice sur les émotions de Marji-enfant. Agissant comme un support immersif, l’adoption du point de vue du personnage favorise une lecture affective, à partir d’une démarche analytique visant à déceler et à interpréter les effets de sens présents dans le tissage iconique de cette séquence. Il y a donc de la part du lecteur·trice un va-et-vient entre une lecture participative et une lecture distancée, ce qui correspond à la lecture littéraire, telle qu’elle a été développée dans les recherches en didactique du français (Dufays, Gemenne & Ledur 2015).
Le deuxième exemple est tiré de la dernière partie du récit (tome 4, chapitre «Les Chaussettes»), dans laquelle Marjane quitte l’Autriche et revient en Iran. Bien que la guerre soit terminée, Téhéran est toujours aux prises avec le fanatisme religieux, qui se manifeste notamment par une restriction importante des libertés individuelles. En l’occurrence, c’est un passage où la narratrice revient sur la nécessite, pour une femme, en Iran dans les années 1980, de maintenir une séparation entre une identité privée et une identité publique. La planche thématise la pression exercée par l’État islamique d’Iran, sur la liberté et l’identité féminines.

Marjane Satrapi, Persepolis © L’Association 2007.
Alors que les récitatifs explicitent les enjeux entre l’identité publique et l’identité privée, la disparité entre les deux étant associée à une forme de schizophrénie, c’est par le biais de la comparaison visuelle entre les deux vignettes que le lecteur·trice peut interpréter cette problématique centrale. En ce sens, les récitatifs cadrent et guident le récit, tandis que l’implication du lecteur·trice est activée par l’organisation et les choix graphiques de la planche. Le dispositif «en miroir» incite en effet à s’arrêter sur les deux images pour les comparer et réfléchir à la question de l’identité féminine aux prises avec la religion. En outre, la protagoniste n’est reconnaissable que sur la bande inférieure, dans son identité privée. Le dispositif graphique encourage dès lors une forme de suspension réflexive, visant à comparer les deux images de près. Sur la vignette du haut, les femmes sont représentées debout, et portent toutes la même tenue. Seuls certains attributs, les lunettes par exemple, et les expressions du visage (colère, sourire, perplexité) permettent une forme d’identification ou de différentiation. En comparaison, sur la bande inférieure, les femmes sont représentées dans des postures plus hétérogènes (assise, debout). De plus, la diversité des coupes de cheveux et des tenues vestimentaires (robes, décolletés, etc.), la présence d’attributs tels que le rouge à lèvres ou les bijoux, ainsi que la variété d’expressions faciales connotant de la joie, ce qui permet au lecteur·trice de produire certaines inférences au sujet de l’emprise des autorités iraniennes sur l’existence et l’identité sociales, sans que cela soit explicité par la narratrice. La mise en œuvre d’une compétence critique de l’image permet dès lors de comprendre les valeurs véhiculées par le dessin, que le texte seul ne permet pas de construire. En effet, l’appropriation des codes multimodaux de la narration graphique encourage le développement «d’une compréhension beaucoup plus explicite du sens porté par l’image en elle-même comme dans ses interactions avec le texte» (Boutin 2015: 35).
Plus généralement, la familiarisation avec les mécanismes narratifs et immersifs propres à la bande dessinée favorise l’élaboration d’une appréciation argumentée des œuvres. En travaillant l’analyse et la compréhension des procédés impliqués dans la narration graphique, notamment en lien avec le tressage iconique entre les images, les élèves sont invité·e·s à adopter une distance critique qui, en retour, favorise une lecture plus affective des œuvres. L’actualisation d’une lecture engagée passe en ce sens par une première phase, analytique – processus que nous avons tenté d’illustrer en convoquant les deux exemples de Persepolis. C’est précisément dans ce passage délicat entre lecture savante et lecture plaisir qu’intervient l’enseignant·e, d’une part en proposant des œuvres renvoyant à l’histoire contemporaine, d’autre part en guidant les élèves dans l’approche d’un nouvel objet, intrinsèquement multimodal, ayant ses propres codes de lecture, d’analyse et d’interprétation.
Sensibilisation aux dimensions esthétiques
L’une des spécificités de la narration graphique étant la rencontre entre littérature et arts visuels, dans cette partie, il s’agira d’explorer l’esthétique visuelle du mémoire graphique dans sa capacité, d’une part, à engager le lecteur·trice dans l’activité d’analyse et d’interprétation à partir de l’image, d’autre part, à laisser une place importante à sa subjectivité, qui puisse mener au développement d’une relation esthétique aux objets littéraires (Schaeffer 2016). En d’autres termes, il s’agit de sensibiliser les élèves aux dimensions artistiques des albums afin de stimuler leur «immersion mimétique dans l’univers représenté» (Schaeffer 2016: 17). Nous souhaitons donc réfléchir à l’actualisation du récit par le sujet-lecteur·trice (Rouxel 1996; Rouxel et Langlade 2004) à partir de la monstration visuelle, en tâchant «d’objectiver les vecteurs immersifs et intrigants mobilisés par l’auteur» (Baroni 2017a: 83), en l’occurrence par l’intermédiaire du dessin.
Notre argument sera illustré par une double planche du mémoire graphique Wonderland de Tom Tirabosco (2015). Celui-ci relate l’enfance et les liens familiaux du narrateur Tommaso – allant de la rencontre de ses parents à la naissance de son frère Michel, physiquement handicapé – en même temps qu’il dévoile les multiples influences ayant façonné l’imaginaire de l’auteur et illustrateur. Wonderland est donc un mémoire graphique centré à la fois sur les relations familiales et sur la relation esthétique à différents univers littéraires et artistiques. En ce sens, le récit graphique se présente comme une mise en abyme de l’univers créatif de Tirabosco, qui transparaît par le biais de l’expressivité et de la valeur métaphorique du dessin. La double planche qui nous intéresse plus particulièrement apparaît au début du récit. Elle thématise le rapport privilégié que l’auteur/narrateur entretient avec la lecture, en l’occurrence celle de bandes dessinées.

Tom Tirabosco, Wonderland © Atrabile 2015.
Le présent de la narration, qui mêle le narrateur adulte au personnage Tommaso-enfant, fournit un cadre à partir duquel le lecteur·trice plonge dans le point de vue de l’enfant: «Béni[e] soit la période de Noël. Il fait froid dehors, et j’ai la permission de traîner des jours entiers dans ma chambre où je lis et re-lis mes albums de bande dessinée préférés». Il s’agit d’un récit focalisé sur le «je» enfant (entrée dans son imagination) et d’un récit à focalisation élargie, cadré par le narrateur-adulte (Baroni 2017b: 6-8). La gestion de l’information est en effet gérée par le narrateur-adulte, tandis que le foyer perceptif mélange le point de vue externe de ce narrateur, qui s’exprime verbalement, à son point de vue interne de personnage, dont les perceptions sont rendues visibles par le biais du dessin. À cela s’ajoute l’éclatement de la mise en page de l’album (absence de vignettes), puisque le dessin envahit la double planche et acquiert ainsi une dimension métaphorique. La liberté dans l’organisation spatio-topique peut être interprétée comme une manifestation visuelle de la liberté d’imagination découlant de la lecture de bandes dessinées. Dès lors, le remplacement progressif d’éléments du monde réel par l’univers maritime rend visible la puissance de l’imaginaire fictionnel et l’immersion intense qu’elle engendre. Le lit se transforme en bateau, la chambre en océan, tandis que le monstre à tentacules, renvoyant au monde imaginaire, cherche à s’emparer du monde réel – représenté dans les bulles de dialogue «Tom, à table !!!» et «J’arrive ! …», échangé entre Tom et sa mère – en attirant l’enfant vers le bas, dans l’univers de la fiction. Ainsi, l’envahissement de la planche par le dessin crée une rupture narrative visant ici à thématiser la puissance de la littérature et son pouvoir d’immersion fictionnelle, intense au point d’éloigner Tommaso-enfant de la situation diégétique qui l’entoure. La prise en charge du récit par l’image rompt en effet avec la temporalité linéaire pour reproduire les représentations mentales de l’enfant. Elle métaphorise en ce sens la suspension du temps engendrée par une immersion fictionnelle intense. Ceci explique d’ailleurs le choix de la planche de droite comme couverture de l’album, et donc comme support visuel du titre Wonderland (pays des merveilles).
L’interprétation de cette double planche demande un travail d’analyse de ces différentes dimensions (organisation spatio-topique, effets de cadrage, place du dessin, etc.), qui a le potentiel de sensibiliser les élèves à la dimension esthétique inhérente aux œuvres graphiques. En l’occurrence, il est intéressant d’aborder la manière dont cette double planche rompt avec le rythme linéaire du récit et encourage les lecteur·trice·s à s’attarder de manière quasi contemplative sur le dessin, pour en dégager les effets et saisir l’importance de la monstration visuelle au sein du médium de la bande dessinée. Plus généralement, la prise en compte de leur subjectivité devient l’occasion de réfléchir à l’immersion fictionnelle – en tant que source d’émotions et de plaisir – et à l’apport de la littérature dans la création d’univers mentaux.
Conclusion
En convoquant des exemples tirés de trois œuvres particulièrement riches, tant d’un point de vue littéraire qu’esthétique, nous avons cherché à montrer l’engagement du lecteur·trice dans l’activité d’analyse critique, d’interprétation et d’immersion affective, rendu possible par le médium de la bande dessinée. Nous avons illustré, par le biais de trois axes différents, la convocation du récit graphique comme support d’une lecture littéraire «comprise comme un va-et-vient maximal entre les modalités la «participation» psychoaffective (dominante dans la lecture dite «ordinaire») et la «distinction» critique (qui domine, quant à elle, la «lecture savante»)» (Simard, Dufays, Dolz & Garida-Debanc 2010: 242). À l’issue de cette réflexion, l’approche du récit graphique en classe de littérature nous apparaît particulièrement porteuse à plusieurs niveaux. La nature plurisémiotique du support facilite l’acquisition de compétences et d’une littératie multimodale, par la compréhension des mécanismes de mise en intrigue propres à l’utilisation conjointe des modes textuel et graphique (partie 2). De plus, le travail sur les codes spécifiques à la narration séquentielle et l’approche critique de l’énonciation graphique soutiennent le développement de compétences nouvelles, en lien avec les procédés propres à la narration par l’image, en même temps qu’elles élargissent le bagage analytique des élèves en sémiotique visuelle (partie 3). Enfin, la sensibilisation aux dimensions esthétiques du récit graphique, favorisant une posture contemplative pour la création de sens, encourage une lecture affective et permet de travailler les œuvres à partir de leurs actualisations subjectives par les élèves (partie 4).
Notre but était d’esquisser quelques pistes didactiques illustrant les richesses du récit graphique, tant dans une perspective de décloisonnement disciplinaire, que du point de vue d’un alignement curriculaire avec les objectifs du plan d’étude de la formation post-obligatoire. En ce sens, des œuvres telles que Fun Home, Persepolis ou Wonderland répondent aux exigences et objectifs disciplinaires présents dans le plan d’étude, en lien avec l’étude des genres littéraires, des outils narratologiques et des procédés propres à la création littéraire (objectifs explicités dans le Plan d’étude pour l’école de maturité: 17). En même temps, il nous semble que l’enseignement de mémoires graphiques permet de familiariser les élèves avec une création littéraire contemporaine très peu abordée en classe, en les faisant notamment réfléchir à des thématiques importantes, liées à leur expérience actuelle du monde. De plus, la narration plurisémiotique a le potentiel d’entrer en résonnance avec leurs pratiques ordinaires, qui font abondamment usage de l’image. L’approche du genre autobiographique par le roman graphique, quant à elle, ouvre la voie, non seulement à un travail sur les spécificités génériques de l’autobiographie «traditionnelle» (pacte, thématiques, narration rétrospective), mais permet également le développement de nouvelles compétences d’analyse et d’interprétation mono- et multimodales. Certains apprentissages et enjeux poursuivis en travaillant sur le récit graphique sont de ce fait également transposables à l’analyse de textes littéraires classiques, en particulier l’autobiographie.
Il va de soi que l’enseignement de récits graphiques nécessite de la part des enseignant·e·s un investissement conséquent4, en termes de travail sur les spécificités du support (histoire littéraire/caractéristiques) et de transmission d’un lexique technique nécessaire à l’analyse et à l’interprétation. Le médium nous semble néanmoins être une ressource indéniable pour le renouvellement de l’enseignement post-obligatoire de la littérature, notamment pour la création de séquences didactiques inédites. Notre visée n’était pas de prôner un remplacement des lectures du patrimoine, qui ont comme valeur irremplaçable de permettre aux adolescent·e·s d’acquérir des codes communs pour lire le monde et la culture, en même temps que de se situer dans le champ culturel et historique de la littérature (Dufays 2007). Notre but était plutôt d’illustrer les manières d’impliquer les élèves dans la lecture et l’interprétation actives, motivées par les richesses narratives et esthétiques du médium graphique. Pourquoi oser le récit graphique dans l’enseignement de la littérature au degré post-obligatoire? voilà la question à laquelle nous souhaitions réfléchir et dont nous espérions partager la réponse avec les enseignant·e·s et didacticien·ne·s de la littérature.
Bibliographie
Baetens, Jan (2012), «Le roman graphique», in La Bande dessinée: une médiaculture, É. Maigret, M. Stefanelli (dir.), Paris, Armand Colin, pp. 200-216.
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n°16. En ligne, consulté le 19 août 2021, URL: https://journals.openedition.org/narratologie/974
Baroni, Raphaël (2020), «Comment réconcilier la focalisation genettienne avec l’étude de la subjectivité dans le récit?», Nouvelle revue d’esthétique, n° 26, p. 31-42. DOI : https://doi.org/10.3917/nre.026.0031
Baroni, Raphaël (2017a), Les rouages de l’intrique: les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, préface par Jean-Louis Dufays, Genève, Slatkine Érudition.
Baroni, Raphaël (2017b), «Les fonctions de la focalisation et du point de vue dans la dynamique de l’intrigue», Cahiers de Narratologie, n° 32. En ligne, consulté le 19 août 2021, URL: http://journals.openedition.org/narratologie/7851
Bechdel, Alison (2013 [2006]), Fun Home: une tragicomédie familiale, Paris, Denoël Graphic.
Bomel-Rainelli, Béatrice & Alain Demarco (2011). «La BD au collège depuis 1995: entre instrumentalisation et reconnaissance d’un art», Le français aujourd’hui, n°172(1), p. 81‑92. En ligne, consulté le 19 août 2021, URL: https://doi.org/10.3917/lfa.172.0081.
Bon, François (2012), «Apprendre l’invention», Paris, Publie.net. En ligne, consulté le 19 août 2021, URL: https://www.publie.net/wp-content/uploads/2013/04/9782814590168_extrait.pdf
Boutin, Jean-François (2015), «La bande dessinée et l’école: actualisation, compétences multimodales et écueils», Revue d'éducation de l'Université d'Ottawa, printemps, p. 29-35. En ligne, consulté le 19 août 2021, URL: https://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/uott_reveduc_printemps_2015_4.2_acc.pdf
Chute, Hillary (2008), «Comics as literature? Reading Graphic Narrative», PMLA, n° 123 (2), p. 452-465.
Dufays, Jean-Louis (dir.) (2007), Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2015). Pour une lecture littéraire: Histoire, théories, pistes pour la classe (Pratiques pédagogiques), Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Han, Byung-Chul (2017), La société de transparence, Paris, PUF.
Jost, François (1989), L'Œil-caméra. Entre film et roman, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La littératie médiatique multimodale: de nouvelles approches en lecture-écriture à l’école et hors de l’école, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Lejeune, Philippe (1975), Le pacte autobiographique, Paris, Seuil.
Lewis, David (2001), Reading contemporary picturebooks: picturing text, New York, Routledge.
Missiou, Marianna (2012), «Un médium à la croisée des théories éducatives: bande dessinée et enjeux d’enseignement», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, p.79-98, DOI: 10.4000/books.ugaeditions.1236
Pedri, Nancy (2013), «Graphic Memoir: Neither Fact nor Fiction», in From Comic Strips to Graphic Novels: Contributions to the Theory and History of Graphic Narrative, D. Stein & J. N. Thon (éd.), Narratologia Series, DeGruyter, pp. 127-153.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, Ellug.
Rouxel, Annie (1996), Enseigner la lecture littéraire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. «Didact. Français».
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (dir.) (2004), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Satrapi, Marjane (2007 [2000-2003]), Persepolis, Paris, L’Association, coll. «Ciboulette».
Schaeffer, Jean-Marie (2016), Adieu à l'esthétique, Paris, Éditions Mimésis.
Simard, Claude, Jean-Louis Dufays, Joaquim Dolz & Claudine Garcia-Debanc (2010), Didactique du français langue première (Pratiques pédagogiques), Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Tirabosco, Tom (2015), Wonderland, Genève, Atrabile.
Vandendorpe, Christian (2012), «De nouveaux horizons de lecture et leurs implications pour l’école», in La littératie médiatique multimodale. De nouvelles approches en lecture-écriture à l’école et hors de l’école, M. Lebrun et al. (dir.), Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 17-31.
Pour citer l'article
Violeta Mitrovic, "Enseigner les mémoires graphiques au degré post-obligatoire: réflexions et pistes didactiques", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-les-memoires-graphiques-au-degre-post-obligatoire-reflexions-et-pistes-didactiques
Voir également :
Lire Maus à l’école, entre simplicité et complexité
La bande dessinée et le roman graphique sont aujourd’hui des genres qui ne souffrent plus de défaut de légitimité critique. Le roman graphique doit largement la sienne, et même ses lettres de noblesse, à Maus d’Art Spiegelman (2012a), dont il sera question ici. Si la critique s’est, depuis plusieurs décennies, emparée de cette œuvre de manière à en baliser très largement les enjeux esthétiques, historiques, philosophiques, etc.{{On se reportera à la bibliographie associée à l’article de Hillary Chute (2020), traduit par Raphaël Baroni et Sébastien Graber dans ce numéro, pour une sélection des plus fondamentaux de ces travaux.}}, il reste pourtant un domaine, celui de la didactique, où quelques points restent à éclairer. Et si faire figurer Maus aux programmes des écoles secondaires n’est plus forcément un tabou de nos jours, encore n’est-il pas inutile de (re)poser la question: pourquoi et comment enseigner cette œuvre?
Lire Maus à l’école, entre simplicité et complexité
La bande dessinée et le roman graphique sont aujourd’hui des genres qui ne souffrent plus de défaut de légitimité critique. Le roman graphique doit largement la sienne, et même ses lettres de noblesse, à Maus d’Art Spiegelman (2012a), dont il sera question ici. Si la critique s’est, depuis plusieurs décennies, emparée de cette œuvre de manière à en baliser très largement les enjeux esthétiques, historiques, philosophiques, etc.1, il reste pourtant un domaine, celui de la didactique, où quelques points restent à éclairer. Et si faire figurer Maus aux programmes des écoles secondaires n’est plus forcément un tabou de nos jours, encore n’est-il pas inutile de (re)poser la question: pourquoi et comment enseigner cette œuvre?
La question du «comment» trouvera, dans les paragraphes qui suivent, des éléments de réponse dans les propositions théoriques et méthodologiques qui seront avancées, mais elle rencontrera également une limite qu’il faut signaler d’emblée: notre proposition ne se présente pas comme le compte-rendu d’une expérience testée en classe, mais comme une réflexion plus générale, préalable à la conception de séquences d’enseignement liées à la bande dessinée2. Quant au «pourquoi», qui guidera notre démarche de manière plus centrale, il faut aussi apporter quelques précisions. Le bénéfice le plus évident d’une lecture de Maus à l’école est sans doute à chercher dans les liens que cette œuvre tisse avec l’histoire: celle de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de la vaste problématique du témoignage qui s’y rapporte. Rappelons en quelques mots le propos de ce livre, résolument non fictionnel. Art Spiegelman, auteur-narrateur du récit, met en scène sa propre démarche, consistant à recueillir auprès de son père Vladek l’histoire de ce dernier, entre le milieu des années 1930 et le présent de son témoignage (1978), en tant que Juif polonais, survivant d’Auschwitz et émigré aux USA. Même si le bénéfice historique est central dans la perspective d’un enseignement scolaire (voir Brown 1988), il s’agira moins de cela, ici, que d’envisager l’intérêt de cet enseignement sous l’éclairage de la didactique de la lecture littéraire.
Notre hypothèse est la suivante: lire Maus participe d’une éducation à la lecture littéraire. Et ce, à double titre: 1. en tant que l’enseignement de la lecture littéraire doit aujourd’hui bénéficier d’un renouvellement générique (Ouellet 2016: 210); 2. en tant que la lecture littéraire se présente comme un «va et vient dialectique» (Dufays 2002: 22-26) entre différents pôles évolutifs, déterminés en l’occurrence par deux notions fondamentales, celle de la simplicité et celle de la complexité3. Précisons d’emblée que cette catégorisation est heuristique et donc appelée à se modifier en cours de réflexion. Il ne sera évidemment pas question de considérer la bande dessinée comme véhicule unilatéral de simplicité par rapport à la littérature canonique, ni de suggérer que Maus est une œuvre simple – au contraire, elle se caractérise par sa complexité – mais d’envisager le médium du récit graphique comme un facilitateur de lecture, ayant comme dessein d’introduire le·la lecteur·trice à la complexité d’enjeux divers (esthétiques, historiques ou éthiques). On verra aussi, par la vertu du «va et vient dialectique» évoqué précédemment, que le passage du simple au complexe n’est pas à sens unique et que le mandat éducatif discuté ne s’affirme pas par l’unique vecteur du maître à l’élève.
Du zoomorphisme comme facilitateur
Maus est un récit graphique fondé sur le zoomorphisme de ses protagonistes: les Juifs ont des têtes de souris, les nazis des têtes de chats. Dès la couverture, le couple emblématique du chat et de la souris expose la métaphore animalière qui sera filée tout au long du récit. Vers la fin du second tome, on observe que les soldats américains sont représentés sous la forme de chiens, ce qui renforce la chaîne métaphorique: les chiens courent après les chats, qui courent après les souris. Même si d’autres animaux interviennent pour prêter leur identité symbolique aux peuples représentés (en particulier les cochons pour les Polonais, mais aussi les élans pour les Suédois, entre autres) et que ceux-là éludent quelque peu la logique de prédation, c’est avant tout ce couple souris-chat qui importe, et qui donne au zoomorphisme de Maus un aspect systémique. La simplicité initiale qui préside à l’approche de l’œuvre est fondée sur le très fort potentiel structurant de cette métaphore.
En plus du recours à la logique de prédation des espèces convoquées, qui lui fournit un argumentaire naturel, cette structure préalable opère de manière nette sur l’horizon d’attente de la lecture à un niveau culturel. En effet, un tel système fait écho à d’innombrables productions culturelles antérieures, en particulier dans les publications destinées à la jeunesse: illustrations des Fables de La Fontaine, du Vent dans les saules de Beatrix Potter, etc. Plus directement, ce sont les cartoons américains du XXe siècle qui sont sollicités, les Silly symphonies, les Funny animals, Tom & Jerry, la figure incontournable de Mickey Mouse, comme – déjà – leurs détournements underground et en premier lieu Fritz the Cat de Crumb. Outre que ces influences sont pleinement revendiquées par Spiegelman dans les explications qu’il donne à Hillary Chute de la genèse de Maus4, il est raisonnable de postuler une telle reconnaissance de ce substrat au niveau de la réception de l’œuvre, en particulier s’agissant d’un public jeune et en situation de scolarisation5.
De la métaphore naturelle à la codification culturelle s’installe au demeurant une structure d’accueil de la lecture, fondée sur une simplicité initiale qui «facilite»6 celle-ci. Personne ne s’étonnera de voir des souris parler et interagir comme des humains, parce que les codes qui président à cette transformation ont été intégrés dès l’enfance. Pour le dire dans les termes de Steve Baker, dans de tels récits, «la présence animale est systématiquement justifiée; l’animal est le support approprié pour ces messages, ne serait-ce qu’à cause du fait que, comme le disait Bettelheim, "les enfants ont une affinité naturelle avec les animaux"» (Baker 2001: 136, m.t.7). On remarquera, au passage, qu’une telle simplicité n’est pas remise en question par la collision, qui ne manque pas de survenir, entre ces deux étapes de la mise en place du système de réception de Maus – en particulier le fait que le monde décrit est régi par des règles humaines et non animales, les protagonistes laissant périodiquement oublier leur caractère de souris au profit d’interactions ordinaires. Comme l’explique l’auteur: «Le fait que Vladek et Art sont des souris – on n’y fait plus attention – ils discutent, c’est tout.» (Spiegelman 2012b: 134)
N’y faire plus attention revient à laisser aux lecteurs·trices la possibilité d’orienter leur curiosité vers le contenu du récit plutôt que vers sa forme. Aux dires de Spiegelman lui-même, un effet possible de la lecture de Maus serait celui d’une immersion, d’un «état de rêverie que procure tout récit» (Spiegelman 2012b: 135), effet dont nous postulerons ici le caractère initial. Plus encore, aux dires de Ouellet, «le genre du roman graphique favorise […] une lecture littéraire “modalisante” […] c’est-à-dire que l’œuvre fait immédiatement entrer le lecteur dans un monde imaginaire» (2016: 29). Cet «imaginaire immédiat» est certes problématique – il pourrait même passer pour fallacieux, s’agissant d’une œuvre non fictionnelle8 et portant sur le chapitre le plus sombre de l’histoire du XXe siècle. Mais s’il offre un tremplin de lecture pour entrer dans Maus, il présente dès lors une opportunité pédagogique non négligeable, à travers ce que Marianne Hirsch nomme la «stratégie esthétique»9 de l’usage du zoomorphisme dans l’œuvre. Nous observerons donc plus avant la question de la lecture en immersion, via son ancrage dans les réflexions en didactique de la lecture littéraire.
Zoomorphisme et lecture immergée
Parmi les nombreux·es auteur·e·s à s’être penché·e·s sur la question, celui qui nous intéressera en premier lieu est Bertrand Gervais, qui distingue deux «régies de lecture» littéraire, la lecture en progression et la lecture en compréhension (Gervais 1992). Si la seconde doit être envisagée comme une relecture, paradigmatique et critique, la première correspond à une première lecture, immersive, syntagmatique et dirigée vers sa propre fin, dans une perspective caractéristique a priori des lectures de l’enfance: «un tel régime est le mandat des lectures décrites comme naïves, initiales ou encore premières d’un texte» (Gervais 1992: 12). La référence à Gervais, dont l’article est aujourd’hui assez ancien, nous semble intéressante justement dans la mesure où la binarité exprimée entre progression et compréhension est polarisée axiologiquement. Pour Gervais, ce qui caractérise la lecture littéraire est bien le passage à la compréhension, lecture seconde, adulte, valorisée au détriment de la première. Les nombreuses conceptualisations ultérieures de cette différence entre lecture immersive et lecture critique tendent à «nuancer cette opposition» (Bemporad 2014: 68). Annie Rouxel, notamment, lorsqu’elle fait état d’un binôme comparable entre «lecture cursive» et «lecture analytique», propose d’emblée de les inscrire dans une dynamique de «complémentarité» (Rouxel 2000). Pour notre analyse toutefois, s’en tenir à une séparation (certainement fallacieuse, comme on l’a vu, mais heuristique) entre progression et compréhension nous intéresse, parce qu’elle recoupe les observations de Spiegelman, lorsqu’il commente les effets progressifs qu’il envisage de la lecture de Maus:
Un des avantages qu’il y a à utiliser ces visages masqués, c’est que ça crée une sorte de réaction empathique en ôtant aux visages leur spécificité – ça permet de s’identifier, pour se trouver ensuite coincé avec sa propre humanité corrompue et défectueuse. (Spiegelman 2012b: 132, nous soulignons.)
Spiegelman n’envisage pas seulement une gradation de la lecture de son œuvre; il voit aussi cette gradation comme participant d’un procédé pédagogique:
Je pense que c’étaient ces masques d’animaux qui m’ont permis d’approcher des choses sinon indicibles. Ce qui rend Maus épineux est précisément ce qui lui permet d’être un «outil d’enseignement» utile, malgré son intention non didactique. (Spiegelman 2012b: 127)10
Il y a donc bien une simplicité initiale avec laquelle Maus peut être abordé – même si elle est logiquement promise à une complexité seconde, comme on le verra plus loin. Pour exploiter cette simplicité initiale, et pour fournir un début de réponse à la question «comment enseigner Maus?» que nous envisagions en ouverture, on pourrait imaginer que l’enseignant·e procède par extraits pour commencer, en choisissant sciemment quelques pages pouvant être traitées de manière autonome: par exemple, les pages 13, 28, 45, 75 pour commencer, où Art et Vladek sont représentés dans leur quotidien, puis les pages 53-54 où les Juifs ne sont encore «que» des prisonniers de guerre ayant affaire à leurs adversaires allemands et où la métaphore chat-souris se présente de manière très transparente. On parviendrait sans doute, par cette manipulation, à engager une lecture initiale de Maus qui s’en tiendrait à cette simplicité.
Celle-ci fait parfaitement sens dans la symétrie qui s’opère entre production et réception: selon Henri Garric, la compréhension de la genèse de cette œuvre doit prendre en compte le contexte, largement initié par Walt Disney dans la première moitié du XXe siècle, d’un univers de comics destiné à un public enfantin. Cet univers est tributaire d’une «neutralisation» du dessin (Garric 2011: 221), conduisant, sur le plan axiologique, à un «affadissement généralisé», lequel
a provoqué à partir des années 1960 et 70 une réaction brutale de la bande dessinée underground américaine, qui a cherché à réintroduire la négativité humaine dans le monde de Disney […]. C’est de cette réaction que sort Maus. (Garric 2011: 223)
La «réaction» de Spiegelman n’est pourtant pas, comme le seraient les productions d’un Crumb, programmée d’emblée pour une réception adulte: «apparemment, le dessin de Spiegelman s’oriente vers la neutralisation de l’animalité» (Garric 2011: 223), ce qui signifie que le terrain de lecture est ouvert, «apparemment», à une appréhension simple. Il ne s’agit pas ici d’établir une équivalence entre simplicité et adéquation à un public enfantin – Maus n’est pas un livre pour enfants –, mais plutôt de considérer cette simplicité comme l’exposition d’un terrain neutre, voire de ce que, dans les termes de Donald Winnicott, on pourrait appeler une «aire intermédiaire» entre sujet et objet, permettant l’expérience de «phénomènes transitionnels» (Winnicott 1975: 47-49). Nous y reviendrons plus précisément, mais dans l’immédiat, il suffit de reconnaître cet effet de transition: une appréhension simple n’a de sens que si elle conduit progressivement vers une reconnaissance de la complexité de Maus. S’agissant du système zoomorphique dans lequel s’inscrit la lecture initiale, cette complexité apparaît très vite, si l’on suit le fil d’une lecture intégrale, avec l’arrivée dans le paysage graphique de l’œuvre de personnages à tête de cochon – les Polonais – qui, comme on l’a vu, n’entrent pas dans la chaîne de prédation souris-chats-chiens. On peut également citer, parmi les exemples de complexification de ce système, la séquence du second tome durant lequel le personnage d’Art se rend chez son psychanalyste, qui vit au milieu de chats et de chiens domestiques. «Est-ce que je peux en parler, ou est-ce que ça fout ma métaphore en l’air?» (Spiegelman 2012a: 203), commente le narrateur. Évidemment, la réponse est: les deux… car à ce stade, la coexistence du monde zoomorphe, à connotation fictionnelle, et du monde anthropomorphe, autobiographique, est devenue nécessaire à l’appréhension générale du propos. Henri Garric, commentant cette séquence, en vient à envisager l’humour (Garric 2011: 225) comme élément non négligeable des effets que procure la lecture de Maus. Est-ce à dire qu’un tel humour correspondrait à la lecture simple, primaire, d’un genre historiquement qualifié de funny, de silly, voire à travers la connotation de son nom même de comics? Certainement pas: la différence est grande entre s’amuser d’un chat qui court après une souris et sourire d’un monde où coexistent le génocide représenté par la métaphore chat-souris et la possibilité qu’une souris anthropomorphe affectionne les chats de compagnie. Illustration 1: Maus, p. 203. © Flammarion 2012
Illustration 1: Maus, p. 203. © Flammarion 2012
Tension ludique
Entre simplicité et complexité de lecture, l’œuvre pourrait être envisagée sous l’angle d’une tension ludique, englobant ces deux types d’humour sous la forme plus générale du jeu. En effet, parmi les déclinaisons qui enrichissent le binôme progression-compréhension, il faut mentionner l’approche de Michel Picard (1986), grâce à qui le jeu de la lecture se divise en une lecture-play et une lecture-game11. Rappelons que si la lecture-game correspond à un jeu fondé sur des règles communes, caractéristique de l’activité ludique de l’adulte, la lecture-play quant à elle «concerne un mode de lecture participative et captivante qui rappelle “les jeux de la première enfance”» (Bemporad 2014: 67). L’intérêt de cet apport réside dans la perspective d’une lecture-play où la règle est totalement intégrée au profit d’un vagabondage. Mais si ce vagabondage prend place dans les zones bien connues où les animaux se comportent comme des humains, il se confronte dans le même temps à l’évidence selon laquelle ces zones appartiennent à une enfance désormais anachronique. À l’autre bout du spectre, la lecture-game constitue le tenseur qui prolongera ce premier doute quant à l’insuffisance d’une lecture-play, ne serait-ce que dans la promesse d’une complexité à venir. Petit à petit, selon un rythme qu’il appartient à l’enseignant·e de mettre en place, le game se présente comme le retour d’un principe de réalité, indissociable de la valeur historique de Maus. On remarquera au passage le bénéfice pédagogique de cette approche: l’appréhension progressive de la complexité de l’œuvre se présentera moins aux yeux de l’élève comme une corvée purement scolaire que comme la résultante logique d’une transition de la lecture enfantine vers la lecture adulte. En d’autres termes, il y a un gain rhétorique à présenter la complexité de l’œuvre comme nécessaire à l’appréhension globale de cette œuvre, si son appréhension partielle renvoie à la naïveté initiale d’une lecture immature.
Dans son aspect initial, cette tension ludique se présente sous un angle abstrait et général; on pourrait remarquer que toute lecture, voire toute expérience culturelle, est envisageable sous l’angle de cette dynamique entre playing et game: après tout, il s’agit là d’un jeu dont le terrain, décrit par Winnicott sous le terme d’aire transitionnelle «où se chevauchent le jeu de l’enfant et celui de l’autre personne en cause» (1975: 102), ne concerne pas que la lecture mais le développement cognitif en général. Ainsi qu’il le précise: «il existe un développement direct qui va des phénomènes transitionnels au jeu, du jeu au jeu partagé et, de là, aux expériences culturelles» (1975: 105).
Mais il existe un second aspect, par lequel l’idée de jeu se concrétise dans l’expérience de lecture de Maus: dans cette œuvre, la tension ludique se prolonge en effet jusqu’à rencontrer la métaphore prédatrice, en l’adoptant tout d’abord, puis en la prolongeant par complexification. L’adopter, cela veut dire jouer avec le lectorat comme le chat joue avec la souris: le piéger dans la croyance qu’il avait affaire à des petits mickeys, pour mieux l’attirer vers une lecture qu’il n’avait pas prévue; le piéger dans l’horreur que constitue la facilité relative avec laquelle nous traversons cette bande dessinée et sommes tout de même entraînés en plein cœur d’Auschwitz; le piéger comme furent piégés les Juifs d’Europe qui, tentant de s’enfuir, furent méthodiquement ramenés vers ces souricières, les camps de concentration12.
Prolonger la métaphore par complexification, cela signifie que le jeu crée un espace de liberté et de créativité. Aussi cruel que cela paraisse, lorsqu’un chat joue avec une souris, il ne la tue pas tout de suite. Il complexifie le rapport entre prédateur et proie. Cette complexification entre aussi en ligne de compte pour élargir l’espace de potentialités du lecteur, notamment à propos du personnage de Vladek ou du destin des Juifs d’Europe. Vladek est, après tout, un survivant, ce qui implique, a minima pour lui, que la logique de prédation n’a pas fonctionné, qu’une autre loi naturelle de coopération ou d’échange l’a remplacée. On peut jouer, à ce jeu du chat et de la souris, même quand on est la souris. Et si la possibilité de gagner n’entre pas dans la dialectique de ce jeu, on peut au moins ne pas (tout) perdre.
Dynamique de lecture
Le principe de lecture qui conduit du simple au complexe, de la lecture immersive à la lecture distanciée, est inévitable. Il ne saurait être question de maintenir la lecture dans un premier degré tel qu’on omettrait, par exemple, de voir en quoi les indices de fictionnalité de Maus se retournent au profit de sa non-fictionnalité, essentielle. Mais ce principe est-il pour autant à sens unique? La lecture au premier degré n’est-elle convoquée que pour être disqualifiée? Nous pensons que non.
Dans leur article, Dardaillon et Meunier font état d’un questionnement similaire au nôtre quant à la pertinence de l’enseignement de la BD pour parler de la Shoah: «Nous allons tenter de voir comment, au sein de notre corpus, scénaristes et dessinateurs ont procédé pour “attraper” leurs lecteurs, les faire entrer dans une dynamique interprétative» (Dardaillon & Meunier 2019: 213). Mais par la suite, le maître mot qui se dégage de leur analyse est celui de distance: il s’agit pour les élèves, «en mettant l’objet d’étude à distance, [de] prendre du recul avec cette dimension émotionnelle exprimée dans les cases» (Dardaillon & Meunier 2019: 221). Dans notre perspective, si cette lecture distanciée est bien entendu nécessaire dans un second temps (en particulier pour faire valoir une lecture en compréhension complémentaire à la lecture en progression), elle ne doit pas pour autant devenir l’aboutissement unique de la lecture. Il faut qu’il y ait circulation sur cet axe.
Mais atteindre cette dynamique de lecture entre play et game n’est pas chose aisée. Il faut dire que le danger serait fort d’une disqualification de la première lecture au profit de la seconde, en particulier autour des notions de fiction et de non fiction. Comme on l’a vu, seule une lecture naïve parviendrait à justifier une équation, impossible à maintenir, entre zoomorphisme et fiction. La séquence d’ouverture de Maus, à elle seule, travaille à anéantir une bonne partie des présupposés d’une lecture-play. Art, enfant, brise un de ses patins à roulettes et se fait distancer par ses amis. Lorsque, en pleurs, il s’en ouvre à son père, Vladek lui déclare: «Des amis? Tes amis? Enfermez-vous tous une semaine dans une seule pièce, sans rien à manger… Alors tu verras ce que c’est, les amis!» (Spiegelman 2012a: 6). À bien des égards, Maus peut être lu comme un forçage brutal hors de l’enfance et vers le monde des adultes. Par conséquent, il peut sembler inévitable que la lecture de Maus, proposée à un public adolescent, se réduise schématiquement à leurrer le lecteur-enfant pour lui imposer sans transition l’état de lecteur-adulte.
Pourtant, même si le chemin entre lecture-play et lecture-game, entre lecture en progression et en compréhension, est un chemin qui doit nécessairement être parcouru, ce qui compte est moins le point d’arrivée que le regard rétrospectif porté sur le chemin lui-même. De tels allers-retours permettent de mettre en lumière un espace de travail pédagogique, dont le schéma de tension ludique donnait un premier aperçu, permettant de déboucher sur des questionnements en classe tels que: comment jouer avec une œuvre qui joue? Comment jouer avec un récit qui se joue de nous? Ou encore, quelle place accorder à l’humour dans l’interprétation? Mais d’autres schémas de ce type sont envisageables, et la lucidité progressive par laquelle on entre dans la complexité des enjeux de Maus devrait pouvoir servir à décliner toute une série d’espaces de réflexion, également fondés sur des tensions, sur les axes desquelles de tels espaces deviennent arpentables:
- - Tension fictionnelle: s’il est indubitable que Maus s’inscrit génériquement dans la non-fiction, il n’en reste pas moins que la fiction, en tant qu’elle adopterait ici une fonction de leurre, joue un rôle dans l’approche de la lecture. Quels liens Maus entretient-il avec la fable animalière? Avec le conte pour enfants? Avec le récit en général, dans la mesure où il suggérerait un happy end (Elmwood, 2004)? En somme, pour le dire dans la perspective adoptée par Raphaël Baroni (2021: 97), si le genre de la BD a historiquement servi la fiction plus fréquemment que la non-fiction, comment justifier le choix de la BD s’agissant du témoignage historique qu’est Maus?
- - Tension naturelle: si la prédation et la collaboration sont l’une comme l’autre des attitudes naturelles, leur coexistence pose un problème. Et même s’il est commode d’envisager les rapports entre humains comme essentiellement collaboratifs, il est également naïf de croire que seuls de tels rapports prévalent. Quelles sont les valeurs respectives à envisager dans ces rapports? Quelles conclusions en tirer dans une perspective politique, en particulier s’agissant d’un fascisme que la victoire des Alliés n’aura pas conduit à éradiquer de notre monde?
- - Tension générique: si le médium graphique rend l’œuvre plus accessible, cette accessibilité demeure problématique en ce qu’elle peut induire un déficit de sérieux dans le traitement du récit et de son ancrage historique. Un problème auquel Spiegelman a évidemment été confronté, après comme avant la parution de Maus, comme le signalait déjà la grande frilosité des éditeurs auxquels il s’est adressé au moment de la publication (Spiegelman 2012b: 76-79). Interroger ces bénéfices et déficits conduit également à questionner laplace de la BD dans les classes de littérature, ce dont témoignent indirectement au moins deux auteur·e·s ayant intitulé leurs articles de façon similaire: «Comics as literature?» (Chute 2008 et Meskin 2009), ou encore le décalage entre un montré et un dit qui ne s’explicitent pas toujours l’un l’autre, voire se contredisent13.
On pourrait sans doute envisager d’autres lignes de tension ou les traiter de manière transversale. En somme, il s’agit là de tensions de lecture, celles-là mêmes dont se sert Jean-Louis Dufays (cf. note 3) pour fournir une définition possible de la lecture littéraire. Plutôt que de vouloir les résoudre pour proposer aux élèves une lecture uniquement distanciée et critique, mieux vaudrait les thématiser en classe. On pourrait imaginer, par exemple, que l’observation de la tension naturelle débouche sur un exercice de type dissertatif14. Le jeu, en somme, est similaire à celui que joue Spiegelman dans la célèbre page intitulée «le temps s’envole» (Spiegelman 2012a: 201), où il se représente à sa table de travail muni d’un masque de souris. Ce larvatus prodeo rappelle celui du Barthes des Fragments d’un discours amoureux: «je m’avance en montrant mon masque du doigt» (Barthes 2002: 72). Par cette mise en lumière des tensions, l’espace de réflexion se superpose à l’espace de la classe. Maus en devient un instrument permettant la mesure des méthodes didactiques mêmes qui en fournissent l’approche.
Un espace commun
On l’aura compris, il s’agit d’inclure l’enseignant·e aussi bien que l’élève dans cette zone de travail instable où a lieu la lecture, comme va-et-vient entre play et game, de la même manière qu’avait Winnicott d’inclure le thérapeute au sein de l’aire transitionnelle où a lieu le jeu de l’enfant: «un trait essentiel des phénomènes et des objets transitionnels est dans une certaine qualité de notre attitude, dans le temps même où nous les observons» (1975: 179). Rappelons que, pour Winnicott, le rôle cognitif que joue cette aire transitionnelle ne se réduit pas au développement de l’enfant (bien que ce soit chez le bébé qu’il l’observe initialement, dans la perspective d’une séparation acceptable d’avec la mère), mais qu’elle concerne tout aussi bien l’adulte et tous les âges qu’il ou elle traverse. Si elle est transitionnelle, elle n’en est pas pour autant transitoire: «les expériences culturelles sont en continuité directe avec le jeu, le jeu (play) de ceux qui n’ont pas encore entendu parler de jeux (games)» (Winnicott 1975: 186).
En tenant compte de cet espace symbolique, on échappe à la trop simple alternative: forcer la lecture adulte chez l’enfant ou retrouver la lecture enfantine chez l’adulte (dans un esprit de simplification par lequel «enfant» et «adulte» seraient deux rôles alternativement imputables au sujet-lecteur adolescent). On échappe aussi à un écueil similaire, éventuel, qui consisterait à catégoriser Maus comme une «lecture pour l’adolescence», autre manière fallacieuse d’imputer à l’œuvre une assignation rigide, individualisée, du rôle de la lecture. L’important est bien plutôt la mise en place d’espaces communs (Meirieu 2020: 13), compris comme l’inverse de l’occupation par l’enseignant·e d’un seuil stéréotypé d’observation. L’idée est celle d’une mise à disposition pour le groupe (classe et enseignant·e) d’un lieu partagé de lecture réflexive mais aussi, dans la mesure du possible, d’un lieu anarchique, au sens d’une négation des hiérarchies entre lecteurs professionnels et lecteurs en formation. Car si l’on s’en tenait à cette seule lecture «complexe» de Maus qui en disqualifierait automatiquement la lecture «simple», cela équivaudrait finalement à postuler ce que Jacques Rancière (1987) dénonçait jadis comme une inégalité des intelligences; le maintien de la lecture de l’œuvre dans une distance commode, reproduisant celle qui, depuis des siècles, sépare l’élève du maître.

Illustration 2: Maus, p. 296 © Flammarion 2012
L’exemple de la dernière case de Maus nous semble judicieux pour illustrer cette réflexion. Vladek, fatigué d’avoir tant parlé, congédie Art pour pouvoir se reposer, dans une très claire anticipation de sa mort prochaine. Ce faisant, il appelle Art «Richieu», confondant son fils vivant avec son premier fils, mort pendant la guerre à l’âge de cinq ou six ans. Art est à cet instant à la fois abandonné par son père, qui ne lui parlera plus, tout comme l’œuvre, se terminant, nous laisse, lecteurs·trices, aux prises avec tout ce qu’elle n’aura pas pu dire. Mais elle laisse aussi Art dédoublé, enrichi (ou encombré, c’est selon) d’un frère-enfant-mort – à la fois simple et complexe à traiter. Ce dédoublement crée un espace commun, que Victoria Elmwood qualifie de «site pour l’investissement mémoriel» (Elmwood 2004: 702), mais qui s’avère également un site d’investissement didactique, où enfance, adolescence et âge adulte se réduisent à la simple condition humaine. Maus, dans sa dernière page et rétrospectivement dans son ensemble, postule une égalité des âges devant la souffrance des personnages, et pour l’ensemble de ses lecteurs·trices, une égalité des intelligences émotionnelles.
Bibliographie
Baker, Steve (2001), Picturing the Beast. Animal, Identity, and Representation, Urbana & Chicago, Illinois University Press.
Baroni, Raphaël (2021), «Of Mice as Men: A Transmedial Perspective on Fictionality», Narrative, n° 29 (1), p. 91-113.
Barthes, Roland (2002 [1977]), Fragments d’un discours amoureux, Œuvres complètes, t.5, Paris, Seuil.
Bemporad, Chiara (2014), «Lectures et plaisirs. Pour une reconceptualisation des modes et des types de lecture littéraire», Études de lettres, n° 295, p. 65-84.
Brown, Joshua (1988), «Of Mice and Memory», The Oral History Review, n°16, p. 91-109.
Chute, Hillary (2008), «Comics as Literature? Reading Graphic Narrative», PMLA, n° 123, p. 452-465.
Chute, Hillary (2020 [2008]), «La bande dessinée est-elle de la littérature? Lire les récits graphiques», Transpositio. En ligne, consulté le 20 août 2021, URL: http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques.
Dardaillon, Sylvie & Christophe Meunier (2019), «Dire l’indicible: la Shoah dans la bande dessinée. Approche historiographique, littéraire et didactique», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Editions, p. 207-224.
Dufays, Jean-Louis (2002), «Les lectures littéraires: enjeux et évolutions d’un concept», Tréma, n°19. En ligne, consulté le 20 août 2021, URL: https://journals.openedition.org/trema/1579#tocto2n4.
Elmwood, Victoria (2004), «“Happy, Happy Ever After”: The Transformation of Trauma between the Generations in Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale», Biography, n° 27, p. 691-720.
Garric, Henri (2011), «Quelques hommes à tête de souris: réflexions sur le “dessin animalier” dans l’art et la littérature au XXe siècle», in La Question animale. Entre science, littérature et philosophie, J.-P. Engélibert et al. (dir.), Rennes, PUR, p. 215-230.
Gervais, Bertrand (1992), «Les régies de la lecture littéraire», Tangence, n° 36, p. 8-18.
Hirsch, Marianne (1993), «Family Pictures: Maus, Mourning and Post-Memory», Discourse, n°15, p. 3-29.
Meirieu, Philippe (2020), «L’éducation et le rôle des enseignants à l’horizon 2020». En ligne, consulté le 20 août 2021, URL: https://pdf4pro.com/amp/view/l-233-ducation-et-le-r-244-le-des-enseignants-224-l-horizon-2020-27c18d.html
Meskin, Aaron (2009), «Comics as Literature?», The British Journal of Aesthetics, n° 49, p. 219-239.
Ouellet, Sébastien (2016), «L’enseignement de la lecture et de l’écriture littéraires à partir du roman graphique: une approche multimodale en classe de français au secondaire (Québec)», in Statuts des genres en didactique du français, G. Sales Cordeiro & D. Vrydaghs (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 209-236.
Picard, Michel (1986), La lecture comme jeu, Paris, Éditions de Minuit.
Rancière, Jacques (1987), Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard.
Rouxel, Annie (2000), «Lecture cursive / lecture analytique: construire la complémentarité», in Recherches en didactique de la littérature, M.-J. Fourtanier, G. Langlade & A. Rouxel (dir.), Rennes, PUR, p. 75-79.
Spiegelman, Art (2012a [1980-1991]), L’intégrale Maus, traduit par J. Ertel, Paris, Flammarion.
Spiegelman, Art (2012b [2011]), Metamaus, Paris, Flammarion.
Winnicott, Donald (1975 [1971]), Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard.
Pour citer l'article
Gaspard Turin, "Lire Maus à l’école, entre simplicité et complexité", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/lire-maus-a-l-ecole-entre-simplicite-et-complexite
Voir également :
La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser
Parmi les recherches en didactique de la littérature qui se sont développées au cours de la dernière décennie, divers travaux se sont attachés à montrer comment la lecture de bande dessinée peut contribuer pleinement à la formation du lecteur. Rouvière (2012) a notamment souligné qu’une lecture problématisée de bande dessinée mobilise et peut développer les compétences interprétatives en jeu dans la lecture littéraire. Boutin (2012) plaide quant à lui pour une ouverture de la notion de littératie à des supports multimodaux, parmi lesquels la bande dessinée pourrait occuper une place de choix. Ahr (2012) enfin évalue l’intérêt d’adaptations de classiques en bande dessinée à l’aune de la richesse du dialogue interprétatif ouvert par ces créations avec l’œuvre source.
La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser
Introduction
Parmi les recherches en didactique de la littérature qui se sont développées au cours de la dernière décennie, divers travaux se sont attachés à montrer comment la lecture de bande dessinée peut contribuer pleinement à la formation du lecteur. Rouvière (2012) a notamment souligné qu’une lecture problématisée de bande dessinée mobilise et peut développer les compétences interprétatives en jeu dans la lecture littéraire. Boutin (2012) plaide quant à lui pour une ouverture de la notion de littératie à des supports multimodaux, parmi lesquels la bande dessinée pourrait occuper une place de choix. Ahr (2012) enfin évalue l’intérêt d’adaptations de classiques en bande dessinée à l’aune de la richesse du dialogue interprétatif ouvert par ces créations avec l’œuvre source.
Sur le terrain, plusieurs enquêtes font état de l’intérêt manifesté par les enseignant·e·s pour le médium, en même temps que de la rareté de la lecture de bandes dessinées dans les classes (Massol & Plissoneau 2008; Depaire 2019). Plusieurs facteurs concourent certainement à cette situation. L’absence de familiarité professionnelle avec le médium et le manque d’outillage pour aborder en classe des récits largement pilotés par l’image apparait ainsi fréquemment dans les propos des enseignant·e·s (Depaire 2019; Raux 2019). À cette explication, il faut sans doute ajouter l’idée très répandue selon laquelle la bande dessinée constituerait une lecture facile d’accès pour les élèves, susceptible d’«accrocher les petits lecteurs», formule fréquemment lue ou entendue (Raux 2019). Il est probable que l’absence d’outillage et le peu de place faite à la bande dessinée dans les recherches en didactique s’expliquent en partie par cette représentation d’un support facile et motivant, et de fait, les lectures de bandes dessinées proposées à l’école sont pratiquées dans le cadre de la lecture autonome, avec des lectures cursives ou des rallye-lecture, les enseignant·e·s les relayant peu en classe.
Ce présupposé de facilité appelle pourtant des clarifications et devrait être problématisé. On connait en effet bien mal la manière, ou plutôt les manières, dont les jeunes lecteurs lisent, comprennent et interprètent un récit en bande dessinée – il est significatif à cet égard d’avoir pu entendre au cours d’une enquête de terrain deux enseignantes du même établissement affirmer pour l’une que «devant une BD, les enfants ne font pas attention aux images, ils ne lisent que les textes» et pour l’autre que «les jeunes ne regardent que les images dans une BD»… Quelques études de cas s’efforcent d’ouvrir la boite noire des modalités de lecture de bande dessinée et de clarifier les enjeux de cette lecture dans des contextes d’enseignement. Lacelle met ainsi en évidence la diversité des compétences requises au niveau du lycée pour analyser les effets produits par des systèmes sémiotiques combinés dans une œuvre multimodale: en mettant en avant la «variation des niveaux de compétences à la lecture multimodale en fonction de la capacité de chacun à faire la jonction entre les unités de sens visuelles et textuelles» (Lacelle 2012: 138), elle souligne l’importance de prévoir des dispositifs de formation susceptibles de développer les compétences de lecture spécifiques à la bande dessinée pour nourrir les capacités d’interprétation. Polo et Rouvière (2019) montrent quant à eux que le choix de la bande dessinée en tant que document pour une classe de sciences sociales, s’il peut mettre les élèves en confiance en produisant une impression de facilité, n’entraine cependant pas de façon univoque une facilitation de la tâche de lecture.
En partageant des données exploratoires qui mettent en évidence quelques obstacles à la compréhension rencontrés par des élèves du secondaire, le présent article se propose de contribuer à l’«observation fine des pratiques des jeunes lecteurs en situation collective d’apprentissage», identifiée par Baroni (2021) comme un des enjeux de recherche prioritaires en matière d’usages scolaires de la bande dessinée. Deux situations sont analysées successivement: la première dans une classe de cinquième (deuxième année du secondaire) engagée dans la lecture suivie de Groenland Manhattan de Chloé Cruchaudet, où plusieurs travaux écrits ont été recueillis chez un groupe d’élèves pour documenter leur compréhension de différents passages et mécanismes narratifs; la seconde est basée sur un questionnaire soumis à une classe de première (deuxième année du lycée) à la suite de la lecture d’un reportage en bande dessinée en vue de tester la compréhension d’une narration appuyée sur un dessin plus symbolique. Cet échantillonnage modeste, qui correspond à deux expériences de lecture dans des contextes et sur des corpus bien distincts, n’épuise évidemment pas la question, mais se veut une invitation à déployer ce chantier de recherche encore très peu exploré.
Groenland Manhattan en cinquième: une lisibilité qui ne va pas de soi
Pour sa deuxième séquence de travail de l’année, en octobre 2020, une classe de cinquième d’un collège classé en Réseau d’Éducation Prioritaire était engagée dans la lecture de Groenland Manhattan de Chloé Cruchaudet1. Cet album, inspiré par le destin réel de Minik, jeune esquimau amené par l’explorateur Robert Peary à New York au début du XXe siècle, raconte l’enfance et l’adolescence du héros, tourmenté par son tiraillement entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption.
Les premières réactions lors du lancement de cette séquence confirment l’intérêt que peut susciter le choix du support: passée la surprise – «on va lire une BD?» – le fait est que tout au long de la lecture suivie en classe, les élèves rapportaient sans les oublier les exemplaires prêtés pour les temps de lecture à la maison, permettant que les échanges se fassent sans difficulté (l’établissement ne disposait que de quinze exemplaires pour vingt-trois élèves) et l’album était régulièrement tiré des cartables pour le quart d’heure de lecture inscrit dans l’emploi du temps en début d’après-midi. Mais c’est à des enjeux de compréhension et non de motivation que s’attache cet article. Les écrits d’élèves recueillis lors des premières séances mettent en effet en évidence l’importance d’un étayage de la lecture en classe.
Maitrise inégale des caractéristiques énonciatives
Dans un premier temps de la séquence sur l’album, la lecture a été menée en classe. Les deux premières séances, consacrées à la lecture des premières pages, ont eu pour objectif d’expliciter la nature des relations entre l’explorateur et la famille de Minik. Lors de la première séance, les élèves ont été invités à identifier le personnage principal du début du récit et à regrouper les informations données à son propos (pages 2 à 7) – il s’agit d’un «commandant», qui retourne vers New York en emmenant une météorite. Pour le deuxième temps de lecture, portant sur les pages 8 à 16, les élèves ont reçu comme consigne de reformuler ce que les Esquimaux pensent du commandant qu’ils appellent «Puili», et ce que celui-ci pense d’eux.
Ces deux premières séances de lecture ont été l’occasion de clarifier certaines caractéristiques de l’énonciation en bande dessinée, paramètre au sujet duquel des erreurs avaient été commises: plusieurs élèves ont attribué au commandant les noms de «Qisuk» (4 élèves) ou de «Matthew» (2 élèves), qui sont en fait ses interlocuteurs. Une bulle comme «Matthew, demande-leur de revenir demain avec leur famille», clairement reliée au commandant, seul à apparaitre sur la vignette, ne présente pourtant pas d’ambiguïté. La confusion sur le nom de Qisuk peut quant à elle être induite par une particularité énonciative du passage. Le commandant ne s’adresse pas directement aux Esquimaux mais il communique par l’intermédiaire de son interprète, Matthew. Pour figurer ces échanges, les paroles des Esquimaux sont représentées par des boucles indéchiffrables, traduites ensuite par Matthew. L’attribution du nom de Qisuk au commandant provient d’une confusion lors de la lecture de cette vignette:
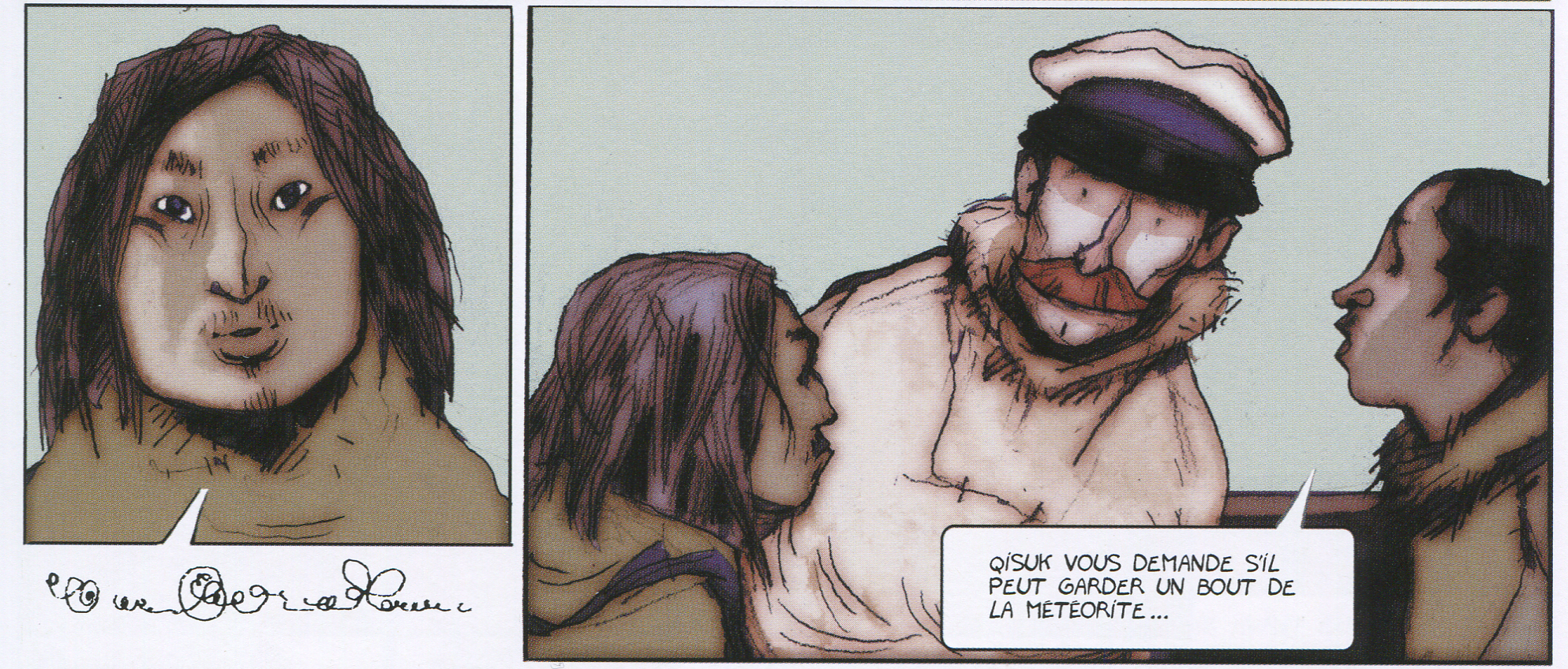
Image 1: Groenland Manhattan
(Cruchaudet 2008: 5), © Éditions Delcourt
Ces erreurs dans l’attribution des noms aux personnages montrent l’importance d’un étayage pour clarifier la situation d’énonciation et ses éventuelles particularités.
Il faut toutefois signaler que toutes les particularités énonciatives ne réclament pas le même accompagnement. Dans les mêmes pages, une planche qui met en jeu un décrochage énonciatif n’a pas posé de problème de compréhension: après qu’un des Esquimaux parlant du commandant déclare que «ça [lui] rappelle la fois où [ils] l’[ont] guidé jusqu’à la première dame de fer», la planche suivante raconte une crise de panique de Puili avec des dessins très schématiques, les contrastes entre le vert clair des dessins et le rouge du texte ou encore l’absence de cadre de la plupart des vignettes contribuant à la distinguer de celles qui précèdent et qui suivent. Ce décrochage énonciatif très marqué et explicitement associé à l’évocation d’un souvenir n’a pas suscité de difficultés de compréhension, seuls deux élèves ne répondant pas à la question «pourquoi les couleurs changent p. 12?», les vingt autres réponses identifiant que cette planche marque un retour en arrière, dans lequel, formule par exemple un élève, «Qisuk raconte une histoire qui s’est passée avec Puili». La fréquence de tels décrochages visuels manifestant un retour en arrière ou le début d’une séquence imaginaire, par exemple dans les fictions audiovisuelles, peut sans doute expliquer l’aisance avec laquelle les jeunes lecteurs ont compris l’enchâssement de ce récit rétrospectif: les compétences de lecture mises en œuvre devant la bande dessinée sont aussi nourries par les expériences audiovisuelles (et peuvent les nourrir en retour).
Difficultés de compréhension d’un récit porté par l’image
Après cette entrée dans l’œuvre fortement étayée, la troisième séance a été l’occasion d’une lecture plus autonome avec un partage du travail, la moitié de la classe lisant le récit du départ de Minik sur le bateau du commandant pendant que l’autre moitié étudiait des documents sur les expéditions polaires de Robert Peary. Pour évaluer la compréhension du passage de l’album, deux questions ont été posées par écrit: on demandait d’abord de légender une vignette muette représentant les Esquimaux sur le pont du bateau de Peary au moment du départ en précisant «qui sont ces Esquimaux, où ils sont, pourquoi, et en indiquant le nom de chacun quand c’est possible»; la deuxième question demandait d’expliquer «ce que fait Minik sur la dernière vignette page 24, et pourquoi». Les différences de précision entre les légendes proposées sont difficiles à interpréter: seul un élève a indiqué les quatre noms donnés dans l’album, la plupart – six sur onze – n’identifiant que Minik et son père, Qisuk, nommés dès les premières pages et identifiés collectivement lors des séances précédentes. Pour être complète, l’information était à chercher non seulement dans l’extrait mais également dans les premières pages, la grande amplitude du passage à consulter a donc pu constituer un obstacle et la dernière information donnée sur la deuxième famille, qui ne donnait pas de nom propre («c’est une chamane»), pouvait être laissée de côté pour satisfaire au mieux à la consigne.
Mais les réponses à la deuxième question montrent quelles difficultés ont pu être rencontrées devant une planche dans laquelle le récit est piloté par l’image, le texte ne l’éclairant que très partiellement. Cette planche, la page 24 de l’album, correspond à la catégorie des récits qualifiés de «lisibles» par Tauveron (1999), dans un travail fondateur sur la lecture littéraire et l’articulation de la compréhension et de l’interprétation:
Les récits qu’on peut dire, avec Barthes, «lisibles» ne posent pas de problèmes de compréhension majeurs (l’intrigue suit la chronologie, les relations entre personnages sont clairement posées, les valeurs des personnages nettement affirmées, leurs motivations explicitées…). (Tauveron 1999: 17-18)
L’organisation de la planche donne en effet nettement à voir ce qui se joue du point de vue de Minik. On le voit jouer avec sa figurine du capitaine Puili, dont il tire le traineau sur le bateau en figurant divers obstacles – les marches d’un escalier deviennent un glacier, «Capitaine Puili, vous êtes bien attaché? Nous montons un glacier!». Quatre vignettes muettes montrent ensuite successivement Minik suivant Puili, se présentant à sa porte, lui adressant un sourire, et recevant en retour la porte que Puili lui claque au nez. Après un dernier gros plan sur le traineau et la figurine, la dernière vignette montre Minik qui le jette par-dessus bord en lui assénant un vigoureux coup de pied. Deux bulles complètent les deux dernières vignettes: «Oh! Attention capitaine Puili…», «… une bourrasque de vent!». Conformément à la définition de la lisibilité mentionnée ci-dessus, l’enchainement est linéaire, les relations entre personnages sont clairement posées ainsi que les motivations et réactions de Minik.

Image 2: Groenland Manhattan
(Cruchaudet 2008: 24), © Éditions Delcourt
Pourtant ces enjeux n’ont manifestement pas été compris par la majorité des onze élèves concernés par ce travail. Si un élève répond avec la plus grande précision que Minik «met un grand coup de pied à capitaine Puili car le commandant lui a fermé la porte au nez», les autres réponses traduisent une compréhension moins assurée. Quatre élèves écrivent qu’«il donne un coup de pied dans Puili» (ou «à Puili»). Le geste est bien compris mais les réponses n’apportent pas d’explication concernant sa motivation. On ne peut exclure que la motivation ait été perçue par ces élèves, et que ce ne soit que la reformulation qui ait posé problème. Mais six élèves, soit la majorité du groupe concerné, ne répondent pas ou passent à côté des enjeux du passage. Outre trois absences de réponses, ce qui constitue un taux important, les trois dernières réponses présentent une certaine confusion ou approximation:
«Il tape sur un des côtés du bateau parce qu’il est énervé.»
«Il boude car les gens n’aiment pas les esquimaux.»
«Il tire un coup de pied pour dire que c’est une bourrasque de vent.»
S’il n’est pas faux qu’il soit «énervé» ou que sa colère soit liée au mépris dont il fait l’objet parce qu’il est Esquimau, la confrontation entre Minik et Peary n’est pas relevée, le fait que le coup soit porté à la figurine de Puili n’est pas mentionné. Tout se passe comme si, dans ce passage, le fait que la lisibilité de la séquence repose exclusivement sur l’image rendait ces enjeux implicites et difficilement interprétables. En l’absence de paroles étayant les images, les élèves semblent avoir de la peine à saisir les enjeux narratifs de la planche, qui sont pourtant présentés explicitement à travers un enchainement d’actions saisies par une suite de postures corporelles stéréotypées, ainsi qu’à travers des changements dans l’expression du visage de Minik, qui affichent son ressenti. Les paroles de Minik se présentent en effet comme un contrepoint à la situation, dans le registre de l’imaginaire, et n’expriment qu’implicitement ses sentiments, que l’image fait cependant apparaitre plus explicitement. Les difficultés rencontrées devant cette articulation invitent à examiner rigoureusement l’épaisseur énonciative des planches pour anticiper les difficultés qu’elles peuvent susciter et former au mieux les élèves à leur lecture.
Ces données sont assurément très partielles: non seulement elles portent sur un petit nombre d’élèves (des aléas organisationnels n’ayant pas permis de procéder au recueil des questionnaires auprès de l’autre moitié de la classe), mais en outre, les réponses écrites ne rendent pas compte de la manière dont les élèves ont procédé, de ce qui a fait obstacle – on ne peut pas écarter l’hypothèse d’un manque d’implication dans l’activité, la curiosité liée à la nouveauté du support s’estompant certainement après deux séances de lecture scolaire2. En dépit des questions laissées en suspens, ces quelques données illustrent toutefois la nécessité de mener des recherches plus approfondies visant à mieux documenter les procédures interprétatives mobilisées par des élèves confrontés à la lecture en classe de bandes dessinées. De telles recherches devraient permettre d’améliorer la didactisation de ce type de support, d’une part en dépassant le préjugé que l’image faciliterait nécessairement la compréhension du récit, d’autre part en tenant compte des difficultés inhérentes liées à la lecture de la bande dessinée.
Un reportage en BD au lycée: former à la lecture de dessins métaphoriques
Le développement du genre du reportage est une tendance forte parmi les évolutions récentes observables dans le champ de la bande dessinée (Groensteen 2017). Une offre éditoriale se structure, y compris pour les jeunes lecteurs Ainsi, la Revue dessinée propose depuis 2016 une variante éditoriale pour la jeunesse: Topo. Cette revue ambitionne de mobiliser les ressources de la narration graphique pour offrir un regard distancié sur l’actualité. Dans ce but, les reportages proposés, réalisés en collaboration entre un journaliste et un auteur de bande dessinée, exploitent un vaste répertoire de stratégies narratives. Régulièrement, des reportages empruntent des voies métaphoriques ou jouent sur le mélange entre différents registres (Raux 2021). La lecture d’un récit graphique de ce type par un groupe de lycéens montre que ce genre est loin d’être transparent et que les compétences pour les décrypter sont, comme le suggèrent Polo et Rouvière (2019), à construire pour une partie des élèves.
L’expérience de lecture a porté sur un sujet paru dans le premier numéro de Topo, abordant la question des armes aux États-Unis (Faure & Adam 2016). Elle a été menée dans une classe de 1ère ES (deuxième année du lycée, de section «économique et sociale») d’un lycée socialement mixte, composée pour moitié d’élèves sélectionnés en section internationale américaine et, pour l’autre moitié, d’élèves considérés comme fragiles par leur professeur principal. Les dix-neuf élèves se sont prêtés à l’expérience, en avril 2017, à la fin du second trimestre. Ils étaient présents à l’occasion d’une heure d’accompagnement personnalisé, et étaient encadrés par leur professeur de sciences économiques et sociales.
Après un premier questionnaire destiné à recueillir les connaissances sur le thème des armes aux États-Unis, qui montrait que les dix-neuf élèves présents savaient que les armes y circulent beaucoup et sont régulièrement l’objet de polémiques autour de fusillades, les élèves ont lu l’article intégralement puis ont répondu (sans avoir l’article à disposition) à des questions plus précises vérifiant la compréhension et l’assimilation des informations diffusées par l’article. À la question «quelle nouvelle loi Barack Obama a-t-il voulu faire passer?», dix-sept réponses signalent l’intention de contrôler davantage la vente d’armes, qui est évoquée plus ou moins précisément à travers les dispositions législatives envisagées. Deux élèves parlent d’un projet d’interdiction du port d’armes, ce qui n’est que partiellement exact – Obama l’aurait souhaité, mais cette disposition n’a pas été retenue dans le cadre de son projet de loi. À la question «quel(s) groupe(s) ou parti(s) politique(s) s’opposent à toute restriction concernant les armes?», à l’exception d’une réponse qui mentionne les démocrates, toutes les autres identifient le parti républicain, et/ou la NRA, et/ou le groupe des «gun lovers». La NRA est le groupe le plus souvent identifié, et il est mentionné dans treize réponses. La restitution des informations principales de l’article atteste donc d’une lecture attentive et d’une bonne compréhension globale des enjeux abordés. La compréhension d’un dessin a ensuite été testée: la dernière question demandait aux élèves quels éléments de l’article ils retrouvaient dans ce dessin, tiré de l’article – dans la vignette originale (image 3), le dessin était accompagné d’un texte, qui n’est pas reproduit pour le questionnaire (image 4). La question portait sur ce dessin car il représente symboliquement un fait répété dans l’article, formulé explicitement dans la vignette originale: ni illustration littérale du texte, ni symbole fonctionnant en autonomie, il présente donc un niveau de difficulté moyen.

Image 3: Pourquoi Barak Obama…
(Faure & Adam 2016), © Topo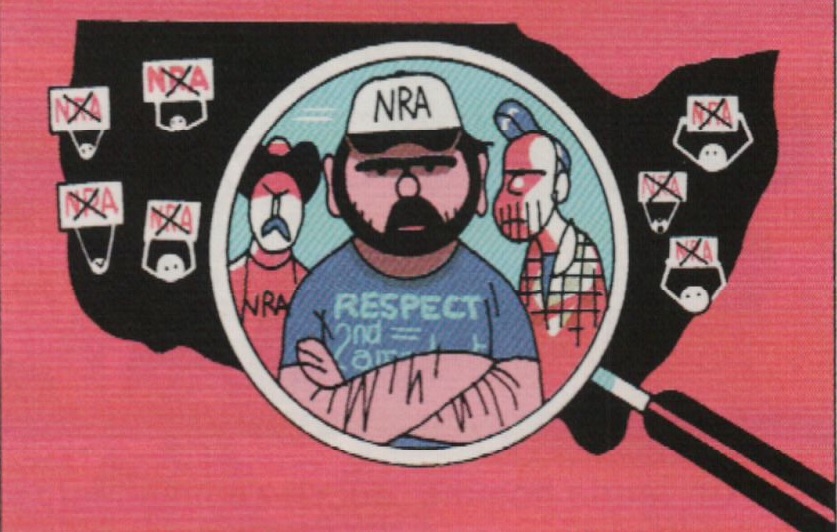
Image 4: Pourquoi Barak Obama…
(Faure & Adam 2016), © Topo
Un tiers des réponses développent l’idée représentée avec concision par le dessin, comme dans l’exemple suivant:
«On nous illustre le lobby intitulé NRA et on nous montre qu’elle n’est pas soutenue partout dans les E-U mais que malgré ça, elle a une grande importance et influence.»
À l’image de cet exemple, cinq réponses articulent le caractère minoritaire de la NRA et son influence. Six autres évoquent l’un ou l’autre de ces aspects, le caractère minoritaire de la NRA ou son influence, sans les mettre en relation. À l’opposé de ces réponses, qui attestent d’une bonne compréhension du dessin, on relève une non réponse et deux interprétations erronées:
«On retrouve la NRA, les États-Unis. À l'arrière il y a un cow-boy, il représente l'époque far-west où il y avait des armes. Peut-être où il y a des croix, ce sont des endroits où il y a eu des victimes.»
«On peut voir la NRA qui est pour le port d'armes. Et la loupe représente plus de contrôle sur les personnes voulant acheter une arme.»
Le plus souvent, sans surprise, l’exactitude et la précision de la réponse sur le dessin sont plus ou moins corrélées avec la qualité des réponses sur les faits et informations présentés dans l’article:
Réponse à la question «quelle nouvelle loi Barack Obama a-t-il voulu faire passer?» | Réponse à la question «quels éléments de l’article retrouvez-vous dans le dessin?» | |
Elève 8 | «Le contrôle d'arme, les vérifications systématiques de l'état mental de l'acheteur ainsi que de son casier judiciaire.» | «Que le peuple américain est en majorité contre les armes ou pour la restriction, mais que la NRA est très influente, plus influente qu'eux malgré leur sous-nombre.» |
Elève 18 | «Obama a voulu interdire le port d'arme et donc l'interdiction d'acheter une arme par n'importe qui.» | «On peut voir la NRA qui est pour le port d'armes. Et la loupe représente plus de contrôle sur les personnes voulant acheter une arme.» |
Mais quelques cas présentent une distorsion entre les réponses, une assimilation correcte des informations allant parfois de pair avec une lecture de l’image erronée:
Réponse à la question «quelle nouvelle loi Barack Obama a-t-il voulu faire passer?» | Réponse à la question «quels éléments de l’article retrouvez-vous dans le dessin?» | |
Elève 1 | «B. Obama a voulu faire passer une loi qui encadre plus les acheteurs. De vérifier l'état mental de la personne, son casier judiciaire. Obama a voulu aussi autoriser certains types d'armes et en interdire d'autres.» | «On retrouve la NRA, les États-Unis. À l'arrière il y a un cow-boy, il représente l'époque far-west où il y avait des armes. Peut-être où il y a des croix, ce sont des endroits où il y a eu des victimes.» |
Elève 10 | «Il a voulu limiter et même éliminer complètement les armes pour ne pas que des innocents meurent chaque année.» | Pas de réponse. |
Cette situation de lecteurs qui ont assimilé des éléments importants de l’article mais peinent à interpréter l’image va à l’encontre de l’idée selon laquelle l’image serait dotée d’un pouvoir facilitateur – et ce, d’autant plus que l’échantillon ne présente pas d’exemple réciproque, d’un lecteur qui aurait peiné à retenir les informations de l’article, mais qui interprèterait correctement l’image. C’est manifestement sur les explications littérales portées par le texte que les lecteurs les plus fragiles s’appuient, plutôt que sur les apports plus symboliques des dessins.
Quatre réponses, situées entre les réponses synthétiques citées plus haut et celles présentant des erreurs manifestes, suggèrent par ailleurs que le contenu de l’image, sans occasionner de difficultés de compréhension, peut néanmoins s’avérer difficile à reformuler. Ces réponses explicitent ce qu’est la NRA mais sans engager d’interprétation du dessin, en particulier sans signaler le processus d’influence mis en relief par le dessin, comme dans cet exemple:
«On retrouve la NRA qui est pour le port d’armes puisqu’ils ont peur et que pour eux c’est le seul moyen d’être en sécurité.»
Les difficultés rencontrées, soit pour décrypter le dessin, soit pour en reformuler la signification, éclairent ainsi certains des «obstacles» constatés par Polo et Rouvière (2019) à l’occasion d’un travail en classe de sciences économiques et sociales portant sur des planches de bandes dessinées au style minimaliste. Le caractère abstrait, schématique ou métaphorique du dessin, en l’occurrence l’association d’un personnage, d’une carte et d’une loupe, joue ainsi un rôle perturbateur dans sa compréhension.
Conclusion
Les deux situations de lecture de bande dessinée observées dans des classes du secondaire montrent que les compétences de lecture mobilisées par la narration graphique requièrent un apprentissage qu’il importe de ne pas sous-estimer. Un des enjeux du travail de conceptualisation que Baroni (2021) appelle de ses vœux concernant l’élaboration d’outils de lecture de la bande dessinée tournés vers l’enseignement serait de faciliter l’identification par les enseignant·e·s de points de vigilance et de formes d’étayage à apporter pour lire les œuvres. Sur le plan de l’investigation des procédures de lecture de bandes dessinées mises en œuvre par les élèves, il est évident que les aperçus présentés ici demanderaient un approfondissement, permettant en particulier d’affiner l’analyse des performances selon le profil des élèves. Il importe aussi de signaler que si le choix a été fait d’insister sur des difficultés de compréhension rencontrées, en raison de la force avec laquelle circule la représentation de la bande dessinée comme un support facile voire facilitateur, il ne faudrait pas négliger a contrario la potentielle mise en confiance des lecteurs offerte par des récits graphiques. Le partage de ces données exploratoires vise donc surtout à encourager l’éclosion d’études de cas plus complètes, qui permettront de discuter et de documenter ces différents aspects.
Le développement de telles enquêtes constitue un enjeu pour la didactique de la littérature en ouvrant deux perspectives. Il s’agit d’une part de clarifier dans quelle mesure et avec quelles limites les compétences de lecture mobilisées par la bande dessinée recoupent et peuvent éventuellement renforcer les compétences de lecture requises par des récits textuels, dans un contexte où la bande dessinée est souvent perçue comme un possible vecteur de remédiation. D’autre part, il en va de la formation des élèves à la diversité des pratiques de lecture: des enquêtes sur les pratiques de lecture font état d’un décrochage de la lecture de bandes dessinées à l’adolescence (Aquatias 2015), ce médium restant associé aux séries d’humour ou d’aventures, très populaires chez les jeunes lecteurs, qui ne passent pas à une production destinée au lectorat adulte, à laquelle l’enseignement de la littérature pourrait bien davantage les initier et les familiariser.
Bibliographie
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bandes dessinées. Sacrilège ou tremplin ?», in Enseigner les «classiques» aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. de Peretti, I. & B. Ferrier (dir.), Berne, Peter Lang, p. 197-208.
Aquatias, Sylvain (2015), «Le goût de la bande dessinée: acquisitions, transmissions, renforcements et abandons», in La bande dessinée: quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL:
https://books.openedition.org/bibpompidou/1675
Baroni, Raphaël (2021), «Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée», La lettre de l’AIRDF, n°68, p. 49-54.
Beaudoin, Isabelle, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Nathalie Lemieux & Martin Gendron (2015), «Consolider ses compétences de compréhension en lecture par la BD», Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale, n° 2. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL: https://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/r2-lmm_vol2_beaudoin-al.pdf
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littératie médiatique multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 33-44.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: la place de la Bande dessinée dans l’enseignement, Syndicat national de l’édition. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL: https://www.sne.fr/document/etude-la-place-de-la-bande-dessinee-dans-lenseignement/
Faure, Guillemette & Benjamin Adam (2016), «Pourquoi Barack Obama n’a-t-il pas réussi à interdire les armes aux États-Unis?», Topo, n°1, septembre-octobre.
Groensteen, Thierry (2017), La bande dessinée au tournant, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales: une expérience vécue en classe à partir des bandes dessinées Paul et Persépolis», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec.
Massol, Jean-François & Gersende Plissonneau (2008), «La littérature lue en 6e et 5e : continuités et progressions», Repères, n° 37, p. 69-103. En ligne, consulté le 8 avril 2021, URL: https://journals.openedition.org/reperes/422
Polo, Claire & Nicolas Rouvière (2019), «La BD: un support "facilitant" en classe de SES?», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 8 avril 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.5003
Raux, Hélène (2019), La bande dessinée en classe de français: un objet disciplinaire non identifié, thèse de doctorat, Université de Montpellier. URL: https://biu-montpellier.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=33MON_ALMA51358121230004231&vid=33UM_VU1&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=fr_FR&context=L
Raux, Hélène (2021), «Groom et Topo, ou l’actualité racontée à la jeunesse», in Presse et bande dessinée. Une aventure sans fin, A. Lévrier & G. Pinson (dir.), Bruxelles, Les Impressions nouvelles, p. 323-337.
Rouvière, Nicolas (2012), «Étudier une œuvre intégrale en bande dessinée au cycle 3 : quelles spécificités didactiques ?», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, p. 103-121.
Tauveron, Catherine (1999), «Comprendre et interpréter le littéraire à l’école: du texte réticent au texte proliférant», Repères, n° 19, p. 9-38.
Pour citer l'article
Hélène Raux, "La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-en-classe-une-lecture-a-didactiser
Voir également :
La lecture dialectique de bandes dessinées historiques: étude de treize parcours de lecture
Dans cet article, nous nous intéresserons aux qualités multimodales et narratives (temporalité, stéréotypie, hypermédia) qui font de la bande dessinée (BD) un véritable prototype multimodal du récit. Dans ce sens, il nous apparaît évident que la BD a droit de cité à l’école au même titre que toute autre forme scolaire de narration. Une première partie, d’orientation épistémologique, mettra en évidence les composantes plurisémiotiques – multimodales – des récits graphiques, puis nous reviendrons sur les questions relatives à la temporalité narrative (Baroni 2010; Ricœur; 1984) et à la stéréotypie (Dufays 2010) pour en définir la littérarité (par exemple historique) (Boutin & Martel 2018; Louichon 2016).
La lecture dialectique de bandes dessinées historiques: étude de treize parcours de lecture
1. Introduction
Dans cet article, nous nous intéresserons aux qualités multimodales et narratives (temporalité, stéréotypie, hypermédia) qui font de la bande dessinée (BD) un véritable prototype multimodal du récit. Dans ce sens, il nous apparaît évident que la BD a droit de cité à l’école au même titre que toute autre forme scolaire de narration. Une première partie, d’orientation épistémologique, mettra en évidence les composantes plurisémiotiques – multimodales – des récits graphiques, puis nous reviendrons sur les questions relatives à la temporalité narrative (Baroni 2010; Ricœur 1983; 1984) et à la stéréotypie (Dufays 2010) pour en définir la littérarité (par exemple historique) (Boutin & Martel 2018; Louichon 2016). Nous nous intéresserons plus précisément aux potentialités didactiques de la BD en regard, certes, de l’enseignement proprement dit de la littérature, mais aussi de celui d’autres disciplines scolaires, en l'occurrence l’histoire, tout cela dans une démarche dite de lecture dialectique (Boutin & Martel 2018; Martel 2018) qui met en dialogue des savoirs dits profanes et les savoirs de référence, ou savoirs savants.
Dans un second temps, nous illustrerons de façon empirique ces propositions conceptuelles par le partage d’une démarche de recherche – étude de cas multiples – nous ayant permis d’accompagner en lecture dialectique de la BD historique (BDH) des élèves québécois du primaire et du secondaire. L’étude de ces réceptions différenciées du récit de fiction historique confirme la pertinence, voire le besoin, de poursuivre la démarche de transposition didactique d’une lecture dialectique, certes en classe d’histoire, mais aussi en classe de littérature comme en classe de langue.
2. Narration multimodale, temporalité narrative et lecture dialectique
La BD, en tant que récit, s’avère un exemple explicite d’objet plurisémiotique. Par ailleurs, elle constitue une véritable mimèsis, ce qui signifie qu’elle opère une reconfiguration du réel, qui prend forme grâce à la stéréotypie littéraire. Un regard sur la place de l’histoire en BD permet de consolider empiriquement ces postulats.
2.1. La bande dessinée comme prototype de la fiction multimodale
La montée en force des approches multimodales au cours des vingt-cinq dernières années, d’abord dans le monde anglo-saxon (Kress 1997; Kress & Von Leeuwen 2006; Kress 2010; Jewitt, Bezemer & O’Hallaran 2016, etc.), puis dans l’espace francophone (Lebrun, Lacelle & Boutin 2012; 2013; Lacelle, Boutin & Lebrun 2017; Martel 2018, etc.) s’est concrétisée sous l’égide du paradigme de la multimodalité. L’influence de ce dernier s’est surtout fait sentir en communication et en éducation, mais sa nature éminemment sémiotique le destine de plus en plus à irriguer le champ de la littérature et, surtout, de son enseignement/apprentissage.
Par multimodalité, on entend le recours, en situation de communication (réception et/ou émission), à au moins deux modes sémiotiques1 qui interagissent pour incarner le sens porté par un message donné (Jewitt, Bezemer & O’Halloran 2016; Kress 1997, 2010; Kress & van Leeuwen 2001; Lebrun, Lacelle & Boutin 2012):
on définit la multimodalité comme l’usage, en contexte réel de communication médiatique, de plusieurs modes sémiotiques pour concevoir [et réaliser] un objet ou un événement sémiotique, ce que constitue par exemple, en didactique de la littérature, un texte, son interprétation en direct, son adaptation, sa transformation, etc. (Lacelle & Boutin 2020).
La narration multimodale, pourtant des plus répandues dans l’espace de la fiction littéraire (théâtre, cinéma de fiction, série télévisuelle, websérie, baladodiffusion2, BD, etc.) obtient depuis peu une plus grande attention de la part du champ de la didactique de la littérature, notamment à l’université (Boutin 2015; Gallego 2015; Rouvière 2012). La BD3 constitue, en quelque sorte, un prototype multimodal (Boutin 2012; 2015): il ne peut y avoir de BD sans narration (textuelle et/ou graphique), pas plus qu’il ne peut y en avoir sans représentation illustrée (Mitchell 2006). Ici, l’interaction modale, fondamentale au récit, est inévitable (Kress 2010; Boutin & Martel 2018): les modalités textuelle et visuelle, voire sonore et cinétique, sont explicitement ou implicitement sollicitées – inférées – afin d’incarner dans ses moindres rouages, même par effet elliptique, la séquence narrative.
2.2.Une mimèsis (stéréotypie et hypermédia)
Ricœur formule dans son triptyque Temps et récit (1983; 1984) une actualisation intéressante de la conception antique de la mimèsis qui, aujourd’hui, trouve écho dans l’analyse des formes multimodales du récit de fiction, notamment celui qui aborde frontalement ou de manière croisée l’histoire, donc le passé de l’humanité. Baroni (2010) précise que la mimèsis, en tant que processus créatif, consiste à enrichir l’expérience du temps par sa reconfiguration narrative. La BD est l’une des formes du récit qui, de façon intrinsèque, permet de faire l’expérience du temps préfiguré dans l’expérience, configuré par le récit, puis refiguré par la lecture, bref de cette triple mimèsis (Ricœur 1983; Baroni 2010). La BD dite historique4 accentue alors ce phénomène en intégrant à l’expérience du temps individuel celle du temps historique, inscrit socialement et soumis aux traces documentaires.
Comment, alors, peut s’incarner concrètement la mimèsis au sein de tout récit? Dufays (2010) propose une explication pragmatique, fondée sur la stéréotypie littéraire. On peut dire de cette dernière qu’elle est à la fois imitation de la nature et stylisation: elle sous-tend en simultané la reproduction du réel et sa métamorphose par une mise en discours, elle-même fondée sur d’innombrables stéréotypes littéraires5, c’est-à-dire sur tous ces différents signes narratifs perçus par le lecteur et qui, toujours, en réfèrent à d’autres les pré-datant, nourrissent la mimèsis et assurent donc l’expérience de la temporalité narrative (Baroni 2010; Boutin & Martel 2018; Dufays 2010). Ce fonctionnement peut s’observer aussi bien dans le roman moyenâgeux que dans la série policière d’inspiration scandinave, dans une chanson de Brassens comme dans le cinéma de Leone, dans l’Antigone de Sophocle comme dans un récit en bande dessinée. La stéréotypie littéraire fait de toute fiction, a fortiori historique6, une reconfiguration de la réalité basée sur la mobilisation de stéréotypes, et l’expérience du temps narratif s’y conjugue avec celle du temps historique.
2.3. Une approche didactique novatrice de la fiction: la lecture dialectique
On constate que la BD, parmi de nombreuses autres formes de fiction, possède des caractéristiques narratives qui demeurent rarement mises en relief en didactique, quelle que soit la discipline scolaire interpellée (littérature, histoire, sociologie, etc.): 1. son essence multimodale; 2. sa fonction stéréotypique qui permet d’expérimenter la mimèsis. L’actualisation attendue des pratiques didactiques disciplinaires (Éthier, Lefrançois & Joly-Lavoie 2018; Lebrun & Dias-Chiaruttini 2020; Martel 2018) offre dès lors une occasion difficilement contournable d’examiner ces caractéristiques et de soutenir une perspective innovante en réception du récit de fiction à l’école: la lecture dialectique (Boutin & Martel 2018). Cette approche participe du débat plus générique autour du rapport ambigu de l’humain au réel (Barthes 1982a; 1982b; Ricœur 1983; 1985; Baroni 2010; Gallego 2015), qui se traduit de façon plus pragmatique par la question de l’usage profane et savant du savoir, notamment historique, en classe (Éthier, Lefrançois & Joly-Lavoie 2018; Jablonka 2014).
À l'instar de toute représentation culturelle du monde, réelle ou fictive, la BD est un objet inscrit dans un usage public – profane – du savoir (Éthier & Lefrançois 2021). Les représentations – multimodales – du vraisemblable / crédible en fiction historique (Bordage 2008; Louichon 2016; Martel & Boutin 2015, Nokes 2013), bien que destinées à première vue à un usage informel, donc profane, sont pourtant le produit d’un inévitable dialogue critique qui les confronte invariablement aux usages stabilisés et formels de la connaissance, donc aux usages savants du savoir (Éthier & Lefrançois 2021). Dans une telle dialectique, les discours profane et savant se croisent, se fécondent et se remodèlent dans des œuvres qui, conséquemment, reposent alors «sur un construit vraisemblable (représentations, conceptions et croyances issues de la vérifiabilité d’un faisceau de preuves crédibles) du social et du culturel soutenu par des traces, des artefacts, des sources» (Boutin & Martel 2018: 298) d’une indéniable richesse comparative et réflexive pour la classe.
La lecture dialectique consiste à placer les élèves dans un dialogue critique tenant compte des représentations, des symboles, des codes, des modes, des langages et des valeurs qu’ils rencontrent à l’occasion de la réception (lecture) d’œuvres littéraires multimodales (Boutin & Martel 2018), en tenant compte de la manière dont chaque œuvre s’inscrit dans une représentation du réel, qu’il contribue en même temps à déplacer et à reconfigurer (cf. Ricœur 1983).
Collective, dialogale et critique, la lecture dialectique, en tant que pratique engagée de réception du littéraire, permet aux élèves de déchiffrer, comprendre (traiter et interpréter) et intégrer le sens porté par le récit et ses modalités sémiotiques (Cartier 2007; Lacelle, Boutin & Lebrun 2017; Martel 2018; Martel & Boutin 2015). Appliquée à la BD, cette approche permet, comme nous l’écrivions ailleurs:
de mettre en branle et, surtout, de consolider: 1) des processus cognitifs et affectifs ainsi que des stratégies de lecture qui se développent formellement et informellement depuis le préscolaire / primaire; 2) des compétences sémiotiques et sémantiques propres à la lecture contemporaine – multimodale –; 3) le lire pour apprendre en contexte (inter)disciplinaire et 4) la critique des sources [...] En bout de course, un tel travail «sur et à partir du» roman graphique historique [BD] génère l’acquisition de savoirs historiques et/ou le remaniement des savoirs historiques antérieurs. (Boutin 2018: 307)
3. La lecture dialectique de bandes dessinées historiques: études de cas
Pour étayer notre propos avec des données empiriques, nous présentons les résultats exploratoires de différents parcours de lecture dialectique de bandes dessinées historiques auprès d’élèves québécois du primaire et du secondaire ayant eu cours au printemps 2019.
Ces parcours nous ont permis d’accompagner et, surtout, de détailler minutieusement la pratique de lecture dialectique d’élèves de 11 à 16 ans – toutes et tous volontaires7 (N = 13) – et répartis au sein de quatre cercles de lecture (Hébert 2019) (figure 1). Trois élèves de 6e année (école primaire - 11-12 ans) constituaient le Cercle 1; quatre autres élèves de 1ère secondaire (13-14 ans) formaient le Cercle 2; enfin, six élèves de 5e secondaire (15-16 ans) se retrouvaient au sein des Cercles 3 et 4. Au cours de l’expérimentation, les élèves ont été rencontrés lors d’entretiens focalisés (Lacelle, Boutin & Lebrun 2017) de trois à quatre fois sur une période de deux mois (avril-mai 2019). Tous ces entretiens ont été transcrits de façon intégrale (verbatims) et nous avons choisi, plus loin, d’en reproduire des extraits afin d’illustrer notre propos. C’est à partir de ces transcriptions qu’une analyse thématique de contenu permettant de décrire chacun des parcours de lecture dialectique a été réalisée (Miles & Huberman 2003; Sabourin 2009).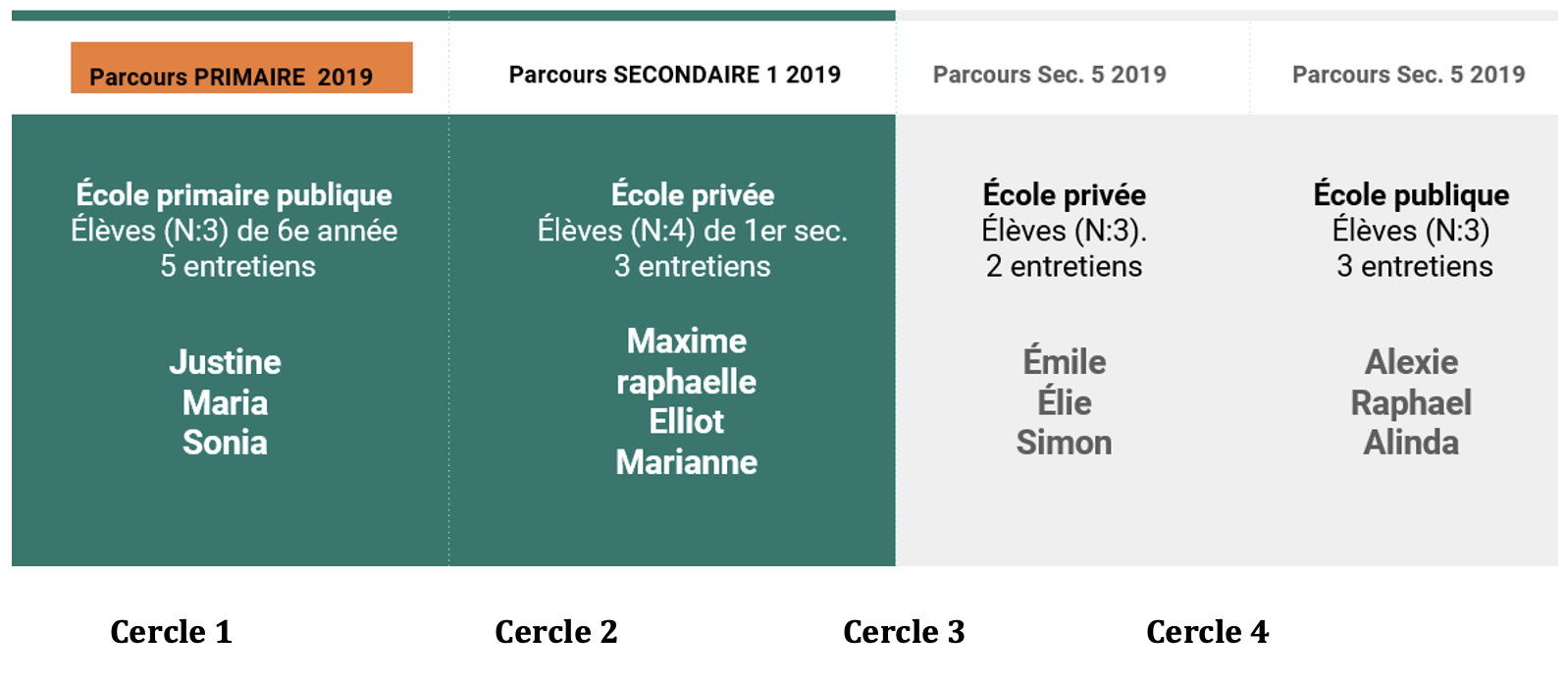
Figure 1: Présentation de l’échantillon (élèves/lecteurs volontaires)
Dans le cadre de l’expérimentation dont il est question ici, nous avons proposé aux volontaires de s’engager dans un dispositif de lecture inspiré de nos réflexions théoriques et praxéologiques à l’égard d’un modèle de lecture dialectique en BDH. Ce dispositif est commun à tous les élèves pour ce qui concerne les étapes proposées et les outils réflexifs associés, mais il s’appuie sur un corpus de BDH différencié selon les besoins des différents cercles de lecture dialectique. Le choix des BDH repose essentiellement sur l’adaptation de leur contenu respectif au lectorat visé et aux thèmes à l’étude dans les cursus en jeu (âge scolaire des élèves). Le dispositif était organisé en trois étapes de lecture dialectique, chacune de celles-ci étant complétée par un entretien focalisé réunissant tous les élèves/lecteurs des différents cercles de lecture.
Dans un premier temps (étape 1), les élèves ont été invités à lire de manière autonome les BDH ciblées pour leur cercle, sans qu’aucune intention de lecture ne leur soit explicitée. De même, aucune tâche connexe n’était proposée. Lors de l’entretien faisant suite à cette première étape, les élèves ont d’abord été questionné·e·s sur leur appréciation littéraire et esthétique (modalités textuelle, visuelle, sonore et cinétique) des BDH proposées et sur les obstacles (compréhension, traitement, interprétation, engagement dans la tâche, etc.) qu’ils ont rencontrés. Ils ont aussi été invité·e·s à identifier le thème des BDH lues et à en résumer l’essentiel. Dès ce premier entretien, il leur a aussi été demandé de se prononcer sur la «qualité historique» des BDH proposées8. Pour les aider à juger ainsi de la valeur des BDH en regard du savoir historique de référence, ils ont établi des liens entre leurs connaissances initiales des thèmes abordés et le traitement de ceux-ci dans les BDH. Plus spécifiquement, ils ont été interrogé·e·s sur la vraisemblance, ou non, de la (re)présentation des personnages mis en scène au regard de leur époque, des événements (historiques ou non) représentés, des lieux illustrés, etc. La formule collective des entretiens a permis à chacun, à cette étape du dispositif, de s’enrichir de la réflexion des autres.
Dans un deuxième temps (étape 2), les élèves ont été invités à s’engager dans une lecture semi-guidée d’un autre corpus de BDH. Pour ce faire, une intention de lecture spécifique a été formulée: lire les BDH en adoptant une posture critique pour juger ultimement de la qualité de chacune des BDH comme 1. œuvre littéraire et 2. source crédible d’information et de réflexion sur la période historique concernée. De même, un outil de réflexion leur a été proposé: le 3QPOC9, Avant d’entreprendre cette deuxième partie du parcours de lecture dialectique, le caractère multimodal de la BD – interaction des modes sémiotiques – leur a été présenté. De même, l’intérêt de se placer en posture critique lors de la lecture d’une BDH a été souligné, notamment parce que celle-ci encourage la réflexion sur la temporalité narrative, la mimèsis et la confrontation des usages profane et savant des idées et des représentations. Bien que l’outil 3QPOC ait été présenté et que son emploi – préalablement modélisé – ait été encouragé, il n’a pas été exigé des élèves-lecteurs qu’ils l’utilisent de manière obligatoire, et ce, afin d’éviter une «surdidactisation» de l’expérience dialectique. Lors de l’entretien faisant suite à cette deuxième étape, les mêmes questions que celles utilisées lors du premier entretien ont été posées. Toutefois, des questions à propos de l’utilisation et de l’utilité du 3QPOC ont été ajoutées.
Dans un troisième temps (étape 3), la formule de lecture semi-guidée a été poursuivie avec toujours la même intention de lecture et le recours (volontaire) à un nouvel outil de réflexion (présenté et modélisé): la méthode 4C10, qui est proposée par Martel (2018) pour faciliter le traitement critique de documents multimodaux . Lors de l’entretien focalisé qui a suivi cette dernière étape, les mêmes questions initiales de l’étape 1 ainsi que celles de l’étape 2 ont été posées. Toutefois, des questions à propos de l’utilisation et de l’utilité de la méthode 4C ont été ajoutées. De même, des questions à propos de l’appréciation d’ensemble du dispositif de lecture dialectique proposé (étapes retenues, choix des BD, utilité des outils proposés, appréciation des entretiens focalisés réalisés, etc.) ont permis de réaliser un retour général sur l’expérience vécue.
Dans le tableau qui suit, chacune des trois étapes, pour chacun des cercles de lecture dialectique, est présentée ainsi les BDH retenues. Les références complètes de ces dernières sont présentées en fin d’article.


Tableau 1: Dispositif de lecture dialectique expérimenté
L’expérimentation réalisée auprès des 13 élèves qui composent les quatre cercles de lecture et l’analyse de leurs pratiques de lecture dialectique conduit à quelques constats préliminaires. Essentiellement, l’analyse de cette première mise à l’essai nous a permis 1. de décrire de façon ethnographique différents processus de réception mobilisés par de jeunes lectrices et lecteurs volontaires, 2. d’analyser l’ampleur de l’engagement en dialectique de ceux-ci11 et 3. d’objectiver la démarche initiale de lecture dialectique. Ultimement, la validation initiale de la démarche de lecture dialectique, du moins dans le cas de la BDH, nous permet d’anticiper positivement ses multiples retombées en classe.
D’entrée de jeu, il faut souligner le rôle essentiel qu’a joué dans cette première expérimentation l’appréciation (littéraire et esthétique) des BDH proposées. L’appréciation semble en fait le facteur premier de l’engagement dans la tâche de lecture dialectique et dans la discussion réflexive proposée lors des entretiens focalisés. Les BDH qui plaisent (par leur force narrative, leur résonance subjective, la thématique historique qui y est abordée et son esthétisme visuel) sont celles qui engagent les élèves, qui sont lues, voire relues, avec plaisir, qui suscitent la réflexion par le dialogue, ce qui évoque spécifiquement les enjeux de la subjectivité en littérature (Langlade & Rouxel 2005) et de son appréciation par les élèves (Gabathuler 2016; Hébert 2019). Les extraits d’entretien suivants sont explicites à cet égard, puisqu’ils mettent en lumière l’appréciation (et sa justification) que font les élèves-lecteurs des BDH proposées.
Maria (cercle 1). C’est l’histoire d’un homme qui participe à la 2e guerre mondiale, plus précisément dans un régiment; il s’appelle Chandler. Il va à la guerre avec son ami. J’ai (...) beaucoup aimé comment ils ont présenté la BD. Je pensais que ce serait plus violent. Mais finalement c’est plus calme que prévu.
Sonia (cercle 1). Ma préférée, c’est La Petite Russie que j’ai vraiment adorée, c’est même mon coup de cœur de l’année (...) C’est la vie d’un personnage attachant. C’est comme s’il y avait une ligne du temps et que le personnage avançait dedans, mais c’est sa ligne avec des événements vrais. Magellan, j’ai un peu moins aimé parce que l’histoire était dure à comprendre, on était mêlé, la fin était au début (....) Des fois, la page couverture déçoit… ça m’est arrivée avec Magellan. Je suis difficile avec les images. Mais tu vois, d’habitude je n’aime pas le noir et blanc, mais là, dans La Petite Russie, le texte et les images étaient tellement bien faits, j’ai aimé ça.
Justine (cercle 1). Oui car quand c’est juste des faits historiques, on apprend des choses parfois, mais c’est plate… alors que quand l’histoire est bonne avec un peu de vraie histoire, on apprend aussi mais c’est plus le fun.
Raphaëlle (cercle 2). Oui, et le fait que c’était historique mais que c’était raconté comme une histoire, pas juste des faits, c’est le fun dans la BDH.
Émile (cercle 3). Moi, j’ai lu Radisson et je trouve que le contexte au départ est bien expliqué (...) la Nouvelle-France, puis les personnages sont tous interactifs. Ça accrochait, en plus avec les images…
Alinda (cercle 4). Et vraiment c’est la fiction, c’est l’histoire avec des émotions qui fait qu’on aime plus le sujet et même qu’on comprend mieux (...) J’ai lu Radisson et La Petite Russie. J’ai préféré La Petite Russie parce que vraiment, malgré qu’il raconte beaucoup l’histoire, c’est l’histoire des grands-parents. Ça m’a vraiment ouvert plus les yeux, ça m’a donné un autre point de vue. Parce que je connais l’histoire des historiens, l’histoire de l’école, mais là, ce sont des personnes qui ont vécu cette époque-là. On comprend mieux vraiment leur histoire (...)
De façon assez singulière et surtout spontanée, les jeunes lectrices du Cercle 1 (primaire) ont mis en relief la dimension hypertextuelle (Genette, 1982) en présence dans le corpus lu, notamment l’effet de «collection»
Justine. Moi je l’ai lue la BD sur Jacques Cartier. J’étais quand même intéressée même si ce n’était pas mon livre préféré, même si je trouvais qu’il n’avait pas beaucoup d’action… et en plus à la fin, je continuais à lire, mais je ne comprenais plus rien. Je lisais mais c’était juste des mots, je ne comprenais plus l’histoire.
Sonia. Un peu comme Magellan…
Maria. C’est la même collection, alors c’est un peu pareil que Magellan. Il y a un document à la fin et je pense que justement, ils mettent ce document parce que l’histoire n’avance pas vraiment. C’est ce document sérieux qui permet vraiment d’apprendre quelque chose. La BD, l’histoire dedans, c’est plus du blabla pas vraiment le fun.
Suite à la découverte de la richesse du corpus de BDH, par le biais de la participation volontaire à cette étude, 11 élèves-lecteurs sur 13 souhaitent explicitement poursuivre leurs découvertes en matière de BD, et plus spécifiquement de BDH. Conséquemment, les parcours de lecture dialectique réalisés et les entretiens dialogaux qui y sont liés paraissent avoir stimulé l’intérêt des participant·e·s pour le genre (la BDH) et la démarche (lecture dialectique). Cela, en plus de conforter nos choix épistémologiques et didactiques, rappelle le rôle majeur que joue la médiation dans la transmission de la culture littéraire (Hébert, 2019). Voici à cet égard des extraits dignes d’intérêt:
Alexi (cercle 4). Moi, juste l’idée de la recherche m’a donné le goût de lire de nouveau des BD, pas juste des BD historiques cependant. J’ai envie de replonger.
Maxime (cercle 2). Moi, je croyais qu’il y avait juste des BD de type Les Légendaires.
Alinda (cercle 4). Moi vraiment, j’ai découvert des BD très différentes de ce que je connaissais. La majorité de ce que je lis d’habitude ce sont des romans, mais là, j’ai découvert un autre univers et surtout des sujets sur lesquels je ne lis pas souvent.
Raphael (cercle 4). Moi la lecture, ce n’est pas mon point fort mais le fait de lire La Petite Russie, qui était loin d’être dans mon champ d’intérêt, de base un livre historique ce n’est pas ce que je préfère, mais d’avoir une histoire plus développée que trois carrés avec des blagues, ça m’a donné une autre perspective et vraiment honnêtement, j’ai envie d’aller plus loin. Peut-être aller encore dans un autre univers fictif, pas nécessairement historique, mais une fiction qui permet quand même d’apprendre des choses et de se questionner.
La maîtrise (même partielle) des compétences de lecture multimodale et, plus spécifiquement, des codes et techniques de la BD, qui est acquise par une fréquentation assidue et personnelle du média ou grâce à l’école12, s’avère fondamentale à la réception réussie du récit historique. De manière marquée, ce sont 1. les élèves qui possèdent déjà des acquis spécifiques en BD (initiation en classe par leur enseignant) et en lecture multimodale, par exemple les trois élèves du primaire (Cercle 1), et 2. les élèves sensibles spontanément à son caractère multimodal, qui s’engagent véritablement dans la lecture dialectique recherchée.
Sans surprise, ces mêmes élèves parviennent à trouver les mots pour parler de leur lecture, des processus qui la sous-tendent, des réflexions qui s’y rattachent. Maitrisant le langage (même intuitif) de la multimodalité et de l’univers de la BD, ils semblent plus outillé·e·s pour adopter une posture réflexive, entre autres parce qu’ils parviennent, et c’est l’hypothèse la plus plausible, à comprendre et à interpréter l’ensemble des subtilités narratives (temporalité, stéréotypes, hypermédia) et plurisémiotiques des œuvres lues.
Par exemple, pour la BDH Deux généraux, ce sont les élèves-lecteurs qui semblent maîtriser les codes de la BD et la lecture multimodale13 qui parviennent à cerner le rôle narratif que joue la mise en scène de la coloration.
Maria (Cercle 1). Il y a un jeu de couleurs vraiment intéressant. Quand les images sont rouges, c’est plus violent, et les autres images sont vertes.
Raphaëlle (Cercle 2). Je me suis vite aperçue que les couleurs avaient un rôle à jouer. Quand le fond était rouge, il était question de la guerre. Vert, c’était plus réflexif, pour l’histoire en dehors des combats.
L’extrait qui suit, tiré d’un échange réalisé avec les élèves du Cercle 4, est éloquent, puisqu’il illustre l’apport de sens que suscite pour plusieurs la complémentarité textes-images en BD.
Raphael. Moi aussi, lire une BD, ça m’aide (...) Dans un roman ce qui m’énerve, c’est qu’il manque d’images, il manque de représentations, de visuel et je suis une personne visuelle. J’aime lire du texte et de l’image associés ensemble. Quand je regarde une BD, je peux comprendre facilement, je n’ai même pas besoin de m’imaginer les personnages, ils sont là devant moi. Mais tout va ensemble.
Alexi. Moi, il y avait longtemps que je n’avais pas lu de BD et comme Raphael, je m’intéresse autant au texte qu’aux images. Ça m’aide à mieux comprendre l’histoire, on voit les émotions notamment et on a moins besoin d’inférer.
Il est important d’admettre que la posture de lecture dialectique recherchée n’est pas naturelle et spontanée pour les élèves-lecteurs de cette étude, notamment en ce qui a trait à la confrontation critique des (re)présentations de l’histoire permettant de juger de la vraisemblance et donc de la crédibilité des BDH. Bien que celles-ci portent en elles un contenu éminemment historique et qu’elles proposent un rapport précis au temps, elles sont initialement perçues par les élèves-lecteurs rencontrés comme des œuvres de divertissement, d’évasion, de procuration. Toutefois, et c’est là quelque peu paradoxal, ces œuvres, bien que destinées au plaisir de la lecture, semblent aussi jugées par la majorité des participant.e.s comme porteuses d’une (re)présentation vraisemblable du passé, puisque ce sont justement des BDH. Questionnés sur la crédibilité qu’ils accordent aux BDH, les élèves-lecteurs du Cercle 2, entre autres, précisent ainsi leur position.
Maxime (Cercle 2). Je ne me demande jamais si c’était vrai ou faux parce qu’il y a vraiment beaucoup de faits là-dedans que je connaissais et quand même, c’est une BDH.
Elliot (Cercle 2). Moi, j’ai l’impression que tout était vrai.
Raphaëlle (Cercle 2). J’avais quand même l’impression d’être dans le vrai moi aussi, mais en même temps, c’était bizarre les choix qu’ils faisaient.
Dès lors que les élèves sont invités à questionner la qualité de la (re)présentation historique des BDH proposées, ils sont tout d’abord pris au dépourvu, comme l’expriment bien deux élèves-lectrices du Cercle 1.
Maria (Cercle 1). Moi, c’est facile de caractériser et de comprendre une BD, les deux premiers C de la méthode 4C, mais confronter, c’est vraiment dur, je ne sais même pas ça veut dire quoi…
Justine (Cercle 1). C’est vrai, confronter, je ne sais pas comment faire et pourquoi il faut le faire.
Guidés toutefois par les questions posées, apprenant d’un entretien focalisé à l’autre à questionner les BDH lues, à traquer les invraisemblances ou, du moins, les problèmes de vraisemblance, ils parviennent presque tous à adopter une posture critique (et argumentée) et à s’engager dans la lecture dialectique recherchée. De telle sorte qu’il semble y avoir une certaine émulation des compétences de lecture dialectique – comme en fait foi entre autres la richesse des échanges réalisés dans le cadre des derniers entretiens qui témoignent d’un développement apparent de la posture des participant·e·s. Certains extraits de ces échanges sont ici présentés; ils permettent de constater que plusieurs des élèves avec qui nous avons échangé parviennent progressivement à adopter une posture critique et distanciée avec la BDH.
Raphaëlle (Cercle 2). Bien on n’a pas besoin de s’appuyer sur des faits dans une BD non historique. On peut s’inspirer de n’importe quoi, de n’importe quelle époque, de n’importe où. Alors qu’une BD historique, il faut rester dans le temps. Quelqu’un qui fait une BD historique doit prendre des faits pour ne pas mettre des incohérences dans l’histoire. Si des Amérindiens sortent leur parapluie, ce n’est pas possible.
Maxime (Cercle 2). Tu sais, même si c’est historique, on invente un peu, pour faire avancer l’histoire, on est obligé d’en ajouter (...) il faut reconnaître ce qui est inventé.
Alexi (Cercle 4). Et il y a des BD appuyées sur des faits historiques, comme des autobiographies, mais il y a aussi des BD qui proposent des histoires imaginaires dans un contexte historique. Il y a donc une certaine différence.
Marianne (Cercle 2) (À propos de Deux généraux). C’avait toute l’air d’être très réel, il y avait des faits réalistes, mais peut-être que c’est exagéré aussi… Mais en même temps c’est vraiment bien raconté. En tout cas, je suis persuadée que si c’était seulement le récit du grand-père, il y aurait eu des affaires un peu plus farfelues et exagérées.
Raphaëlle (Cercle 2) (À propos de Paul au parc). Il y a plusieurs choses vraies mais bon, ça reste une autofiction (...) Mais il y a eu l’enlèvement de Pierre Laporte et ça, je sais que l’enlèvement a vraiment eu lieu (...) je sais que Pierre Laporte est vraiment mort, qu’ils ont donné son nom à un pont, qu’il s’est fait enlever, que le FLQ a vraiment fait des choses, il y avait vraiment ces problèmes au Québec.
Plusieurs arrivent même à nommer tout le travail de reconfiguration du réel que sous-tend une œuvre de semi-fiction historique, comme en témoigne ce passage du dernier entretien réalisé avec les élèves-lecteurs du Cercle 2.
Raphaëlle (Cercle 2). Oui, comme ce qu’ils ont dans le visage. On sait que les Amérindiens ont des maquillages, mais ce n’est pas n’importe quel. Donc avant, il faut se renseigner un peu avant de dessiner.
Maxime (Cercle 2). Oui mais tu ne peux pas dire n’importe quoi non plus. Il ne faut pas juste se documenter pour les images mais pour tout. Tu ne peux pas dire n’importe quoi.
Cependant, et c’est là un constat d’importance, cette évolution ne semble pas reposer sur le recours expérientiel à des tâches/outils de type scolaire. Par exemple, le 3QPOC ou la méthode 4C ont finalement trouvé très peu d’écho. En fait, ils n’ont pas du tout été appréciés. Certains élèves-lecteurs précisent que l’utilisation, même partielle, de ces outils, a entravé leur lecture et le plaisir de découvrir le corpus des BDH. D’autres, encore plus nombreux, affirment avec honnêteté de pas les avoir utilisés parce qu’un tel recours rendait l’expérience de lecture trop scolaire.
Maria (Cercle 1). Moi j’ai lu les feuilles avant et après, mais franchement, je me suis laissé aller dans la lecture. C’est vraiment après que j’ai relu les feuilles pour essayer de répondre aux questions. Mais je trouve que ces outils ne m’aident pas, ça fait trop «école» de toute manière.
Alinda (Cercle 4). Moi j’ai oublié. En fait, je savais qu’il y avait ces outils que je pouvais utiliser mais je rentrais trop dans l’histoire. Je l’ai fait un peu avec une BD mais bon… Mais avec les autres, vraiment, je rentre trop dans l’histoire, je lis pour le plaisir. Quand je ne connais pas une méthode, quand je vois quelque chose comme ça, je sens ça comme à l'école et je n’ai plus le goût de lire. Pour une fois qu’on pouvait lire juste pour le plaisir.
Alexi (Cercle 4). Moi, chaque fois qu’on me dit de lire pour faire un travail, ça me coupe tout mon plaisir. Ce que je vais finir par faire, c’est lire avec le travail à côté. Comme pour ce projet, on avait le choix, j’ai simplement lu et j’ai réfléchi à nos discussions.
C’est plutôt la mise en place d’un environnement favorable à l’échange, au dialogue et à la réflexion, en l'occurrence les moments d’entretiens focalisés autour des œuvres lues, qui paraît avoir joué un rôle central dans l’adoption progressive de la posture de lecture dialectique recherchée.
Alinda (Cercle 4). Moi, ce que je préfère, ce sont les échanges qu’on a eus. C’est vraiment plus motivant en plus, c’était libre, sans évaluation. (...) Nos discussions m’ont permis de comprendre que ça prend aussi beaucoup de connaissance pour faire les personnages et expliquer l’histoire.
Maxime (Cercle 2). Moi je suis capable de te dire maintenant que ça c’est la partie qui rend l’histoire intéressante et ça c’est la partie vraie de l’histoire. À force d’échanger avec toi et les autres sur cela, je parviens maintenant à distinguer ce qui est vrai et pas vrai.
Conséquemment, c’est la démarche de dialogue dialectique mise en place par le biais des entretiens focalisés, faisant place à l’échange littéraire et réflexif, qui paraît ici avoir joué le rôle de catalyseur. Le rôle central de l’échange, du dialogue, de l’apport de la parole de l’Autre, rappelle le rôle important que joue la discussion littéraire, les cercles littéraires et autres dispositifs d’échanges dans l'appropriation et la réflexion en didactique de la littérature (Dufays, Gemenne & Ledur 2018).
C’est enfin le caractère volontaire et non formellement scolaire de l’expérience de lecture dialectique proposée qui semble avoir joué en notre faveur et donc en faveur de l’engagement des élèves dans l’appréciation et l’exploration critique de la BDH.
Raphaëlle (Cercle 2). Moi je me suis dit que je devais lire comme si c’était Tintin parce que c’était une BD historique. Il a fallu que je me dise que c’était plus une histoire, qu’une BD historique, pour pouvoir plus apprécier. Car quand on me dit historique, c’est comme si je rentre dans le mode école. Là pour le projet, il a fallu que je me mette dans l’état d’esprit que c’est volontaire ce que je suis en train de lire sinon j’ai de la misère à apprécier ma lecture.
4. Conclusion
Nos investigations en classe auprès d’élèves du primaire et du secondaire nous ont permis d’illustrer le fait que l’usage scolaire de la BD, notamment en histoire, permet d’instaurer à l’école ce dialogue souhaité entre les mondes profane et savant. Particulièrement, le travail autour de certaines œuvres, dont celles qui sont controversées, et le dispositif de lecture dialectique que nous développons, permettent par exemple de faire réfléchir les élèves à «l’historisation de la fiction et à la fictionnalisation de l’histoire» (Gallego 2015: 5). Pour ce faire, il faut cependant que les élèves s’engagent véritablement dans ladite lecture dialectique, ce qui leur demande d’apprécier et de critiquer, par le dialogue, la teneur des composantes multimodales et stéréotypiques du récit de fiction.
L’observation ethnographique, la documentation et l’analyse de ces pratiques de réception in situ et in extenso dans un contexte de réception d’œuvres profanes constitue, à notre avis, un préalable incontournable à une conséquente didactisation de la lecture dialectique – multimodale et mimétique – à l’école. Grâce, désormais, à de telles assises, nous semblons désormais à l’aube d’une telle transposition.
Médiagraphie (corpus des bandes dessinées historiques retenues)
Bérubé, Jean-Sébastien (2009), Radisson - Fils d’Iroquois, Montréal, Glénat Québec.
Chantler, Scott (2012), Deux généraux, Montréal, La Pastèque.
Clot, Christian, Thomas Verguet & Bastien Orenge (2012), Magellan: jusqu’au bout du monde, Grenoble, Glénat.
Clot, Christian & Jean-Baptiste Hostache (2013), Tenzing: sur les toits du monde avec Edmund Hillary, Grenoble, Glénat.
Clot, Christian, Denis-Pierre Filippi & Patrick Boutin-Gagné (2017), Jacques Cartier, Grenoble, Glénat.
Desharnais, Francis (2018), La Petite Russie, Montréal, Éditions Pow Pow.
Landry, Mario & Marcel Levasseur (2009), Laflèche - Fort nécessité, Montréal, Boomerang.
Lapierre, François & Maud Tzara (2018), 1642: Osheaga, Montréal, Glénat Québec.
Lapierre, François & Maud Tzara (2018), 1642: Ville-Marie, Montréal, Glénat Québec.
Lizano, Marc & Loïc Dauvillier (2012), L’enfant cachée, Bruxelles, Le Lombard.
Lupano, Wilfrid & Gaël Séjourné (2013). L’homme de l’année: 1967, Paris, Delcourt.
Rabagliati, Michel (2011), Paul au parc, Montréal, La Pastèque.
Spiegelman, Art (2012), Maus, l’intégrale, Paris, France, Flammarion.
Bibliographie
Baroni, Raphaël (2010), «Ce que l'intrigue ajoute au temps. Une relecture critique de Temps et récit de Paul Ricœur», Poétique, n° 163, p. 361-382.
Barthes, Roland (1982a), «L’effet de réel», in Littérature et réalité, R. Barthes et al. (dir.), Paris, Seuil.
Barthes, Roland (1982b), «Le discours de l’histoire», Poétique, n° 49, p. 13-21.
Bordage, Fanny (2008), Contribuer au développement de la pensée critique des élèves en histoire au collégial: la bande dessinée à caractère historique, mémoire de maitrise, Université Laval.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littératie médiatique multimodale: une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun et al. (dir.), Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 33-43.
Boutin, Jean-François (2015), «La bande dessinée et l’école: actualisation, compétences multimodales et écueils», Revue d’éducation de l’Université d’Ottawa, n° 4 (1), p. 29-35.
Boutin, Jean-François & Virginie Martel (2018), «Le roman graphique historique: entre discours profane et discours savant… une lecture dialectique?», in Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire, M.-A. Éthier & al. (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, p. 291-310.
Cartier, Sylvie (2007), Apprendre en lisant au primaire et au secondaire, Montréal, CEC.
Dufays, Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture, Bruxelles, Peter Lang.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2018), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Bruxelles, De Boeck Supérieur.
Éthier, Marc-André, David Lefrançois & Alexandre Joly-Lavoie (dir.) (2018), Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire, Québec, Presses de l’Université Laval.
Éthier, Marc-André & David Lefrançois (dir.) (2021), Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire, Québec, Presses de l’Université Laval.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature. La relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Gallego, Julie (dir.) (2015), La bande dessinée historique. Colloque international - Premier cycle: l’Antiquité, Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Ardour.
Genette, Gérard (1982), Palimpsestes, Paris, Seuil.
Hébert, Manon (2019), Lire et apprécier les romans en classe, Montréal, Chenelières.
Jablonka, Ivan (2014), L’histoire est une littérature contemporaine, Paris, Seuil.
Jewitt, Carey, Jeff Bezemer & Kate O’Halloran (2016), Introducing Multimodality, New York, Routledge.
Kress, Gunther (1997), Before Writing, Londres, Routledge.
Kress, Gunther (2010), Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, New York, Routledge.
Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (2001), Multimodal Discourses: The Modes and Media of Contemporary Communication, Londres, Edward Arnold.
Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (2006), Reading Images: The Grammar of Visual Design, Londres, Routledge.
Lacelle, Nathalie & Jean-François Boutin (2020) «Multimodalité», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou & al. (dir.), Paris, Honoré Champion.
Lacelle, Nathalie, Jean-François Boutin & Monique Lebrun (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique. Outils conceptuels et didactiques, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Langlade, Gérard & Annie Rouxel (2005), Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses de l’Université de Rennes.
Lebrun, Marlène & Ana Dias-Chiaruttini (dir) (2020), Recherches en didactique du français» / La question de la relation entre les disciplines scolaires: le cas de l’enseignement du français, Lausanne, AIRDF.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La littératie médiatique multimodale. De nouvelles approches en lecture-écriture à l'école et hors de l'école, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (2013), «La littératie médiatique à l’école: une (r)évolution multimodale», Globe, n° 16, p. 71-89.
Louichon, Brigitte (2016), «Introduction», in Fictions historiques pour la jeunesse en France et au Québec, B. Louichon & S. Brehm (dir.), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, p. 11-20.
Martel, Virginie (2018), Développer des compétences de recherche et de littératie: l’exemple de la classe d’histoire au primaire et au secondaire, Montréal, Éditions JFD.
Martel, Virginie & Jean-François Boutin (2015), «La classe d’histoire de l’Antiquité: réflexion préliminaire sur les apports et limites pédagogiques du recours à la bande dessinée», in La bande dessinée historique. Colloque international - Premier cycle: l’Antiquité, J. Gallego (dir.), Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Ardor, p. 113-120.
Miles, Matthew B. & Michael Huberman (2003), Analyses des données qualitatives, Bruxelles, De Boeck.
Mitchell, William & John Thomas (2008), «Visual Literacy or Literary Visualcy?», in Visual Literacy, J. Elkins (dir.), New York, Routledge, p. 11-29.
Mottet, Martine, « Faire une recherche, ça s’apprend », Université de Laval, en ligne, consulté le 18 octobre 2021, URL : http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/
Nokes, Jeffrey D. (2013), Building Student’s Historical Literacies. Learning to Read and Reason with Historical Texts and Evidence, New York, Routledge.
Ricœur, Paul (1983), Temps et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil.
Ricœur, Paul (1984), Temps et récit 2. La configuration du temps dans le récit de fiction, Paris, Seuil.
Ricœur, Paul (1985), Temps et récit 3. Le temps raconté, Paris, Seuil.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, ELLUG.
Sabourin, Paul (2009), «L’analyse de contenu», in Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données, B. Gauthier (dir.), Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 415-443.

Pour citer l'article
Jean-François Boutin & Virginie Martel, "La lecture dialectique de bandes dessinées historiques: étude de treize parcours de lecture", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/la-lecture-dialectique-de-bandes-dessinees-historiques-etude-de-treize-parcours-de-lecture
Voir également :
Enseigner la bande dessinée autobiographique pour développer la littératie médiatique multimodale
Dans le monde contemporain, les jeunes sont plus que jamais confronté·e·s à des récits composites, mêlant souvent textes et images, dont le rapport avec la réalité apparaît de plus en plus complexe à définir et à évaluer. L’enseignement de la littérature, qui demeure le lieu principal d’une éducation aux formes narratives, peut difficilement ignorer cette évolution du paysage médiatique. Pourtant, les textes enseignés à l’école continuent le plus souvent à se limiter à un corpus de fictions littéraires. En 1994, Alain Viala déplorait déjà cette prépondérance du «littéraire{{Dans son article, Viala s’appuie sur la définition du «littéraire» qui sous-tend les Instructions officielles. Le «littéraire» se déploie à travers la poésie, le conte, le roman, les nouvelles, les légendes, la science-fiction, le roman policier, etc., tandis que le non-littéraire comprend les»textes d’information, reportages, documents variés relatifs au monde d’aujourd’hui et pouvant donner lieu à une étude critique» (Viala 1998 [1994]: 328).}} « dans l’enseignement du français (souvent limité à la prose narrative réaliste et au théâtre classique), malgré des prescriptions des programmes de l’Éducation nationale dont le but était de valoriser les conditions réelles de la lecture en incluant différents types de textes.
Enseigner la bande dessinée autobiographique pour développer la littératie médiatique multimodale
Dans le monde contemporain, les jeunes sont plus que jamais confronté·e·s à des récits composites, mêlant souvent textes et images, dont le rapport avec la réalité apparaît de plus en plus complexe à définir et à évaluer. L’enseignement de la littérature, qui demeure le lieu principal d’une éducation aux formes narratives, peut difficilement ignorer cette évolution du paysage médiatique. Pourtant, les textes enseignés à l’école continuent le plus souvent à se limiter à un corpus de fictions littéraires. En 1994, Alain Viala déplorait déjà cette prépondérance du «littéraire»1 dans l’enseignement du français (souvent limité à la prose narrative réaliste et au théâtre classique), malgré des prescriptions des programmes de l’Éducation nationale dont le but était de valoriser les conditions réelles de la lecture en incluant différents types de textes. Il observait une «contradiction entre l’objectif déclaré, la conquête des “lectures réelles”, et la formation réellement accomplie d’habitus lectoraux spécialisés» (Viala 1998 [1994]: 330). Un tel constat, qui reste encore d’actualité, souligne la nécessité de resserrer les liens entre les lectures réalisées dans des contextes privés et scolaires. Une partie de ces «lectures réelles» étant composée de supports médiatiques composites, il s’agit de partir de ces expériences de lecture pour aller vers un apprentissage toujours plus pointu des compétences multimodales. Tout en étant consciente que les jeunes ne sont pas systématiquement des lecteur·trice·s de bande dessinée, je propose aux enseignant·e·s de faire un pas vers les «lectures réelles» de leurs élèves par le biais de ce média composite.
La notion de «littératie» permet de mener une réflexion sur la diversité des supports dans l’enseignement. Portant initialement sur les usages variés de l’écrit, qu’ils soient individuels ou sociaux, quotidiens ou exceptionnels, scolaires ou professionnels (Barré-De Miniac 2003; Jaffré 2004; Painchaud, d’Anglejan, Armand, & Jezak 1993), la notion a été élargie et renouvelée par Nathalie Lacelle, Jean-François Boutin et Monique Lebrun afin de satisfaire aux nouvelles exigences médiatiques. La «littératie médiatique multimodale» intègre ainsi une pluralité de modes (notamment textuel et visuel) liés aux médias actuels, permettant de concevoir l’apprentissage de la lecture comme une approche graduelle de différents types de textes et de médias, chacun amenant des spécificités et complexités propres.
La littératie est la capacité d'une personne à mobiliser adéquatement, en contexte communicationnel synchrone ou asynchrone, les ressources et les compétences sémiotiques modales (ex: mode linguistique seul) et multimodales (ex: combinaison des modes linguistique, visuel et sonore) les plus appropriées à la situation et au support de communication (traditionnel et/ou numérique), à l'occasion de la réception (décryptage, compréhension, interprétation et évaluation) et/ou de la production (élaboration, création, diffusion) de tout type de message2 (Lacelle, Boutin, & Lebrun 2017: 8)
Le développement de compétences multimodales à l’occasion de la lecture d’un support composite est un défi que je propose de relever par le biais de l’enseignement de la bande dessinée. À la suite de Missiou, qui considère le récit graphique comme une forme privilégiée pour développer des compétences complexes de lecture et pour former les élèves à devenir de «véritables acteurs-interprètes» (Missiou 2012: 79), je postulerai que la lecture de ce média implique la mobilisation de compétences spécifiques permettant le traitement d’une «variété toujours grandissante de ressources sémiotiques» (Lacelle, Boutin & Lebrun 2017: 7). Dans cette étude, j’insisterai en particulier sur la manière dont la bande dessinée permet de repenser la linéarité de la lecture, en la mettant en rapport avec la tabularité du support et avec les rapports spatiaux tissés entre les images, qui se superposent à la séquentialité du récit.
L’élargissement du corpus des textes enseignés à la bande dessinée apparaît d’autant plus urgent que le potentiel didactique de ce support demeure peu exploité. En effet, Hélène Raux a observé, à partir de l’analyse de plus de 700 séquences d’enseignement de la littérature publiées sur des blogs d’enseignant·e·s3, que moins de 4 % du corpus enseigné à l’école est constitué de bandes dessinées (Raux 2019). De manière à illustrer plus concrètement le type de séquences susceptibles d’exploiter la multimodalité du support pour réfléchir à la manière dont se construit une représentation «factuelle» du passé, deux bandes dessinées seront convoquées: Persepolis de Marjane Satrapi (2000-2003) et Coquelicots d’Irak (2016) de Brigitte Findakly et Lewis Trondheim. Une comparaison des indices péritextuels, puis des deux incipits de ces bandes dessinées, aura pour but de suggérer des pistes de réflexion à mener en classe. Comment le rapport entre le récit graphique et le passé réellement vécu est-il agencé? Comment la bande dessinée exploite-t-elle son hybridité pour mettre en scène, explicitement ou implicitement, un média tel que la photographie? Quelle influence ces éléments ont-ils sur le pacte de lecture? Enfin, comment guider les élèves dans la construction de ce pacte? Telles seront les questions fondamentales qui orienteront cette étude, pour lesquelles j’esquisserai, en dépit de la brièveté de l’analyse, quelques débuts de réponse.
Analyser Persepolis et Coquelicots d’Irak dans une perspective multimodale
L’enseignement des récits graphiques de Satrapi et de Findakly et Trondheim devrait permettre, en raison de leur inscription générique et de leur nature médiatique, de développer des compétences en littératie médiatique multimodale tout en stimulant une réflexion sur le rapport au «réel», c’est-à-dire sur le rapport que les œuvres entretiennent avec la vie des autrices et le contexte dans lequel elles ont grandi.
Ces deux œuvres racontent chacune l’enfance, l’adolescence et une partie de l’âge adulte de leur scénariste4 . Publiée en quatre volumes à L’Association entre 2000 et 2003, Persepolis est la première bande dessinée de Marjane Satrapi. Coquelicots d’Irak, publiée en 2016 à L’Association, naît d’une collaboration entre Brigitte Findakly et son mari Lewis Trondheim: il s’agit de la première bande dessinée que Findakly co-écrit en tant que scénariste (et non en tant que coloriste uniquement). Findakly, née en 1959 en Irak, et Satrapi, née en 1969 en Iran, racontent leur quotidien d’enfant dans un contexte d’instabilité politique qui mènera à la guerre Iran-Irak en 1980 (dont il est question dans les deux œuvres). Elles abordent notamment leur adolescence, qui va de pair avec un départ en Europe (en Autriche pour Satrapi et en France pour Findakly).
Si la guerre et l’exil sont des contenus qui pourraient être explorés dans le cadre d’un usage pédagogique de ces œuvres, ils ne constitueront pas l’objet principal de cette étude, qui a plutôt pour but de proposer des pistes visant le développement de compétences littératiées et une réflexion sur le rapport entre faits et fiction, c’est-à-dire de donner les bases pour élaborer, au sein de la classe, un certain cadre interprétatif. Je me limiterai donc à examiner comment se construit le rapport entre l’œuvre et le «réel», que ce soit sur le plan péritextuel, textuel ou iconique, et à traiter la question de l’autoreprésentation, notamment par le biais de la photographie. Les spécificités multimodales et les questionnements relatifs à l’autobiographie se veulent transférables à d’autres bandes dessinées que celles de Satrapi et de Findakly et Trondheim.
Cadrage péritextuel
L’enseignement de l’autobiographie en bandes dessinées rend possible l’exploration des notions de factualité et de fictionnalité dans une perspective nuancée. Il donne l’occasion de guider les élèves vers la construction d’un «pacte de lecture» défini comme une «relation plurivoque, souple et mobile qui s’établit entre l’auteur et ses lecteurs» (Wagner 2012: 388). Malgré la souplesse de ce pacte, Wagner considère que cette relation est «fondée sur un ensemble de conventions tacites nées de l’usage» (Wagner 2012: 387). Ces conventions n’ayant pas nécessairement été rencontrées fréquemment en amont de la lecture scolaire, il est utile d’accompagner les élèves vers les différentes ressources favorisant la construction d’un pacte, dans le cas présent de type autobiographique (Lejeune 1996), tout en veillant à ce que celui-ci n’incite pas les élèves à ignorer la reconfiguration du réel opérée dans l’œuvre.
On peut attirer l’attention des élèves sur les aspects péritextuels qui montrent la complexité du cadrage interprétatif de l’œuvre dès le seuil de la lecture. En effet, un lectorat peu expérimenté pourrait associer prématurément la bande dessinée à des fictions de divertissement. Pour éviter que l’œuvre ne soit prise «à la légère»5, l’enseignement pourrait construire, avec les élèves, un cadrage interprétatif contextualisant, prenant en compte les différents éléments qui montrent une reconfiguration du vécu personnel tout en brouillant, dans une certaine mesure, les pistes génériques. Védrines et Ronveaux estiment que la notion de «genre» est fondamentale pour restituer les textes «dans le cadre social d’une communication». Selon eux, un enseignement littéraire devrait chercher à outiller les élèves «pour apprendre à expliciter ce que lire veut dire dans les normes des genres» (Védrines & Ronveaux 2019: 58). Si cette prise en compte des situations de communication apparait particulièrement importante dans le cadre d’un enseignement de récits testimoniaux6 (corpus de l’article de Védrines & Ronveaux), elle l’est aussi dans le cadre de textes de type autobiographique.
Pourtant, les textes ne se laissent pas volontiers catégoriser et plusieurs éléments péritextuels de Persepolis et Coquelicots d’Irak rendent d’emblée complexe toute tentative de classification générique, en soulignant un rattachement nuancé au genre autobiographique. Afin d’interroger ces nuances en classe, il peut être utile de proposer un examen minutieux des éléments iconotextuels du péritexte et, par exemple, de comparer les pages de couverture de différentes éditions.

Figure 1: Satrapi, Persepolis, L'Association, 2000, première de couverture © Marjane Satrapi & L'Association, 2000

Figure 2: Satrapi, Persepolis, L'Association, 2017, première de couverture © Marjane Satrapi & L'Association, 2017
Dans le péritexte de la première édition de Persepolis (2000, tome 1), le côté «autobiographique» est plutôt ténu. La combinaison iconotextuelle d’un guerrier perse à cheval, en première de couverture, et du titre Persepolis, renvoyant au nom de la capitale de l’empire perse – désormais réduite à l’état de ruines –, pourrait sembler encline à introduire un conte oriental (prenant place dans un espace-temps lointain ou fictionnel). La connaissance du contenu du livre permettrait d’identifier la petite fille représentée sur la quatrième de couverture, clouée au mur par les oreilles, comme «Marji», et aussi de réaliser qu’il s’agit là d’un autoportrait «fictif», puisque la scène de torture en question est imaginée par la protagoniste, suite à un conflit avec sa mère («Qu’est-ce que tu dirais si je te clouais au mur par les oreilles?» (2017: 47). Mais comme ce savoir est hors de portée, dans le cadre d’une approche strictement péritextuelle, c’est ici aussi à la catégorie générique du conte, de ses cruautés initiatiques, que ce dessin renvoie. Loin de fournir une fausse piste de lecture, l'identification de ce genre permet d’enrichir la lecture de Persepolis: même s’il ne s’agit pas d’un conte à proprement parler, le traitement auquel Satrapi soumet l’univers de l’enfance permet fréquemment d’en retrouver certains aspects. Enfin, précédant le récit et réorientant partiellement le pacte de lecture, une introduction rédigée par David B. ramasse en quelques paragraphes l’histoire de l’Iran, depuis l’invasion de la Perse par les Arabes en 642 jusqu’au moment où Mohamed Rezah fuit la Révolution en 1979. Il termine son texte ainsi: «Voilà, ça c’est la grande histoire. Marjane a hérité de tout ça, elle a réalisé le premier album de bandes dessinées iranien». Ce que David B. relève, c’est donc à la fois l’inscription de l’œuvre de Satrapi dans l’histoire iranienne – depuis L’Ascension du Haut Mal on connait son propre intérêt pour la question historique – et l’innovation médiatique de Satrapi par rapport à sa culture. En somme, le péritexte n’annonce pas de manière explicite que le livre s’apprête à raconter l’enfance et la jeunesse de l’autrice.
L’édition intégrale de Persepolis de 2017 offre une autre lecture péritextuelle du récit: la couverture représente Marji petite fille à côté de Marjane jeune femme. Cette évolution prend particulièrement sens dans une approche intermédiale de l’œuvre. En effet, le portrait de Marjane occupant le premier plan est le même que celui qui orne le coffret DVD du film d’animation éponyme de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi (2007). Le choix d’illustrer le profil droit de la jeune femme permet d’exhiber le grain de beauté qu’elle porte sur le nez. Ce «détail» fait écho à la narration, dans le troisième volume, de l’apparition de cette marque distinctive à l’âge de seize ans. En établissant un parallèle entre la protagoniste et l’autrice, cette modification d’ordre éditorial – qui survient également alors que Satrapi est davantage connue du «grand public»7 – peut rendre l’aspect autobiographique plus visible dans le péritexte. Pourtant, cette visibilité est relative, les élèves n’ayant pas forcément vu ou entendu parler du film Persepolis. En classe, une thématisation des différentes façons d’approcher l’œuvre, selon les connaissances antérieures des lecteur·trice·s, permet non seulement d’établir, dans le cas présent, des liens intermédiaux, mais aussi de mettre le doigt sur la pluralité des lectures découlant de la rencontre entre un texte et un sujet lecteur.
Vingt ans après la première édition, Satrapi ne qualifie pas volontiers son œuvre d’autobiographique. Interrogée par Virginie Bloch-Lainé sur ses intentions en créant Persepolis, elle affirme dans une interview: «Ça n’a jamais été mon truc de raconter ma vie» (Satrapi 2020). Elle présente la dimension personnelle comme une forme de «prétexte»:
J’ai utilisé mon histoire personnelle pour raconter quelque chose qui se passait autour de moi. Je n’avais pas d’autre moyen que de prendre ce parti-là parce que si je faisais autrement, c’était comme si je prétendais que j’étais soit sociologue, soit politologue, soit philosophe, soit historienne; et non seulement je n’ai pas cette prétention, mais en plus je n’ai même pas la connaissance et la science pour ça, ce n’est que mon point de vue personnel. (Satrapi 2020, ma transcription)
L’aspect autobiographique n’est donc mis en avant ni dans le discours qu’elle tient sur son œuvre vingt ans après, ni dans le péritexte de la première édition (2000), tandis qu’il l’est dans une certaine mesure dans l’édition intégrale. La prise en compte de cette évolution péritextuelle dans le cadre d’un enseignement dédié à Persepolis peut favoriser d’une part une réflexion sur le cadrage interprétatif et sur le rôle que joue le péritexte dans cette construction – bien que celle-ci s’opère aussi hors de l’œuvre – et, partant, elle peut encourager des considérations sur le «je» autobiographique et son positionnement par rapport à la dimension historique et collective des événements.

Figure 3: Findakly et Trondheim, Coquelicots d'Irak, L'Association, 2016, première de couverture © Brigitte Findakly, Lewis Trondheim & L'Association, 2016.

Figure 4: Findakly et Trondheim, Coquelicots d'Irak, L'Association, 2016, quatrième de couverture © Brigitte Findakly, Lewis Trondheim & L'Association, 2016.
Si les œuvres de Satrapi et de Findakly et Trondheim comportent la mention d’une zone géographique dès le titre, créant un lien – qui n’est pas nécessairement perçu en amont de la lecture – entre un élément biographique et une histoire collective, le péritexte de Coquelicots d’Irak fait référence de manière plus directe au vécu de Findakly. Celui-ci offre davantage d’indices orientant le cadrage vers un récit de type autobiographique. La quatrième de couverture montre un portrait de Findakly, représentée en train de peindre (il ne s’agit pas d’un autoportrait au sens plein du terme, étant donné que Trondheim et Findakly collaborent à la création de l’image, l’un au dessin, l’autre aux couleurs). Surplombant cette image, une phrase résume le propos du livre: «Au moment où l’histoire de l’Irak s’efface à l’explosif et les mémoires s’estompent peu à peu, ce récit recueille les souvenirs d’une fillette, d’une famille et de tout un pays». Cette phrase, qui fait référence à la destruction violente et récente de certains sites irakiens (les premières planches donnent l’exemple des sites archéologiques de Nimrod et d’Hatra), offre un ancrage contextuel à la bande dessinée. Elle met en parallèle la destruction de la mémoire collective et de la mémoire individuelle, présentant le livre comme un remède contre ces deux formes d’oubli.
Pour compléter ces informations, la couverture est munie d’un rabat qui précise que Brigitte Findakly est née en 1959 à Mossoul et qu’elle y a grandi jusqu’en 1973. Ces indications fonctionnent comme un «avertissement», construit probablement par Findakly, Trondheim et la maison d’édition («ce que vous allez lire a réellement été vécu») aussi bien que comme une proposition, voire une requête d’attitude de lecture («pourriez-vous prendre ce récit au sérieux?»). La «réponse» du lectorat permettra alors d’établir les prémisses d’un pacte autobiographique, qui pourra se confirmer (ou se modifier) au fil de la lecture. Des indices d’un tel pacte sont presque totalement absents du péritexte du récit graphique de Satrapi: ce n’est qu’une fois entré·e dans le texte, comme nous allons le voir, que s’instaure un rapport entre un «je» (qui semble engager l’autrice) et la petite fille représentée en première case.
Dans le cadre d’un enseignement de la bande dessinée autobiographique, on peut donc montrer aux élèves dans quelle mesure les éléments du péritexte relient les récits à des faits (historiques et/ou personnels) et situent des personnes par rapport à ces faits. On peut aussi aller plus loin en s’intéressant aux faits et personnes par d’autres biais que celui des œuvres: des recherches peuvent être menées par les élèves pour en apprendre plus sur la vie de Satrapi et de Findakly ou sur les événements historiques mentionnés, afin de mener une réflexion sur le rapport entre leur vie, le «réel» et l’œuvre. Sans glisser vers un relativisme absolu («tout est fiction») ni vers une naïveté trop grande («tout est réel»), il est essentiel, dans une société où textes et images sont souvent décontextualisés par le biais des réseaux sociaux, de rendre les élèves attentif·ve·s à cette mise en contexte de l’œuvre.
Photographie et autoreprésentation par le dessin: quels cadrages?
L’enseignement de la bande dessinée ne permet pas seulement de réfléchir au contexte, mais aussi aux différents types de médias (photographies, dessin, etc.) et au rapport de ces médias au «réel». En effet, la bande dessinée, par son caractère multimodal et composite, offre la possibilité d’agencer différents médias dans un même espace graphique, engageant une réflexion sur leur statut et un questionnement sur les a priori qui leur sont attachés. La juxtaposition de photographies et de dessins a notamment été largement exploitée par Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier, dans leur œuvre Le Photographe (2003), où les cases sont composées de dessins et de photographies qui s’alternent tout au long de l’œuvre. Findakly/Trondheim et Satrapi explorent également les possibilités de combinaisons de ces deux médias: tandis que Coquelicots d’Irak intègre de réelles photographies – régulièrement, une page entière est consacrée à réunir des photos de famille «en vrac» –, Satrapi mentionne textuellement des photographies, qui sont remédiatisées par le biais du dessin.
Cette manière de combiner des modes sémiotiques, ou de mentionner le rapport entre deux médias, peut amener les élèves à interroger la véracité de la photographie et à questionner les liens entre photos, dessin et texte. Par des réflexions guidées, les élèves peuvent se familiariser avec des concepts souvent réservés aux ouvrages critiques universitaires. Nancy Pedri constate que lorsque des photographies sont intégrées dans des graphic memoirs (comme Fun Home de Bechdel ou Maus de Spiegelman), elles n’ont pas seulement pour but de confirmer la réalité, la factualité ou la fidélité de ce qui est décrit (2013: 137), mais aussi de mettre en relief les points communs entre différentes modalités de représentation:
En plus de brouiller les frontières entre les dimensions documentaire et esthétique, l'inclusion de photographies dans les mémoires graphiques peut mettre l’accent sur un point commun, souvent négligé, entre images photographiques et images dessinées: l’une comme l’autre sont des représentations8.
Dans cette perspective, une réflexion sur l’insertion de photographies dans une bande dessinée peut permettre de construire une compréhension plus nuancée des différences entres les médias, et surtout de considérer les supports composites dans toute leur complexité.
Dès la première planche, Coquelicots d’Irak et Persepolis problématisent l’absence (ou la «présence» hors-cadre) d’éléments jugés importants. Précisons que ce que l’on nomme «hors-cadre» (ou «hors-champ») dans les domaines du cinéma ou de la photographie se double d’une dimension supplémentaire dans la bande dessinée, que Benoît Peeters a appelée le «péri-champ». Il est pertinent de différencier les notions de péri-champ et de hors-cadre dans la mesure où la première fait référence à des cases situées au sein d’un même espace graphique; dans ce sens, «cet espace à la fois autre et voisin influence inévitablement la perception de la case sur laquelle les yeux se fixent» (Peeters 2003: 21). Tandis que la notion de hors-cadre implique une forme d’«absence», celle de péri-champ, propre à la bande dessinée, peut être envisagée comme une forme de présence dans l’optique d’une lecture non linéaire, attentive au réseau que créent les cases sur la planche. Ce phénomène rend possible un jeu sur le cadrage: pendant la lecture d’une image, il y a, de part et d’autre de celle-ci, ce qui n’est «plus vraiment là» et ce qui est «déjà là». La comparaison des premières planches des deux bandes dessinées permet de souligner différentes manières de jouer avec le média de la photographie en l’intégrant ou en le remédiatisant au sein d’une bande dessinée.
En associant une lecture de type linéaire et une lecture de type «scriptural», l’élève est apte à saisir les divers jeux de cadrage et de dialogue entre une case et son péri-champ. Cette distinction entre deux types de lectures (syntagmatique et paradigmatique), déjà mise en relief par l’anthropologue et instigateur de la notion de literacy Jack Goody (1977), qui s’intéressait, outre la dimension textuelle, à des procédés graphiques tels que les listes et tableaux, a ensuite été reprise par Christian Vandendorpe – qui différencie linéarité et tabularité (Vandendorpe 1999) – puis, dans le domaine de la didactique, par Jean-Louis Chiss – textualité et scripturalité (Chiss 2004). Dans le domaine plus spécifique de la bande dessinée, Raphaël Baroni définit la lecture scripturale comme étant non pas «focalisée sur la compréhension linéaire», mais visant à «saisir l’architecture du récit graphique et ses effets de tressage iconique» (Baroni 2021a: 51).

Figure 5: Findakly et Trondheim, Coquelicots d'Irak, L'Association, 2016, première planche © Brigitte Findakly, Lewis Trondheim & L'Association, 2016.

Figure 6: Satrapi, Persepolis, L'Association, 2017, premier strip © Marjane Satrapi & L'Association, 2017.
L’effet de tressage qui se déploie sur toute la première page de Coquelicots d’Irak invite par exemple à effectuer une lecture scripturale et à anticiper ou revenir en arrière. Ainsi le lien métonymique qui unit la petite fille photographiée en première case et la protagoniste dessinée sur les autres cases (robe blanche, cheveux noirs) est doublé d’un lien iconotextuel dissimulé à l’arrière-plan. Le récitatif de la dernière case précise que les piliers visibles dans le décor représentent les pattes sculptées de lions ailés. En mettant en relief la question du cadrage, il donne des clés pour réinterpréter la première «case» (photo): «Si mon père avait soupçonné qu’un jour ces lions ailés allaient être détruits, il aurait dans doute cadré différemment la photo». Tandis que le père souhaite immortaliser une scène dont ses enfants constituent l’élément central, Findakly et Trondheim proposent un regard distancé sur l'instantané. Autant le cadrage du père que les choix textuels et iconiques de Findakly et Trondheim peuvent être perçus comme les traces d’un «discours» ou d’une forme «d’énonciation»9, qui établit en même temps une interprétation de la réalité. Si la photographie vise à saisir et à fixer dans le temps un événement familial éphémère, elle ne témoigne qu’en «marge» de l’existence du site archéologique, aujourd’hui démoli, le photographe ne pouvant anticiper cette précarité d’un monument millénaire. Devant la perte de ce hors-cadre, les auteurs de la bande dessinée choisissent de ne pas remédier à la lacune; ils ne complètent pas la représentation photographique des lions ailés par le dessin. Ce qui a été perdu ne sera pas retrouvé, le témoignage graphique souligne la perte au lieu de tenter d’y remédier.
La question du cadrage photographique fait également l’objet d’une mise en scène dans Persepolis, bien que Satrapi n’insère pas réellement de cliché dans son œuvre. Elle affirme dans le récitatif de la deuxième case: «Ça c’est une photo de classe. Je suis assise à l’extrême gauche, alors on ne me voit pas.». L’usage du pronom démonstratif dans le récitatif indique que l’image qui complète le texte dans la case, bien que dessinée, est censée reproduire un cliché dont Marji se trouverait exclue. Cette «marginalisation» est en partir contredite par la case précédente, qui se trouve à gauche de l’image tronquée. Cette exclusion est en partie contredite par la case précédente, qui se trouve «à gauche» de l’image tronquée: Satrapi s’y représente, son identité étant affirmée par un autre pronom démonstratif, qui fait également office de pacte autobiographique: «Ça, c’est moi quand j’avais dix ans. C’était en 1980». La première case fait donc à la fois office de cadrage (au sens de contextualisation) et, en quelque sorte, de «recadrage», par rapport à l’absence signifiée dans la case suivante. Par ce dispositif, Satrapi signale, à l’instar de Findakly et Trondheim, qu’une photographie ne montre pas tout et qu’elle peut même laisser l’essentiel dans ses marges. Mais elle prend d’emblée le parti de la reconstitution en s’appuyant sur deux modes de représentation du passé, la narration verbale et le dessin, qui sont capables de combler les lacunes documentaires. Tandis que dans Coquelicots d’Irak, le dessin refuse de remédier à la destruction du site archéologique, dans Persepolis le jeu sur le péri-champ complète ce qui n’a pas été cadré par le supposé photographe.
L’insertion d’une photographie au sein d’une planche, ou sa simple imitation graphique, peuvent avoir une influence décisive sur le pacte de lecture, bien qu’en l’occurrence, cette notion doive être repensée en tenant compte des spécificités médiatiques de la bande dessinée. Par une série d’exemples, Catherine Mao a montré les limites de la notion de «pacte autobiographique» en bande dessinée. Selon elle, ce média ne peut pas offrir une perspective homogène du soi de l’auteur·trice et il entraîne une quête identitaire nécessairement «contrariée et plurielle». Dans cette optique, elle affirme que «la bande dessinée dénonce le filtre au cœur de toute écriture de soi et épure ainsi le pacte autobiographique d’un certain nombre de ses illusions» (Mao 2013: §33). Satrapi débute son œuvre par les termes «Ça c’est moi», pourtant, il s’avère que la petite fille ressemble en tous points aux autres filles de sa classe. Seuls les cheveux, presque entièrement recouverts par le foulard, différentient légèrement les enfants les unes des autres. Puisque l’image ne la distingue pas de ses camarades, le texte est nécessaire pour individualiser Marji. Le dispositif visuel d’indistinction – déjà employé par l’auteur de bande dessinée Christian Binet dans son récit d’enfance intitulé L’Institution (1981) – fait partie, selon Mao, des «stratégies d’esquive» de l’autoreprésentation (2013: §4).
S’il est important d’enseigner à repérer des indices de factualité, il est aussi essentiel de montrer que la réalité ne se donne pas d’elle-même. Ces réflexions concernant le cadrage ont ainsi pour but de révéler qu’un récit basé sur des faits authentiques ne constitue pas pour autant un récit objectif et fidèle. L’«identité» se construit également à travers le «hors-champ», par le «péri-champ» et, paradoxalement, à travers la multiplicité des représentations iconiques. Pour reconstruire l’identité du sujet, il s’agit ainsi de tresser des relations, parfois incertaines, entre des images dessinées, un pronom personnel et une identité auctoriale affichée sur la couverture.
Pour un enseignement sensibilisant à la spécificité du langage de la bande dessinée
Ainsi que nous l’avons vu, la bande dessinée propose une expérience de lecture assez différente de celle que l’on observe dans les textes dits «littéraires». En effet, la présence de cases incluant du texte et des images au sein d’une unité graphique de rang supérieur (strip, planche, ou volume) permet un traitement particulier de la linéarisation des informations, de sorte que l’élaboration et la réception d’un récit narratif multimodal (et son cadrage générique) suit un processus particulièrement complexe.
De nombreux critiques10, dans le sillage de Will Eisner, ont défini la bande dessinée comme un «art séquentiel» (sequential art) au sein duquel la case constitue un élément fondamental, et comme l’affirme Benoît Peeters: «Loin de se poser comme un espace suffisant et clos, la case de bande dessinée se donne d’emblée comme un objet partiel, pris dans le cadre plus vaste d’une séquence» (Peeters 2003: 24). Entre arrêt sur image et continuité, entre rappel de la case précédente et appel de la suivante, Peeters et d’autres auteurs11 ont décrit les particularités de cette unité, en particulier son intrication étroite avec un ensemble qui la dépasse. Mais d’autres éléments peuvent être considérés comme les maillons d’une chaîne séquentielle: les textes au sein de la case, le strip, la planche, le chapitre, l’album, etc. – autant d’unités qui possèdent une certaine «autonomie», tout en étant elles-mêmes intégrées dans une totalité de rang supérieur. À tous ces niveaux, des effets de sens peuvent être dégagés à partir de la temporalité que le lecteur ou la lectrice doit reconstruire, de manière plus ou moins libre ou réglée, à l’intérieur des espaces graphiques. Précisons que si les cases sont généralement délimitées par des cadres et séparées par des gouttières12, il arrive – comme c’est le cas dans Coquelicots d’Irak – que la frontière soit moins nette, entraînant une perception légèrement modifiée de la séquentialité.
Si les textes «littéraires» sont globalement caractérisés par leur linéarité, la planche de bande dessinée crée en revanche une tension entre cette linéarité et la mise en réseau des informations, ce qui entraîne une progression de la lecture spécifique13. Tandis que la dimension textuelle du récit graphique invite le regard à progresser de manière linéaire, sa dimension visuelle (ou tabulaire) l’invite au contraire à circuler à la surface du support et à embrasser la double planche, proposant un cheminement de lecture nouveau, plus ou moins créatif. Les créateurs et créatrices tirent parti de cette potentielle «indocilité» du regard, par exemple en tissant des liens visuels entre différentes lieux de l’espace graphique, ce que Groensteen qualifie d’effet de «tressage iconique»14(1999). Entre textualité et création d’un réseau inter-iconique, entre effets de sens induits par le récit et singularité de chaque lecture, il est particulièrement difficile d’anticiper le trajet des yeux d’un lecteur ou d’une lectrice de bande dessinée. Cette imprévisibilité peut être augmentée lorsque l’auteur ou l’autrice joue sur une mise en page dans laquelle les cases ne sont pas délimitées par un cadre ou lorsqu’elles ne sont pas architecturées selon les agencements conventionnels du «gaufrier» (pour reprendre l’expression popularisée par André Franquin). Si cette forme de liberté liée à l’espace graphique permet de répondre de manière personnelle aux différents stimuli visuels disséminés à la surface de la planche ou de la double-planche, elle implique également, en regards de textes «littéraires», une complexité supplémentaire.
Dans le cadre d’un enseignement soucieux d’insister sur les spécificités formelles de la bande dessinée, il sera ainsi utile de susciter chez les élèves une réflexion à la fois sur les effets de sens qui se dégagent de la planche (par exemple «quels effets produit le tressage?») et sur les différentes façons dont les lecteur·trice·s arpentent cet espace, ainsi que sur les stratégies qui rendent la lecture plus efficace ou plus critique. Dans ce but, il peut être pertinent de passer un certain temps sur des planches riches comme celles que j’ai commentées et d’encourager les activités engageant une métacognition: «Quel trajet effectuent vos yeux sur la page?», «Qu’est-ce qui guide ce trajet?», «Quel sens apparaît quand on met en relation tel texte avec telle image, et telle case avec telle autre case?». À partir de ces interrogations, les élèves pourront partager leurs façons de lire et discuter des effets de sens qu’ils/elles auront observés.
On constate par ailleurs la nécessité de rendre les élèves attentif·ve·s aux indices paratextuels, péritextuels ou textuels, susceptibles de construire un cadre interprétatif en accord avec le statut générique de l’œuvre. Ici se joue toute la complexité du récit autobiographique en bande dessinée comme objet d’enseignement: il est doté d’un ancrage référentiel, mais il est également l’œuvre singulière et subjective d’une auctorialité, qui s’exprime autant par la monstration dessinée que par le biais d’une narration verbale.
Dans son article dédié aux défis de l’élargissement transmédial de la question de la frontière entre fait et fiction, Baroni (2021b) montre que tout média peut constituer une représentation factuelle – chacun le faisant avec ses propres moyens15 – mais que cette représentation n’est jamais exempte de subjectivité, laquelle s’exprime de manière différente en fonction des supports. Comme le dit García Márquez dans son œuvre en partie autobiographique: «La vie n’est pas ce que l’on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s’en souvient» (García Márquez 2003: 7). Cette nuance rappelle qu’il est utile d’activer ce que Schaeffer appelle un «“monitoring” critique» par rapport à la valeur de vérité du récit (Schaeffer 2015: 246). Dans une perspective pédagogique, comprendre un récit autobiographique en bande dessinée, c’est d’une part pouvoir le recontextualiser (ce qui entraîne un engagement particulier dans la lecture), mais c’est aussi appréhender la manière dont il est construit et l’effet que cette construction produit sur nous. Cette seconde posture requiert d’exercer son esprit critique face à un récit reconstruit à partir de souvenirs et de remémorations, bien réels mais qui, comme le signale la quatrième de couverture de Coquelicots d’Irak, «s’estompent peu à peu».
Toute personne n’est pas familière avec le langage de la bande dessinée, comme le rappelle Novak16. Aussi, il importe d’élaborer un enseignement accessible pour des élèves qui entretiennent des affinités différentes avec le média. Si la présence d’images peut parfois favoriser la compréhension, elle peut également la complexifier ou l’entraver. Il s’agit alors d’apprendre à lire les images, d’apprendre à interpréter les rapports complexes qui se tissent entre elles, mais aussi entre ces images et le texte, de case en case et de planche en planche. Partant de cette multiplicité potentielle des rapports que chaque apprenant·e peut entretenir avec la bande dessinée, l’enseignant·e peut donner à chacun·e des clés permettant d’élargir et d’enrichir ses compétences littératiées en mettant en avant les spécificités du média et en l’aidant à en prendre conscience.
Bibliographie
Baroni, Raphaël (2021a), «Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée», La Lettre de l’AIRDF, n°68, p. 49-53.
Baroni, Raphaël (2021b), «Of Mice as Men: A Transmedial Perspective on Fictionality», Narrative, n°29 (1), p. 91-113.
Barré-De Miniac, Christine (2003), «La littéracie: au-delà du mot, une notion qui ouvre un champ de recherches variées», Revue suisse des sciences de l’éducation, n°25 (1), p. 111-123.
Chiss, Jean-Louis (2004), «La littératie: quelques enjeux d’une réception dans le contexte éducatif et culturel français», in La littéracie: conceptions théoriques et pratiques d’enseignement de la lecture-écriture, C. Barré-de Miniac, C. Brissaud & M. Rispail (dir.), Paris, L’Harmattan, p. 43-52.
Findakly, Brigitte & Trondheim, Lewis (2016), Coquelicots d’Irak, Paris, L’Association.
García Márquez, Gabriel (2003), Vivre pour la raconter, Paris, Grasset.
Goody, Jack (1979), La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, J. Bazin & A. Bensa (trad.), Paris, Les Éditions de Minuit.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration. Système de la bande dessinée, vol. 2, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Jaffré, Jean-Pierre (2004), «La litéracie [sic]: histoire d'un mot, effets d'un concept», in La littéracie. Conceptions théoriques et pratiques d'enseignement de la lecture-écriture, C. Barré-De Miniac, C. Brissaud & M. Rispail (dir.), Paris, L'Harmattan, p. 21-41.
Lacelle, Nathalie, Boutin, Jean-François & Lebrun, Monique (dir.) (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique. Outils conceptuels et didactiques, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Lachat, Jacob, Schaer, Camille & Zbaeren, Mathilde (eds.) (2020), Regards sur le témoignage. A contrario. Revue interdisciplinaire de sciences sociales, n°30, p. 3-13. En ligne, consulté le 15 juin 2021, URL: https://www.cairn.info/revue-a-contrario-2020-1.htm
Lejeune, Philippe (1996) [1975]), Le pacte autobiographique, Paris, Seuil.
Mao, Catherine (2013), «L’artiste de bande dessinée et son miroir: l’autoportrait détourné», Comicalités. En ligne, consulté le 21 janvier 2016, DOI: https://journals.openedition.org/comicalites/1702
Marion, Philippe (2018), «Les stratégies du chapitre en BD reportage», Cahiers de Narratologie, n°34, consulté le 5 février 2021. DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.9085
Marion, Philippe (1997), «Narratologie médiatique et médiagénie des récits», Recherches en communication, n°7, p. 61-88.
Mccloud, Scott (2007) [ 1993]), L’art invisible, Paris, Delcourt.
Missiou, Marianna (2012), «Un médium à la croisée des théories éducatives: bande dessinée et enjeux d’enseignement», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, ELLUG.
Novak, Ryan (2014), Teaching Graphic Novels in The Classroom. Building Literacy and Comprehension, Waco, Prufrock Press Inc.
Painchaud, Gisèle, D’anglejan, Alison, Armand, Françoise & Jezak, Monika (1993), «Diversité culturelle et littératie», Repères: Essais en éducation, n°15, p. 77-94.
Pedri, Nancy (2013), «Graphic Memoir: Neither Fact Nor Fiction», in From Comic Strips to Graphic Novels. Contributions to the Theory and History of Graphic Narrative, D. Stein & J.-N. Thon (dir.), Berlin; Boston, De Gruyter, p. 127-153.
Peeters, Benoît (2003) [1998]), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Raux, Hélène (2019), «Ce que les blogs d’enseignants disent de la lecture de bandes dessinées à l’école», Tréma, n°51. En ligne, consulté le 6 août 2019. DOI: https://journals.openedition.org/trema/4826
Saint-Exupéry, Antoine de (2000) [1946]), Le Petit Prince, avec des aquarelles de l’auteur, Paris, Gallimard.
Satrapi, Marjane (2017), Persepolis, édition intégrale, Paris, L’Association.
Satrapi, Marjane (2000), Persepolis, tome 1, Paris, L’Association.
Satrapi, Marjane (2020), Épisode 2. Persepolis, Interviewer: V. Bloch-Lainé. À voix nue, France culture, diffusé le 13 octobre.
Schaeffer, Jean-Marie (2015), «Immersion», in Fragments d’un discours théorique. Nouveaux éléments de lexique littéraire, E. Bouju (dir.), Nantes, Éditions nouvelles Cécile Defaut, p. 225-247.
Tabachnick, Stephen E. (dir.) (2009), Teaching the Graphic Novel, New York, The Modern Language Association of America.
Vandendorpe, Christian (1999), Du papyrus à l’hypertexte, Paris, La Découverte.
Védrine, Bruno & Ronveaux, Christophe (2019), «Agir par la littérature. L’intention éthique à l’épreuve des pratiques d’enseignement des textes», Repères, n°58, p. 49-62.
Viala, Alain (1998), «Rhétorique du lecteur et scholitude», in L’acte de lecture, D. Saint-Jacques (dir.), Montréal, Éditions Nota bene, p. 323-336.
Wagner, Frank (2012), «Des coups de canif dans le contrat de lecture», Poétique, n°4 (172), p. 387-407.
Pour citer l'article
Camille Schaer, "Enseigner la bande dessinée autobiographique pour développer la littératie médiatique multimodale", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-bande-dessinee-autobiographique-pour-developper-la-litteratie-mediatique-multimodale
Voir également :
Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
Si la reconnaissance de la valeur culturelle de la bande dessinée, durement conquise au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui acquise{{Rappelons, au niveau de la reconnaissance institutionnelle, que le ministère de la culture en France a décrété l’année 2020 «année de la bande dessinée». Sur cette phase de «post-légitimation», voir notamment (Berthou 2017; Heinich 2019). Notons néanmoins qu’en dépit de ces honneurs, de nombreux·ses auteur·e·s et éditeurs·trices insistent sur le fait que leur profession est menacée de paupérisation, notamment en raison d’une surproduction saturant le marché et du manque de soutien institutionnel, ce qui a récemment conduit Lewis Trondheim à renvoyer au ministère la médaille de chevalier des arts et lettres qui lui avait été attribuée en 2005.}}, sa place au sein des programmes scolaires reste malgré tout fragile, ce qui a amené récemment Flore Steyaert et Jean-Louis Tilleul (2017: 233) à conclure que l’école restait «un caillou dans le soulier de la légitimation» de ce médium{{Cette publication est liée au projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique: "Pour une théorie du récit au service de l'enseignement" (Projet FNS n° 100019_197612 / 1).}}.
Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
Enseigner la bande dessinée dans un monde qui avance
Si la reconnaissance de la valeur culturelle de la bande dessinée, durement conquise au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui acquise1, sa place au sein des programmes scolaires reste malgré tout fragile, ce qui a amené récemment Flore Steyaert et Jean-Louis Tilleul (2017: 233) à conclure que l’école restait «un caillou dans le soulier de la légitimation» de ce médium2. Pour envisager le type de résistance que peut rencontrer la bande dessinée quand il s’agit de l’étudier en classe, il peut être intéressant d’envisager les choses sous l’angle, non pas des prescripteurs et des enseignant·e·s, mais sous celui des auteur·es et des représentations des élèves. Dans son dernier album –que l’on peut qualifier de roman graphique ou d’autofiction en bande dessinée– l’auteur genevois Frederik Peeters met en scène son avatar, Oleg, lors d’une intervention en classe qui, précise-t-il, est le «moyen qu’il a trouvé pour rester connecté avec le monde qui avance» (Peeters 2021: n.p.).
 Image 1: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 1: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Lorsque l’enseignante demande aux élèves si quelqu’un a une question à lui poser, Oleg se heurte d’abord à un mur de silence. L’enseignante recadre un élève endormi, qui explique, pour justifier son état comateux, avoir «regardé la nouvelle saison de "Titans"» la nuit précédente3. La plupart des questions posées à l’auteur concernent ensuite la longueur du labeur aboutissant à la création d’un album et le profit qui se dégage de cette activité. Lorsqu’Oleg répond que la réalisation de son album lui a pris à peu près une année, une élève réagit en disant «c’est trooop looong». Oleg répond qu’il pense être, au contraire, plutôt rapide et demande à l’élève combien de temps il lui a fallu pour lire son album. Elle répond «quinze minutes», expliquant qu’elle n’a lu en réalité que les premières pages, et Oleg découvre ainsi que seulement deux élèves de la classe ont lu son œuvre dans son intégralité.
 Image 2: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 2: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Cette confrontation avec le «monde qui avance» souligne plusieurs aspects de l’évolution récente de la bande dessinée et de ses rapports à l’enseignement. Premièrement, la posture d’Oleg et son décalage vis-à-vis des représentations de plusieurs élèves soulève la question d’une polarisation de la production qui s’est opérée au sein du champ de la bande dessinée à partir de la fin des années 19604 et de ses effets sur la manière de lire les récits graphiques dans et hors de la classe. Le premier pôle renvoie à l’autonomie créative d’un artiste publiant ses œuvres chez des éditeurs indépendants ou issus du champ littéraire. Peeters est par exemple édité chez Gallimard, à l’Association ou chez Atrabile, éditeur indépendant genevois dont il est cofondateur, et il dispose ainsi d’un contrôle étendu sur la thématique, le style et le format de ses récits graphiques. Il faut relever par ailleurs qu’il n’est plus irréaliste d’imaginer qu’un auteur correspondant au profil de Frederick Peeters / Oleg puisse être invité dans une classe de français pour parler de son œuvre, à l’instar d’un écrivain. En l’occurrence, quand l’enseignante présente l’auteur, elle évoque un «prix BD des écoles5», ce qui témoigne également du gain de légitimité au sein des institutions scolaires. Cette liberté implique en revanche un mode de production artisanal et très chronophage, dans lequel un auteur «complet» réalise peu ou prou toutes les tâches, ce qui lui assure un revenu instable essentiellement lié à la gestion de ses droits6.
Le second pôle renvoie aux industries culturelles visant une accélération de la production fondées sur une standardisation des produits et sur la division du travail et l’anonymisation des créateurs, lesquels ne disposent plus que d’une liberté très limitée7. Aujourd’hui, le type de bandes dessinées le plus largement diffusé parmi les jeunes sont des produits émanant de grands groupes industriels, à l’instar de Disney, de Sony ou de Média Participations, qui intègrent différents supports médiatiques et coordonnent les activités de milliers d’employés. Et évidemment, au sommet de ces empires médiatiques, certains auteurs historiques, comme Hergé, Zep ou Stan Lee, peuvent accumuler des fortunes considérables. Bounthavy Suvilay et Edith Taddei (2019) rappellent par ailleurs que les bandes dessinées les plus largement consommées par les jeunes se rattachent aujourd’hui au genre importé du manga, qui a connu ces dernières années un essor phénoménal, soutenu par la diffusion sur les chaines en streaming d’adaptations sous forme d’anime.
Si la bande dessinée dans son ensemble a donc visiblement conquis ses lettres de noblesse, les œuvres valorisées par le monde de l’éducation semblent ainsi de plus en plus déconnectées des œuvres appartenant pleinement à la culture «juvénile» (Mitrovic 2019), ici incarnée par une série télévisée adaptée d’un univers créé par DC comics. La réaction de l’élève quant à l’état du compte en banque d’Oleg est prise par ce dernier comme peu pertinente, parce qu’à ses yeux, l’élève se trompe de pôle, confondant un auteur appartenant au champ de production restreinte avec un créateur travaillant à une échelle industrielle. Mais au-delà de la méprise, voire du mépris que l’on serait tenté d’adopter devant une question si triviale, se cache une réalité socioculturelle dont l’élève se fait ici le témoin précieux: le fait que lui, comme vraisemblablement la majorité de ses camarades, n’est exposé qu’au second de ces deux pôles et qu’il n’envisage pas l’existence d’une culture autonome, centrée sur l’individu producteur et héritée du XIXe siècle. Il n’a finalement en face de lui qu’un adulte actif parmi d’autres, au sein d’une société où la réussite individuelle se mesure à l’argent que l’on gagne.
En somme, la scolarisation de la bande dessinée est évidemment liée à «l’artificationde la bande dessinée» (Heinich 2017), mais la «légitimité culturelle» (Berthou 2017) dont jouit une partie de la production éloigne d’autant les corpus enseignés des représentations ordinaires que se font les élèves du médium, ce qui ne manque pas de produire des malentendus et des difficultés dans l’émergence d’une lecture de la bande dessinée que l’on pourrait qualifier de littéraire, au sens que les didacticiens donnent de ce terme (Dufays, Gemenne & Ledur 2005; Ronveaux & Schneuwly 2018). Ce que montrent les réactions de la plupart des élèves dans cet extrait, c’est que ces derniers assimilent la bande dessinée à une forme de culture populaire – à l’instar des mangas et des comics qui peuplent leur bibliothèque intérieure – et que cela induit des questionnements orientés sur des enjeux essentiellement économiques ou professionnels, au lieu d’adopter des gestes de lecture qui se seraient sédimentés dans la pratique scolaire du commentaire des textes littéraires. Ce faisant, l’entrée de la bande dessinée dans la classe de français, d’une part, ne produit pas forcément un rapprochement entre lectures scolaires et lectures privées (Norton 2003; Mitrovic 2019; Suvilay & Taddei 2019) et d’autre part, ne débouche pas nécessairement sur la pratique d’une lecture susceptible de renforcer le développement d’une littératie médiatique multimodale (Boutin 2012).
Le rappel de cette dualité explique que, face à cette forme d’expression que Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019) définissent – à la suite de Thierry Groensteen (2006) – comme un «objet didactique mal identifié», les angles interprétatifs peuvent diverger sensiblement en fonction du statut qui est accordé à l’œuvre commentée. L’entrée de la bande dessinée dans la classe de français ne pose donc pas seulement la question de son identité médiatique, mais également celle de son statut culturel et des angles de lecture qui en découlent. Peut-on considérer la bande dessinée comme une forme de littérature? Ces questions, inlassablement posées depuis une vingtaine d’années (Morgan 2003; Chute 2008; Meskin 2009; Baetens 2009; Dürrenmatt 2013) ne doivent donc pas être comprises uniquement en termes généraux et médiatiques mais également en termes locaux et critiques. Pour rendre les enjeux plus explicites, il faudrait commencer par poser les questions suivantes: peut-on lire en classe certaines bandes dessinées comme on lirait des romans ou des pièces de théâtre? peut-on poser aux récits graphiques le même genre de questions que l’on poserait à des œuvres littéraires? peut-on étudier ces compositions de textes et d’images selon des procédures similaires à celles que l’on mobilise face à la représentation verbale ou scénique d’une histoire?
Il s’agirait ensuite d’anticiper une éventuelle réponse positive à ces questions pour qu’apparaisse une problématique secondaire: si cette lecture est possible, c’est probablement parce que l’on se refuse encore à envisager l’institutionnalisation de la bande dessinée dans le cadre scolaire sous un angle qui engloberait le caractère industriel et commercial d’une partie non négligeable de ses manifestations. Et qu’un tel refus risque de reconduire une forme sociologiquement induite d’inégalité parmi les élèves, en particulier en termes de cadrage des activités (Rochex & Crinon 2014), dont la séquence d’enseignement reproduite ici par Peeters semble relativement dépourvue. Oleg ou l’enseignante auraient pourtant pu profiter de cette question, qui n’est impertinente qu’en apparence, pour mentionner l’existence de différents types de produits culturels rattachables au média «bande dessinée» et expliciter les différences de nature existant entre ces produits en ce qui regarde la liberté dont disposent les créateurs, laquelle ne garantit nullement la qualité finale de l’objet. Cela aurait aussi permis de signaler l’existence d’œuvres populaires nées d’un compromis entre les contraintes d’une production industrielle plus ou moins formatée et la réputation de génies qui s’attache à certains auteurs formant un panthéon historique, à l’instar d’Osamu Tezuka, de Jack Kirby, d’Hergé ou de la paire René Goscinny et Albert Uderzo, qui a enfanté une œuvre pharaonique: 380 millions d’albums vendus dans le monde, plusieurs blockbusters cinématographiques, un parc d’attraction, etc.
Les conditions matérielles de production ne devraient ainsi jamais être complètement évacuée d’un enseignement centré sur l’histoire et l’esthétique de la bande dessinée, l’émergence et l’évolution de ce média relativement jeune étant consubstantiellement liées à l’essor de la presse imprimée et des logiques sérielles qui en découlent et sous-tendent encore la plupart des productions, même les plus auteuristes. Même les auteur·e·s indépendant·e·s ne peuvent survivre en se privant totalement des circuits de production et de diffusions traditionnels, et le positionnement de leurs œuvres ne peut se comprendre qu’en lien étroit avec les formes et les thèmes développés par les industries culturelles, ainsi qu’en témoigne la récurrence des motifs superhéroïques dans les œuvres de Chris Ware ou de Daniel Clowes.
Oleg se montre néanmoins reconnaissant lorsqu’une élève lui adresse enfin une question qu’elle aurait très bien pu poser à Flaubert, à Maupassant… ou à Houellebecq: quelle place donnez-vous à l’actualité du monde dans votre travail? Est-ce que vous hésitez entre faire des histoires intemporelles et des histoires réalistes? La question suppose évidemment que l’auteur dispose de suffisamment d’autonomie pour envisager ces différentes options et choisir celle qui correspond le mieux à son projet artistique. Le roman graphique de Frederik Peeters est enfin abordé sous l’angle de sa littérarité et non sous l’angle unique de son statut d’objet culturel rattaché à l’industrie des loisirs. S’ouvre alors la possibilité d’une véritable disciplination de la bande dessinée par son rattachement à la pratique de la lecture littéraire telle qu’elle s’est sédimentée dans les pratiques scolaires (Ronveaux & Scheuwly 2018).
 Image 3: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
Image 3: Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile
La bande dessinée d’auteur et sa lecture scolaire
Jan Baetens avance que «la rencontre des domaines longtemps séparés de la littérature et de la bande dessinée» s’impose aujourd’hui «comme une évidence» (2009: §1), ce dont témoigne, entre autres, l’explosion des adaptations de classiques en bande dessinée, mais aussi l’émergence d’un genre identifié comme «roman graphique» et son accession à des prix littéraires prestigieux. Toutefois, Baetens souligne le risque de confondre cette rencontre avec une forme de fusion ou d’hybridation:
Une chose est l’explosion des croisements entre littérature et bande dessinée, autre chose est le bien-fondé ou la solidité de cette nouvelle hybridité, qui ne manque pas de soulever plus d’une question essentielle sur notre conception même du récit. (Baetens 2009: §1)
Si l’on exclut les adaptations ne servant que de marchepied pour accéder aux œuvres vraiment littéraires, les bandes dessinées enseignées dans les classes de français comme de la littérature sont plutôt rares et les mêmes titres ne cessent de revenir dans les discours des chercheur·euse·s, didacticien·ne·s, enseignant·e·s: Maus, Persepolis, Pilules bleues, Fun Home… Ce retour inlassable d’un corpus d’œuvres restreint témoigne d’une part de la difficulté d’établir un périmètre élargi de récits graphiques dignes d’être enseignés en classe comme de la littérature. La patrimonialisation des œuvres passant généralement par leur inscription dans les corpus scolaires, pour le meilleur ou pour le pire, on peut dès lors considérer que l’école n’a pas encore joué son rôle de sélection des œuvres supposément légitimes, le choix des enseignant·e·s se repliant sur la bibliothèque intérieure correspondant à leurs lectures privées liées à l’enfance et à l’adolescence8 (donc souvent liées à des œuvres populaires) ou sur quelques succès critiques validés par des prix ou des récompenses, avec le fameux Pulitzer pour Art Spiegelman, bien sûr, mais aussi le prix du jury du Festival de Cannes pour l’adaptation cinématographique de l’œuvre de Marjane Satrapi. On peut donc anticiper sur cette sélection en considérant la possibilité qu’elle se calque sur une légitimité dont elle emprunte les caractéristiques sociologiques à la littérature, sans tenir compte des spécificités médiatiques du champ de production de la bande dessinée.
Par ailleurs, si le statut culturel acquis par certaines œuvres font de la bande dessinée un objet certes mal identifié mais au moins potentiellement enseignable, il ne faut pas négliger les problèmes inhérents à la disciplination des gestes de lecture spécifiques, aussi bien du côté de l’enseignant que de celui des élèves9, ce qui passe par l’intégration de pratiques compatibles avec la conception que l’on peut se faire d’un enseignement de la littérature, mais aussi par l’établissement de procédures nouvelles, adossées aux caractéristiques sémiotiques du support. Outre le problème du rattachement des œuvres à un média populaire, qui complexifie le cadrage interprétatif des enseignant·e·s et des apprenant·e·s, le mélange de textes et d’images dessinées pose ainsi un problème qui se reflète dans les hésitations des plans d’étude: faut-il rattacher la bande dessinée à l’histoire de l’art ou à la classe de français? Comment traiter à la fois le style graphique des dessins, la composition de la case et celle de la planche, le découpage de l’action, les effets de cadrage, le contrastes des couleurs, tout en liant ces aspects au développement du récit, aux jeux sur la focalisation et le point de vue, aux dialogues et aux récitatifs, alors que la formation initiale des enseignant·e·s de français ne les a généralement guère préparé·e·s à traiter ces aspects simultanément.
Ainsi que l’ont montré Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), le chemin est encore long pour former les enseignant·e·s à des gestes interprétatifs susceptibles d’intégrer ces différentes dimensions, sans pour autant tomber dans un répertoire de notions techniques déconnectées des enjeux esthétiques ou éthiques soulevés par la lecture de l’œuvre, et sans se méprendre sur la complexité inhérente à un médium à la fois textuel et graphique. L’objectif de ce numéro est précisément de contribuer à développer des pistes de réflexions relatives à l’ensemble de ces aspects, d’abord en lien avec l’histoire du médium et de sa scolarisation, puis orienté sur différentes propositions didactiques et observations en classe.
La première partie, qui s’inscrit dans une perspective historique, s’ouvre sur un article de Nicolas Rouvière exposant la situation actuelle de la bande dessinée, qui est entrée depuis une dizaine d’années dans une phase que l’on peut définir comme celle d’une «post-légitimation». Si cette nouvelle manière d’envisager le média devrait lui ouvrir les portes de l’enseignement aux différents niveaux de la scolarité, elle pousse aussi Rouvière à dresser le constat d’un déficit de «théorisation didactique éclairant les enjeux et les modalités de son étude en classe», ce qui souligne l’importance de renforcer la recherche dans ce domaine. Cette théorisation apparait d’autant plus importante que les matérialisations médiatiques des récits graphiques ne cessent de se complexifier dans la culture numérique contemporaine, brouillant les frontières entre bande dessinée, jeu vidéo, dessin animé ou série télévisée.
L’article suivant offre un survol historique beaucoup plus large des relations tumultueuses entre la bande dessinée et les institutions scolaires, en suivant la piste des instructions officielles en France de manière à mettre en lumière, depuis les années 1960, la place réservée aux récits graphiques dans les programmes scolaires. Sophie Béguin illustre cette trajectoire scolaire qui, en effet, semble en partie déconnectée des enjeux entourant la légitimation culturelle du médium. Les hésitations portent non seulement sur les titres ou le nombre d’œuvres préconisés par les instructions officielles, mais également sur le rattachement disciplinaire de l’étude de la bande dessinée. Enfin, si la scolarisation du médium ressemble à une série de rendez-vous manqués, Béguin montre que c’est aussi en raison d’une certaine méfiance émanant des milieux de la bande dessinée, certain·e·s de ses représentant·e·s craignant les effets de la scolarisation d’un objet qu’ils·elles préfèrent ranger dans le domaine de la contre-culture et de la subversion.
Le troisième article de cette partie historique envisage la place de la bande dessinée vis-à-vis de l’enseignement du français langue étrangère, à travers l’analyse d’un corpus de manuels publiés entre 1919 et 2020. Son auteure, Anick Giroud, soulève un intéressant paradoxe: alors que le potentiel didactique des images narratives pour l’enseignement des langues est très tôt reconnu, avec l’émergence des méthodes directes au début du XXe siècle, puis, de manière encore plus marquée, avec l’éclosion des méthodes audio-visuelles, communicatives et actionnelles, la place de la bande dessinée en tant que document authentique est restée très modeste. La grande majorité des récits graphiques insérés dans les manuels demeure donc le travail d’illustrateurs·trices, produisant des objets sur mesure, adaptés aux objectifs de la leçon, mais dépourvus de valeur culturelle. Face à ces documents forgés, les modalités d’une lecture littéraire apparaissent impossibles, et la valeur culturelle du médium singulièrement diminuée.
La partie suivante réunit trois propositions didactiques adossées à des œuvres dont la réputation littéraire est fortement établie, du Maus d’Art Spiegelman au Persepolis de Marjane Satrapi, en passant par l’incontournable Fun Home d’Alison Bechdel. Si le choix de ces œuvres oriente naturellement l’exploitation didactique vers un horizon esthétique et culturel, les trois articles mettent également en évidence les spécificités d’une littérature dessinée et montrent comment exploiter cette dimension graphique.
La proposition de Violeta Mitrovic articule la lecture de trois «mémoires graphiques» (Fun Home, Persepolis et Wonderland de Tirabosco) dans la perspective de leur enseignement au post-obligatoire. En insistant sur la richesse et l’épaisseur des possibilités interprétatives de ces œuvres, elle se sert de leur caractère profondément multimodal pour convoquer la possibilité effective d’une lecture littéraire, au sens élargi de ce terme, dans lequel elle rassemble et interroge les notions de participation et de distanciation, de littératie, de lectures «ordinaire» et «savante», sans oublier de faire valoir la spécificité du médium comme vecteur d’acquisition de compétences nouvelles.
Gaspard Turin, dans une contribution portant sur la didactisation de Maus, propose une approche pragmatique face à une œuvre à la fortune critique si importante qu’elle pourrait en paraître hors de portée pour de jeunes lecteurs. En cherchant à rendre à l’œuvre une forme de simplicité, induite par le traitement zoomorphique de ses personnages, il n’en oublie pas moins que cette simplicité ne sert qu’à dialoguer avec la complexité d’une œuvre grave et dont l’enjeu de lecture devient dès lors celui d’un questionnement à étages multiples. Faire lire Maus à des adolescent·e·s revient-il à les forcer dans un monde adulte? Ou plutôt à envisager un dialogue avec les modalités d’appréhension du monde propres à l’enfance?
Enfin Camille Schaer s’attache, elle aussi, à assigner à la lecture de la bande dessinée en classe des enjeux portant sur la littératie et sur les compétences qui lui sont associées. Elle choisit pour sa part d’insister sur les spécificités du médium par rapport à la littérature ordinairement enseignée à l’école, afin de faire reconnaître une «tension entre linéarité et mise en réseau des informations». Cette mise en réseau l’incite à porter un regard neuf sur le livre en tant qu’objet, comme en témoigne son attention au paratexte. Il s’agit enfin, pour elle, par le biais des œuvres sélectionnées (Persepolis d’une part et Les Coquelicots d’Irak, de Findakly et Trondheim, de l’autre) d’ouvrir les élèves aux subtilités de l’autobiographie dessinée.
La dernière partie envisage l’enseignement de la bande dessinée sous un angle plus empirique, informé par des observations en classe, de sorte que les articles éclairent les vertus, mais aussi les obstacles inhérents à une lecture littéraire de la bande dessinée dans différents degrés de la scolarité.
Dans sa contribution, Hélène Raux interroge le «présupposé de facilité» qui accompagne le traitement scolaire de la bande dessinée pour montrer que la lisibilité du médium ne va pas de soi et qu’il doit s’accompagner d’un étayage en classe, fondé sur l’enseignement des codes propres à la lecture des récits graphiques. Des exemples de terrain suggèrent que la compréhension des logiques présidant à l’enchaînement des cases n’a rien d’un acquis pour les élèves observés, et que le déficit de compréhension ou de reformulation se présente plus volontiers dans le cadre de la lecture des images que de celle du texte. L’accent est mis, en conclusion, sur la nécessité de renforcer des approches didactiques orientées sur ces aspects et de réorienter le regard des élèves face à un médium souvent considéré par eux, a priori, comme destiné aux enfants.
L’article de Jean-François Boutin et Virginie Martel s’intéresse quant à lui aux modalités de la lecture de bandes dessinées historiques, en suivant treize parcours de lecture d’élèves du secondaire et du primaire. Les auteurs s’attachent à creuser en particulier la question des rapports entre le passé et sa reconfiguration par les récits graphiques, tout en tenant compte de la multimodalité du support. Pour poser les bases d’une lecture dialectique, permettant de rendre compte de «l’historisation de la fiction et [de] la fictionnalisation de l’histoire» (Gallego 2015: 5), les auteur·e·s préconisent de porter l’attention des lecteurs·trices sur la dimension multimodale et les stéréotypes propres au champ de la bande dessinée.
Si la bande dessinée demande encore à être enseignée, elle demande aussi, plus vivement peut-être, à être didactisée. Mais au-delà de ces questions, elle demande aussi à être interrogée dans ses rapports à l’institution scolaire et aux rapports que cette institution entretient avec ce «monde qui avance», ou qui semble parfois stagner, voire reculer… et dont, malgré ses richesses, la bande dessinée n’est encore qu’une manifestation marginale. Il suffit de courir le risque d’ouvrir ce champ culturel à des élèves pour réaliser à quel point son objet reste «non identifié», ou indexé à des codes culturels, économiques et sociétaux auxquels la bande dessinée «comme littérature» peine encore à se confronter. Tout reste à faire donc, dans ce champ. Les travaux réunis ici cherchent à en proposer une exploration que l’on espère enthousiasmante, mais ils ne pourront en aucun cas se substituer aux pratiques d’enseignement, informées ou improvisées, que nous engageons nos lecteurs·trices à tenter, à poursuivre et à partager.
Bibliographie
Aquatias, Sylvain (2015), «Le goût de la bande dessinée: acquisitions, transmissions, renforcements et abandons», in La bande dessinée: quelle lecture, quelle culture?, B. Berthou (dir.), Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information. En ligne, consulté le 24 septembre 2021, DOI: 10.4000/books.bibpompidou.1675
Baetens, Jan (2009), «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», Cahiers de Narratologie, n°16, en ligne, consulté le 28 août 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.974
Berthou, Benoît (2017), «Une nouvelle légitimité culturelle. Le cas de la bande dessinée», in Le Statut culturel de la bande dessinée, Ahmed Maaheen, Stéphanie Delneste & Jean-Louis Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 221-232.
Blanchard, Marianne & Hélène Raux (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 6 août 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818
Boltanski, Luc (1975), «La constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1 (1), p. 37-59.
Boutin, Jean-François (2012), «De la paralittérature à la littératie multimodale. Une évolution épistémologique et idéologique du champ de la bande dessinée», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle & J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses Universitaires du Québec, p. 33-44.
Chute, Hillary (2008), «Comics as Literature? Reading Graphic Narrative», PMLA, n° 123, p. 452-465.
Chute, Hillary (2020 [2008]), «La bande dessinée est-elle de la littérature? Lire les récits graphiques», Transpositio. En ligne, consulté le 20 août 2021, URL: http://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2005), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier.
Gallego, Julie (dir.) (2015), La bande dessinée historique. Colloque international - Premier cycle: l’Antiquité, Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Ardour.
Groensteen, Thierry (2006), Un objet culturel non identifié, Angoulême, Editions de l’An 2.
Heinich, Nathalie (2017), «L’artification de la bande dessinée», Le Débat, n° 195, p. 5-9.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (2014), «Disciplinarisation et disciplination consubstantiellement liées. Deux exemples prototypiques sous la loupe: les sciences de l’éducation et les didactiques des disciplines», in Disziplin - Discipline, Balz Engler (dir.), Fribourg, Academic Press, p. 27-46.
Lacassin, Francis (1971), Pour un neuvième art, la bande dessinée, Paris, Union générale d’édition.
Meskin, Aaron (2009), «Comics as Literature?», The British Journal of Aesthetics, n° 49, p. 219-239.
Mitrovic, Violeta (2019), «Se rapprocher de la culture juvénile par l’usage du roman graphique autobiographique au lycée», Le français aujourd’hui, n° 207, p. 67-77. En ligne, consulté le 17 février 2020. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2019-4-page-67.htm
Morgan, Harry (2003), Principes des littératures dessinées, Angoulême, Editions de l'an 2.
Norton, Bonnie (2003), «The Motivating Power of Comic Books: Insights from Archie Comic Readers», The Reading Teacher, n° 57 (2), p. 140-147.
Peeters, Frederik (2021), Oleg, Genève, Atrabile.
Rochex, Jean-Yves & Jacques Crinon (dir.) (2014), La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs d’enseignement, Rennes, PUR «Paideia».
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (dir.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Roux, Antoine (1970), La bande dessinée peut être éducative, Paris, Éditions de l’École.
Steyaert, Florie & Jean-Louis Tilleul (2017), «La bande dessinée à l’école. Un caillou dans le soulier de la légitimation», in Le Statut culturel de la bande dessinée, Ahmed Maaheen, Stéphanie Delneste & Jean-Louis Tilleul (dir.), Louvain-la-Neuve, Academia, p. 233-268.
Suvilay, Bounthavy & Edith Taddei (2019), «Les mangas: faire entrer les lectures privées à l’école et les constituer en objets littéraires», Le français aujourd’hui, n° 207, p. 79-91. En ligne, consulté le 17 février 2020.
URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2019-4-page-79.htm
Pour citer l'article
Raphaël Baroni & Gaspard Turin, "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, 2021https://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-4-enseigner-la-bande-dessinee-comme-de-la-litterature
Voir également :
Introduction n°5: La bande dessinée à l’Université : regards croisés sur "Le Long Voyage de Léna" d’André Juillard et Pierre Christin
Le présent dossier de la revue Transpositio, à nouveau consacré à la bande dessinée, fait écho au numéro précédent et le complète à plusieurs égards. Le premier volet visait à aborder l’enseignement de la bande dessinée sous les angles historiques et pratiques, en s’interrogeant, entre autres, sur les conditions nécessaires pour une scolarisation de cet objet souvent qualifié d’hybride ou d’inclassable et, de ce fait, difficile à associer à tel ou tel geste interprétatif balisé par des pratiques disciplinaires.
Introduction n°5: La bande dessinée à l’Université : regards croisés sur "Le Long Voyage de Léna" d’André Juillard et Pierre Christin
Le présent dossier de la revue Transpositio, à nouveau consacré à la bande dessinée, fait écho au numéro précédent et le complète à plusieurs égards. Le premier volet visait à aborder l’enseignement de la bande dessinée sous les angles historiques et pratiques, en s’interrogeant, entre autres, sur les conditions nécessaires pour une scolarisation de cet objet souvent qualifié d’hybride ou d’inclassable et, de ce fait, difficile à associer à tel ou tel geste interprétatif balisé par des pratiques disciplinaires.
Ainsi, l’étude de la place précaire de la bande dessinée dans les pratiques scolaires s’explique en partie par des défis méthodologiques liés l’enseignement du médium, qui découlent autant de ses caractéristiques médiatiques que de son histoire culturelle. Il s’agissait de passer en revue les obstacles historiques à la scolarisation de la bande dessinée, mais également de décrire la fenêtre qui s’ouvre actuellement, dans un régime culturel qualifié par Rouvière d’ère de «post-légitimation». Une autre partie proposait quelques pistes pour éviter de réduire la bande dessinée à ses aspects exclusivement narratifs, littéraires, visuels ou graphiques. Ces pistes proposaient au contraire de mettre en évidence l’interrelation fondamentale entre ces différents aspects de la bande dessinée, tout en ne perdant pas de vue l’existence de caractéristiques spécifiques au médium (support, perspective narrative, sérialité de la représentation iconique, etc.). Une dernière partie examinait enfin les défis posés par l’étude du médium, tels qu’ils apparaissent à la lumière d’une observation des pratiques effectives des enseignants et des élèves.
Face à ces nombreux défis ou obstacles, Hélène Raux (2019 : §62) signale qu’il y a un vrai danger à réduire l’enseignement de la bande dessinée à l’application d’une nomenclature spécialisée (case, planche, bulle, gouttière, etc.) ou à une analyse thématique, qui ne rendrait pas justice à la richesse des récits graphiques pour le développement de compétences littératiées. Les articles que nous avons réunis dans le précédent numéro montraient que considérer la bande dessinée comme un support populaire, attrayant, facile à comprendre et qui rapprocherait les objets étudiés de la culture juvénile ou des lectures privées est à la fois réducteur et trompeur. On oublie trop souvent la complexité inhérente à la bande dessinée et ce qu’il en coûte, pour un enseignant ou une enseignante soucieuse de lui rendre justice, quand il s’agit de savoir par quel bout saisir cet objet «mal identifié» (Blanchard & Raux 2019). Marianne Blanchard et Hélène Raux suggèrent ainsi que le déficit de «légitimité scolaire de la bande dessinée» (Blanchard & Raux 2019 : §2) ne s’explique pas seulement par des raisons historiques ou culturelles, du fait de la réputation populaire ou juvénile du médium, mais aussi par un «manque de maîtrise du support par les enseignants», qu’il faudrait rattacher à une lacune dans leur formation initiale :
peu présente dans les programmes scolaires, la bande dessinée est quasiment absente des cursus universitaires, notamment dans les composantes chargées de la formation des enseignants (ESPE) – même si elle peut être abordée ponctuellement par des enseignants-chercheurs impliqués dans des recherches sur le médium, qui connaissent actuellement un important développement dans une diversité de disciplines. (Blanchard & Raux 2019 : §4)
Le présent dossier tente ainsi de combler cette lacune en faisant état d’une expérience collective débutée il y a une dizaine d’années au sein d’une université suisse. Il s’agit à la fois d’éclairer le caractère nécessairement interdisciplinaire des formations académiques portant sur la bande dessinée, mais également de montrer comment il devient possible d'approcher un objet en multipliant les angles et les cadrages interprétatifs. Loin d’offrir un éventail raisonné de l’ensemble des perspectives de recherche applicables à la bande dessinée, il s’agit plutôt de montrer quels types de savoirs peuvent être intégrés dans la formation initiale des enseignant et d’expliciter quelques gestes d’analyse qui constituent autant de regards croisés sur une œuvre classique du répertoire.
Le choix de l’objet qui sert de support à ces regards croisés s’est imposé aux auteurs dans le contexte d’une Master-class organisée entre plusieurs universités. La série choisie se veut représentative d’une bande dessinée scolarisable, c’est-à-dire que l’on peut qualifier à la fois de formellement «classique» tout en la rattachant à des auteurs reconnus au sein de la production franco-belge, tant du fait de la collection dans laquelle elle s’insère qu’en raison de la réputation du scénariste et du dessinateur qui appartiennent au panthéon des auteurs canonisés. Le troisième opus n’ayant pas encore été publié au moment de la création de la Master-class, il n’en sera fait mention que de manière marginale dans les articles réunis dans ce dossier. En revanche, pour les deux premiers volumes de la série, Le Long Voyage de Léna (qui était d’abord pensée pour être un one-shot) et Léna et les trois femmes, il a été possible de recueillir des entretiens avec l’éditeur1 et les auteurs, et ces derniers ont donné un accès inédit à de riches documents génétiques, qui ont permis d’ouvrir le capot de l’œuvre et d’offrir un rare aperçu de son processus de production. Le public auquel s’est adressé le séminaire de master, qui est à l’origine des contributions réunies dans ce dossier, était composé d’étudiant·e·s inscrits dans plusieurs disciplines du Master ès lettres, en particulier en histoire et esthétique du cinéma, en français moderne et en histoire de l’art. Les textes que nous avons réunis sont le produit d’un groupe de recherche lié à diverses sections de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne et il nous a semblé intéressant de retracer rapidement comment cette collaboration a pu se nouer. Il s’agit d’éclairer sous quelles conditions l’enseignement académique peut être stimulé, de sorte que les futurs enseignants puissent acquérir une meilleur «maîtrise du support», ainsi que le suggèrent de Raux et Blanchard.
Les prémices du Groupe d’étude sur la bande dessinée (GrEBD) bénéficièrent d’une conjonction de planètes favorable. Les auteurs et l’autrice ici rassemblés avaient déjà manifesté leur intérêt pour la bande dessinée en participant aux mêmes publications et aux mêmes colloques consacrés au «neuvième art». Certains avaient, dans le cadre de recherches soutenues par le FNS, glissé la bande dessinée parmi les médiums étudiés ; ce fut le cas par exemple du projet «Les Usages de Jésus au XXe siècle» (2006-2009), qui a permis de renforcer la collaboration avec le Centre BD de la Bibliothèque municipale de Lausanne (créé dix ans plus tôt), notamment à l’occasion d’un débat public organisé en marge d’un colloque international à l’Hôtel de Ville de Lausanne en mai 2009. En février 2011, grâce à l’acquisition par le Centre BD du fonds du collectionneur genevois Pierre-Yves Ghebali, un nouveau projet consacré à la sérialité dans les périodiques de bande dessinée de l’après-guerre («Le découpage de l'action») est conçu (Université de Fribourg et Université de Lausanne), puis financé par le FNS (2012-2015). C’est à cette même époque qu’Olivier Christin, professeur à l’Université de Neuchâtel, invite les universités romandes à se joindre à un cycle de rencontres intitulé «La bande dessinée à l'université». Soutenu par les éditions Dargaud, le cycle débute à Lyon, le 5 décembre 2011, avec Enki Bilal et Pierre Christin. Les universités de Neuchâtel et de Grenoble 3 prévoient d’inviter Jean-Claude Mézières, l’Université de Lausanne opte pour le duo André Julliard et Pierre Christin.
Très vite, les Lausannois s’entendent sur le constat qu’une rencontre animée par un·e professeur·e ne suffit pas à répondre à la question ouverte par «La bande dessinée à l’université ?!». En particulier, la participation des étudiant·e·s leur paraît indispensable. Le contact est alors pris avec André Julliard et Pierre Christin autour d’un l’album qu’ils ont publié ensemble en 2006 : Le Long Voyage de Léna. Grâce à Clotide Palluat, des éditions Dargaud, les deux auteurs acceptent de mettre à disposition les documents préparatoires de l’album. Alain Boillat, Raphaël Baroni, Danielle Chaperon et Philippe Kaenel décident alors d’organiser ensemble, pour le semestre de printemps 2012, un séminaire de niveau Master ayant pour objectif le montage d’une exposition pour le compte du Centre BD de la Ville de Lausanne. Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque municipale, valide le projet, et Cuno Affolter, conservateur au Centre BD, se propose pour intervenir dans le séminaire et superviser la réalisation de l’exposition dans l’espace de la Bibliothèque.
Pendant le semestre, chaque étudiant·e présentera un exposé sur un aspect de l’album et sera chargé de concevoir, à partir de ses résultats, un «poster». Dix panneaux d’exposition seront ainsi composés (Margot Daeppen, Justine Duay, Bige Öcal, Marina Popea, Valérie Rohrbach, Fabien Schneider, Sarah Studer, Maëlle Tappy) et mis en page par l’un d’eux (Rodolfo Garcia). Les étudiant·e·s procéderont également à l’accrochage et à l’installation des vitrines présentant des documents originaux, sous l’œil bienveillant de Cuno Affolter. L’exposition Autour de Léna est inaugurée le 16 avril 2012. Pierre Christin, malheureusement souffrant, sera interviewé ultérieurement à Paris par Alain Boillat et Philippe Kaenel. Le 27 avril, la conférence publique avec André Julliard et Philippe Ostermann, directeur général des éditions Dargaud de l’époque, est précédée d’une rencontre sur le site de l’Université avec les enseignant·e·s et les étudiant·e·s, qui avaient développé une lecture experte de l’album, et préparé des questions pointues, voire épineuses, portant sur les aspects commerciaux ou sur les stéréotypes de genre : questions auxquelles les deux invités répondirent sans tabou et avec force détails.

Montage de l’exposition Autour de Léna à la Bibliothèque municipale de la ville de Lausanne, en présence de Cuno Affolter.
C’est à la suite de ce semestre de printemps 2012 qu’est né à l’Université de Lausanne le Groupe d’étude sur la bande dessinée (GrEBD), dont le site internet offre de nombreuses ressources aux enseignants, notamment une bibliographie et un lexique en ligne. Il s’est formé à partir de trois constats : celui de la présence dans le corps professoral de la Faculté des lettres de l’UNIL d’un nombre relativement élevé de personnes passionnées par la BD ; celui de la place décidément introuvable dévolue à l’étude de ce média dans les structures universitaires francophones ; celui, enfin, de l’existence à la Bibliothèque municipale de Lausanne, grâce à Cuno Affolter, de l’un des plus riches fonds de bandes dessinées en Europe. Alors que le cinéma possède aujourd’hui des départements d’enseignement et de recherche qui lui sont entièrement consacrés, la bande dessinée, même dans un pays comme la Belgique, traditionnellement considérée comme la patrie de cet art, n’est étudiée que par des chercheur·se·s émargeant à d’autres foyers disciplinaires. Un spécialiste de narratologie (Raphaël Baroni), un théoricien du cinéma (Alain Boillat), une moderniste férue de dramaturgie (Danielle Chaperon), un médiéviste (Alain Corbellari), un historien de l’art (Philippe Kaenel) et un germaniste (Alexander Schwarz) ont décidé de créer une structure grâce à laquelle la recherche sur le «neuvième art» pourrait être développée en tenant précisément compte de la variété et de la complémentarité des approches. Ajoutons à ce comité de base, une équipe très active de doctorant·e·s (Justine Favre, Gaëlle Kovaliv, Raphaël Oesterlé, Camille Schaer et Olivier Stucky), dont les thèses couvrent différents domaines de recherche, allant de la didactique des langues et de la littérature à l’histoire des supports, des magazines pour la jeunesse d’après-guerre et à la transition numérique.
Le projet de rédaction du présent dossier s’inscrit dans la continuité du cours, de l’exposition et de l’invitation d’André Juillard en 2012, mais il n’a pu se concrétiser, dans l’esprit pédagogique qui était à l’origine de notre démarche, qu’avec l’opportunité offerte par la revue Transpositio, et grâce à l’autorisation des auteurs et de l’éditeur portant sur l’usage du matériel iconographique et documentaire à la base de cet enseignement et de cette recherche.
Comment travailler sur la bande dessinée? Sur quelles prémices? À partir de quelles sources documentaires? Et surtout, à quelles fins? Les études de type monographique sont en règle générale tournées vers des «classiques» du genre, de Rodolphe Töpffer à nos jours, en passant par les aventures de Little Nemo ou de Tintin, dont l’historiographie est sans équivalent. Il est par conséquent rare de rencontrer des travaux centrés sur un ou deux albums spécifiques appartenant à ce que l’on pourrait qualifier, sans jugement de valeur aucun, la bande dessinée mainstream. Tel est la singularité de ce recueil d’études consacrées à un album inaugurant un triptyque déployé entre 2009 et 2020. Les extensions ultérieures, qui n’avaient pas été prévues à l’origine par les deux auteurs, se sont développées autour d’une figure forte, d’une héroïne en l’occurrence. En effet, les personnages principaux sont les moteurs de nombre de collections : ils permettent de leur donner une cohérence et de les labéliser dans la masse des albums publiés chaque année.
Il faut dire que Léna avait tout pour plaire à ses deux créateurs, qui comptent parmi les plus importants de la bande dessinée francophone aujourd’hui. André Juillard trouvait en cette aventurière séduisante l’occasion non seulement de mettre en scène (en abyme même) la pratique du dessin, tout en croquant des nus féminins qui constituent l’une des marques distinctives de son œuvre. Pierre Christin, quant à lui, pouvait construire autour de ce personnage énigmatique une intrigue hitchcockienne, toute en tensions et parsemée d’indices.
Les responsables de la présente recherche ont eu par ailleurs l’immense chance de disposer d’archives inédites : le témoignage oral des auteurs, un dialogue avec l’éditeur et les archives personnelles, généreusement transmises par le dessinateur et le scénariste : script, scénario, crayonné, photographies. Cette documentation a permis de nouer les fils de la genèse d’une bande dessinée reposant sur la complicité de deux artistes. De plus en plus, les scientifiques qui se spécialisent dans le domaine de la bande dessinée s’intéressent aux conditions matérielles, contractuelles et médiatiques de production des œuvres et exploitent les archives d’édition, tandis que les auteurs et autrices prennent de plus en plus soin de leurs propres archives, veillant à leur patrimonialisation. Les études réunies dans ce recueil participent de cette démarche générale qui vise à articuler les choix esthétiques et les pratiques narratives avec tout ce qui entoure l’œuvre, qu’on l’appelle contexte, conditions de production ou encore, avec Gérard Genette, péritexte et paratexte. Cette articulation entre ces «mondes» ou ces «espaces» n’est évidemment pas nouvelle. Elle se fonde sur les études dans le domaine des littératures et des arts de très longue date et obéissent en définitive à une finalité : donner à comprendre le processus de création d’œuvres le plus souvent collectives résultant de médiations diverses et proposant des fictions qui sont autant de regards portés sur le monde.
Sur le plan didactique, ce dossier, qui complète le numéro précédent intitulé «Lire la bande dessinée comme (de la) littérature ?», met en évidence la manière dont la diversité des regards, inhérente à une approche académique résolument interdisciplinaire, permet d’enrichir notre compréhension de la bande dessinée. Sur le plan historique et artistique, on retiendra l’intérêt de prendre en compte le contexte éditorial et la manière dont l’œuvre s’inscrit dans la trajectoire des auteurs. Le regard du médiéviste, sensible à l’entrelacement du texte et de l’image, nous rend attentif aux choix esthétiques qui président à la représentation des personnages et à leur impact sur la lecture. Le spécialiste du cinéma éclaire pour sa part les paramètres relatifs au point de vue et à la focalisation dans un récit en régime de monstration, qui partage de ce fait certains de ses mécanismes avec les dispositifs cinématographiques. L’horizon des études théâtrales, en s’appuyant sur une conception dynamique des schémas narratifs, nous aide en outre à démêler les intrigues complexes qui s’entrelacent dans les scénarios de Pierre Christin et dans les compositions d’André Juillard. Enfin, une analyse fondée sur les principes de la narratologie transmédiale, soucieuse de mettre en évidence les spécificités médiatiques des récits graphiques, conduit à reconsidérer les typologies des mises en page de manière à saisir les nuances d’une organisation tabulaire du récit.
Ainsi que l’illustre ce numéro, le GrEBD se conçoit comme un lieu de convergence interdisciplinaire mu par la conviction que la manière la plus efficace de contribuer à la formation initiale des futur·e·s enseignant·e·s consiste à tenter de ne laisser dans l’ombre aucune des principales caractéristiques d’une forme d’expression mixte inventée et théorisée par un écrivain, dramaturge et artiste, Rodolphe Töpffer. Ce genre, cette pratique a permis, en quelque sorte, de renouer avec un goût très médiéval pour le mélange du texte et de l’image, renouvelé plus tard par les récits cinématographiques. Si la bande dessinée étudiée en contexte scolaire constitue sans nul doute un instrument idéal pour le développement d’une littératie intermédiale, sa vraie richesse s’affirme dans la mesure où on ne l’assimile pas trop hâtivement à l’une ou l’autre de ces perspectives. Ni littérature graphique, ni storyboard proto-filmique, ni théâtre en estampes, ni récit enluminé, ni architecture narrative, la bande dessinée est un peu tout cela en même temps. C’est à cette diversité d’expériences médiatiques que reconduit presque inéluctablement l’étude approfondie des récits en bande dessinée, et au sein de ceux-ci, Le Long Voyage de Léna.
Références
Blanchard, Marianne & Hélène Raux (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 6 août 2021, DOI : https://doi.org/10.4000/trema.4818
Raux, Hélène (2019), «Ce que les blogs d’enseignants disent de la lecture de bandes dessinées à l’école», Tréma, n° 51. En ligne, consulté le 6 août 2021, DOI : https://doi.org/10.4000/trema.4826
Pour citer l'article
Raphaël Baroni, Alain Boillat, Danielle Chaperon, Alain Corbellari et Philippe Kaenel, "Introduction n°5: La bande dessinée à l’Université : regards croisés sur "Le Long Voyage de Léna" d’André Juillard et Pierre Christin", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022https://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-5-la-bande-dessinee-a-l-universite-regards-croises-sur-le-long-voyage-de-lena-d-andre-juillard-et-pierre-christin
Voir également :
Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page
Sur la base de l’analyse de l’organisation des planches que l’on rencontre au fil de l’album Le Long Voyage de Léna de Pierre Christin et André Juillard, cet article visera à montrer comment il est possible de décrire et d’interpréter l’architecture des planches d’un récit graphique{{Cette réflexion a été développée dans le cadre du projet Sinergia «Reconfiguring Comics in our Digital Era», financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS: CRSII5_180359).
Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page
La dimension tabulaire de la bande dessinée: de la théorie à l’enseignement… et retour
Sur la base de l’analyse de l’organisation des planches que l’on rencontre au fil de l’album Le Long Voyage de Léna de Pierre Christin et André Juillard, cet article visera à montrer comment il est possible de décrire et d’interpréter l’architecture des planches d’un récit graphique1. Je commencerai par souligner l’importance, pour la didactique de la bande dessinée, de disposer d’un outillage conceptuel permettant d’identifier différents prototypes de mise en page, tout en soulignant les lacunes observables en ce domaine. Je mettrai aussi en lumière un certain nombre de problèmes liés à l’ergonomie des principaux modèles théoriques, ce qui justifie selon moi leur reconfiguration dans l’optique d’une transposition didactique des typologies existantes. Cela m’amènera à proposer un modèle original, que je mettrai à l’épreuve par ma lecture de l’album de Christin et Juillard.
Philippe Sohet, dans son effort de didactisation d’une bande dessinée d’Edmond Baudoin, commente de la manière suivante une planche caractérisée par des effets de symétrie:
Ces ajustements graphiques nous rappellent qu’une planche ne se réduit pas à une succession de cases, elle est surtout un espace où cohabitent des vignettes. Si la «lecture» d’une bande dessinée est séquentielle, case par case, il ne faut pas perdre de vue que son appréhension visuelle est d’abord globalisante, l’œil percevant la planche dans son ensemble. Cette réalité correspond à la dimension «tabulaire» de la planche. Il est donc possible de penser cette cohabitation, de l’organiser en fonction de certaines fins. (Sohet 2010: 66)
Pour les enseignants soucieux de mettre en avant les spécificités du langage de la bande dessinée, il est en effet difficile de faire l’impasse sur l’un des aspects les plus saillants de ce médium, à savoir le fait que la séquence de cases est projetée à la surface de son support, ce qui entraine l’émergence d’effets liés à la coprésence des images. Pourtant, en dépit de la reconnaissance de cette «dimension tabulaire», où se joue en partie le sens du récit, de nombreux manuels se caractérisent par une carence d’outils permettant de traiter cet aspect. L’ouvrage de Sohet, par exemple, possède des sections intitulées «La planche comme composition» (2010: 63-67), «La panopticité» (2010: 68-73) et «La stratégie du site» (2010: 73-80), mais, fidèle à une approche dont l’objectif est surtout de dégager la spécificité de l’œuvre de Baudoin, il ne propose aucun principe général de «composition» ou d’organisation de cette «panopticité», ce qui réduit considérablement la transférabilité de cette lecture vers d’autres contextes. Plus récemment, dans les manuels publiés par Marie-Hélène Marcoux, pourtant très systématiques dans leur approche du langage de la bande dessinée, la description de la dimension tabulaire est totalement absente du manuel destiné aux niveaux primaires (2018), alors que pour le niveau secondaire, les mises en page régulières sont érigées en matrices pour toutes les autres formes de composition, ce qui l’amène à leur attribuer une valeur esthétique que l’on peut juger excessive:
Le gaufrier sert de modèle pour disposer les cases de façon harmonieuse et visuellement attrayante. Il est normal que certaines scènes importantes ne puissent pas correspondre au format plus contraignant de six ou neuf cases. Le bédéiste a parfois besoin de plus de cases […] pour illustrer une scène d’action rapide. Il choisira donc de varier, selon ses besoins, le gaufrier classique. (Marcoux 2016: 30)
À côté du «gaufrier», il existe pourtant bien d’autres types d’organisation de l’espace paginal, que l’on peut qualifier, selon les auteurs, de mises en page «semi-régulière», «irrégulière», «rhétorique», «décorative» ou «productrice» (Chavanne 2010 ; Groensteen 1999 ; Peeters 2003). Renaud Chavanne rappelle en outre que «contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, les compositions régulières ne sont pas nécessairement les plus anciennes attestées de la bande dessinée» (2010: 57). La question se pose donc de savoir si, pour construire un savoir scolaire sur la «panopticité» ou la «planche comme composition», il suffit de renvoyer à ces typologies savantes et aux terminologies qui en découlent. Et si c’est le cas, quel modèle choisir?
Jusqu’à récemment, je m’appuyais dans mes cours2 sur les modèles élaborés par Benoît Peeters (1991) et Thierry Groensteen (1999), qui sont les plus fréquemment cités dans la recherche francophone3. Si les types dégagés par ces deux auteurs sont relativement faciles à expliquer et à illustrer avec des exemples choisis4, en revanche, le passage à un usage empirique se révèle beaucoup moins aisé. Mon expérience m’a notamment permis de constater l’existence de difficultés persistantes, pour un grand nombre d’étudiants, quand il s’agissait de classer certaines mises en page d’apparence plutôt banale, mais qui se situaient en dehors des catégories, ou plutôt qui cumulaient des traits contradictoires invitant à les classer dans plusieurs catégories simultanément. Ces modèles ont pour eux la simplicité des critères qui sont au fondement des catégorisations, mais l’analyse d’œuvres singulières ne cesse de mettre en évidence l’existence de cas indécidables. Au début, je suggérais de sélectionner la typologie correspondant le mieux à l’objet étudié, voire de nommer différentes classifications possibles, en mettant en évidence les traits qui les rapprochent de tel ou tel type, ce qui n’était au fond guère satisfaisant. Au lieu d’offrir un levier pour l’interprétation, les typologies finissaient par devenir des obstacles bloquant l’analyse dans sa phase descriptive, au lieu de l’orienter vers une réflexion sur la fonction du dispositif.
En contexte scolaire, quand on présente une planche et que l’on porte la discussion sur sa dimension tabulaire, il est pourtant difficile d’échapper à la question de savoir comment décrire telle ou telle mise en page et à l’interrogation qui découle de cette difficulté: pourquoi tel ou tel dispositif ne se laisse pas facilement classer? Si cela concerne une œuvre expérimentale, on pourra en conclure que la valeur de l’objet se fonde, en partie du moins, sur son écart créatif vis-à-vis des principes de compositions habituels. Mais si l’on rencontre le même problème à la lecture d’un album d’André Juillard et de Pierre Christin, qui s’inscrit dans la droite ligne de la tradition franco-belge, alors il faudra en conclure que l’outil mobilisé pour l’analyse souffre d’un défaut d’ergonomie.
La théorisation de la mise en page en bande dessinée est marquée par un déficit chronique de mises à l’épreuve empiriques et la réflexion portant sur la transposition didactique des modèles pourrait être l’occasion de remédier à ce problème. Dans le domaine de la didactique de la bande dessinée, Nicolas Rouvière, à la suite de Jean-Paul Meyer (2019: 164, n. 19), dénonce également les «limites des typologies actuelles» (2019: 372), tout en insistant sur le rôle que pourrait jouer la didactique dans la théorisation de la bande dessinée:
Il est enfin un dernier argument, sans doute le plus décisif, pour reconsidérer sans mépris aucun l’apport que peut représenter la sphère éducative pour une meilleure connaissance de la bande dessinée. En effet, les difficultés à caractère didactique que rencontrent les enseignants quand il s’agit de faire étudier la BD en classe correspondent très souvent à des nœuds épistémologiques qui se trouvent au cœur de la spécificité du médium. Ainsi en va-t-il de la notion d’hypercadre, qui a constitué l’une des difficultés les plus importantes pour la théorisation sémiotique de la bande dessinée. (Rouvière 2016: 372)
L’objectif de cet article sera précisément de tenter d’améliorer l’ergonomie des typologies existantes en élaborant un modèle en partie original, qui soit à la fois plus facile à enseigner, plus souple et plus efficace pour décrire l’organisation tabulaire des planches. On pourrait contester l’intérêt d’un tel outil en arguant que l’interprétation des effets découlant de l’organisation spatiale des récits graphiques pourrait se passer d’une description standardisée, ainsi que l’illustre l’approche du récit graphique de Boudoin par Sohet. D’ailleurs, les didacticiens dénoncent souvent les dérives d’un enseignement qui se contenterait de transmettre une terminologie ou un bagage technique au lieu de s’attacher à dégager le sens de l’œuvre:
Enseigner la bande dessinée est un défi que l’enseignement scolaire doit relever, en particulier pour établir des liens entre la littératie traditionnelle et les nouvelles formes de culture médiatique. Mais il ne s’agit pas seulement de former des lecteurs experts et critiques, aussi bien à l’aise dans le monde des lettres que celui des représentations figuratives, pour démêler des productions discursives combinant des codes variés. Il s’agit aussi de former des lecteur sensibles, impliqués, entrant en résonnance symbolique avec les œuvres, pour s’accomplir à part entière comme sujets-interprètes. (Missiou 2019: 98)
J’essaierai de montrer, en m’appuyant sur la lecture du Long Voyage de Léna, que le fait de discuter de la mise en page des planches en se fondant sur une grille d’analyse permet de sensibiliser les apprenants à une dimension souvent négligée lors de la lecture, tout en élargissant le champ de leur expérience esthétique. Ainsi que l’affirme Elizabeth Rosen, l’étude de leur dimension tabulaire souligne que les bandes dessinées «remettent en question la plupart des façons dont nous avons appris à lire: de gauche à droite, de haut en bas, de façon linéaire et progressive» (2009: 58). Jesse Cohn insiste quant à lui sur le fait que de nombreux lecteurs, habitués à cette lecture linéaire, négligent les effets qui se construisent à l’échelle de la page, ce qui réduit considérablement leur horizon esthétique et les amène à lire les bandes dessinées comme des romans ordinaires5:
Parfois, en lisant un roman graphique, nous pouvons perdre de vue le fait que nous regardons une page. En effet, pour la plupart de nos élèves, habitués à considérer la bande dessinée comme une lecture facile, leur regard passe assez rapidement sur les pages, qui sont généralement conçues pour ne pas interrompre cette fluidité ; ils voient des personnages agissant dans le temps, et non un dessin étendu dans l'espace. (Cohn 2009: 44)
Cohn confesse avoir rencontré des résistances quand il s’agissait d’attirer l’attention de ses étudiants sur l’aspect proprement graphique des récits en bande dessinée. Il ajoute que si cette dimension devient évidente lorsqu’il confronte sa classe à des œuvres expérimentales, à l’instar des romans graphiques de Chris Ware, la grande majorité des bandes dessinées exigent de disposer d’un cadre interprétatif permettant d’identifier les procédures standardisées à travers lesquelles les récits «occupent l’espace» (2009: 44). Il s’agit par conséquent de découvrir des principes généraux de composition, que Cohn compare avec l’art du montage hollywoodien enseigné dans les cursus d’études cinématographiques6. Il ne s’agit pas de confondre le découpage filmique avec l'organisation tabulaire du récit, qui sont des opérations totalement différentes, mais d’insister sur l’importance d’objectiver les logiques sous-jacentes au montage cinématographique et à la mise en page de la bande dessinée pour que ces configurations narratives soient perçues au-delà des automatismes culturels qui les invisibilisent.
Par ailleurs, outiller les apprenants avec une typologie de techniques narratives permet de discuter de phénomènes qui transcendent le cas particulier, posant par exemple la question des parentés et des filiations entre les œuvres, tout en permettant de mettre au jour des procédures standardisées qui donnent forme aux productions sérielles de la culture médiatique7. Mobiliser de tels cadres interprétatifs permettrait par conséquent sans nul doute de renforcer la littératie médiatique des apprenants (cf. Lebrun, Lacelle & Boutin 2012).
Tabularité des récits graphiques et typologies des mises en page
Dans un article pionnier, Pierre Fresnault-Deruelle (1976) définit la bande dessinée comme un produit culturel écartelé entre la linéarité du strip et la tabularité de la planche. Cette double dimension a amené Thierry Groensteen à souligner l’existence de deux modes d’appréhension des rapports entre les images dessinées. Dans une terminologie qu’il emprunte à Jean Ricardou (1978), il évoque une arthrologie restreinte et une arthrologie généralisée. L’arthrologie, en médecine, consiste en l’étude des articulations entre différents membres du corps humain. En bande dessinée, cette double logique articulatoire souligne que les cases – qui constituent l’unité fondamentale de la bande dessinée – ne font pas que se succéder linéairement, comme une suite de mots, mais forment également un réseau entre des éléments occupant différents lieux disséminés dans l’espace graphique. L’étude des relations qui se tissent au sein de cet espace consiste, toujours selon la terminologie de Groensteen, à mettre en lumière un «tressage iconique», c’est-à-dire un réseau qui se déploie dans une dimension tabulaire et plus seulement linéaire. A priori, ce tressage peut se déployer à n’importe quelle échelle de l’œuvre imprimée, Groensteen insistant sur le fait que les images facilitent une saisie rapide du sens, ce qui invite, davantage que dans d’autres genres d’imprimés, à naviguer librement à la surface des pages et au feuilletage des albums:
La bande dessinée est fondamentalement une littérature qui ne dissimule rien, qui s’offre à une possession entière et sans reste: on la découvre rien qu’à la feuilleter, on navigue à sa surface sans oblitérer ce qui précède et en ayant déjà un œil sur ce qui arrive. (Groensteen 2011: 82)
Au sein de ce système, qualifié de «spatio-topique», se pose en particulier la question de l’étalement des images à la surface des planches et des effets qui découlent de leur configuration paginale. Comme l’explique Groensteen:
Parmi les diverses opérations qui assurent l’intégration des composantes d’une bande dessinée, celle qui a le plus particulièrement pour fonction de régir les paramètres spatio-topiques est communément désignée sous le terme de «mise en page». (1999: 107)
Benoît Peeters est probablement l’un des premiers auteurs à avoir proposé une typologie des mises en page8. Selon son approche, deux critères sont retenus pour classer la composition des planches: d’une part, l’interdépendance ou l’autonomie entre le tableau et le récit ; d’autre part, le rapport de domination, respectivement de la fonction narrative ou de la tabularité. En croisant ces critères, Peeters (2003: 49) obtient un tableau à double entrée définissant quatre types de composition, qui renvoient respectivement à une utilisation rhétorique, conventionnelle, productrice ou décorative de la mise en page.
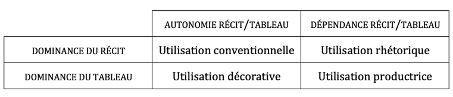
Tableau 1: Typologie des mises en page selon Benoît Peeters.
Les mises en page rhétorique et conventionnelle sont donc dominées par la fonction narrative, mais elles s’opposent sur le plan de la variabilité des cases. Dans la mise en page rhétorique, le format s’adapte au contenu tandis que dans le dispositif conventionnel, il n’y a pas d’interdépendance, le format adoptant une grille régulière, aussi appelée «gaufrier» (Peeters 2003: 51). Au sujet de la mise en page conventionnelle, Peeters affirme par ailleurs qu’il s’agit d’un «système fortement codifié, où la disposition des cases dans la planche, à force de se répéter, tend à devenir transparente» (2003: 52). Les mises en page décorative et productrice se caractérisent quant à elles par une dominance du tableau, mais la première est exploitée à des fins purement esthétiques, tandis que la seconde engendre des effets qui modifient l’appréhension du récit.
Si les mises en page dites rhétoriques ou conventionnelles sont relativement faciles à identifier, il est plus difficile de différencier concrètement les utilisations décoratives ou productrices. L’appréciation de la fonction du dispositif et la détermination du point de bascule à partir duquel on peut considérer que la dimension tabulaire devient dominante reposent en effet sur des critères subjectifs. Jan Baetens et Pascal Lefèvre ont d’ailleurs montré que ces qualificatifs pouvaient très bien s’utiliser en relation avec le «gaufrier», que Peeters range pourtant dans la catégorie des usages conventionnels. Par exemple, de nombreuses pages de Watchmen exploitent des effets de symétrie ou des compositions en damier jouant sur le contraste des couleurs, ce qui renforce l’une ou l’autre de ces fonctions:
Ce qui fait la force de l’album, sous l’angle du cadrage, c’est l’utilisation du principe conventionnel selon des logiques en fait contradictoires. Ainsi la plus neutre de toutes les mises en page – la fragmentation de la planche en neuf vignette analogues – connaît aussi un emploi producteur. La symétrie du modèle de base pousse à doter un chapitre entier d’une structure symétrique globale et de faire miroiter les successives pages de la première partie de cette section dans les planches équivalentes de la seconde moitié. Par ailleurs de nombreuses planches de Watchmen revêtent sûrement, en premier lieu par la distribution réglée, souvent en damier, des contrastes chromatiques, un aspect décoratif et ne peuvent pas ne pas être déchiffrées comme un espace plastique. (Baetens & Lefèvre 1993: 60)
Groensteen propose quant à lui une typologie un peu différente, ce qui l’autorise à envisager l’existence de gaufriers productifs ou décoratifs. Reprenant l’exemple de Watchmen discuté par Baetens et Lefèvre, il est conduit à critiquer le qualificatif de conventionnel pour définir le gaufrier, car cette mise en page exacerberait les correspondances non linéaires qui peuvent être tressées entre des cases isomorphes:
La mise en page régulière est donc aussi celle qui exalte certains effets de tressage parce qu’elle leur permet de produire les agencements les plus simples et prégnants du point de vue perceptif, et parce qu’elle renforce les correspondances entre lieux prédéterminés. (Groensteen 1999: 114)
Le principe retenu par Groensteen pour analyser une mise en page repose sur les réponses données à deux questions, apparemment très simples:
a / Est-elle régulière ou irrégulière?
b / Est-elle discrète ou ostentatoire? (Groensteen 1999: 114)
En croisant ces deux critères, Groensteen reconstruit une typologie à quatre termes:
- régulière et discrète ;
- régulière et ostentatoire ;
- irrégulière et discrète (ce qui correspond à la mise en page «rhétorique» classique) ;
- irrégulière et ostentatoire. (Groensteen 1999: 115)
Le problème découlant de ce modèle, c’est qu’il ne précise pas quel degré de régularité correspond au juste l’expression «mise en page régulière» et il n’indique pas davantage selon quel critère il est possible de décider que telle ou telle composition devient ostentatoire. En effet, Groensteen mentionne la possibilité de rencontrer, au sein d’une mise en page régulière, des rupture saillantes, sans que cette modification du gaufrier ne fasse basculer ce dernier du côté des organisations irrégulières:
[La mise en page régulière] possède enfin cette ultime vertu, de ménager la possibilité de ruptures soudaines et spectaculaires avec la norme posée d’abord. Dans un album dont les pages sont régulières, une page qui se distingue soudain par une configuration spéciale obtiendra un impact très fort […]. Au lieu que, quand toutes les vignettes sont discriminées par des formats différents – comme le propose l’option rhétorique –, il est plus difficile d’en faire vraiment ressortir aucune. (Groensteen 1999: 114-115)
On voit ainsi que l’opposition la plus élémentaire, à savoir celle entre régularité et irrégularité, pose la question du seuil à partir duquel on passe d’un prototype à l’autre, puisque Groensteen – comme Peeters9, d’ailleurs – suggère que des variations locales du gaufrier ne remettent pas en cause le type de base auquel se rattache la composition. Quant à la fonction de ces ruptures, Groensteen considère qu’elles peuvent renforcer le caractère ostentatoire de la mise en page, faisant basculer une mise en page conventionnelle dans un registre décoratif ou productif, ou qu’elles peuvent tout aussi bien répondre à la simple nécessité d’adapter le format de la case à son contenu narratif, ce qui la rapprocherait d’un usage rhétorique.
Cette possibilité de considérer que certaines planches irrégulières ne représenteraient que des variations du gaufrier pose non seulement la question du seuil à partir duquel une irrégularité peut être jugée pour elle-même, mais également de l’échelle à partir de laquelle caractériser une mise en page. Faut-il considérer l’ensemble de l’œuvre, que l’on classerait dans l’une ou l’autre de ces catégories de base – régulière ou irrégulière pour Groensteen, conventionnelle ou rhétorique pour Peeters – et définir ensuite, sur cette base, des passages qui offriraient des variations de cette matrice, ou vaut-il mieux s’attacher à décrire chaque planche dans sa relative autonomie vis-à-vis de l’œuvre globale? La question est d’autant plus actuelle que de nombreux romans graphiques contemporains jouent sur une forte hétérogénéité de registres, accentuée par l’esthétique discontinue du chapitrage et des compositions paginales10. On comprend mieux sur cette base la perplexité des étudiants confrontés à des mises en page irrégulières, que l’on devrait définir comme des variantes, ostentatoires ou discrètes, d’une mise en page régulière, dont la fonction pourrait être aussi bien productrice que décorative ou rhétorique.
Avant de proposer une alternative, je mentionnerai un dernier cadre théorique, un peu moins connu, mais qui a le mérite d’être fondé sur une base empirique, à savoir l’étude systématique des mises en page d’Edgar P. Jacobs par Renaud Chavanne (2005). Dans une tentative de généralisation ultérieure de son modèle, Chavanne réarrange les typologies de Peeters et Groensteen en proposant un modèle simplifié à trois pôles:
Poursuivant, développant et approfondissant l’analyse de nos prédécesseurs, nous identifions trois grands principes de composition susceptibles de s’appliquer aux œuvres organisées par bandes: le principe de régularité, le principe de semi-régularité et le principe rhétorique. (2010: 27)
Chavanne reprend donc de Peeters le «principe rhétorique» et emprunte à Groensteeen le «principe de régularité», mais il introduit un pôle intermédiaire, qu’il appelle «principe de semi-régularité11», qui règle en quelque sorte la question du seuil entre les deux dispositifs. Outre l’introduction de cette catégorie, l’une des innovations majeures apportée par Chavanne consiste à souligner, davantage que ne le font Peeters et Groensteen, le fait que ces trois prototypes ne sont que des pôles et que leur concrétisation au sein d’une œuvre procède d’une logique combinatoire, débouchant sur un «mélange de ces principes»:
[O]n pourrait venir à penser de ce qui précède qu’il existe une séparation étanche entre ce qui procède de la rhétorique et ce qui appartient à la régularité, et, dans un moindre degré, entre la semi-régularité et la rhétorique. Il n’en va pas ainsi. Bien sûr les définitions de ces principes de composition sont suffisamment fortes pour qu’elles permettent de distinguer des constructions effectivement différentes, et que cette distinction se conforme à l’observation […]. Mais rien ne justifie l’impossibilité d’une combinatoire, d’un mélange des principes. (Chavanne 2010: 153).
Au lieu de penser les rapports sous forme de choix binaire ou de tableau à double entrée, il faudrait ainsi se représenter les types de mises en page possible comme des pôles se répartissant sur un spectre allant de la mise en page rhétorique à la mise en page régulière en passant par différents stades intermédiaires. On peut aussi retenir du modèle de Chavanne la notion de matrice, qui désigne une configuration de base présidant à la construction de l’œuvre, laquelle se distingue des concrétisations locales et plus ou moins divergentes de telle ou telle planche dans son état publié:
Lorsqu’il s’engage dans la création d’une bande dessinée, le dessinateur s’astreint presque systématiquement à un certain nombre de contraintes de composition. Ces contraintes peuvent lui être imposées, ou il peut les choisir de lui-même. Ce choix peut être fait en pleine connaissance de cause, comme il peut résulter d’une habitude, d’une tradition que l’on reproduit sans même s’en apercevoir. Il s’agira par exemple du format de la bande dessinée (une page? de quelles dimensions? une partie d’une page plus grande occupée par d’autres éléments que la bande dessinée?), du nombre de vignettes par bande (fixe, variable, dans quelles proportions?), du nombre de bandes se succédant sur l’espace de composition (fixe? variable?), de la hauteur de ces bandes (toujours semblable ou fluctuante?), de la régularité ou non de la dimension des cases, et ainsi de suite. L’ensemble de ces contraintes de composition, nous les appellerons la matrice de l’œuvre. (Chavanne 2010: 15)
Il faut donc souligner l’intérêt de la notion de matrice et du principe de gradualité introduits par Chavanne, mais on peut regretter la disparition de la dimension ostentatoire ou de ce que Peeters définissait comme des mises en page où le tableau domine. Plus exactement, les mises en page les plus ostentatoires sont bien envisagées dans les derniers chapitres de l’ouvrage, mais libérées de leur dépendance envers la linéarité de la bande, elles font l’objet d’une nomenclature de plus en plus foisonnante, ce qui complexifie son usage12. En outre, la catégorie «semi-régulière» apparait, comme son nom l’indique, comme une dérivation de la mise en page régulière, plus que comme une véritable catégorie intermédiaire, ainsi qu’en témoigne cette citation:
[L]a régularité de composition peut se transformer en une contrainte terrible voire paralysante. C’est probablement alors qu’apparaissent les avantages des compositions semi-régulières. […] Une composition semi-régulière dérive directement d’une composition régulière, dont elle est en quelque sorte une altération. De la composition régulière, la semi-régulière retient le principe d’invariance des dimensions des bandes et des vignettes. La matrice élémentaire qui sous-tend de manière simple et sans aucune équivoque les compositions régulières, est toujours immédiatement perceptible dans une composition semi-régulière. Pour parler autrement, on peut dire que la grille de base, que le gaufrier de la composition régulière apparaît immédiatement et sans difficulté sous une composition semi-régulière. (Chavanne 2010: 49)
Chavanne n’envisage donc pas le cas où une mise en page semi-régulière serait dérivée d’une matrice rhétorique, ce qui est pourtant fréquent dans l’œuvre de Hergé, par exemple quand ce dernier met en scène le récit de Tchang dans Tintin au Tibet, qui prend la forme, au sein d’une mise en page globalement rhétorique, d’un montage régulier de cases isomorphes montrant en alternance le narrateur et des fragments de son récit et produisant un effet de damier qui préfigure les compositions décoratives que l’on rencontre dans Watchmen. On peut citer également une double page célèbre rattachée au flashback du Secret de la licorne dans laquelle Hergé joue sur des effets de symétrie entre deux grandes cases spectaculaires montrant des navires et un combat entre des marins et des pirates, qui contrastent avec une séquence de petites cases de format identique, où l’on peut suivre les mésaventures burlesques du capitaine Haddock mimant l’événement.
L’idée que la mise en page semi-régulière serait la dérivation d’une composition régulière et qu’en outre elle aurait pour fonction essentielle d’assouplir une contrainte de production conduit Chavanne à négliger les cas, pourtant nombreux, où un mélange de régularité et d’irrégularité confère à la planche une valeur ostentatoire ou productrice. Il me semble que ce genre de dispositif, que j’appellerai pour ma part mise en page architecturée, est susceptible de se rencontrer aussi bien dans une œuvre dominée par une matrice rhétorique que fondée sur le principe du gaufrier. J’ajouterai que ce dispositif peut même devenir une matrice en soi dans des récits graphiques exploitant pleinement la dimension tabulaire de la bande dessinée. Cette catégorie a aussi l’intérêt d’offrir une base pour regrouper la très grande diversité des compositions occupant l’espace paginal d’une manière que l’on pourrait qualifier de créative.
Typologie circulaire et mise en page architecturée
On peut retenir plusieurs principes dérivés des modèles élaborés par Peeters, Groensteen et Chavanne en vue de leur réarticulation au sein d’un modèle que je tenterai de rendre plus souple et plus efficace pour un usage scolaire. Tout d’abord, on peut considérer que la mise en page rhétorique et le gaufrier ne posent pas de problème de repérage particulier, dans la mesure où ils renvoient à des standards historiquement attestés, qui continuent de structurer une partie importante de la production actuelle. Les termes eux-mêmes sont devenus courants dans le langage des spécialistes de la bande dessinée, à tel point qu’ils ne nécessitent plus de définition particulière dans leurs travaux. Quand il s’agira d’expliquer la nature de ces prototypes à des apprenants, on se contentera de rappeler que le gaufrier consiste en un découpage régulier de la page, qui forme une grille, alors que la mise en page rhétorique consiste à adapter le format des cases au contenu représenté, ce qui induit un principe de variation plus ou moins aléatoire. On retiendra également le principe défini par Peeters, à savoir que le gaufrier est fondé sur une autonomie de l’organisation tabulaire, alors que la mise en page rhétorique adapte la mise en page aux contraintes de l’histoire représentée.
La clarté de cette opposition repose également sur un principe d’engendrement qui en constitue la raison d’être. Le gaufrier propose une organisation tabulaire standardisée, qui simplifie la mise en page, mais il complexifie le «cadrage» de l’action. À l’inverse, la mise en page rhétorique offre plus de souplesse pour mettre en scène le contenu narratif dans chaque case, mais elle complexifie l’agencement de ces cases dans l’espace du support. Dans un cas comme dans l’autre, on associera ces dispositifs à des matrices fondées sur un principe de production standardisée, ce qui explique que le dispositif tende généralement à s’invisibiliser au profit de la progression linéaire dans le récit et de l’immersion dans le plan de l’histoire.
En ce qui concerne les mises en page ostentatoires, c’est-à-dire celles dans lesquelles la dimension tabulaire devient plus saillante, on évitera de différencier les usages décoratif ou productif, car leur interprétation repose sur des critères trop subjectifs. Il me semble par contre que la catégorie introduite par Chavanne, qui consiste à proposer un pôle intermédiaire entre la régularité du gaufrier et l’irrégularité de la mise en page rhétorique offre une piste intéressante. Mais plutôt que d’en faire une simple dérivation de la mise en page régulière, il serait plus productif de lui conférer un statut propre et d’expliquer en quoi une irrégularité régulière ou une régularité irrégulière, est susceptible de renforcer la saillance de la dimension tabulaire de la planche. Pour ce troisième pôle, je propose d’utiliser l’expression de mise en page architecturée.
Ainsi que l’explique Catherine Labio, l'architecture «occupe depuis longtemps une place prépondérante dans la bande dessinée» (2015: 312). Elle explique qu’il ne s’agit pas seulement d’un sujet «médiagénique13» pour les récits graphiques, mais que cette thématique constitue également une mise en abîme du dispositif, car «la dimension architecturale de la page est une caractéristique essentielle du genre» (2015: 315, n. 7). Labio va plus loin en associant les déformations productrices que l’on peut observer dans les mises en page de Winsor McCay aux principes esthétiques de l’art nouveau, qui dominaient son époque. Dans le même registre, Alain Boillat, à la suite de Vincent Amiel, souligne qu’au sein d’une série comme Les Cités obscures – scénarisée par Benoît Peeters et dessinée par François Schuiten, lui-même fils d’architecte – on peut observer une «convergence entre l’architecture de la ville et celle de la planche» (2018: 143). Boillat rapproche cette conception ostensiblement architecturée du modèle de la mise en page productrice, que Peeters valorise dans ses travaux théoriques:
Dans un art de l’espace comme la bande dessinée où la disposition des cases sur la planche appelle un niveau de lecture tabulaire (facultativement subsumé en partie par la lecture linéaire), la démarche à l’œuvre dans les Cités obscures constitue intrinsèquement un renvoi aux conditions fondamentales de la création/réception de la BD. […] À travers les exemples qu’il convoque (Winsor McCay, Régis Frank et Fred) pour illustrer sa typologie, on comprend bien que c’est une utilisation dite «productrice» (par opposition à celles respectivement qualifiées de «conventionnelle», «décorative» et «rhétorique») qu’il entend valoriser dans la production contemporaine (et par conséquent dans la sienne propre), c’est-à-dire une mise en page obéissant au principe selon lequel «c’est l’organisation de la planche qui semble dicter le récit» (Peeters 1998: 68). (Boillat 2018: 143)
En résumé, même si n’importe quelle mise en page peut être considérée comme une forme d’architecture graphique, on pourrait utiliser l’étiquetage mise en page architecturée pour renvoyer plus spécifiquement à une configuration que l’on qualifierait, dans une autre terminologie, de productrice ou d’ostentatoire. Ce troisième pôle pourra également être défini formellement comme une composition au sein de laquelle des irrégularités locales s’inscrivent dans une configuration de rang supérieur, ce phénomène correspondant par exemple aux effets de symétrie, de contraste ou de hiérarchie qui relient des éléments hétérogènes au sein de la page. Parmi les cas typiques de compositions architecturées, on pourra mentionner par exemple les cases en médaillon placées au milieu de la planche, que l’on trouve parfois chez Jacobs, ou ces grandes cases qui viennent rompre la régularité d’un gaufrier en occupant toute la largeur d’un strip, qui sont fréquentes chez Frederik Peeters. On inclura également les compositions jouant sur des contrastes de couleur ou des correspondances graphiques non linéaires, qui abondent dans les compositions de Watchmen. Il faut rappeler en effet que l’architecture de la page ne passe pas nécessairement par des variations affectant la forme des cases: ainsi que l’ont montré Baetens et Lefèvre (1993: 60), les contrastes de couleurs au sein d’un gaufrier ou d’une mise en page rhétorique peuvent très bien créer des effets saillants à l’échelle de la planche ou de la double planche.
Enfin, il faut noter que les principes de composition peuvent varier au fil d’une œuvre, et que même à l’échelle d’une planche, on peut observer localement différents principes qui se combinent en se superposant les uns aux autres. Ces métissages, qui font parfois glisser une mise en page d’une matrice vers un pôle différent, tout en conservant certains traits inhérents au dispositif de base, soulignent l’importance de disposer d’une typologie suffisamment souple pour ménager des lieux intermédiaires, situés à une plus ou moins grande distance d’un pôle ou de l’autre.
De manière à conserver ces nuances tout en échappant à la question souvent insoluble des «seuils» qui font basculer une mise en page d’une catégorie à une autre, je propose de réarticuler ces trois prototypes (rhétorique, gaufrier, architecturé) au sein d’un continuum, lui-même structuré par les oppositions mises en évidence par Groensteen. Cette articulation serait impossible dans une modélisation sous la forme d’un tableau à double entrée, mais elle peut néanmoins être envisagée dans le cadre d’un typologie circulaire inspirée des travaux du narratologue allemand Franz Karl Stanzel (1955). Dans ce genre d’approche, les prototypes de mises en page s’articulent au sein d’un espace polarisé par deux axes: régularité/irrégularité, discret/ostentatoire. Suivant le modèle de Groensteen et de Peeters, la mise en page rhétorique correspond à un pôle situé dans le quart «irrégulier/discret» alors que le gaufrier se situe du côté «régulier/discret». Enfin, le pôle de la mise en page architecturée se situe sur le versant ostentatoire, mais à l’entrecroisement entre régularité et irrégularité.
Ce modèle possède la caractéristique de ménager des lieux intermédiaires, que l’on peut considérer comme des sous-types dérivant des trois pôles principaux. On peut ainsi mentionner les mises en page semi-régulières de Chavanne, qui partagent la discrétion des pôles rhétorique et du gaufrier tout en se situant à mi-chemin entre les deux dispositifs sur le plan de leur régularité. On peut aussi situer dans ces espaces intermédiaires des mises en page rhétoriques ou dérivant d’un gaufrier, mais qui partagent certains traits du pôle architecturé. Ce schéma circulaire permet enfin de décrire des variations observables localement au sein d’une même œuvre entre des mises en page susceptibles de s’écarter de manière plus ou moins ostensiblement de la matrice dont elles dérivent.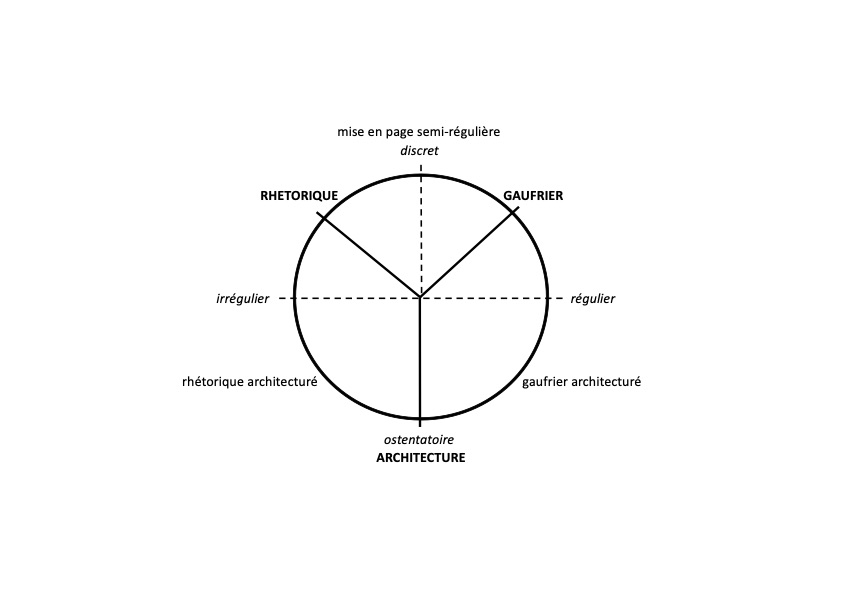 Schéma 1: Typologie circulaire des mises en page
Schéma 1: Typologie circulaire des mises en page
Notons malgré tout que quelques types de composition échappent à cette typologie, laquelle repose fondamentalement sur la possibilité de définir l’agencement d’une séquence d’information (généralement narrative) au sein d’une unité graphique de rang supérieur. Les bandes dessinées qui adoptent une mise en page flottante, c’est-à-dire dépourvue de cadres facilitant le repérage de l’agencement des cases dans l’espace de la planche, mais aussi les dispositions en ruban continu ou suivant une logique de diaporama – qui sont en train de devenir majoritaires dans le domaine de la production numérique14 – échappent à cette logique, car un tel mode de présentation, ainsi que l’explique Groensteen, «déterritorialise chaque image, masquant ou ruinant l'ensemble des liens tissés à la surface de la page» (2011: 72). Ces limites admises, nous allons voir comment l’analyse des mises en page dans un album tel que Le Long Voyage de Léna est susceptible de bénéficier de notre typologie. L’objectif ne sera pas, dans ce cas précis, de rattacher l’ensemble de l’œuvre à un pôle ou à un autre, mais plutôt de dessiner les contours d’une matrice permettant de souligner comment, localement, telle ou telle mise en page investit la dimension tabulaire de l’album en vue de produire tel ou tel effet ou de s’adapter à telle ou telle contrainte. La valeur essentielle de cette approche sera d’objectiver différentes manières d’occuper l’espace et de rendre ainsi possible l’interprétation de la valeur de chacune des compositions.
Mettre en page Léna
Déterminer la matrice à laquelle se rattache l’œuvre de Christin et Juillard n’est pas chose aisée dans la mesure où cette bande dessinée offre une grande diversité de mises en page. Un regard distant pourrait en conclure que l’irrégularité évidente de ces compositions renvoie à une matrice rhétorique, exemplifiée dès l’incipit. Dans cette première planche (qui correspond à la page trois de l’album imprimé), l’irrégularité apparente se révèle beaucoup plus complexe quand on l’analyse de manière plus détaillée en se penchant sur sa genèse.
 Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 3 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 3 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Image 2: Storyboard, planche 1 © André Juillard & Pierre Christin 2005
On constate que le storyboard, contrairement à la planche finale, présente une structure plus régulière, car on n’y trouve pas de variations au sein des cases du premier et du troisième strip. Dans ce travail préparatoire, on voit néanmoins que le gaufrier de base est modifié pour signifier graphiquement que Léna se trouve seule dans le tramway, l’élargissement du cadre permettant de montrer les sièges vides qui l’entourent. Ce procédé fait passer le strip d’un régime régulier de trois cases à une disposition en deux cases de formats différents. Si l’on observe la version finale, on constate que Juillard introduit une seconde variation dans le format des vignettes du premier strip et du troisième strip: les cases centrales montrant la protagoniste cadrée en «plan taille» apparaissent plus étroites que les cases situées sur les bords, qui sont davantage orientées sur la monstration du décor («plan moyen» ou «plan pied»). Cette irrégularité et ces correspondances thématiques produisent une symétrie axiale verticale et, pour les deux strips extérieurs, également horizontale, ainsi qu’une symétrie centrale entre les quatre coins opposés de la page. Ces cases isomorphes et solidaires accentuent ainsi légèrement la visibilité de la dimension tabulaire, ce qui rapproche la configuration du pôle architecturé. On voit ainsi comment deux phases d’élaboration d’une même planche, en dépit de variations que l’on pourrait juger quasi imperceptibles, peuvent néanmoins se situer différemment par rapport à différents pôles de notre typologie, laquelle contribue ainsi à visibiliser le travail graphique du dessinateur: dans un premier état, un gaufrier devient semi-régulier par la fusion de deux cases, ce qui le rapproche du pôle rhétorique, puis dans la mise en page finale, on observe un glissement vers le pôle archtiecturé par un jeu de correspondances formelles et thématiques construisant des effets de symétrie au sein de l’irrégularité du dispositif.
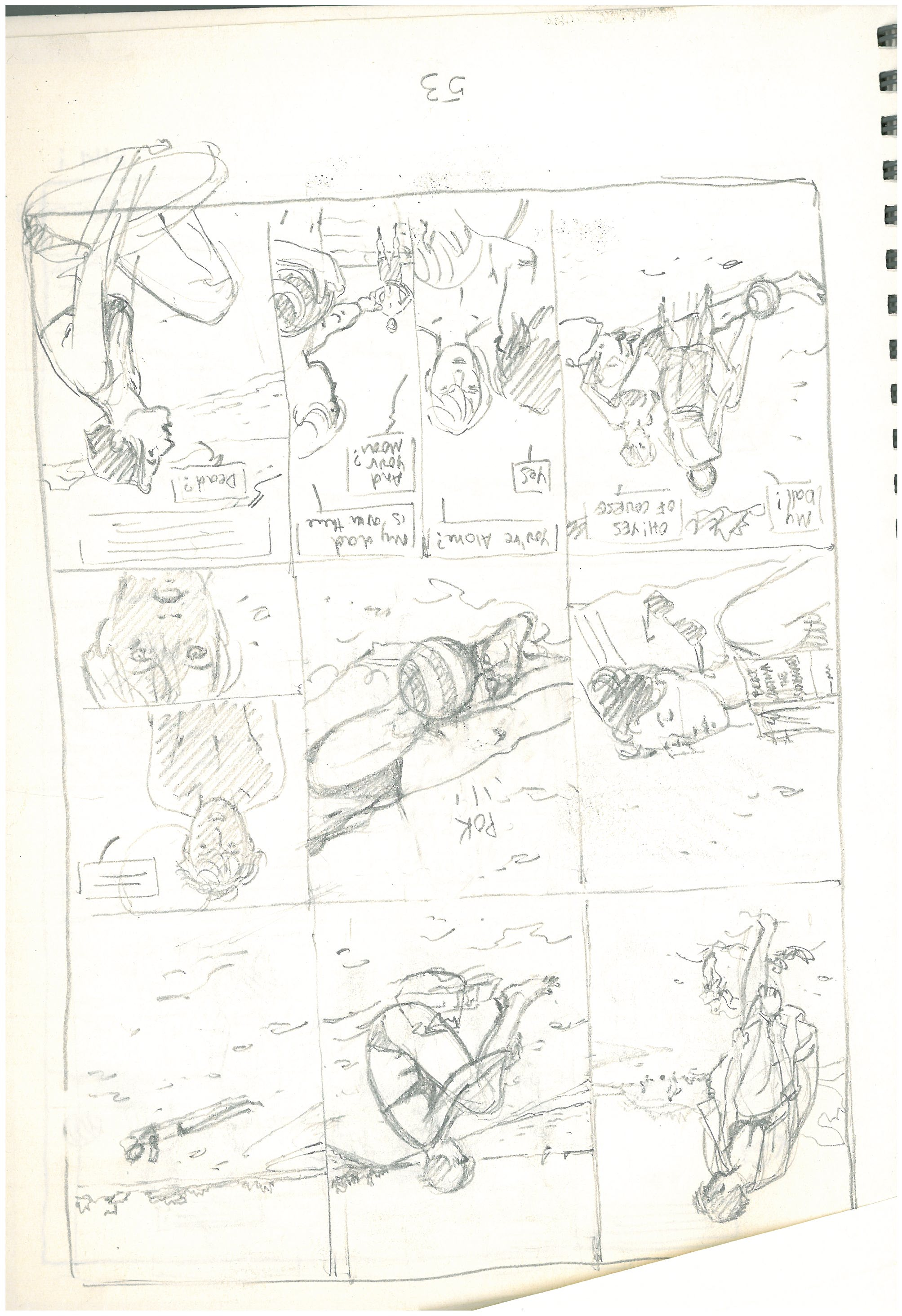
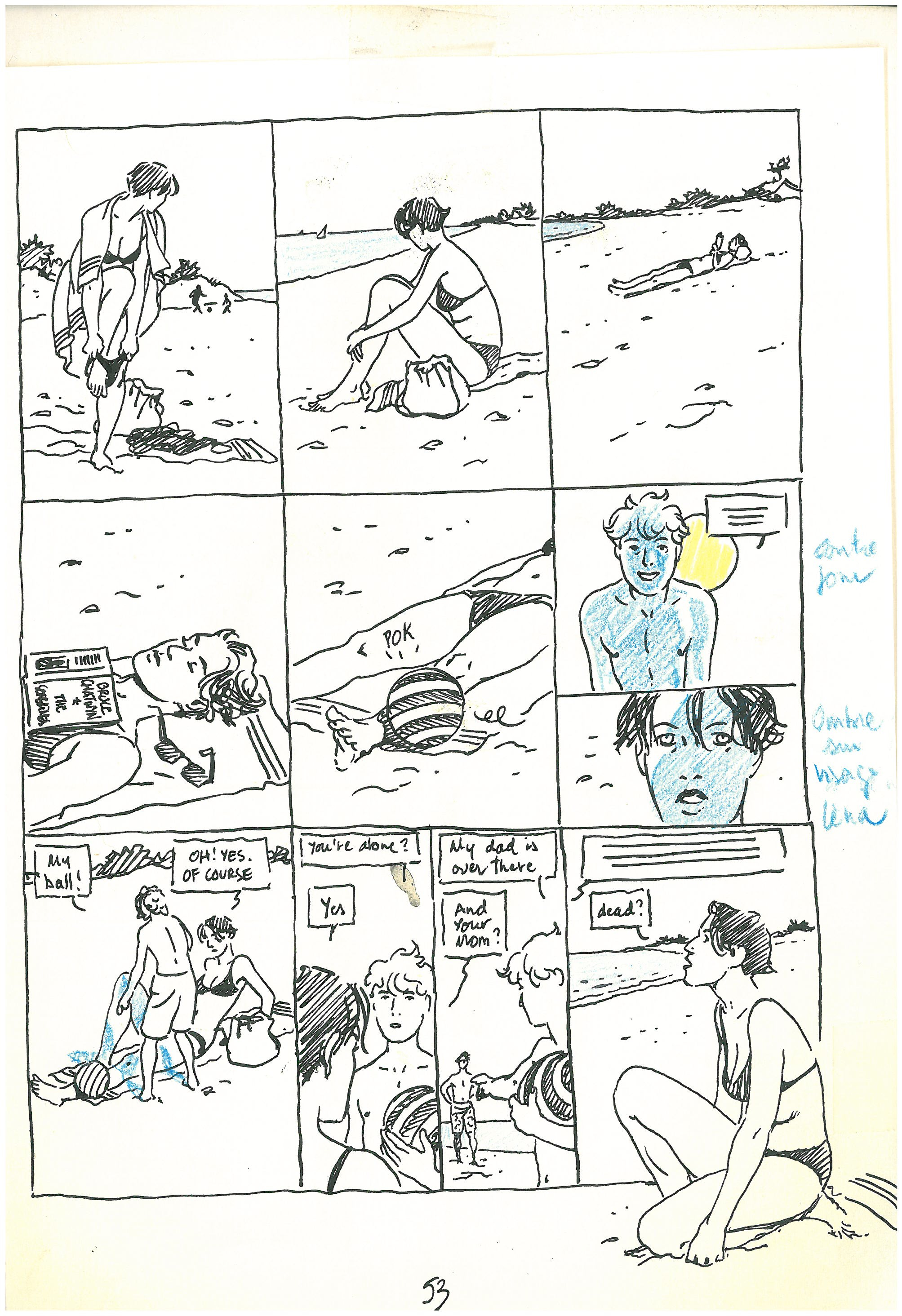
Images 3 et 4: Storyboard, planches 53 et 53bis
© André Juillard & Pierre Christin 2005
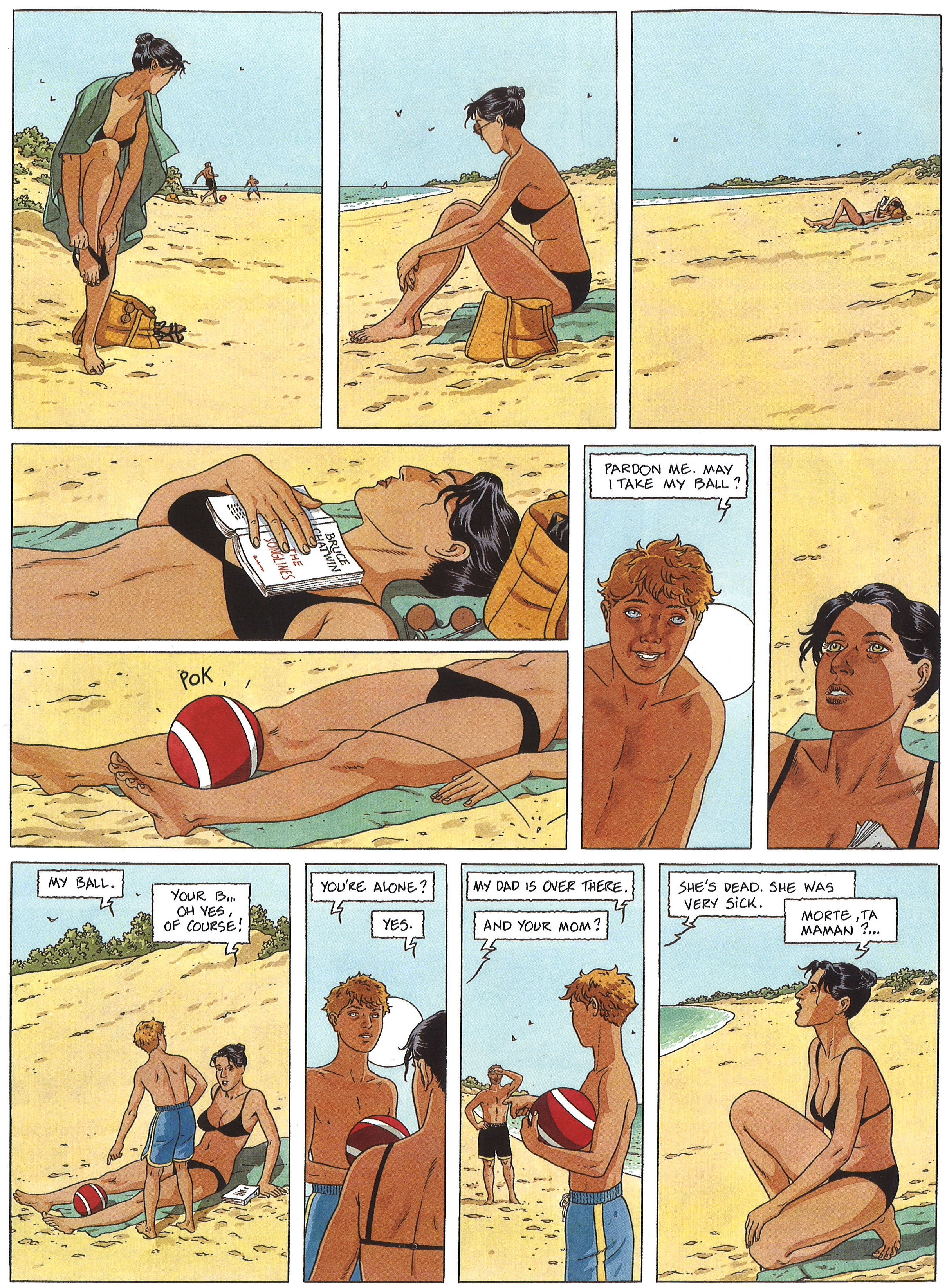
Image 5: Le Long Voyage de Léna, p. 55
© Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
On observe la même tendance à s’écarter du gaufrier dans les planches finales de l’album, l’effet étant particulièrement visible dans la version «encrée» du storyboard, car le tracé du stylo rend le cadre des cases plus ostentatoire15. À cette étape, on perçoit encore clairement la présence du gaufrier, qui a évolué par fragmentation horizontale et verticale pour s’adapter au contenu du scénario. On constate en outre, dans la dernière case, que le corps de Léna déborde du cadre au lieu que celui-ci s’adapte à son contenu. D’un côté, ce débordement crée un effet architectural dans le storyboard en créant un contraste ostentatoire avec le reste de la page, mais d’un autre côté, cela montre que nous sommes encore très éloignés du pôle rhétorique, puisque la case ne s’adapte pas à son contenu, l’auteur devant se résoudre à réduire le corps de Léna dans la version ultérieure pour la «recadrer».
En dépit de cette contrainte, évidemment plus forte sur la dernière case de la planche, la régularité matricielle du gaufrier finit par disparaitre presque complètement dans la version finale, qui offre une beaucoup plus grande hétérogénéité compositionnelle. On constate notamment, dans les cases 4 et 5, que le corps de Léna, qui est allongée sur le sable, impose une reconfiguration débouchant sur une superposition verticale de vignettes au format oblong, qui s’adaptent à leur sujet tout en s’écartant de la grille de départ, qui n’est plus perceptible que dans le premier strip. Dans les versions encrée et crayonnée, le découpage vertical et horizontal ne faisait pas «déborder» les cases du gaufrier, alors que dans la version finale, le strip du milieu présente une variation importante puisque les cases horizontales sont plus courtes que la somme de deux cases, ce qui laisse plus de place pour élargir les deux cases verticales de la fin du strip, qui peuvent ainsi déborder d’une simple case coupée en deux.
En amont du travail de composition auquel procède André Juillard, le scénario rédigé par Pierre Christin propose également un découpage qui témoigne déjà d’une réflexion sur la mise en espace du récit. Alors que le synopsis se présentait sous la forme d’un texte continu, organisé en paragraphes et en lignes de dialogues, le scénario est quant à lui segmenté en cases et en pages. Il est frappant de constater que les planches sont comptées par paires16 (2-3, 4-5, 6-7, etc.), ce qui montre que le scénariste pense d’emblée le récit en fonction des unités graphiques du produit final17. Pour chaque double page, Christin segmente ensuite le contenu en une quinzaine de cases adoptant une numérotation continue, laissant au dessinateur le choix de déterminer le lieu de l’articulation entre les deux planches. On constate d’ailleurs que les annotations manuscrites de Juillard induisent un redécoupage du scénario à partir du travail sur le storyboard: le dessinateur détermine d’abord la charnière entre les planches et procède ensuite à une renumérotation des cases pour la page de droite. 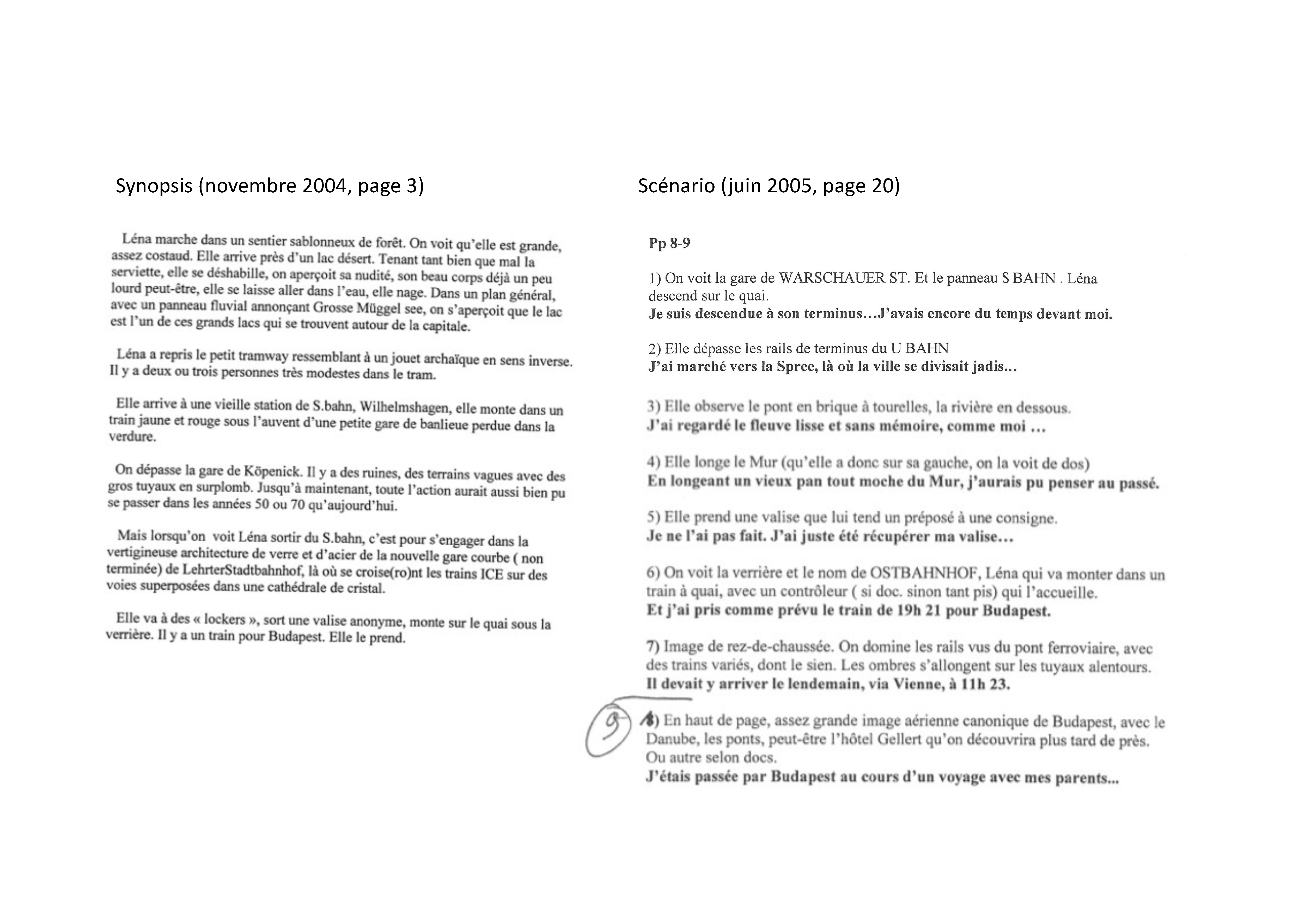
Image 6: synopsis et scénario
© André Juillard & Pierre Christin
Quant au choix de Christin de segmenter les doubles pages en une quinzaine de cases, il se fonde probablement sur un principe d’approximation. Ainsi que l’a précisé Juillard dans un entretien, ce scénario a été écrit sur mesure pour un dessinateur dont les œuvres les plus connues – par exemple sa série Les sept vies de l’épervier ou Le Cahier Bleu, qui lui a valu en 1995 le prix de l’Alph-Art au festival d’Angoulême – s’organisent généralement selon un format assez caractéristique: une mise en page en trois strips, que l’on peut qualifier d’aérée et qui met en valeur le dessin de Juillard, lequel apprécie de représenter des corps aux proportions réalistes dans des décors détaillés, ce qui exige de disposer de plus d’espace que ce que pourrait offrir un découpage sur quatre strips, pourtant assez répandu dans la bande dessinée franco-belge. En cela, Juillard apparait bien comme l’héritier d’Edgar P. Jacobs – dont il a d’ailleurs repris la série Blake et Mortimer – et non comme un continuateur du style d’Hergé, qui avait une approche beaucoup plus rhétorique18. Pour Juillard, une double page canonique consiste donc en une composition articulant deux grilles construites sur une matrice de trois bandeaux de trois cases, soit environ dix-huit cases, qui lui permettent ensuite de moduler des effets, soit à des fins rhétoriques, soit pour architecturer l’espace, souvent en jouant sur des effets de symétrie. Ce qui explique la raison pour laquelle Christin propose généralement trois ou quatre cases de moins que les dix-huit du gaufrier matriciel, c’est qu’il a conscience que le scénario, notamment quand il inclut de longs dialogues ou des récitatifs, exige un étalement de la matière narrative. Cet étalement peut impliquer une fragmentation du contenu en plusieurs «moments» (ce qui conduit à une augmentation du nombre de cases prévues par le scénario) ou une dilatation de la case (ce qui réduit le nombre de cases par rapport à la grille de départ). Par ailleurs, Christin compose avec le fait que le dessinateur doit conserver la liberté d’insérer des cases supplémentaires, fondées sur ce que l’on pourrait appeler des idées graphiques, auxquelles le scénariste n’aurait pas pensé mais qui peuvent surgir au moment de la création du storyboard ou lors de sa reconfiguration lors de l’élaboration de la planche finale.
Si l’on observe le passage du scénario (image 6) au storyboard (image 7), puis à la mise en page finale (image 8), la huitième planche passe ainsi de sept segments à neuf, puis dix cases. On voit notamment que la cinquième vignette est fragmentée in extremis pour isoler la monstration d’un pan du mur de Berlin, dont la nudité coïncide avec le récitatif «Je ne l’ai pas fait». Cette segmentation renforce à la fois l’effet de «virgule» au sein du récitatif, mettant la phrase en saillance, tout en invitant à associer la nudité du mur avec la présence silencieuse d’une pensée refoulée.
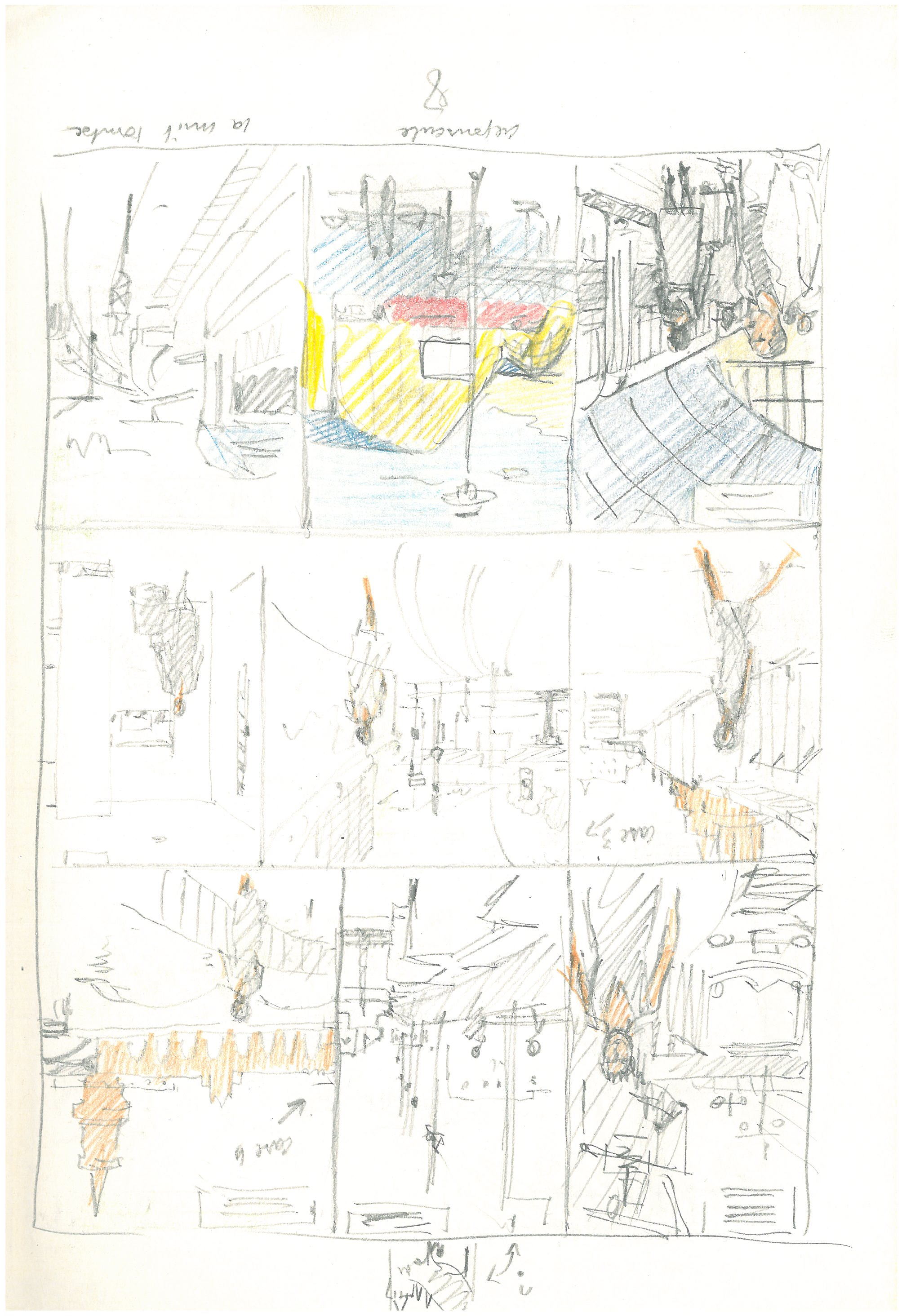
Image 7: Storyboard, planche 8 © André Juillard & Pierre Christin 2005

Image 8: Le Long Voyage de Léna, p. 10 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
On constate ainsi que les notions de matrice et de mise en page régulière et semi-régulière s’avèrent particulièrement opératoires pour définir le processus de création de l’œuvre, même si, dans la version publiée, l’album se situe davantage sur le rhétorique ou architecturé. L’espace graphique se construit progressivement sur la base d’un gaufrier de neuf cases, réparties en trois bandes, qui correspond à une sorte de modèle par défaut sur lequel se fondent aussi bien le dessinateur que le scénariste pour déployer la matière de leur récit. Ajoutons que cette matrice confère une sorte rôle hiérarchique par défaut à la cinquième case, du fait de sa position centrale dans la page, et cet effet est souvent accentué graphiquement ou exploité narrativement lors du passage du scénario à la mise en page finale. L’existence de cette matrice facilite indéniablement la coordination entre les deux auteurs et l’engendrement du récit graphique. On peut aller jusqu’à avancer que cette matrice rythme l’imaginaire de Juillard, comme elle organise l’univers graphique des références dont il s’inspire, sous la figure tutélaire de Jacobs. À partir de cette grille de départ, l’auteur peut procéder à divers ajustements pour occuper de manière optimale l’espace dont il dispose, ce qui oriente – suivant les options choisies – sa mise en page vers les pôles rhétoriques ou architecturés. Si ce gaufrier matriciel est parfois bien visible dans le storyboard, le second niveau de configuration, rattachable à la planche finale, opérera presque invariablement un glissement vers d’autres pôles19.
Si j’ai insisté dans un premier temps sur les ajustements de nature rhétorique que l’on observe non seulement dans l’incipit et l’excipit, mais également dans presque toutes les planches bavardes, qui doivent composer avec un espace saturé de textes, Juillard ne manque pas d’explorer des configurations paginales nettement plus ostentatoires. C’est le cas en particulier dans les planches les plus silencieuses de l’album, qui sont presque toutes fortement architecturées. Pour construire ces planches, Juillard exploite notamment des effets de symétrie centrale ou axiale produits par la variation des cases ou par des contrastes visuels ou thématiques, mais il exploite aussi souvent la valeur hiérarchique de l’image située au milieu de la planche.
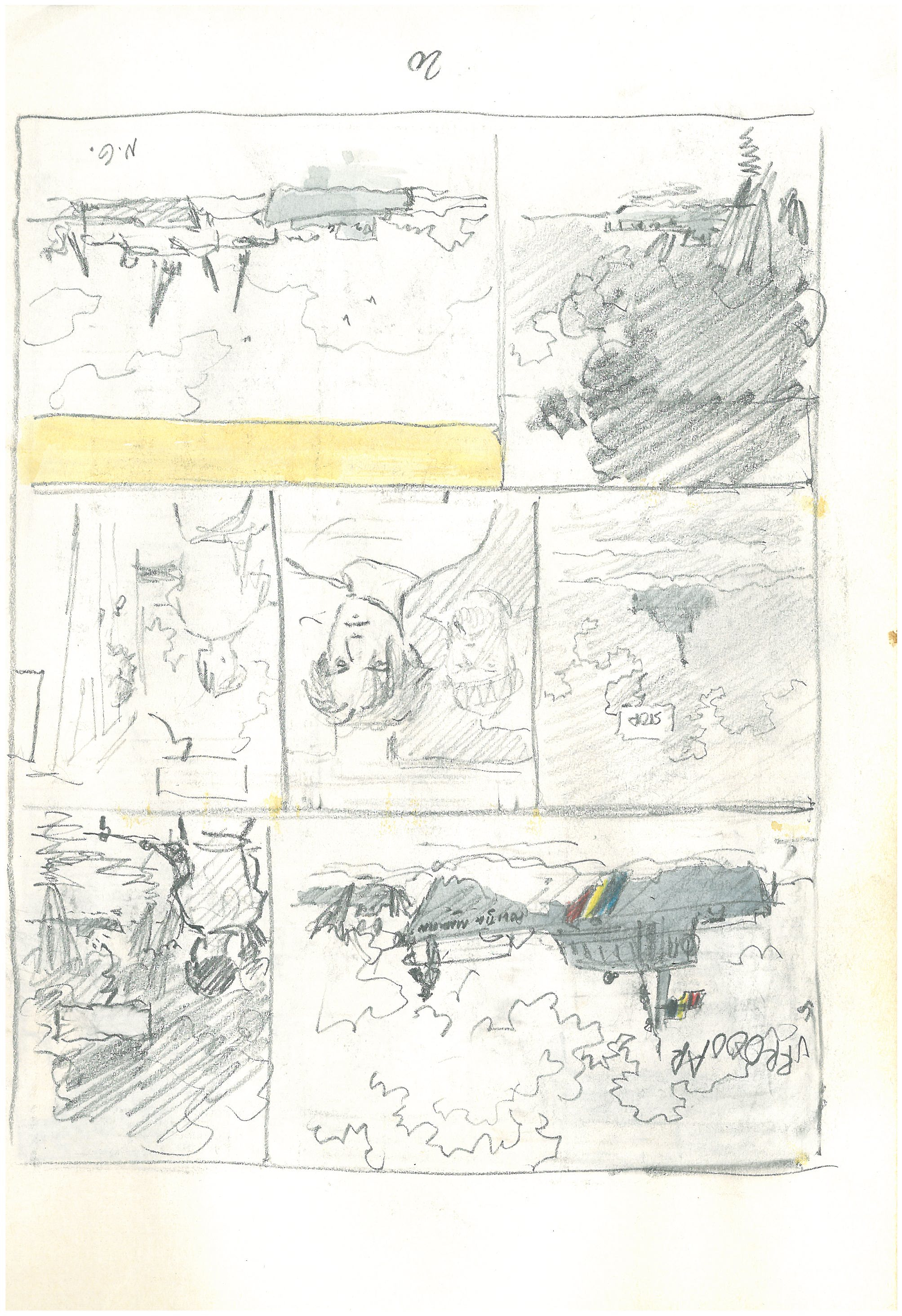
Image 9: Storyboard, planche 20 © André Juillard & Pierre Christin 2005
Ces effets sont exploités dans la vingtième planche, où Juillard joue sur un allongement de la première et de la dernière case pour insérer le dessin détaillé de navires associés à un paysage maritime. Cette déformation construit un effet de symétrie centrale, invitant à contempler la structuration globale de la planche, dont le cœur est occupé stratégiquement par une représentation de l’héroïne. Même si l’isomorphisme du premier et du dernier strip n’est pas parfait, la proximité thématique du contenu des cases renforce la correspondance entre deux segments éloignés du récit qui cadrent la séquence. On remarque aussi, dans la diagonale opposée, un rapprochement entre les arbres de la mangrove, qui se répondent et dont la verticalité contraste avec l’horizontalité des navires. Cette planche montre également que l’effet d’achitecturation de l’espace est davantage prégnant dans ces pages en raison de leur thématique, dans la mesure ou le récit, très silencieux, invite davantage à une contemplation du monde représenté qu’à une lecture linéaire des événements de l’histoire.
Ce procédé va se généraliser vers la fin de l’album, en particulier dans les pages 46 à 54 (qui correspondent aux planches 44 à 52 dans le scénario). Ces pages, pratiquement muettes, se composent selon un principe presque invariant: la construction d’une symétrie axiale verticale à l’échelle globale de la planche (à deux ou trois exceptions près, notamment, pour des raisons clairement rhétoriques, dans le troisième strip de la page 48) et un portrait de Léna, dans une case étroite située centre de la planche, dont le format ne varie jamais, renforçant un effet de tressage iconique entre les pages. Cette architecture est particulièrement visible aux pages 46, 47, 52 et 54, dans la mesure où elle est renforcée par l’isomorphisme des strips 1 et 3 et par le caractère totalement silencieux des images, qui favorise un régime de lecture moins linéaire.

Image 10: Le Long Voyage de Léna, p. 52 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Dans les pages 48 à 53, cette case centrale fonctionne sur le modèle du montage alterné au cinéma: elle insère une référence au voyage en avion de l’héroïne au cœur de la scène focalisée sur les terroristes, quand bien même ces deux évènements ne se déroulent pas dans le même chronotope. Dans ce cas, on peut ajouter que le caractère architecturé de l’espace est renforcé par l’apparence de la vignette centrale, dont l’étroitesse et l’ambiance nocturne du voyage en avion de Léna contraste avec le contexte diurne et très lumineux des cases plus larges qui représentent l’action des terroristes. On peut également signaler l’effet découlant de la récurrence du procédé dans le degré de saillance de la configuration paginale.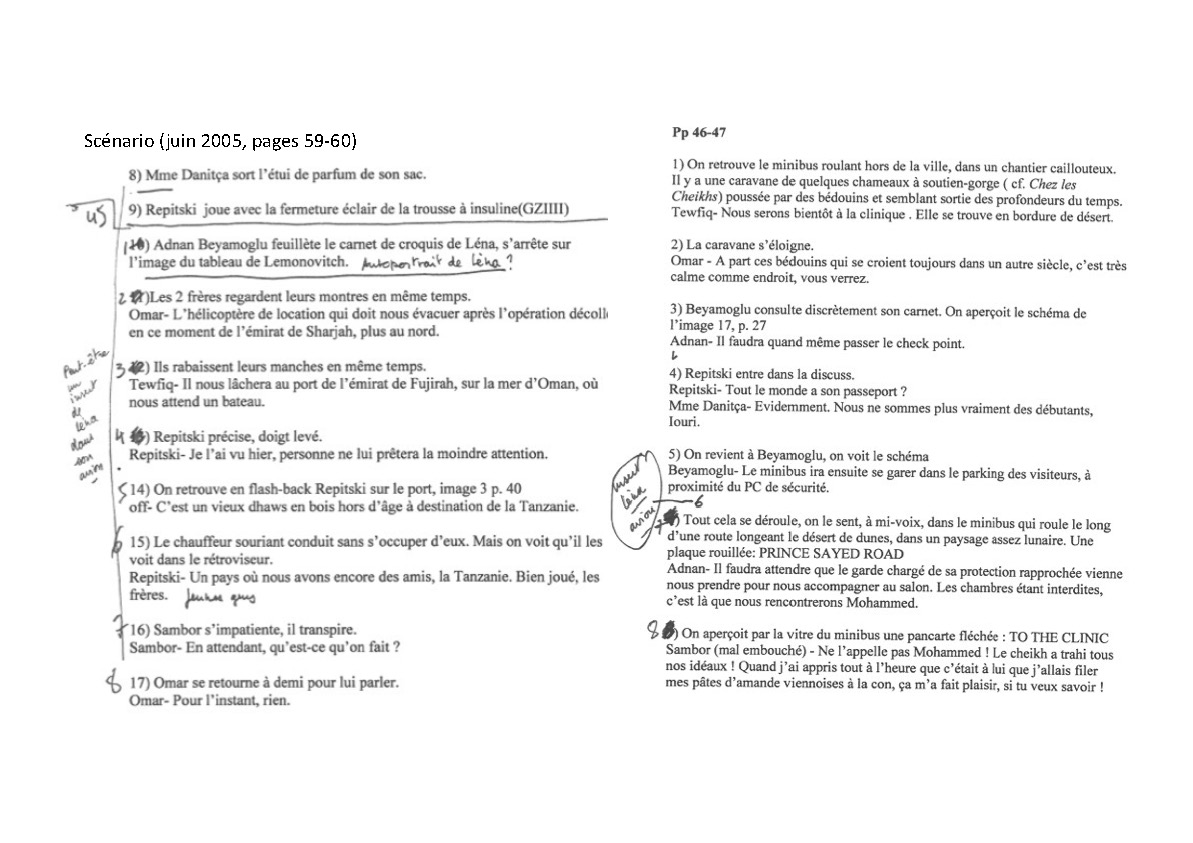
Image 11: scénario du Long Voyage de Léna © André Juillard & Pierre Christin
Il est frappant de constater que cette idée, que l’on pourrait qualifier d’éminemment graphique, est trouvée par Juillard, qui est alors amené à transformer le scénario de Christin pour ajouter ces «inserts» de Léna. Lors d’un entretien qu’il nous a accordé, le dessinateur assume d’ailleurs la paternité de cette idée et en explique l’intérêt narratif:
Cela ne vient pas de Pierre Christin. Ce n’était pas dans le scénario. Cela vient de moi qui avais envie que Léna reste présente. […]C’était une façon de montrer que sa mission continuait bien qu’elle ne soit pas là.
La première occurrence est assez subtile, dans la mesure où Juillard suggère de remplacer un dessin de Lénine par un autoportrait de Léna, de sorte que la contemplation en surcadrage de ses croquis conduise à la replacer au cœur de la planche20, avant que le «montage alterné» se mette en place. L’effet est renforcé par un tressage iconique à l’échelle de la double page: dans la case correspondante de la page précédente, on trouve en effet un autre portrait de Léna, qui la montre installée dans son avion et située au lieu stratégique où le récit bascule d’un régime de focalisation exclusivement centré sur elle, à une perspective qui suivra ensuite le déroulement de l’action des terroristes. Dès la page suivante, Juillard introduit donc systématiquement, au sein du découpage proposé par Christin, une case supplémentaire avec la mention «insert Léna avion», tout en s’arrangeant pour la situer au milieu de la planche et pour l’inscrire dans une série de cases centrales isomorphes. Cet insert est d’ailleurs souligné graphiquement dans le storyboard par l’usage d’une couleur bleue, ajoutée à l’aquarelle, qui vient mettre en évidence la case ou le «dessin21» montrant Léna dans une section du récit où elle est paradoxalement absente ou passive.
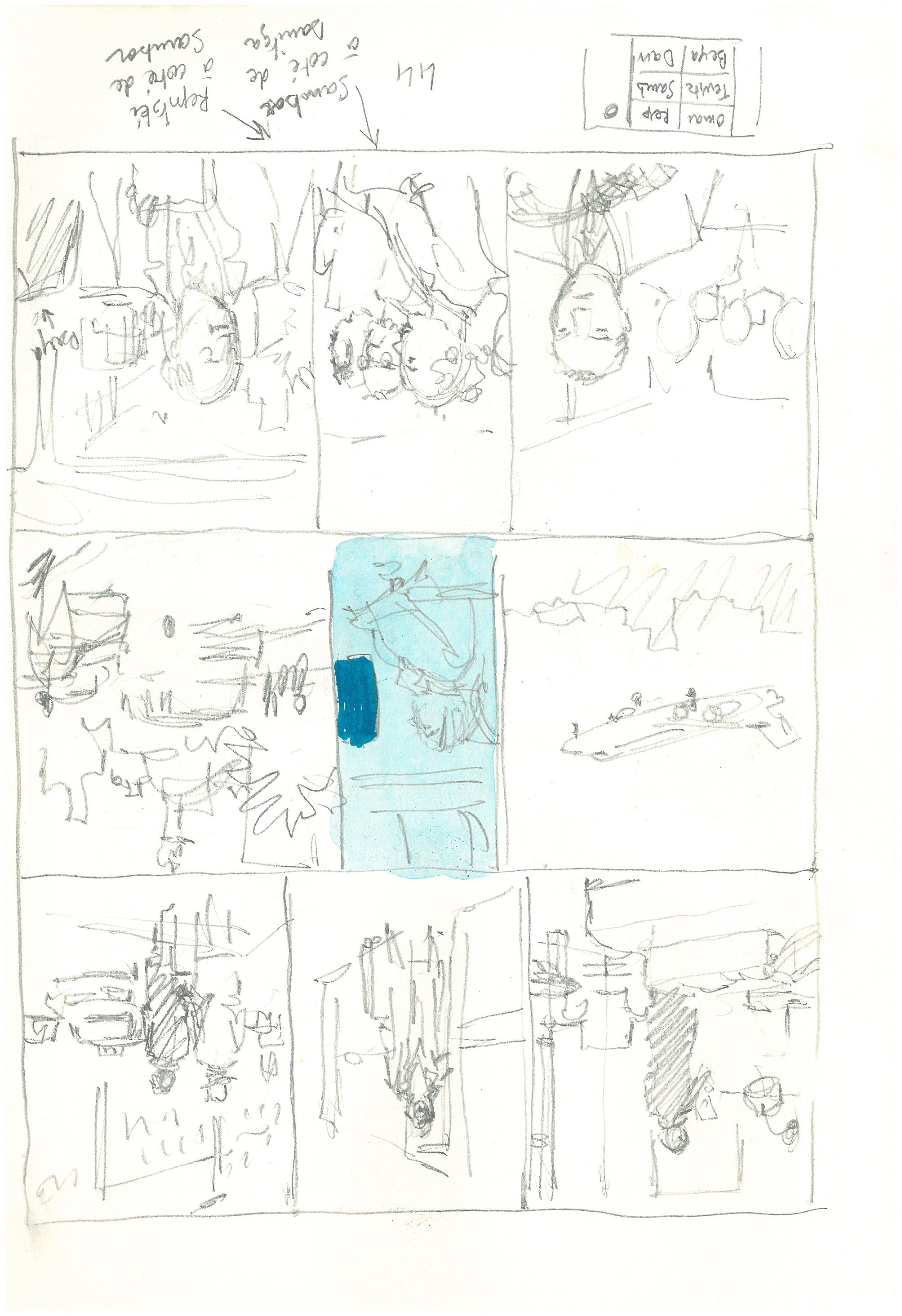
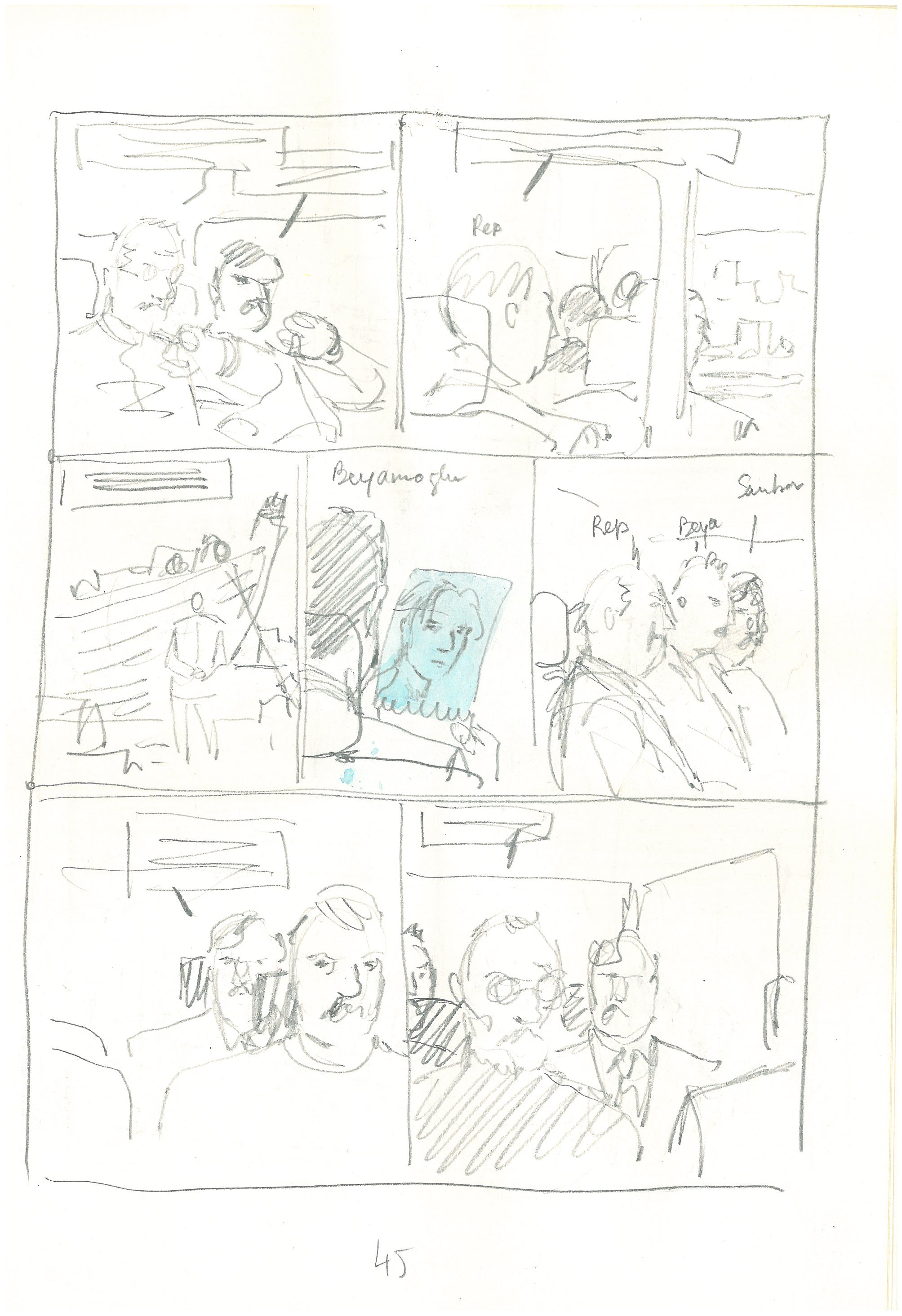
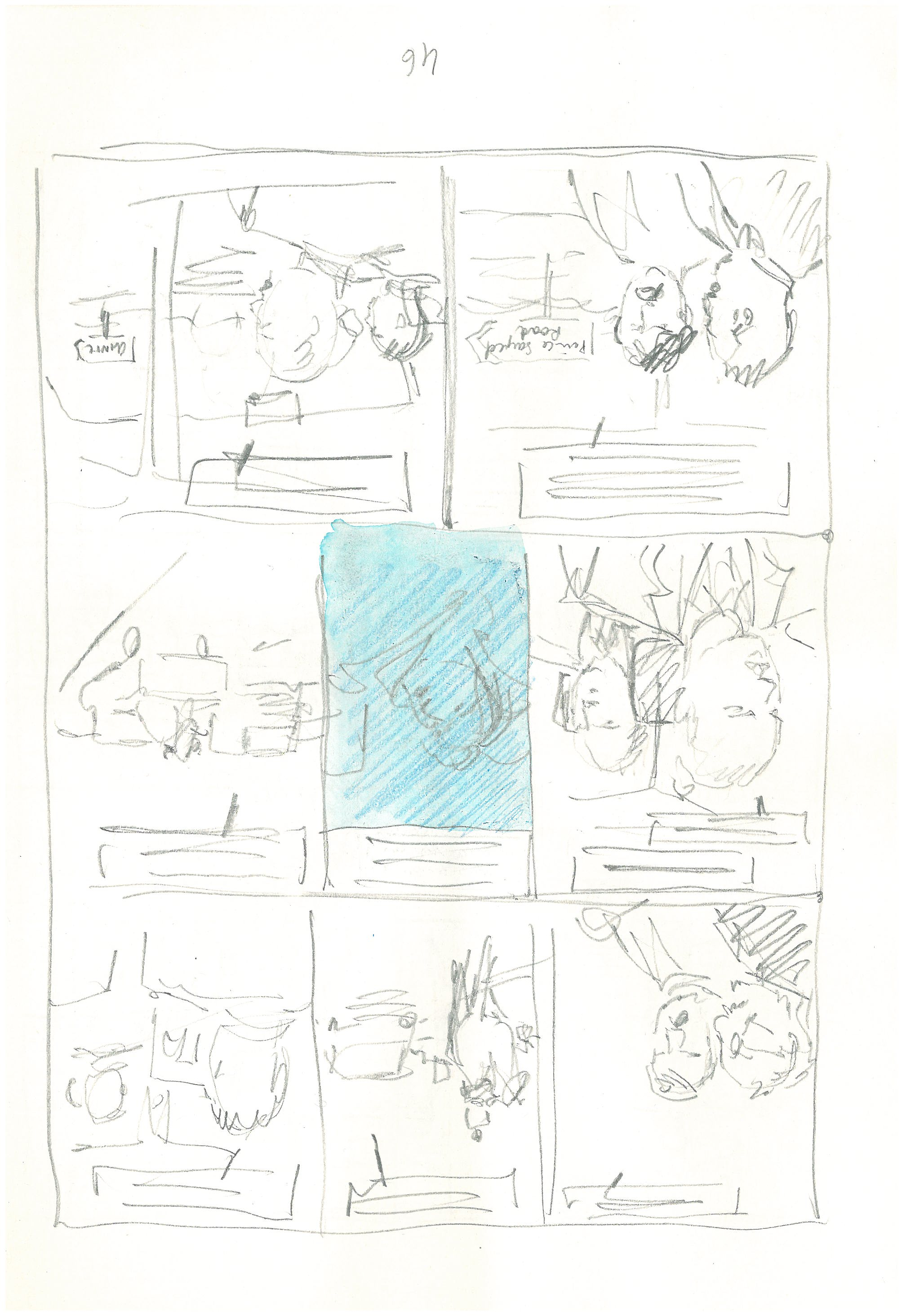
Images 12, 13, 14: Storyboard des planches 44 à 46 © André Juillard & Pierre Christin 2005
On peut enfin mentionner la manière très intéressante dont Juillard exploite localement le gaufrier, qui passe du statut de matrice occultée au rôle de dispositif ostentatoire. Ici, la composition régulière devient saillante, en partie en raison du contexte dans lequel elle s’insère: au sein de l’album, le gaufrier, qui s’étale brusquement sur une double page, tranche avec les compositions antérieures, et cet épisode se distingue aussi par sa fonction dans l’intrigue. De nombreux mystères sont dénoués: Léna décline sa véritable identité, explique ses motivations et finit par révéler l’identité des personnages figurant sur la photo de la case 6, qui avait été montrée comme un leitmotiv aux pages 15, 20, 27 et 32.
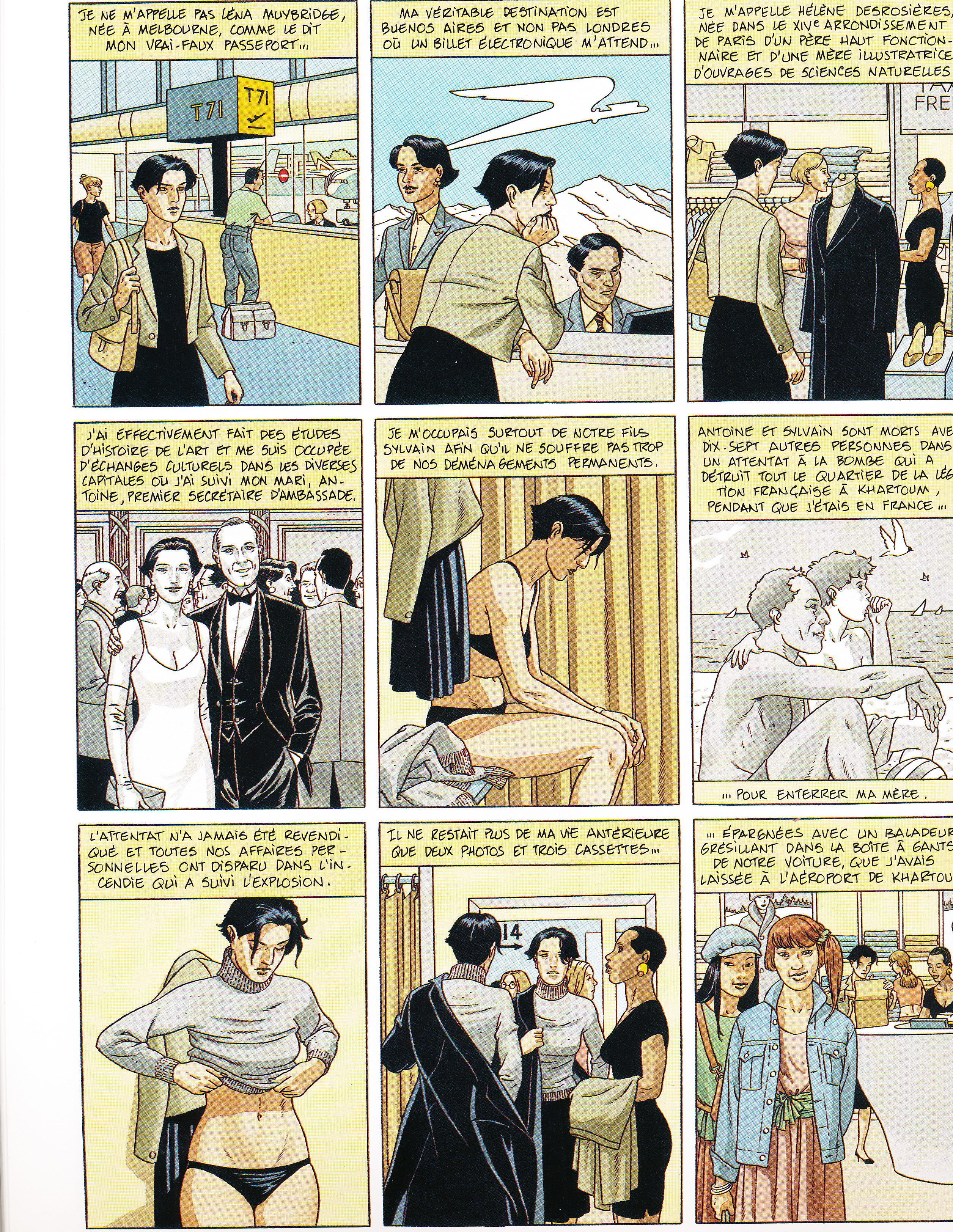
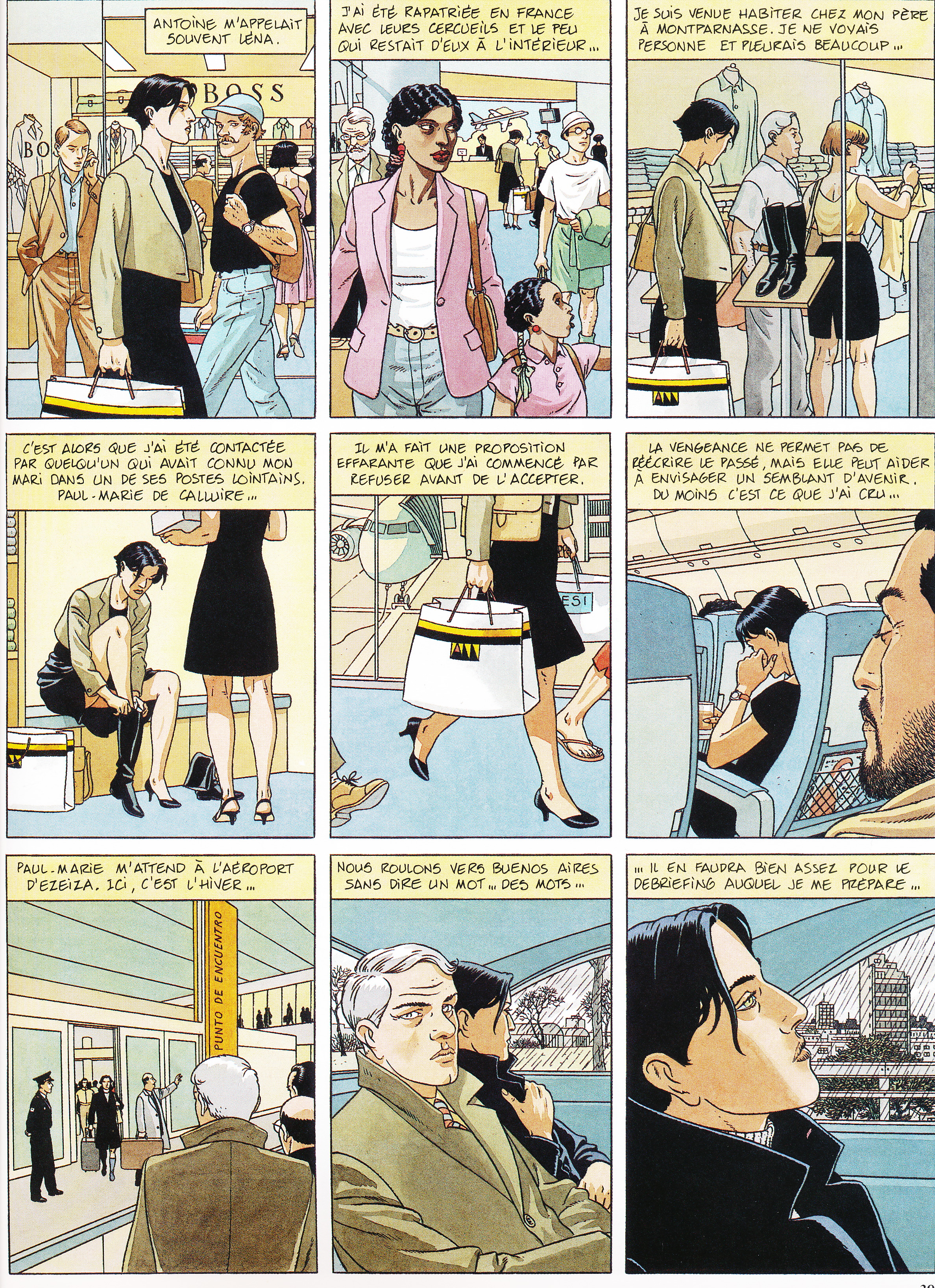
Images 15 et 16: Le Long Voyage de Léna, p. 38-39 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Les pages 38 et 39 sont donc les seules de l’album à adopter ce plan strict du gaufrier et elles tranchent aussi formellement par l’usage systématique du récitatif et l’absence de dialogues. On voit comment Juillard met à profit la valeur expressive du gaufrier, au lieu de le déformer pour l’adapter aux contraintes de son récit. L’absence de variation dans la dimension des cases donne l’impression que les images ne sont pas vraiment coordonnées, qu’elles ne s'imbriquent pas dans la structure organique de la page, ce qui renforce l’effet d’un rythme régulier et dépourvu de relief. Les images deviennent illustratives (quand elles montrent les photos de l’époux ou du fils de Léna) ou anecdotiques (quand elles montrent Léna achetant des vêtements et prenant l’avion). Ce que l’on peut considérer comme un sommaire graphique se subordonne à la voix l’héroïne, sur laquelle repose entièrement la progression narrative. Léna semble perdue dans ses pensées: on la montre méditative, se laissant porter par l’accomplissement d’actions routinières, désormais dépourvues d’importance. L’intrigue est déjà dénouée pour elle. La composition graphique de cette séquence semble ainsi renforcer la perspective distanciée d’une voix over fatiguée, qui peut enfin libérer des pensées réprimées et laisser derrière elle les tensions inhérentes à l’accomplissement de sa mission.
Conclusion
Le modèle que je propose d’introduire pour l’analyse de la mise en page apparait finalement davantage comme un perfectionnement ou une réarticulation des modèles antérieurs que comme une véritable rupture avec ces derniers. La typologie circulaire intègre en particulier les critères dégagés par Groensteen, à savoir le caractère plus ou moins régulier ou ostentatoire du dispositif, tout en reprenant les catégories rhétorique, régulière et semi-régulière de Peeters et Chavanne, ainsi que la notion de matrice introduite par ce dernier. Enfin, ce qui est peut-être encore plus important, ce modèle se fonde sur un principe qui se trouve au cœur de l’approche de Peeters, à savoir que la déformation d’une case au sein d’un système fondé sur la répétition produit une irrégularité qui peut s’expliquer de deux manières différentes: soit elle répond à la nécessité d’adapter le cadre de l’image au contenu représenté (ce qui correspond au pôle rhétorique), soit elle vise à accentuer la dimension tabulaire de la planche en produisant des effets que l’on peut qualifier de décoratifs ou de productifs (ce qui la fait basculer du côté de l’architecture).
La principale innovation, déjà suggérée par Chavanne, tient au caractère progressif des catégories retenues, qui sont redéfinies comme des pôles au sein d’un continuum plutôt que comme des unités discrètes formant un tableau à double entrée. La seconde innovation repose sur l’introduction d’un nouveau prototype, que j’ai appelé mise en page architecturée. En soi, ce pôle n’est pas entièrement original car il découle de la fusion des types décoratif et productif, que je place sur le versant ostentatoire des compositions semi-régulières. En outre, il dérive des nombreuses études ayant souligné la parenté entre architecture et mise en page dans un médium tel que la bande dessinée. L’usage du qualificatif architecturé vise avant tout à définir un principe formel qui se trouve au fondement des mises en page ostentatoires. Ce principe repose sur la possibilité de déceler la présence d’une régularité au sein de l’irrégularité en changeant d’échelle, ce qui revient à décrire une configuration créative de la planche, qui s’écarte peu ou prou des structures conventionnelles, c’est-à-dire de la régularité du gaufrier ou du caractère apparemment aléatoire (car lié à des contraintes locales) des variations de la mise en page rhétorique.
Pour devenir pleinement opératoire, ce modèle devra probablement évoluer, être clarifié et simplifié. D’un point de vue terminologique, on pourra par exemple regretter que les trois pôles soient labellisés avec des termes qui n’appartiennent pas au même paradigme. Peut-être vaudrait-il mieux substituer au substantif gaufrier l’adjectif régulier. Avec le recul, l’adjectif rhétorique n’est peut-être pas si transparent, en dépit de son usage courant chez les spécialistes, car il suggère la présence d’un effet sur le lecteur, ce qui le placerait sur un versant plus ostentatoire. Pour aller plus loin dans la transposition didactique, on pourrait aussi s’émanciper davantage des principes dont dérive le modèle, par exemple en abandonnant la mention des axes de la régularité et de l’ostentation, au profit d’une description plus empirique des trois prototypes et des compositions intermédiaires.
À ce stade, la valeur que l’on peut reconnaitre à ce modèle en devenir est d’offrir un outil suffisamment souple pour dépasser l’impression que la mise en page d’un album tel que Le Long Voyage de Léna serait uniforme ou simplement rhétorique. Il permet au contraire de saisir les nuances locales qui font glisser le dispositif vers tel ou tel pôle, tout en montrant comment les pages dérivent d’une matrice plus ou moins identifiable. Il n’est évidemment pas toujours possible de disposer de documents génétiques permettant de remonter à cette matrice, mais dans de nombreux cas, il est possible d’en déduire les contours en repérant au fil des pages des invariances sur lesquelles repose l’imaginaire graphique de l’auteur. Toutefois, même si l’analyse des planches ne permet pas de définir un principe génétique sous-jacent, ce modèle permet de classer chaque mise en page à une plus ou moins grande distance de tel ou tel pôle, ce qui permet à la fois d’objectiver les éléments formels caractérisant la composition, tout en réfléchissant aux effets produits par ce dispositif. Pour rendre le cercle typologique plus lisible – à l’instar du cercle des situations narratives de Stanzel –, on pourrait en proposer des déclinaisons illustrées en disposant différents types de planches à une plus ou moins grande distance des trois pôles fondamentaux, dont le sens s’éclairerait de manière plus empirique que théorique.
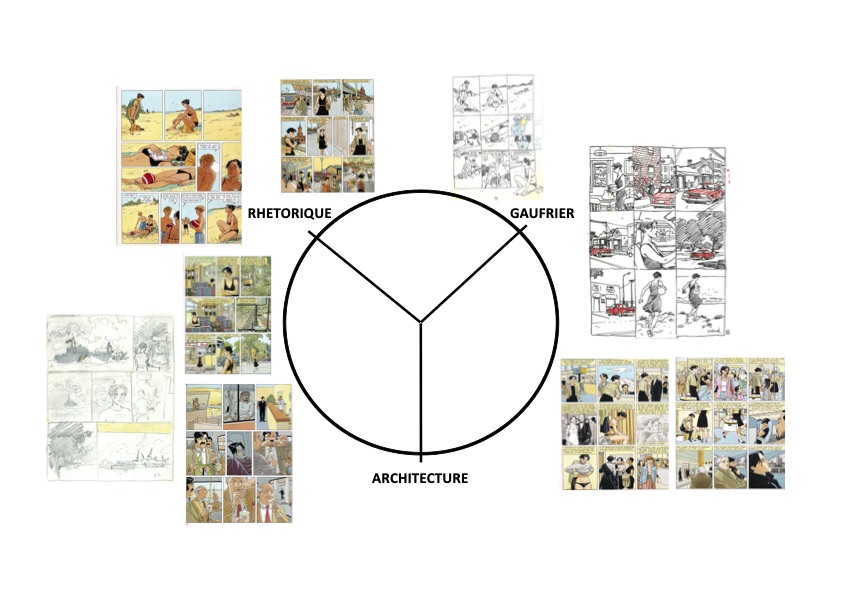
Schéma 2: Classement des planches dans un cercle typologique simplifié
En lien avec l’imaginaire graphique de Juillard, lui-même en partie dérivé des mises en page de Jacobs, j’ai beaucoup insisté sur les effets de symétrie architecturant la planche, mais il y a bien d’autres manières de produire des effets similaires, en jouant sur les contrastes entre les cases ou sur leur contenu graphique. Il faut ajouter qu’il y peut y avoir, sur le pôle des mises en page architecturées, d’importantes variations en termes de degré de visibilité et de complexité des structures, les cas les plus expérimentaux et les plus inextricables étant certainement incarnés par les compositions de Chris Ware. À l’opposé de cette esthétique du scriptible, Juillard déploie au contraire beaucoup d’efforts pour que les variations du gaufrier demeurent toujours très lisibles et même plus ou moins invisibles. L’architecture de la page doit ainsi accomplir ses effets sans nuire à l’immersion ou briser le rythme de la lecture et, en cela, elle reste assez conventionnelle. Ses compositions aérées et plus ou moins architecturées induisent néanmoins un rythme que l’on pourrait qualifier de contemplatif22, à l’instar du long voyage de Léna, qui apprécie de prendre son temps dans ses déambulations. Cette dernière commente son itinérance en ces termes: «Aller où je dois aller, même si c’est lent…» (p. 19). Les déplacements de l’héroïne à pied, à la nage, en train, en bus, en tram, en navire ou dans de vieilles voitures se situent ainsi aux antipodes de la passion hergéenne pour la vitesse mécanique23, mais ils sont au diapason de cette manière très personnelle dont André Juillard occupe l’espace de son médium et construit la lecture de ses albums.
Références
Amiel, Vincent (1986), «Bande dessinée et architecture: l’espace encadré», Les Cahiers de la bande dessinée, n° 69, p. 24-25.
Baetens, Jan (2016), «La question du rythme entre texte et bande dessinée: l’exemple de "Boule de Suif" dans Maupassant. Contes et nouvelles de guerre (Battaglia)», French Forum, n°14 (3), p. 289-301.
Baetens, Jan (2006), «Hergé, auteur à contraintes? Une relecture de L'Affaire», French Forum, n° 31 (1), p. 99-111.
Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.
Baetens, Jan & Kathryn Hume (2006), «Speed, Rhythm, Movement: A Dialogue on K. Hume’s Article "Narrative speed"», Narrative, n° 14 (3), p. 349–355.
Baetens, Jan & Pascal Lefèvre (1993), Pour une lecture moderne de la bande dessinée, Bruxelles, Centre Belge de la Bande Dessinée.
Baroni, Raphaël (2021), «Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée», Lettre de l’AIRDF, n° 68, p. 49-54.
Baroni, Raphaël (2018), «Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne: une segmentation précaire», Cahiers de narratologie, n° 34. En ligne, consulté le 12 août 2021, URL: http://journals.openedition.org/narratologie/8594
Baroni, Raphaël, Gaëlle Kovaliv & Olivier Stucky (2021), «La transition numérique de la bande dessinée. Une mutation impossible?», Belphégor, n° 19 (2). En ligne, consulté le 16 août 2021, URL: https://journals.openedition.org/belphegor/3948
Boillat Alain (2018), «Reflets des cités: les mondes en miroir (sans tain) de Schuiten
et Peeters», Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry, n° 38 (1-2), p. 141–162.
Chavanne, Renaud (2010), Composition de la bande dessinée, Montrouge, PLG.
Chavanne, Renaud (2005), Edgar P. Jacobs et le secret de l’explosion, Montrouge, PLG.
Chiss, Jean-Louis (2003), «La littératie: quelques enjeux d’une réception dans le contexte éducatif et culturel français», in La littéracie: conceptions théoriques et pratiques d'enseignement, p. 43-52.
Christin, Pierre & André Juillard (2006), Le Long Voyage de Léna, Paris, Dargaud, coll. «Long Courier».
Cohn, Jesse (2009), «Mise-en-Page: A Vocabulary of Page Layouts», in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 44-57.
Dufays, Jean-Louis (2017), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n° 45. En ligne, URL: http://trema.revues.org/3486
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2015), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 3e édition.
Fresnault-Deruelle, Pierre (1976), «Du linéaire au tabulaire», Communications, n° 24, p. 7-23.
Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.
Groensteen, Thierry (2001), «Le réseau et le lieu: pour une analyse des procédures de tressage iconique», in Time, Narrative & the Fixed Image. Temps, narration & image fixe, J. Baetens & M. Ribière (dir.), Amsterdam, Rodopi, p. 117-129.
Groensteen, Thierry (2011), Bande dessinée et narration. Système de la bande dessinée 2, Paris, PUF.
Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), «Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée», Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107. En ligne, consulté le 14 août 2021, URL: http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305/1807
Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.
Kukkonen, Karin (2020), «The Speed of Plot. Narrative Acceleration and Deceleration», Orbis Litterarum, n° 75 (2), p. 73-85.
Labio, Catherine (2015), «The Architecture of Comics», Critical Inquiry, n° 41 p. 312-343.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La littératie médiatique multimodale, Québec, Presses Universitaires du Québec.
Lefèvre, Pascal (2009), «The Conquest of Space: Evolution of Panel Arrangements and Page Layouts in Early Comics Published in Belgium (1880–1929)», European Comic Art, n° 2 (2), p. 227-252.
Letourneux, Matthieu (2017), Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil.
Marcoux, Marie-Hélène (2015), La BD au secondaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.
Marcoux, Marie-Hélène (2018), La BD au primaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.
Marion, Philippe (1997), «Narratologie médiatique et médiagénie des récits», Recherches en communication, n°7 p. 61-88.
Meyer, Jean-Paul (2019 [2012]), «À propos des albums de BD adaptés de romans: de la transposition littéraire à la transposition didactique», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Éditions, p. 157-170.
Missiou, Marianna (2019 [2012]), «Un médium à la croisée des théories éducatives: bande dessinée et enjeux d’enseignement», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, UGA Editions, p. 79-98.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Peeters, Benoît (1991), Case, planche, récit: comment lire une bande dessinée, Paris, Casterman.
Ricardou, Jean (1978), Nouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil.
Rosen, Elizabeth (2009), «The narrative intersection of image and text: teaching panel frames in comics», in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 58-66.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2019 [2012]), Bande dessinée et enseignement des humanités, Grenoble, UGA Éditions.
Sohet, Philippe (2010), Pédagogie de la bande dessinée. Lecture d’un récit d’Edmond Baudoin, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Stanzel, Franz Karl (1955), Die Typischen Erzählsituationen im Roman, Wien, Braumüller.
Stucky, Olivier (2021), «La planche de bande dessinée comme interface: déplacer les rapports texte-image», Arkhaï, n° 16, p. 127-148.
Pour citer l'article
Raphaël Baroni, "Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées: Léna mise en page", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022https://www.transpositio.org/articles/view/decrire-et-interpreter-l-architecture-graphique-des-bandes-dessinees-lena-mise-en-page
Voir également :
La bande dessinée comme œuvre collective. Dialogue entre André Juillard et Pierre Christin
L’imaginaire de la création artistique a tendance à considérer cette dernière comme un acte individuel, intime, singulier, voire en rupture avec les normes ou la tradition. Il s’agit d’une conception romantique, renouvelée par le surréalisme et fondée sur l’idéologie de l’avant-garde.
La bande dessinée comme œuvre collective. Dialogue entre André Juillard et Pierre Christin
L’imaginaire de la création artistique a tendance à considérer cette dernière comme un acte individuel, intime, singulier, voire en rupture avec les normes ou la tradition. Il s’agit d’une conception romantique, renouvelée par le surréalisme et fondée sur l’idéologie de l’avant-garde. Dans le domaine de la bande dessinée, les collaborations entre plusieurs acteurs, dont les statuts d’ «auteurs» varient, sont devenus une norme pratique admise au XXe siècle, tandis qu’il n’en fut pas de même un siècle plus tôt, dans le genre naissant de ce que Rodolphe Töpffer appelait le «histoires en estampes». Cette question se pose sous un angle particulier dans le cadre des relations entre André Juillard et Pierre Christin, deux figures de premier plan, d’autorité même, dans le monde de la bande dessinée. Dans le cas des aventures de Léna (un triptyque dont le premier volume est traité ici),comment situer le dessinateur et le scénariste, leur collaboration et leurs choix, tant esthétiques que narratifs ou rédactionnels, ceci en dialogue avec leur éditeur? Autrement dit, comment leurs travaux individuels ont-ils donné une œuvre?
De manière plus générale, force est de constater que dans l’histoire des créations culturelles et notamment dans le domaine de l’histoire de l’art, de l’antiquité, à l’art contemporain en passant par le moyen âge et la période dite «moderne» (de la Renaissance à la Révolution), les œuvres collectives sont plutôt la règle que l’exception. La peinture et en particulier les œuvres de grandes dimensions ou de complexités techniques résultent très souvent d’une collaboration ou d’un travail collectif en atelier. Il en est de même de la sculpture, de l’architecture et bien sûr de la gravure, essentiellement utilisée comme art de la reproduction, qui implique un artiste (peintre ou dessinateur), un graveur, un éditeur et un imprimeur. L’idée de l’estampe dite «originale», idéalement exécutée de bout en bout par une même personne, ne s’est établie que dans le dernier tiers du XIXe siècle.
Dans cette idéologie de la création singulière se rejoue la distinction canonique entre l’«artiste» et l’«artisan», entre l’«art» et le «commerce». C’est de ce clivage normatif qu’est né, entre autres, le rejet de l’«illustration» comme œuvre seconde et secondaire, soumise à l’antériorité et l’hégémonie du texte et de l’écrivain (Kaenel 2005). De là est également issue l’idée du «cinéma d’auteur» qui, dans les faits, est nécessairement (ou du moins presque toujours) une œuvre collective. Ces conceptions n’empêchent pas la persistance et l’efficacité de l’idéologie de la création individuelle et indivise, c’est-à-dire unique, singulière et «originale».
Töpffer comme idéal
Dans le domaine de la bande dessinée, un personnage historique est venu appuyer cette vision ou ce rêve d’autonomie créatrice. Rodolphe Töpffer (1799-1846) est devenu depuis une trentaine d’années une figure d’autorité, dans tous les sens du terme. Rebaptisé «inventeur de la bande dessinée», il cumule tous les traits idéaux et apocryphes de l’«auteur de bande dessinée». On se souvient que, frustré d’une carrière dans les beaux-arts (qui fut la voie suivie à Genève par son père, Wolfgang-Adam), Rodolphe devient directeur de pensionnat et professeur de rhétorique et belles-lettres à l’Académie de Genève, critique d’art à ses heures, journaliste politique (conservateur) vers la fin de sa vie, touriste, illustrateur de ses propres récits de voyages et autres fictions moralisantes, auteur, acteur, metteur en scène de ses pièces de théâtre, inédites de son vivant mais fondamentales dans la gestation de ce qu’il appellera les «histoires en estampes» et qu’il théorisera peu avant sa mort, dans une sorte de manifeste et de manuel, l’Essai de physiognomonie (1845).
Töpffer est «auteur» à plusieurs titres, sous plusieurs formes et dans plusieurs genres, plus ou moins publics et reconnus, alors qu’il exécute ses premiers albums peu avant 1830. Il commence à les éditer dès 1833, avant qu’ils ne connaissent une diffusion française et européenne dans les années 1840. En témoignent la reproduction de ses œuvres dans le journal L’Illustration, le piratage des albums par la Maison Aubert à Paris et l’essor d’une véritable «mode» qui sera suivie par Gustave, Doré, Nadar et tant d’autres. Surtout, d’un point de vue qui est le nôtre aujourd’hui, Töpffer a accompli ce rêve d’autonomie créatrice, car non seulement il est l’auteur de ses histoires, son propre «scénariste» (avant même que ce profil professionnel ne se développe), le seul dessinateur de ses albums qu’il imprime à compte d’auteur et diffuse lui-même (Kaenel 2005). A cette maîtrise exceptionnelle de la chaîne de production et de diffusion s’ajoute un trait (c’est le cas de le dire) essentiel caractérisant son œuvre sur le plan esthétique: l’usage de la ligne, dans lequel on a parfois vu l’archéologie de la fameuse «ligne claire» hergéenne. Le fait que le dessin et le texte de Töpffer sont autographes et qu’ils se limitent au noir et blanc résonne également avec des pratiques d’auteurs contemporains (Groensteen 1994). On sait combien le combat pour le noir et blanc contre les thèmes, usages et formats standardisés de la bande dessinée (le «48cc», 48 pages, cartonné en couleur) s’est retrouvé au cœur des revendications des jeunes auteurs de bandes dessinées. Tel est le cas de L’Association, à Paris, une maison d’édition fondée en 1990, qui défend implicitement les valeurs que Töpffer et son œuvre condensent. Or, ce modèle idéal est rarement atteignable au regard des pratiques de la bande dessinée aujourd’hui, qui, dans la presque totalité des cas, rendent impossible la création purement autonome et individuelle. Internet, il est vrai, a rendu cette autonomie créatrice plus aisée; mais il s’agit d’un «support» ou d’un espace qui demeure encore peu valorisé parmi les auteurs de bandes dessinées.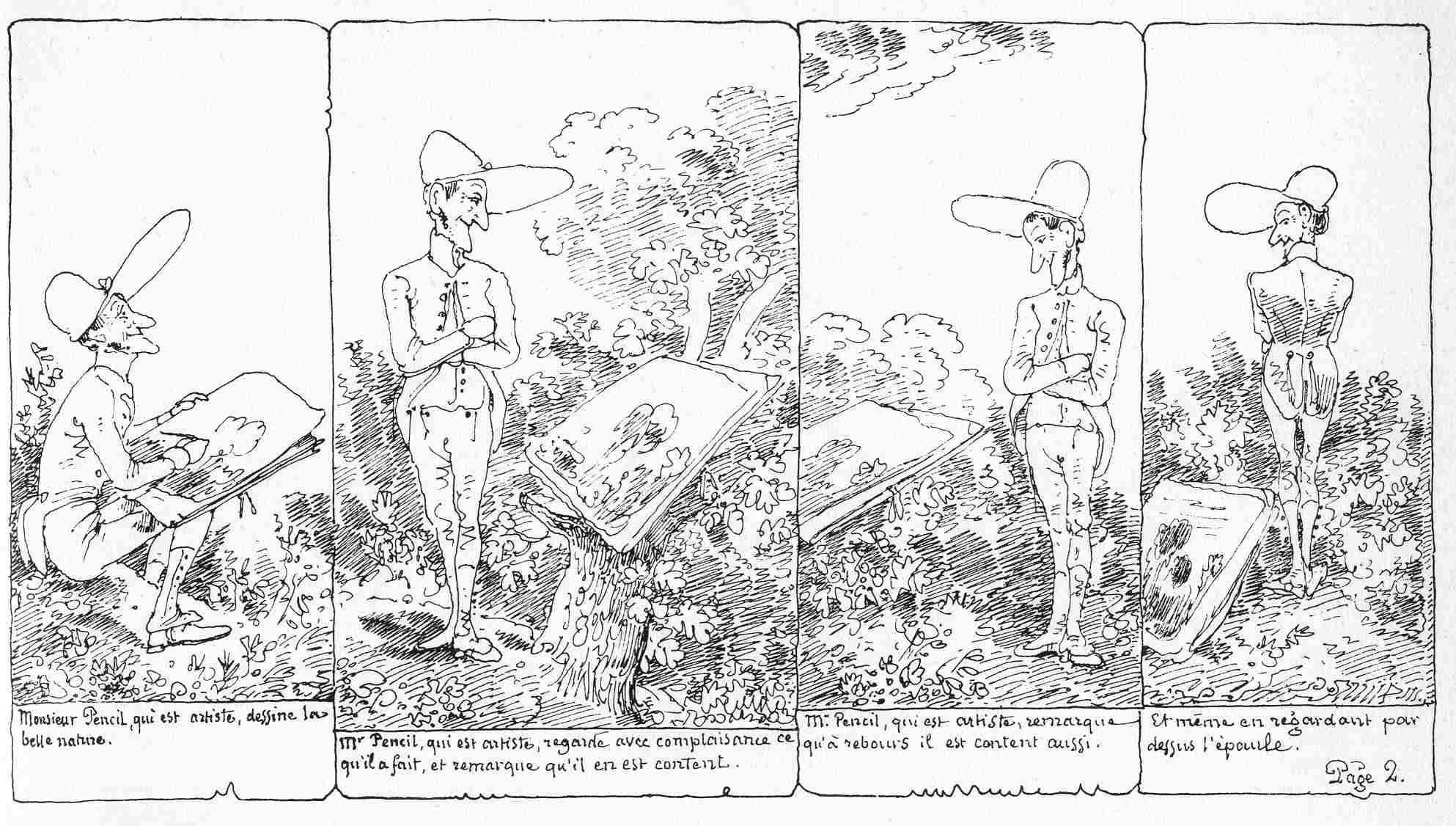
Image 1: Rodolphe Töpffer, Mr. Pencil, 1840, page 1. Autographie. Coll. privée.
A travers leurs récits, qui naissent de l’entrelacs du texte et de l’image, dessinateurs et scénaristes de bande dessinée, animés depuis une quarantaine d’années d’une ambition esthétique nouvelle, ont néanmoins produit des œuvres qui ont renouvelé les constructions narratives, les choix graphiques et leurs modes d’inscription dans la culture d’aujourd’hui (Ory 2012). Il s’agit certes d’un univers extrêmement diversifié: des mangas à la bande dessinée «artiste» ou d’«avant-garde», en passant par les graphic novels et une multitude de genres et de pratiques en dialogue avec d’autres médias ou arts, comme la littérature, la peinture, comme les arts de la scène (6e art), le cinéma (7e art), la télévision et la photographie (8e art). Il s’agit également d’un immense marché générant des millions, monopolisé en Europe par des éditeurs et grands groupes de presse comme Dargaud ou Hachette (aujourd’hui Lagardère), au sein duquel, paradoxalement, la majeure partie des auteurs (dessinateurs et scénaristes principalement) peinent à vivre de ce métier. Un monde, un «champ» diraient les sociologues dans la tradition bourdieusienne, qui s’est véritablement constitué dans les années 1970 avec des expositions (qui de plus en plus ont conquis des lieux légitimes), des revues spécifiques, des critiques spécialisés, des musées (à Angoulême, Bruxelles, Louvain…), des collections publiques, alors que les ventes aux enchères des «classiques» comme Hergé atteignent des sommets et que prolifèrent les festivals de par le monde (Boltanski 1975; Beaty 2007).
Des auteurs «complets»?
Mais qui sont effectivement les «acteurs» (les agents) de la bande dessinée aujourd’hui dans la francophonie? Ces œuvres collectives mettent le plus souvent aux prises un scénariste, un dessinateur, un éditeur. A ces trois instances qui pèsent de tout leur poids dans les choix esthétiques et commerciaux viennent s’ajouter le metteur en couleur, le calligraphe des textes et parfois le dessinateur de la couverture, qui n’est pas toujours le même que l’auteur des dessins de l’album.
Les qualificatifs employés pour désigner ces «acteurs» (qui ne jouissent pas du même degré de reconnaissance en tant qu’»auteurs»1) varient suivant leurs formations et sont implicitement l’objet d’enjeux et de positionnement professionnels (Maigret 1994). Le scénariste peut être également écrivain ou journaliste (parfois historien ou professeur d’université), tandis que le dessinateur peut être assimilé à un artiste proche du pôle beaux-arts ou plutôt à un graphiste, proche du pôle arts décoratifs. Les exemples d’autodidaxie ne sont pas rares dans cette population d’auteurs, tandis que l’essor de la bande dessinée en ligne et la multiplication des blogs portés par le genre du témoignage ou de l’autofiction, ont largement contribué à ce phénomène. Internet sert aux «auteurs» connus, reconnus ou consacrés à diffuser leur travail urbi et orbi (en amont ou en aval de l’édition d’albums) tandis que les nouveaux entrants utilisent l’écran pour se faire connaître, comme marchepied vers le marché de l’édition, l’album fonctionnant toujours comme un indice de notoriété, si ce n’est de qualité. La bande dessinée donne ainsi lieu à des «pratiques», des «métiers» qui, dans une minorité de cas, débouchent sur des «professions». Les acteurs quels qu’ils soient se retrouvent inclus dans une logique socioprofessionnelle obéissant à des principes de classements et de hiérarchies.
Un postulat classique de la sociologie des arts et des littératures est que les conditions matérielles et sociales de production des œuvres ne sont pas simplement des causalités «antérieures» à l’œuvre, à savoir un cadre, un décor, un contexte sur lequel se détacherait ou d’où émergerait l’œuvre. Les formes, les styles, les genres, les esthétiques sont également issus de positionnements liés à des postures spécifiques (par exemple une attitude cool, le tutoiement facile, un mode de s’exprimer souvent oral, décontracté si ce n’est familier, etc).
Dans le domaine de la bande dessinée, la répartition des tâches est apparemment claire. Elle est définie par des compétences acquises dans la plupart des cas à travers une formation spécifique (à l’écriture, au dessin, à la gestion commerciale). Comme œuvre mixte et le plus souvent collective, l’exercice de la bande dessinée favorise souvent les tandems (comme dans le cas de la série Astérix), même si certains cumulent ces compétences, que l’on songe à Philippe Geluck, l’auteur du Chat ou Greg, alias Michel Louis Albert Regnier, l’inventeur des aventures d’Achille Talon, qui fut dessinateur, scénariste, rédacteur en chef et directeur littéraire. Ce cumul et cette polyvalence sont caractéristiques d’une bande dessinée où jeux d’images et jeux de mots sont indissociables. Les doubles casquettes sont encore le propre du genre de l’autobiographie ou de l’autofiction qui reposent sur l’idée que l’intimité ou l’«authenticité». En principe, elles ne peuvent se raconter et se dessiner de manière «vraie» que par soi-même (Miller 2011; Turgeon 2010).
Le profil professionnel, les choix esthétiques ou de genres sont indissociables d’enjeux économiques et symboliques particuliers. En règle générale, on ignore les conditions contractuelles précises qui lient l’éditeur et le dessinateur ou le scénariste. Quels pourcentages de droits touchent-ils sur les ventes? sur la première édition? sur les éventuelles rééditions? sur les produits dérivés ou les adaptations? Dans le cas de Léna, on sait en tout cas que la participation aux bénéfices fut plus importante pour le dessinateur (André Juillard) que pour le scénariste (Pierre Christin), selon des critères ne reposant pas sur leurs «qualités» d’auteurs, mais plutôt sur le temps de travail effectif et leur investissement personnel (encadré 1).
Les enjeux symboliques (indissociables de ceux économiques) sont principalement corrélés à la notion ou la valeur d’auteur. Mais qui est l’auteur principal d’une bande dessinée comme Léna en termes de prédominance, de préséance ou d’antécédence? Ici (ceci indépendamment de la complicité ou de l’entente avérée des deux acteurs), le poids du dessinateur, une «star» dans le domaine, l’a emporté. Rares sont les scénaristes qui jouissent d’une reconnaissance ou d’une visibilité équivalente à celle d’André Juillard, même si Pierre Christin fait également figure de «star» parmi les scénaristes (Pierre Christin, 2020). Il n’empêche que la bande dessinée, produit iconotextuel par excellence, se vend principalement à travers l’image, qui lui assure sa visibilité et sa distinction dans un marché extrêmement concurrentiel. Ceci semble une évidence, mais elle pose problème dans le cas, par exemple, de romans graphiques adaptés de Flaubert, Proust ou Céline, qui ont occasionnellement provoqué des débats sur la légitimité de leur réécriture par l’image, de leur transposition ou de leur appropriation visuelle. Ces rejets s’appuient notamment sur la formule stigmatisante traduttore, traditore (le traducteur est un traître) dont l’une des occurrences anciennes et célèbres se trouve dans La Défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay (1549): «Mais que diray-je d'aucuns, vrayement mieux dignes d'estre appelez traditeurs, que traducteurs? veu qu'ils trahissent ceux qu'ils entreprennent exposer, les frustrans de leur gloire, et par mesme moyen seduisent les lecteurs ignorans, leur monstrant le blanc pour le noir.» 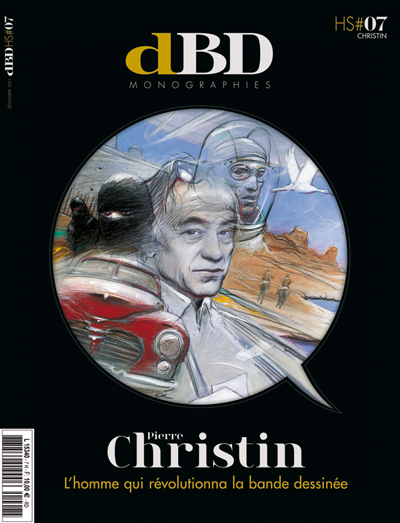
Image 2: «Pierre Christin. L’homme qui révolutionna la bande dessinée2»
La visibilité de l’artiste, la part de l’image dans l’œuvre, entre en conflit avec le prestige socio-culturel accordé à l’écriture à laquelle on associe depuis la Renaissance la conception, l’idée et l’intellection, tandis que l’image serait du côté matériel de la sensation ou du sentiment. Cet a priori fonde le mépris culturel dont a pâti la pratique de l’illustration, surtout depuis la fin du XVIIIe siècle, à partir du moment où les livres se mettent à se vendre grâces aux gravures, menaçant le monopole lettré et relançant l’adage italien précité. D’où la tentation du dessinateur et illustrateur de «faire l’auteur». Telle est l’expression qu’utilise J.-J. Grandville vers 1845, lorsqu’il réunit ses esquisses et dessins originaux destinés à l’illustration des Fables de La Fontaine, illustrées de gravures sur bois dite de reproduction, en 1838. Il fait précéder l’album unique recueillant ses dessins d’une lettre-préface manuscrite dans laquelle il explique son travail graphique et affirme son intelligence du texte (Kaenel 2005).
Un siècle et demi plus tard, André Juillard, qui a travaillé avec de nombreux scénaristes, s’est affirmé comme auteur à travers une remarquable bande dessinée, Le Cahier Bleu,publié dans un premier temps en 1993-1994 dans la revue (À Suivre) (Lavanchy 2007). Il s’est assimilé par ce biais à ceux qui sont parfois qualifiés des auteurs «complets» (comme Töpffer); une expression problématique car elle induit que la complétude du métier de dessinateur serait nécessairement dépendante de sa capacité à tenir également la plume.
Tirer la couverture
Dans cette économie symbolique, les couvertures occupent un espace de représentation particulièrement sensible. Quel nom faire figurer en haut, en bas, en grand, avant ou après, et dans quelle typographie? Dans le cas de Léna, le scénariste et le dessinateur sont placés de part et d’autre du titre, en haut. A travers la typographie, la couverture affirme par ce biais l’égalité auctoriale des deux protagonistes. 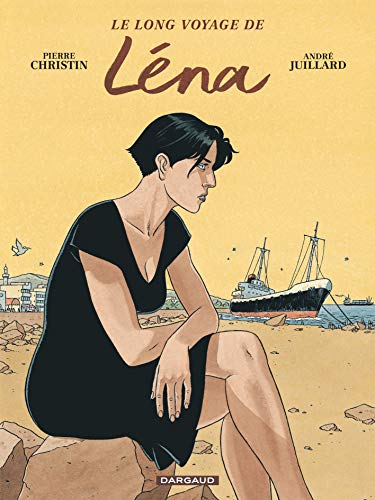
Image 3: Le Long Voyage de Léna, couverture © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Cette situation binaire peut occasionnellement se complexifier lorsqu’un tiers apparaît: l’illustrateur «externe», mandaté par l’éditeur le plus souvent. Juillard, victime de cette imposition à ses débuts, se rappelle de la décision prise par Jacques Martin de ne pas retenir sa couverture pour un volume des aventures d’Arno, ceci pour des raisons probablement commerciales, préférant la confier au dessinateur sous contrat pour la suite, Jacques Denoël (Jans 1996, p. 34). L’ironie du sort et la logique des carrières veut que Juillard, ayant acquis la réputation qu’on lui connaît, sera lui aussi sollicité en externe pour exécuter des couvertures d’albums dont il n’est pas le coauteur.
A propos de la couverture comme affichage du crédit des deux auteurs, Pierre Christin a souligné, dans un entretien avec Gilles Ratier, en 1994, la différence générique (dans les deux sens du terme) entre une œuvre cinématographique et une bande dessinée. Tout en soulignant l’égalité de statut des créateurs, de la plume et du crayon, le scénariste reconnaît le poids prédominant du dessin par rapport au texte:
[…] les rapports entre le metteur en scène et le scénariste n’ont rien à voir avec ceux existant entre le dessinateur et le scénariste: le metteur en scène est le seul maître à bord, car faire un film c’est comme lancer un transatlantique, il y a des types à la plomberie, dans les soutes, en train de ramer, à la passerelle… C’est monstrueux ! Alors qu’en bande dessinée, quoi qu’on en dise, si le scénariste et le dessinateur ont leur nom en lettres de taille égale sur la couverture d’un album, ce n’est pas un hasard; c’est quand même quelque chose qui se fait à deux et le rôle du scénariste n’est pas inférieur à celui du dessinateur, même si le meilleur des scénarios illustré par le plus mauvais des dessinateurs donne forcément un mauvais résultat, alors que le meilleur des dessinateurs est capable de métamorphoser un assez mauvais scénario3.
Les œuvres de bandes dessinées résultent ainsi de ce dialogue antérieur, interne, fait de défense de territoires, d’empiètements et de complicités, de spécificités mais aussi de compétences partagées ou doubles qui font sortir les acteurs de leur rôle et peuvent occasionnellement générer des tensions, notamment lorsque le dessinateur intervient sur le scénario. On sait, par exemple, que Juillard a occasionnellement coupé les textes de Jacques Martin, qu’il juge trop bavard. Inversement, il arrive que le scénariste empiète à son tour sur les prérogatives du dessinateur; par exemple lorsque Martin donne à Juillard les pages avec le découpage et le crayonné (l’esquisse préalable, le script visuel) qu’il doit suivre ou adapter, le «jeune» dessinateur devant «faire du Martin» contre son gré… Il est intéressant (et logique) de constater qu’une fois reconnu comme dessinateur et comme auteur, Juillard, assumera volontairement cette posture d’imitateur lorsqu’il reprendra les aventures de Blake et Mortimer d’Edgar P. Jacobs, avec d’autres, à partir de 2003 (Sente 2008).
En résumé, la plupart des albums de bandes dessinées sont des œuvres collectives résultant de relations de travail, de négociations qui peuvent reposer sur des liens de complicité étroits, comme dans le cas de Pierre Christin et André Juillard. Mais qui sont ces deux auteurs? comment s’est établie leur collaboration dans le cadre des aventures de Léna? Nous bénéficions d’une documentation exceptionnelle pour éclairer ces questions: les archives personnelles, généreusement transmises par les auteurs (script, scénario, crayonné, photographies), complétées par des entretiens, conduits à la suite d’une Masterclass à l’Université de Lausanne et d’une exposition organisée en 2012 dans les espaces de la Bibliothèque municipale de Lausanne qui, pour rappel, conserve la seconde plus importante collection de bandes dessinées en Europe.
Le corps dédoublé de Léna
Interrogés au moment de la parution du troisième volume des aventures de l’héroïne, André Juillard et Pierre Christin reviennent sur leur collaboration et leurs points de vue respectifs dans un entretien publié sur le site de l’éditeur Dargaud le 20 janvier 2020:
Dix ans après Léna et les trois femmes, vous avez pris plaisir à la mettre en scène une nouvelle fois?
André Juillard: J’aime sa personnalité, sa vulnérabilité et sa force. Dans cet album, elle a tourné la page de son drame personnel et assume son rôle avec énergie. Léna est une femme compétente et sérieuse. Et, mine de rien, elle observe toujours ce qu’il se passe autour d’elle. Elle est plus tournée vers l’action, même s’il n’y en a pas beaucoup dans cette histoire...
À ce propos, il paraît que vous avez râlé en découvrant le scénario...
AJ: J’ai dit à Pierre que j’avais envie de scènes d’action afin que Léna utilise ses compétences physiques. C’est une nageuse de bon niveau, elle aime la compétition... Quand j’ai reçu la première version, j’ai constaté que l’histoire se déroulait dans un lieu clos ! Les scènes d’intérieur, ce n’est pas ce que je préfère dessiner... Je lui ai suggéré de modifier le scénario. Les passages dialogués pouvaient très bien être situés à l’extérieur. Il a tenu compte de mes désirs: dans l’album, Léna monte à cheval, elle pratique le ski de fond et elle participe à une chasse.
Pierre, qu’est-ce qui vous motive dans les aventures de Léna?
Pierre Christin: Elles me permettent de faire entrer ce Moyen-Orient en pleine crise dans la bande dessinée. Je me suis longtemps intéressé aux différents aspects du système communiste, mais les enjeux géopolitiques se situent désormais ailleurs.
Pourquoi nous avoir fait patienter dix ans depuis le précédent album?
PC: J’avais envie de revenir à cette série car j’avais l’impression d’être resté au milieu du chemin, mais il me fallait attendre qu’André en ait terminé avec Blake et Mortimer. Je suis un gars patient, j’ai donc attendu une dizaine d’années... Ce qui m’a obligé à modifier le scénario à plusieurs reprises, car je tenais à ce qu’il entre en résonance avec l’actualité immédiate.
Il y a plus de dialogues que dans les albums précédents, qui faisaient plutôt la part belle aux récitatifs...
PC: Dans la plupart des films et des séries venus des États-Unis, les Arabes sont des salauds. En somme, ils ont remplacé les communistes... Je tenais à ce qu’ils soient présentés ici comme des gens honorables. Ils défendent leur pays, mais ils peuvent aussi faire preuve de générosité. C’est pour cette raison que j’ai laissé plus de place aux dialogues, afin de permettre à ces personnages d’expliquer leurs motivations au lecteur4.

Image 4: André Juillard, Esquisse pour la couverture du Long voyage de Léna, 2005. Archives André Juillard. © André Juillard
Ce bref échange est riche d’enseignements. En premier lieu, il trahit ce que l’on pourrait appeler un «syndrome de Pygmalion»: tant le dessinateur que l’écrivain se sont épris de l’héroïne à laquelle ils ont donné vie sur le papier. On apprend ensuite que l’œuvre en question est le résultat d’échanges discontinus sur une dizaine d’années, dépendant de la disponibilité des deux auteurs. Le projet a évolué non seulement en relation avec l’ancrage de l’histoire dans une actualité politique internationale mais encore selon les priorités et les goûts du dessinateur et du scénariste, le premier aimant le plein air et appréciant de montrer le corps sportif (et parfois dénudé) de Léna, le second privilégiant les huis-clos, selon une logique psychologique et spatiale modélisée par le film policier. On y découvre enfin, entre les lignes, un scénariste volubile (il se reconnaît volontiers bavard) et un dessinateur dont la prise de parole est certes précise, mais moins présente, comme si se rejouaient dans l’entretien leurs postures professionnelles: celles de l’homme de langage et celle de l’homme d’images.
Deux mots sur Pierre Christin
Pierre Christin est présenté (et se présente) comme un écrivain et un scénariste (les notices Wikipédia servent de marqueurs à ce sujet). Né en 1938, il étudie à la Sorbonne et à Sciences Po, qui se déclare «université de recherche internationale, sélective, ouverte sur le monde, qui se place parmi les meilleures en sciences humaines et sociales5». Il y soutient une thèse de doctorat en littérature intitulée Le fait divers, littérature du pauvre: une étude d'un type de récit littéraire. Pianiste de Jazz à ses heures, journaliste, traducteur, il se rend en 1965 aux Etats-Unis, à Salt Lake City, où il enseigne la littérature française et retrouve un ami d’enfance, Jean-Claude Mézières. Il débute avec lui dans la bande dessinée en adressant au journal Pilote une première histoire, celle de Valérian et Laureline (Les Mauvais Rêves, 1967). Nommé l’année suivante à l’Université de Bordeaux, il donne un enseignement qui sera à la base de l’école de journalisme, aujourd'hui IJBA, première école de journalisme publique de France. Christin a raconté son parcours de manière enjouée sur le site booknode.com (encadré 2).

Image 5: «Entretien avec Pierre CHRISTIN6»
Couvert de prix et d’honneurs, devenu grand professionnel du scénario de bandes dessinées, il demeure néanmoins un personnage singulier dans ce métier. A diverses occasions, l’écrivain est revenu sur cette question, notamment lors d’un dialogue avec le public en 2003 (encadré 3) ou plus récemment dans un entretien inédit à son domicile parisien en 2012 (encadré 4).
Les Aventures de Léna occupe une place exemplaire dans l’œuvre de Pierre Christin, à la croisée entre le registre de l’enquête journalistique, son goût du roman policier et sa passion du tourisme (en particulier de la photographie de voyage). Il est à noter qu’à ses yeux «La BD n’est pas à proprement parler de la littérature»; «Le scénariste n’écrit que la partie d’un tout qui n’existe pas encore»; «L’art de la BD est avant tout l’art du découpage». On pourrait ajouter: «un art du sacrifice» au sens que la théorie de l’art (et notamment Eugène Delacroix) accordait à l’expression. En effet, le peintre (à la différence du photographe travaillant en analogique) a la capacité de choisir, d’accentuer ou d’atténuer les composantes de la représentation afin de produire l’effet voulu. C’est ce qui s’appelle «faire œuvre», mais à quatre mains (au moins) dans le cas de la bande dessinée.
Deux mots sur André Juillard
André Juillard est né en 1948 à Paris. Il est présenté (et se présente) comme dessinateur et scénariste de bandes dessinées sur Wikipédia. Il a assis sa réputation grâce à une série d’albums scénarisés par Patrick Cotias, dont l’histoire se passe sous Henry V, Les Sept Vies de l'Épervier (1994-1998). Dans les mêmes années, il écrit et dessine un diptyque, Le Cahier bleu, qui paraît d’abord dans le journal (A suivre) et reçoit le Grand prix de la Ville d’Angoulême en 1996. Il reprend dans les années 2000 le dessin des aventures de Blake et Mortimer de Jacobs et entreprend en 2006 Le Long Voyage de Léna, puis en 2009 Léna et les trois femmes, suivi, après une pause de dix ans, par Léna dans le brasier, en 2020.

Image 6: André Juillard dans son exposition de dessins originaux à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges7
Une double page illustrée intéressante dans le journal Lire, durant l’été 2011, montre le dessinateur chez lui, dans ce qui est son «atelier8 «: une table de travail; des dessins et des livres partout («Je ne suis peut-être pas un historien mais j’aime me documenter», confesse-t-il), ainsi qu’une collection de modèles réduits («Jamais un livre ne saura vous rendre la vue globale d’une voiture ou d’un avion»). On y apprend que son projet était d’être illustrateur: «Mon père était bibliophile et avait de très beaux ouvrages dans sa bibliothèque. Mon rêve était alors de les illustrer. Mais au moment où je suis arrivé en âge de travailler, le métier n’existait plus ! C’est pourquoi je me suis rabattu sur la bande dessinée». Il avoue également qu’il rechigne à utiliser l’ordinateur (nous sommes en 2011) «lui préférant un porte-plume en bois de son enfance, des pinceaux Raphaël, des crayons «2B, un peu gras». Puis il s’empresse de montrer ses carnets de croquis «constellés de splendides nus féminins», comme le relève le journaliste, Julien Bisson, qui s’entend dire: «Toutes ont un air de parenté, sans doute parce qu’elles ressemblent inconsciemment à ma femme». En effet, à l’instar de Léna, les figures féminines occupent une place centrale dans son œuvre graphique.
Dans plusieurs entretiens, Juillard a témoigné de sa pratique documentée de la bande dessinée, comme en 2001, dans le site bdparadisio où l’on peut lire:
La documentation, ça vient avant toute chose en fait ! Quand on fait une bande dessinée historique, c'est vital. Même pour une histoire contemporaine, d'ailleurs. Pour «Le Cahier Bleu», j'ai pris mon appareil photo et mon vélo puis je suis allé visiter certains lieux que j'avais déjà plus ou moins repérés dans Paris, j'ai fait des repérages comme au cinéma. Je me suis dit: mon héroïne va habiter ici, j'ai essayé de regarder un peu quel genre de paysage elle pouvait avoir de sa fenêtre, etc.9
Interrogé sur le passage des croquis préparatoires, caractérisés par un crayonné dynamique, à une «écriture» faite de lignes épurées, le dessinateur répond:
Je crois que je suis très attaché à la technique de base de la bande dessinée, celle de nos ancêtres Hergé, Jacobs, Franquin même… c'est-à-dire le cerné noir à l'encre de chine. J'ai du mal de ce fait à garder la vitalité que vous dites trouver dans mes croquis […] ma passion pour la BD me ramène toujours vers cette espèce de tradition alors que la bande dessinée évolue. […] La lisibilité, c'est la première chose qui doit exister dans une bande dessinée. C'est l'élément essentiel, à mon point de vue. Dans le phénomène particulier à la bande dessinée qui est cette association d'un texte et d'une image, si l'image est trop compliquée, on va lire le texte mais on va peut-être être obligé de s'arrêter sur l'image parce qu'elle n'est pas évidente. Ça va nuire à la fluidité de la lecture.
Nous reviendrons sur cette transformation du crayonné en dessin à la plume sur la page des albums. Retenons pour l’instant l’image du dessinateur précis, documenté, héritier de la ligne claire, loué pour ses décors, mais aussi ses constructions (ses cadrages) et surtout pour ses figures (ses nus féminins): un auteur parfois «complet» (dans le cas du Cahier bleu), qui aquarelle les dessins quand il le peut, comme dans le cas de Léna, au contraire de Blake et Mortimer.
Histoire d’une collaboration: la passion documentaire
Un entretien inédit à l’Université de Lausanne en 2012 donne des informations sur la fabrication du diptyque (devenu triptyque depuis lors) et la collaboration des deux auteurs avec l’éditeur. Il nous fait entrevoir l’ «atelier» d’une bande dessinée. C’est fort d’une relation ancienne et connaissant l’intérêt du dessinateur pour les figures féminines que l’écrivain lui taille sur mesure l’histoire de Léna. Face à deux auteurs reconnus, l’éditeur se voit, lui, en «premier lecteur» et «accompagnateur». Et Juillard d’acquiescer: «L’éditeur, c’est vrai qu’il ne peut pas imposer à l’auteur de faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire». Mais c’est avec lui qu’il incite Christin à rendre la bande dessinée moins «silencieuse» et par conséquent plus dense et moins vite lue: de là serait née l’idée du monologue intérieur de l’héroïne qui fait d’elle l’une des instances de la narration (encadré 1).
La complicité exceptionnelle et l’admiration réciproque sont déclarées à de multiples reprises par les deux auteurs. Pierre Christin confirme dans un entretien de 2001:
Depuis longtemps j’admirais la sérénité du dessin d’André, la douceur de ses couleurs, la délicatesse de ses portraits et, en même temps, la rigueur narrative très classique de son récit. Alors, quand il m’a laissé entendre qu’il aimerait peut-être travailler avec moi, je me suis enfermé avec mon ordinateur et, passionnément, j’ai écrit le premier jet du Long Voyage de Léna, du «sur-mesure», comme je le fais toujours, puisque ce n’était destiné qu’à André et à lui seul. Dire que le résultat ne m’a pas déçu serait un euphémisme. Nous avons même été si heureux de notre collaboration, André et moi, que nous pensons déjà lui donner une suite.
Dans un autre entretien le scénariste soulignait ce respect mutuel reposant entre autres choses sur une claire répartition des compétences et des interventions. Ils font preuve d’une capacité d’écoute mutuelle qui les prédispose à reformuler leur travail pour répondre aux attentes ou désirs du partenaire. Christin se plaint par contraste de Jean-Claude Mézières, dessinateur de Valérian, qui «demande régulièrement des modifications du scénario pour mieux se l’approprier» (encadré 5).
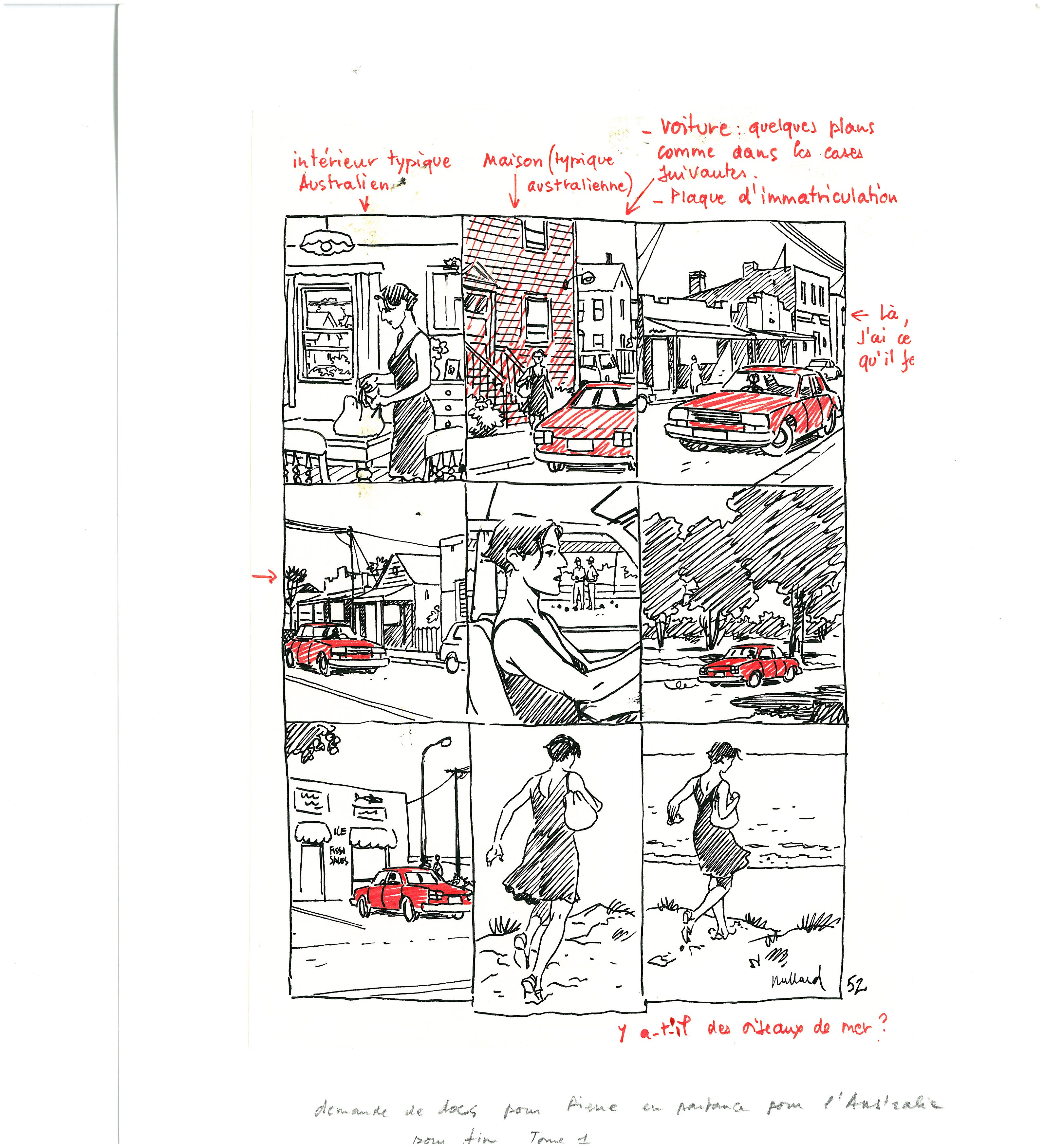
Image 7: Storyboard, planche 52 © André Juillard & Pierre Christin 2005
Les deux auteurs du Long Voyage de Léna s’accordent également sur un plan central: leur goût partagé pour la documentation, pour la vraisemblance des personnages, des décors et des lieux. Certes, toute bande dessinée est aujourd’hui basée sur du matériel documentaire, même dans le genre où prédomine l’imagination comme le domaine de la science-fiction. Dans le cas de Léna toutefois, le parcours topographique du récit a exigé du scénariste une série de voyages dont les traces sont conservées dans des carnets de notes et des albums photographiques. Les clichés de Christin alternent des sites ou des lieux qui indexent le récit dans une géographie référentielle et d’autres lieux qu’à la suite de l’anthropologue Pierre Augé on qualifie de «non-lieux», soit des espaces interchangeables où l’individu reste anonyme: moyens de transport, aires d’autoroute, grandes chaînes hôtelières, autant d’espace avec lequel on noue des relations de consommation non identitaires ou historiques (Augé 1992).
Image 8: Pierre Christin, photographie. Archives Pierre Christin © Pierre Christin
Image 9: Le Long Voyage de Léna, page 33 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Le voyage est l’élément central du récit, comme l’indique le titre de l’album. Cependant, à la différence des traditionnels héros de bande dessinée itinérants qui, à l’instar de Tintin, se déplacent en suivant des pistes, en résolvant des énigmes, Léna avance à tâtons. Elle ignore parfois où elle doit se rendre, et comment s’y rendre, de même que la nature de sa mission reste cachée pour elle et le lecteur. En même temps, au fil de cette itinérance à la fois organisée et errante, Christin comme Juillard jouent sur les stéréotypes du récit de voyage littéralement véhiculé grâce à un éventail de modes de déplacement, de la marche à l’avion, en passant par la voiture, le bateau, le bus ou le train. Occasionnellement, la photographie est mise en abîme dans l’album, en noir et blanc, redessinée, avec pour sujet non des lieux, mais des personnages.
Image 10: Pierre Christin, photographie. Archives Pierre Christin © Pierre Christin
Image 11: Le Long Voyage de Léna, page 32 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Le long voyage de Léna se déroule dans la géographie des pays de l’Est à la fin de la guerre froide. Mais c’est aussi un voyage intérieur, mélancolique, une sorte de rédemption, une manière pour l’héroïne, dans le présent de l’action, de régler la question des fantômes du passé qui la hantent: un travail de deuil impossible, ce qui explique la présence de la photographie en leitmotiv du mari et du fils de Léna décédés dans un attentat. L’imbrication entre la documentation, l’écriture et le dessin est décrite par Christin au fil de l’entretien précité, le scénariste étant non seulement celui qui a photographié, qui a vu, qui écrit, qui décrit, mais aussi celui qui se plaît à imaginer, à prévoir, à rêver le dessin à venir (encadré 6).
Du dessin à la page: le dessin dans la page
Léna est fille de dessinatrice, illustratrice d’ouvrages de sciences naturelles. Elle a une formation d’historienne de l’art. Elle jouit également d’une excellente mémoire visuelle et «photographique» comme le montre une page du second album, Léna et les trois femmes, où se trouvent «projetées» dans la case les photographies mémorisées de trois personnages qu’elle rencontre (p. 22). On apprend à la page 38 seulement qu’elle s’appelle Hélène Desrosière et l’on comprend que le noir qu’elle porte exclusivement est celui du deuil de son mari et son fils. Dans le cadre de sa mission, elle dessine des figures qui sont ses contacts, mais aussi quantité de sujets anecdotiques pour jouer au touriste et à l’amatrice. A un moment donné, son contact turc feuillette le carnet et déclare en voyant une tête de profil: «C’est qui ce barbu? Il n’est pas des nôtres», Léna répond: «J’ai dessiné des gens et des choses que j’ai vus pendant mon voyage. J’ai pensé arracher ces pages, mais c’est plus crédible comme ça» (p. 32).
Le crayonné «original» de Juillard, se trouve non seulement reproduit mais encore mis en abîme par cette astuce dans la fiction bédéique. Le dessin en question figure un pilote de bateau, clope au bec, qui, en fait, semble s’inspirer directement d’une copie à la mine de plomb et crayons de couleurs par Juillard d’un portrait de Vittore Carpaccio (1465-1525/26), présenté lors de l’exposition des œuvres d’André Juillard au Musée Ingres en 1988. Autrement dit, un dessinateur met en images dans un récit une femme historienne de l’art et dessinatrice, qui tire le portrait d’un personnage de fiction, inspirés par l’histoire de la peinture italienne de la Renaissance, et exposé par ailleurs dans le musée de l’artiste, Ingres, qui est le parangon du dessin aux yeux de l’historiographie…
Image 12: Le Long Voyage de Léna, page 30 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Image 13: Le Long Voyage de Léna, page 21 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007

Image 14: André Juillard, Carpaccio10
L’intrigue du Long voyage de Léna n’est pas que policière: elle est photographique et surtout graphique. Ces jeux d’images, de supports et de reproduction et l’insertion «en contrebande», narrativisé, du crayonné de Juillard sont en fait une idée de Christin (encadré 6). Il s’agit de représentations de représentations qui visent à produire un effet de réel au sein de la fiction. Le lecteur «voit» en effet les personnages dont Léna regarde les reproductions dans l’espace diégétique de l’action, de la fiction. Certaines photographies redessinées sont parfois exhibées, ainsi lorsque l’un des commanditaires de la mission de Léna lui montre en photographies des agents, le lecteur-spectateur étant placé frontalement dans la position et le point de vue de Léna (p. 40).
Image 15: Le Long Voyage de Léna, page 40 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Dans le récit graphique, les cadrages, les points de vue, les jeux de regards (anecdotiques, évités, croisés, insistants jusqu’au «regard» caméra, les instruments d’optique (jumelles, lunettes et surtout miroirs) sont autant d’instruments et de dispositifs qui renforcent les ambiguïtés de la position de l’héroïne, ses deux identités, son histoire passée et présente: en un mot, sa fonction d’agent double. Cette logique omniprésente de la duplication graphique est mise en intrigue dans la double page 46-47. On y voit Léna dans un avion tandis qu’au Moyen-Orient les terroristes se rendent sur les lieux de l’attentat. Le centre des deux pages est occupé à gauche par une représentation de Léna assise dans la cabine et à droite, en miroir, par un autoportrait de Léna qui figure dans son carnet de dessins regardé par l’un des terroristes: un pseudo-autoportrait qui regarde également le lecteur-spectateur dans une relation spéculaire redoublée, qui exprime la duplicité de Léna et sa double personnalité.
Image 16: Le Long Voyage de Léna, page 47 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
André Juillard et le «grand art»
De père vétérinaire, et de grand-mère directrice d’école, le jeune André Juillard se rend occasionnellement au Louvre avec sa mère qui soutient sa passion du dessin. Il débute des études de médecine en 1968 à Lyon, mais abandonne après deux ans pour se tourner vers la bande dessinée et des études aux Arts Décoratifs en 1973. Il est affilié au Syndicat des dessinateurs de presse. La consécration vient en 1984 avec le premier des Cahiers de la Bande dessinée qui lui est dédié, sous la direction de Thierry Groensteen. Elle prend en particulier la forme d’un article de Jacques Martin (1921-2010) intitulé «André Juillard, l’héritier», qui l’ «adoube» en en faisant le représentant majeur de l’ «école de Bruxelles». Il le compare à un autre dessinateur, Paul Cuvelier, qui appartient à la «grande tradition classique»; «en découvrant les dessins de Juillard, je songe aussitôt à David, Ingres ou Devéria, et point du tout à une vedette ancienne ou moderne de la bande dessinée», déclare l’auteur des aventures d’Alix et de Lefranc.
Image 17: Jacques Martin, «André Juillard, l’hériter11» © Glénat
A l’instar de Martin, Juillard s’est souvent référé au grand art, comme dans une interview reprise dans le blog d’André Juillard: «je ne me suis jamais dit je serai Cuvelier ou rien. Du reste, enfant, je ne rêvais pas de devenir Hergé ou Jacobs mais Delacroix ou Rembrandt»12. Ici, Juillard ne mentionne pas Ingres, avec lequel il entretient pourtant des relations complexes. Ses dessins au crayon, en particulier ceux exposés dans une exposition monographique au Musée Ingres en 1988, témoignent d’une volonté de faire «académique». Au sens premier, une «académie» est un nu réalisé en institution; c’est d’ailleurs le titre de l’exposition/vente personnelle à la Galerie du 9e Art à Paris en 2011. La relation au peintre français s’étoffe lorsque l’on regarde l’autoportrait dessiné de Juillard sous les traits de son héros, Arno, traité comme un pastiche d’Ingres et reproduit dans les Cahiers de la Bande dessinée en 1984.
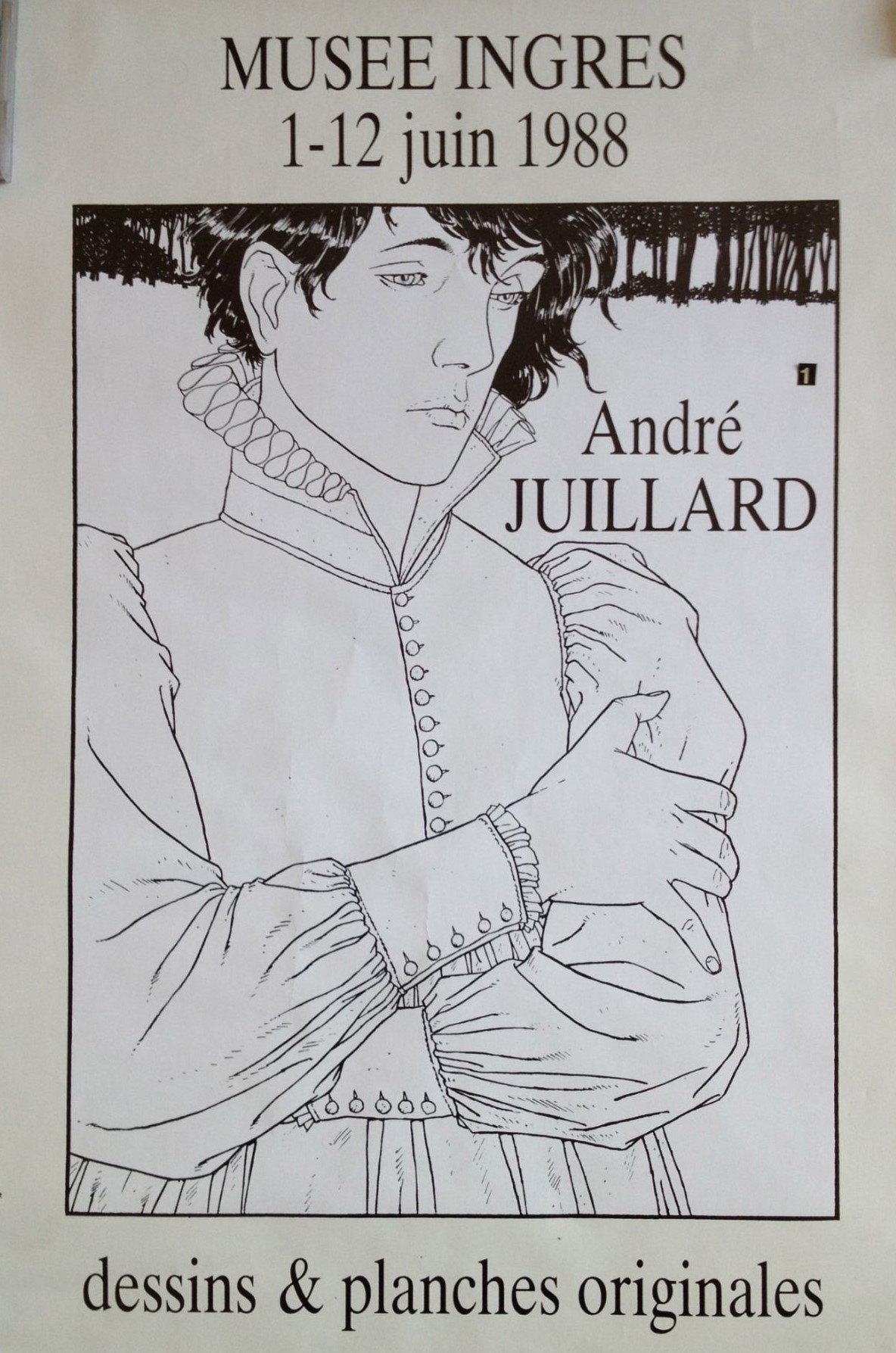
Image 18: André Juillard, Portrait d’Arno11© André Juillard
Image 19: Exposition 14 © André Juillard
Dans ce même cahier 56, un article du grand spécialiste de la bande dessinée, Thierry Groensteen, intitulé «Profil d’une carrière», note que le succès du dessinateur fut tardif et fait suite à un changement d’éditeur (de Fleurus à Glénat) et à la publication d’un premier album en 1977, passage devenu obligé dans la reconnaissance. L’auteur y fait l’éloge de la variété, de l’humilité, de la patience méthodique, de l’apprentissage, soit du métier qui est celui de Juillard, avant de conclure significativement: «L’artisan est devenu artiste».
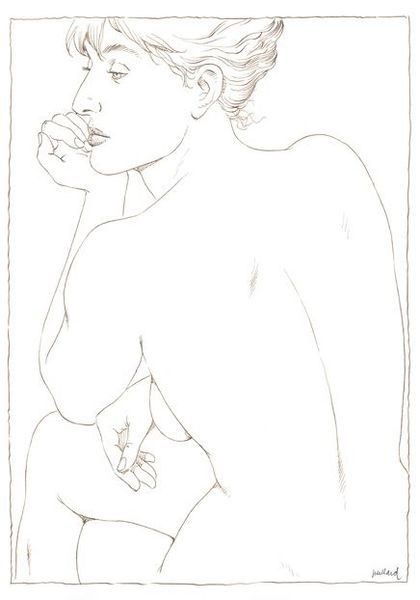
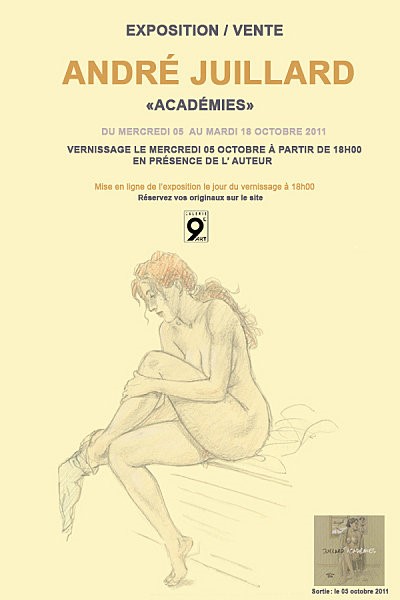
Image 20: André Juillard, Nu de Dos15
Image 21: Affiche de l’Exposition / Vente André Juillard16
Les dessinateurs de bandes dessinées restent néanmoins des artistes d’un type particulier. Ils exposent et vendent leurs tirages de tête ou leur dessins originaux dans les circuits et les galeries consacrés au genre. Cette relégation dans un marché parallèle exprime une forme de domination symbolique qui se lit d’autant plus fortement dans les discours, tenus par l’artiste comme par ses critiques, sur les qualités du crayonné de Juillard, comme si l’esquisse première, non destinée à un usage «commercial», contenait la «première idée» du dessinateur: une dimension autographe survalorisée dans le marché des arts graphiques, comme si Juillard était plus artiste en faisant du crayonné qu’en pratiquant la ligne claire… Interrogé sur le succès de la bande dessinée sur le marché de l’art, Juillard répond en ces termes en 2011:
Moi, cela ne me choque pas.Mais dans la mesure où tout est art, pourquoi la BD ne le serait pas? On dit que c’est le 9ème art. Je trouve que les meilleurs artistes de BD sont largement au niveau des artistes des temps passés. J’ai vu certaines œuvres d’artistes des temps passés qui étaient à la limite de la médiocrité. Je dis cela de mon point de vue. Par exemple, tout ce qui a été peint au 17ème siècle n’a pas à être considéré comme étant des chefs d’œuvres. Et il me semble que dans la BD, il y a une sorte de sélection de tout ce qui sort et elle ne palie pas [sic]par rapport à ce que l’on peut voir ailleurs. En BD, comme dans tout, que ce soit en littérature. En peinture. En musique. Il y a le meilleur et il y a le pire. Et là c’est plutôt quand même du tout bon (rires)17.

Image 22: André Juillard dessinant18
Récemment, en 2020, Juillard a publié une sélection de ses Carnets secrets 2004-2020. On y trouve toute sorte de sujets: des nus bien sûr et des dessins inspirés des maîtres formant son musée imaginaire, comme Ingres, Klimt, Watteau, Simon Vouet, Vuillard ou encore des photographes comme Helmut Newton dont les nus sont les exacts homologues de ceux crayonnés par Juillard. Cette publication reprend un court texte de l’auteur qui donne sa profession de foi en introduction à un volume antérieur, les 36 vues de la Tour Eiffel (Christian Desbois Editions, 2002). Cet album de Juillard est un hommage centenaire à celui, lithographié en couleurs, du graveur Henri Rivière, et découvert une vingtaine d’années plus tôt par le dessinateur. Les gravures de Rivière sont à leur tour inspirées par les Trente-six vues du mont Fuji, gravées sur bois par Hokusai entre 1830 et 1833. Le recueil d’aquarelles paysagères de 2002 par Juillard est composé de vues réelles; d’autres reproduisent des objets représentant la tour Eiffel (de l’affiche au tee-shirt); d’autres enfin sont imaginaires et inspirées d’œuvres célèbres mêlant De Chirico à Hergé, Jacobs ou Kertész. Voici donc la profession de foi de Juillard reprise dans cet album d’hommage très particulier:
Les hasards de la vie, mes gènes, mon milieu, mes admirations et mes détestations ont fait qu’aujourd’hui je dessine comme au bon vieux temps avec un crayon de bois et graphite et m’escrime à reproduire la réalité au lieu de présenter des installations dans une galerie d’Art Contemporain […]. J’assume sereinement cet asservissement à la réalité. (Carnets secrets 2004-2020, 2020)
Rétrospectivement, et aussi anachronique que cela puisse paraître, on ne peut s’empêcher de trouver un côté bande dessinée à l’œuvre graphique de Rivière, revu à l’aune de la ligne claire, comme d’ailleurs le pourraient être les gravures sur bois de Hokusai.
Le conservatisme assumé de Juillard, sur le plan esthétique et technique, a pour conséquence de le rapprocher du monde des beaux-arts ou de ce que l’on appelle le «grand art» ou les «classiques». Il s’agit en fait de l’une des matrices du Long voyage de Léna. A un moment du récit, Léna traverse avec l’un de ses contacts un musée d’art en Ukraine (p.24-25). Elle passe devant le tableau imaginaire d’un peintre fictif, Lemonovitch, intitulé Staline et les deux enfants dont deux versions existeraient: l’une en Ukraine et l’autre à la Galerie Tretiakov de Moscou, sans que l’on sache laquelle est la copie de l’autre: deux œuvres identiques représentant deux enfants, face à Léna, un agent double.
Image 23: Le Long Voyage de Léna, page 24 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Le contact qui l’accompagne a ce commentaire qu’il faut lire comme un clin d’œil de Pierre Christin à André Juillard sur le plan de l’intrigue visuelle et peut-être comme une allusion à leur projet quatre mains: «Il faut qu’il en soit de même pour ce que notre petit groupe s’apprête à accomplir. Nous allons peindre un tableau dont personne ne saura attribuer la signature avec certitude, mais dont l’effet sera considérable».
Image 24: Le Long Voyage de Léna, page 25 (détail) © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Bibliographie
Augé, Marc (1992), Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil.
Beaty, Bart (2007), Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book in the 1990’s, Toronto, University of Toronto Press.
Bisson, Julien (2011), «André Juillard. Passeur d’Histoire(s)», Lire, p. 26-27. En ligne, consulté le 29 juillet 2021, URL: http://andre-juillard.over-blog.com/article-magazine-lire-andre-juillard-passeur-d-histoire-s-79508153.html
Boillat, Alain & Philippe Kaenel (2012), «Entretien avec Pierre Christin à son domicile parisien» (inédit)
Boltanski, Luc (1975), «La constitution du champ de la bande dessinée», Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, p. 37-59.
Bosser, Frédéric (dir.) (2020), Pierre Christin. Le grand rénovateur du récit en bande dessinée, Buhl, Caurette.
Collectif (1984), «Dossier André Juillard», Les Cahiers de la bande dessinée, n° 56, p. 4-36.
Collectif (1987), «Dossier Juillard», APJABD, n° 22, été, p. 17-36.
Collectif (décembre 2011), «Pierre Christin. L’homme qui révolutionna la bande dessinée», DBD. Les arts dessinés, hors-série, n° 7. En ligne, consulté le 3 août 2021,URL: http://www.sceneario.com/interview/entretien-avec-pierre-christin_CHRI.html
Groensteen, Thierry (1984), «Profil d’une carrière», Cahiers de la Bande dessinée, n° 58, p. 15-17.
Groensteen, Thierry & Benoît Peeters (1994), Töpffer. L'invention de la bande dessinée, Paris, Hermann.
Jans, Michel, Jean-François Douvry & Nadine Douvry (1996), Juillard. Une monographie, Saint-Estève, Mosquito, coll. «Bulles dingues».
Juillard, André (2020), Juillard. Carnets secrets 2004-2020, Paris, Éditions Daniel Maghen.
Juillad, André (1999), Pêle mêle. Monographie André Juillard, Chaumont, le Pythagore Editions.
Kaenel, Philippe (2005), Le métier d'illustrateur 1830-1900. Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Genève, Librairie Droz (réédition).
Lavanchy Éric (2007), Étude du Cahier Bleu d'André Juillard. Une approche narratologique de la Bande Dessinée, Louvain-La-Neuve, Bruylant-Academia.
Maigret, Eric (1994), «La reconnaissance en demi-teinte de la bande dessinée», Réseaux, n° 12 (67), p. 113-140.
Martin, Jacques (1984), «André Juillard, l’héritier», Cahiers de la Bande dessinée, n°56.
Miller, Ann (2011), «Autobiography in bande dessinée», in Textual and Visual Selves: Photography, Film and Comic Art in French Autobiography, N. Edwards, A. Hubbell & A. Miller (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 235-262.
Ory, Pascal, Laurent Martin, Jean Pierre Mercier & Sylvain Venayre (2012), L'art de la bande dessinée, Paris, Citadelles & Mazenod
Ratier, Gilles (2002), Avant la case: histoire de la bande dessinée francophone du XXème, siècle racontée par les scénaristes, Montrouge, PLG édtions.
Sente, Yves & André Juillard (2008), Dans les coulisses de Blake et Mortimer, Paris, Dargaud.
Tomblaine, Philippe (2018), Juillard: dessins d'histoires, Angoulême, Le Troisième Homme éditions.
Turgeon, David (2010), «Crise de l’autobiographie», Du9. En ligne, consulté le 3 août 2021, URL: http://www.du9.org/dossier/crise-de-l-autobiographie/
Annexes
Encadré 1: Entretien inédit d’Alain Boillat avec André Juillard et le directeur des éditions Dargaud, Philippe Ostermann, en 2012 à l’Université de Lausanne
Alain Boillat: Pourquoi Léna?
André Juillard: Un petit historique de Léna. Ça vient en fait d’un désir de collaboration entre Pierre Christin et moi-même, et vice versa, qui datait quand même d’il y a quelques années, puisqu’on se connaissait depuis une vingtaine d’années. Mais il se trouvait que lui comme moi avions des engagements par ailleurs; donc il fallait trouver un moment propice. Je l’ai trouvé un jour, je me suis trouvé en fait entre deux boulots, et il se trouve que j’ai déjeuné avec Pierre, et je lui dis: «Bon c’est peut-être le moment?» Il me dit: «Bon, ben je vais y réfléchir…». Et deux jours après, j’avais un synopsis, le synopsis de Léna, qui m’a tout de suite plu, parce que pour moi une histoire c’est les personnages. Si je ne peux pas m’attacher à des personnages, je ne fonctionne pas, ça ne m’intéresse pas. Et Pierre qui me connaissait bien a dégoté dans son armoire à malices un personnage féminin comme je les aime, c’est à dire complexe, tourmenté, ayant vécu. Et c’est ainsi qu’il m’a séduit. (…) Voilà comment est né Léna. Et Pierre m’a dit plus tard que c’est un personnage, enfin une histoire, disons, qu’il avait créé spécialement pour moi, parce qu’il me connaissait; il connaissait mes désirs, le genre d’histoires que j’avais envie de raconter, enfin de mettre en scène. (…) J’étais touché, à la fois par cette histoire, mais aussi par la sensation que Pierre me connaissait bien. C’est quelque chose d’assez émouvant en fait. Bon, voilà la genèse de Léna.
AB: C’est-à-dire aucune intervention à ce stade-là de l’éditeur?
Philippe Ostermann: Non ! aucune, non, non ! Mais euh !
AB: C’est fréquent que ça se passe comme ça?
PO: Quand c’est André Juillard et Pierre Christin, oui ! Après, on peut dire: «Cette histoire je la sens bien et j’ai envie de l’éditer ! Ou au contraire, ben non ! Je pense qu’il y a des trucs qui fonctionnent pas !» Mais au départ c’est une rencontre d’auteurs. Ce sont des auteurs majeurs, qui ont déjà derrière eux une carrière importante, voilà. Donc, dans ce cas-là on est un peu en retrait. Et le job de l’éditeur il s’adapte aussi aux auteurs avec lesquels on travaille. […] on est un accompagnateur et on est le premier lecteur. Alors, dans le cas d’une collaboration entre un dessinateur et un scénariste, on est le deuxième lecteur. Mais, notre rôle c’est aussi de poser des questions que se poserait un lecteur en disant «Voilà ! Là, l’histoire me paraît parfaite, mais là, je bloque un tout petit peu» […] surtout quand c’est Pierre et André, voilà, on pose des questions et on essaye de pousser à la réflexion, mais on ne va pas dire: «Moi, ton éditeur, je t’ordonne de faire ça !»
AJ: […] L’éditeur, c’est vrai qu’il ne peut pas imposer à l’auteur de faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire. […] Pour revenir à Léna, je me souviens (tout ça pour revenir au rapport avec l’éditeur) que le premier scénario était un scénario très silencieux. C’est-à-dire qu’il y avait quelques dialogues dans l’histoire et beaucoup de pages sans écrit, sans commentaires. Et on s’était fait la réflexion que ce n’était pas forcément une très bonne idée de faire une bande dessinée silencieuse, dans la mesure où, par expérience, on sait qu’elles sont très vite lues et avec moins d’attention que les autres. Et donc, on a suggéré à Pierre de faire parler un peu plus les personnages. Et c’est là qu’il a eu l’idée, qui m’a semblé très intéressante, du monologue intérieur. […]
PO: Tout dépend de l’arrangement qu’il y a entre les auteurs. L’éditeur ne se mêle pas de cela. Certains auteurs vont partager à cinquante-cinquante. Et certains auteurs vont considérer que, le dessinateur passant beaucoup plus de temps, il va toucher soixante pour cent, jusqu’à soixante-dix pour cent de droits, notamment en Belgique. Et souvent, ces soixante-dix-trente continue jusqu’à remboursement des avances ou jusqu’à un certain palier de vente, puis cinquante-cinquante. En France, Goscinny et Charlier ont vraiment mis la règle des cinquante-cinquante qui est quasiment…
AJ: Oui. J’étais surpris en travaillant avec Pierre que lui n’exigeait pas cinquante/cinquante. C’était soixante-quarante, je crois. C’est aussi qu’on bénéficie d’un statut par rapport à beaucoup d’auteurs, c’est que le travail est payé à la planche. On est payé pour chaque planche que l’on fait. Et cette rémunération ne sera pas déduite des droits d’auteurs.
Encadré 2: Pierre Christin sur Pierre Christin dans le site booknode.com
Le métier de scénariste lui permet d’explorer ses vocations restées en friche: bien que s’estimant trop bavard pour l’emploi, il aurait aimé être espion afin de monter des scénarios en vraie grandeur. Ou alors officier de marine pour avoir tout le temps de lire à bord de cargos pourris comme ceux qu’il a empruntés pour écrire «Lady Polaris», balade dans les ports d’Europe publiée avec Mézières en 1987. Il aurait aussi aimé être architecte, pour bâtir toutes ces villes qu’il a racontées, telles Los Angeles dans «L’Etoile oubliée de Laurie Bloom» ou le Belgrade encore yougoslave de «Cœurs Sanglants et autres faits divers» avec Enki Bilal.
Il aura en tout cas été un voyageur conséquent, profitant des immobilités imposées –attentes dans les hôtels, les gares, les aéroports – pour observer, noter, emmagasiner. Il est capable d’arpenter une ville des journées entières de façon obsessionnelle, prenant des photos (plutôt moches mais efficaces) qu’il distribue ensuite à ses dessinateurs. Mais divaguer en Patagonie ou descendre les rapides du Mékong ne lui fait pas peur (enfin, pas trop). Chaussé de ses indestructibles Weston ayant foulé le Cap Nord et le Kalahari, il a fait un premier tour du globe par l’hémisphère nord en 1992, un second par l’hémisphère sud en 1999, périples qu’on retrouve dans «L’homme qui fait le tour du Monde» (avec Philippe Aymond). Mais il a fait beaucoup plus souvent encore le tour de Paris sur les rails abandonnés de la petite ceinture («La Voyageuse de Petite Ceinture» avec A. Goetzinger, 1985) et celui de la Petite Couronne en vélo («La Bonne Vie» avec Max Cabanes, 1999).
Romancier, il traite aussi bien l’aventure citadine dans «ZAC» et «Rendez-Vous en Ville» que les plongées au fond du terroir français dans «L’Or du Zinc» (1998). Il aborde également le théâtre ou le scénario de film («Bunker Palace Hôtel» avec Enki Bilal en 1989). Et, sans pour autant abandonner la bande dessinée, il a publié récemment de nombreux ouvrages illustrés explorant d’autres rapports entre textes et dessins dans la collection en format à l’italienne Les correspondances de Pierre Christin. Collection pour laquelle il a travaillé notamment avec Patrick Lesueur, Jacques Ferrandez, Jean-Claude Denis, Alexis Lemoine et Enki Bilal.
Considérant que, pour vivre heureux, il faut vivre beaucoup mais caché, il aurait aimé avoir cent vies dans cent villes et presque autant d’identités.
Encadré 3:«Entretien avec Pierre CHRISTIN au festival BD de Cluny, lors de la manifestation «Pierre CHRISTIN, rencontre avec le public» le 15 mars 2003(http://www.sceneario.com/sceneario_interview_CHRI.html):
Public: Vous êtes scénariste, quels conseils donneriez-vous à ceux d’entre-nous qui souhaiteraient se lancer dans ce métier?
Pierre Christin:A l’époque où j’ai débuté, dans les années soixante, on devenait scénariste un peu par hasard. Il s’agissait essentiellement de travaux pour les magazines destinés à la jeunesse. Je suis donc rentré dans la BD par effraction. En voyage aux USA avec mon ami Jean-Claude Mézières, on n’avait plus un sous pour se payer le voyage retour. Suite aux conseils d’un ami, Jean Giraud (alias Moebius), j’ai commencé à envoyer des histoires à un certain Goscinny pour le magazine Pilote. Il s’agissait avant tout de boucler les histoires, des premières idées jusqu’à la publication, dans la semaine. Il fallait aller rapidement, sans forcément connaître le dessinateur auquel serait attribuée l’histoire. Dans un second temps, le métier s’est construit, codifié. Et cette codification est basée sur plusieurs préceptes simples, qui font que le métier de scénariste est très différent du métier d’écrivain.
1- La BD n’est pas à proprement parler de la littérature. En effet, même un ballon long est finalement un élément de dialogue bien court. Il faut accepter de faire court.
2- Le scénariste n’écrit que la partie d’un tout qui n’existe pas encore. Et pour construire ce tout, le scénariste produit une quantité de textes dont les 2/3 ne sont pas destinés à être publiés, mais servent au contexte. Un grand nombre d’informations de ma production sont pour le seul dessinateur (for his eyes only, comme on dit dans les romans d’espionnage…).
3- L’art de la BD est avant tout l’art du découpage. Le scénario est écrit avant, page par page et image par image. Ce qu’on écrit est un tout qui n’existe pas encore.
Suivent les textes off dont la bande dessinée a le secret («peu après», «pendant ce temps», «quelque part dans l’univers»…), cela permet d’élaborer le fil de l’histoire. Il y a ensuite les indications sur les personnages et enfin les dialogues.
Encadré 4: Entretien inédit par Alain Boillat et Philippe Kaenel au domicile de Pierre Christin à Paris en 2013 (extrait):
Philippe Kaenel: Est-ce que vous n’êtes pas un scénariste atypique dans le monde de la BD?
Pierre Christin: Bah ! Comme on me l’a souvent dit, j’ai fini par le croire. En tout cas, quand je suis rentré dans la bande dessinée, là j’étais véritablement atypique. Ne serait-ce que par mon niveau de diplôme, par exemple.
PhK: Il n’y a pas beaucoup de docteurs ès lettres dans le milieu…
PC: C’est sûr. Apparemment, j’étais une exception à la règle par cette cohabitation entre le fait d’être universitaire et scénariste de BD où, à l’époque, à l’université, tout de même, cela faisait bizarre. Ce n’était pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Et je peux vous dire que dans les années soixante-dix, quand je disais aux gens que je faisais de la bande dessinée, ils pensaient vraiment que c’était un gag ! D’ailleurs, ce qui était aussi la règle en bande dessinée, petit métier, j’avais pris un pseudonyme, pour signer mes premiers scénarios. […] Ce n’était pas un snobisme, mes goûts littéraires faisaient que je prenais mes références tout à fait à l’extérieur du monde de la bande dessinée. Bizarrement, si on prend la composition sociologique de la BD en France au jour d’aujourd’hui, je suis beaucoup moins atypique.
Encadré 5: L'Épervier, «Pierre Christin envoie Léna chez les kamikazes» in Les interviews, Communauté: bd blog, 10 janvier 2010, repris dans Le blog d'André Juillard (http://andre-juillard.over-blog.com).
Pierre Christin:[…] Mon entente avec André Juillard compte beaucoup. Et puis Léna est un personnage mystérieux, cryptique, même pour ses auteurs, ce qui donne envie de la ranimer. D’autant plus qu’André ne l’a eue réellement dans la main qu’à la fin du premier épisode, et était alors frustré de ne pouvoir continuer.
Avez-vous voyagé pour les besoins de ce scénario?
PC: Je suis retourné en Australie pour ne pas en donner une image saugrenue [l’histoire y débute], et je suis allé en Géorgie. André Juillard avait dessiné les scènes qui s’y déroulent avant l’invasion russe. Pendant ces événements, j’ai prié pour que les Russes s’arrêtent avant Tbilissi, ce qu’ils ont heureusement fait. Il aurait sinon fallu tout changer… Je ne force pas sur les descriptions pour lui laisser une large marge de manœuvre. Contrairement à celle que j’entretiens avec Jean-Claude Mézières [qui dessine Valérian], ma relation avec André est très douce. Jean-Claude, lui, me casse les nougats, il demande régulièrement des modifications du scénario pour mieux se l’approprier.
Comment travaillez-vous avec André Juillard?
Très facilement. Sa virtuosité et sa rapidité sont extraordinaires, il peut tout faire. Je connais ses goûts, et je prépare des textes sur mesure – il suffit qu’il réclame une scène se passant dans le désert ou une à Paris pour que je les ajoute. Je lui donne des scénarios très découpés, image par image, accompagnés de photos.
Encadré 6: entretien inédit par Alain Boillat et Philippe Kaenel au domicile de Pierre Christin à Paris en 2013 (extraits):
«Je voyage toujours avec mes carnets de notes. Je voyage comme un journaliste. Je ne voyage pas comme un touriste. Le tout est de savoir si je voyage à tel ou tel endroit avec l’idée que j’en tirerai un livre ou si j’ai déjà en fait une idée derrière la tête, que j’ai envie de raconter une histoire qui se passerait là, et donc je vais aller plutôt dans ce type d’endroits. Alors là, je dirais, dans le cas de Léna, il y a eu les deux. Il y a eu le fruit de voyages que j’avais fait en faisant des photos… Parce que je fais des photos très particulières pour les dessinateurs. Je ne suis pas un grand photographe. Enfin, eux ils disent que je suis bon, justement parce que je suis mauvais. Cela ne les gêne pas pour dessiner; parce que, quand il y a des photos trop artistiques, au fond, les dessinateurs n’aiment pas tellement cela […].
Je ne fais jamais de cadrage alambiqué. Je photographie frontalement. Voilà, je dis: «Cela se passe dans cette pièce. Je fais une photo là, une là, une là, une là. Clac.» Comme ça j’appuie à toute allure. Je photographie énormément de détails de la vie quotidienne qu’ils ne pourront jamais trouver dans un guide touristique ou sur internet parce que, je prends souvent cela comme exemple, il n’y a pas un pays où les fenêtres se ferment de la même façon, en particulier en Suisse, d’ailleurs. Il y a plein de petits détails comme cela… […]
Et je dirais que ce qui me plaît tout particulièrement, si vous regardez mes histoires et en particulier celles avec André, c’est des non-lieux. Ce n’est pas des lieux connus. De temps à autre, on dit Dubaï ou Sidney. Bon, pour le lecteur, ok, nous allons mettre une image où on voit l’opéra de Sidney parce que c’est une espèce de balise intellectuelle. Mais, pratiquement toutes les scènes se passent dans des lieux non répertoriés […].
Ma seule qualité comme scénariste, mais encore que je pense que tous les bons scénaristes l’ont, sinon ce n’est pas la peine d’essayer de faire ce métier-là, c’est d’être capable de visualiser ce que va faire le dessinateur. En ce sens, j’écris de façon particulière pour chacun de mes dessinateurs. Or là, le dessin d’André que j’ai toujours adoré, dans sa pureté, bien entendu quand je suis derrière l’ordinateur, ce n’est pas moi qui peut dessiner ce qu’il a à faire, mais je le rêve […].
J’admire vraiment les croquis d’André qui est d’ailleurs l’un des rares dessinateurs que je connaisse à faire des croquis entiers préparatoires, etc., de ses histoires. Et beaucoup de gens ont souvent dit à André que ses cahiers préparatoires de croquis ont presque autant de charme que la bande dessinée terminée et nickel. Cela m’amusait de faire rentrer son autre style de dessin, notamment au crayon, à l’intérieur de l’histoire. Donc, pour cela aussi, il fallait trouver un vecteur, pour que ce ne soit pas artificiel et le vecteur c’est que Léna, désœuvrée, pouvait revenir à ses premières amours, au métier de sa mère…»
Pour citer l'article
Philippe Kaenel, "La bande dessinée comme œuvre collective. Dialogue entre André Juillard et Pierre Christin ", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-comme-oeuvre-collective-dialogue-entre-andre-juillard-et-pierre-christin
Voir également :
Aux confins de la narrativité. Une expérience de lecture: du paratexte à l’interprétation
La tentation est grande, pour les enseignants de littérature, de ne voir dans la bande dessinée qu’un réservoir inépuisable d’exemples séduisants, qu’un magasin d’ «illustrations» rassurantes pour un public supposé rétif à la théorie. Ainsi, les comics (Barthes 1966: 7) ont-ils fait pendant les décennies structuralistes l’épreuve des outils d’analyse affutés par la narratologie et la grammaire du récit.
Aux confins de la narrativité. Une expérience de lecture: du paratexte à l’interprétation
La tentation est grande, pour les enseignants de littérature, de ne voir dans la bande dessinée qu’un réservoir inépuisable d’exemples séduisants, qu’un magasin d’ «illustrations» rassurantes pour un public supposé rétif à la théorie. Ainsi, les comics (Barthes 1966: 7) ont-ils fait pendant les décennies structuralistes l’épreuve des outils d’analyse affutés par la narratologie et la grammaire du récit. Actuellement, bien que menacée de péremption par les jeux vidéo et les séries, la bande dessinée fait encore les beaux jours des théories de la lecture et de la fiction. Les zélateurs du medium n’avaient-ils pas eux-mêmes vu, dans cette heureuse disponibilité des cases et des planches, une formidable opportunité de promouvoir la dignité du 9e art? C’est ainsi qu’au gré de que l’on pourrait lire historiquement comme une instrumentalisation réciproque (la BD comme outil de promotion pédagogique des modèles descriptifs, les modèles descriptifs comme outil de promotion culturelle de la BD), se prenait, à bas bruit, l’habitude de pratiques transmédiales1 dont on mesure aujourd’hui la fertilité.
Le présent dossier, consacré à ce qui est devenu depuis sa parution un «classique», offre l’occasion de la double opération qui sera tentée dans les pages qui suivent: 1) considérer Le long voyage de Léna à la fois comme une «structure» (un système de relations) et comme un «dispositif» (un modèle ouvert sur les contextes de production et de réception2), c’est-à-dire comme une «œuvre» offerte à une expérience de lecture, depuis le moment où l’on prend en main l’album pour apprécier les détails de la couverture jusqu’au moment où on le range en se demandant s’il y aura une suite; 2) vérifier localement la robustesse des postulats transmédiaux en convoquant, quand le besoin s’en fait ressentir, des outils descriptifs empruntés aux études théâtrales (un domaine situé en marge de la narratologie, que celle-ci soit qualifiée de classique ou de postclassique).
Zone de passage (le paratexte)
Ainsi qu’en témoignent les archives génétiques que nous avons pu consulter3, le titre Le long voyage de Léna s’impose dès les premiers documents préparatoires.

Illustration 1: André Juillard, Esquisse pour la couverture du Long voyage de Léna, 2005. Archives André Juillard. © André Juillard
Relevant du péritexte auctorial4(Genette 1987), il se présente d’emblée comme un clin d’œil à son inscription dans la collection «Long courrier» des éditions Dargaud 5. Sur les pages de couverture de l’album, l’image de deux navires et celle d’une cabine avec hublot et couchette activeront les connotations maritimes de la collection. Pierre Christin et André Juillard ne sont pas les premiers à proposer un titre qui joue ainsi avec l’horizon d’attente prescrit par l’éditeur, comme en témoigne, imprimée en regard de la page de faux-titre, la liste de la quinzaine d’ouvrages parus «dans la même collection6». Sur la quatrième de couverture, une flamme d’oblitération évoque pour sa part le versant postal de la collection; les lignes ondulées sont liées à la charte graphique de cette dernière et, comme le logo à la rose de vents, appartiennent au péritexte éditorial7. Au verso de la page de faux-titre, un péritexte auctorial débute ainsi: «Cet album est issu d’un voyage à Berlin effectué par André Juillard et Pierre Christin, ainsi que des photos, de la documentation et des entretiens réalisés par Pierre Christin dans tous les autres pays où se rend Léna.» Les deux auteurs ont voyagé8; ils expédient, sous forme d’album, comme une liasse de cartes postales. Mais qu’en est-il de Léna?
Le court texte d’accroche qui figure sous l’image de la quatrième de couverture (encore un péritexte éditorial) commence par ces mots: «Qui est Léna? Que fait Léna? Le sait-elle elle-même?». Ces questions inattendues (se demande-t-on «Qui est Pierre Christin? Que fait-il? Le sait-il lui-même?») entrent en tension avec le titre dont l’évidence paraît alors trompeuse. Rapidement, le lecteur apprendra en effet que Léna «joue les touristes moyens» (p. 17, c. 10)9 et qu’elle n’est pas engagée dans «un voyage d’agrément» (p. 19, c. 6). Son nom – Muybridge10 – évoque le mouvement, mais il figure sur un «vrai-faux passeport» (p. 38, c. 1). Léna voyage sans plaisir; les paysages et les monuments sont pour elle sans attrait (il n’est que de voir son expression sur la couverture). Elle n’écrit à personne qui attende de ses nouvelles. Elle joue pourtant un «rôle de courrier» (p. 26, c. 3), ce qui ne manque pas de piquant, étant donné le nom de la collection.
Le dispositif paratextuel de l’album invite le lecteur à embarquer, c’est-à-dire à franchir la «“zone” de passage» (Del Lungo 2009: 9911) qui le sépare de l’univers fictionnel. Certains «vecteurs d’immersion» (le portrait de l’héroïne et le titre en cursives, par exemple) y sont déjà mis en œuvre (Schaeffer 1999: 25512). Les nombreuses dissonances de ce dispositif, particulièrement élaboré, éveillent immédiatement l’intérêt: la contradiction entre le mouvement et la mélancolie, la confusion entre le romanesque et le documentaire, le mélange annoncé entre «intimisme» et «fresque géopolitique». Tout attise la curiosité du lecteur, jusqu’au face à face troublant, sur la quatrième de couverture, d’un hublot ouvert et d’une photographie retournée.
Illustration 2: Quatrième de couverture, Le Long voyage de Léna © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007.
Zone de tension (l’histoire et le récit)
«Qui est Léna?». Elle est sans conteste l’héroïne du récit (elle est présente graphiquement dans 70% des cases selon les calculs d’Alain Corbellari et Alain Boillat), mais est-elle le personnage principal de l’histoire? Le long voyage de Léna offre une belle occasion d’éprouver la différence entre le récit et l’histoire, entre ces «deux aspects de toute œuvre littéraire» (Todorov 1971: 12) et entre les deux «niveaux de description» qu’ils requièrent (Barthes 1966: 11). À cette fin, il peut être utile de tenter de résumer la séquence compositionnelle (Todorov 1981: 133) ainsi que la séquence événementielle (Baroni 2017: 8413) de l’album. Bien que l’exercice soit peu formaliste, il devrait permettre de mieux saisir comment l’écart entre histoire et récit est mis en intrigue (Baroni 2017: 39-57) – afin que cet écart soit vécu par les lecteurs comme une tension qui ne se résout qu’une fois l’album refermé. Commençons par le résumé du récit:
Léna – on reconnaît la femme de la couverture – se rend dans un quartier de Berlin-Est. Elle a rendez-vous avec un vieil homme, nostalgique de la RDA. Il lui confie une liste de contacts qu’elle apprend par cœur avant de la brûler. Aux adresses et dates qu’elle a mémorisées, elle rencontre successivement six personnes à qui elle donne l’un des objets qu’elle transporte avec elle. Elle livre ainsi une boîte de massepain à Budapest, un flacon de parfum en Roumanie, une trousse pour diabétique à Kiev; on comprend que ces objets contiennent de quoi composer et injecter un poison. Des plans sont ensuite transmis en Turquie et une lettre codée en Syrie; ces deux derniers éléments renseignent les assassins sur la localisation et l’identité de leur future victime. Au fur et à mesure, Léna marque intérieurement sa distance envers les gens qu’elle contacte. À la fin du parcours, on apprend qui est Léna: celle-ci a perdu son fils et son mari dans un attentat perpétré par ceux-là mêmes qu’elle a rencontrés. Les services secrets français lui ont proposé la mission qui doit aboutir à leur neutralisation. À Dubaï, pendant que Léna s’envole à l’autre bout de la planète, les six terroristes explosent dans un véhicule piégé. En Australie, Léna fait la rencontre d’un veuf et de son jeune garçon.
Ce petit texte ayant été rédigé avant la consultation du site internet des éditions Dargaud, on se plaira à relever sa parenté avec le résumé (partiel) proposé, en guise de teaser, à l’occasion de la réédition récente du Long voyage de Léna 14:
Elle s'appelle Léna. C'est une jeune femme brune, élégante et mystérieuse. On ignore d'où elle vient et où elle va. Son voyage commence à Berlin-Est, dans le quartier où vivent les anciens dignitaires d'un régime effacé par le vent de l'Histoire. Léna rend visite à un homme qui lui remet une liste de noms et de numéros de téléphone, qu'elle apprendra par cœur avant de la détruire. Après Berlin, il y aura Budapest et un autre rendez-vous. Et après Budapest, Kiev, Odessa, la Turquie et la Syrie. À chaque fois, une rencontre. Peu de mots prononcés, juste un objet étrange remis par Léna à son destinataire: une boîte de pâtes d'amandes, un flacon de parfum, un nécessaire pour diabétiques.
Dans les deux textes, le pronom impersonnel «on» et le présent de l’indicatif (également utilisés dans le projet de scénario établi par Christin15) se sont imposés, sous la pression manifeste de la séquence visuelle. Un autre parti était possible, qui aurait privilégié les récitatifs (les cartouches narratifs). Le résumé aurait alors pu commencer ainsi: «Léna – la femme représentée sur la couverture – raconte comment elle s’est rendue dans un quartier de Berlin-Est pour rencontrer un vieil homme, nostalgique de la RDA. Elle ne précise pas quel était son point de départ.» Cette option peut se justifier du caractère manifestement structurant des cartouches narratifs dans le crayonné de Juillard. Un tel choix contraint cependant à rappeler avec régularité la source imaginaire du récit («Léna raconte que…»). Une troisième piste pour un résumé du récit est inspirée par les «Légendes pour une exposition» rédigées par Christin. Ces légendes qui accompagnent chaque planche de l’album, sont le résultat d’une identification totale avec l’héroïne. Elles actualisent au présent (parfois en l’augmentant) la voix intérieure de Léna qui parle au passé dans les récitatifs. Par exemple, pour la Planche 1: «On m’appelle Léna, et je me trouve pour la première fois de ma vie dans cette lointaine partie de Berlin-Est. Je suis seule, absolument seule. C’est l’été. Il fait très chaud. Je dépasse une écluse immobile16». Un résumé inspiré par ces étonnantes variations autour des planches montrerait comment le plan iconique de la narration, perçu comme simultané, peut altérer la grammaire des récitatifs. L’examen de ces différents résumés, de la combinatoire des pronoms et des temps verbaux et la comparaison avec les documents préparatoires, tout cela s’avère pédagogiquement fertile pour une exploration des spécificités du récit en bande dessinée, mais également pour une compréhension globale, dans un esprit transmédial, des outils narratologiques. Mais revenons au premier résumé proposé ci-dessous. Dans son économie générale, ce résumé tient compte du fait que l’identité de Léna reste indécise durant les deux premiers tiers de l’album, à savoir pendant 35 pages sur 53 (862 caractères sur 1303 dans le résumé proposé). Le voyage peut donc être qualifié de «long» en raison du nombre de kilomètres parcourus et de l’archaïsme des moyens de transport (dans l’histoire), mais aussi en raison du nombre de pages (pages 3 à 38) qui attisent la curiosité du lecteur (dans le récit). Une dizaine de pages (pages 43 à 53) prennent le relais pour produire l’unique effet de suspense de l’album à propos du destin des terroristes. Quant à la surprise (qui invaliderait les diagnostics et les pronostics du lecteur), elle est moins produite par la révélation de l’identité de Léna (préparée par un semis d’indices) ou par la mort des assassins (annoncée de manière peu cryptée17) que par une scène qui dévoile l’étendue de l’ignorance de l’héroïne (mais n’anticipons pas). Alain Boillat et de Raphaël Baroni analysent ici-même les techniques compositionnelles de l’album, nous ne nous y attarderons donc pas. Certes, la tension narrative «ne dépend pas uniquement d’éléments thématiques (ce qui arrive aux personnages ou ce qui les caractérise), mais aussi d’une certaine organisation du discours» (Baroni 2017: 85), il convient néanmoins de prêter attention à ces «éléments thématiques» et de ne pas négliger, comme il est souvent d’usage18, «ce qui arrive aux personnages». Voici donc un résumé de l’histoire:
Un attentat non revendiqué fait dix-sept victimes dans le quartier de la légation française à Khartoum: parmi les victimes, figurent le mari et le fils d’Hélène Desrosières (Léna). Un ami de Desrosières, Paul-Marie de Calluire, membre des services secrets français, identifie les responsables. Il est informé de la prochaine opération «anti-impéraliste» fomentée par ce groupe de communistes dirigé par un ancien membre de la Stasi. Il s’agit d’assassiner un cheikh dont le rôle est crucial dans la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient. Le chef du groupe accepte l’aide de Paul-Marie (qu’il a eu l’occasion de fréquenter pendant la Guerre froide). Paul-Marie propose à Léna de contribuer à la neutralisation des terroristes. Léna se présente à Berlin comme le courrier qui doit livrer à chaque membre du groupe – c’est-à-dire en Hongrie, Roumanie, Ukraine, Turquie et Syrie – une partie des moyens et des données nécessaires au nouvel attentat. De ce projet, Léna ignore la cible. Ce n’est qu’une fois sa mission achevée que Paul-Marie l’en informe. Il lui cache en revanche le sort qui les attend. À Dubaï, sur le point de commettre leur forfait, ils explosent dans un véhicule piégé, pendant que Léna est en route pour l’Australie. Sur une plage, elle rencontre un veuf et son jeune fils.
Ce résumé diffère nettement du précédent, bien que rigoureusement de la même longueur19. Alors que le résumé du récit frappait par son rapport deux tiers / un tiers (mystère / révélation), celui-ci révèle la structure symétrique d’une histoire «à clôture forte» (Schaeffer 2020: 10), une histoire «passant d’un équilibre à l’autre»:
Un récit20 idéal commence par une situation stable qu’une force quelconque vient perturber. Il en résulte un état de déséquilibre; par l’action d’une force dirigée en sens inverse, l’équilibre est rétabli; le second équilibre est semblable au premier mais les deux ne sont jamais identiques (Todorov 1980: 50).
Les deux événements qui respectivement ouvre et ferme le résumé permettent de dégager ceci:
La cellule familiale de Léna (situation stable) est fracturée par l’attentat de Khartoum (perturbation); après sa mission (force dirigée en sens inverse), la jeune femme est exfiltrée aux Antipodes; sa rencontre avec un veuf et un orphelin laisse présager la constitution d’un nouveau foyer (situation stable)21.
Décrite ainsi cependant, l’histoire de Léna ne manque pas de surprendre voire de mettre à mal la description de Todorov et le fameux schéma quinaire qui l’a clarifiée par la suite (Larivaille 1974)22. En effet, on ne peut que s’interroger sur la nature de la «force dirigée en sens inverse» supposée permettre le retour à l’équilibre affectif pour Léna. Le résumé de l’histoire permet de relever deux rendez-vous entre Léna et Paul-Marie de Calluire symétriquement situés à proximité du début et de la fin du texte. De Calluire est de fait lui aussi porteur d’une histoire à clôture forte:
Les services de renseignement français, représentés par l’expérimenté de Calluire (situation stable), ont été mis en échec par l’attentat de Khartoum qu’ils n’ont pas su anticiper (perturbation); afin de prendre sa revanche, de Calluire s’insinue, dès ses prémisses, dans l’organisation de la prochaine opération du groupe terroriste responsable de cet attentat (force dirigée en sens inverse; cette revanche mettra le groupe définitivement hors d’état de nuire (situation stable).
Enfin, on remarquera également l’importance des contacts entre de Calluire et le chef des terroristes autour d’une troisième histoire à clôture forte:
Un groupe de communistes soudé par leur passé commun et dirigé par un ancien dignitaire de la Stasi (situation stable), n’acceptant pas la chute de l’URSS (perturbation), poursuit par ses actions la lutte anti-impérialiste; ainsi cherchent-ils à empêcher la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient (force dirigée en sens inverse); au cours de cette opération, l’ensemble du groupe trouve la mort, privant l’ancien dignitaire de la Stasi de ses moyens (situation stable).
Après avoir identifié cette troisième histoire, nous pourrions être tentés de réécrire le résumé, peut-être en dégageant plus lisiblement la manière dont elles s’emboîtent: Léna / De Calluire / les terroristes / De Calluire / Léna. Une telle entreprise serait sans doute vaine. En effet, n’est-ce pas déjà un biais (dû à l’influence du récit) que de braquer, en ouverture et en fermeture, le projecteur sur Léna? Il suffit, pour s’en assurer, de réécrire le résumé en dirigeant tour à tour le même projecteur sur de Calluire (Calluire / le Berlinois / Léna / le Berlinois / de Calluire) ou sur le Berlinois (le Berlinois / de Calluire / Léna / de Calluire / le Berlinois). L’histoire resterait inchangée dans les deux cas, mais Léna y perdrait son statut de personnage principal.
Reconnaissons que l’exercice qui consiste à résumer une histoire n’est pas une mince affaire. Pour Roland Barthes, l’histoire ne «relevait pas du langage» (Barthes 1966: 11, note 4) et Tzvetan Todorov en parlait comme d’un «matériau prélittéraire». Ce dernier ajoutait: «l’histoire est une convention, elle n’existe pas au niveau des événements eux-mêmes», elle est «une abstraction car elle est toujours perçue par quelqu’un, elle n’existe pas “en soi”». Il précisait surtout: elle «est rarement simple: elle contient le plus souvent plusieurs “fils” et ce n’est qu’à partir d’un certain moment que ces fils se rejoignent» (Todorov 1966: 133)23. Dans ce texte, précurseur à bien des égard, Todorov emprunte la notion de fil au vocabulaire de la dramaturgie classique, qui a aussi fourni les termes nœud, dénouement et intrigue issus du même bain métaphorique. Rappelons en effet que la poétique classique définissait l’intrigue comme un entrelacs de «fils» dans lequel les personnages se trouvaient «empêtrés». On peut rappeler à cet égard l’amusante étymologie qui ouvre l’article «Intrigue» de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
Ce mot vient du latin intricare, & celui-ci, suivant Nonius, de triæ, entrave, qui vient du grec τρίχες [triches], cheveux: quod pullos gallinaceos involvant & impediant capilli. Tripand24 adopte cette conjecture, & assure que ce mot se dit proprement des poulets qui ont les piés empêtrés parmi des cheveux, & qu’il vient du grec Θρίξ [trix], cheveux.
Intrigue, dans ce sens, est le nœud ou la conduite d’une pièce dramatique, ou d’un roman, c’est-à-dire, le plus haut point d’embarras où se trouvent les principaux personnages, par l’artifice ou la fourbe de certaines personnes, & par la rencontre de plusieurs événements fortuits qu’ils ne peuvent débrouiller.25
En régime classique, l’entrelacs de quelques fils (entre deux et quatre) suffit à donner matière à une représentation intelligible de l’existence humaine en tant qu’elle est soumise à la contingence, aux aléas, aux renversements de situation – le malheur succédant au bonheur et le bonheur au malheur (Scherer 1950: 9626). Les scénaristes de cinéma et de bandes dessinées – ne serait-ce qu’en raison de semblables contraintes de format – ont exploité à loisir ce type de construction (sans s’astreindre aux autres exigences de l’unité d’action27). Pourtant, pendant les décennies structuralistes, le modèle de l’histoire à plusieurs fils a été totalement périmé et occulté. À l’heure où la narratologie transmédiale prend la relève, on osera se souvenir que les études théâtrales ont, pendant ces mêmes décennies, persisté à promouvoir une méthodologie concurrente à la grammaire du récit dominante. Dans Lire le théâtre, Anne Ubersfeld se servait en effet du schéma actantiel de Greimas28 comme d’ «un mode de lecture» et revendiquait le caractère artisanal de cet usage dans la mesure où il visait le niveau sémantique des œuvres analysées et non pas leur niveau linguistique (Ubersfeld 1981: 55 et 56)29. Précautions utiles, car la méthode est très loin d’être orthodoxe: au nom d’une (supposée) «spécificité de l’écriture théâtrale», Ubersfeld promeut non seulement des «modèles actantiels» multiples mais aussi dynamiques et en transformation (Ubersfeld 1989: 81).
S’autoriser à dessiner plusieurs modèles actantiels et à y reporter les changements constatés en cours d’action (les actants se déplaçant en particulier d’une fonction à l’autre), c’était leur donner la possibilité de représenter les fils (et avant cela de les extraire du récit dramatique). Chaque fil est par ailleurs descriptible grâce à un schéma quinaire – mais on remarque alors aisément que sa séquence événementielle ne peut se passer des apports des autres fils (ainsi, Léna ne rencontrerait pas le veuf australien si Paul-Marie de Calluire n’avait pas cherché à se venger du «vieux maître berlinois»). Si l’on en croit l’article «Action» de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (Mallet 1751: 171a), toute action dramatique comporte plusieurs «desseins», des «efforts contraires» et la «solution des obstacles30». Plusieurs, car les «efforts contraires» ne sont dus qu’à la pluralité des fils. Ainsi inspirés, nous reconnaîtrions, dans Le long voyage de Léna, trois fils qu’il serait aisé de les valider en dessinant trois schémas actantiels, autour de trois Sujets: 1) Les services secrets français représentés par Paul-Marie Calluire; 2) Le «vieux maître berlinois», à la tête de son petit groupe d’anciens agents communistes; 3) Hélène Desrosières dite «Léna». Trois Sujets qui recherchent trois Objets: 1) Éliminer le groupe terroriste qui a tué des compatriotes et attenté à l’image de la France; 2) Empoisonner le cheikh Mohammed Al-Fahim pour faire échouer la signature d’un traité voulu par les «impérialistes»; 3) Surmonter la mort de son mari et de son fils afin d’envisager un avenir.
Reste à décrire l’entrelacs. Le plus évident est le croisement entre le fil 1 et le fil 2: c’est en enquêtant sur l’attentat de Khartoum que De Calluire remonte jusqu’au Berlinois. Comme leurs routes se sont déjà croisées par le passé, il n’a aucun mal à prendre contact avec lui et à se proposer de collaborer à son prochain projet (l’assassinat de Dubaï). Plus obscur est le croisement entre le fil 1 et le fil 3. De Calluire propose à Léna d’être l’instrument de sa «collaboration» au projet du Berlinois, mais aucune raison explicite n’est donnée à cette initiative bizarre. Léna ne fait pas partie de ses troupes, elle n’est nullement nécessaire à une mission que n’importe quel agent peut exécuter à sa place et sa personnalité est plutôt voyante (ce que les terroristes se feront fort de commenter chacun à sa façon). Pour comprendre cet aspect de l’entrelacs, il faut sans doute en revenir au récit et en particulier à ses caractéristiques visuelles. On se risquera à supposer que les raisons de Paul-Marie de Calluire ne peuvent être que symboliques: c’est parce que Léna est la jeune veuve d’un diplomate mort dans l’attentat qu’elle pourra incarner la vengeance – avec une robe noire et une allure de Némésis qui sont le fait du dessinateur31 – et réparer aux yeux des services français l’irrémédiable blessure de Khartoum32.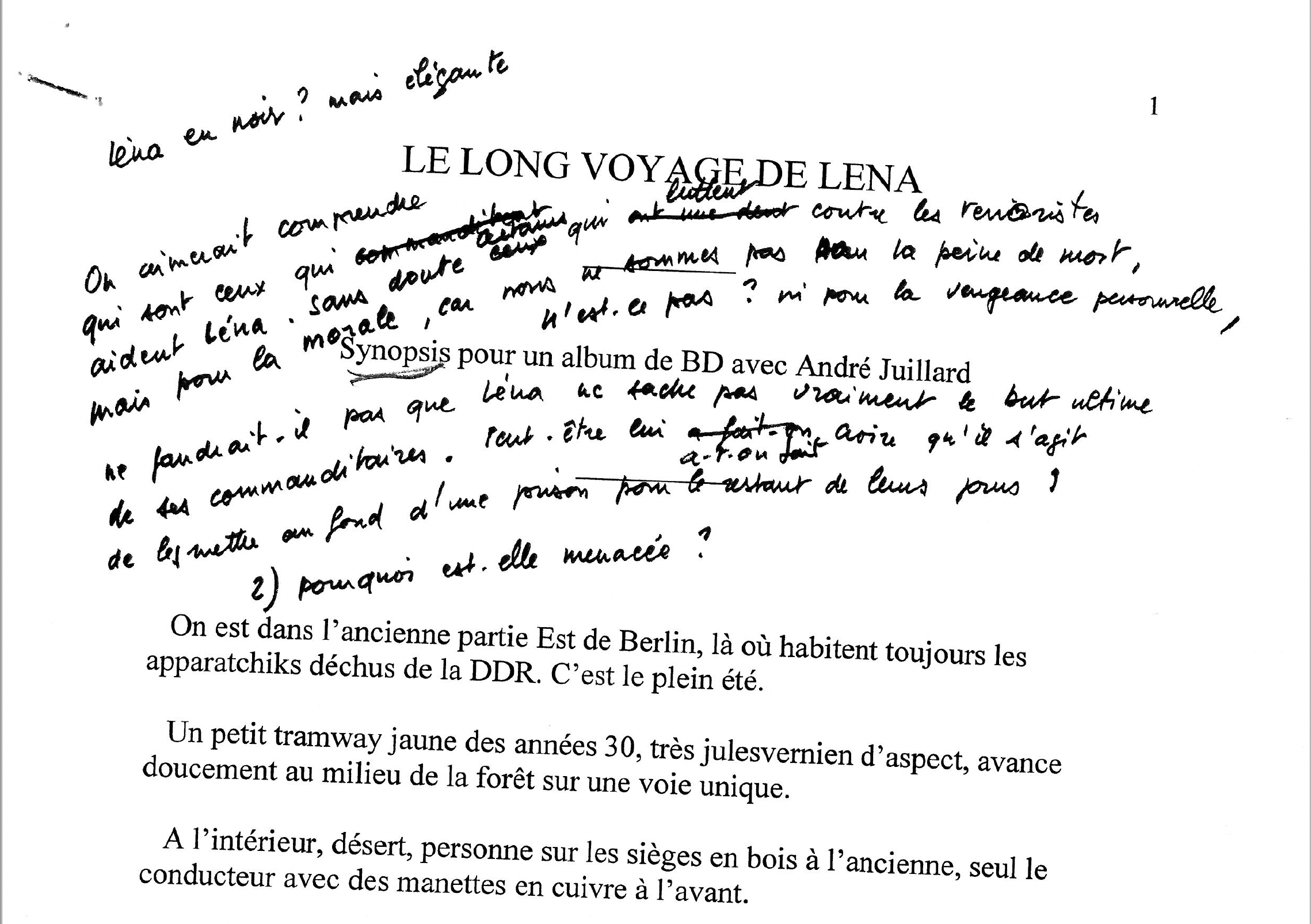
Illustration 3: Synopsis de Christin, p.1. © André Juillard & Pierre Christin 2005.
La vertu opératoire de cet exercice de reconstitution des fils réside dans le fait que celui-ci contraint à se concentrer sur l’histoire et rien que sur elle. L’exercice vaut aussi par les difficultés rencontrées et par les interrogations qu’il soulève. Pour continuer dans cette direction, on cherchera en vain, dans Le long voyage de Léna, la trace de véritables «efforts contraires», c’est-à-dire un obstacle ou un conflit avec des opposants. Léna ne court aucun danger d’être démasquée33, quand bien même elle peut irriter ses contacts avec ses réactions de «petite-bourgeoise». Hors l’explosion finale, tout se passe pour l’ensemble des personnages «comme prévu», «sans problème»; personne n’est amené à improviser, à s’écarter du plan. Ce défaut d’obstacle fait semble-t-il l’objet de l’une des deux remarques générales apportées par Juillard sur le synopsis de Christin: «pourquoi est-elle menacée?», écrit-il au sujet de Léna. Pour remédier à ce qui paraît un défaut, l’accrochage entre une vedette de la police et un navire écologiste est développé dans le projet de scénario. Bien que monté en épingle par le commentaire de l’Ukrainien (page 23, c. 5 à 9) et par celui de Paul-Marie de Calluire (p. 40, c. 2 à 6), «l’épisode dans le delta du Danube» se règle néanmoins en quelques cases (p. 21) sans avoir le temps d’inquiéter le lecteur. On remarquera également qu’aucun des trois desseins (à l’origine des trois fils) n’est explicité avec précision en termes de causes ou de raisons (on s’en aviserait au moment de tenter de nommer les actants occupant les fonctions de destinateur et de destinataire34). Il est par exemple difficile de savoir dans quelle mesure la signature d’un traité à Dubaï (désigné comme un accord de paix israëlo-palestinien uniquement dans les documents préparatoires) représente un enjeu, qu’il s’agisse de le favoriser ou de l’entraver. Au-delà de la vie du cheikh Mohammed Al-Fahim35, l’objectif principal des services secrets français semble bien de prendre une revanche, et celui du «vieux maître berlinois» de continuer d’entretenir un combat hors d’âge contre les puissances de l’Ouest. Paul-Marie agirait ainsi par vanité et le chef terroriste par «Ostalgie». Enfin, il s’avère que les échecs comme les réussites ne sont que des résultats provisoires dans le contexte de la «nébuleuse du terrorisme international» (p. 40, c.6). Quant à Léna, il est bien difficile de comprendre quel profit elle tire de cette histoire. Le synopsis prévoyait un scénario à la Monte-Cristo, mais André Juillard, pris d’un scrupule à sa lecture, note à la main: «nous ne sommes pas pour la peine de mort, n’est-ce pas? ni pour la vengeance personnelle? Ne faudrait-il pas que Léna ne sache pas vraiment le but ultime de ses commanditaires?». Si Léna ne poursuit pas la mort des coupables, que fait-elle?
Zone de troubles (l’interprétation)
«Que fait Léna?». À la fin de l’album, la tension narrative prend fin, mais la tension interprétative ne fait que commencer: «non pas l’incertitude sur l’issue, mais l’incertitude sur le sens» (Jouve 2019: 46-47). «Que fait Léna?». La question reste entière, et cela malgré l’artifice qui consiste à lui prêter, dans les deux premiers tiers de l’album, la voix d’un narrateur (d’une narratrice) homodiégétique. Que dire de cette voix, si ce n’est d’abord sa réticence (sa «retenue», écrit Alain Boillat)? Cette voix n’est pas comme on pourrait peut-être le croire une anticipation du «debriefing» de sa mission36 (dans ce cas, tout le voyage aurait basculé dans l’analepse). Bien que prenant en charge des descriptions d’actions au passé, cette voix ne témoigne d’aucune «ultériorité». Elle affecte plutôt un caractère «intercalé» (Genette 1972: 229), à la manière d’un journal de bord, un journal intériorisé puisque l’écriture est évidemment exclue par les circonstances. Reste à comprendre la réticence de la narratrice, que certains critiques n’hésiteraient pas à qualifier de «non fiable» (Booth 1977). Sans entrer dans les débats ouverts par cette notion, retenons qu’une narration non fiable «réoriente l’attention du lecteur sur les processus mentaux du narrateur» (Wall 1994: 23, cité par Nünning 2018: 127). Le passé composé – frappant dans les récitatifs – contribuerait quant à lui à maintenir une distance avec le lecteur. L’usage de ce temps verbal rendrait en effet «cognitivement plus difficile d’oublier complètement la médiation du discours narratif et de se replacer dans la perspective temporelle du personnage» (Baroni 2017: 122-123)37. On peut ainsi faire l’hypothèse que ce temps permet à Léna de prendre elle-même de la distance.
De même que Léna voyage et ne voyage pas, on pourrait donc dire qu’elle narre et ne narre pas, qu’elle simule la narration comme elle simule le voyage. En effet, le «monologue intérieur38», qui se poursuit jusqu’à la page 38, occulte le principal: une biographie fracturée par la perte et le deuil. Léna ne se contente pas d’assumer avec réticence la position de narrateur de sa propre vie (Ricœur 2008), elle s’efforce de tuer dans l’œuf tout processus qui relèveraient du «proto-narratif» (Schaeffer 2020: 46-59): 1) elle se refuse à toute mémoire épisodique en se voulant «lisse et sans mémoire» (p. 10, c. 4, p. 32, c. 4); 2) elle répète qu’elle passe des nuits sans rêve (p. 15, p. 4, p. 20, c. 6); 3) elle évite toute planification d’action et se déclare incapable de projection dans l’avenir (p. 16, c. 6). Ainsi Léna s’exile-t-elle volontairement des «territoires originaires du récit», c’est-à-dire de son «vaste continent narratif intérieur» (Schaeffer 2020: 43 et 44).
Cet exil est susceptible d’expliquer bien des choses: en acceptant la mission proposée par Paul-Marie, Léna se met au service d’un projet exogène qui la dispense de tout dessein personnel. La page où elle apprend par cœur la liste des «noms, numéros de téléphones et adresses» (p. 5) est parlante à cet égard: Léna se remplit la mémoire avec le plan élaboré par l’ancien agent de la Stasi39. Simple exécutante, elle cesse provisoirement d’être le sujet de sa propre biographie.
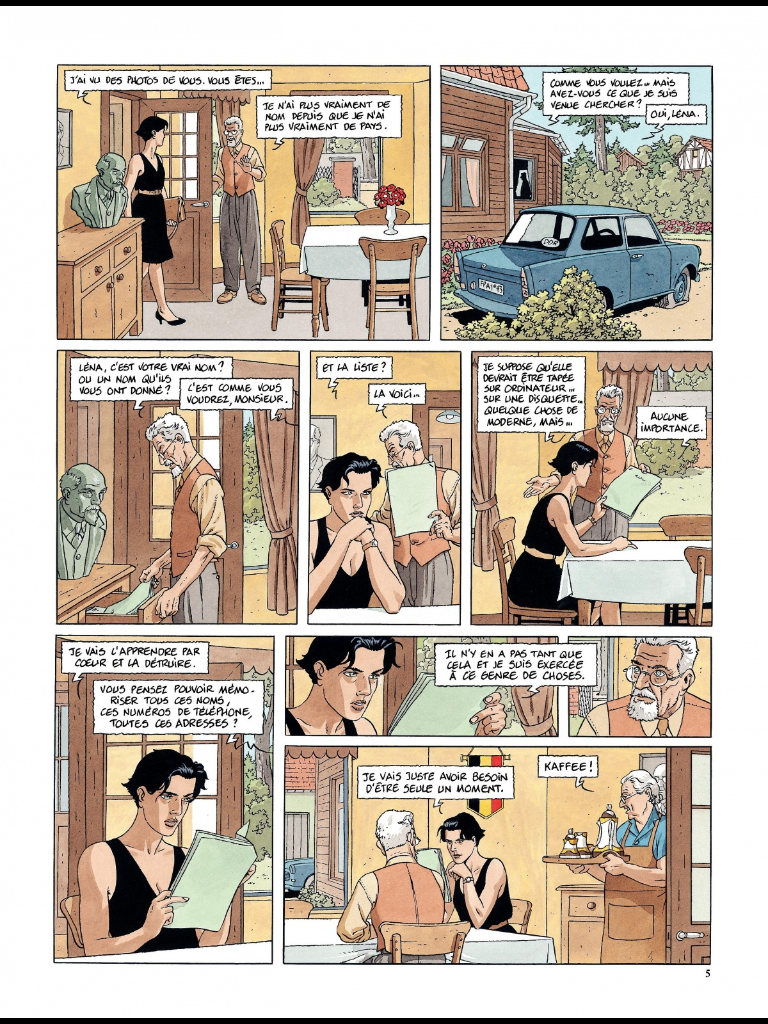
Illustration 4: , p.5 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007.

Illustration 5: Storyboard, planche 4, © André Juillard & Pierre Christin 2005
Ainsi, l’un des principaux moteurs de la curiosité du lecteur est-il interprétable diégétiquement. Léna se présente comme un instrument sans souvenirs, sans désirs et, autant que faire se peut, sans affects: «Toujours rester au-delà de la colère», «calmer des pensées qui tournaient un peu trop vite», «Ne pas penser à ça, aller de l’avant […].» (p. 19, c. 1)40. Se bornant à manifester une sorte d’attention flottante, elle avance sans crainte de s’égarer, d’être en retard ou de rater un rendez-vous. On pense alors à James Bond, dont Umberto Eco avait en son temps montré comment, à partir de la fin du premier volume (Casino Royale), il avait été libéré par son auteur de toute «névrose», de toute interrogation morale, c’est-à-dire que ce dernier avait abandonné toute «psychologie en tant que moteur de la narration». Ayant cessé de s’interroger sur les motivations de ses ennemis et celles de ses supérieurs41, Bond n’est plus qu’une «merveilleuse machine» (Eco 1981: 84). Suite au traumatisme émotionnel qu’elle a vécu, c’est à cet état que semble aspirer Léna. Elle ne s’interroge pas sur la finalité de sa mission, il lui suffit d’avoir un plan. Sa mission lui donne l’occasion de se mettre – paradoxalement – «à l’abri du chaos», après avoir fait l’expérience de l’imprévisible et de l’incontrôlable (Rimé 2005: 297 et 305).
Le désarroi existentiel et moral de Léna refait surface à la page 38, une fois la mission terminée. Il est alors temps d’en venir à l’étrange scène où l’héroïne, emportée par une colère subite, adopte un comportement tout à fait surprenant: elle devient pour la première fois vulgaire («espion de merde», «salopard de manipulateur»), agressive (elle saisit Paul-Marie par le col) et en proie à des stéréotypes de classe (elle s’en prend à sa «particule de merde»). Cet épisode – qui n’est pas développé dans le synopsis – paraît invraisemblable à la première lecture puisqu’il repose sur le soupçon que Paul-Marie aurait décidé de ne pas empêcher l’assassinat du cheikh. Fallait-il produire un peu d’agitation dans un album jusque-là fort calme ou animer le visage trop placide de l’héroïne? S’agissait-il seulement de souligner – au prix d’une invraisemblance – l’ignorance de Léna quant à l’issue de sa mission et son innocence? Ne serait-ce pas plutôt que la machine du scénario d’espionnage cesse alors de fonctionner et que Léna, à l’instar du premier James Bond42, est à nouveau «mûr[e] pour la crise, pour la reconnaissance salutaire de l’ambiguïté universelle» (Eco 1981: 84)? Il est vrai que les explications de Paul-Marie ont de quoi troubler celle qu’il appelle Hélène.
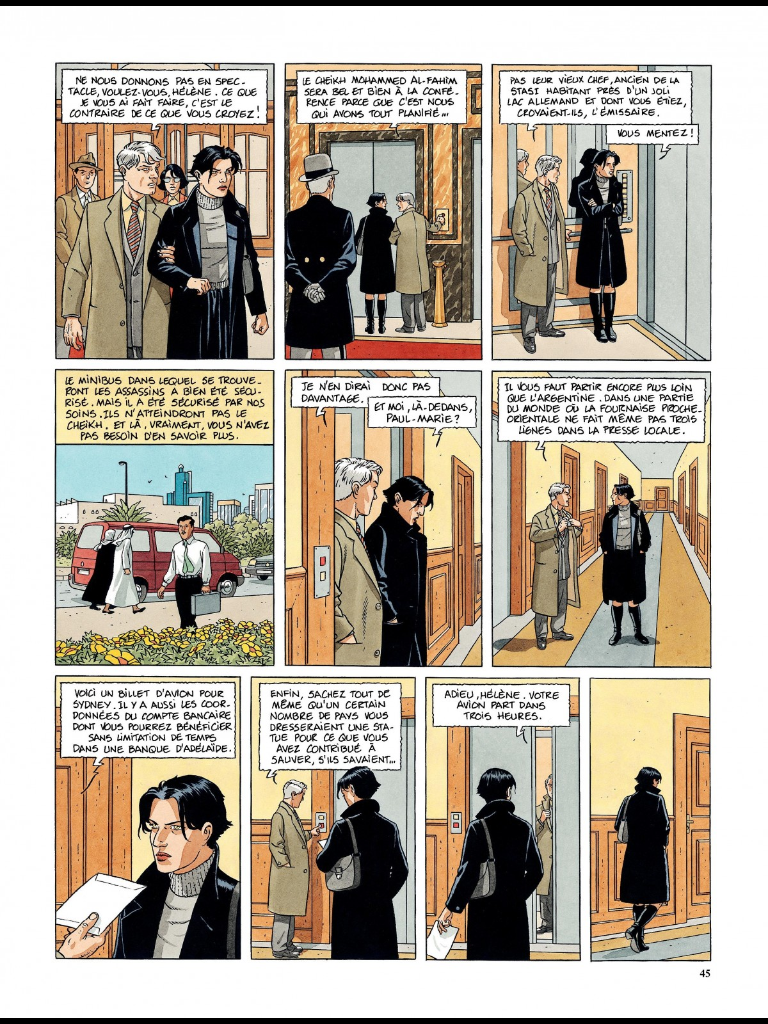
Illustration 6: Le Long voyage de Léna, p.45 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007.
N’apprend-on pas qu’il hésite à qualifier le «vieux maître berlinois» d’ami ou d’ennemi (p. 40, c. 10), que le cheikh a été proche de tous les ceux qui sont chargés de le tuer (pp. 43-44) et que Léna elle-même – elle vient de l’admettre – n’a pas vu en ceux-ci «que des monstres»?
Il y a plus troublant peut-être. Tout au long de son «voyage», le deuil énigmatique de Léna est sans cesse mis en parallèle avec l’effondrement des utopies socialistes. La photographie encadrée de noir qu’elle transporte avec elle entre en écho graphique, dès les premières pages, avec le portrait de Trotsky et le buste de Lénine qui ornent la salle à manger berlinoise, puis, dans d’autres intérieurs, avec des images de Staline, Hafez el-Assad, Mustafa Kemal Atatürk... Croisant les «vestiges» d’un «monde disparu» de Berlin-Est (p. 9), sa voix intérieure dit: «j’ai eu sentiment curieux qu’il n’y avait presque plus rien de vivant autour de moi». Au centre de la ville, sans que l’on puisse savoir de quel passé il est question: «en longeant un pan du mur tout moche, j’aurais pu penser au passé… je ne l’ai pas fait» (p. 10). En Roumanie, l’analogie est encore plus explicite: «je sais qu’il est impossible de faire revivre le passé. Aussi impossible que de faire repartir les usines dévastées de l’époque communiste» (p. 16). Peu après, elle se donnera du courage en prenant pour exemple les statues des «vieux héros prolétariens» (p. 19, c. 1). Elle remarquera, à Kiev, les chantiers abandonnés du port (p. 23), le bâtiment officiel désaffecté devenu un «tombeau» (p. 25). De «l’ancienne Trébizonde», elle soulignera qu’ «il ne restait plus grand-chose de la magie passée» (p. 27). Le plus frappant dans cette lignée sémantique (comment croire que Léna se soit «amusée» en esquissant ce dessin, comme le prétend le projet de scénario) est sans doute la substitution, dans le carnet de croquis, de son mari Antoine en lieu et place de Staline; elle-même, affublée de tresses, se figure assise avec son fils sur les genoux du petit père des peuples (p. 31, c. 6 p. 24, c. 6).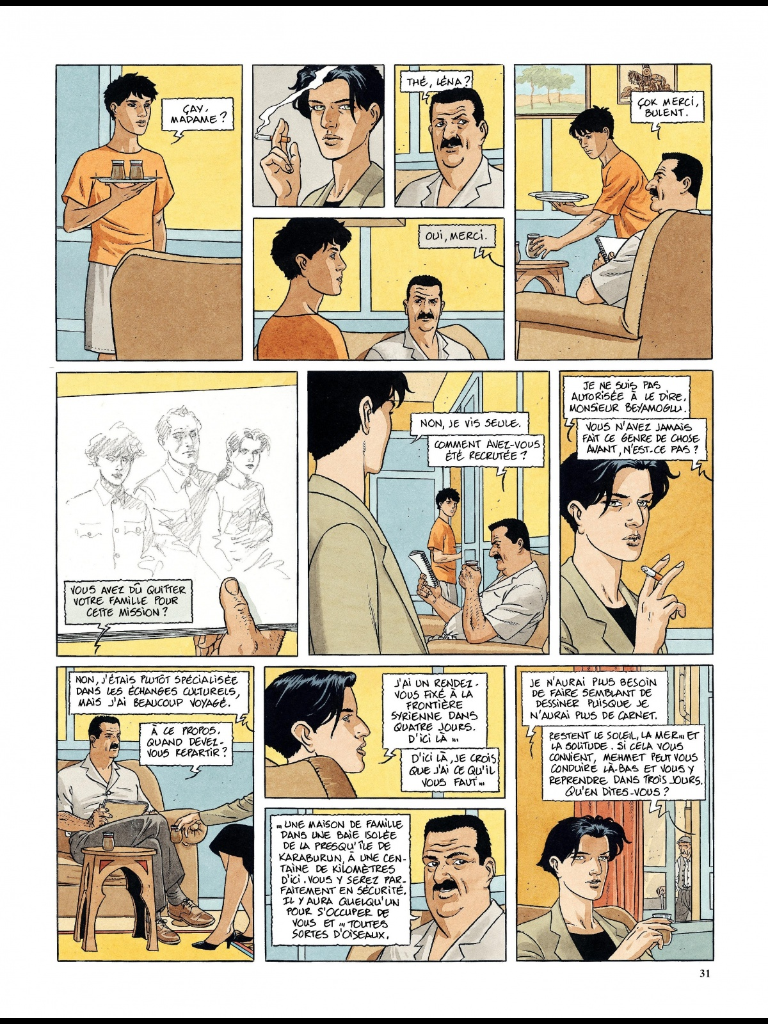 Illustration 7: Le Long voyage de Léna, p.31, © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Illustration 7: Le Long voyage de Léna, p.31, © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
L’effondrement des pays communistes est bel et bien mis en équivalence avec le désastre de son existence. Est-ce exagéré de remarquer que sa vie reposait, elle-aussi, sur une utopie dominée par la figure «paternelle» d’Antoine Desrosières? N’était-elle pas contrainte de suivre son mari, de poste en poste, avec l’unique fonction d’atténuer les effets des déménagements sur le développement de leur fils Sylvain43? Bien qu’ils soient responsables de son deuil, les terroristes que Léna va rencontrer au cours de sa mission ne sont-ils pas comme elle, les orphelins d’une utopie, privés comme elle d’identité (p. 5, c. 1), de rôle (p. 25, c. 2), d’amis (p. 18, c. 1-2)?
C’est alors bien le voyage qui importe à Léna (le chemin) plus que le but (la vengeance). Un voyage qui relie des personnes et non des villes. Il s’agit pour Léna d’expérimenter ce que cela lui fait de parler, de boire un café ou un thé, de serrer la main à ces frères (et sœur) dévoyés. Dès les premières étapes, elle avoue – sans que le lecteur puisse à ce moment comprendre la portée de la remarque – qu’il est «dur» de rencontrer ces «gens» (p. 19, c. 3). On doit alors relire l’album, et s’intéresser à chacune de ces rencontres «éprouvantes» (p. 18, c. 7) et à sa tonalité affective propre: antipathie réciproque envers Imre Sambor et le professeur Danitça — teintée d’agressivité pour le premier, d’ironie pour la seconde; «difficulté à trouver antipathique» Iouri Repitski doublée d’une «joie mauvaise» à le tromper: sympathie possible mais non formulée envers Adnan Beyamoglu qui devine que Léna est séparée des siens et qui partage son goût des baignades solitaires (ce que Paul-Marie ne manquera pas de souligner); méfiance envers les deux frères d’Alep qui ne cachent pas leur mépris. Il n’est rien dit de cet arc-en-ciel affectif dans le synopsis. Rendu perceptible par le «monologue intérieur», il aboutit à ce constat communiqué à Paul-Marie: «Tous ceux que j’ai rencontrés n’étaient pas des monstres» (p. 40, c. 1).
Pierre Christin a voulu que Le Long Voyage de Léna traverse une partie de la planète marquée, au début du XXIe siècle, par les ruines du bloc de l’Est et hantée les spectres de la Guerre froide. André Juillard a pour sa part désiré apporter plus de complexité au personnage principal. Alors que le scénariste assumait la volonté de vengeance de l’héroïne ainsi que sa fonction artificielle de «porte-regard» (Hamon 1981: 185), le dessinateur insiste pour que la finalité de la mission de Léna lui soit obscure et pour que sa détresse soit plus intéressante. Ce faisant, ce dernier accentue le paradoxe originel du caractère de la jeune femme: décidée et intrépide, elle n’en regrette pas moins un passé de femme au foyer dépendante; alternativement, elle se soumet et se révolte contre le scénario de son commanditaire. À vrai dire, aveuglement et paradoxe, soumission et révolte, frisent pareillement l’invraisemblance, mais ils permettent à Juillard de réaliser ce nouage de «l’intimisme» et de la «fresque géopolitique» qui est spécifique au duo qu’il forme avec Christin44. Ce nouage touche peu le niveau de l’histoire; l’articulation des fils étant déjà assurée dans le scénario de Christin, les apports de Juillard à la construction du personnage de Léna seront surtout déterminants pour la construction du récit. D’ordre analogique bien plus que logique, ils consistent à faire entrer en résonance affective la biographie individuelle et la grande Histoire45. La contradiction interne du personnage de Léna, tout à la fois émancipée et nostalgique, entre ainsi en écho avec la situation politique de l’ancienne zone d’influence de la Russie soviétique. Ce réseau d’analogies étant tissé sans souci particulier de l’intrigue, il augmente singulièrement, et de manière à coup sûr inattendue, les difficultés que rencontre toute tentative d’interprétation.
Bibliographie
Anonyme (1765), «Intrigue», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. VIII, p. 845b–846a, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v8-2668-1/
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative, suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Baroni, Raphaël (2017), Les rouages de l’intrigue, Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Barthes, Roland (1981 [1966]), «Introduction à l’analyse structural des récits», in Communications 8, L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, p. 7-33.
David, Jérôme (2012), «Le premier degré de la littérature», Fabula-LhT, n° 9, mars 2012, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://www.fabula.org/lht/9/david.html.
Eco, Umberto (1981 [1966]), «James Bond: une combinatoire narrative», in Communications 8, L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, p. 131-157.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Discours du récit, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1983), Nouveau discours du récit, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.
Greimas, Algirdas Julien (1966), Sémantique structurale, recherche et méthode, Paris, Larousse.
Hamon, Philippe (1981), Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette.
Jaucourt, Louis, Chevalier de (1765), «Nœud», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. XI, p. 185, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v11-681-10/
Jauss, Hans-Robert (1978), Pour une esthétique de la réception[texte allemand 1977], Paris, Gallimard.
Jouve, Vincent (2007), «Les métamorphoses de l’écriture narrative», Protée, n° 34 (2-3), p. 139-152, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2006-v34-n2-3-pr1451/014273ar/
Jouve, Vincent (2019), Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires?, Paris, Armand Colin.
Mallet, Edme François(1751), «Action», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. I, p. 121a-122a, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v1-501-5/
Merlin-Kajman, Hélène (2015), Lire dans la gueule du loup, Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard.
Nünning, Ansgar (2018), «Pour une reconceptualisation de la narration non fiable: une double approche cognitive et rhétorique», in Introduction à la narratologie postclassique, Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Raimond, Michel, La crise du roman des lendemains du naturalisme aux années vingt, Paris, José Corti.
Ricœur, Paul (2008), «La vie: un récit en quête de narrateur», in Ecrits et conférences, t.1: Autour de la psychanalyse, Paris, Seuil.
Rimé, Bernard (2005), Le partage social des émotions, Paris, Puf.
Schaeffer, Jean-Marie (2020), Les Troubles du récit, pour une nouvelle approche des processus narratifs, Vincennes, Editions Thierry Marchaisse.
Scherer, Jacques (1950), La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet.
Souriau, Etienne (1950), Les deux cent mille situations dramatiques, Paris, Flammarion.
Todorov, Tzvetan (1980 [1971-1978]), Poétique de la prose, suivi de Nouvelles recherches sur le récit, Paris, Seuil.
Todorov, Tzvetan (1981 [1966]), «Les catégories du récit littéraire», in Communications 8, L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, p. 131-157.
Ubersfeld, Anne (1989), Lire le théâtre [1982], Paris, Éditions sociales.
Vouilloux, Bernard (2007), «La critique des dispositifs», in Critique, n° 718, p. 152-168.
Annexe
Résumé de l’histoire
Un attentat non revendiqué fait dix-sept victimes dans le quartier de la légation française à Khartoum: parmi les victimes, figurent le mari et le fils d’Hélène Desrosières (Léna). Un ami de Desrosières, Paul-Marie de Calluire, membre des services secrets français, identifie les responsables. Il est informé de la prochaine opération «anti-impéraliste» fomentée par ce groupe de communistes dirigé par un ancien membre de la Stasi. Il s’agit d’assassiner un cheikh dont le rôle sera crucial dans la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient. Le chef du réseau accepte l’aide de Paul-Marie (qu’il a eu l’occasion de fréquenter pendant la Guerre froide). Paul-Marie propose à Léna de contribuer à la neutralisation des terroristes. Léna se présente à Berlin comme le courrier qui doit livrer à chaque membre du groupe – c’est-à-dire en Hongrie, Roumanie, Ukraine, Turquie et Syrie – une partie des moyens et des données nécessaires au nouvel attentat. De ce projet, Léna ignore la cible. Ce n’est qu’une fois sa mission achevée que Paul-Marie l’en informe. Il lui cache en revanche le sort qui les attend. À Dubaï, sur le point de commettre leur forfait, ils explosent dans un véhicule piégé, pendant que Léna est en route pour l’Australie. Sur une plage, elle rencontre un veuf et son jeune fils.
Résumé du récit
Léna – on reconnaît la femme de la couverture – se rend dans un quartier de Berlin-Est. Elle a rendez-vous avec un vieil homme, nostalgique de la RDA. Il lui confie une liste de contacts qu’elle apprend par cœur avant de la brûler. Aux adresses et dates qu’elle a mémorisées, elle rencontre successivement six personnes à qui elle donne l’un des objets qu’elle transporte avec elle. Elle livre ainsi une boîte de massepain à Budapest, un flacon de parfum en Roumanie, une trousse pour diabétique à Kiev; on comprend que ces objets contiennent de quoi composer et injecter un poison. Des plans sont ensuite transmis en Turquie et une lettre codée en Syrie; ces deux derniers éléments renseignent les assassins sur la localisation et l’identité de leur future victime. Au fur et à mesure, Léna marque intérieurement sa distance envers les gens qu’elle contacte. À la fin du parcours, on apprend qui est Léna: celle-ci a perdu son fils et son mari dans un attentat perpétré par ceux-là mêmes qu’elle a rencontrés. Les services secrets français lui ont proposé la mission qui doit aboutir à leur neutralisation. À Dubaï, pendant que Léna s’envole à l’autre bout de la planète, les six terroristes explosent dans un véhicule piégé. En Australie, Léna fait la rencontre d’un veuf et de son jeune garçon.
Pour citer l'article
Danielle Chaperon, "Aux confins de la narrativité. Une expérience de lecture: du paratexte à l’interprétation", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022https://www.transpositio.org/articles/view/aux-confins-de-la-narrativite-une-experience-de-lecture-du-paratexte-a-l-interpretation
Voir également :
Une question de point de vue : mode et voix dans "Le Long voyage de Léna"
La notion de «focalisation», devenue usuelle dans l’enseignement de la littérature pour aborder les récits romanesques, est parfois malaisée à proposer en tant qu’outil d’analyse dans la mesure où elle tend à recouvrir une trop grande diversité de phénomènes et présente certains flottements dans sa définition même, posée par Gérard Genette (Genette 1972 : 183-224 ; 1983 : 43-52) et reprise ou discutée par ses continuateurs.
Une question de point de vue : mode et voix dans "Le Long voyage de Léna"
La notion de «focalisation», devenue usuelle dans l’enseignement de la littérature pour aborder les récits romanesques, est parfois malaisée à proposer en tant qu’outil d’analyse dans la mesure où elle tend à recouvrir une trop grande diversité de phénomènes et présente certains flottements dans sa définition même, posée par Gérard Genette (Genette 1972 : 183-224 ; 1983 : 43-52) et reprise ou discutée par ses continuateurs. Ainsi Reuter souligne-t-il dans un ouvrage de synthèse récent à vocation pédagogique l’importance de l’étude du «point de vue» en ces termes :
La question des perspectives est en fait importante pour l’analyse des récits car le lecteur perçoit l’histoire selon un prisme, une vision, une conscience, qui détermine la nature et la quantité des informations. (Reuter 2016: 47)
Force est de constater qu’une telle conception englobante ne facilite guère l’appréhension des phénomènes : la subordination de la transmission d’informations narratives (envisagée de façon quantitative, en fonction d’un degré de restriction) à la construction d’un sujet percevant (étonnamment assimilé ici au lecteur et non au personnage) a en effet pour inconvénient de postuler une corrélation nécessaire entre deux niveaux distincts (le second «déterminerait» le premier). En outre, les notions de «vision» (héritée de Jean Pouillon) et de «conscience» demeurent entachées d’imprécisions : la première parce que la dimension visuelle est conçue de manière métaphorique en littérature et par conséquent s’avère problématique dans une démarche transmédiale, la seconde parce qu’elle porte sur l’accès à un état mental qui est davantage tributaire de choix énonciatifs (il relève donc plus de la voix que du mode).
La comparaison avec des médias visuels et narratifs tels que la bande dessinée ou le cinéma peut a priori sembler commode pour clarifier certaines des facettes de la question du «point de vue», mais elle occasionne souvent de nouvelles confusions. Le présent article entend revenir sur ce cadre théorique à partir d’une analyse de l’album Le Long Voyage de Léna (2006) scénarisé par Pierre Christin et dessiné par André Juillard, et de quelques références ponctuelles à sa suite parue en 20091. Nous souhaitons démontrer à la fois la productivité de certaines notions de la narratologie pour examiner le médium de la bande dessinée (et inversement) ainsi que l’intérêt spécifique de cet album dans le cadre d’un usage pédagogique visant à illustrer les concepts de mode et de voix. Rappelons que le dessinateur André Juillard est l’auteur du Cahier bleu (1994), autre récit centré sur la vie intime d’un personnage féminin qui, à l’instar du célèbre Rashômon (le seul film à être cité par Genette), présente un récit en focalisation interne variable (ou multiple selon les segments racontés) 2.
Prémisses théoriques : focalisation et médias (audio)visuels
Comme dans d’autres moyens d’expression, le fonctionnement du récit en bande dessinée et corrélativement le positionnement du lecteur par rapport à l’histoire racontée dépendent dans une large mesure de choix qui sont effectués par les auteurs quant à la construction du «point de vue» – hyperonyme dont il importe de prendre conscience de la polysémie3 et de l’iconocentrisme4, mais qui a l’avantage de résonner, au-delà du seul champ de la narratologie, avec des aspects envisagés au sein de différents champs disciplinaires5 et à propos tant de représentations visuelles (œuvres picturales, photographie,…) que de productions et dispositifs médiatiques (cinématographiques, vidéoludiques, etc.). Ce qui importe à notre sens, à l’ère des caméras subjectives et des jeux vidéo en «première personne», c’est de discuter dans une démarche intermédiale une notion inscrite dans différentes traditions théoriques en confrontant les acquis de celles-ci sur un objet spécifique, en l’occurrence ici la bande dessinée. Nous nous cantonnerons dans le présent article à envisager le «point de vue» sur deux plans distincts : en termes de réglage épistémique de l’accès (plus ou moins restreint) à des informations pertinentes pour la compréhension du récit (la «focalisation»au sens de Genette)6 et de subjectivisation de la représentation par l’éventuel filtre d’un personnage (ou, comme nous le verrons, par la présence récurrente de ce dernier à l’image). Cette dernière s’opère notamment (mais non exclusivement) à un niveau perceptif : il s’agit du point de vue (au sens strict) ou du point d’écoute pour la composante auditive (suggérée ponctuellement dans le médium «muet» de la bande dessinée par le truchement, notamment, de bulles et onomatopées).
L’absence de distinction entre ces deux niveaux (épistémique et perceptif), comme l’a montré Raphaël Baroni (2020) dans un récent état de la question, explique la plupart des réserves adressées à la typologie genettienne de la focalisation. Baroni fait le constat qu’il faut «admettre une articulation possible entre deux manières très différentes d’aborder la question de la perspective narrative» (2020: 33), et ce d’autant plus lorsque l’objet d’étude, à l’instar de la bande dessinée, offre une représentation visuelle dont l’examen ne peut se satisfaire d’une acception flottante initialement pensée pour le récit romanesque:
Les récits graphiques et audiovisuels apparaissent en effet comme des révélateurs d’un risque de confusion entre deux phénomènes très différents : d’un côté, le réglage de l’information narrative, de l’autre, la construction d’une vision subjective, qui passe par des procédés formels spécifiques.» (Baroni 2020: 34)
Dans une perspective transmédiale analogue, nous privilégierons des modèles non spécifiquement élaborés pour le récit scriptural. Une approche comme celle d’Alain Rabatel visant à étudier les marqueurs linguistiques de la représentation de perceptions subjectives en proposant un modèle alternatif aux «efforts genettiens et post-genettiens de définition du foyer reste[raie]nt marqués par une sorte de primat phénoménologique de la vue» (1998: 8) pourrait certes contribuer à l’étude de la genèse d’un album (via des documents scénaristiques7) ou ponctuellement à la part verbale du récit bédéique, mais elle nous conduirait à faire l’impasse sur les principales propriétés d’un moyen d’expression qui repose sur une interaction entre texte et images.
Ainsi n’est-ce pas un hasard si c’est précisément dans le champ de l’étude du récit filmique que les deux phénomènes distingués par Baroni ont été envisagés conjointement sans être pour autant confondus : François Jost, dans l’ouvrage L’Œil-caméra (1987) auquel se réfère Baroni, distingue la focalisation qui a trait au savoir de l’ocularisation (ou auricularisation) qui concerne le voir (ou l’entendre), dédoublant de la sorte, avec quelques nuances, les critères sur lesquels repose la typologie genettienne. Ainsi l’ocularisation zéro est définie par le fait que la caméra «ne prend la place d’aucun œil interne à la diégèse» et l’ocularisation interne par le fait que «le spectateur s’identifie ponctuellement au regard du personnage» (Jost 1987: 26). Cette dernière est dite primaire lorsque des éléments internes à l’image renvoient à la présence du regard d’un personnage, et secondaire «lorsque la subjectivité de l’image [au sens strictement perceptif] est construite par le montage, les raccords» (Jost 1987: 27). On peut ajouter que Bordwell et Thompson, pour leur part, abordent dans le domaine des études cinématographiques ce qu’ils appellent le «champ informatif» du récit filmique, respectivement sous l’angle de son étendue (degré de restriction) et de sa profondeur (degré de subjectivité), témoignant ainsi d’un même souci de distinguer deux types de phénomènes8 (2009: 141-147). Leur conception graduelle ne permet toutefois pas d’isoler des types de configuration narrative, commodes selon nous pour définir un régime dominant dans un segment donné du récit analysé, fût-ce pour montrer, à travers les particularités que présente ledit segment, en quoi il diffère du type prévu par la théorie. On pourrait à ce titre affirmer que chaque changement majeur de type de focalisation (niveau épistémique) ou d’attribution d’un statut de sujet percevant à un personnage (niveau perceptif) introduit dans le récit une nouvelle «séquence» qui s’inscrit plus généralement dans une architecture rythmique globale qui influence notre expérience de lecture ou de visionnement, et dont il est possible de rendre compte dans l’analyse. C’est pourquoi nous opterons pour la typologie de François Jost, et ce en dépit de la gymnastique articulatoire qu’exige à l’oral la prononciation des néologismes proposés. La distinction postulée par Jost entre «cognitif» et «perceptif» demeure toutefois redevable d’un modèle (genettien) peu adapté à l’étude de l’inscription d’une subjectivité, puisque celle-ci ne peut se réduire à la présence d’un sujet de la perception.
Nous en voulons pour preuve la discussion, chez les théoriciens du cinéma, des effets d’un usage systématique de la caméra subjective («POV-shot» en anglais, terme qui souligne la polysémie du point of view)9. Il a en effet été discuté en quoi ce procédé qui assoit l’ocularisation interne n’implique pas nécessairement une focalisation interne ni ne favorise l’accès à la «psychologie» du personnage dont nous partageons la perception. Au contraire, le rejet hors-champ constant du visage (sauf présence de miroirs) résultant d’une assimilation de la caméra à l’emplacement supposé des yeux du personnage enraie l’expression d’une subjectivité qui, au cinéma, passe surtout par la monstration à l’écran du jeu de l’acteur ou de l’actrice. La caméra subjective postule en outre que les personnages regardés par le sujet diégétique nous regardent (plutôt qu’ils ne se regardent au sein d’une diégèse supposément close et autonome). C’est pourquoi les usages de la caméra subjective au cinéma se veulent le plus souvent «déshumanisants» au sens où ils sont rapportés à des êtres caractérisés par une altérité totale (du moins lorsque la production de l’image n’est pas motivée au sein même de la diégèse par un personnage-filmeur)10 : le regard que nous partageons y est de manière récurrente celui d’une froide machine à tuer (prolongement morbide de la caméra))11. L’essor des jeux vidéo en «First Person», s’il a contribué à populariser le procédé au cinéma12, n’invalide pas fondamentalement ce constat : dans un tel médium interactif, le rapport à l’avatar vidéoludique consiste surtout en l’exploitation d’un élément actionnable plutôt qu’en l’identification à un personnage13. Même si, en bande dessinée, la référence au cinéma transparaît dans un recours à une ocularisation interne ancrée de manière récurrente dans un même personnage (par exemple dans les planches dédiées, dans le roman graphique From Hell, au futur tueur14), ce constat a priori paradoxal d’une «caméra subjective» faiblement chargée en «subjectivité» est considérablement affaibli pour trois raisons: le médium ne met pas en jeu la construction socioculturelle de la vedette qui incarne un personnage (en le chargeant de sa persona à laquelle peuvent être associés des affects) – le personnage, à la rigueur, y est une star en soi ; l’ocularisation interne n’implique pas un jeu d’occultation/exhibition d’un dispositif technique de prise de vues (même si son corolaire, le «regard à la caméra», vise aussi le lecteur) ; enfin, le degré de stylisation de la représentation dessinée du personnage, lorsqu’elle est soumise comme chez Juillard aux conventions graphiques du dessin réaliste, fait de l’expression faciale et corporelle du protagoniste un canal qui offre, comparativement à la caricature humoristique, beaucoup moins de lisibilité à l’expression de l’intériorité, au même titre que le texte écrit ne peut guère rendre compte du grain d’une voix, sauf expédients ponctuels de type onomatopéique. Il s’agit là de limites discutées dans le présent dossier par Alain Corbellari, pour qui «l’adhésion et l’identification du lecteur aux personnages […] sont souvent inversement proportionnelles à l’effort mimétique déployé par le dessinateur» (même s’il ne faut pas négliger combien l’exhibition de l’acte de graphiation, pour reprendre le terme de Marion 1993, amoindrit l’immersion dans la fiction et par conséquent l’identification à des personnages qui, souvent, sont précisément fortement stétéotypés). Nous verrons que les auteurs du Long Voyage de Léna ont su tirer parti de ces limites intrinsèques. Car rien n’interdit de jouer précisément sur cette ambiguïté pour établir un certain régime de subjectivité, et il ne fait pas de doute que dans l’album que nous étudions, le scénario de Christin était spécifiquement prévu pour le style graphique déjà bien établi de Juillard.
Le parti de Léna
Nous examinerons ici en détail les partis-pris de Christin et Juillard en termes de focalisation (restriction du champ informatif) et de point de vue (dans le sens spécifique de l’ocularisation). Une première évidence consiste à noter qu’il n’est pas besoin de voir à travers les yeux de Léna, courrier qui transmet des informations entre les membres d’un réseau terroriste et s’avère être un agent infiltré, pour partager le vécu de la jeune femme. Comme nous l’avons exposé ailleurs, la notion de «point de vue», considérée comme un hyperonyme, ne se réduit pas aux aspects mentionnés jusqu’ici : les choix concernant la modalisation du discours narratif procèdent plus fondamentalement d’un positionnement idéologique des auteurs qui transmettent, qu’ils le veuillent ou non, une certaine opinion sur le monde (Boillat 2006). Aussi, dans Le Long Voyage de Léna, il n’est pas anodin que cela ne soit pas avec l’équipe internationale de comploteurs que Christin et Juillard solidarisent leur lecteur comme cela se serait produit s’ils les avaient élus en tant que personnages sur lesquels le récit est focalisé – cette mise à distance sera encore plus marquée dans le deuxième tome par rapport aux djihadistes –, et si, inversement, la prise en charge énonciative du récit de l’assassinat des terroristes, qui s’amorce à la page 44 et s’achève sur les trois cases de l’explosion de la page 5315, n’est plus assumée, comme dans les deux premiers tiers de l’album, par l’héroïne qui, jusque-là, s’exprimait à la première personne dans les textes de récitatifs. Cette «voix intérieure» du personnage a en outre un impact spécifique sur le lecteur en ce qu’elle assure, de manière continue, la présence verbale du personnage de Léna, et de la sorte garantit sa disponibilité à l’adhésion affective du lecteur, et ce même si les énoncés s’avèrent peu modalisés. Dans un ouvrage ultérieur à L’Œil-caméra, François Jost mentionnait de manière incidente (et à notre connaissance jamais reprise dans les discussions sur ces questions) un aspect qui constitue peut-être encore une autre facette du «point de vue», ou du moins qui est irréductible au caractère strictement quantitatif de la focalisation selon une conception empruntée par Genette à Todorov (1966), et qui stipule que le savoir du lecteur est inférieur, égal ou supérieur à celui du personnage:
En termes cognitifs, qu’est-ce que la focalisation interne ? C’est, pour celui qui raconte, décider, consciemment ou non, que l’on va faire partager au lecteur ou au spectateur la vie du personnage, comme il est censé l’appréhender ou l’avoir appréhendé […]. Pour que l’on sache comme il sait (non pas : ce qu’il sait), on doit éprouver comme lui. La focalisation vise à faire partager une impression. (Jost 1991: 43).
Ce passage du quoi au comment, de la connaissance à l’émotion n’est en fait guère favorisé par la conceptualisation de la focalisation, trop ancrée dans un cadre (post)structuraliste pour tenir compte des modalités d’absorption diégétique du lecteur/spectateur. Or, le «long voyage» qui fut d’abord celui de Christin (lorsqu’il prit des clichés qui serviront de matériel documentaire16) est certes rapporté à Léna, mais il est aussi celui du lecteur de l’album : sans voir à travers ses yeux, sans en savoir autant qu’elle sur les raisons de sa présence dans les lieux successivement visités, le lecteur appréhende le monde fictionnel par le biais de l’expérience qui est la sienne. Bien que le texte du récitatif thématise une forme de blocage d’une subjectivisation des énoncés («J’aurais pu penser au passé… Je ne l’ai pas fait», p. 10, «Cette nuit-là encore, j’ai dormi sans rêves», p. 20, ou «J’essayais seulement d’être lisse, fraîche et sans mémoire», p. 32) – blocage qui certes rappelle la fuite en avant perpétuelle des héros de séries BD d’aventure mais qui, par la thématisation même qui est proposée dans le monologue intérieur, ne fait qu’accroître l’importance de la psychologie énigmatique du personnage et renforce chez le lecteur le régime de la curiosité –, l’omniprésence du corps de Léna à l’image et de sa pensée dans le texte assurent l’identification du lecteur au personnage.
En tant que premier tome qui fut initialement conçu comme un one shot, Le Long voyage de Léna est particulièrement intéressant pour discuter la question de la focalisation en BD dans la mesure où le lecteur ne sait encore rien du personnage éponyme dont les motivations et intentions ne sont dévoilées que tardivement, et ce bien que le récit soit focalisé sur Léna, que nous ne quittons jamais. Ce paradoxe tient à plusieurs choix scénaristiques. Premièrement, le récit débute en pleine action, soit par la première visite de Léna à Berlin-Est: ainsi, rien ne nous est dit de la préparation de sa mission, des conditions de son départ, etc. Cette logique immersive est soulignée par une structure parente de celle du journal de voyage, où Léna agit au jour le jour, bien que les temps verbaux du récitatif soient au passé – sans, notons-le, que cette dimension rétrospective ne soit exploitée sur le plan épistémique, contrairement à ce qui se passe dans le récit de Léna et les trois femmes17. D’ailleurs, le temps verbal du présent s’impose dès la page 38, ce qui correspond au moment où Léna Muybridge a achevé sa mission, et s’apprête donc à revenir, après la série d’aventures vécues en tant qu’agente secrète, à la vie quotidienne associée à son vrai nom, Hélène Desroisières, qu’elle apprend au lecteur précisément en ce moment-pivot du récit, alors que l’image nous la montre acheter un billet d’avion et un manteau en prévision de sa véritable destination.
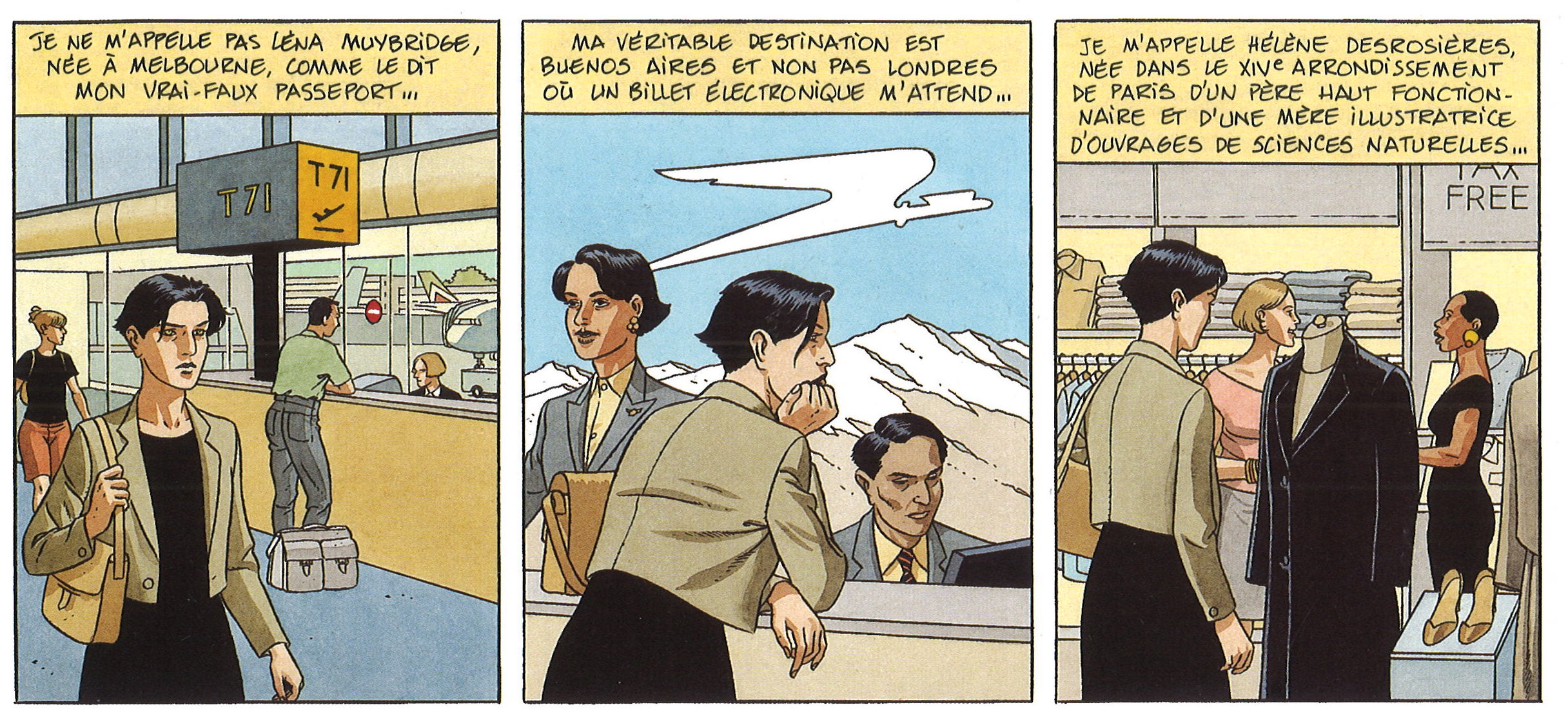
Image 1: Le Long Voyage de Léna, p. 38 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Deuxièmement, le texte des récitatifs sont certes rédigés à la première personne et attribués à Léna, mais le récit demeure «behavioriste», s’en tenant la plupart du temps à décrire ou commenter ce que perçoit la jeune femme (et que le lecteur voit à l’image), rarement ce qu’elle ressent et jamais ce qu’elle prévoit de faire ; son passé, dont on comprendra qu’elle essaie de refouler le caractère douloureux (la natation lui permet de faire le vide, d’être «sans mémoire», p. 32, c.5), ne fait surface que par bribes, par le biais de traces diégétiques (une photographie et une K7 audio de chansons) – interprétables en tant que signes d’une perte, et donc en tant que marqueurs de subjectivité –, jusqu’au dévoilement de la page 38 (image 1), où Léna, montrée dans la dernière case de la planche précédente dans une attitude de repli introspectif (corps détendu, écouteurs sur les oreilles, yeux mi-clos), nous donne sa véritable identité: c’est donc le personnage même qui assume de nous en apprendre plus sur lui-même, sans intercession d’une autre instance narrative. Les vignettes en noir/blanc, ici, servent la «background story» du personnage, longtemps différée.
Troisièmement, au vu du caractère secret de la mission de Léna et du fait que ses interlocuteurs agissent dans la clandestinité, les dialogues sont allusifs. Léna voyage seule (elle n’a ni confident ni acolyte qui justifierait une explicitation verbale diégétique) et n’a aucun contact avec ceux qui lui ont confié sa mission afin de ne pas être repérée (on sait combien les situations de télécommunication sont favorables à la transmission naturalisée d’informations au lecteur, comme cela est fréquemment le cas dans la série Blake et Mortimer, dont Juillard est l’un des continuateurs). Les personnes qu’elle rencontre comme autant de jalons sur son parcours sont par ailleurs peu loquaces jusqu’à l’homme de Kief, ex-membre du KGB, un bavard dont les répliques vont permettre au lecteur, après avoir lu vingt planches, de confirmer certaines inférences qu’il avait pu émettre quant au contexte narratif. Ainsi, on trouve dans les bulles attribuées à l’Ukrainien la première mention du terme «terrorisme» qui occasionne ensuite, dans une vignette étroite qui suggère un statut de bref aparté, un positionnement fort du personnage principal: «Moi, Léna […], je ne suis pas une terroriste» (p. 24, c. 5). À l’occasion de cet échange, pour la première fois, Léna laisse transparaître dans le récitatif (c’est-à-dire à l’intention du seul lecteur) son ressenti et livre une information sur la manière dont elle se positionne par rapport à la cause anti-impérialiste des membres du réseau secret: «Et je n’ai pu m’empêcher d’éprouver une joie mauvaise en constatant la légère erreur d’analyse du bavard18»(p. 26, c. 5). L’adhésion du lecteur au point de vue de Léna (au sens idéologique du terme) est favorisée par l’explicitation de la non-adhésion de celle-ci à la cause de ses interlocuteurs (et futures victimes).
Finalement, Léna elle-même ne maîtrise pas le plan d’ensemble du projet. En effet, elle ne dispose que de certaines pièces du puzzle, et à ce titre se distingue foncièrement de ceux «pour lesquels la fin justifie les moyens» (p. 23, c. 10). Léna ayant étudié l’histoire de l’art (l’une des rares informations qu’elle transmet à ses interlocuteurs et qui n’est pas mensongère), elle utilise un comparant pictural pour décrire son rôle dans l’opération: «Je ne suis chargée que de fournir le petit matériel de peinture […], je ne sais même pas ce que représentera la scène finale» (p. 25, c. 7). La séquence finale, en effet, comme nous le verrons, se déroule indépendamment d’elle.
Léna, une figure omniprésente offerte aux regards
La dimension visuelle du médium bédéique nous invite à considérer un aspect qui paraît tout à fait évident dans une démarche intuitive mais qui n’est que rarement mentionné dans les théories sur le point de vue: il s’agit simplement du degré de présence à l’image d’un personnage donné19. En bande dessinée, le fait de tracer successivement dans chacune des cases (ou presque) la silhouette du héros ou de l’héroïne dont la récurrence participe souvent à la cohérence graphique de la planche (par exemple le motif du groom à la tenue rouge dans Spirou) constitue pour le dessinateur un véritable défi et une contrainte laborieuse, et ce en raison du fait que cette apparence doit demeurer reconnaissable en dépit des changements d’angle, d’échelle de plan, etc., puisque le Même – l’identité du sujet – doit être maintenu dans la variation. Montrer le personnage, c’est offrir l’occasion au lecteur d’être «avec lui»: l’identification, tant narrative qu’émotive, commence par là.
La question de l’identification au personnage principal se pose de manière d’autant plus légitime dans Le Long voyage de Léna que l’héroïne est mentionnée dès le titre (et ce avant même que les auteurs aient prévu d’en faire le personnage d’une série) et que sur la couverture de l’album elle apparaît seule, pensive, à l’avant-plan d’un fond maritime qui l’inscrit dans un paysage tout en contribuant à assoir sa centralité (son visage se trouve au milieu de l’image, exactement sous la mention du nom «Léna20») ; cette position centrale – prémices du statut de personnage focal assuré par le «Je» du récitatif– se voit en outre renforcée par le contraste qu’impose la tenue sombre de Léna avec le jaune lumineux de l’environnement (significativement, le ciel n’y est pas bleu, ce qui permet aux contours du visage et même à la couleur de la peau modelée par des ombres propres de se détacher de l’arrière-plan21).
Un repérage quantitatif de la présence ou de l’absence du personnage de Léna dans chacune des vignettes – indépendamment des modalités de représentation du visage de l’héroïne, discutées dans ce dossier par Alain Corbellari – s’avère instructif: on observe que, même si l’héroïne n’apparaît dans certaines cases qu’en très petit, sous forme de silhouette22 ou seulement partiellement – c’est-à-dire selon un procédé relevant de la métonymie, qu’il s’agisse d’une main (p. 6, c. 9) ou de jambes (p. 8, c. 8) –, elle est présente visuellement23 à l’échelle de l’album dans 70% des vignettes (484 cases sur 54 planches, soit près de 9 images par page en moyenne), parfois même dans chaque image d’une même planche (aux pages 23, 24 et 25, ou 34-35). Par ailleurs, le 30% des cases restantes comporte nombre de contrechamps sur les interlocuteurs de Léna, ce qui inscrit en creux la présence du regard de celle-ci (on peut, sur ce point, assimiler mutatis mutandis la juxtaposition des cases au montage cinématographique, et concevoir ces images comme une ocularisation interne secondaire24). Un autre type de présence de Léna, spécifique à cet album, réside dans des vignettes qui incluent une image noir/blanc présente en tant qu’objet dans la diégèse: une photographie du couple qu’elle formait avec son mari décédé (p. 38, c. 425) ou l’autoportrait dessiné par Léna sur son carnet à dessin (p. 47, c. 4). La mise en scène du regard porté sur les croquis diégétisés constitue d’ailleurs l’un des rares cas d’ocularisation interne (primaire) sur l’un des personnages principaux26, en l’occurrence Léna (p. 29, c. 9, image 2) puis, après un passage de relais qui s’effectue au moment où le lecteur tourne la page de l’album, sur le Turc Adnan (p. 30, c. 5-7 et 9, après deux cases «semi-subjectives» où il apparaît en amorce, image 3).
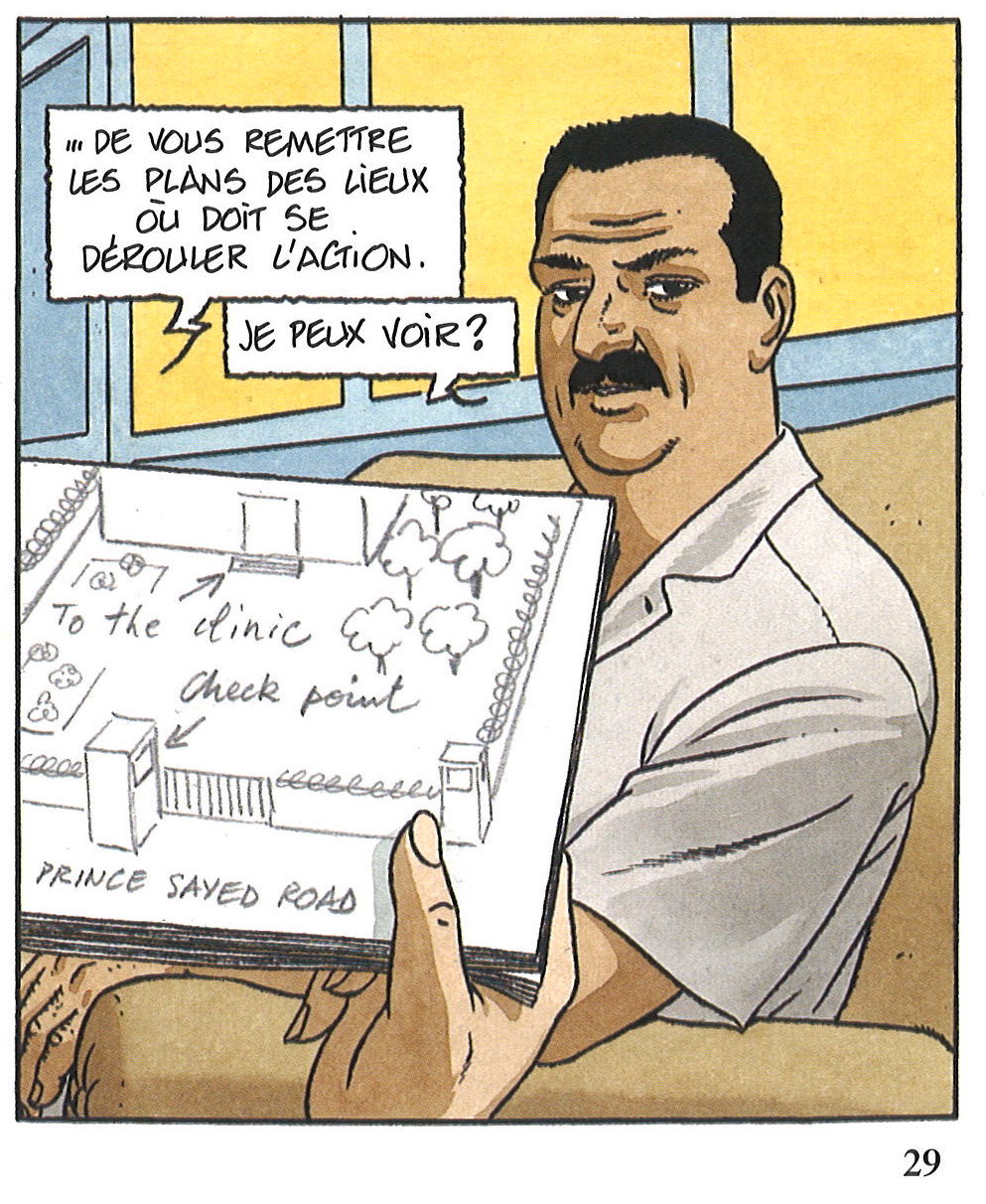
Image 2: Le Long Voyage de Léna, p. 29 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin2007

Image 3: Le Long Voyage de Léna, p. 30 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Ce qui importe avant tout sur un plan quantitatif et à l’échelle de l’album, c’est la répartition du nombre de visualisations de Léna par planche: on constate en effet un changement de régime qui s’amorce à la page 46, avec une séquence d’images qui repose sur un principe d’alternance entre des gros plans de Léna dans l’avion et la piste narrative consacrée à la tentative avortée d’assassinat qui se déroule dès lors en dehors d’elle, mais selon ce qu’elle a prévu (d’où le rappel de son visage, alors que l’on peut supposer qu’elle pense à ce qui se passe ailleurs, ou peut-être le rêve). Ici encore, la centralité de Léna est signifiée graphiquement en ce que, sur huit pages consécutives (p. 46-53), elle figure systématiquement dans une case située exactement au milieu de la planche, comme si toutes les autres vignettes gravitaient autour d’elle. Cette récurrence a été prévue et soulignée au stade du découpage préparatoire (story-board), où la case centrale de chacune de ces planches est mise en évidence par une hachure bleue (voir l’article de Raphaël Baroni dans le présent dossier). À la page 47, nous ne quittons pas les terroristes à Dubaï mais Léna est néanmoins présente sous la forme d’une «image dans l’image», un portrait dessiné que l’un des protagonistes tient en main et oriente en direction du lecteur, en une sorte de réciproque de la case où Pierre-Marie tend la photo de l’équipe de terroristes à Léna (et au lecteur) pour accréditer ses dires (sa réplique débute significativement par l’interrogation «Vous voyez ?»). Si on se concentre sur le segment compris entre la première page de l’album et la 45, la présence de Léna grimpe à 78% des vignettes (ce qui est un chiffre considérable au vu de la place accordée par ailleurs à des paysages vides de tout personnage principal) ; elle figure en outre dans presque chaque image des trois dernières planches.
Ocularisation et focalisation
La conjonction de la forte présence de Léna et du régime dominant de l’ocularisation zéro conduit d’une part à l’exhibition du corps de l’héroïne offerte au regard du lecteur (en particulier lorsqu’elle se baigne nue aux pages 8-9, alors qu’elle n’est vue de personne27), d’autre part à ce qu’aucun autre personnage ne soit construit en tant qu’instance percevante et par conséquent ne vienne concurrencer l’identification au personnage éponyme. Quelques cases font toutefois exception en venant ponctuer le récit à des moments bien spécifiques.
Il s’agit premièrement de deux passages où le lecteur, l’espace d’une seule case venant clore une page de droite (p. 7, c. 10 ; p. 13, c. 11, image 4), reste avec l’interlocuteur de Léna qui la regarde s’éloigner, comme si la seule présence masculine au premier plan faisait peser sur elle une menace dont elle ne semble pas avoir conscience, le lecteur constatant (sans gain épistémique aucun) qu’elle est observée à son insu (et ce d’autant plus qu’il s’apprête à ce moment-là à tourner la page, et ne peut donc anticiper la suite d’un simple regard). Cette impression est également distillée souterrainement, sur un mode proche de ce que l’on trouve dans la série Blake et Mortimer28, par la représentation de l’environnement de Léna dans d’autres cases de l’album dans lesquelles des «figurants» se situent au premier plan dans une posture qui pourrait être lue de manière paranoïaque comme visant une surveillance de l’héroïne29. Dans l’un des cas (p. 17, c. 8, image 5), cette finalité du regard est confirmée, mais sans intention d’entretenir un suspense quant à ce protagoniste à lunettes noires, puisqu’il a tôt fait d’être identifié comme l’agent censé conduire Léna à la gare. Il n’en demeure pas moins que ces jeux de regard soulignent l’instabilité de la situation de l’héroïne qui, dans le récitatif, souligne son sens aigu de la précarité des choses (p. 20, c. 7 ; p. 32, c. 9).

Image 4: Le Long Voyage de Léna, p. 7, cases 9 et 10 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007

Image 5: Le Long Voyage de Léna, p. 17, case 8 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Deuxièmement, nous pensons à une case (p. 21, c. 7) dans laquelle s’opère un déblocage inattendu puisqu’elle montre un personnage féminin dont il s’agit de l’unique occurrence dans l’album et qui, situé au premier plan de l’image, observe Léna sur le bateau d’en face (sans que la case réciproque du regard de l’héroïne sur elle ne soit dessinée). Cet apax ne reste pas sans explication: dix-neuf pages plus loin, l’agent secret Paul-Marie confie à Léna, surprise qu’il soit au courant de ce qui s’est passé dans le delta du Danube, qu’une des leurs se trouvait parmi l’équipage des écologistes, et «qu’elle a vu un bateau se dissimuler sous les arbres et [les] en a informés» (p. 40, c. 4).
Dans une telle intrigue d’espionnage, comme le souligne la référence à cette informatrice, la circulation du savoir est bien sûr centrale. Cependant, Léna, à l’instar du lecteur, est placée en dehors de ce circuit pendant les deux premiers tiers de l’album. Sur un plan quantitatif, on peut donc définir la focalisation de la manière suivante (en reprenant les termes de Baroni 2020):
Récit personnel de Léna – focalisation restreinte jusqu’à la page 38:
Terroristes < lecteur (indices) < Jean-Marie / Léna
Récit du projet d’assassinat – focalisation sur Léna impliquant une forte restriction jusqu’à la page 40:
Lecteur = (<) Léna (consignes à transmettre) < membres du réseau terroriste < Jean-Marie.
On observe par conséquent une importante stabilité dans l’instauration du régime de focalisation, fixe lorsqu’elle s’effectue sur Léna, portant sur un ample segment narratif lorsqu’elle est restreinte.
Les albums plus récents se départiront quelque peu de cette régularité qui a trait au fait que Léna, au cours de son «long voyage», se laissait en quelque sorte porter par les flots. Ainsi, au début de Léna et les trois femmes, un montage alterné s’instaure entre deux pistes: l’une est consacrée à la traversée en jeep de Léna dans le désert australien, l’autre aux agents secrets pour lesquels elle a travaillé dans l’aventure précédente, qui la suivent en espérant la convaincre d’accepter une nouvelle mission. Sur la première planche, ces deux pistes sont intriquées d’une manière qui ne se comprend que rétrospectivement, du moins pour un lecteur peu habitué à la représentation «paranoïaque» de Juillard: si un homme téléphone dans une cabine au premier plan de la cinquième case (qui prend un format large pour mieux inclure l’environnement de Léna, image 6), c’est qu’il est en train d’informer l’agent des renseignements de la présence de Léna à la station-service. Léna et le lecteur ne l’apprendront que plus tard de la bouche de Paul-Marie (p. 8, c. 6). Il s’agit donc, à ce stade, d’une focalisation du récit sur Léna postulant une équivalence relative entre ce que sait cette dernière et ce qu’apprennent progressivement les lecteurs.
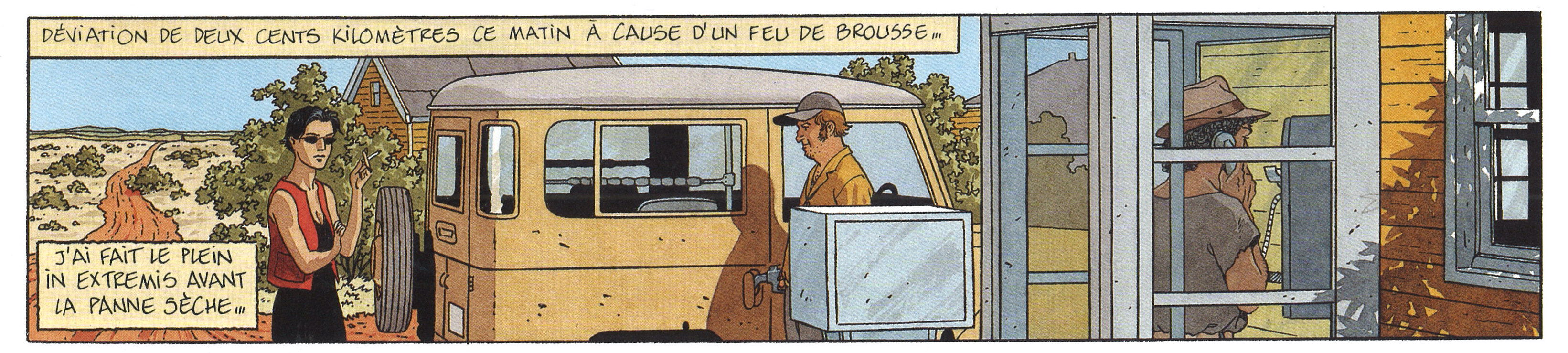
Image 6: Léna et les trois femmes, p. 3, case 5 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2009
Cette focalisation s’accompagneà la page suivante d’une alternance entre des gros plans sur Léna et des images visualisant ses proches disparus vers lesquels voguent ses pensées, comme le confirme le monologue intérieur – ce dernier provoque une césure moins forte avec le présent de l’image que les récitatifs du premier album30). La case longitudinale de la page 5 – située approximativement au même endroit dans la planche que la précédente à la page 3, instaurant ainsi une parenté graphique avec celle-ci – modifie quant à elle ce régime (image 7): nous voyons deux hommes – dont un n’est pas reconnaissable, son visage demeurant hors-champ (il s’agit d’une paralipse visuelle) – manigancer quelque chose: ils libèrent un kangourou pour le lancer sur la route empruntée par Léna, dressant devant elle un danger dont la vraisemblance a été suggérée précédemment par un panneau de circulation quelque peu exotique pour un lecteur français. Il faut remarquer que le gain épistémique acquis par le lecteur sur Léna dans ce passage est faible: certes nous savons que Léna est suivie, mais nous ne savons ni pourquoi, ni par qui, ni dans quelle intention. Seul le dialogue de la page 8 entre Léna et Paul-Marie réinstaure une équivalence épistémique entre Léna et le lecteur, et permet à ce dernier d’accéder aux informations obtenues par l’héroïne au stade de son recrutement. Lors de sa préparation proprement dite, qui est assortie dans la diégèse d’une projection de diapositives, la transmission des renseignements se veut particulièrement didactique. On observe donc une inversion par rapport au premier tome, où les explications éclairantes de Paul-Marie n’interviennent que dans la dernière partie du récit, alors que dans Léna et les trois femmes, que l’on pourrait considérer comme le développement d’une case du premier volume où Léna croise des passantes voilées («une sombre cohorte venue de je ne sais où est passée près de moi», p. 33, c. 5), ces éclaircissements, après avoir été quelque peu différés suite à une ellipse (p. 11, c. 8-9), constituent la phase liminaire du récit.
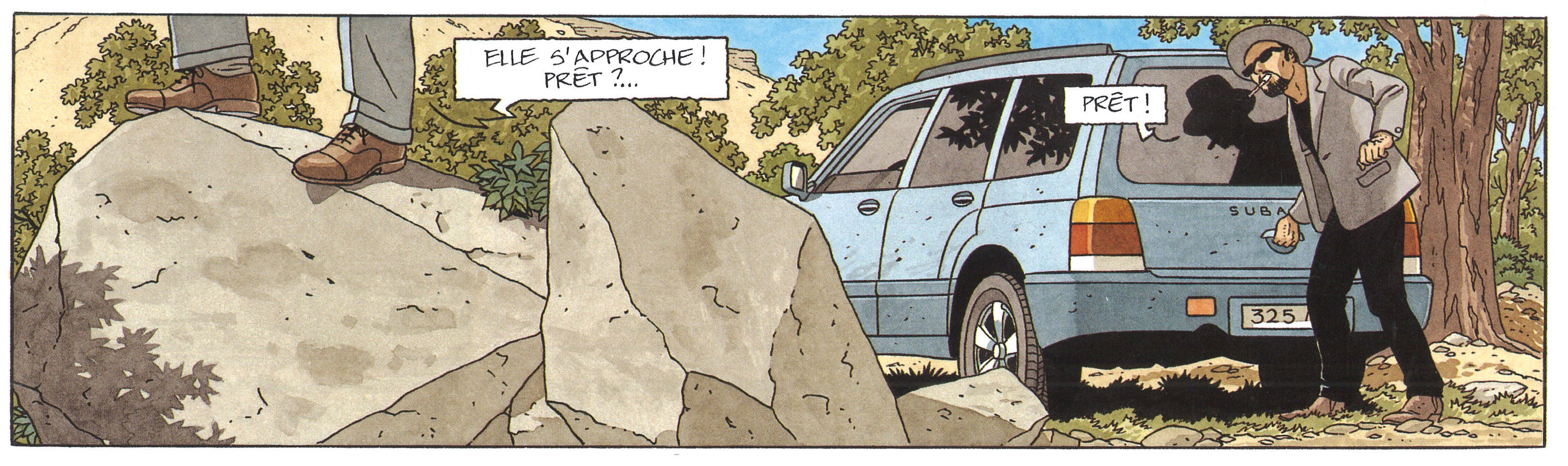
Image 7: Léna et les trois femmes, p. 5, case 6 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2009
En passant du débriefing du premier tome au briefing du deuxième, la curiosité du lecteur est beaucoup moins titillée puisqu’il bénéficie des acquis de la formation de Léna, puis est constamment guidé par elle dans l’aventure. Les auteurs ont néanmoins introduit une autre forme de restriction du savoir: pendant que Léna fait l’apprentissage des trois jeunes femmes promises à devenir des martyrs de la cause djihadiste, elle tente parallèlement de désamorcer l’attentat qui se prépare. Bien que nous accédions en ocularisation interne primaire à l’image et aux répliques qui se présentent à elle lorsqu’elle épie par l’œil de bœuf les terroristes pour lesquels elle feint de travailler (p. 42, c. 7 ; p. 51, c. 631), nous ne savons rien du plan qui est le sien ni de sa manière de communiquer avec les services secrets. Le texte du récitatif reste en effet sciemment évasif: «Le gars chargé de nous tenir à l’œil est resté dehors […]. [J]’ai pu vérifier quelque chose d’important sans qu’il s’en aperçoive» (p. 45, c. 9). ). Il en va de même lorsque Léna se regarde – et lorsque nous la regardons avec ses yeux à elle – dans le miroir: «Au matin, je sais ce que je vais faire» (p. 48, c. 2). Dans ce cas, le rapport du lecteur à Léna relève de la focalisation restreinte. Trois cases qui comportent un récitatif convoyant des informations importantes (mais encore lacunaires) soulignent le rôle décisif de la gestion du savoir pour le scénariste: «La piscine de la Butte-aux-Cailles est l’une des adresses qui m’a été confiée sur un ferry-boat de Sydney. Et ça, mon suiveur encagoulé qui m’attend patiemment dehors ne peut pas le savoir. Ce que ne peut savoir non plus Cheikh Najib, c’est que je sais désormais où, quand et comment aura lieu l’attentat-suicide.» (p. 52, c. 1-3). Ces énoncés soulignent la nature relationnelle de la détermination du point de vue: un réseau de personnages est construit et le lecteur est positionné différemment par rapport à chacun de ceux-ci. À ce titre, l’organisation narrative de l’album est très proche de celle des films d’espionnage d’Alfred Hitchcock comme La Mort aux trousses (où une jeune femme est précisément, là aussi, un agent infiltré).
Nous terminerons cette illustration des catégories de la focalisation et de l’ocularisation en nous référant à deux strips consécutifs (image 8) de Léna et les trois femmes qui racontent comment l’héroïne, après avoir vu passer une grosse berline allemande susceptible de représenter une menace32, comprend qu’elle est l’objet d’une filature en entendant des bruits de pas derrière elle (un cas d’auricularisation interne transposé verbalement)33. En dépit du régime dominant de la focalisation du récit sur Léna, le surgissement de l’inconnu est montré en une ocularisation interne primaire (p. 20, c. 5) puis secondaire (p. 20, c. 7) ancrée dans ce personnage masculin, dont le lecteur constate la présence avant que Léna ne la perçoive. Cette paralepse momentanée a toutefois une incidence moindre dans la mesure où la pertinence narrative de l’information supplémentaire est faible. Cet exemple atteste la nécessité de faire le départ entre les niveaux perceptif et épistémique.
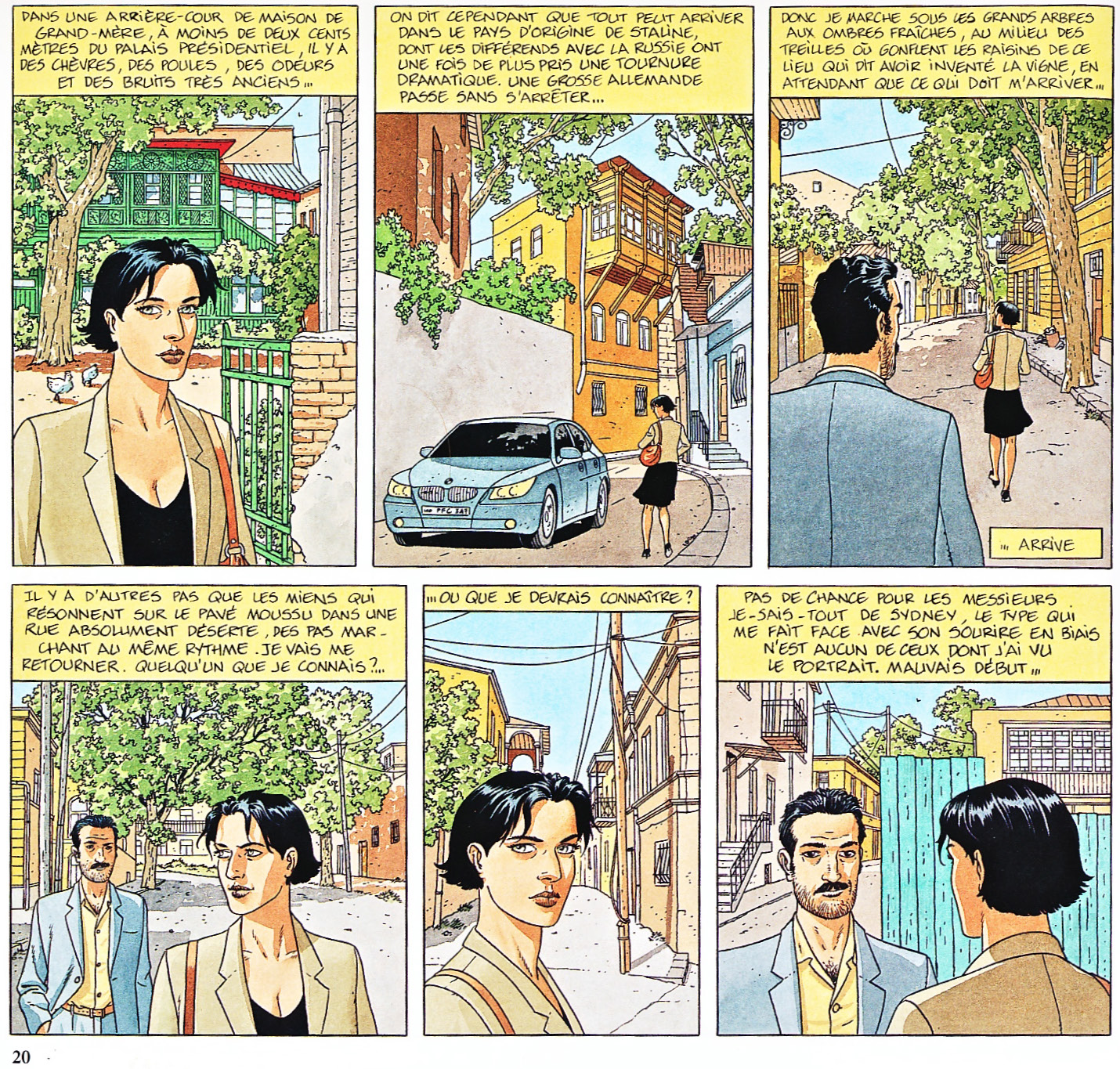
Image 8: Léna et les trois femmes, p. 20, cases 3-8 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2009
La voix intérieure de Léna
Il convient d’ajouter à nos observations concernant les «perspectives» adoptées par les auteurs du Long Voyage de Léna la question de la voix, c’est-à-dire de l’instance narrative, dans la mesure où, ici, le choix du scénariste a une incidence décisive sur la représentation de la subjectivité dans l’album. À l’incitation de son éditeur34, Christin a en effet opté pour faire de Léna la narratrice (homodiégétique) du récit scriptural convoyé par les textes du récitatif, qui équivalent ici à ceux proférés au cinéma par des personnages en voix over35. Ils sont donc rédigés à la première personne et rendent compte de commentaires qui ne sont pas proférés dans le for intérieur de l’héroïne au moment correspondant au lapse de temps suggéré par l’action figurée dans la case, mais ultérieurement, les temps verbaux étant au passé (tout en collant à l’action représentée, comme dans certains films noirs, à l’instar de Détour ou des Griffes du passé36). On a dit toute la retenue qu’y manifeste la narratrice en modalisant fort peu son discours, en n’anticipant jamais la suite de l’histoire et en se contentant bien souvent d’une simple description de ce qui est visualisé dans la vignette. Ce registre descriptif ne produit toutefois aucune redondance, d’une part parce qu’il s’agit de canaux sémiotiques différents, d’autre part parce que chaque énoncé renvoie indubitablement à son énonciatrice (Léna étant présente dans toutes les scènes qu’elle raconte, la vraisemblance de sa prise en charge énonciative est garantie), affirmant la présence du personnage et son contrôle (fictif) sur la narration – contrôle certes partiel, puisqu’elle ne maîtrise ni le niveau de la «monstration»37 (sauf lorsqu’elle lui est déléguée via des images dessinées par elle) ni celui de la narration visuelle. D’ailleurs, le récitatif est en général absent lorsque la case comprend des phylactères (la narratrice superpose rarement sa voix à celle des dialogues, à moins que le contenu de ceux-ci ne soit superfétatoire, comme à la page 29), comme s’il s’agissait avant tout de faire «entendre la voix» du personnage éponyme. Préalablement aux révélations qui interviennent dans le dernier tiers du récit, les récitatifs ne participent guère au réglage de la transmission au lecteur d’informations pertinentes pour comprendre le récit (si ce n’est en ce qui concerne les allusions au passé de Léna). En fait, leur présence se justifie avant tout par une volonté d’affirmer la «voix» de Léna.
Un premier débrayage énonciatif s’opère entre les pages 42 et 45, lorsque Paul-Marie prend le relais de la narration verbale, jusqu’à une phrase-clé: «Vous n’avez pas besoin d’en savoir plus» (p. 45, c. 4). La situation d’énonciation s’ancre dans un dialogue mené avec Léna à Buenos Aires – on passe, comme cela est courant au cinéma, d’une voix in (p. 45, c. 1-3) ou off (p. 45, c. 7) à une voix over et inversement, tandis que les énoncés se réfèrent aux agissements des terroristes à Dubaï figurés en alternance dans certaines des vignettes, envisagés d’abord dans la simultanéité, ensuite sur un mode proleptique (à partir de «Un minibus […] viendra les prendre à leur hôtel», p. 44, c. 5), enfin représentés uniquement au niveau de la monstration, Paul-Marie ayant interrompu sa prise en charge de la narration verbale. Dans la première planche totalement muette de l’album (page 46) qui souligne la vacance provisoire de narrateur verbal, un deuxième débrayage intervient. Il introduit une nouvelle situation d’énonciation dont les sujets sont les membres de l’équipe d’assassins rassemblés dans le minibus précédemment présenté par Paul-Marie (le référent du discours devient une nouvelle situation d’énonciation diégétique). La visualisation de ces locuteurs (en voix in, c’est-à-dire par le truchement de phylactères rattachés à leur visage respectif) alterne avec des images illustrant leur propos sur lesquelles se poursuit l’échange: comme dans le cas d’un pont sonore («overlapping») au cinéma, la voix in devient over, c’est-à-dire que le texte passe, en bande dessinée, de la bulle au récitatif. Ainsi l’espion Repitski, après avoir dit que, la veille, il a pu voir le bateau qui est censé garantir leur fuite après l’assassinat, décrit l’embarcation qui est par ailleurs représentée dans la case (p. 47, c. 2-3), derrière Repitski lui-même (il s’agit donc d’une analepse dont la portée est de vingt-quatre heures). Aux pages suivantes, une variation touche à l’une des deux pistes de ce «montage alterné»: les images de la discussion dans le véhicule n’alternent plus avec des cases illustrant le propos des tueurs (l’absence de coréférence suggérant que les choses ne se passeront pas comme ces derniers sont en train de les planifier), mais uniquement avec des vignettes montrant Léna dormant dans l’avion. Le lecteur est ainsi invité à inférer que la piste de Léna est simultanée, ce qui contribue à disculper l’héroïne des conséquences ultimes de son intervention. La corrélation de l’alternance repose sur un rapport de cause à effet, puisque Léna est, somme toute, la personne qui est à l’origine de la future mise en échec du plan dont les assassins récapitulent à ce moment-là le déroulement. Une nouvelle planche muette (p. 54), dont chacune des vignettes est consacrée au trajet de Léna à Sydney, introduit ensuite l’épilogue qui, notablement, est dépourvu de tout récitatif: il n’incombe pas à l’héroïne d’assumer l’étape ultime de configuration narrative du récit.
À travers l’analyse des deux albums de Christin et Juillard, nous avons démontré la pertinence pour l’étude de la bande dessinée des notions de «focalisation» et d’»ocularisation» envisagées par Jost pour le cinéma, et en particulier l’intérêt que présente l’examen de procédés visant la restriction du savoir du lecteur et délimitant, dans une portion donnée du récit bédéique, un régime dominant (ou, à l’inverse, instaurant des points de rupture). Dans le genre de l’espionnage où certaines informations doivent demeurer secrètes (à l’intérieur de la diégèse, mais aussi en termes d’un rapport au lecteur fondé sur la curiosité ou le suspense), le jeu sur le réglage de la transmission du savoir narratif (respectivement véhiculé par le canal du texte ou celui de l’image) constitue l’un des principaux ressors du récit. Nous avons montré combien il importe de distinguer cette dimension épistémique de la question de la subjectivité, dimension très faiblement présente dans le cas étudié en dépit d’une identification favorisée à Léna via le monologue du récitatif et la forte récurrence du personnage féminin éponyme dans les vignettes.
La complexité énonciative du dernier tiers de l’album Le Long Voyage de Léna dont nous avons essayé de rendre compte en dégageant une série de glissements – d’autant plus invisibilisés pour le lecteur que la facture des phylactères (typographie, style d’écriture, couleur du fond) demeure strictement identique – témoigne cependant de la nécessité de prendre en considération certaines interactions entre mode et voix: la succession d’instances de narration confère au lecteur par addition un savoir qu’aucun des personnages ne possède, et fait donc basculer, le temps d’une parenthèse sanglante, la focalisation sur Léna vers une focalisation élargie que Jost renomme habilement «focalisation lectorielle» (Jost 1987: 129). L’évanouissement du narrateur (verbal) à la fin du Long voyage de Léna contribue à signifier que l’héroïne peut reprendre la maîtrise sur son destin sans avoir à le ressaisir par la parole au moment où, immergée dans les eaux de l’océan Austral, elle s’apprête à renaître après avoir fait le deuil des siens.
Bibliographie
Baroni, Raphaël (2020), «Comment réconcilier la focalisation genettienne avec l’étude de la subjectivité dans le récit ?», Nouvelle revue d’esthétique, n° 26, p. 31-42.
Boillat, Alain (2020), En cas de malheur, de Simenon à Autant-Lara. Essai de génétique scénaristique, Genève, Droz.
Boillat, Alain (2012), «L’inquiétante étrangeté du found footage horrifique», Décadrages, n° 21-22, p. 146-165.
Boillat, Alain (2007), Du bonimenteur à la voix-over, Lausanne, Antipodes.
Boillat, Alain (2006), «Le point de vue», in Dictionnaire mondial des images, L. Gervereau (dir.), Paris, Editions Nouveau Monde, p. 834-837.
Bordwell David & Kristin Thompson (2009), L’Art du film. Une introduction, Bruxelles, De Boeck.
Christin, Pierre & André Juillard (2020), Dans le brasier, Paris, Dargaud.
Christin, Pierre & André Juillard (2009), Léna et les trois femmes, Paris, Dargaud.
Christin, Pierre & André Juillard (2006), Le Long Voyage de Léna, Paris, Dargaud.
Galloway, Alexander (2006), Gaming. Essays On Algorithmic Cultures, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Gaudreault, André (1999), Du littéraire au filmique, Paris/Montréal, Armand Colin/Nota Bene.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil
Genette, Gérard (1983), Nouveau discours du récit, Paris, Seuil.
Kaempfer, Jean, Boillat, Alain, Kaenel, Philippe, Gisel, Pierre (dir.) (2008), Points de vue sur Jésus au XXe siècle, Études de lettres, n°280.
Truffaut, François (1993), Hitchcock, Paris, Gallimard.
Jost, François (1991), Un monde à notre image. Énonciation, cinéma, télévision, Paris, Klincksieck.
Jost, François (1987), L’Œil-caméra. Entre film et roman, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Juillard, André (1994), Le Cahier bleu, Tournai, Casterman.
Lavanchy, Eric (2007), Étude du Cahier bleu d’André Juillard. Une approche narratologique de la bande dessinée, Paris, Academia-Bruylant.
Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur, Louvain-la-Neuve, Academia-Erasme.
Moore, Alan & Eddie Campbell (2000 [1991]), From Hell, Paris, Delcourt.
Mulvey, Laura (2017 [1975]), Au-delà du plaisir visuel, Paris, Mimesis.
Rabatel, Alain (1998), La Construction textuelle du point de vue, Lausanne & Paris, Delachaux et Niestlé.
Reuter, Yves (2016), L’Analyse des récits, Paris, Armand Colin.
Robert, Valentine (2010),«Le Scaphandre et le papillon et l’adaptation filmique du "je" littéraire: l’œil qui écrit», Décadrages, n° 16-17, URL: http://journals.openedition.org/decadrages/242
Simon, Jean-Paul (1983), «Énonciation et narration», Communications, n° 38, p. 155-191.
Todorov, Tzvetan (1966), «Les catégories du récit littéraire», Communication, n° 8, p. 125-151.
Triclot, Mathieu (2011), Philosophie des jeux vidéo, Paris, Edition de la Découverte.
Vernet Marc (1988), Figures de l’absence, Paris, Éditons de l’Etoile & Cahiers du cinéma, p. 36-58.
Pour citer l'article
Alain Boillat, "Une question de point de vue : mode et voix dans "Le Long voyage de Léna"", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022https://www.transpositio.org/articles/view/une-question-de-point-de-vue-mode-et-voix-dans-le-long-voyage-de-lena
Voir également :
Témoignage de Jean Michel Adam et de Françoise Revaz
Sollicitée dans le cadre du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement», qui a pour objectif de « questionner les usages et l’ergonomie de la boîte à outils narratologique pour l’enseignement de la littérature aux degrés du secondaire I et II dans quatre pays francophones : la France, la Suisse, la Belgique et le Québec », je tiens d’emblée à préciser que mon expérience d’enseignement, de formation et de recherche autour du récit est ancrée dans ma fonction d’enseignante dans les degrés primaires de l’école publique genevoise, dans les années 1970-1980, au moment de la rénovation de l’enseignement du français dans les classes romandes.
Témoignage de Jean Michel Adam et de Françoise Revaz
Jean-Michel Adam
Professeur honoraire de linguistique française à l’Université de Lausanne, Jean-Michel Adam est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, traduits dans plusieurs langues, sur la linguistique textuelle, le récit, la description, l’analyse du discours littéraire et l’argumentation publicitaire. Derniers titres parus : Le Paragraphe (A. Colin 2018), Souvent textes varient (Classiques Garnier 2018), ainsi que la 4ème édition de Les Textes : types et prototypes (A. Colin 2017) et la 4ème édition de La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours (A. Colin 2020).
Françoise Revaz
Professeure émérite de linguistique française à l’université de Fribourg (Suisse) et narratologue, Françoise Revaz a dirigé plusieurs projets de recherche et publié de nombreux articles dans le champ de la linguistique textuelle et de la narratologie, dans le souci constant d’aborder la narrativité dans une variété de genres de discours: bande dessinée, entretiens thérapeutiques, historiographie, littérature et presse écrite.
Entretien
FR : Avant de répondre aux diverses questions ci-dessous, j’aimerais faire quelques remarques liminaires.
Sollicitée dans le cadre du projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement», qui a pour objectif de « questionner les usages et l’ergonomie de la boîte à outils narratologique pour l’enseignement de la littérature aux degrés du secondaire I et II dans quatre pays francophones : la France, la Suisse, la Belgique et le Québec », je tiens d’emblée à préciser que mon expérience d’enseignement, de formation et de recherche autour du récit est ancrée dans ma fonction d’enseignante dans les degrés primaires de l’école publique genevoise, dans les années 1970-1980, au moment de la rénovation de l’enseignement du français dans les classes romandes. Dès lors, mes réponses au questionnaire ci-dessous vont déborder du cadre scolaire sélectionné dans la recherche du prof. Baroni, à savoir le secondaire I et II. Ce débordement me semble nécessaire dans la mesure où le rappel de ce qui s’est passé à cette époque, à Genève, au niveau de l’enseignement primaire ne peut qu’éclairer les processus d’appropriation du récit qui ont suivi dans les degrés du secondaire I et II dans toute la Romandie. La conséquence de cet ancrage dans mon tout début de carrière est que la question du processus de scolarisation du récit sera moins envisagée dans le cadre de l’enseignement de la littérature que dans le cadre plus large de l’apprentissage des types de textes dans l’enseignement du français.
Enfin, mes réponses résultent d’une plongée dans des souvenirs d’il y a parfois plus de quarante ans. A ce titre, elles doivent donc être considérées comme un témoignage personnel partiel et partial avec tout ce que cela comporte d’approximations et peut-être de faux souvenirs !
JMA : Avant de répondre aux questions, je dois introduire, moi aussi, deux remarques préalables. La première est que, très sincèrement, je ne peux rien dire d’un peu documenté sur l’enseignement actuel du français (langue maternelle, seconde ou étrangère) et sur la didactique de la langue et de la littérature. Je n’ai plus aucun contact avec ce domaine, sauf quand je suis sollicité pour des questions précises et plutôt théoriques par des collectifs de revues destinées aux enseignants comme Recherches (n°42, 2005 : «La notion de typologie de textes en didactique du français : une notion “dépassée”?» ; n°56, 2012 : «Discursivité, généricité et textualité» et n°76, 2022 : «Autour de l’explicatif»), Le Français aujourd’hui (Postface au n°175, 2011, consacré à «Littérature et linguistique : dialogue ou coexistence ?»), Québec français (entretien dans le n°99, 1995, et n°128, 2003 : «Entre la phrase et le texte») et, plus régulièrement, dans Pratiques (n°169-170, 2016 : «Pratiques, la linguistique textuelle et l’analyse de discours dans le contexte des années 1970» ; n°129-130, 2006 : réponses à des questions relatives au «contexte» et n°179-180, 2018 : réponses à un entretien sur la poésie ; ou encore le n°181-182, 2019 : «Linguistique – récits – narratologie», qui nous rapproche de l’objet du présent entretien, mais reste à un niveau historique et théorique). La seconde remarque préalable est que je n’ai aucune idée du devenir actuel de mes travaux dans le champ de la didactique, en France, Belgique, Suisse ou Québec. Les titres de quelques-unes de mes interventions des 20 dernières années donnent une idée de la place plutôt réduite de la narratologie dans ce qui m’a été demandé et pouvait donc éventuellement intéresser enseignant·e·s et didacticien·ne·s.
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous ?
FR : La question de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie ne peut être traitée indépendamment de la question plus générale de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la linguistique des textes. En outre, elle prend sa source dans un contexte historique particulier, à savoir le bouleversement opéré par le «renouvellement» de l’enseignement du français dans les années 1970, tant en Suisse romande qu’en France, en Belgique ou au Québec. Il me semble donc utile de proposer un bref rappel chronologique afin de situer l’émergence de l’enseignement du récit dans le contexte des innovations pédagogiques de cette époque et dans ses liens étroits avec la recherche en psychologie cognitive et en linguistique.
En 1967, une Commission interdépartementale romande de coordination de l’enseignement (CIRCE) produit un programme cadre pour l’enseignement du français dont l’objectif est la rédaction et l’adoption de plans d’études harmonisés. La première étape (CIRCE I) concerne les quatre premiers degrés de l’école primaire1 ; elle voit la publication, en 1972, d’un nouveau plan d’études. Puis, dans le cadre de CIRCE II, c’est un nouveau plan d’études pour les cinquième et sixième années primaires qui est publié en 1979.
Les plans d’études de 1972 et de 1979 marquent un jalon important puisqu’ils sont marqués par le «tournant communicatif» qui imprègne les recherches en didactique du français menées à cette époque. Ces plans se fondent clairement sur le fait que le langage est une pratique sociale «située» et que la langue, en tant qu’outil de communication, doit être enseignée via des activités en lien avec des genres discursifs et des actes de parole variés.
Pour pouvoir être appliquée cette réforme de l’enseignement du français ambitieuse et novatrice nécessitait encore une nouvelle méthodologie et des manuels eux aussi «renouvelés». C’est dans ce contexte que paraît en 1979 Maîtrise du français, un ouvrage méthodologique collectif rédigé par M.-J. Besson, M.-R. Genoud, B. Lipp et R. Nussbaum (actifs dans la formation des enseignants primaires genevois) sous la supervision et l’évaluation de deux professeurs de linguistique (E. Roulet et H. Huot) et d’un professeur de psychopédagogie de la langue (J.-P. Bronckart). L’idée forte était qu’il ne pouvait y avoir de renouvellement de l’enseignement du français sans maîtrise préalable d’un savoir linguistique chez les enseignants. Cet ouvrage, élaboré dans l’effervescence des recherches en linguistique et en psychologie cognitive, propose deux types d’activités : d’une part des activités dites de «structuration» autour du lexique, de la conjugaison, de la syntaxe et de l’orthographe, d’autre part des activités langagières dites de «libération» dont l’objectif est de permettre à l’élève de «libérer sa parole». La grande nouveauté de Maîtrise du français sera d’avoir donné une importance majeure aux activités de compréhension et de production de textes en classe via des exemples de genres et de visées différents, les théories de référence étant résolument la linguistique du texte.
L’introduction de l’enseignement rénové du français s’est faite de manière progressive dans les classes genevoises à partir de la rentrée scolaire 1980, via un recyclage de tous les enseignants primaires planifié sur plusieurs années. J’ai vécu ces étapes de recyclage de très près puisque, nommée institutrice dans la campagne genevoise en automne 1976, j’ai été sollicitée pour faire partie d’un petit groupe d’enseignants prêts à s’engager pour suivre une formation de linguistique et de didactique du français pendant deux ans, puis pour former à leur tour les collègues de leur circonscription. J’ai occupé cette fonction officielle d’«animatrice de français» jusqu’en automne 1984. Dans l’intervalle, j’ai eu l’opportunité de faire une licence en Sciences de l’éducation à l’Université de Genève et, dans ce cadre, de suivre les enseignements du professeur Jean-Paul Bronckart, dont plus particulièrement un séminaire de recherche en psychologie du langage centré sur une méthode d’analyse de quatre «architypes discursifs» : le discours en situation, le discours théorique ainsi que deux genres narratifs, le récit conversationnel et la narration. Une fois encore, la théorisation du récit était intégrée à une réflexion plus large sur divers types discursifs. Ce travail de recherche théorique a abouti en 1985 à la parution du Fonctionnement des discours, ouvrage dont j’ai fait une recension en 1988 dans le numéro 58 de la revue Pratiques. Dans la section « Perspectives didactiques », constatant «l’hétérogénéité propre à tout texte concret», je concluais que le modèle de Bronckart semblait «être la meilleure piste pour approcher non pas des types de textes, ce qui paraît encore trop ambitieux, mais des types de séquences textuelles» renvoyant ainsi aux propositions de Jean-Michel dans le numéro 56 de Pratiques.
En 1988, j’avais quitté l’enseignement primaire genevois depuis quelques années et avais été engagée en automne 1985 comme assistante de recherche par Jean-Michel, professeur de linguistique française récemment nommé à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. J’intégrais ainsi un projet de recherche interdisciplinaire consacré à la description… encore un genre textuel! Dans le cadre de cette recherche, je tentais d’appliquer le modèle de Bronckart via une grille d’analyse détaillée de marques linguistiques censées indiquer à quel genre discursif appartient un texte donné. C’est en analysant un corpus de textes descriptifs que j’ai pu constater que la distinction entre textes descriptifs et textes narratifs n’était pas si claire. En effet, je me trouvais face à des textes dont les marques linguistiques les faisaient osciller entre le genre narratif et le genre descriptif. Ces textes que, dans un premier temps, j’ai catégorisés comme des « descriptions d’action » étaient des textes dont la visée était effectivement descriptive mais qui décrivaient des personnages en action. Selon la grille d’analyse de Bronckart, les marques de surface relevées, des verbes d’action principalement, faisaient basculer ces textes dans la catégorie du genre narratif ! Cette découverte d’une catégorie intermédiaire, entre récit et description, m’a conduite par la suite, dans le cadre de ma thèse dirigée par Jean-Michel et intitulée «Aux frontières du récit», à élaborer une typologie de textes d’action (le fait divers, le conte, la nouvelle, la fable, et le roman, certes, mais aussi la recette, le mode d’emploi, l’horoscope, la notice nécrologique, le bulletin météo ou le reportage sportif), qui montrait l’existence de divers « degrés » de narrativité2.
Quant aux publications importantes des années 1980 qui ont certainement inspiré les chercheurs et les didacticiens, je citerais, outre les ouvrages de Jean-Michel sur le récit, deux ouvrages de psychologie cognitive: Le récit et sa construction de Michel Fayol paru en 1985 chez Delachaux et Niestlé et Il était une fois… Compréhension et souvenir de récits de Guy Denhière paru en 1984 aux Presses Universitaires de Lille.
JMA : J’ai l’habitude de me référer à des étapes et grandes dates de la recherche… Pour le versant « entrée dans les classes de la narratologie », je suis tenté de mettre en avant le travail accompli avec mes amis de la revue Pratiques, dans la seconde moitié des années 1970 et les années 1980. Je retiens surtout les années 1976-1978 et, en particulier, les numéros 11/12 (1976) et 14 (1977) de Pratiques et le n°38 (1978) de Langue Française: «Enseignement du récit et cohérence du texte». Dix ans après le n°8 de Communications consacré à « L’analyse structurale du récit », les paradigmes étaient en train de changer et nous mesurions mieux le fait que le récit n’est qu’une forme de mise en texte, à côté de bien d’autres formes importantes. À commencer par le dialogue, la description et le commentaire qui, soit se mêlent au récit de façon harmonieuse, soit l’envahissent et l’enlisent (abondance descriptive, invasion de commentaires méta-textuels). L’histoire de la littérature narrative est celle des diverses étapes de la fin de l’hégémonie du récit. À cette hétérogénéité constitutive, il faut ajouter l’argumentation en général, mais aussi l’explication et les discours régulateurs. Ce point est important car il explique mon rejet progressif du fondement de la «sémiotique narrative» de Greimas et de l’École de Paris, pour laquelle tout était récit.
Ce qui m’intéresse, c’est que nous ne cessons d’expliquer et de demander des explications. La compréhension des mystères de l’agir humain est au cœur de notre fascination pour les récits, mais elle n’a d’égal que l’explication continue des mystères du monde qui nous entoure et qui se traduit par les questionnements en pourquoi? dont usent et abusent les enfants, entre 3 et 7 à 8 ans. Nous avons tous fait l’expérience de cet «âge questionneur de l’enfant» (Piaget 1947 : 156), point de rencontre des logiques des adultes et des enfants que Saint-Exupéry place au cœur du Petit Prince:
Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d’explications. […]
[…] Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications.
Dans un de ses premiers livres, Le Langage et la pensée chez l’enfant (1923), Jean Piaget consacre d’ailleurs un chapitre entier (p. 155-208 de l’édition 1947) à la question des différentes sortes de pourquoi enfantins. Il distingue différents types d’explications et confirme l’importance sociocognitive de ce questionnement des adultes par les enfants.
Alors que l’omniprésence de la narration (fictionnelle, factuelle, mensongère) dans nos vies et dans toutes les pratiques discursives (de la religion et la littérature à la presse et la politique, en passant par l’histoire et la psychanalyse) est largement reconnue, les discours régulateurs incluant des consignes et des conseils, incitant à agir ou ne pas agir et guidant ainsi les actions humaines, de la cuisine à la circulation routière, du vestiaire sportif au champ de bataille, n’ont pas autant intéressé les chercheurs, même si les didacticiens y sont plus sensibles.
Mon dernier livre sur le récit pose la question du cadre théorique qu’il nous faut adopter pour aborder toutes ces questions. Il met en avant, pour cela, la problématique des genres de discours: Genres de récits. Narrativité et généricité des textes (Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2011).
2. En conséquence, quelles ont été, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français ?
JMA & FR : En 1988, de nouveaux moyens d’enseignement romands ont vu le jour dans le canton de Vaud, qui proposaient des activités «textuelles» pour les degrés du secondaire I (à l’époque 7e, 8e et 9e). L’enseignement des types de textes était réparti ainsi: en 7e, le texte narratif, en 8e, le texte informatif et en 9e le texte argumentatif. On voit que ces intitulés suivent les grandes lignes mentionnées plus haut.
Pour ce qui concerne la didactisation des recherches sur le récit et les autres formes de textualité, on peut renvoyer aux rôles importants du collectif de la revue Pratiques : d’André Petitjean (sur le récit et la description), de Jean-François Halté (sur le récit et l’explicatif), de Jean-Pierre Goldenstein (sur le récit), d’Yves Reuter (sur la description), de Michel Charolles (sur le récit et l’argumentation), de Caroline Masseron (sur divers genres de récits). Il suffit de citer les numéros suivants de Pratiques n°11-12, 1976: «Récit 1»; n°34, 1982: «Raconter et décrire»; n°55, 1987: «Les textes descriptifs», pour que se dessinent les grandes orientations et propositions qui en découlaient. La bascule se fait entre le n°56, 1987, sur «Les types de textes» et les n°59, 1988, sur «Les genres du récit» et n°66, 1990, sur «Didactique des genres». Les moyens d’enseignement qui se sont développés dans la francophonie ont largement suivi ce cadre que nous dessinions collectivement.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique ?
FR : Durant sept ans (entre 1989 et 1996), parallèlement à mon poste d’assistanat à l’UNIL, j’ai eu l’opportunité de proposer un enseignement ponctuel de deux mois par année sur les types de textes au Département d’audio-visuel et d’informatique (DAVI) de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Cet enseignement s’inscrivait dans une collaboration institutionnelle entre l’UNIL et l’ECAL. Il s’agissait d’animer un atelier intitulé «Construction du discours» qui consistait en une alternance de cours théoriques et de travaux pratiques (analyses de films) sur les théories de la communication et sur les discours narratif, descriptif, argumentatif et poétique.
Durant cette même période (1989-1996), l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a confié la formation continue des professeurs de français de l’Ecole de Commerce de Châtelaine (GE) à l’Unité de linguistique française de l’UNIL. En collaboration avec Jean-Michel, j’ai ainsi pu proposer des sessions de formation d’une semaine, deux fois par année, sur l’enseignement renouvelé du français. Nous avons abordé, une fois de plus, les types de séquences narrative, descriptive et argumentative tout en prolongeant dans les dernières années notre enseignement des types textuels dans le cadre de genres discursifs spécifiques tels que la presse et la publicité.
Au milieu des années 1990, à la suite d’une conférence donnée à la Sorbonne en 1992 dans le cadre des «Entretiens Nathan» intitulée «Enseigner à écrire des textes. L’expression écrite à l’école» et à l’article qui en a découlé sur les «schémas de récit» (Entretiens Nathan, Actes III, 1993), j’ai été sollicitée par l’éditeur Nathan, via Alain Bentolila, pour élaborer des moyens d’enseignement destinés aux élèves français de CE1, CE2, CM1 et CM2 et «conformes aux programmes de 1995». Il s’agissait, comme le rappelle la quatrième de couverture des ouvrages intitulés «Expression écrite» de proposer «cinq grandes catégories d’écrits, toutes liées à un objectif de communication, pour apprendre à l’élève à reconnaître à chaque fois l’objectif qu’il assigne à sa production: échanger, convaincre, expliquer, jouer avec la langue, raconter». Encore une fois, le récit n’était pris en compte que comme une forme de mise en texte parmi bien d’autres. Ce qui était mis en avant était moins l’apprentissage de formes textuelles précises que le repérage de divers buts communicatifs. Dans ces ouvrages, les productions spontanées de l’élève étaient systématiquement confrontées à l’observation de textes de natures différentes. Puis des outils textuels étaient proposés (vocabulaire, temps verbaux, connecteurs et organisateurs textuels) afin de permettre à l’élève de réécrire son texte initial « spontané » en l’améliorant. Pour rédiger ces ouvrages j’ai collaboré étroitement avec Bernard Schneuwly de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation (FPSE) et avec le Service du français de l’enseignement primaire du canton de Genève3.
JMA : Outre ma participation à certains numéros de Pratiques, dès le début de l’existence de la revue, je dirai que mon travail a consisté à introduire aux grandes théories du récit, en particulier dans mon Que sais-je ? (n°2149): Le Récit, qui a connu six rééditions entre 1984 et 1999. De Propp aux théories énonciatives et textuelles de la narration, en passant par la sémiotique de Greimas, la narratologie de Genette, la socio-linguistique de Labov et les recherches de psycholinguistique sur le récit (en particulier Michel Fayol: Le récit et sa construction, déjà cité plus haut par Françoise). À côté, dans Le Texte narratif (Nathan 1985 & nouvelle éd. 1994), je replaçais cette fois ces travaux narratologiques dans le cadre théorique unifié de la linguistique textuelle4. En multipliant les exemples d’analyses je me suis efforcé d’indiquer comment passer de la théorie à l’analyse de textes très différents, pas uniquement littéraires (comme c’était le cas dans une certaine narratologie littéraire).
Je suis surtout fier de notre petit ouvrage de la collection Mémo, L’analyse des récits, au Seuil (n°22, 1996), dans lequel les recherches de Françoise ont permis des avancées significatives. L’ouvrage est, grâce à notre collaboration, une réussite en termes de clarté des définitions et distinctions de concepts clés.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort ?
FR : Le concept narratologique certainement le plus souvent mobilisé a été la formalisation du récit sous la forme d’une structure prototypique comportant cinq macro-propositions de base (le fameux « schéma quinaire »). L’engouement pour ce schéma et son emploi incontournable tant au niveau de la réception/compréhension des récits que de la production doit être replacé dans le contexte épistémologique des années 1960-1970 marqué par le structuralisme et le distributionnalisme. Si du côté de la structuration des phrases les emprunts à la grammaire générative de Chomsky imposaient alors aux élèves de représenter les phrases selon un modèle arborescent (dans une organisation hiérarchique de leurs constituants), la même apparente rigueur formaliste était comblée par le schéma quinaire. On peut ainsi faire l’hypothèse que les enseignants se sont emparés de ce schéma que Jean-Michel avait élaboré en tenant compte des travaux de Todorov, de Greimas, de Labov et de Larivaille (auquel il a été attribué par la suite, à la plus grande surprise de ce dernier) parce qu’il offrait un modèle concret pour l’analyse et la production de récits. Le problème a évidemment été l’imposition rigide du schéma quinaire, sa grammaticalisation.
JMA : Parmi les autres concepts, présentés largement dans notre Mémo commun et dans nos deux livres sur le récit, il faudrait probablement citer le schéma actantiel de Greimas, souvent utilisé pour distinguer les rôles profonds des personnages de surface, et la question de l’ordre du récit (discordances entre l’ordre du texte et celui de l’histoire) dont Genette a bien montré que le cas de la chronologie absolue est extrêmement rare et que la norme est le désordre de la suite, non chronologique, des événements et actions.
Pour répondre à la dernière partie de votre question, je vois au moins trois concepts oubliés. Le premier est celui de gradients de narrativité. Tous les textes ne sont pas des récits et ils le sont, de surcroît, à des degrés divers : ils sont plus ou moins narratifs. Comme les travaux de Françoise l’ont montré, une description d’actions est faiblement narrative et ce qui est intéressant c’est : quels aspects sont communs avec le récit et lesquels avec la description ?
Le deuxième concept oublié découle de ce premier point : c’est celui d’hétérogénéité textuelle et de dominante. L’effet global a tendance à l’emporter sur les différences locales et, de ce fait, sur la complexité compositionnelle du tout textuel.
Le troisième est celui de scène ou épisode. À côté des découpages séquentiels de l’intrigue, un épisode correspond souvent à un chapitre, comme c’est le cas dans Le Petit prince, déjà mentionné plus haut, dont la lisibilité tient probablement à ce découpage en petits épisodes d’une histoire dont la structure temporelle est particulièrement difficile à rétablir. Les scènes-types de la vie quotidienne (scripts d’action dans le monde: aller au restaurant, prendre le train ou l’avion, commander ses courses sur internet, saluer un inconnu, dire au revoir, etc.) et les scènes-types de genres de récits (bagarre du western, piège tendu au coupable d’un récit policier, triplication des épreuves subies par le héros d’un conte, etc.), sont d’une très grande importance pour la lecture comme pour l’écriture.
FR : Si je peux me permettre un témoignage personnel à propos du schéma quinaire, j’ai vécu l’enseignement du récit au secondaire I au début des années 1990 via mes filles scolarisées à Lausanne. J’ai ainsi pu constater à quel point les enseignants voulaient faire entrer tous les récits dans ce cadre quinaire rigide. Plus grave, ma fille aînée s’est vue sanctionnée pour la rédaction d’un récit d’imagination dont le seul défaut était qu’il ne comportait pas toutes les phases du schéma! Elle s’était en effet autorisée à ne pas décrire la situation finale, au demeurant facilement déductible du dénouement.
En somme, si l’analyse structurale des récits a permis la prise en compte de ce type de textes dans leur réalité formelle, elle a malheureusement autonomisé le texte narratif au point d’en oublier l’aspect communicationnel et les visées pragmatiques indissociables de toute production narrative.
Un autre concept, moins narratif qu’énonciatif, mais dont tous les manuels ont abusé (et abusent encore) pour théoriser le récit est la notion de «récit/discours», terme simplificateur que les rédacteurs de manuels (tout comme de nombreux linguistes!) attribuent à Émile Benveniste (1966). Ce dernier – qui souhaitait établir un système des temps verbaux construit non plus sur la fameuse tripartition temporelle en passé, présent, futur mais sur un critère énonciatif – a certes proposé de distinguer l’«énonciation historique» dont le temps pivot est le passé simple et l’«énonciation de discours» dont le temps pivot est le présent. Malheureusement, cette opposition entre deux modes énonciatifs s’est transformée très vite en une opposition entre deux types de textes: le récit et le discours oral. En 1998, nous avions rédigé Jean-Michel et moi, en collaboration avec Gilles Lugrin, un article dans Pratiques n° 100, afin de dénoncer ce raccourci dommageable5. Mais le couple « récit/discours » semble s’être installé durablement dans les manuels de français.
Durant les 17 ans de ma charge de professeure de linguistique française à l’université de Fribourg (2001-2018), je n’ai cessé, tant dans les formations continuées que dans les cours destinés aux futurs enseignants de français, de montrer les problèmes concrets que pose cette dichotomie «récit/discours», le problème majeur étant évidemment la place du récit au passé composé6. Pendant toutes ces années, j’ai vu passer plusieurs lignes de manuels, édités chez Nathan, Belin, puis chez Hatier. Les manuels Hatier, dûment agréés par la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et actuellement utilisés dans les classes, reprennent la dichotomie «récit/discours» sous une nouvelle désignation : «énoncé coupé» vs «énoncé ancré». Cette allusion à une coupure de (ou un ancrage dans) la situation d’énonciation désigne de façon caricaturale «les récits menés au passé simple» d’une part, «les lettres et les dialogues réels ou fictifs» d’autre part.
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français ?
JMA : Je citerais d’abord Jean Peytard, dans le n°38 (mai 1978) de Langue Française, consacré à « Enseignement du récit et cohérence du texte », dont j’ai déjà parlé plus haut. Il termine ainsi sa présentation du numéro: «La théorie, ici comme ailleurs, permet à l’enseignant de prendre aussi distance par rapport à lui-même et à sa pratique. Pour s’en défier et ne point s’y confondre» (p. 6). Nous ne visions pas autre chose, dans le cadre du collectif de la revue Pratiques, dans le cadre de la formation des enseignants, dans nos échanges avec les formateurs, en Suisse, au Québec, en Belgique et en France, et dans nos contacts avec les concepteurs de manuels. Nous avons toujours distingué ce qui concerne l’enseignement, d’une part, et la recherche, d’autre part.
Les concepts travaillés dans le cadre de nos recherches sur la textualité et les degrés de narrativité ou d’argumentativité des textes n’étaient jamais destinés à l’application directe en classe! Il s’agissait d’indiquer des directions en vue de transpositions et d’adaptations aux besoins des enseignants, sur la base d’une formation initiale et continuée digne de ce nom. C’est du moins ce que nous attendions de la didactique et de la formations initiale et continuée que nous ne prétendions pas remplacer.
Pour en revenir à votre question, que Finkielkraut, Orsenna7 et d’autres aient rendu les concepts narratologiques, rhétoriques et linguistiques responsables de la «détérioration de l’enseignement-apprentissage du français», c’est à la fois trop d’honneur et un absurde aveuglement qui ne mérite même pas d’être discuté. L’état de l’enseignement de la langue maternelle et de la culture littéraire et artistique dépasse les questions de méthodes. Les didacticiens ont, depuis un certain temps déjà, appris à prendre leurs distances par rapport aux données de la recherche universitaire. Nous n’entrerons donc pas dans ce débat, nous contentant de dénoncer le fait que certaines dérives didactiques aient pu aboutir au fait de plus enseigner le «schéma quinaire» du récit ou l’opposition «récit/discours» ou les divers types de «focalisations» au lieu d’étudier les textes et les usages contextuels de la langue et des langues. On a trop confondu le moyen et le but, l’outil d’exploration et de découverte et les visées d’un projet de formation et d’acquisition-construction de connaissances.
La question de la théorie et des outils conceptuels comme instruments de mise à distance des objets étudiés est une question plus large d’épistémologie de la connaissance. Comme le dit Gaston Bachelard dans le Rationalisme appliqué, la connaissance scientifique, comme toute connaissance formatrice, est une connaissance double: «Elle est à la fois intuition sensible et intuition intellectuelle. Qui peut aller par la pensée de la flamme à la frange d'interférence connaît la lumière du cuivre intimement. Et s'il souhaite revenir par la perception de la frange à la flamme il n'a en rien diminué son bonheur de voir» (1949, p. 21-22). Nous sommes en train de sombrer dans un monde qui a remplacé l’usage de la raison par les fictions alternatives et l’indistinction des projections fantasmatiques et idéologiques en rejetant tout acte de connaissance. Il me semble que l’histoire est actuellement en première ligne, confrontée qu’elle est aux récits alternatifs et révisions en tous genres. Alors, non, si nous en sommes là, ce n’est pas la faute à la narratologie classique! Et oui, la narratologie pourrait être en première ligne, avec l’analyse de discours, pour interroger le problème des «narratifs» étatiques et groupusculaires. En particulier, elle devrait permettre de démonter les mécanismes de mise en place de la causalité narrative, masquée sous la consécution temporelle, les mécanismes de constitution de héros et de bouc émissaires, de détournement de la parole. La force de conviction du récit est utilisée aussi bien dans l’explication (en lieu et place de «parce que») que dans l’argumentation (exemplum). On le sait bien depuis la Rhétorique d’Aristote.
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général ?
JMA : Comme toute démarche de connaissance – et pas plus que les autres (en particulier l’enseignement de l’argumentation et de la rhétorique, de la langue et des langues) – l’analyse des différentes formes de récit, des ressources manipulatoires de la narration qui commencent par l’usages des temps verbaux du français et des autres langues est d’une indéniable importance. Toute démarche de connaissance susceptible d’introduire une mise à distance par rapport à l’objet d’étude est, à nos yeux, importante.
Alors que la société enseigne l’exaltation d’un moi hédoniste et consumériste, l’école est le lieu de la rencontre d’une altérité radicale: celle des grands textes (pas seulement littéraires), d’objets qui résistent dans leur altérité à un usage immédiat, libre et personnel. Les langues étrangères et la langue étrangère des grands textes littéraires sont des lieux d’altérité qui nous décentrent de nous-mêmes. Je sais que cela va à l’encontre de certaines approches des textes littéraires qui ont actuellement le vent en poupe. Je n’exclus pas d’autres usages ludiques et personnels des récits, mais il y a des choses que seule l’école peut enseigner et c’est sur cela que nous devons concentrer nos efforts. C’est du moins notre raison, encore actuelle, de travailler et de répondre à un entretien comme celui-ci.
FR : Je n’ai pas suivi les évolutions «actuelles» de la didactique du français, mais j’ai pu constater que la place du récit dans les manuels d’enseignement (du secondaire inférieur entre autres) est tributaire de la volonté de ratisser large et de prendre en compte toutes sortes de textes qui «racontent». Or, la variété des récits devrait être théorisée à l’aulne des gradients de narrativité, ce qui n’est jamais fait. On se retrouve face à ce paradoxe en tant qu’enseignant: d’un côté, une variété d’exemples de textes qui racontent proposés à la lecture et à l’analyse des élèves ; de l’autre côté, des notices théoriques qui ne présentent que le seul récit canonique, à savoir un récit à la 3e personne et au passé simple. Les autres textes sont ainsi considérés comme des exceptions (par exemple, les récits en JE rédigés au passé composé). Comment alors aborder avec pertinence L’Etranger de Camus ?!?
Dans la mesure où certains chercheurs, dont Raphaël Baroni, envisagent de repérer quels outils issus de recherches narratologiques récentes seraient susceptibles d’être utilisés dans l’enseignement de la littérature8, j’aimerais conclure cet entretien sur une réflexion à propos d’une notion qui paraît très en vogue actuellement: la narratologie «transmédiale» (ou «intermédiale»). Tout d’abord il me semble que ce n’est pas tant la narratologie qui doit être qualifiée de transmédiale mais son objet, à savoir l’ensemble des récits qui se manifestent dans des médias divers, sous des formes verbales ou non verbales. Si maintenant la narratologie transmédiale désigne simplement l’étude des pratiques narratives dans divers médias, alors il n’y a rien de nouveau sous le soleil narratologique puisque, sans parler de transmédialité, Barthes et bien d’autres contemporains structuralistes parlaient déjà dans les années 1960-1970 de la diversité des récits du monde (oraux, écrits, en images fixes ou animées). J’ai moi-même été toujours intéressée à élargir l’objet de mes investigations narratologiques en analysant des récits issus de formations discursives diverses (presse, bande dessinée, entretiens médicaux, etc.) et en revisitant à ces occasions les théories narratives existantes. En travaillant par exemple sur le genre du récit «suspendu» (ou feuilleton), j’ai pu mettre en évidence que ce dernier constitue bien un objet «transmédiatique» puisqu’il peut se manifester sous la forme d’un feuilleton télévisé ou journalistique, d’un feuilleton littéraire ou encore d’une histoire à suivre en bandes dessinées. A mon sens, dans la mesure où les productions narratives peuvent appartenir à différents médias, la transmédialité est assurément « constitutive » de la narrativité.
Si je ne peux que saluer l’élargissement de l’analyse narratologique aux récits non strictement verbaux, je redoute cependant que l’objectif de refonder les concepts de la narratologie afin «de les rendre suffisamment souples pour s’adapter à n’importe quel média» (Baroni, ibid., p.2) ne s’accompagne d’une définition de la narrativité plus cognitive que verbale, comme semble le réclamer Marie-Laure Ryan qui prétend en effet que «le récit n’est pas un objet linguistique mais une représentation mentale» (Introduction à la narratologie postclassique, dir. S. Patron, 2018, p. 154). Face à une définition de la narrativité fondée sur un invariant tellement large, je crains pour ma part que la notion de narratologie transmédiale ne perde toute pertinence. Mais ce n’est que le modeste avis d’une narratologue-linguiste!
En conclusion, ne contribue-t-on pas à une inflation des notions en adoptant ce concept de narratologie transmédiale? Ou alors est-ce simplement une stratégie pour assurer la survie des institutions universitaires qui, comme le remarque très justement Jürgen E. Müller dans un article de 2006 sur l’intermédialité (Médiamorphoses, n° 16: 99-100), «ne peuvent plus bâtir leur légitimité scientifique sur un partage disciplinaire strict du savoir» ?
Références citées
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Que sais-je ?».
Adam, Jean-Michel (1985), Le texte narratif, Paris, Nathan-Université.
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Que sais-je ?».
Adam, Jean-Michel (1985), Le texte narratif, Paris, Nathan-Université.
Adam, Jean-Michel (2003), «Entre la phrase et le texte : la période et la séquence comme niveaux intermédiaire de cohésion», Québec français, n° 128, p. 51-54. URL: https://id.erudit.org/iderudit/55780ac
Adam, Jean-Michel (2005), «La notion de typologie de textes en didactique du français: une notion “dépassée”?», Recherches, n° 42.
Adam, Jean-Michel (2011a), Genres de récits : narrativité et généricité des textes, Louvain-la-Neuve, Academia, coll. «Sciences du langage : carrefours et points de vue n° 4».
Adam, Jean-Michel (2011b), «Postface - Littérature et linguistique : dialogue ou coexistence ?», Le français aujourd'hui, n° 175 (4), p. 103-114. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2011-4-page-103.htm
Adam, Jean-Michel (2012), «Discursivité, généricité et textualité», Recherches, n° 56.
Adam, Jean-Michel (2016), «Pratiques, la linguistique textuelle et l’analyse de discours, dans le contexte des années 70», Pratiques, (169-170). URL: https://dx.doi.org/10.4000/pratiques.2931
Adam, Jean-Michel (2017 [1992]), Les textes : types et prototypes, Paris, Nathan Université.
Adam, Jean-Michel (2019), «Linguistique – récits – narratologie», Pratiques, n°181-182. URL: https://dx.doi.org/10.4000/pratiques.5632
Adam, Jean-Michel (2022), «Autour de l’explicatif», Recherches, n° 76.
Adam, Jean-Michel, Guy Achard-Bayle, Dominique Maingueneau, B. Combettes & Sophie Moirand (2006), «Textes/Discours et Co(n)textes. Entretiens avec Jean-Michel Adam, Bernard Combettes», Pratiques, n° 129-130, p. 20-49. URL: https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2006_num_129_1_2094
Adam, Jean-Michel, Gilles Lugrin & Françoise Revaz (1998), «Pour en finir avec le couple récit / discours», Pratiques, n° 100 (1), p. 81-98.URL: https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1998_num_100_1_1853
Adam, Jean-Michel & Françoise Revaz (1996), L'analyse des récits, Paris, Seuil, coll. «Mémo 22. Lettres».
Bachelard, Gaston (1949), Le rationalisme appliqué, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Bibl. de philosophie contemporaine. Logique et philosophie des sciences».
Baroni, Raphaël (2017), «Pour une narratologie transmédiale», Poétique, n° 182 (2), p.155-175. DOI: https://doi.org/10.3917/poeti.182.0155
Benveniste, Émile (1966), Problèmes de linguistique générale, Paris, N.R.F., coll. «Bibliothèque des Sciences humaines».
Bronckart, Jean-Paul, Daniel Bain & Bernard Schneuwly (1985), Le fonctionnement des discours: un modèle psychologique et une méthode d'analyse, Lausanne, Delachaux et Niestlé, coll. «Actualités pédagogiques et psychologiques».
Denhière, Guy (1984), Il était une fois... Compréhension et souvenir de récits, Lille, Presses universitaires de Lille, coll. «Psychologie cognitive».
Fayol, Michel (1994 [1985]), Le récit et sa construction : une approche de la psychologie cognitive, Lausanne , Delachaux & Niestlé, coll. «Actualités pédagogiques et psychologiques».
Genot, Gérard (1984), Grammaire et récit : essai de linguistique textuelle, Nanterre, Université Paris X - Centre de recherches de langue et littératures italiennes.
Müller, Jürgen E. (2006), «Vers l'intermédialité. Histoires, positions et options d'un axe de pertinence», MédiaMorphoses, n°16, p. 99-110. URL: https://www.persee.fr/doc/memor_1626-1429_2006_num_16_1_1138
Paret, Marie-Christine & Raymond Blain (1995), «La structure compositionnellle des textes - entretien avec Jean-Michel Adam», Québec français, n° 99, p. 54-57. URL: https://id.erudit.org/iderudit/44223ac
Revaz, Françoise (1993), «L'expression écrite à l'école: les "schémas de récit"», in Les entretiens Nathan, Actes III, A. Bentolila (dir.), Paris, Nathan, p. 131-140.
Ryan, Marie-Laure (2018), «Sur les fondements théoriques de la narratologie transmédiale», in Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, S. Patron (dir.), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Pour citer l'article
Jean Michel Adam & Françoise Revaz, "Témoignage de Jean Michel Adam et de Françoise Revaz", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-michel-adam-et-de-francoise-revaz
Voir également :
Témoignage de Jean-Paul Bronckart
Nous amorcerons notre diachronie par l’examen d’une phase qui, si elle se situe dans la préhistoire des emprunts et usages aux théories textuelles et narratologiques, fournit néanmoins, pour cette raison même, un utile éclairage sur les raisons pour lesquelles ces emprunts se sont avérés utiles ou nécessaires. Nous remonterons à la publication, en France, du Plan Rouchette, qui a constitué le déclencheur des démarches d’adaptation/modernisation des programmes et méthodes didactiques, requises d’un côté par la volonté politique de démocratisation de l’enseignement et d’un autre par un souci de mise à jour ou de modernisation des méthodes pédagogiques et des références théoriques, en particulier linguistiques.
Témoignage de Jean-Paul Bronckart
Jean Paul Bronckart
Professeur honoraire de didactique des langues à l’université de Genève, Jean-Paul Bronckart a développé divers programmes de recherche portant notamment sur l’épistémologie des sciences humaines/sociales, l’analyse des discours, les processus d’acquisition du langage et la didactique des langues.
Entretien
Dans la mesure où elles requièrent un examen rétrospectif à caractère en partie au moins autobiographique, les réponses que nous proposerons aux questions qui nous sont adressées saisiront la problématique des emprunts et usages des théories du récit dans le cadre plus large que nous nous sommes donné dans nos travaux, à savoir celui de l’investigation, sur les plans didactique et théorique, des théories du texte, des genres de textes et des types discursifs. Nos réponses seront en outre marquées par le fait que nos interventions didactiques ont, pour des raisons institutionnelles, concerné surtout l’enseignement primaire, avec néanmoins des interventions épisodiques dans l’enseignement secondaire inférieur.
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
Nous amorcerons notre diachronie par l’examen d’une phase qui, si elle se situe dans la préhistoire des emprunts et usages aux théories textuelles et narratologiques, fournit néanmoins, pour cette raison même, un utile éclairage sur les raisons pour lesquelles ces emprunts se sont avérés utiles ou nécessaires. Nous remonterons à la publication, en France, du Plan Rouchette, qui a constitué le déclencheur des démarches d’adaptation/modernisation des programmes et méthodes didactiques, requises d’un côté par la volonté politique de démocratisation de l’enseignement et d’un autre par un souci de mise à jour ou de modernisation des méthodes pédagogiques et des références théoriques, en particulier linguistiques. L’accent majeur de cette réforme était d’abandonner l’hyper-centration sur un enseignement grammatical à visée orthographique, et de se donner comme objectif premier le développement et la maîtrise des capacités d’expression/communication.
Dans la mise en place de ce Plan, il s’agissait d’abord d’inciter les élèves à «libérer» leurs capacités verbales et à les adapter aux diverses situations de communication et ensuite de compléter cette démarche par des «approfondissements analytiques» structurels, qui en l’occurrence étaient inspirés des premiers écrits de grammaire générative, considérés alors comme la ressource scientifique la plus «sérieuse» dans le domaine de la structuration des connaissances langagières.
La Suisse romande a adhéré d’emblée à cette démarche, ce qui s’est concrétisé par l’élaboration de Maîtrise du français (1979), ouvrage à la réalisation duquel le signataire a participé en effectuant une large part de la formation linguistique des auteurs. C’est dans le chapitre de cet ouvrage consacré à la morphosyntaxe du verbe qu’apparaît l’une des premières références à des notions d’ordre narratologique, en l’occurrence une présentation de l’opposition discours/récit inspirée de l’ouvrage de Weinrich (1973), qui visait essentiellement à mettre en évidence et à conceptualiser les valeurs des temps des verbes; domaine qui fut et est resté celui de l’emprunt majeur aux théories narratologiques.
Dans le canton de Genève, une réforme de l’enseignement inspirée de Maîtrise du français ayant été engagée à partir des années 1985, il a fallu préparer les enseignants du secondaire inférieur à l’accueil d’élèves ayant bénéficié de cette réforme, et leur proposer de nouveaux moyens d’enseignement; ceux-ci n’existant guère sur le marché, il a été décidé de créer une série de moyens d’enseignement, en l’occurrence les manuels Pratique de la langue, 7e, 8e et 9e, élaborés dans l’urgence en 1988-89 et publiés en 1990. Ces trois manuels comportaient un premier chapitre centré sur les propriétés d’un ou deux genres de texte et, puis de nombreux chapitres centrés sur la grammaire, et enfin un chapitre final intitulé «De la phrase au texte».
- - Le premier chapitre du manuel de 7e portait sur les textes narratifs et les descriptions, et présentait les notions de «phases du plan» et de «narrateur» issues de l’ouvrage Le texte narratif de J.-M. Adam (1985). Le chapitre final intitulé «le fonctionnement discursif des unités» était centré sur les conditions d’usage des temps des verbes et sur les enchainements d’organisateurs temporels.
- - Le premier chapitre du manuel de 8e, était centré sur les textes informatifs et proposait un ensemble de notions ayant trait à la progression thématique, telle qu’elle était présentée dans l’ouvrage de Combettes (1983). Le chapitre final était centré sur les reprises anaphoriques et les modalisations dans une perspective inspirée des travaux du signataire.
- - Le premier chapitre du manuel de 9e était consacré à l’argumentation dans les textes, avec des références à la linguistique textuelle allemande; le chapitre final, d’inspiration pragmatique, était centré sur le fonctionnement des connecteurs et le discours rapporté.
À cette même époque, le signataire a créé, chez l’éditeur Delachaux et Niestlé, une nouvelle collection intitulée Techniques et méthodes pédagogiques, dont le but était de «contribuer à la création de moyens didactiques efficaces, inspirés des théories nouvelles, tout en restant centrés sur les besoins pratiques des éducateurs». Le premier ouvrage de cette série, L’écriture buissonnière; pédagogie du récit (Bach 1987), était destiné à l’enseignement secondaire. Il comportait des références explicites aux écrits d’Adam, Brémond, Bronckart, Greimas et Propp; il introduisait les notions d’«acteurs-narrateur», de «schéma narratif», de «personnage» et présentait surtout une nouvelle approche de la valeur des temps des verbes, tout en considérant que «le modèle théorique choisi n’a pas grande importance; l’essentiel est qu’il y en ait un». (Bach: 25). Il y eut une suite à cette approche dans le remarquable ouvrage de Tauveron (1995) centré sur une approche du «personnage» destinée à l’enseignement primaire.
Au cours de la décennie 1990-2000, divers ouvrages à visée didactique ont introduit des notions issues de la linguistique textuelle et de la narratologie. En 1994, Genevay a publié Ouvrir la grammaire, ouvrage conçu comme document de référence de l’enseignement du français au cycle secondaire du canton de Vaud. Dans cet ouvrage sans référence théorique et sans la moindre indication bibliographique, les trois premiers chapitres traitaient de trois aspects de l’organisation textuelle: d’abord, sous l’intitulé «le cadre de l’énonciation», une présentation des valeurs des temps des verbes et des conditions d’usage des «marqueurs de lieu» et des «mots personnels»; ensuite un chapitre sur les modes de réalisation des divers actes de parole; enfin un chapitre sur les marques de modalisation et les discours rapportés. Suivaient dans cet ouvrage quatre longs chapitres de «grammaire de phrase» d’inspiration radicalement chomskyenne. Venait enfin un chapitre terminal intitulé «Cohésion et progression du texte», mais qui était de fait centré sur les modalités d’articulation, dans la textualité, des structures syntaxiques, sans prise en compte effective de la textualité même.
Au Québec, a été publié en 1999 la Grammaire pédagogique du français aujourd’hui, ouvrage dirigé par S. Chartrand, réédité en 2011 et toujours en usage, qui est destiné aux élèves du secondaire et à leurs enseignants. Cet ouvrage propose ce qui est qualifié de «grammaire du texte», long chapitre comportant d’abord une définition de cette grammaire, puis des développements ayant trait aux reprises anaphoriques, au discours rapporté et à la modalisation, et enfin une approche centrée sur les «modes de discours», consistant en l’occurrence en une reformulation des «séquences» telles que J.-M. Adam les a présentées dans diverses publications.
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
Issue d’une profonde analyse de Verret (1975), la théorie de la transposition didactique de Chevallard (1985/1991) pose que la confection des objets d’enseignement procède par transformation de savoirs savants en savoirs à enseigner, puis par transformation de ces derniers en savoirs tels qu’ils sont enseignés, en un processus à l’issue duquel les savoirs de référence se trouvent détachés du système théorique au sein duquel ils ont émergé, découpés et réorganisés en fonction des objectifs et de la programmation d’une matière scolaire.
Comme Brassart & Reuter (1992) ainsi que Chervel (1998) notamment, nous avons questionné la pertinence et l’éventuelle spécificité de cette théorie pour l’enseignement du français, en raison de l’hétérogénéité des théories proposées dans le champ linguistique et du fait que divers objets de cette matière scolaire n’avaient pas d’origine proprement scientifique. Cette réserve demeure pour ce qui concerne l’exploitation didactique de notions issues de la narratologie, en raison certes de la richesse/diversité des cadres théoriques en ce domaine, mais en raison surtout de la diversité, du peu de clarté voire de la confusion des objectifs didactiques ayant trait à ces notions. Comme Veck, Fournier & Lancrey-Javal (1990) l’avaient montré à propos de la notion de thème, la transposition dans les programmes de littérature prend régulièrement la forme d’un déplacement sémantique résultant de l’insertion de ce terme nouveau dans un paradigme de termes anciens de valeurs parentes.
À notre avis, le problème majeur en ce domaine n’a pas trait à la richesse ou même à l’hétérogénéité des données théoriques, mais plutôt au fait que les visées et objectifs didactiques en ce domaine, et en conséquence la place et le statut que peuvent y prendre les notions et/ou concepts narratologiques, ne sont aujourd’hui pas clarifiés. Ce qui n’est pas le cas dans le domaine proprement grammatical où l’histoire de l’enseignement, quelle que soit sa lourdeur (ou en raison de sa richesse), a fourni des éléments de réflexion sur la base desquels peuvent être plus aisément élaborés des objectifs, des programmations et des principes de progression.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique ?
Dans mon parcours de didacticien, ayant été formé à la grammaire générative par Nicolas Ruwet à l’Université de Liège, dès mon arrivée à Genève au début des années 1970, j’ai pu œuvrer pendant quatre décennies à la transposition des notions de grammaire de phrase; tâche au fond assez simple quant à la construction d’un système de notions qui soit cohérent et assez clairement structuré. Cependant, si les objectifs de maitrise notionnelle voire conceptuelle étaient clairs en ce domaine, l’utilité même de ces connaissances formelles pour une maitrise de l’usage de la langue l’était beaucoup moins.
Sur le plan discursif/textuel, nous avons proposé dans deux ouvrages (Bronckart et al. 1985; Bronckart 1997), des constructions théoriques puisant à divers cadres théoriques et y mettant notre grain de sel, et nous demeurons convaincu de la pertinence globale de notre mode d’analyse des valeurs des temps des verbes, ainsi que de notre analyse des types discursifs. Quant à la transposition didactique, nous avons été confronté aux difficultés globales énoncées plus haut pour les concepts narratologiques; en ce domaine nous avons eu, et nous avons encore, le souci majeur de ne pas saisir les entités textuelles dans une perspective dogmatique, comme c’est le cas pour certaines approches centrées sur les genres textuels et leurs propriétés présumées. La situation reste donc difficile en ce domaine notamment faute d’une clarté sur le lieu de cette transposition dans la structure technique et signifiante des programmes didactiques actuels, et de leur histoire.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort?
Comme indiqué plus haut, c’est dans le domaine des temps des verbes que les concepts narratologiques ont été les plus utilisés, primairement pour fournir une conceptualisation de leurs valeurs, jusque-là manquantes ou d’une pertinence plus que discutable, et secondairement (ou comme conséquence) pour conceptualiser les cadres structurels qui orientent ou conditionnent la distribution de ces valeurs.
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Réponse simple; au vu des ressources théoriques et conceptuelles antérieurement à disposition dans l’enseignement du français, l’introduction de concepts narratologiques ne pouvait que constituer un progrès ou en tout cas ne pas faire de mal, même si un travail important reste à faire en ce domaine, qui, comme indiqué plus haut, concerne certes le choix des cadres et notions théoriques, mais surtout la constitution de programmes didactiques qui soient utiles et pertinents pour les objectifs de maîtrise textuelle; ce qui implique à nos yeux que soient poursuivies et/ou mises en place des recherches proprement didactiques susceptibles de mettre en évidence les utilités et pertinences évoquées.
Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
Pour la société en général, nous n’avons pas d’éléments de réponse. Pour la didactique du français, les travaux de narratologie sont utiles, voire indispensables, pour autant que leur mobilisation au service de la didactique, ni ne s’effectue dans une perspective unilatéralement descendante, ni ne soit reçue dans le champ éducatif dans la perspective figée et dogmatique qui toujours guette.
Références citées
Adam, Jean-Michel (1985), Le texte narratif - précis d'analyse textuelle, Paris, Nathan-Université.
Bach, Pierre (1987), L'écriture buissonnière: pédagogie du récit, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. «Techniques et méthodes pédagogiques».
Besson, Marie-Josèphe, Marie-Rose Genoud, Bertrand Lipp & Roger Nussbaum (1979), Maîtrise du français: méthodologie pour l'enseignement primaire, Lausanne, Office romand des éditions et du matériel scolaires.
Besson, Marie-Josèphe, Jean-Paul Bronckart, Sandra Canelas-Trevisi & Isabelle Nicolazzi-Turian (1990), Français 7e. Pratique de la langue, Genève, Cycle d'Orientation.
Besson, Marie-Josèphe, Jean-Paul Bronckart, Sandra Canelas-Trevisi & Isabelle Nicolazzi-Turian (1990), Français 8e. Pratique de la langue, Genève, Cycle d'Orientation.
Besson, Marie-Josèphe, Jean-Paul Bronckart, Sandra Canelas-Trevisi, Isabelle Nicolazzi-Turian & E. Rougemont (1990), Français 9e. Pratique de la langue, Genève, Cycle d'Orientation.
Brassart, Dominique-Guy & Yves Reuter (1992), «Former des maîtres en français: éléments pour une didactique de la didactique du français», Études de linguistique appliquée, n° 87, p. 11.
Brassart, Dominique-Guy & Yves Reuter (1992), «Former des maîtres en français: éléments pour une didactique de la didactique du français», Études de linguistique appliquée, n° 87, p. 11-24.
Bronckart, Jean-Paul, Daniel Bain, Bernard Schneuwly, Clairette Davaud & Auguste Pasquier (1985), Le fonctionnement des discours: un modèle psychologique et une méthode d’analyse, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
Bronckart, Jean-Paul (1997), Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionnisme socio-discursif, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
Chartrand, Suzanne-Geneviève & François Morin (1999), Grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui, Montréal, Graficor.
Chervel, André (1988), «L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 59-119. URL: https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1988_num_38_1_1593
Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage, coll. «Recherches en didactique des mathématiques» [Réédition augmentée en 1991].
Chiss, Jean-Louis & Jacques David (2018 [2012]), Didactique du français: enjeux disciplinaires et étude de la langue, Paris, Armand Colin, coll. «Collection U, Lettres».
Combettes, Bernard (1983), Pour une grammaire textuelle: la progression thématique, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot, coll. «Pratiques. Série formation continuée».
Combettes, Bernard & Roberte Tomassone (1988), Le texte informatif: aspects linguistiques, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, coll. «Prisme. Problématiques».
Genevay, Éric (1994), Ouvrir la grammaire : interlocuteur, énoncé, communication, phrase, Lausanne, Loisirs et Pédagogie, coll. «Langue et parole».
Tauveron, Catherine (1995), Le personnage: une clef pour la didactique du récit à l'école élémentaire, Lausanne, Delachaux et Niestlé, coll. «Techniques et méthodes pédagogiques».
Lancray-Javal, Romain, Jean-Marie Fournier & Bernard Veck (1990), «Un cas de transposition didactique en français: la notion de thème», Revue française de pédagogie, n° 93, p. 41-49. URL: https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1990_num_93_1_1372
Verret, Michel (1975), Le temps des études, Paris, Honoré Champion.
Weinrich, Harald (1973), Le temps: le récit et le commentaire, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Pour citer l'article
Jean Paul Bronckart, "Témoignage de Jean-Paul Bronckart", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-paul-bronckart
Voir également :
Témoignage de Jean-Louis Dumortier
Au tournant des années 1960-1970, en même temps que paraissaient les premiers ouvrages des fondateurs de la narratologie française (Barthes, Genette, Todorov, Greimas, etc.) ou les traductions en français des précurseurs russes (Propp, Bakhtine, Chklovski, Tomachevski…), en même temps que se répandait, au sein du corps professoral, l’esprit de contestation de la tradition académique et pédagogique qui avait contribué à la flambée de mai 1968, s’opérait, en Belgique francophone, une rénovation des programmes de l’enseignement obligatoire liée à une réforme des structures scolaires dont l’objectif était, dans une conjoncture socio-économique encore favorable (nous sommes à la fin des Trente glorieuses), de mettre fin à une répartition précoce des élèves dans les formes d’enseignement générale, technique et professionnelle et de permettre à l’École de jouer pleinement son rôle d’ascenseur social.
Témoignage de Jean-Louis Dumortier
Jean-Louis Dumortier
Professeur honoraire de l’université de Liège, Jean-Louis Dumortier y a été responsable du service de didactique des langues et littératures françaises. Ses travaux ont porté, entre autres, sur les pratiques scolaires de lecture/écriture du récit. Il est ainsi l’auteur d’un Tout petit traité de narratologie buissonnière à l’usage des professeurs de français qui envisagent de former non de tout petits (et très mauvais) narratologues mais des amateurs éclairés de récits de fiction (2005).
Entretien
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
Au tournant des années 1960-1970, en même temps que paraissaient les premiers ouvrages des fondateurs de la narratologie française (Barthes, Genette, Todorov, Greimas, etc.) ou les traductions en français des précurseurs russes (Propp, Bakhtine, Chklovski, Tomachevski…), en même temps que se répandait, au sein du corps professoral, l’esprit de contestation de la tradition académique et pédagogique qui avait contribué à la flambée de mai 1968, s’opérait, en Belgique francophone, une rénovation des programmes de l’enseignement obligatoire liée à une réforme des structures scolaires dont l’objectif était, dans une conjoncture socio-économique encore favorable (nous sommes à la fin des Trente glorieuses), de mettre fin à une répartition précoce des élèves dans les formes d’enseignement générale, technique et professionnelle et de permettre à l’École de jouer pleinement son rôle d’ascenseur social. C’est la conjonction de ces innovations qui, à mon avis, a favorisé l’engouement de certains jeunes professeurs de français pour la première narratologie.
Je pense que celle-ci s’est implantée dans l’enseignement secondaire (puis dans l’enseignement primaire) avant même d’être résolument enseignée dans les universités, par l’action d’enseignants progressistes et militants qui, au cours des décennies suivantes ont pu faire connaître leurs transpositions didactiques des travaux des narratologues grâce à des revues et à des collections dédiées à la formation des maîtres (Enjeux, Français 2000, Revue de la Direction générale de l’Organisation des Etudes, «Formation continuée», «Séquences», pour m’en tenir à des publications belges), grâce aussi à des propositions de formation continuée bien accueillies par une fraction dynamique du corps enseignant soucieuse d’innover en s’appuyant sur des connaissances solides.
Quitte à tomber dans le piège de l’idéalisation d’une époque qui a été celle de mes premiers pas professionnels, je dirais volontiers que la diffusion de la narratologie dans le secondaire est une des conséquences de l’effervescence pédagogique des années 1970-1980. Cette dernière a suscité, dans la sphère des professeurs de français, un appel de savoirs et de pratiques rompant avec les approches académiques qui tenaient encore le haut du pavé (celles de la «philologie romane») comme avec une tradition d’enseignement que la «sociologie de la reproduction» (Bourdieu) avait prise à partie. Ceux qui ont été alors les champions de la narratologie dans l’enseignement obligatoire avaient, je pense, le sentiment de participer à une révolution scolaire qui conjuguait exigence de scientificité et volonté de donner à tous les élèves des instruments d‘observation des récits qui ne supposaient pas une connivence culturelle préalable entre enseignants et apprenants. Avec le recul, je suis porté à croire qu’il était (un peu?) illusoire de penser réduire l’écart entre les dispositions culturelles de certains maîtres et celles de certains élèves, issus des milieux défavorisés, en donnant à tous les mêmes outils pour l’étude des textes et les mêmes modes d’emploi de ces outils : ce que ces derniers permettaient de constater et de dire pouvait paraître, aux yeux des peu nantis, tout aussi vain, tout aussi inintéressant – voire plus oiseux encore – que les observations et les discours qui concrétisaient les approches traditionnelles des récits, celles qui reposaient sur le «dogme de l’expression-représentation» alors mis à mal par la «nouvelle critique».
Les premiers narratologues s’étaient donné comme objet de recherche le récit (littéraire) en tant que construit sémiotique, coupé de son auteur et de son lecteur. Ils ont mis au jour ses structures profondes et les procédés de «mise en intrigue» de l’histoire qu’il donne à connaître. C’est la nouveauté, la solidité et la relative simplicité de leurs outils de description qui ont séduit certains maîtres du secondaire comme du primaire1 et leur ont souvent fait perdre de vue – un peu ici, complètement là – les raisons pour lesquelles les gens lisaient des récits (de fiction notamment), celles pour lesquelles l’étude de ces derniers avait pris tant de place dans la formation littéraire aux degrés primaire et secondaire et, en fin de compte, celles qui justifiaient l’enseignement de la littérature dans le programme rénové des humanités. La transposition didactique de la narratologie m’apparait, a posteriori, comme une manifestation parmi d’autres d’une entreprise pédagogique qui a commencé dans le dernier quart du XXe siècle: celle d’initier précocement les élèves aux méthodes de la recherche scientifique. Sans que cela n’ait été dit aussi clairement que nécessaire pour donner prise à la contestation, le but est devenu de former des linguistes, des historiens, des chimistes, des physiciens… en herbe et, subsidiairement, comme je l’ai écrit naguère, «de tout petits (et très mauvais) narratologues [plutôt que] des amateurs éclairés de récits de fiction». La redéfinition des objectifs de l’enseignement en termes de compétences (1999) peut être envisagée comme une ratification de ce but latent : il s’agissait désormais de rendre les élèves capables de mettre en œuvre leurs connaissances… pour imiter la démarche des chercheurs… sans être dans une authentique situation de recherche. Dès lors, plus l’appareil d’investigation avait une apparence scientifique et plus il était facile d’un exhiber l’usage («Qui est l’auteur? Qui est le narrateur?», «Le narrateur est-il intra-extra-homo-hétéro diégétique?», «Avons-nous affaire à une focalisation interne, externe ou zéro», etc.: je caricature un peu), plus les performances se prêtaient à une évaluation critériée objective. Une des explications de l’usage scolaire de la première narratologie est, me semble-t-il, à chercher de ce côté-là.
Je ne pense pas que l’extension, au cours des années 1980-1990, des recherches narratologiques aux genres narratifs non fictionnels, dans quelque champ que ces recherches s’inscrivent, que ce soit celui de l’anthropologie (Bruner), de la sociologie (Labov), de la philosophie (Ricoeur), de la psychologie cognitive (Fayol), etc., ait eu un impact important dans l’enseignement obligatoire. Cela tient probablement au fait que les résultats de ces recherches n’ont pas donné lieu à de nombreuses vulgarisations, à des transpositions didactiques encore moins. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que les outils des premiers narratologues ont reçu la consécration des programmes et bénéficié d’une large diffusion par les manuels. D’un instrument d’étude avalisé par l’institution scolaire, la majorité des enseignants se servent souvent sans se demander si ce à quoi il sert concourt à pourvoir les élèves des dispositions dont on voudrait nantir la jeunesse que l’on diplôme. Les outils en question et les pratiques dans lesquelles ils ont été mis en œuvre se sont révélés commodes pour évaluer les acquis de la formation littéraire et je pense qu’ils ont ainsi fait obstacle à la rénovation de cette dernière, qu’ils auraient pu pourtant favoriser.
En même temps que s’élargissait le domaine de la recherche narratologique, se transformait l’objet que s’étaient donné les premiers narratologues. Les investigations des spécialistes du récit de fiction ont porté sur l’interaction entre ce dernier et le(s) lecteur(s). Les pionniers –Iser, en Allemagne; Eco, en Italie; Marghescou et Picard, en France– et leurs successeurs – Jouve, en France; Gervais, au Québec; Dufays, en Belgique; Baroni, en Suisse, etc. – se sont attachés à théoriser la lecture du récit en accordant une attention variable à ce que l’auteur a mis en place pour faire réagir le lecteur, et aux dispositions de ce dernier à prêter attention aux facteurs des effets que le texte est susceptible de produire. Ces travaux, qui avaient l’avantage d’intégrer les recherches antérieures sur ce que Genette avait appelé le «discours du récit» et d’exhiber la puissance d’action de ce dernier sur l’esprit des (ou de certains) lecteurs, étaient, au prix d’une transposition didactique accessible, avalisés par l’institution et largement diffusés par l’édition scolaire, susceptibles d’ébranler et, à terme, de ruiner les pratiques de lecture excessivement «formalistes» auxquelles avait donné lieu la réception scolaire de la première narratologie. Est-ce que c’est ce qui s’est passé? Je pense que non et je le déplore.
Cela ne s’est pas passé parce que ne s’est pas reproduite la conjonction des ruptures (dans le champ de la recherche, dans les programmes et dans le rapport des maîtres à l’institution) qui, une trentaine d’années auparavant, avait favorisé la transposition didactique de la narratologie et l’adoption par la fraction progressiste des enseignants de français des pratiques qu’induisait cette transposition. Cela ne s’est pas passé en dépit de la sévère critique, dans la première décennie du siècle actuel, de ces pratiques devenues de plus en plus formalistes, par ceux-là mêmes qui les avaient inspirées ou répandues, et des propositions concrètes en vue d’une rénovation appuyée sur les travaux des néo-narratologues.
Ce n’est pas que ces travaux n’aient eu aucun impact dans le champ de la didactique du français: c’est sur certains de ceux-ci (entre autres) que s’est appuyé J.-L. Dufays pour conceptualiser la «lecture littéraire», mais c’est que cette didactique est devenue une discipline de recherche et que les résultats de la recherche en didactique dédiée à l’étude du récit se sont moins répandus au sein de l’ensemble du corps professoral que ceux des premières recherches en narratologie. Ces derniers avaient donné lieu à une transposition rapide de la part d’enseignants engagés sur la voie académique (Goldenstein, Petitjean, Halté, Reuter…) et animés par la conviction de concourir au progrès de l’École par le partage du «savoir savant». Trente ans plus tard, les «courroies de transmission» du savoir narratologique que sont les revues pédagogiques, les ouvrages de vulgarisation scientifique, la formation en cours de carrière, les programmes, les manuels, les conseils de l’inspection se sont distendues ou ont tout bonnement disparu, et (surtout, peut-être) le sentiment de concourir à l’amélioration du vivre ensemble en rénovant les savoirs et les pratiques scolaires n’anime plus guère une partie du corps professoral, lequel est, dans son ensemble, excédé par des réformes où le contrôle des acquis d’apprentissage prend aux professeurs une bonne partie du temps que certains consacraient naguère à la rénovation de leurs connaissances. Par ailleurs, il ne me semble pas que les néo-narratologues aient, autant que leurs prédécesseurs, produit un arsenal conceptuel et une nomenclature afférente organisés en distinctions de préférence binaires, pas plus que des savoirs qui se prêtaient autant à la schématisation et à la simplification. Enfin – et paradoxalement – plus la didactique de la littérature (où l’objet «lecture du récit» occupe toujours une place léonine) s’intéressait au «sujet lecteur» et à sa production de sens, moins elle produisait de résultats exploitables par des maîtres de plus en plus contraints à n’enseigner que ce qui pouvait être évalué et à utiliser des outils d’évaluation congruents avec la (néfaste) visée de l’égalité de résultats.
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
Pour autant que je comprenne bien ces «modalités particulières du phénomène de transposition», je pense avoir anticipé cette question en répondant à la précédente. La transposition didactique des premières recherches en narratologie a été, me semble-t-il, relativement rapide, favorisée par un «esprit d’époque» porté à la démocratisation de l’enseignement secondaire, entendue comme processus visant à en faire bénéficier les moins nantis économiquement, socialement et culturellement. Elle s’inscrit dans un ample courant de réforme des contenus et des pratiques d’enseignement inspiré par l’innovation scientifique et la volonté de rendre tous les élèves capables de manier les mêmes instruments d’investigation (des textes en l’occurrence). Elle a été le fait d’une fraction progressiste du corps professoral qui s’affirmait en rompant à la fois avec la tradition académique et la tradition pédagogique.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique?
Ayant été au nombre des tout premiers vulgarisateurs des recherches en narratologie (1980, 1986) et ayant constaté avec effarement la dérive formaliste de l’usage des savoirs que j’avais contribué à faire connaître, il m’est arrivé de penser que j’aurais mieux fait de me casser le poignet au lieu d’écrire les livres et les articles où je partageais les connaissances que je devais aux spécialistes. J‘ai néanmoins toujours résisté à la tentation de l’accident volontaire en me disant qu’un exemple de plus de l’usage de la narratologie au service de la réflexion sur le(s) plaisir(s) de lire et sur la pragmatique du récit pouvait éviter à quelques-uns de dériver ainsi. Ma foi en la vertu de l’exemple est déraisonnable, mais credo quia absurdum : on sait ça…
Une vingtaine d’années après mes premiers méfaits, j’ai tenté de rassembler dans une thèse de doctorat (2001) ce que je savais des différents apports au domaine de la narratologie et d’en proposer des usages qui évitaient (vaille que vaille) les fourvoiements du formalisme.
Informé des dégâts provoqués dans l’enseignement primaire par des pratiques fondées sur des vulgarisations de troisième main, je n’ai pas cru inutile de rappeler, dans un livre destiné aux instituteurs, qu’on ne devrait pas appeler n’importe quoi n’importe comment et se servir d’une panoplie de notions bancales dans des pratiques qui dégoutaient prématurément les enfants de la lecture (2006). En outre, je me suis fendu, à l’usage des enseignants du secondaire, d’un Tout petit traité de narratologie buissonnière… (2005) qui contribuait au chantier de démolition d’un enseignement de la littérature gâté par le formalisme et pour lequel je garde quelque indulgence parce que je pense y avoir allègrement persévéré sans (trop) verser dans le diabolique.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort ?
Je me garderais bien d’affirmer que ce sont des «concepts» qui ont été mis en œuvre par tous les enseignants ayant utilisé le vocabulaire des narratologues et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’emploi de ce vocabulaire a été souvent erratique ou incongru.
Cela dit, au palmarès des mots les plus utilisés, je ferais figurer : «récit» et «histoire», «auteur» et «narrateur» (j’ajoute «personnage» quand il a été arraché au discours commun pour compléter le trio devenu indispensable pour l’étude des «récits de vie», fictionnels ou non), «schéma narratif» (avec ses composantes), «schéma actantiel» (avec ses actants), «fictionnel» et «factuel», «vraisemblable» et «invraisemblable», ainsi que tout l’appareil descriptif (je renonce à l’inventaire : pardon pour cette paresse) élaboré par Genette pour distinguer les procédés de «mise en intrigue» (Ricoeur) relevant de la «voix», de la «personne» et du «temps» –mais dans des versions adaptées ad usum delphini qui manifestaient rarement les scrupules terminologiques de l’auteur de «Discours du récit» (in Figures III), de Nouveau discours du récit, et de Fiction et diction, entre autres).
La fortune de ces mots tient, selon moi, notamment au fait que la plupart d’entre eux peuvent entrer dans des oppositions binaires aisément mémorisables («situation initiale» vs «situation finale», «sujet» vs «objet», «focalisation interne» vs «focalisation externe», «analepse» (rétrospection) vs «prolepse» (prospection), «factuel» vs «fictionnel», etc.) et servent à opérer ces distinctions élémentaires devenues un nec plus ultra dans un enseignement piloté par le contrôle des acquis d’apprentissage.
Au nombre des concepts ou des notions qui auraient pu (ou dû) mieux retenir l’attention, j’accorderais une priorité aux modes de réception du personnage par le sujet lisant (personnage perçu comme pion, comme personne et comme prétexte) distingués par Jouve (1992) et, surtout, aux affects distingués par Baroni2 (2007), ceux-là comme ceux-ci permettant de s’interroger sur la pragmatique du récit, sur les effets potentiels de procédés identifiés par Genette. Du lot de ces derniers, je sortirais volontiers, comme l’a fait Genette lui-même (2004), la métalepse, fort utile pour susciter une bien nécessaire réflexion des élèves sur la fiction et le rapport du lecteur aux mondes fictionnels (Ryan, Cohn, Jacquenod, Schaeffer, Caïra, etc.).
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Du «français»? Je ne saurais dire. Mais voici deux mots sur l’impact qu’a eu, selon moi, la transposition didactique de la narratologie sur la formation littéraire au cours de la scolarité obligatoire.
Le savoir narratologique a renouvelé les pratiques scolaires d’étude du récit, il a rendu possible des procédures d’analyse que les élèves étaient capables de s’approprier vaille que vaille, et cela pouvait être interprété comme un progrès par les tenants de l’apprentissage par l’activité. Mais ces pratiques, qui donnaient prise à une évaluation critériée objective du savoir lire, ont freiné (empêché?) le changement de cap de la formation lorsque celle-ci, dans une conjoncture culturelle marquée au coin d’un individualisme hédoniste (qui s’est malheureusement radicalisé), s’est déportée des objets littéraires sur l’usage de ces objets par le sujet lecteur. La néo-narratologie aurait pu favoriser ce changement de cap, mais sa transposition didactique, dans le cadre de la «lecture littéraire» notamment, pour les raisons que j’ai dites, a eu moins d’influence que celle des savoirs établis par les pionniers, d’autant moins que la plupart des contempteurs du formalisme dans l’enseignement littéraire se sont acharnés sur ces savoirs au lieu de s’intéresser aux plus récents, qu’il y avait bien des raisons de promouvoir.
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
Est-il trop tard pour rédimer la narratologie par l’exemple de pratiques qui articulent les savoirs anciens et les nouveaux pour expliquer les effets potentiels du récit sur le lecteur et pour rendre intelligibles l’actualisation de certains de ces effets sur certains sujets lisants? Peut-être pas, mais il n’y a pas de temps à perdre car, pour ce que je sais de la place qu’en Belgique francophone la formation littéraire prendra dans les nouveaux programmes de français, on fera la part un peu trop belle à une réception esthétique des œuvres par des jeunes – et non des élèves – que l’on n’a pas assez songé à nantir des moyens de les apprécier. Que l’on se soucie de ce mode de réception plus qu’on ne l’a fait précédemment, je m’en réjouis, mais je ne me réjouis pas d’un renoncement à la réflexion sur les goûts personnels, ni à une éducation du goût susceptible de favoriser un vivre ensemble qui ne se pervertit pas en communautarisme tolérant. À cette réflexion, à cette éducation, un solide savoir narratologique pourrait sans doute contribuer bien plus que ne l’imaginent ceux qui, sans précaution, le jettent avec l’eau du bain formaliste.
J.-L. Dumortier 21.01.2022
Références citées
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Dumortier, Jean-Louis & Francine Plazanet (1980), Pour lire le récit : l’analyse structurale au service de la pédagogie de la lecture. Langages nouveaux, pratiques nouvelles pour la classe de langue française, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot.
Dumortier, Jean-Louis (1986), Écrire le récit, Bruxelles-Paris-Gembloux, DeBoeck-Duculot.
Dumortier, Jean-Louis (2001), Lire le récit de fiction : pour étayer un apprentissage : théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck-Duculot, coll. «Savoirs en pratique : français ».
Dumortier, Jean-Louis (2005), Tout petit traité de narratologie buissonnière : à l'usage des professeurs de français qui envisagent de former non de tout petits (et très mauvais) narratologues mais des amateurs éclairés de récits de fiction, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Diptyque».
Dumortier, Jean-Louis & Micheline Dispy (2006), Aider les jeunes élèves à comprendre et à dire qu'ils ont compris le récit de fiction, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Tactiques 1».
Genette, Gérard (2004), Métalepse : de la figure à la fiction, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Jouve, Vincent (1992), L'effet-personnage dans le roman, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Écriture».
Pour citer l'article
Jean-Louis Dumortier, "Témoignage de Jean-Louis Dumortier", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-louis-dumortier
Voir également :
Témoignage de Yves Reuter
Il me semble qu’il a d’abord fallu que certains enseignants s’emparent de ces nouveaux contenus en relation avec des cours suivis dans les universités où quelques professeurs (très minoritaires) abordaient ces questions, notamment dans les départements de lettres et de sciences du langage. Cela n’avait rien d’évident tant cela s’opposait à la doxa commentative dominante dans les universités (une sorte de mixte entre vulgates psychologique et historique) et à la tradition de l’enseignement du français.
Témoignage de Yves Reuter
Yves Reuter
Professeur émérite à l’université de Lille, après avoir enseigné en collège, en lycée et en école normale, Yves Reuter est le fondateur de l'équipe de recherche en didactiques Théodile (aujourd’hui intégrée au sein du CIREL). Il a mené diverses recherches et publié de nombreux articles et ouvrages sur les représentations des disciplines, sur les relations entre le vécu des disciplines et le décrochage scolaire, sur l’erreur, sur l’enseignement et l’apprentissage de l’écrit (littérature, lecture, écriture, récit, personnage, description, littéracies universitaires...) et sur les concepts des didactiques.
Entretien
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
Je n’ai pas vraiment effectué ce travail historique. Aussi, ma réponse est totalement impressionniste.
Il faut en tout cas rappeler le travail essentiel de revues théoriques de sciences humaines telles Communications (voir notamment le n°8(1966)), Poétique ou Littérature et l’émergence de théoriciens tels Barthes, Greimas, Genette, Hamon, Todorov ou encore les relectures des travaux de Propp.
Il me semble qu’il a d’abord fallu que certains enseignants s’emparent de ces nouveaux contenus en relation avec des cours suivis dans les universités où quelques professeurs (très minoritaires) abordaient ces questions, notamment dans les départements de lettres et de sciences du langage. Cela n’avait rien d’évident tant cela s’opposait à la doxa commentative dominante dans les universités (une sorte de mixte entre vulgates psychologique et historique) et à la tradition de l’enseignement du français. Cela a été d’autant moins simple que nombre d’enseignants et d’étudiants «engagés» étaient peut-être plus intéressés par des courants plus philosophico-politiques autour d’Althusser ou des revues Tel Quel ou Dialectiques. Il faut aussi rappeler la concurrence des approches thématiques dans ces années-là.
Puis l’entrée dans certaines classes s’est appuyée sur plusieurs phénomènes: la volonté de combattre cette doxa commentative à l’université et de renouveler l’enseignement de la littérature en s’appuyant sur des recherches «contemporaines» censées lutter plus efficacement contre l’échec scolaire (voir la critique des manuels en usage dans les revues telles L/S/I ou Pratiques); une appropriation et une transmission de ces apports par des mouvements tels le GFEN ou des revues (Pratiques) au travers de stages ou d’universités d’été; la rencontre avec des théories des textes et notamment la question des typologies (avec les travaux de J.-M. Adam); la vulgarisation de certains pans de la narratologie dans des ouvrages d’initiation (Dumortier-Plazanet, Goldenstein, Reuter…), puis dans certains manuels scolaires.
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
Je préfère parler d’élaboration didactique (voir Françoise Ropé ou Jean-François Halté) plutôt que de transposition, ce concept réduisant à mon sens la complexité de la construction des contenus scolaires. Il me semble que cette élaboration a été prise dans une tension entre, d’un côté, appauvrissement et applicationnisme et, de l’autre, ouverture puisque cela a permis d’introduire dans les classes des genres peu étudiés jusqu’alors (les contes étaient bien moins étudiés auparavant) et de nouveaux exercices (voir la question 5). Cela s’est en tout cas inscrit dans des luttes symboliques et institutionnelles assez violentes entre «modernistes» et «traditionnalistes» (voir l’ouvrage de Pommier, professeur à la Sorbonne, Assez décodé, en 1978).
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique?
Là encore, je ne sais pas bien comment répondre, car je ne dispose pas véritablement d’éléments sur cette question (au-delà de témoignages d’enseignants de cette époque).
Mais ma contribution a emprunté divers chemins qui ont en commun de ne pas en rester à une approche générale et essentiellement formelle :
- - une volonté d’éviter le technicisme en articulant cette approche à la question des effets produits;
- - un souci de l’articulation lecture – écriture;
- - un travail approfondi sur certains genres (policier et particulièrement suspens, sentimental, quatrième de couverture…);
- - un travail spécifique et approfondi sur la description, les personnages (et le système des personnages selon le genre) et les scènes…
- - la volonté de montrer comment fonctionnait les récits ou les descriptions dans diverses disciplines scolaires et de recherche.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort?
Il me semble que les principaux concepts ont été le schéma quinaire, le schéma actantiel et le point de vue, tous étant très simplifiés et parfois issus de plusieurs sources sans trop penser leur articulation (plutôt Greimas, Larivaille pour le premier), Greimas et Hamon (en ignorant Souriau pour le second) ou d’une source unique (en ignorant les critiques existantes, cf. Genette pour le troisième).
Il me semble que leur fortune est, au moins en partie, liée aux exemples fournis par les théoriciens qui en étaient les promoteurs ou les manuels ainsi que l’illusion que leur maniement était simple et directement transférable dans les classes sans se soucier véritablement de la difficulté de leur usage sur des écrits longs et relativement complexes (ce qui explique, au moins en partie, la floraison des contes dans les classes).
Je regrette en revanche le peu de place accordée aux concepts qui renvoyaient aux questions fondamentales de la textualisation des savoirs (énoncifs ou énonciatifs pour Hamon) ou des valeurs, notamment chez Hamon ou encore de l’énonciation. Il me semble aussi que la focalisation sur l’écrit au détriment des récits oraux (voir les travaux de Labov ou de Brès) a contribué à cette minoration.
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Pour moi, ils ont été porteurs d’une bouffée d’oxygène pour quatre raisons au moins:
- - ils représentaient une ouverture de possibles théoriques et pédagogiques, de textes, d’exercices, de types d’analyses…
- - ils instauraient une véritable possibilité d’explicitation, notamment auprès d’élèves issus de milieux défavorisés, permettant ainsi de sortir de la connivence liée à l’impressionnisme psychologico-historique;
- - ils offraient, en relation avec des notions linguistiques, une base pour des interprétations diverses, qu’elles soient psychanalytiques, sociologiques ou encore historiques;
- - ils permettaient d’articuler, au moins en partie, «grammaire de phrase» et «grammaire de texte ou de discours».
Ils ont cependant été galvaudés en raison de quelques dérives: la confusion entre savoirs pour l’enseignant et savoirs pour les élèves ; une confusion entre les dimensions de la fiction et de la narration et de la mise en discours (ce qui faisait que certains enseignants demandaient à leurs élèves d’écrire des récits en suivant la linéarité du schéma quinaire); un appauvrissement de la souplesse d’écriture que pouvait procurer cette approche; le manque d’articulation entre lecture et écriture; le cadrage par les typologies de textes qui ont engendré des démarches d’étiquetage (comme pour la grammaire classique) et l’idée que les types étaient des catégories étanches et non des dimensions des genres (ce que j’avais tenté de défendre dans la lignée des formalistes russes et de Hamon) ; le cloisonnement des composantes de la matière français qui a entravé les relations avec les questions de grammaire (ce que nous avions essayé de faire avec la question du personnage construit comme organisateur possible de l’enseignement du français).
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
La question est trop générale pour moi.
Je souhaitais quand même dire à quel point j’étais surpris par la manière dont certains avancent deux idées sans grand fondement pour moi (je ne connais pas véritablement d’études précises sur ces questions): la narratologie aurait envahi le champ de l’enseignement du français et ses usages auraient été néfastes, notamment en ce qu’elle aurait généré des récits plus stéréotypés qu’auparavant.
Ayant dit cela, il me semble que les analyses du récit demeurent présentes dans l’enseignement du français (le récit est une des catégories de textes les plus étudiées en relation avec des idées reçues sur la genèse de son appropriation par les enfants (qui serait plus précoce que pour d’autres «types») et sur l’intérêt qu’il susciterait (supérieur à d’autres types). Cela s’articule aussi avec la place de la littérature et du roman.
Les analyses du récit (sans se référer exclusivement à la narratologie) sont aussi très présentes dans la société en général et dans les discours sociaux : voir l’essor des histoires de vie, voir aussi la référence fétichisée à Ricœur, les débats autour du récit national ou la vogue du «storytelling».
Annexes. Quelques publications d’Yves Reuter sur ces questions
Ouvrages
- Introduction à l'analyse du roman, Paris, Dunod, 1991, 165 p.
Seconde édition revue et corrigée en 1996, Troisième édition, revue et corrigée, Armand Colin, 2009. Quatrième édition revue et corrigée 2016.
- Enseigner et apprendre à écrire. Construire une didactique de l'écriture, Paris, E.S.F., 1996, 181 p.
- L’analyse du récit, Paris, Dunod, 1997, coll. «Topos», 128 p.
Traduction au Brésil. L’analyse du récit, Paris, Nathan, 2001, coll. «128» (édition Dunod modifiée), L’analyse du récit, Nouvelles éditions, revues et corrigées, Armand Colin, 2005, 2009, 2016.
- La description. Des théories à l’enseignement-apprentissage, Paris, ESF, 2000, 230 p.
- Personnage et didactique du récit, Metz, Centre d'Analyse Syntaxique de l'Université de Metz, 1996, (en collaboration avec P. Glaudes), 221 p.
- Le personnage, Paris, P.U.F., 1998, coll. « Que sais-je ? » (en collaboration avec P. Glaudes), 128 p.
- Personnage et histoire littéraire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991 (en collaboration avec P. Glaudes), 258 p.
Direction d’ouvrages collectifs
- La question du personnage. Cahiers de Recherches en Didactique du Français, n°1, Université de Clermont-Ferrand, CRDP, octobre 1987, 155 p.
- Le personnage dans les récits. Cahiers de Recherches en Didactique du Français, n°2, Université de Clermont-Ferrand, CRDP, octobre 1988, 64 p.
- Personnages et histoires. Cahiers de Recherches en Didactique du Français, n°3, Université de Clermont-Ferrand, CRDP, janvier 1990, 173 p.
Pour citer l'article
Yves Reuter, "Témoignage de Yves Reuter", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-yves-reuter
Voir également :
Témoignage de Claude Simard
D’après moi, l’entrée de la narratologie dans la classe de français s’est faite surtout par l’entremise de publications auxquelles ont été initiés les étudiants et les enseignants dans les diverses instances de formation pédagogique (universités, instituts, colloques, journées de perfectionnement, etc.). On peut distinguer différentes catégories de publications qui ont contribué à l’utilisation des théories du récit dans l’enseignement. D’abord les ouvrages de narratologie proprement dits portant sur les structures du récit, ceux des théoriciens comme Propp (1928, trad. 1970), Greimas (1966), Genette (1972) ou Larivaille (1974) et ceux d’introduction générale comme les synthèses d’Adam (1984) ou de Reuter (1997).
Témoignage de Claude Simard
Claude Simard
Professeur retraité de l’université Laval, Claude Simard a enseigné la didactique du français en formation initiale et continue des enseignants du primaire et du secondaire. Dans ses recherches, il s'est intéressé notamment à l'enseignement de la grammaire et de l'écriture.
Entretien
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans la classe des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
D’après moi, l’entrée de la narratologie dans la classe de français s’est faite surtout par l’entremise de publications auxquelles ont été initiés les étudiants et les enseignants dans les diverses instances de formation pédagogique (universités, instituts, colloques, journées de perfectionnement, etc.). On peut distinguer différentes catégories de publications qui ont contribué à l’utilisation des théories du récit dans l’enseignement. D’abord les ouvrages de narratologie proprement dits portant sur les structures du récit, ceux des théoriciens comme Propp (1928, trad. 1970), Greimas (1966), Genette (1972) ou Larivaille (1974) et ceux d’introduction générale comme les synthèses d’Adam (1984) ou de Reuter (1997). Viennent ensuite les publications à visée plus didactique cherchant à familiariser les enseignants avec les savoirs narratologiques de manière à leur montrer comment les exploiter en classe avec les élèves (en lecture et en écriture surtout) ; je citerai entre autres les numéros 11-12 et 14 portant spécifiquement sur le récit de la revue Pratiques ainsi que des livres comme ceux de Halté et Petitjean (1977) ou de Dumortier et collaborateurs (1980, 1986, 2001 et 2005). Enfin certaines publications relevant davantage de la création littéraire se sont intéressés plus spécifiquement aux techniques d'écriture narrative que l’on peut développer chez les élèves: pour le Québec, je pense par exemple à L’École à fictions de Bourque et Noël-Gaudreault (1985); en France, Oriol-Boyer (1992, 2004) a contribué notablement à intégrer dans la classe de français les ateliers d’écriture littéraire d’inspiration narratologique.
Une autre voie importante est sans aucun doute les programmes d’études ministériels qui, en ayant intégré des savoirs issus de la narratologie, leur ont conféré un caractère officiel dans l’enseignement. Pour le Québec, le programme de français langue première qui a été le premier à tenir vraiment compte des théories du récit est celui qui est paru en 1995 et qui a notamment consacré sur le plan didactique le concept de schéma narratif.
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
Il faut se rappeler le contexte dans lequel est apparue la narratologie à l’école. La transposition didactique des concepts narratologiques est issue d’un courant d’opposition à l’enseignement littéraire traditionnel qui avait cours depuis plusieurs décennies dans l’ensemble de la francophonie, et spécialement en France. On a qualifié cette époque (autour des années 1970) d’« ère du soupçon ». Plusieurs auteurs dont Halté et Petitjean reprochaient à l’enseignement littéraire traditionnel son subjectivisme, son encyclopédisme, son historicité arbitraire et son élitisme. La narratologie a été vue comme une approche moderne prometteuse devant assurer l’étude des textes littéraires par les élèves à partir de concepts scientifiquement élaborés au lieu de les soumettre à une attitude de vénération béate des auteurs reconnus. La classe de littérature quittait ainsi son ancrage idéologique du dogme de l’expression personnelle des grands génies de la communauté linguistique pour devenir un lieu d’acquisition de savoirs sur les textes littéraires et d’outils d’analyse de leurs structures.
Cependant, avec le temps, ce nouveau courant a été soumis lui aussi à la contestation. On a critiqué son caractère trop analytique et abstrait, son formalisme qui risquait de rebuter les élèves et de les détourner de la lecture littéraire. Avec le courant plus récent du sujet lecteur, l’attention s’est portée vers la personne de l’élève par la valorisation de ses goûts, de ses intérêts, de ses appréciations et de ses interprétations propres.
Au cours des cinquante dernières années, l’enseignement littéraire dans la classe de français me semble donc être passé successivement de la centration sur l’auteur, sur le texte puis sur le sujet lecteur, ce qui montre que la transposition didactique est en bonne parti tributaire de l’objet d’étude auquel on accorde la priorité.
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique?
En toute franchise, je dois dire que je n’ai pas été un acteur important de ce processus historique. Certes, au cours de ma carrière, je me suis intéressé à l’enseignement littéraire, notamment à l’exploitation de la littérature d’enfance et de jeunesse dans la classe de français. Mais mon champ principal d’intérêt a été l’enseignement de la grammaire.
Contrairement à des auteurs comme Halté, Petitjean, Reuter, Legros ou Dufays, qui ont consacré une grande partie de leur carrière à faire progresser l’enseignement littéraire notamment par l’introduction des concepts de la narratologie, ma contribution dans le domaine a été plus modeste et s’est concentrée sur l’initiation à l’exploitation didactique des théories du récit dans le cadre des cours que j’ai donnés à l’université aux futurs enseignants.
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort ?
Comme le Québec correspond à la communauté francophone où j’ai travaillé en tant que didacticien du français, je m’intéresserai ici surtout au Québec en me référant aux programmes d’études actuels édictés par le ministère de l’Éducation.
Le programme du primaire a une approche globale des textes et ne définit guère les caractéristiques spécifiques des divers genres textuels. On y trouve donc très peu de notions propres à la narratologie; il est question à la place de principes d’organisation générale des textes tels que la division jugée universelle en introduction/développement/conclusion. À propos du récit, il est demandé en lecture ou en écriture d’initier les élèves aux principaux genres narratifs (conte, légende, bande dessinée, roman) sans autre précision. Certains termes peu spécifiques propres à la constitution d’un récit apparaissent à quelques endroits comme personnage, intrigue, événements perturbateurs, rebondissement de l’action.
Au secondaire, la narratologie occupe une place plus importante. À la rubrique «La narration dans les textes littéraire» de la partie consacrée à la progression des apprentissages, on trouve plusieurs concepts narratologiques:
- - la distinction entre l’auteur et le narrateur;
- - les types de narrateur (ominiscient, participant à l’histoire, multiple, récit à la 1re ou à la 3e personne);
- - les personnages et leurs rôles actanciels (héros, adjuvant, opposant, bienfaiteur, victime);
- - l’intrigue : la quête d’équilibre du personnage principal, la séquence narrative (situation initiale, élément déclencheur, actions, situation finale, dénouement);
- - le déroulement des événements (ordre chronologique, retour en arrière, anticipation);
- - les séquences secondaires dans le récit (description, dialogue, explication, argumentation).
Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi le ministère de l’Éducation du Québec a fait ces choix. Les conceptions théoriques des équipes de rédaction ont dû certainement jouer : celle du primaire adhérait manifestement une vision globalisante des textes, alors que celle du secondaire se référait davantage à la diversification des textes en genres ou en séquences.
Les notions narratologiques retenues dans le programme du secondaire me semblent couvrir les structures essentielles du récit. Cependant on pourrait regretter que la distinction fondamentale entre histoire et narration ne soit pas mentionnée, un récit étant avant tout un texte qui raconte une histoire, c’est-à-dire une forme verbale qui évoque d’une certaine manière des événements réels ou imaginaires. Pour comprendre ce qu’est un récit, il importe de départager ce qui relève du monde constitutif de l’histoire et la manière dont ce monde est représenté par la narration, car comme l’a si bien montré Queneau dans Exercices de style, une même histoire peut donner lieu à de multiples récits si on en change le mode de narration.
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Question délicate qui ne peut pas recevoir une réponse tranchée.
On ne peut certes pas se désoler que des savoirs sérieusement élaborés comme ceux de la narratologie soient introduits dans la classe de français pour aider les élèves à mieux maîtriser la communication verbale et à s’initier avec plus de rigueur aux phénomènes littéraires. Les acquis de la narratologie comme ceux de la linguistique textuelle en général ont assurément contribué à enrichir les contenus d’apprentissage de la classe de français en la dotant d’outils conceptuels assurant une appréhension plus approfondie des entités complexes et multiformes que sont les textes.
Cependant, un savoir qui entre dans le monde de l’école n’est plus exactement le savoir qui est traité dans le monde scientifique. Il est remodelé, transposé à des fins didactiques. La question fondamentale concernant l’introduction de concepts dans l’enseignement est celle de leur visée et corollairement de leur mode de présentation en classe : pourquoi serait-il pertinent pour la formation des jeunes de leur faire connaître tel ou tel concept narratologique et, compte tenu de l’intention pédagogique poursuivie, quelle serait la meilleure approche pour les traiter dans l’institution scolaire?
En classe de littérature, la narratologie, en tant que champ du savoir, peut être étudiée pour elle-même, le but étant de faire acquérir aux élèves des notions explicites sur le fonctionnement du récit. Cette perspective didactique peut se justifier à la fois sur le plan culturel en raison de l’élargissement du bagage de connaissances des élèves qui en résulte au sujet du langage et de la littérature, mais aussi sur le plan intellectuel si l’on songe à l’étude rigoureuse des diverses structures du récit que la narratologie rend possible grâce à ses puissants outils d’analyse.
Toutefois, la classe de littérature n’est pas seulement un lieu d’acquisition de savoirs. Elle est censée aussi développer des pratiques culturelles en contribuant à former des lecteurs d’œuvres littéraires. Comme je l’ai mentionné plus haut, on a critiqué un mode d’exploitation essentiellement formaliste de la narratologie en classe ayant la tendance trop académique à n’aborder les textes littéraires que du point de vue de leur organisation interne sans prise en compte de la subjectivité et de la sensibilité du lecteur, de ses réactions personnelles, du retentissement du récit sur son esprit.
La classe de littérature devrait veiller à maintenir un équilibre entre l’intellect et l’affect, entre l’étude systématique des textes littéraires et la place à réserver à l’élève en tant que sujet lecteur. Voilà un défi à relever sans relâche en classe de littérature. Les concepts narratologiques ne devraient pas être uniquement étudiés en tant que savoirs sur la littérature, ils devraient principalement servir à la formation de lecteurs en s’intégrant le plus naturellement possible aux instruments de compréhension et d’interprétation des élèves de manière à former des lecteurs de textes littéraires à la fois fervents, plus autonomes, plus conscients et plus avertis.
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
À mon avis, l’analyse du récit s’est intégrée à la classe de français depuis assez longtemps, déjà une cinquantaine d’années, pour faire maintenant pleinement partie du domaine de la didactique du français. Elle constitue en quelque sorte une composante incontournable de l’enseignement-apprentissage des textes et de la littérature.
Sur le plan social, il me semble que l’étude du récit est un champ de connaissance essentiel compte tenu de l’importance des genres narratifs dans l’histoire de l’humanité. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ressentent le besoin de raconter des histoires. Les récits qu’ils ont produits sont constitutifs de leurs diverses cultures. Savoir comme ils sont construits m’apparaît comme une voie féconde pour mieux comprendre comment la pensée se met en forme et s’actualise dans les grandes entités sémiotiques que sont les textes.
Références citées
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?».
Bourque, Ghislain & Monique Noël-Gaudreault (1985), L’École à fictions, Québec, Presses de l’Université du Québec.
Dumortier, Jean-Louis & Francine Plazanet (1980), Pour lire le récit : l’analyse structurale au service de la pédagogie de la lecture. Langages nouveaux, pratiques nouvelles pour la classe de langue française, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot.
Dumortier, Jean-Louis (1986), Écrire le récit, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot.
Dumortier, Jean-Louis (2001), Lire le récit de fiction: pour étayer un apprentissage : théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck-Duculot, coll. «Savoirs en pratique: français».
Dumortier, Jean-Louis (2005), Tout petit traité de narratologie buissonnière : à l'usage des professeurs de français qui envisagent de former non de tout petits (et très mauvais) narratologues mais des amateurs éclairés de récits de fiction, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Diptyque».
Greimas, Algirdas Julien (2002 [1966]), Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, PUF.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Oriol-Boyer, Claudette (dir.) (1992), Ateliers d’écriture, Grenoble, L’Atelier du texte-Ceditel.
Oriol-Boyer, Claudette (2002), Lire-écrire avec des enfants, Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées.
Propp, Vladimir (1928/1970), Morphologie du conte, Paris, Seuil, coll. «Points».
Reuter, Yves (2016 [1997]), L'analyse du récit, Paris, Armand Colin.
Halté, Jean-François & André Petitjean (1977), Pratiques du récit, Paris, CEDIC, coll. «Textes et non textes».
Pour citer l'article
Claude Simard, "Témoignage de Claude Simard", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-claude-simard
Voir également :
Témoignage de André Petitjean
Votre question me donne l’occasion d’opérer un regard rétrospectif sur une partie de ma carrière professionnelle en tant qu’enseignant du secondaire, puis Professeur des universités, jusqu’à mon Éméritat présent. Je pense que j’ai contribué à la diffusion des théories du récit par mes propres publications (http://andre-petitjean.fr/), au travers de mes cours, de mes directions de thèse, de l’organisation de séminaires et de colloques ou des stages de formation des enseignants que j’ai animés tant en France qu’en Belgique ou en Suisse.
Témoignage de André Petitjean
André Petitjean
Professeur émérite en Sciences du langage à l’UFR Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Lorraine (site de Metz). Membre du CREM (Centre de recherche sur Les médiations Communication, Langue, Art, Culture), Pôle PRAXITEXTE (Langue, Texte, Discours et Médiations) et directeur de la collection ELT (Études linguistiques et textuelles). Co-fondateur en 1974 de la revue Pratiques dont il est le directeur.
Les théories du récit et leur transposition didactique : l’exemple de la revue Pratiques.
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
Votre question me donne l’occasion d’opérer un regard rétrospectif sur une partie de ma carrière professionnelle en tant qu’enseignant du secondaire, puis Professeur des universités, jusqu’à mon Éméritat présent. Je pense que j’ai contribué à la diffusion des théories du récit par mes propres publications (http://andre-petitjean.fr/), au travers de mes cours, de mes directions de thèse, de l’organisation de séminaires et de colloques ou des stages de formation des enseignants que j’ai animés tant en France qu’en Belgique ou en Suisse. J’ai eu aussi l’occasion de co-diriger la collection de manuels intitulés Maîtrise de l’écrit édités par Nathan (cf. Petitjean, n° 82)1. Pour ne prendre que l’exemple du manuel de 6e, les titres des chapitres sont significatifs (Récits brefs, Du script à l’histoire, Construire un récit, Les personnages, Nommer et désigner les personnages, Temps et récit, Faire rire, faire pleurer, faire peur). J’ai eu enfin la responsabilité de co-diriger le Plan d’Études de Français du Cycle d’Orientation du canton de Genève (1998) et, en France, les Instructions Officielles pour le lycée (2000). Dans les deux cas, les théories du récit ont largement été transposées.
Il reste que c’est la revue Pratiques que je dirige depuis 1974, qui aura largement contribué à produire et/ou diffuser les théories du récit tout en assurant leur didactisation au service des apprentissages, tant de la lecture que de l’écriture. C’est pourquoi il m’a semblé utile d’en rendre compte, à l’aide d’un examen des nombreux articles publiés sur le sujet. Ce faisant, j’ai conscience que tenter d’objectiver un espace éditorial dans lequel on est soi-même engagé peut être problématique. J’en prends le risque, néanmoins, car j’ai essayé de neutraliser les possibles effets d’oubli ou d’aveuglement, en m’appuyant sur ma connaissance des différents contextes institutionnels et des référents théoriques, qui ont présidé à leur publication.
2. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique?
Pour mesurer les modalités diverses de transposition des théories du récit, il importe de commencer par retracer brièvement le contexte dans lequel est née la revue. Elle est créée en 1974 par trois enseignants du secondaire, Jean-François Halté dont je salue la mémoire par amitié et pour le rôle qu’il a joué dans la revue Pratiques, Raymond Michel et moi-même. Quelques éléments d’explication à propos de la genèse de cette décision me semblent nécessaires. En 1971, nous venons de passer les concours, Capes et Agrégation, et suivons l’année de CPR (Centre Pédagogique Régional), année de stage obligatoire avant d’être titularisés après une inspection et affectés dans des collèges. En parallèle à notre formation académique, nous dévorons les ouvrages de linguistique (Saussure, Benveniste, Hjemslev, Jakobson, Greimas…) dont nous n’avons jamais entendu le nom au cours de nos études. Il est difficile d’imaginer dans quel état de déréliction théorique peut se trouver, à cette époque, un étudiant de Lettres dans un collège littéraire universitaire de province, et il faut avoir conscience de la situation de l’université. La linguistique, dans quelques facultés, est en débat parmi les grammairiens et les linguistes, débats souvent organisés par de jeunes assistants (Chevalier, Arrivé…), qui viennent d’être recrutés après un enseignement en lycée. En littérature, la Sorbonne, bastion du conservatisme, sous la houlette de Picard ou Deloffre, est en conflit ouvert avec l’École Pratique des Hautes Études où Barthes, Genette, Greimas élaborent les premières notions de narratologie. Quant à la formation pédagogique, point encore d’INSPÉ (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), mais des cours assurés par des enseignants en poste, nos «conseillers pédagogiques», et un mercredi par mois, nous sommes réunis par l’Inspection. Les recherches en didactique (on parle alors de «pédagogie du français») ont lieu à l’INRP (Institut National de Recherche Pédagogique), créé en 1970. Elles concernent le premier degré et sont quasiment inexistantes pour l’enseignement secondaire. C’est dans ce contexte que tous les trois nous assurons notre auto-formation à la nouvelle critique tout en lisant avec intérêt les premiers numéros de Langue Française (1969), Poétique (1970), Littérature (1971). Nous faisons le constat qu’en dehors du Français Aujourd’hui (1967), il n’existe pas de revue qui fasse le lien entre nos lectures théoriques et notre pratique de jeune enseignant. Ce qui, à nos yeux, différencie Pratiques de ces autres supports éditoriaux tient au fait que nous ne sommes ni universitaires ni pris en charge par un éditeur. En effet, nous préférons la liberté de l’auto-gestion, au sein d’une association que nous créons: le CRESEF (Collectif de Recherche sur l’Enseignement du Français). Mais cette différence tient surtout au fait que dans le contexte de mai 68, nous avons une culture marxisante et un engagement syndical et politique en fonction desquels nous faisons la critique du système scolaire et de l’enseignement du français, en lien avec les analyses de Bourdieu et Passeron (1971). Nous sommes convaincus, les éditoriaux des premiers numéros de Pratiques en témoignent, qu’en érigeant l’enseignement des Lettres sur des bases scientifiques, en lieu et place du «bavardage esthético-psychologico-moral» dominant, on réduirait en conséquence sa fonction idéologique de détermination et de reproduction sociale. En ce sens, l’émergence de Pratiques est révélatrice d’une double crise de la discipline qui porte atteinte à sa configuration. Elle est pour une part interne, au sens où elle correspond à l’obsolescence théorique, tant de la matrice grammaticale traditionnelle que de celle des savoirs littéraires, par rapport aux savoirs dits «savants» émergents, dont témoignent les livres et les revues de linguistique, outre les revues citées précédemment. Pour une autre part, elle est externe, au sens où les contenus et les méthodes ne sont plus en adéquation avec l’hétérogénéité progressive du public scolarisé et par rapport à la demande sociale d’instruction et d’éducation. C’est à l’aune de cette double crise que se mesure le rôle de notre discipline dans la production de l’échec scolaire. La volonté d’œuvrer à la remédiation de cette situation sera à l’origine d’une tension entre engagement militant et exigence scientifique pour longtemps assez caractéristique de Pratiques, comme le soulignent Daunay et Reuter (n°137/138).
En effet, étant à l’époque plutôt ignorants des théories de l’apprentissage et de l’enseignement, nous mettons l’accent sur les contenus à enseigner. C’est ainsi que nous diffusons pour l’essentiel les théories structurales. A titre d’exemple, dans le numéro 1/2 de Pratiques, sous la plume d’Halté, Michel et Petitjean (1974), on trouve une analyse d’un conte de Poe (Le chat noir). Chacun pourra constater qu’il s’agit, avec cette lecture interprétative du conte, d’une application des théories structurales mâtinées de psychanalyse un peu rudimentaire. Dans le numéro suivant (3/4), nous commençons la publication d’une étude au long cours (n°5 et 6) consacrée à Candide qui s’assume comme relevant de la sémiotique narrative à partir des travaux de Greimas. Le confirme un glossaire dans lequel nous précisons nos emprunts (armature du récit, séquence transformationnelle, modèle actantiel, modèle fonctionnel, objets de valeur, etc.). Référence théorique que nous croisons avec les travaux de Hjemslev, 1971 («plan du contenu et plan de l’expression; langage de connotation»), Lotman, 1970 («les principes constructifs du texte»), Barthes, 1970 («les codes culturels et le découpage en lexies»), Greimas, 1973 («Un problème de sémiotique narrative: les objets de valeur»), Genette, 1969 («la fonction de régie du narrateur»), Riffaterre, 1970 («intertextualité aléatoire et obligatoire»). Cela nous permet de mener une étude de la structuration du récit et de ses contenus, tout en rendant compte des jeux allusifs, pastichants et parodiques, auxquels se livre Voltaire. Au cours des années qui suivent, je commence une thèse intitulée «le récit en situation scolaire», sous la houlette de Jean Peytard, qui dirigera une quarantaine de thésards dont Charolles et Adam. Ces derniers vont rejoindre le collectif de rédaction de Pratiques qui s’est étoffé dans l’intervalle, et se réunit régulièrement. On doit à Charolles une analyse sémantique des verbes de communication (n°9) dont on sait la fréquence dans l’introduction des dialogues dans les récits. Quant à Adam, dans le même numéro, à partir du Conte du Graal, il propose un modèle génératif du récit articulant structure profonde et structure de surface. Au cours des réunions du collectif, nous débattons des travaux structuralistes sur le récit des années 60 et 70 en nous posant des questions qui sont à la fois d’ordre épistémologique et méthodologique mais aussi didactique. Nous passons en revue les tentatives de modélisation, inspirées par le modèle de Propp (1970), le schéma actantiel, proposé par Greimas (1966), l’analyse des actions et de leurs interactions, avancée par Bremond (1973), la macro-séquence narrative quinaire théorisée par Larivaille (1974), le modèle à intégration progressive des unités de Barthes (1970), les catégories du récit littéraire par Todorov (1966) ou la distinction histoire/récit/narration de Genette (1972). Il nous apparait que le fait d’avoir recours à une démarche schématisante risque de faire abstraction des implications culturelles et anthropologiques des récits et qu’il faut se garder de traiter les concepts structuralistes comme un ensemble de postulats normatifs. A cet égard, la table ronde intitulée «Théorie et pédagogie du récit» publiée dans le n° 14 de Pratiques, est révélatrice de nos débats internes. Ils portent sur les rapports entre macrostructure et superstructure narrative, niveau linguistique et niveau sémiotique, sur l’opposition entre séquences narratives et composantes descriptives. Au niveau didactique, on s’interroge sur le rôle des théories narratives pour la réception et/ou la production des récits, sur l’obstacle possible des études formelles selon la socio-culture des élèves, sur la place laissée à leurs investissements émotionnels et axiologiques. Pour l’heure, notre travail de réflexion se concrétise par la publication du numéro 11/12 de Pratiques. Il s’ouvre par un entretien avec Greimas et se clôt par un état des lieux de la sémiotique narrative établi par Darrault. On y trouve aussi des articles qui ont recours à la théorie greimassienne du récit au travers d’un roman policier (L’Aiguille Creuse de M. Leblanc) et d’une bande dessinée (Le Devin d’Uderzo et Goscinny). Dans ce même numéro, Maillard confronte la méthode de Propp à l’étude de trois contes populaires, Adam et Goldenstein se livrent à une analyse macro-textuelle de Mateo Falcone de Mérimée, suivie d’une étude des personnages et des enjeux de valeur du récit. Toujours dans ce numéro 11/12, Charolles met en débat la sémiotique narrative avec les grammaires de textes (Van Dijk 1972; Petöfi et Reiser 1973) et milite, par le biais de la notion de cohérence textuelle et discursive, pour une intégration de la Superstructure Narrative dans une Grammaire du Discours. Sur le plan didactique, dans le prolongement de l’article de Goldenstein intitulé «Une grammaire de texte pour la composition française» (n°10), Debyser propose des exercices d’invention de contes et de récits d’aventures à partir du canevas de Propp et des figures du Tarot des Mille et un Contes. Il y reviendra plus tard (n°50), avec des exercices de production de textes à l’aide de «matrices narratives». De façon analogue, Adam et Petitjean commencent par se servir du modèle narratif de Larivaille pour rendre compte de l’organisation d’un conte anonyme (Le Merle Blanc), puis étudient la circulation des valeurs dans le récit. Suite à quoi, articulant lecture et écriture, ils proposent des jeux d’écriture sous la forme de manipulations textuelles (imaginer une transposition spatio-temporelle, d’autre épreuves qualifiantes ou une fin déceptive). Avec le numéro 13 de Pratiques, intitulé «Textes, Linguistique», s’inaugure le déplacement théorique que nous opérons de la sémiotique narrative à la linguistique textuelle. Il a été entamé par l’article d’Adam («Langue et Texte: Imparfait/Passé simple») paru dans le n°10, complété par celui de Simonin-Grumbach (n°13). Il s’agit, à la suite de Weinrich (1973), lui-même discutant l’opposition «récit/discours» de Benveniste, de montrer que le passé simple et l’imparfait possèdent, compte-tenu de leurs traits aspectuels, une valeur narrative différente dont les notions de premier et arrière-plan et de mise en relief rendent compte. Ce faisant, Adam, au-delà de Weinrich, met en évidence le rapport qui unit un phénomène micro-structurel de surface (le changement de temps narratif), à un phénomène macro-structurel (l’organisation narrative). Ce changement de paradigme se poursuit par la tentative d’Adam de clarifier les notions de cohérence/cohésion et par la réflexion de Combettes (1983) consacrée à la progression thématique que l’on doit aux linguistes de l’École de Prague. Il est vrai que les contraintes de la discipline et les directives officielles font que l’on privilégie les récits de fiction. Néanmoins, les articles du numéro 14 apportent la preuve que le récit peut être abordé à partir d’objets discursifs et de socles théoriques différents. C’est ainsi qu’Abastado, pour traiter des récits de magazine tels que Nous deux, emprunte à Genette sa distinction entre récit et histoire et ses catégories d’ordre, de durée, et de voix. Cela lui permet d’analyser les orientations et les effets idéologiques de ce genre de récit. Quant à Maldidier et Robin, à partir du meeting politique de Charléty (mai 1968), elles étudient l’économie narrative du genre «reportage» au travers de quatre quotidiens parisiens: Le Figaro, L’Aurore, Combat et L’Humanité.
Reprenant, elles aussi, la distinction de Genette entre récit et histoire, elles opèrent un découpage des récits entre segments narratifs, descriptifs et de jugements. Selon la dominance et le contenu des segments se repère le fonctionnement idéologique des différents journaux. J’ajoute qu’avec le numéro 17, on s’intéresse au récit oral, soit qu’avec l’article de Bachmann l’attention porte sur la narration orale dans un cadre interlocutif (Labov 1972; Goffman 1974), soit qu’avec Fillol et Mouchon, on confronte les analyses de Weinrich à un corpus oral dans le but de rendre compte des éléments récurrents et organisateurs du récit. J’y reviendrai (Petitjean, n°34) en relatant une expérience menée avec une classe de 6e. Je demande aux élèves volontaires de raconter une histoire qui leur est arrivée pendant les vacances. En écoutant les enregistrements, on constate le peu d’intérêt pour les récits qui ont la forme d’une série routinière d’actions ou script d’actions (Espéret 1981; Fayol 1985). Inversement, est apprécié le savoir-faire narratif de ceux qui savent ouvrir/fermer leur récit et entrelarder les propositions narratives de plages d’orientation et d’évaluations tant internes qu’externes. Les élèves s’en souviendront quand ils auront à produire des récits écrits. Je rappelle que nous étions alors enseignants de collèges mais qu’adoptant une posture de recherche-innovation nous échangions à l’intérieur du collectif nos expériences avant de les transformer en articles. C’est ainsi que dans le numéro 22/23, je publie un travail consacré, avec une classe de 5ème, à un roman de science-fiction, mais qui a la forme d’un récit policier, que Goldenstein rend compte d’un travail réalisé dans une classe de même niveau portant sur Michel Strogoff et que Masseron et Petitjean se focalisent sur l’étude du personnage dans Germinal menée en parallèle avec une classe de 3ème et une seconde technique. Le point commun de ces articles est de montrer combien les théories narratives, à condition d’être transposées, sont efficientes tant au niveau de la lecture que de l’écriture. Pour ne prendre que mon exemple, après avoir observé les croyances et les connaissances des élèves en matière de science-fiction, l’étude du roman se déroule sous la forme de «fiches» portant sur l’énigme, les descriptions, les acteurs du roman, le monde de la fiction, les objets de valeur, la fiction et la narration. Je m’appuie pour ce faire sur Van Dijk (1977) et sa catégorie du «setting» qui subsume les éléments indiquant le temps et le lieu, Todorov (1971) pour les intrigues policières, Hamon (1972) pour la description, Greimas (1973) pour les acteurs, les figures et les objets de valeur, Genette (1969) pour le déroulement du récit. On sait par ailleurs qu’il existe une pluralité des manifestations du récit selon des substances variées, qu’elles soient uniques ou mixtes et que l’on ne raconte pas en bande dessinées comme on le fait au cinéma. C’est pourquoi sont abordés, d’un point de vue sémiologique, la bande dessinée (Picquenot, n°8, Dillies, n°18/19), le récit filmique (Chaumette, n°8, Sublet, n°37), la narration et l’image fixe (Fresnault-Deruelle, Numéro spécial). Colas-Blaise (n°181/182) abordera à nouveau le sujet en empruntant le cadre théorique de la sémiotique greimasienne et post-greimasienne, mais en y intégrant des éléments d’herméneutique et d’anthropologie, pour analyser une image fixe, en l’occurrence des tableaux de Paul Klee. De même, Duvin-Parmentier (n°187/188) fera un bilan des théories sémiotiques utilisées pour l’analyse des images dans les classes du secondaire.
Au fil des années, les articles publiés dans Pratiques, qu’ils aient la forme de synthèses théoriques ou d’activités didactiques, accordent, en écho à la doxa scolaire des années 1970, une attention particulière aux récits de fiction dont les différents genres seront largement représentés : contes (n°11/12, 13, 59), fables (n°34, 91), récits de vie (n°45), nouvelles (n°107/108), romans (n°11/12, 14, 22/23, 55,78), ainsi que des études consacrées à des sous-genres : Schnedecker (n°66) pour le portrait, Amstutz (n°78) et Vernet (n°88) pour les nouvelles policières, Dezutter (n°113/114) pour l’épistolaire. Je précise, cependant, qu’ils portent aussi sur la narration dans les discours sociaux, qu’ils soient publicitaires (Adam, n°8), politiques (Adam n°30), journalistiques dont le «potin» – (Van den Heuvel n°30) ou le fait-divers (Petitjean n°50). Adam et Revaz reviendront sur les genres de la presse écrite dans le n°94 et Laborde-Milaa sur le portrait de presse (n°99). Ce choix répondait à une double exigence. D’une part théorique, au sens où il s’agit de rendre compte de la dimension pragmatique et des enjeux communicationnels de tout récit, d’autre part didactique, dans la mesure où l’introduction des discours non littéraires dans la classe correspond à l’idée d’une «Initiation à une culture accordée à la société de notre temps», aux dires des Instructions Officielles de 1977. Il est vrai qu’au cours des années 80, l’espace réservé aux textes littéraires s’est restreint car ils ont été concurrencés par d’autres discours, qu’ils relèvent du champ de la littérature de jeunesse ou proviennent de ce que l’on appelle les «discours sociaux» (presse, images, publicités). C’est ainsi qu’au grand dam des partisans des «Humanités littéraires», la revue a fortement participé à scolariser, au niveau du premier degré et du collège, les récits relevant de la littérature de jeunesse (n°47, 88) ou les textes labellisés comme étant des «mauvais genres» dont on sait qu’ils font l’objet d’une dévalorisation, tant théorique et pédagogique que culturelle. C’est ainsi que les numéros 50 et 54 accordent un intérêt particulier au roman sentimental (Cadet et Helgorsky), d’anticipation (Duhamel), policier (Reuter, Vinson) et, qu’au hasard d’autres numéros, sont abordés les romans de science-fiction (Janot n°14) ou les récits fantastiques (Ouvrard n°14; Masseron, n°34), voire les récits de rêves (Gollut, n°59). Ce qui ne signifie pas que l’on ait renoncé à l’étude des textes patrimoniaux : Chrétien de Troyes (n°9), Rabelais (n°5), Voltaire (n°59), Hugo (n°151/152), Balzac (n°3/4), Zola (n°22/23), etc.
3. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune ? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort?
Les savoirs mobilisés sont à la croisée de la narratologie linguistique et de la linguistique textuelle (Adam et Lundquist (n° 169/170) en feront le bilan en 2015). Nous multiplions les analyses des formes d’organisation textuelle et de leurs fonctions telles que le dialogue (n°64 et 65), la description (n°34, 55, 66, 99), le personnage (n°5, 60) ou les scènes romanesques (n°81). Les récits étant des objets langagiers, il est aussi nécessaire d’observer, dans la surface des textes, les phénomènes micro-textuels produisant des effets de cohésion et utiles pour la compréhension comme pour la production des textes narratifs. Les études portent sur les temps verbaux (Combettes et Fresson n°6; Adam, Lugrin, Revaz n°100), la reprise des éléments d’un texte (Combettes n°49), les connecteurs dans les récits écrits (Fayol n°49), la dénomination du personnage en contexte dialogué (Schnedecker n°64), les modes de désignation des personnages (Masseron et Schnedecker n°60), les types de textes et les faits de langue (Combettes n°56). Ils concernent les types ou les genres de textes (n°62, 66, 83) et les relations textuelles (n°42, 67, 107/108). Il serait d’ailleurs intéressant d’examiner en quoi le récit varie, d’un numéro à l’autre, dans sa conceptualisation, en compréhension et en extension, selon qu’il est problématisé en tant que «type de de textes» (n°56) ou genre de textes (n°59). À ce propos, Daunay et Denizot (n°133/134) ont bien montré que le récit est, au niveau des classes du secondaire actuel, une notion fâcheusement équivoque, le même terme étant employé dans des acceptions différentes. D’un côté, il est associé aux typologies textuelles en opposition à l’argumentation et à l’explication. De l’autre, il est présenté comme une catégorie générique et s’oppose alors à théâtre et à poésie et se décline en sous-genres (récit policier, fantastique, autobiographique, etc.). Une clarification conceptuelle devrait être menée, équivalente à la réflexion sur les rapports entre contexte, texte, textualité et textualisation (n°129/130).
4. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
Il est indéniable que ces travaux ont fini par provoquer une reconfiguration progressive de la discipline. Mais pour savoir s’ils ont marqué un progrès, il faut prendre acte des écarts existants entre les élaborations didactiques proposées dans nombre d’articles de Pratiques et ce qu’elles sont devenues quand elles ont été transposées, en particulier sous la forme de l’exercice baptisé la «lecture méthodique». Il a été modélisé par les textes officiels (BO de 1987 et 1988) et certains ouvrages de la collection B. Lacoste (Descotes 1989; Weiland et Puygrenier-Renault 1997), avant d’être généralisé par les manuels. Pratiques en dénoncera très tôt les méfaits didactiques (Michel, n°97-98 et 101/102) avant que la critique ne soit relayée par les didacticiens de la littérature (Langlade 2001; Rouxel et Langlade 2004) au nom d’une prise en compte «de la dimension subjective de la lecture» et «des réalisations effectives des sujets lecteurs». Les partisans de la lecture méthodique ne manquent pas d’affirmer, comme le fait Descottes (1990), que l’acte de lire est «une activité de construction du sens mettant en jeu les opérations d’anticipation, d’élaboration d’hypothèses de sens» et qu’il faut partir des «représentations» des élèves, pour ensuite les confronter aux textes avec la médiation des savoirs procurés par l’enseignant. En fait, si on en juge par nombre d’ouvrages édités par les CRDP (Centre régional de documentation pédagogique), les séquences sont formelles et la compréhension du texte est réduite à la maîtrise de connaissances linguistiques et sémiotiques. Aucun fatalisme en la matière, car utilisées à bon escient, les études narratologiques ont prouvé leur validité et leur rendement analytique, à condition de se poser la question du degré de leur formalisation. En effet, il n’est pas le même selon que l’on s’adresse aux enseignants ou aux élèves, eux-mêmes à différencier selon leur âge et leur socio-culture. Avec le recul, on peut donc se demander si la «dérive techniciste» dont il est question tient nécessairement aux théories ou à l’insuffisante maîtrise des connaissances narratologiques et linguistiques des auteurs de manuels (Coirault et David 2011) et de nombre d’enseignants, compte tenu de leur formation académique initiale. C’est ainsi que la poétique et la narratologie françaises et anglo-saxonnes ont été réduites au schéma narratif ou à des problèmes de focalisation. Les grammaires de textes (Petöfi 1972; Ihwe 1972) ont engendré des typologies textuelles abstraites. Les travaux sur la cohésion et la cohérence textuelle (Bellert 1970, Halliday et Hasan 1976) ont fini sous la forme de relevés de connecteurs ou de marqueurs textuels (Pour un bilan, cf. Achard-Bayle 2010). Certes, il ne faut pas sous-estimer la part de responsabilité des Instructions Officielles de 2000 distinguant pour les «activités grammaticales», la «grammaire de texte», la «grammaire du discours» opposées à la «grammaire de phrase». Adam (2010) reconnaît que la première «est plus un obstacle méthodologique qu’un outil heuristique» et Maingueneau (1999) considère qu’il y a «bien des inconvénients à employer grammaire pour des phénomènes textuels et énonciatifs». Censés apporter un intérêt didactique pour la production de texte, les phénomènes énonciatifs et transphrastiques (type d’attitudes élocutives, opposition des plans de texte, progression thématique, chaîne de référence…), dont nombre de numéros de Pratiques ont rendu compte, sont devenus inintelligibles quand ils ont servi à élaborer des grilles d’analyse des textes. On trouvera dans Nonnon (n°97/98) une mise en garde par rapport aux modes de transposition des théories du texte en formation des enseignants (changement du statut épistémique des théories de référence, formes de simplification des savoirs scolaires élaborés, modes d’appropriation par les élèves des savoirs enseignés). J’ajouterai que nous partageons d’autant plus ce point de vue que, dans Pratiques, nous ne nous sommes pas limités aux contenus à enseigner, en l’occurrence aux théories du récit, mais avons pris en compte la culture des enseignés et réfléchi aux démarches d’enseignement, en lien avec l’apprentissage de la lecture comme de l’écriture.
Pour la lecture, comme je l’ai montré (Petitjean n°161/162), nous avons progressivement mesuré les conséquences de l’immanentisme textuel et avons pris en considération tant les travaux relevant de la sociologie de la lecture (n°80) que les théories de la réception (de l’«horizon d’attente» à la théorie des «communautés interprétatives» et aux approches herméneutiques) afin de prendre en compte la «perspective du lecteur» (n°95, 151/152). Ce qui implique de prolonger au collège, l’équivalent du coin lecture et de la bibliothèque de classe du primaire et de promouvoir le développement au sein de la classe de sociabilités autour du livre. A titre d’exemple, je citerai l’article de Duhamel (n°80), qui met en place des dispositifs d’échanges de livres et de lectures, monte des entretiens au cours desquels les élèves prennent conscience de ce qu’implique une lecture autonome. Je renvoie aussi aux activités proposées par Vinson et Lelièvre-Portalier (n°80) sur les médiations culturelles (familiarisation avec les lieux du livre et avec la culture du livre à l’aide du dispositif qu’elles appellent «la bouquinerie»). Depuis cette époque se sont généralisées les pratiques des carnets de lecture et des journaux de lecture dans lesquels les élèves notent le retentissement en eux de leurs lectures (impressions et réactions), qu’elles soient affectives, morales ou esthétiques. Ils y consignent aussi les livres lus pendant et en dehors du temps scolaire, ce qui leur permet de prendre conscience de leur passé de lecteur et de constituer une mémoire de leurs découvertes littéraires. On a aussi recours à des cercles de lecture sous la forme de forums scolaires de lecture (Moinard n°181/182 et 187/188), au cours desquels les élèves échangent leurs interprétations personnelles. Il apparaît que tout lecteur ordinaire, aussi «faible lecteur» soit-il, est nécessairement capable d’une «interprétation sémantique» (Eco 1985), car, dès l’instant où «le lecteur impliqué prend corps dans le lecteur réel» (Ricœur 1985), s’opère un acte de reconfiguration qui dépend à la fois de la compétence linguistique de ce dernier mais aussi de l’univers encyclopédique et culturel de son expérience (codes socio-culturels) et de son degré de familiarité avec les conventions esthétiques et le contrat générique du texte (codes littéraires). C’est pourquoi il est important, en situation scolaire, de diversifier les activités. Les unes reposent sur des moments d’immersion dans le monde du texte, au fil d’une lecture «courante» et «investie». Les autres sont liées à une méta-lecture impliquant des moments de réflexion, de mémoration, d’associations, de comparaisons, d’autant plus nécessaires que les récits contiennent des espaces vides que le lecteur se doit de combler (Eco 1979/1985, 1991). On rejoint ici cette «dialectique» entre des activités «relevant de la participation» et d’autres «privilégiant la distanciation» (Dufays 2005). Réflexion qui rejoint celle qu’opèrent V. Jouve (1993) entre « lecture naïve » et « lecture avertie » ou R. Rorty (1992) entre «lecture inspirée» et «lecture méthodique». En fonction de quoi il me semble judicieux, à l’encontre de la valorisation excessive du «sujet lecteur» (Langlade 2004) de rappeler, comme le fait Todorov (2007) que «le sens de l’œuvre ne se réduit pas au jugement purement subjectif de l’élève, mais relève d’un travail de connaissance». Il est assez étonnant de constater à quel point les recherches en didactique de la «lecture littéraire» font l’impasse sur les théories cognitives et psycho-linguistiques de la lecture qui se sont développées dans les années 1980 (Smith 1975; Kintsch, T. A. Van Dijk 1975; Espéret, 1981; Denhière, Legros 1983; Denhière 1984) et le numéro 35 de Pratiques) et ont continué depuis (Fayol et al. 1992; Coirier, Gaonac’h, Passerault 1996; Golder, Gaonac’h 1998. etc.). On se reportera aussi, pour un état de l’art des théories du «traitement cognitif du récit», à Schaeffer (2010) et l’on sait que plus l’œuvre est complexe, plus il est difficile d’assurer cette dialectique entre «type de compréhension» et «mode de progression» dont parle Gervais (1992). Ce qui signifie, sans ignorer ces problèmes, qu’il importe de multiplier les exercices qui développent les capacités inférentielles et interprétatives des élèves et de leur montrer que la validité de l’interprétation d’un récit se mesure aux types et aux nombres d’aspects du texte dont elle est capable de rendre compte en fonction des seules contraintes déterminées par le texte, ou en tenant compte de données contextuelles (y compris biographiques), paratextuelles, intertextuelles… A titre d’exemple, on se reportera aux analyses de type ethno-critique que l’on trouve dans différents numéros (n°76, 151/152) ou au protocole que propose Reuter (n°76). Il consiste à faire réfléchir les élèves aux informants et indices textuels sur lesquels ils s’appuient pour justifier leurs lectures («réaliste-psychologique» ou «policière») d’une nouvelle de Pascal Mérigeau.
Quant à l’écriture, il importe de donner aux élèves la possibilité de «faire» de la littérature et pas uniquement de la commenter (Schaeffer 2011). Sans confondre illusoirement ou avec démagogie «pratiques» des élèves et «métier» de l’écrivain, il s’agit de rendre leur écriture productive. Écrire avec, dans, ou contre un texte littéraire, multiplier les ravaudages scripturaux, imiter, emprunter, transposer, bref entrer dans «une coopération scripturale» concerne tout autant la lecture que l’écriture et augmente l’expertise littéraire des élèves en les incitant à se poser des questions tant cognitives, éthiques, linguistiques, narratives qu’esthétiques. Cela passe par une articulation entre lecture et écriture (n°86), que ce soit sous la forme d’aides à l’écriture narrative (n°78), d’activités d’écriture dites «longues» ou «en projet» (n°27, 36, 41, 66, 83), d’écriture «créatives» (n°89), de «jeux d'écriture» (n°26, 27) ainsi que de la pratique de la «réécriture» (n°20, 105-106). Cela passe encore par les «ateliers d’écriture» (n°26, 61, 89, 127/128, 155/156). Il serait fastidieux d’énumérer les numéros de Pratiques qui portent sur l’écriture de récits selon les genres fictionnels (n°83). À cette fin, les savoirs, qu’ils soient narratologiques ou linguistiques, sont mis à la disposition des élèves et des enseignants mais selon des logiques différentes. Tel est l’enjeu de leur transposition comme j’ai pu le montrer (Petitjean, n°97/98). Ils aident les premiers à planifier leurs écrits et à favoriser le contrôle de leur production en développant leur conscience métacognitive et ils permettent aux seconds de programmer leur enseignement, de préciser leurs consignes d’écriture et leur servent de critères d’évaluation des écrits produits. Ce renouvellement des enseignables s’est accompagné d’une réflexion portant sur les démarches d’enseignement. En témoigne l’intérêt de la notion de «séquence didactique» sous la forme d’une suite d’activités progressives, planifiées et finalisées par un objectif général d’enseignement/apprentissage et diversifiant les tâches et les supports (Masseron et Perrin, n°92).
5. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
Les années passant, la totalité des membres du collectif, devenu «comité de rédaction», a intégré l’université. C’est ainsi qu’accédant en 1984 au statut de Professeur, j’ai été amené à diriger le CELTED (Centre d’Études Linguistiques des Textes et des Discours) de l’Université de Metz et à prendre la direction de collections («Didactique des Textes», «Recherches Linguistiques», «Recherches Textuelles») dans lesquelles certains livres sont plus ou moins directement liés au récit et à son enseignement : Combettes (L’organisation du texte, 1992), Glaudes et Reuter (Personnage et didactique du récit, 1996), Rabatel (Une histoire du point de vue, 1997), Revaz (Les Textes d’Action, 1997), Schnedecker (Nom propre et chaînes de référence, 1997), Leclaire-Halté (Robinsonnades et valeurs en littérature de jeunesse contemporaine, 2004), Perrin (Le sens et ses voix, Dialogisme et polyphonie dans la langue et les discours, 2006), Verselle (Faire dire, pour décrire, 2012). Ce changement de statut a eu pour conséquence que chacun s’est spécialisé dans un domaine, parfois au détriment d’une réflexion commune, induisant, de fait, des modifications de la ligne éditoriale de la revue. Est significatif, à cet égard, le remplacement du sous-titre originel («Théorie / Pratique / Pédagogie») par un nouveau triptyque («Linguistique / Littérature / Didactique») référant à des champs théoriques différents. En linguistique, nous avons participé, dans le cadre des recherches textuelles puis énonciatives et discursives, à la théorisation de notions capitales telles que «auteur» et «ethos» (n°113/114), «valeurs» (n°117/118), «genre» (n°62, 157/158), «style» (n°135/136), «registre» (n°109/110), «contexte» (n°129/130) ou «polyphonie» (n°123/124). Si j’en juge par les revues relevant de la narratologie (Poetics Today, Vox poetica, Cahiers de narratologie), assez rares sont les études des modes de verbalisation des intrigues, à la différence de Baroni (2017). On peut d’autant regretter l’insuffisante articulation avec les Sciences du langage qu’elles sont un adjuvant incontournable pour l’analyse des récits. Je pense au travail monumental de Rabatel (2008) sur le point de vue, aux études linguistiques qui s’intéressent à la manière dont les émotions sont rendues manifestes dans les textes (Kerbrat-Orecchioni, 2000), au rôle des organisations modales dans la production d’effets affectifs (Fontanille, 1999) ou à la réflexion de Rabatel (n°181/182) sur la notion de mobilité empathique. On peut, à ce propos, les compléter par les recherches cognitives qui analysent les modalités de l’immersion émotive en lien avec la compréhension des états mentaux et des comportements des personnages (Pelletier, 2010) ou des épisodes du récit (Dijkastra et al., 1994). En littérature, selon les domaines de prédilection de chacun d’entre nous, le récit connaît des approches différentes. Avec le numéro 151/152, intitulé «Anthropologie de la littérature», on se penche sur les phénomènes de mises en récit de pratiques culturelles. Aranda associant anthropologie et narratologie rend compte des héros de récits populaires merveilleux; Löcherbach montre que les travaux d’Elias permettent de comprendre en quoi les personnages de La Princesse de Clèves révèlent les rapports du récit avec la logique civilisatrice, Cnockaert, à propos de la nouvelle de Maupassant intitulé Saint-Antoine, montre qu’au travers de l’épisode du gavage de cochon s’établit une homologie structurale entre la logique anthropologique du rite et la logique narrative du récit. Dans une partie du numéro 181/182 («Le récit en questions»), il s’est agi de rendre compte du statut du récit dans les productions actuelles, qu’elles aient la forme de romans, de pièces de théâtre ou de «narrations documentaires». C’est ainsi que Lawson étudie la place qu’occupent les animaux dans nombre de fictions romanesques contemporaines, la nouveauté étant qu’ils sont considérés dans leur individualité animale. Le fait d’adopter un point de vue zoocentré nécessite l’utilisation de procédés (forme de la liste ou tableau descriptif) et de techniques narratives (point de vue, instance narratrice, monologues intérieurs) au service d’une intention à la fois éthique et esthétique des auteurs. Petitjean s’arrête sur les pièces monologuées contemporaines et montre en quoi elles ont la forme de récits fragmentés et polyphoniques. Leur intérêt est de faire advenir de nombreux personnages et c’est là un indice du processus de romanisation que connait le théâtre depuis plusieurs années. Lacoste s’intéresse à ce que d’aucuns appellent la «non-fiction», dénomination qui recouvre, au-delà de la diversité des œuvres et des auteurs, des textes qui partagent une même intention documentaire. Il s’ensuit que ces œuvres, qui privilégient la description, le fragment et la liste, prennent leur distance avec la fiction, au sens où elles remettent en question les vertus configuratrices que l’on prête ordinairement à la «mise en intrigue». Concernant la didactique, on constate un reflux des articles praxéologiques au profit de recherches à caractère historique et épistémologique. C’est ainsi que Daunay et Denizot (n°133/134), à partir des Textes Officiels et des manuels, retracent les modifications historiques qu’a connues le récit en tant qu’objet scolaire et, plus particulièrement, selon qu’il est travaillé dans le cadre de l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture. De même, le n°109/110 est consacré à l’histoire de la description scolaire au secondaire, des manuels de rhétorique aux manuels de textes contemporains, en passant par les manuels de littérature du XIXe siècle. Notre attention s’est aussi déportée sur la place, la forme et les fonctions du récit dans d’autres disciplines scolaires que le français, que ce soient dans les enseignements scientifiques (Cohen-Azia, n°133/134), dans les classes de mathématiques (Lahanier-Reuter, n°133/134) ou en didactique de l’histoire (Delaplace, n°133/134). Pour cette dernière, alors qu’Audigier et Ronveaux (n° 133/134) s’interrogent sur le récit comme forme textuelle dans l’écriture des historiens par rapport à la fois aux récits fictionnels et à l’histoire scolaire, de leur côté, Revaz et Béguin (n°100) étudient l’usage des temps verbaux respectivement dans le discours des historiens et dans les manuels d’histoire. Au niveau des élèves, Laparra (n°69) avait déjà analysé des problèmes de lecture que posent la lecture des manuels d’histoire, quand René, dans le même numéro, montrait qu’écrire en histoire nécessite un apprentissage rédactionnel qui porte autant sur les contenus de savoirs historiques que sur la planification et la mise en texte tant global que local du devoir d’histoire.
Il est vrai qu’à partir des années 2000 la place accordée dans Pratiques aux théories du récit s’est amenuisée et que l’on a pris de la distance par rapport à l’héritage structuraliste. Celui-ci connaît une certaine défaveur, d’autant plus grande que l’on assiste au retrait des figures tutélaires de la narratologie – Todorov (1989,1991) s’est tourné vers l’éthique et Genette (1994, 1997) vers l’esthétique – quand ce n’est pas vers la régression polémique pour certains. Je pense à la charge critique de Bremond et Pavel (1999) contre le S/Z de Barthes, qui n’a rien à envier à l’ancien pamphlet de Picard. Plus généralement, on peut dire que la théorie littéraire, comme le diagnostique Viala (2000), est entrée dans les usages universitaires et se diffuse par le biais de recueils de textes théoriques (voir, par exemple, les ouvrages publiés dans la collection «Corpus» de Flammarion et dont les titres sont évocateurs: Le genre littéraire, La fiction, L’intertextualité, Le roman, Le personnage, etc.). Plus encore, comme on l’a vu, elle a été transposée dans le champ scolaire, à l’encontre de Compagnon (1998) qui n’y voit «qu’une petite technique pédagogique souvent aussi desséchante que l’explication de texte à laquelle elle s’en prenait alors avec verve.» Finis les débats, voire les polémiques, du passé. On a l’impression que la boîte à outils fonctionne, au travers des études d’un genre, d’une forme, d’un procédé ou d’une œuvre. Pour qu’advienne un renouvellement majeur des théories du récit, il faudra attendre les travaux de Baroni (2007, 2009) ou Patron (2009, 2018 et n°181/182) ainsi que ceux de Lavocat (2010, 2016) en phase avec les recherches de langue anglaise (théories des mondes possibles, narratologie cognitive, narratologie non naturelles…). Il était donc nécessaire de nous pencher à nouveau sur les outils de la narratologie. Cela d’autant plus que concernant la place du récit dans nos sociétés contemporaines, on peut interroger l’inflation d’une notion comme celle de «storytelling» et observer que la fiction est aussi en expansion, qu’elle prenne des formes aussi différentes que les romans, les films, les séries ou les écrits numériques liés la cyber-littérature. Comme nous avons rejoint le CREM (Centre de recherche sur les médiations) de l’Université de Lorraine, nous participons à son programme de recherche «Narrations de la société/sociétés de la narration» consacré au récit et à la narration sociale. Pour prendre la mesure de l’état de la narratologie dans les débats actuels des sciences humaines en France et au-delà de l’hexagone, on peut se référer au tableau que dresse Baroni (2016) dans la 30e livraison de Questions de communication et des réponses qui s’ensuivent dans le no31 de la même revue (Baetens, Fleury et Walter, Jost, Rabatel, Saurier et Vallée, Schmitt). Pour Pratiques dans ce programme du CREM, l’enjeu est de faire interagir des recherches qui mettent l’accent sur la description et la classification avec d’autres plus spéculatives et interprétatives. C’est ainsi qu’avec le n°181/182, intitulé «Le récit en questions», nous avons confronté certains paradigmes du récit, privilégiant la linguistique textuelle et discursive (Adam et Rabatel), la sémiotique narrative (Bertrand et Colas-Blaise), l’ethnocritique (Privat), la perspective cognitiviste (Fragonara). Une attention particulière a été réservée à la narratologie non naturelle (Patron et Richardson) ou polylogale (Revaz), dont l’existence nécessite l’invention de nouvelles méthodes et un outillage narratologique adapté pour en rendre compte. Il en va de même pour la narration sérielle (Boni et Martinez) et pour les récits interactifs (Compagno). Suite à quoi, nous avons lancé le numéro 197/198 de Pratiques, intitulé «Raconter (une) des histoires. Les mots de la narration». Il comporte trois volets : linguistique (cartographie des synonymes et des hyponymes de récit, étymologie et construction des deux formes «raconter»et «récit»), narratologique et discursif (comment segmenter, nommer et analyser les séquences narratives), didactique (quelle place pour le récit dans les pratiques enseignantes du premier et du second degré). À plus long terme, à propos de la fiction, nous avons en projet un numéro de Pratiques (2024) intitulé provisoirement «Territoires scolaires de la fiction de l’école à l’université». On y examinera, d’un point de vue théorique et historique, les conceptions divergentes de la fiction, tant en compréhension que dans ses domaines d’application, qu’elles soient philosophiques, psychanalytiques, anthropologiques, narratologiques, sémiotiques, cognitives, linguistiques, textuelles, stylistiques, pragmatiques, énonciatives (Schaeffer 1999; Vuillaume 1990; Kroll 2017; Hamburger 1977; Goodman 1985; Pavel 1988; Cohn 2001; Searle 1975/1982; Genette 1991; Philippe, Atlani-Voisin 2000; Schaeffer 2009; Bikialo 2014; Pelletier 2017). Sur le plan didactique, on cherchera, en fonction de ces théories, à élaborer une modélisation du sujet lecteur. Ce qui nécessitera, aussi, une enquête sociologique sur les usages non scolaires des œuvres de fiction et les représentations des élèves concernant l’intérêt qu’ils leur portent. A ce propos, on examinera ce qu’apporte l’explication de l’adhésion aux formes narratives selon qu’elle est conceptualisée en termes de ressorts pathétiques liés à différentes modalités de la tension narrative (Baroni 2007) ou d’«intérêt» narratif, herméneutique ou esthétique (Jouve 2019 ). On reviendra sur la question des modalités de l’immersion fictionnelle (notions d’identification et d’empathie, d’émotion réelle et d’émotion fictive), de la démarcation et/ou de l’hybridation entre fiction et non-fiction (marqueurs de fictionnalité, modes de référence…). Le numéro montrera surtout l'enjeu didactique des fictions, selon les apprentissages, puisqu’elles réfèrent indéniablement à nos « principaux soucis sociaux ou existentiels » (Pavel 1998; Jouve 2010) et ont des fonctions importantes, tant sur le plan cognitif (Schaeffer 1999) qu’affectif (Citton 2007). Il sera aussi intéressant d’analyser ce qui différencie les conduites d’immersion fictionnelle des conduites esthétiques (Schaeffer 1996, 2000) ou des expériences esthétiques (Dewey 1934/1997; Goodman 1996). Dit autrement, comment mesurer la différence entre jugement de fictionnalité et appréciation d’articité ou émotions de fiction et émotions eshétiques. Ce qui me semble utile à plus d’un titre : sortir du flou de la notion de «lecture littéraire», réfléchir au corpus des œuvres estimées légitimes, entretenir un vrai dialogue avec les disciplines artistiques.
Bibliographie
Pour les raisons signalées dans la note (1), je réserve la bibliographie aux références externes aux numéros de Pratiques.
Achard-Bayle, Guy (dir.) (2010), Linguistique textuelle: états de lieux. Actes de la journée CONSCILA du 28 mai 2010 - Introduction, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll. «Verbum».
Adam, Jean-Michel (2010), «L’émergence de la linguistique textuelle en France (1975-2010). Parcours bibliographique en 100 titres», in Linguistique textuelle: états de lieux, G. Achard-Bayle (dir.), Nancy, Presses universitaires de Nancy, p. 237-261.
Atlani-Voisin, Françoise (2000), «Énonciation fictionnelle et constructions référentielles: Réflexions à partir du Bavard de Louis-René Des Forêts», Langue française, n° 128 (1), p. 113-125. URL: https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_2000_num_128_1_1011
Barthes, Roland (1966), « Introduction à l'analyse structurale des récits », Communications, n° 8, p. 1-27. URL: https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1113
Barthes, Roland (1970), S/Z, Paris, Seuil, coll. « Tel quel ».
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative: suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Baroni, Raphaël (2009), L'œuvre du temps: poétique de la discordance narrative, Paris, Seuil, coll. « Poétique ».
Baroni, Raphaël (2016), «L'empire de la narratologie», Questions de communication, n° 30, p. 219-238.
Baroni, Raphaël (2017), «La manifestation verbale de l’intrigue», in Les rouages de l'intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l'analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine, p. 117-137.
Bellert, Irena (1970), «On a Condition of the Coherence of Texts», Semiotica, n° 2 (4), p. 335-363. URL: https://doi.org/10.1515/semi.1970.2.4.335
Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1973), La reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement, Paris, Minuit, coll. «Le sens commun».
Brémond, Claude (1973), Logique du récit, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Brémond, Claude & Thomas Pavel (1999), De Barthes à Balzac: fictions d'un critique, critiques d'une fiction, Paris, Albin Michel.
Citton, Yves (2007), Lire, interpréter, actualiser: pourquoi les études littéraires ?, Paris, Éditions Amsterdam.
Cohn, Dorrit (2001), Le propre de la fiction, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Coirault, Déborah & Jacques David (2011), «Interactions langue-littérature et approches didactiques. Étude de manuels de troisième du collège», Le français aujourd'hui, n° 175 (4), p. 25-34. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2011-4-page-25.htm
Combettes, Bernard (1983), Pour une grammaire textuelle : la progression thématique, Bruxelles-Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot, coll. «Pratiques. Série formation continuée».
Combettes, Bernard (1992), L'organisation du texte, Metz, Université de Metz, coll. «Didactique des textes».
Compagnon, Antoine (1998), Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil.
Denhière, Guy (1984), Il était une fois... Compréhension et souvenir de récits, Lille, Presses universitaires de Lille, coll. «Psychologie cognitive».
Legros, Denis & Guy Denhière (1983), «Comprendre un texte», Revue française de pédagogie, n° 65, p. 19-29. URL: https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1983_num_65_1_1599
Descotes, Michel (1989), La lecture méthodique, Paris-Toulouse, Delagrave CRDP de Toulouse.
Descotes, Michel (1990), «La lecture méthodique: un problème de représentations? », Le Français aujourd’hui, n° 90, p. 48-59.
Dewey, John (1934/1994), Art as experience, Carbondale, Southern Illinois University Press.
Dijkstra, Katinka, Rolf A. Zwaan, Arthur C. Graesser & Joseph P. Magliano (1995), «Character and reader emotions in literary texts», Poetics, n° 23 (1), p. 139-157. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304422X9400009U
Eco, Umberto (1985/1994), Lector in fabula, ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset.
Espéret, Éric (1981), Genèse de la conduite de récit, Laboratoire de Psychologie, ERA CNRS 797, Université de Poitiers.
Fayol, Michel (1994 [1985]), Le récit et sa construction: une approche de la psychologie cognitive, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Fayol, Michel (1992), Psychologie cognitive de la lecture, Paris, Presses universitaires de France.
Fontanille, Jacques (1999), «Passions et émotions» in Sémiotique et littérature. Essais de méthode, Paris, Presses Universitaires de France.
Genette, Gérard (1969), «Frontières du récit», in Figures II, Paris, Seuil, p. 49-68.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1991), Fiction et diction, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1994), L’œuvre de l’art. Immanence et transcendance, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1997), L’œuvre de l’art. La relation esthétique, Paris, Seuil.
Gervais, Bertrand (1992), «Lecture: tensions et régies», Poétique, n° 89, p. 105-125.
Glaudes, Pierre & Reuter Yves (1996), Personnage et didactique du récit, Université de Metz, Publication du Centre d’Études Linguistiques des Textes et des Discours.
Goffman, Erving (1974), Frame analysis. On essays on the organization of experience, New York, Haper and Row.
Golder, Caroline & Daniel Gaonac'h (1998), Lire et comprendre: psychologie de la lecture, Paris, Hachette, coll. «Profession enseignant».
Goodman, Nelson (1985), Faits, fictions et prédictions, Paris, Minuit.
Goodman, Nelson (1996), L'art en théorie et en action, Paris, L’éclat.
Greimas, Algirdas Julien (2002 [1966]), Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, PUF.
Greimas, Algirdas Julien (1973), «Un problème de sémiotique narrative : les objets de valeur», Langages, n° 31, p. 13-35.
Halliday, M. A. K. & Ruqaiya Hasan (1976), Cohesion in English, London, Longman, coll. «English language series 9».
Hamon, Philippe (1972), «Qu’est-ce qu’une description?», Poétique, n° 12, p. 467-485.
Hamburger, Käte (1977), Logique des genres littéraires, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Hjelmslev, Louis (1971), Essais linguistiques, Paris, Minuit.
Ihwe, Jens (1972), «On the foundations of a general theory of narrative structure», Poetics, n° 1 (3), p. 5-14. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304422X72900368
Jouve, Vincent (2010), Pourquoi étudier la littérature, Paris, Armand Colin.
Jouve, Vincent (2019), Pouvoirs de la fiction, Paris, Armand Colin.
Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2000), «Quelle place pour les émotions dans la linguistique du XXe siècle? Remarques et aperçus», in Les émotions dans les interactions, C. Plantin, M. Doury & V. Traverso (dir.), Lyon, Presses universitaires de Lyon, p. 33-74.
Kintsch, Walter & Teun A. Van Dijk (1975), «Comment on se rappelle et on résume des histoires», Langages, n° 40, p. 98-116.
Krol, Marta (2017), Pour un modèle linguistique de la fiction : essai de sémantique intégrée, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. «Philosophie & linguistique».
Labov, William (1972), «La transformation du vécu à travers la syntaxe narrative», chapitre 9 de Language in the inner city, trad. française, Le parler ordinaire, Paris, Minuit, 1978, p.289-355.
Langlade, Gérard (2001), «Et le sujet lecteur dans tout ça? », Enjeux, n° 51/52, p. 53-62.
Larivaille, Paul (1974), «L'analyse (morpho)logique du récit», Poétiques, n° 19.
Lavocat, Françoise (2011), La théorie littéraire des mondes possibles, Paris, CNRS.
Lavocat, Françoise (2016), Fait et fiction: pour une frontière, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Lavocat, Françoise (dir.) (2016), Interprétation littéraire et sciences cognitives, Paris, Hermann.
Leclaire-Halté, Anne (2004), Robinsonnades et valeurs en littérature de jeunesse contemporaine, Publication du Centre d’Études Linguistiques des Textes et des Discours, Université de Metz.
Lotman, Iouri (1973), La structure du texte artistique, Paris, Gallimard.
Maingueneau, Dominique (1999), «Réflexions sur la « grammaire de discours » au collège», Le Français aujourd’hui, n° 128, 20-28.
Michel, Raymond. (2005), «Expérience de lecture et expérience esthétique : du plaisir et de l’émotion», in L’expérience de lecture, V. Jouve (dir.), Paris, L’improviste, p. 425-468.
Patron, Sylvie (2009), Le narrateur. Introduction à la théorie narrative, Paris, Armand Colin, coll. «U».
Patron, Sylvie (2018), Introduction à la narratologie postclassique : les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. «Perspectives. Arts et littératures».
Pavel, Thomas (1988), L’Univers de la fiction, Paris, Seuil.
Pelletier, Jérôme (2011), «Du récit à la fiction: un point de vue de philosophie cognitive», in Théorie, analyse, interprétation des récits, S. Patron (dir.), Bern, Peter Lang, p. 215-246.
Pelletier, Jérôme (2016), «Quand l'émotion rencontre la fiction», in Interprétation littéraire et sciences cognitives, F. Lavocat (dir.), Paris, Hermann, p. 123-155.
Perrin, Laurent (2006), Le sens et ses voix: dialogisme et polyphonie en langue et en discours, Metz, coll. «Recherches linguistiques».
Petöfi, János S. (1972), «The syntactico-semantic organization of text-structures», Poetics, n° 1 (3), p. 56-99. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304422X72900393
Petöfi, János S. & Hannes Rieser (1973), Studies in text grammar, Dordrecht, D. Reidel, coll. «Foundations of language».
Philippe, Gilles (2000), «Les divergences énonciatives dans les récits de fiction», Langue française, n° 128, p. 30-51.
Propp, Vladimir (1970), Morphologie du conte, Paris, Seuil, coll. «Points».
Rabatel, Alain (1997), Une histoire du point de vue, Metz, Université de Metz, coll. «Recherches textuelles».
Rabatel, Alain (2008), Homo narrans: pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, Limoges, Lambert-Lucas.
Revaz, Françoise (1997), Les textes d'action, Metz, Université de Metz, coll. «Recherches textuelles».
Ricoeur, Paul (1985), «Mimésis III» in Temps et récit, Paris, Seuil, Tome 1, 109-129.
Riffaterre, Michel (1970), Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (dir.) (2004), Le Sujet lecteur. Lectures subjectives et enseignement de la littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction, Paris, Seuil.
Schaeffer, Jean-Marie (1996), Les Célibataires de l’art. Pour une esthétique sans mythes, Paris, Gallimard.
Schaeffer, Jean-Marie (2000), Adieu à l’esthétique, collège international de philosophie, Paris, PUF.
Schaeffer, Jean-Marie (2009), «Le récit entre fait et fiction: perspectives cognitives» in Devant la fiction, dans le monde, C. Grall et M. Macé (dir.), Schaeffer, Jean-Marie (2000), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 15-32.
Schaeffer, Jean-Marie (2010), «Le traitement cognitif de la narration», in J. Pier, F. Berthelot (dir.), Narratologies contemporaines : Approches nouvelles pour la théorie et l'analyse de récit, Paris, Archives contemporaines 2010, p. 215-231.
Schaeffer, Jean-Marie (2011), Petite écologie des études littéraires, Vincennes, Éditions Thierry Marchaisse.
Searle, John (1975/1982), «Le statut logique du discours de la fiction», in Sens et Expression, Paris, Minuit, p.101-119.
Smith, Franck (1980), Comment les enfants apprennent lire, Paris, Retz.
Todorov, Tzvetan (1989), Nous et les autres, Paris, Seuil.
Todorov, Tzvetan (1991), Les morales de l’histoire, Paris, Hachette.
Todorov, Tzvetan (1971), «Typologie du roman policier» in Poétique de la prose, Paris, Seuil, p. 57-68.
Van Dijk, T.A. (1972), Some aspects of text grammars, Mouton, La Haye.
Van Dijk, T.A. (1972), «Modèles génératifs en théorie littéraire» in Essais de théorie du texte, C. Bouazis et alii (dir.), Paris, Galilée, p.81-99.
Van Dijk, T.A. (1977), Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse, Longman Linguistics Library.
Verselle, Vincent (2012), Faire dire, pour décrire: caractérisation langagière des personnages et poétique du récit dans la littérature comique et satirique (XVIIe et XVIIIe siècle), Metz, Université de Lorraine, coll. «Recherches textuelles».
Viala, Alain (2000), «Théories littéraires, théorie du texte et histoire», Textuel, n° 37, Paris 7-Denis Diderot, p. 201-223.
Vuillaume, Marcel (1990), Grammaire temporelle des récits, Paris, Minuit.
Weinland, Katherine & Puygrenier-Renault, Janine (1997), L’enseignement du français au collège, Paris, Bertrand-Lacoste.
Weinrich, Harald (1973), Le temps: le récit et le commentaire, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Pour citer l'article
André Petitjean, "Témoignage de André Petitjean", Transpositio, La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-andre-petitjean
Voir également :
La narratologie scolaire, objet de descriptions et de critiques
Si l’on prend acte, à la suite de Baroni, de la décadence sur le plan académique de «l’empire de la narratologie» après une période faste dans la deuxième moitié du XXe siècle, et si l’on s’étonne avec lui du « contraste entre l’ampleur du ‘‘tournant narratif’’ et la place relativement dérisoire occupée par la ‘’théorie du récit’’ au sein des institutions académiques » (2016: 226), un fait reste néanmoins avéré : la narratologie figure encore dans les programmes et les plans d’étude, dans les manuels scolaires, dans des articles de recherche en didactique{{Cf. Dufays, Lisse & Meurée (2009), encore récemment Dezutter, Babin & Lépine (2020).}}.
La narratologie scolaire, objet de descriptions et de critiques
Pour Bertrand Daunay1
1. La narratologie scolaire est-elle périmée?
Si l’on prend acte, à la suite de Baroni, de la décadence sur le plan académique de «l’empire de la narratologie» après une période faste dans la deuxième moitié du XXe siècle, et si l’on s’étonne avec lui du « contraste entre l’ampleur du ‘‘tournant narratif’’ et la place relativement dérisoire occupée par la ‘’théorie du récit’’ au sein des institutions académiques » (2016: 226), un fait reste néanmoins avéré : la narratologie figure encore dans les programmes et les plans d’étude, dans les manuels scolaires, dans des articles de recherche en didactique2. L’enquête mise en œuvre par le groupe DiNarr sur les usages déclarés par les enseignant·e·s atteste en effet que la narratologie scolaire reste d’actualité – ce que corroborent d’ailleurs, même si leur objectif premier était différent, d’autres travaux effectués à partir de données recueillies dans des classes (Gabathuler 2014, Franck 2017, Védrines 2017, Ronveaux & Schneuwly 2018). La persistance de la narratologie scolaire représenterait-elle donc un archaïsme, une nouvelle illustration du décalage entre les forces vives du savoir et la sempiternelle lenteur d’une institution rigide inapte à les intégrer? À écouter les critiques formulées à son encontre, qui ne manquent pas, on peut se demander si l’enseignement de la narratologie a encore du sens3.
Nous proposerons pour notre part de considérer que l’élaboration de dispositifs intégrant des concepts narratologiques conserve une pertinence didactique. Au-delà du constat, certes non négligeable, mais qui ne saurait tout justifier, que la narratologie ne cesse de s’enseigner, nous voulons souligner l’importance de sa médiation dans le développement intellectuel des élèves et – ce qui peut paraitre à première vue paradoxal – dans les rapports de ce développement avec leurs émotions. Ce sera l’occasion de revenir sur le double intérêt que quelques didacticiens, dès les années 70-80, avaient pu reconnaitre aux méthodes d’analyse, alors nouvelles, dont faisait partie la narratologie. Ce double intérêt, presque un demi-siècle plus tard, a sans doute été un peu perdu de vue. Pourtant, à notre sens, la narratologie conserve sa puissance critique à l’encontre d’une certaine mystique littéraire reposant sur des notions implicites conniventes de goût, de sensibilité, d’impression, de conception idéaliste de la subjectivité4, autrement dit, à l’encontre de cette «idéologie de la grâce culturelle et de la communion lectorale» dont parle Petitjean (2014: 51). Et la narratologie contribue aussi, par l’action même de la verbalisation des effets du texte, par sa commodité à être évaluée, par son approche méthodique, technique de l’exercice d’explication des textes (pas seulement littéraires d’ailleurs), à l’étayage de l’apprentissage des élèves qui, pour en être les plus éloigné·e·s, ont le plus besoin de comprendre les codes de l’école.
2. Critiques littéraires et didactiques
L’introduction que Compagnon rédige pour son livre Le démon de la théorie (1998) peut nous servir à exemplifier les difficultés que rencontre une certaine critique littéraire lorsqu’elle entreprend de commenter des enjeux scolaires, ou même de parabole, tant les personnages qu’elle met en scène, en particulier celui de l’École, relèvent davantage de la fantaisie allégorique que de la description. Lorsque, fort de sa position académique et de son autorité savante, Compagnon évoque l’école, (au sens où il la fait apparaître comme par magie, avec ses mots et son esprit), il commence par souligner la pauvreté de la théorie littéraire en France avant les années 60 en regard de l’intense productivité internationale: «formalisme russe, […]cercle de Prague, […]New Criticism anglo-américain, […]stylistique de […]Spitzer, […]topologie de […]Curtius, […]antipositivisme de […]Croce […]critique des variantes de […]Contini, […]école de Genève et […] critique de la conscience […]antithéorisme […]de […]Leavis et de ses disciples de Cambridge» (1998: 7). Pour expliquer ce retard, Compagnon mentionne une explication donnée par Spitzer : en seraient autant de causes un sentiment de supériorité français dû à un passé littéraire éminent auquel s’ajoutent le positivisme scientifique et enfin la prédominance de la pratique scolaire de l’explication de texte. Mais Compagnon note que cette interprétation a été rapidement démentie par une évolution que Spitzer ne pouvait pas deviner: «par un très curieux renversement qui peut donner à réfléchir, la théorie française s’est trouvée momentanément portée à l’avant-garde des études littéraires dans le monde» (9) et s’est implantée dans l’enseignement littéraire, bouleversant la méthode de l’explication de texte. L’affirmation de Spitzer s’est donc trouvée contredite par les faits, et son appréciation quant à la cause scolaire s’est avérée, en réalité, peu clairvoyante. Ceci donne effectivement à réfléchir, mais n’empêche pas pour autant Compagnon d’écrire quelques lignes plus loin :
La théorie s’est institutionnalisée, elle s’est transformée en méthode, elle est devenue une petite technique pédagogique souvent aussi desséchante5que l’explication de texte à laquelle elle s’en prenait alors avec verve. La stagnation semble inscrite dans le destin scolaire de toute théorie.
Et il ajoute:
La nouvelle critique […] s’est solidement implantée dans l’Éducation nationale, notamment dans l’enseignement secondaire. C’est même probablement cela qui l’a rendue rigide. Il est impossible de réussir aujourd’hui à un concours sans maîtriser les distinguos subtils et le parler de la narratologie. (10)6.
Ainsi, à quelques lignes d’écart, Compagnon relève-t-il l’erreur de Spitzer avant de reproduire le travers qui s’en trouve à l’origine: son affirmation sur les effets supposés délétères de l’institutionnalisation d’une théorie se passe de toute justification empirique; elle trahit une méconnaissance de la pratique réelle des exercices scolaires et de leurs raisons d’être (le «probablement» mériterait à lui seul un long commentaire). Et d’ailleurs, de quel enseignement secondaire parle-t-on : collège, lycée, lycée technique, professionnel, lycée Henri IV ou lycée fréquenté par des élèves socialement défavorisés? Et qu’en est-il des établissements francophones hors de France, etc.? Relevons également au passage la pétition de principe associant les concours et les pratiques réelles d’enseignement, et qui omet que, jusqu’à preuve du contraire, les concours sont préparés à l’université, de même que les jurys sont composés en majorité d’universitaires et non d’enseignants du secondaire. Finalement, supposer que le futur enseignant appliquerait sans désemparer dans ses classes ce qu’il a appris pour les concours revient ni plus ni moins à ignorer tout à la fois les processus de transposition didactique et les conditions réelles de l’enseignement, et donc, le fait que tout rapport au texte réfracte nécessairement les paramètres sociaux orientant le contexte d’interaction (Vuillet 2018).
Le parti-pris assumé (notamment) par Compagnon se fonde sur une image de l’enseignement secondaire qui répliquerait plus ou moins laborieusement des recherches menées dans les laboratoires, les universités, les grandes écoles, etc. Il est alors facile de déplorer la déperdition en rigueur et en finesse due au transfert de certains concepts de la narratologie depuis les forces vives de la pensée – celle de Genette principalement, dont une partie de l’œuvre théorique a été transposée à partir des années 70 avec une grande constance – vers la classe, où ils ne pourraient que se dévaluer, voire se fossiliser.
Pour résister aux réductions de ce type, les connaissances qui relèvent d’un positionnement didactique standard, et donc en particulier les questions concernant la transposition s’avèrent utiles (Bronckart 2017)7. Une telle perspective demande de se départir d’une conception des savoirs scolaires comme copie plus ou moins fidèle des savoirs dits savants, et en fin de compte dominants8. Rappelons que les impasses applicationnistes de la transposition didactique sont critiquées depuis longtemps par Chevallard (1985) et par Schneuwly (1990, 1995) – le second, plus nettement peut-être que le premier, s’opposant à une vision passive de l’école et insistant au contraire sur sa puissance créatrice dans le traitement des savoirs, quels qu’ils soient, pour les transformer en objets à enseigner et enseignés9. Schneuwly l’exprime de manière explicite: «le savoir enseigné doit être considéré comme une création hautement originale, collective, souvent séculaire» (2009: 18), ce qui équivaut à accorder un rôle central aux disciplines et à la formalisation des savoirs10. C’est d’ailleurs l’un des arguments que Daunay oppose à Compagnon lorsque ce dernier met en cause le formalisme des disciplines: «une discipline scolaire peut-elle s’affranchir d’un tel formalisme? Ce serait une position audacieuse, au regard de l’histoire des disciplines…» (2010: 29).
Pour prendre un exemple caractéristique en didactique du français, le concept de narrateur est un peu «plus11», au secondaire, que le narrateur dans Figures III. Il est un peu «plus», car il entre en relation avec d’autres pratiques propres à l’enseignement, en l’occurrence, avec l’exercice de l’explication de texte littéraire. Ce «plus» le transforme en fonction de la situation, ce que ne semblent pas prendre en compte certains théoriciens, car de leur point de vue, il est inadmissible qu’il se situe un peu «moins» par rapport à leur propre système et leurs propres pratiques. Le problème tient à ce qu’ils prétendent légitimer leur discours comme une norme à partir de laquelle devrait être évaluée l’école.
Le narrateur de Genette n’est donc pas celui du cours de français; qu’y a-t-il de «plus»? Eh bien, précisément, qu’il soit transposé avec toutes les conséquences propres aux systèmes didactiques. Par exemple, que signifie le fait que les concepts narratologiques entrent avec beaucoup d’autres dans une «boite à outils» méthodologique12 ? Les observations de leçons montrent que l’enseignement d’une méthode (parfois appelée technique) est indissociable de la volonté des enseignant·e·s d’expliciter cours après cours les conditions requises pour réussir des exercices, dont certains sont évalués aux examens. On constate que cette technique trouve du sens dans la mesure où elle donne des repères aux élèves et procède d’un entrainement régulier à l’usage d’instruments leur permettant de ne pas rester sans voix face à l’exercice complexe d’explication. Ils suivent un protocole. Et il n’est peut-être pas inutile à ce propos d’insister sur ce principe: «L'ordre didactique, qui ne se plie pas à nos désirs, vient […] rappeler qu’un enseignement, avant d’être bon, doit être tout simplement possible» (Chevallard 1991: 37). Une précaution consisterait à penser que si les enseignant·e·s agissent ainsi, techniquement, c’est sans doute qu’il y a des raisons qui ne relèvent pas fatalement de la routine, de la paresse intellectuelle, mais plutôt de contraintes inhérentes aux paramètres qui orientent leurs pratiques: la mise en œuvre quotidienne du métier et de ses propres techniques spécifiques expérimentées régulièrement durant l’exercice de leur travail.
C’est ici l’occasion de mentionner que la didactique du français, à son origine, s’est fédérée, y compris de manière polémique, contre les pratiques de certaines formes d’enseignement littéraire. À cet effet, il est intéressant de citer le bilan que Petitjean propose en 2014:
L’intérêt affiché et revendiqué de l’apport structural immanentiste était double, à la fois critique et propositionnel.
Critique, voire polémique, au sens où les approches poétiques et linguistiques des textes ont rendu problématiques certains présupposés théoriques de la version scolaire de l’histoire littéraire: l’évidence des intentions de l’auteur, la monosémie des textes et leur transparence référentielle, l’instrumentalisation psychologique et moralisatrice des œuvres […]. Pratiques reviendra par la suite sur ces exercices canoniques liés à la pratique du commentaire, qui vont certes évoluer, mais demeurent discutables sur le fond (voir Charolles, 1990, et l’ensemble du numéro 68 de Pratiques ; Daunay, 1997; Delcambre, 1989, 1990; Denizot, 2013). Ces critiques des différents aspects de la "forme scolaire" (Vincent, 1994; Reuter et al., 2007) de l’enseignement de la littérature sont d’autant plus justifiées dans le contexte des années 70 que l’on assiste à un début de rapprochement des deux ordres (primaire et secondaire) d’enseignement […]. Ce qui signifie que cet enseignement de la littérature, destiné à "une élite de jeunes bourgeois cultivés", comme l’écrit S. Delesalle, ne saurait être adapté au nouveau public qui va progressivement, des CEG (collèges d’enseignement généraux) aux futurs CES (collèges d’enseignement secondaire), accéder à ce niveau d’études et qu’il faudra repenser en profondeur la discipline […].
Propositionnels, les premiers travaux de didactique et les théories auxquelles ils réfèrent l’ont été dans la mesure où ils ont servi d’antidote à l’impressionnisme […] censé permettre d’accéder à la "pensée indéterminée" ou à la "conscience profonde" qu’expriment les œuvres. Pour ce faire, l’accent sera mis sur les indices formels susceptibles d’étayer les interprétations et qui ont l’avantage de fournir à la discipline des savoirs objectivables et des exercices évaluables, procurant, de ce fait, un regain de légitimité aux études de lettres par rapport aux disciplines scientifiques. (Petitjean 2014: 19)13
On notera que ce discours de la méthode ne peut être dissocié de la volonté de s’adapter à un nouveau public d’élèves, corollaire de cette massification que la sociologie scolaire a bien documentée. Petitjean relève très justement le lien entre cette massification et les positionnements militants de la recherche en didactique:
Comme l’attestent les premiers numéros de Pratiques, il s’est agi, sur des bases militantes d’une revendication de scientificité conjointe à une volonté d’innovation pédagogique, de tenter de répondre à un nouveau public scolaire, à la suite des bouleversements démographiques. (2014: 13)
L'évolution des rapports scolaires aux textes réputés littéraires est donc une réponse au besoin de faciliter l’apprentissage des élèves n’entrant pas spontanément dans leur célébration. Dans cette perspective, il est utile de rappeler encore l’observation de Schneuwly sur la création hautement originale de la transposition. Combien d’idées justes théoriquement ont été prêchées dans le désert parce qu’il n’était pas tenu compte de la matérialité du travail que l’on prétendait amender! On peut d’ailleurs douter que l’enjeu fondamental se trouve uniquement dans une recherche de fidélité scrupuleuse au savoir savant. Tout d’abord, existe-t-il réellement un savoir savant stabilisé dans les sciences linguistico-discursives? Le cas de la narratologie est parlant. Quelle est la narratologie la plus savante, la plus incontestable, qui pourrait servir de parangon à une transposition digne de ce nom: celle de Genette, de Patron, de Rabatel, de Baroni? On peut aussi rappeler que tandis que la science débat, polémique, affine et progresse, enseignant·e·s et élèves travaillent en classe en fonction d’autres finalités. C’est pourquoi, il serait sans doute bienvenu de contextualiser les approximations et reformulations dues à la transposition.
Cela ne signifie pas pour autant que les pratiques existantes soient intangibles, mais qu’il vaut mieux partir d’un réel état des choses, sous peine de rêver la réalité plutôt que la décrire. Ce n’est qu’à partir de là, nous semble-t-il, qu’une réflexion peut être menée sur d’éventuelles propositions d’améliorations, d’amendements ou de confirmations. C’est la voie dans laquelle s’engage l’équipe DiNarr, et Baroni (2020) donne un bon exemple d’une réflexion savante qui s’intéresse, dans une perspective scolaire, à la qualité scientifique des concepts. Il s’inscrit ainsi dans une démarche d’éclaircissement terminologique au service des enseignant·e·s et des élèves, tout en prenant la peine de préciser (avec Reuter 2000: 9) qu’il est nécessaire de se demander à qui s’adressent les savoirs et dans quels buts14. À ce titre, Baroni mentionne les rapports réciproques propres à la transposition entre les champs de la théorie narratologique et de l’enseignement:
De telles situations posent la question de la pertinence d’acquérir ou d’enseigner un appareillage critique dont la définition apparaît obscure ou le gain pour l’interprétation discutable. Mais ces difficultés peuvent aussi avoir une valeur heuristique, dans la mesure où elles devraient être considérées comme le symptôme d’un défaut de la théorie, ce qui devrait nous encourager à la réformer. Théorie et enseignement ne sont pas deux champs d’activités liés par un rapport de transfert unilatéral, mais bien deux pratiques qui se nourrissent mutuellement, dans un cercle que l’on peut espérer vertueux pour autant que l’on accepte de ne pas figer les concepts hérités du passé. (2020: §18)
En complément de ces observations, il nous semble notamment utile de retenir une particularité de l’organisation de l’enseignement par degrés: les élèves changent d’enseignant·e·s d’une année à l’autre et rencontrent régulièrement des empêchements lorsque la nomenclature des concepts change sans que cela ne soit enseigné explicitement. Faut-il pour autant renoncer à tout changement ? Non, bien sûr, mais sur le plan de la progression curriculaire comme sur celui des rapports entre contenus d’enseignement et théorie de référence de ces contenus, la question de la sédimentation gagne à être prise en compte. Il convient dès lors de se demander en quoi une proposition nouvelle s’intègre au système ancien, comment elle peut compléter, éventuellement contribuer à une approche diversifiée, et si réellement elle entre en contradiction, en expliciter la différence et la productivité.
Notre propos ne soutient pas – ce serait absurde – que les effets de la transposition ne puissent pas faire l’objet de critiques et nombre d’articles didactiques s’y emploient, mais il s’agit d’une question de méthode. Et la didactique peut à son tour être objet de critique (Daunay 2007b : 160).
3. Le rôle du concept pour l’apprentissage et le développement
La réflexion sur l’introduction de la narratologie à l’école a déjà été documentée, mais nous souhaitons insister sur le rôle de cet apprentissage pour le développement de l’élève, afin d’en estimer le coût s’il devait être abandonné. Notre réflexion sur les rapports entre apprentissage et développement est redevable à la thèse du psychologue L. S. Vygotskij qui soutient que, contrairement à la maturation des instincts et des tendances innées, la force motrice qui provoque le processus du développement psychique
Est située non pas au-dedans de l'adolescent, mais au-dehors et en ce sens les tâches que le milieu social propose à l'adolescent en développement et qui sont liées à son insertion dans la vie culturelle, professionnelle et sociale des adultes sont véritablement un élément fonctionnel d'une extrême importance, qui indique une nouvelle fois la détermination réciproque, la liaison organique et l'unité interne du contenu et de la forme dans le développement de la pensée. (1934 / 1997 : 208)
Vygotskij mentionne «un fait depuis longtemps établi par l'observation scientifique» et qui nous semble capital pour une réflexion didactique :
Là où le milieu ne suscite pas les tâches voulues, ne présente pas d'exigences nouvelles, n'encourage pas ni ne stimule à l'aide de buts nouveaux le développement intellectuel, la pensée de l'adolescent ne cultive pas toutes les possibilités qu'elle recèle réellement, n'accède pas à ses formes supérieures ou y parvient avec un très grand retard. (1934 / 1997 : 208)
L’enjeu est considérable : il s’agit tout simplement de réfléchir aux potentialités des objets enseignés, des activités, des dispositifs en termes d’accès à des formes supérieures de pensée – et bien sûr la narratologie n’échappe pas à la règle. Ainsi, le raisonnement de Vygotskij le conduit à défendre la nécessité de ne pas laisser le développement de l’enfant uniquement à sa propre logique, car elle ne se transformera alors jamais en développement culturel (1931/2014 : 500) :
L'apprentissage n'est valable que s'il devance le développement. Il suscite alors, fait naître toute une série de fonctions qui se trouvent au stade de la maturation, qui sont dans la zone prochaine de développement. C'est là le rôle capital que joue l'apprentissage dans le développement [...]. L'apprentissage serait parfaitement inutile s'il ne pouvait utiliser que ce qui est déjà venu à maturité dans le développement, s'il n'était pas lui-même la source du développement, la source du nouveau. (1934/1997 : 358)
C’est ce qui explique que la zone de développement potentiel15 soit un facteur essentiel des processus à l’œuvre au sein des systèmes didactiques, et la narratologie peut jouer, par son outillage conceptuel, un rôle moteur dans le fonctionnement de cette zone de développement potentiel. Le processus de conceptualisation se réalisant au cours d’un programme d’apprentissage contribue en effet de manière fondamentale au développement psychique. Voici, en quelques mots, le raisonnement de Vygotskij : partant d’observations empiriques, il constate d’abord qu’à un premier stade l’enfant confond la liaison entre ses propres impressions avec une liaison entre les choses (1934/1997 : 211); ces concepts dits syncrétiques sont suivis d’une deuxième étape qu’il nomme «pensée par complexes» dont les généralisations réunissent les objets ou les choses «non plus sur la base des seules liaisons subjectives», mais sur «une liaison concrète et de fait entre les différents éléments qui [les] composent» (1934/1997 : 216); la liaison, et c’est important pour la suite de notre propos, est alors essentiellement empirique. Vygotskij explique que c’est comme si l’enfant pensait par noms de famille. Comme le nom propre «Pétrov» rassemble les divers membres d’une même famille, la pensée par complexes réunit des objets singuliers par leurs aspects concrets. Il ajoute que c’est un progrès incontestable, mais ce n’est pas encore véritablement la pensée conceptuelle proprement dite – tant réunir des personnes par leur nom de famille ne nécessite aucunement une connaissance exacte du concept même de «famille».
Il est crucial de comprendre que le concept n’est pas seulement un savoir verbal, mais qu’il est dans un rapport essentiel avec la réalité expérimentée (1934/1997 : 190). Il s’inscrit également dans un processus vivant, c’est-à-dire qu’il contribue à la communication, à la manifestation du sens, aux résolutions de problèmes et qu’il est évolutif (1934/1997 : 192). Ce n’est donc pas seulement un rapport à la réalité, mais un rapport problématisé à la réalité et dès lors le concept n’est pas envisagé dans sa substance, mais dans sa fonction : il se trouve nécessaire quand le rapport au monde pose problème, et doit être pensé; ce problème peut alors être surmonté grâce à la formation des concepts (195). Il est d’ailleurs notable dans les observations de leçon que, souvent, l’intérêt ou le désintérêt manifesté par les élèves est lié au sens qu’ils peuvent donner aux concepts, c’est-à-dire à l’aide que ces derniers leur apportent potentiellement dans la résolution des problèmes qui leur sont posés : «Le concept apparaît lorsqu'une série de traits distinctifs qui ont été abstraits est soumise à une nouvelle synthèse et que la synthèse abstraite ainsi obtenue devient la forme fondamentale de la pensée, permettant à l'enfant de saisir la réalité qui l'environne et de lui donner un sens» (258). Si ce rapport n’existe pas ou est trop distendu, le fonctionnement de la pensée est interrompu et entraine un décrochage, avec les conséquences que l’on connait.
Ajoutons que le caractère évolutif du concept apparait d’autant plus fondamental qu’il signifie des degrés d’accès à la conceptualisation dans l’apprentissage pour l’apprenant, mais aussi des degrés à prendre en compte par l’enseignant·e. Le problème ne réside pas uniquement dans le degré d’abstraction du concept lui-même, mais aussi dans l’étendue du système auquel il donne accès et c’est pourquoi sa compréhension et son acquisition, en milieu scolaire du moins, dépendent pour partie de l’explicitation des propriétés du concept, telles qu’organisées à travers le temps de l’enseignement et de l’apprentissage, et pour partie des conditions données à l’élève pour lui permettre de lier le concept à des objets situés à l’extérieur de lui-même (autrement dit, des propriétés du milieu didactique qui, à travers des tâches structurées en dispositifs, médient l’élaboration d’un rapport entre les actions de l’élève, le concept à apprendre, et les problèmes auxquels le concept donne accès et contribue à résoudre). Si l’on se fixe pour objectif de conduire un élève à un point x, ce qui importe, c’est de comprendre les étapes qui manquent, les sauts trop importants qui l’empêchent d’y parvenir, en d’autres termes les concepts manquants et les liaisons manquantes entre les concepts dans le système des concepts d’une part, et les liaisons entre les concepts et les problèmes concrets qui sont à résoudre d’autre part. Et il est donc nécessaire, pour que fonctionne la zone de développement potentiel, que dans une interaction didactique l’un des acteurs ait non seulement une connaissance plus vaste du système conceptuel que l’autre, mais aussi, une connaissance des conditions permettant l’apprentissage de ce système.
Toutefois, enseignant·e·s et apprenant·e·s peuvent tout à fait utiliser les mêmes mots, sans pour autant les insérer dans les mêmes systèmes conceptuels, et c’est ici qu’intervient ce que Vygotskij appelle des pseudo-concepts. Il note que dans ce cas la généralisation exprimée par l’apprenant·e rappelle par son apparence celle du concept que l'enseignant·e utilise, mais qu’elle demeure d’une nature psychique différente. Il s’agit
D'une réunion sous forme de complexe d'une série d'objets concrets, qui phénotypiquement, c'est-à-dire par son apparence extérieure, par l'ensemble de ses particularités externes, coïncide parfaitement avec le concept, mais qui par sa nature génétique, par les conditions de son apparition et de son développement, par les liaisons causales-dynamiques qui en sont la base, n'est nullement un concept. Extérieurement, c'est un concept, intérieurement, c'est un complexe. C'est pourquoi nous l'appelons pseudo-concept. (225)
Ce phénomène joue bien sûr un rôle décisif dans les malentendus cognitifs fréquemment observés par les recherches en didactique, puisque dans un cours, l’élève passe en alternance d’une pensée par complexes à une pensée par concepts en fonction de sa progression, de sa place dans les degrés scolaires ou dans les filières, et de la nature des tâches qui lui sont proposées. Nous insistons sur le fait que cette alternance entre pensée par complexes et pensée par concepts traduit des rapports fondamentalement différents à la réalité.
Pour mieux comprendre cet enjeu, ce raisonnement doit être complété par une autre distinction éclairante pour l’analyse du phénomène de l’abstraction conceptuelle, et qui apparait par ailleurs utile à la description des fonctions éventuelles de la narratologie dans un système didactique. Dans le chapitre 6 de Pensée et langage, Vygotskij différencie les concepts qu’il qualifie de quotidiens «spontanés» et ceux qu’il qualifie de scientifiques16. Pour expliciter son propos, il donne l’exemple du nœud : nouer de manière consciente ne signifie pas pour autant prendre conscience de l’action de nouer «parce que [l’] attention [est] dirigée sur l’acte même de nouer et non sur la manière dont[il est accompli]» (1934/1997 : 316). La prise de conscience consiste donc à ce que l’activité même de la conscience, qui «représente toujours un certain fragment de réalité», devienne objet pour prendre place dans une «généralisation des processus psychiques qui conduit à leur maîtrise» (317). Vygotskij précise ainsi que ce sont les concepts scientifiques qui «ouvrent la porte à la prise de conscience» (317)17. C’est la connaissance des opérations psychiques qui permet donc de les maitriser, les réitérer pour la résolution de problèmes posés par de nouvelles activités analogues ou différentes. La différence avec le concept quotidien est primordiale :
[L’enfant] sait ce qu’est un frère, mais il doit gravir dans le développement de cette connaissance de nombreux échelons avant d’apprendre à définir ce mot, si jamais l’occasion s’en présente. Le développement du concept de «frère» n’a pas eu pour point de départ une explication du maître ni une formulation scientifique du concept. En revanche il est saturé de la riche expérience personnelle de l’enfant. (1934/1997 : 292)
Cette dernière phrase sur la saturation par l’expérience contribue de manière passionnante à la compréhension de l’apprentissage tel qu’on peut l’observer dans les classes. En effet, Vygotskij considère que les deux types de conceptualisation sont antagonistes, n’obéissent pas à la même logique, suivent une voie opposée et «c’est là [d’ailleurs] le point cardinal de [son] hypothèse». Leur nature différente tient au fait «que l'élément principal dans [le] développement des concepts scientifiques est la définition verbale initiale, qui dans les conditions d'un système organisé descend jusqu'au concret, jusqu'au phénomène, alors que la tendance des concepts quotidiens est de se développer en dehors d'un système déterminé et de s'élever, d'aller vers les généralisations» (274). Vygotskij précise alors :
La faiblesse des concepts quotidiens se manifeste […] par une incapacité à l'abstraction, une inaptitude au maniement volontaire; ce qui domine dans ces conditions, c'est leur utilisation incorrecte. La faiblesse du concept scientifique, c'est son verbalisme, qui constitue le principal danger pour son développement, c'est son insuffisante saturation en concret; sa force est dans la capacité qu'a l'enfant d'utiliser volontairement sa disponibilité à l'action. (1934 /1997 : 275)
En d’autres termes, concrètement, si l’enseignant·e se cantonne dans une activité qui ne requiert que des concepts quotidiens, il n’y a pas de développement possible, mais si à l’inverse l’enseignement se focalise sur des concepts scientifiques abstraits, un autre risque est encouru :
L'enseignement direct de concepts s'avère toujours pratiquement impossible et pédagogiquement sans profit. Le maître qui tente de suivre cette voie n'obtient habituellement rien d'autre qu'une vaine assimilation des mots, un pur verbalisme, simulant et imitant chez l'enfant l'existence des concepts correspondants, mais masquant en réalité le vide. L'enfant assimile alors non pas des concepts, mais des mots, il acquiert par la mémoire plus que par la pensée et s'avère impuissant dès qu'il s'agit de tenter d'employer à bon escient la connaissance assimilée. Au fond, cette façon d'enseigner les concepts est précisément le défaut fondamental de la méthode d'enseignement […] purement scolastique, purement verbale, qui substitue à la maîtrise d'une connaissance vivante l'assimilation de schémas verbaux vides et morts. (1934 / 1997 : 277)
Même si l’on relève qu’ici Vygotskij parle d’enfants, sa remarque reste juste pour le secondaire, mais à des degrés différents. Le risque de verbalisme est bien sûr possible avec l’enseignement de la narratologie, surtout s’il se fait pour lui-même, indépendamment de son usage instrumental pour analyser des œuvres, en d’autres termes s’il demeure insuffisamment saturé de concret – cette insuffisance étant évidemment relative aux degrés et aux filières. C’est dans la mesure où la narratologie est un moyen au service d’une fin qu’elle a une chance de trouver du sens aux yeux des élèves, et ceci, en particulier, parce qu’elle contribue efficacement à réussir des exercices, comme nous l’avons déjà mentionné.
Les données recueillies dans les classes (on le verra un peu plus bas) attestent de l’importance du rapport au concret. Or, pour Vygotskij, la période de l’adolescence marque le moment d’une «profonde discordance entre la formation du concept et sa définition verbale» (1934/1997 : 260); et ce dissensus entre le concept et sa prise de conscience génère une complication notable dans l’acquisition des apprentissages : «L’adolescent forme un concept, l’emploie correctement dans une situation concrète, mais, dès qu’il s’agit de définir verbalement ce concept, sa pensée se heurte alors aussitôt à d’extrêmes difficultés et la définition qu’il en donne est beaucoup plus étroite que l’emploi vivant qu’il en fait» (1934/1997 : 260). Ce faisant, l’adolescent expérimente la complexité de définir un concept en se détachant de la situation concrète à partir de laquelle il a été élaboré : pour expliquer le concept
Il se met à énumérer les différents objets concrets que ce concept englobe dans la situation donnée. Ainsi, l'adolescent utilise le mot comme un concept, mais le définit comme un complexe. Cette forme qui hésite entre la pensée par complexes et la pensée par concepts est extrêmement caractéristique de la pensée à cette époque de transition. Mais la difficulté majeure, que l'adolescent ne surmonte habituellement qu'au terme même de cet âge de transition, est le transfert ultérieur du sens ou de la signification d'un concept élaboré à des situations concrètes nouvelles qu'il pense elles-mêmes en termes abstraits. La voie de l'abstrait au concret s'avère ici non moins ardue que ne l'était en son temps la voie ascendante du concret à l'abstrait. (1934 / 1997 : 262)
Pour insérer le concept dans un système de concepts, l’adolescent doit peu à peu se familiariser avec une généralisation de deuxième ordre, le premier ordre étant celui de la pensée par complexes. L’âge de transition qui correspond de nos jours grosso modo à l’enseignement secondaire suggère donc que les enseignements tiennent compte de ce double mouvement du concret et de l’abstrait. Face à un texte, l’élève peut très bien en rester à une forme de pensée par complexes, par exemple au niveau du déchiffrage de ce que le texte dit éventuellement du monde et de ce qu’il est capable de mettre en lien avec son expérience de ce monde, ou encore, dans une perspective plus narratologique, au niveau du repérage des points de vue explicites ou implicites qui orientent la production des discours qu’il lit. Cependant, seul un autre degré de conceptualisation lui permettra de prendre conscience des moyens par lesquels le texte a un effet sur lui. De la sorte, on comprend mieux le rôle décisif que peut jouer un ensemble conceptuel comme celui de la narratologie. L’élève, avec ces concepts, pose un regard tout à fait différent sur le texte : il n’est plus «spontané», mais analytique. On peut donc avancer que c’est ce rapport complexe, ce va-et-vient entre étude immanente qui porte l’accent sur le fonctionnement d’un texte et étude référentielle qui traite du rapport au monde qui est formateur et joue pleinement son rôle pour un développement psychique potentiel. Comment soutenir que cette capacité nuirait au plaisir du texte ? Il s’agit de deux postures différentes, également susceptibles d’être plaisantes, et d’ailleurs les lecteurs experts prouvent qu’ils sont capables de passer facilement de l’une à l’autre, avec ce bénéfice que l’attitude conceptuelle critique est susceptible de contribuer à une prise de conscience des manipulations que peuvent générer les effets puissants des procédés d’immersion.
Prenons un exemple qui renvoie à dessein à l’une des tendances les plus marquées du formalisme narratologique selon Todorov : la théorie du conte de Propp. Elle s’est diffusée en particulier sous la forme du schéma quinaire théorisé par Larivaille (1974). Son usage dans les classes relève indéniablement de la transposition didactique d’une recherche formaliste, en tant qu’elle a donné lieu à la production de concepts dont il a pu être estimé qu’ils demeuraient valides pour décrire des fonctionnements textuels observables dans d’autres genres que le conte russophone. Du point de vue de l’apprentissage, moyennant une transposition didactique, le processus mental requis par le schéma quinaire demande à l’élève de se placer dans une posture réflexive et critique. Cette posture fait partie de la diversité des rapports aux textes, de même qu’une diversité du rapport à la langue se pratique par la grammaire et par de nombreuses activités d’écriture. L’analogie avec la grammaire nous est d’ailleurs suggérée par Vygotskij quand il explique que l’enfant conjugue quotidiennement, sans savoir qu’il le fait, et ce n’est que par le passage au plan volontaire, conscient, intentionnel programmé par l’école que le développement intellectuel devient possible (1934/1997: 344). Pour illustrer ce point, on peut évoquer cette situation didactique:
Imaginons [écrit Daunay] un dialogue en CM2 (que j’emprunte en fait à B. Lahire) : «Dans la phrase Le train est grand, qu’est-ce que grand ? – C’est le train». Dans la réponse de l’élève, c’est bien une subjectivité qui s’exprime, qui dit un rapport au langage… Si les effets de cette subjectivité sont scolairement rejetés comme une erreur, c’est à juste titre, parce qu’ils signalent un rapport non distancié, non scolaire (non scriptural-scolaire, pour employer les mots de B. Lahire) à la langue. (2007a : 48)
L’aspect marquant de cet exemple réside dans le fait que l’élève pense avant tout au référent, il est saturé par son expérience, alors qu’on lui demande de s’en détacher pour accéder à un stade de conceptualisation grammaticale, c’est-à-dire de manifester un intérêt pour le fonctionnement de la langue. Si sa réponse n’est pas acceptée, et qu’elle rompt le contrat didactique sous-jacent, c’est en fonction d’un but didactique qui consiste à enseigner un métalangage lui permettant d’avoir un rapport conceptuel à la langue. Dans un autre contexte, celui d’une explication de texte, la réponse sur la dimension du train pourrait être pertinente. La discipline enseignée par la diversité de ses catégories offre précisément une pluralité de rapports à la langue et au texte, et c’est là sa richesse. De la même façon, l’élève par la médiation de la narratologie adopte une posture conceptuelle abstraite : il n’éprouve plus seulement le fait d’être captivé par une lecture, car les tâches préparées par l’enseignant·e lui permettent d’acquérir et de s’approprier un système conceptuel susceptible de l’aider à prendre conscience des raisons pour lesquelles il est captivé, de les verbaliser, par exemple grâce au concept de tension narrative – la tension suggérant une dynamique de mise en intrigue qui joue sur les attentes du destinataire, suscitant son intérêt, et qui peut prendre la forme de la curiosité, du suspens, etc. (Baroni 2007).
4. Concepts et affects
Il nous reste à développer un élément essentiel qui est demeuré jusqu’à présent en filigrane : le concept doit être aussi pensé dans son lien avec les affects18. Concepts quotidiens et concepts scientifiques sont étroitement liés à des façons différentes d’expérimenter des émotions provoquées par la lecture et l’étude d’une œuvre et Vygotskij nous invite à prendre en considération le fait que l’émotion produite parune œuvre engage une action spécifique de connaissance, car elle façonne un matériau qui a été pris dans la vie, mais qui a été transformé (1925/2005 : 78).
Même le sentiment le plus authentique n'est pas en soi capable de créer de l'art. […] La perception même de l’art requiert de la création, parce que pour percevoir l'art il ne suffit pas tout bonnement d'éprouver en toute sincérité le sentiment qui s'est emparé de l'auteur, il ne suffit pas de s'y reconnaître aussi dans la structure de l'œuvre elle-même, il faut encore surmonter de manière créatrice son propre sentiment, trouver sa catharsis, et seulement alors l'action de l'art s'exercera dans sa plénitude. (1925/2005 : 345)
Or, dans le contexte de l’enseignement, cette manière créatrice de surmonter son propre sentiment se pratique régulièrement avec l’exercice de l’explication de texte. Dans ce type d’activité, on attend que l’élève soit capable d’exprimer des émotions, mais qu’en outre sa verbalisation répond aux normes de la disciplination. La classe devient ainsi le lieu où l’on régule selon des modalités codées l’expression des émotions.
Voici un très bref exemple de transcription d’une leçon effectuée dans une classe de 3e de collège19 qui comporte l’usage d’un concept narratologique courant, celui de narrateur20. L’enseignante a proposé à ses élèves l’étude de deux textes de témoins de la Première Guerre mondiale21 :
Ens : donc le narrateur / lui / il réagit comment face à ce qu’il voit
El : il est étonné parce qu’on peut penser que si des gens meurent à côté de nous / on sera choqués / traumatisés / […] alors que même si des amis sont morts / [dans le texte] ils sont heureux /, mais après si on réfléchit vraiment à ça / on peut se dire que si on était dans la même situation / on serait aussi heureux parce que ça aurait pu être moi / alors que moi je suis vivant à côté / donc au début ça provoque l’étonnement /, mais après on prend conscience que peut-être on réagirait de la même manière.
Ens : oui /, mais c’est vrai que ce qui est intéressant aussi c’est que le narrateur il a l’air de vraiment comprendre seulement autour de la ligne 135 / «je comprends trois points de suspension / si ces instants sont heureux malgré tout au sortir de l’enfer / c’est que justement ils s’en sortent / etc.22» / donc on a ici un narrateur qui intervient considérablement dans le récit pour un peu commenter ce qu’il vient de voir /
On peut relever ici dans la réaction de l’élève la manière dont s’effectue l’interprétation par la médiation du concept de narrateur introduit dans la tâche par la question de l’enseignante. La tentation personnalisante est nettement marquée, d’autant plus qu’elle est associée à l’identification («si on était dans la même situation »). Ce n’est donc pas la nature du foyer énonciatif qui est mise en évidence, mais la compréhension du texte par l’expérience personnelle. Se donne ici à voir une sorte de syncrétisme entre différentes approches du texte : à la fois un indice d’une pensée par complexes, mais aussi un indice d’une voie vers l’abstraction (mention de la prise de conscience). Mais la manière dont l’enseignante régule l’interaction est tout aussi significative. Elle valide de manière très succincte la dimension référentielle (oui) pour revenir aussitôt au concept narratologique. Fidèle à la méthode de l’explication de texte, elle mentionne de manière précise l’occurrence (ligne 135), la commente en soulignant l’emploi de la ponctuation (trois points de suspension), pour ouvrir sur une remarque plus générale d’interprétation.
On voit ici ce qui est sous-jacent à la démarche de l’enseignante : elle met en place les conditions permettant aux élèves d’expérimenter le mouvement vers le concret, et le mouvement vers l’abstrait. Ainsi par cet exercice, les élèves sont invités à dépasser un premier état de l’affect pour accéder à un affect médié par un processus simultané de disciplination. Cela leur permet par la suite (les transcriptions le montrent) de comparer la manière dont deux témoins de la guerre relatent leur expérience, et dont le travail formel d’écriture (qui peut être en partie analysé grâce à la narratologie) joue sur la qualité d’authenticité de leurs témoignages respectifs23 :
El : il y a des moments où c’est / il y a des dialogues / un moment où c’est écrit comme un roman
Ens : oui
El : avec la littérature qui va avec / les tournures de phrase
Ens : oui ça c’est vraiment une bonne observation / effectivement dans les dialogues / on est plus dans une optique / essayer de rendre les choses comme elles se sont passées / et puis typiquement dans les descriptions là on retrouve des éléments plus typiques du roman / du romanesque / etc. / donc ça implique quoi / l’utilisation de quoi / comme style
El : quelles figures de style
Ens : oui par exemple quelles figures de style / de certains effets / etc.
Signe de la manière dont la classe entre dans une conceptualisation complexe, celle-ci apparait lorsque les élèves débattent et comparent leurs préférences pour le texte de Lintier ou pour celui de Barbusse24 :
El : [Dans le texte de Barbusse] tout est construit pour nous montrer que c’est vraiment horrible / par rapport à l’autre texte [celui de Lintier] c’est beaucoup moins vrai / aussi les morts comme ils sont décrits / déjà je ne suis pas sûr que quand tu es sur un champ de bataille / tu passes autant de temps à observer comment les gens sont morts / et puis ils sont dans des positions qui ne font pas très réalistes [T_Coll III_l. 3779-3783]
Le texte de Barbusse est abordé sous l’angle de sa construction, c’est-à-dire non pas comme un donné, mais par son intention énonciative qui oriente la signification du texte, ce qui permet de poser la question de la véracité, capitale pour la compréhension du genre des textes de témoignage. La réponse est encore approfondie :
El : il y en a un qui était coupé en deux / et une partie du corps qui était en quelque sorte debout / il me semble / ça ne fait pas très réaliste [T_Coll III_l. 3788-3793]
Cependant, un autre élève argumente en sens opposé :
El : je pense qu’il n’y a rien de plus réel que comment c’est retranscrit / ça ressemblait plus ou moins à ça
L’enseignant profite alors du débat pour proposer une synthèse qui contribue à la formation générale des élèves en cours de français :
Ens : la valeur de témoignage de ce texte / je conçois totalement que certains d’entre vous le reçoivent comme quelque chose d’hyperréaliste et d’autres comme quelque chose/ on va dire de totalement exagéré / maintenant du point de vue littéraire / […] on peut dire qu’il y a un certain nombre de procédés qui sont utilisés et qui suscitent des images en nous / ces procédés ce sont les comparaisons / ce sont les procédés d’exagération / des termes comme extraordinairement / avec des termes qui relèvent de l’hyperbole qu’on retrouve à la fin du texte aussi / donc ça au niveau littéraire […] / après est-ce que ça correspond à une réalité ? / ce serait plutôt un autre travail à effectuer.
De même que cet extrait d’interaction fait apparaitre la mise à profit, en classe, de concepts variés (valeur de témoignage, hyperréalisme, divers procédés littéraires), il est permis de considérer par extension que, dans une analyse de texte, ce n’est pas de la surprise face à l’horreur de la guerre qui est ressentie, mais de la surprise face à cette horreur décrite de façon plus ou moins réaliste, ce n’est pas de la tristesse qui est éprouvée, mais de la tristesse lyrique, non pas du courage, mais du courage épique, non pas de la pitié, mais de la pitié tragique, non pas un état d’attente anxieux, mais un état d’attente anxieux narrativisé, etc. Dans cette optique, l’exercice d’explication de texte peut être considéré comme un instrument psychologique qui offre la capacité de verbaliser la pensée émotionnelle inhérente à la spécificité esthétique de l’œuvre, telle qu’elle est étudiée dans un contexte institutionnel donné. Vygotskij précise que son plein potentiel en termes de développement intellectuel tient à un double facteur : non seulement laisser l’œuvre produire son émotion, mais encore en prendre conscience, sinon l’émotion risque de rester confuse et incompréhensible. Son interprétation, dont l’une des formes les plus élaborées se manifeste précisément dans les diverses pratiques de l’herméneutique, doit permettre d’éviter ses effets potentiellement perturbants, voire dommageables (1925/2005, p. 354). C’est alors que Vygotskij peut parler d’émotions devenues intelligentes, émotions qui «au lieu de se manifester sous la forme de poings serrés ou de tremblements […] se résolvent principalement dans les images de l’imagination» (1925/2005: 293).
Les observations de leçons montrent que l’enseignant·e guide les élèves, conscientise méthodiquement leur activité, et oriente leur attention vers des dimensions abstraites de leur expérience de lecture, ce qui du point de vue du développement revêt un aspect fondamental. Identifier un procédé n’est pas seulement utile en soi comme critère de réussite de l’exercice, mais il conduit l’élève à une prise de distance avec l’émotion première, et il peut alors expérimenter le fait que la conceptualisation ouvre la possibilité de s’en rendre maitre, de l’étoffer et de l’affiner, et de communiquer pour la partager. Loin de réduire, compromettre, gâcher la réception de l’art, la conceptualisation y contribue donc de manière décisive, et elle s’apprend dans notre société pour une part essentielle à l’école par une systématisation disciplinaire qui se forme cours après cours. L’apprentissage des émotions esthétiques se fait donc de manière collective ou, plus précisément, la manière d’apprendre à vivre subjectivement une émotion dépend fondamentalement d’une interaction collective. Il est ainsi possible dans des conditions très précises, à l’intérieur d’un espace bien spécifique, protégé institutionnellement, celui de la classe, d’expérimenter les émotions et les passions sans s’exposer aux sanctions immédiates que pourraient entrainer ces émotions et ces passions dans la réalité. C’est possible parce qu’elles sont transformées grâce à une double médiation : celle de l’art et celle de la culture didactique.
5. Les concepts, les méthodes et les outils
Dans un article intitulé Défense et illustration de "l’honnête homme". Les hommes de Lettres contre la sociologie, Sapiro (2004) analyse le conflit qui s’est ouvert, à la fin du XIXe siècle, entre le champ littéraire et le champ académique. La polémique visait surtout la sociologie (Durkheim), mais aussi son application par Lanson à l’histoire littéraire. Sapiro observe que
Dans le champ littéraire, l’argumentation contre le scientisme prend appui sur une triple antinomie qui condense trois séries d’oppositions : entre créateur et professeur (auctor/lector, invention/répétition, intuition/raison, don/application, génie/habileté, élégance/pédantisme, l’inné/l’acquis); entre homme de lettres et savant (humanités/sciences, culture générale/spécialisation, «idées générales»/positivisme, spiritualisme/matérialisme, désintéressement/utilitarisme); et, enfin, entre «héritiers» et «boursiers» […]. Les arguments pour la défense des humanités, contre les sciences, recoupent très largement ceux qui valorisent le génie de l’écrivain, l’universalité de l’homme de lettres contre le pédantisme du professeur, la spécialisation du savant coupé du réel. (2004 : 16)
Elle ajoute que ces systèmes de classification fonctionnent comme
Des opérateurs axiologiques, sortes de catégories éthiques de l’entendement scolastique qui confèrent aux systèmes d’opposition culturelle leur «sens», dans la double acception de signification et d’orientation dans l’espace, en l’occurrence, le haut et le bas, c’est-à-dire le digne et l’indigne. L’efficacité sociale de ces opérateurs tient aussi […] dans leur capacité à réaliser l’unification symbolique de systèmes de classement ou de types de hiérarchies hétérogènes, dans l’ordre des valeurs et dans l’ordre institutionnel. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient un enjeu majeur des luttes symboliques dans les moments de transformation sociale. (2004 : 21)
Dans cette perspective historique, les diverses critiques formulées à l’encontre de la narratologie scolaire ont un air de déjà-vu. À tout le moins ne renouvellent-elles pas particulièrement les opérateurs axiologiques dont Sapiro décrit l’activation, par des hommes de lettres d’un autre temps, contre les sciences sociales naissantes.
Ce qui a changé pourrait être recherché, en revanche, dans certains éléments qui servent de décor à l’adaptation contemporaine de la tragicomédie, devenue classique, du digne et de l’indigne. Entre les tirades de Péguy qui défend, en 1906 déjà, la probité de l’homme contre les instruments et les méthodes issues des disciplines de l’histoire et de la sociologie, et les accusations portées contre la narratologie scolaire lors d’un procès imaginaire plus récent (où la verve dramatique et la connivence des plaidoyers compensent mal l’absence de preuves, et surtout de victimes), la structuration du champ académique et l’orientation des approches didactiques des textes réputés littéraires ont en effet évolué. Côté cour : des représentants de la recherche littéraire francophone, qui a entretemps su répondre de façon remarquable à l’injonction académique de scientificité par la formalisation de systèmes conceptuels rigoureux, cèdent à la fétichisation de la Théorie en déplorant qu’elle puisse être transposée en méthodes et en techniques dites desséchantes (Compagnon 1998 : 10). Côté jardin : certains travaux se réclamant de la didactique de la littérature prennent à contre-pied le processus de dénaturalisation des objets d’enseignement (Chevallard 1991 : 17), tout coextensif de la scientifisation de la didactique du français qu’il soit, et bien que l’on ne cesse de rappeler son importance à l’endroit du littéraire (Reuter 1995; Daunay 2007b; Vuillet 2017). Ne pourrait-on pas soutenir que nous sommes dès lors très proches d’une démarche tendant à minimiser le rôle des disciplines et de leurs médiations? Dans l’histoire des idées sur l’éducation, deux traditions de pensée peuvent en effet être distinguées, avec des nuances certes importantes, mais malgré tout cohérentes : l’une, naturaliste, cherche à protéger la nature de l’enfant contre les atteintes de l’institution (Rousseau, Tolstoï, l’éducation nouvelle, etc.); l’autre, dénaturalisante, constructiviste, historico-culturelle (Vygotskij, l’interactionnisme socio-discursif, etc.25), conduit à concevoir d’une façon significativement différente l’expérience de la subjectivité dans un milieu didactique26. Or, dans le courant important de la didactique de littérature de ces vingt dernières années, celui du «sujet lecteur», la revendication d’un accès à la sensibilité ou à l'implication émotionnelle de ce «sujet» somme tout abstrait se concrétise, logiquement, par une minimisation, voire par un refoulement des conditions propres au fonctionnement des systèmes didactiques – qu’il s’agisse de celles issues de la discipline «français», ou de celles plus génériquement liées aux contextes institutionnels des activités. C’est donc par des voies différentes, mais entre lesquelles des chemins de traverse existent, qu’un ensemble hétérogène de spécialistes de la littérature parvient au même point de vue : celui qui consiste à dévaloriser les déclinaisons scolaires d’appareillages conceptuels (parmi lesquels la narratologie). Cependant, même si la robustesse de l’outillage conceptuel observé dans les classes demeure toujours questionnable, force est de constater que les enseignant·e·s l’utilisent avec l’intention de servir l’apprentissage et de contribuer potentiellement au développement des élèves – potentiellement puisque les élèves peuvent bien sûr, pour de multiples raisons, ne pas entrer dans la conceptualisation enseignée.
Telle que nous avons tenté d’en donner un aperçu dans cet article, et comme les journées d’études organisées par le groupe DiNarr en juillet de cette année en ont fourni un exemple, la rencontre des approches didactiques de la littérature et de la narratologie offre l’occasion d’interroger scientifiquement les rapports entre des théories (ici : didactiques ou textuelles), des techniques (en l’occurrence : relatives à l’enseignement ou aux procédés narratifs) et des pratiques (dans notre cas : scolaires ou savantes). À elles seules, ces trois composantes et leurs déclinaisons rendent pertinente la mention d’une réflexion développée par Habermas dans un texte datant de 1966, Progrès technique et monde vécu social – mais il se trouve, de surcroit, que les deux ensembles de reproches adressés à la narratologie scolaire y sont comme invalidés par avance. Pour Habermas :
Les informations strictement scientifiques […] ne peuvent pénétrer dans le monde vécu social que par le biais de leur mise en valeur technique, c’est-à-dire en tant que savoir technologique : et là elles servent à développer notre pouvoir de disposer techniquement des choses. [….] . Elles ne se situent donc pas sur le même plan que la conception que les groupes sociaux se font d’eux-mêmes et qui oriente leurs actions […]. (2015 : 78)
Dans cette perspective, les techniques, les méthodes et les outils transposés et stabilisés au sein de la narratologie scolaire apparaissent comme un moyen tout indiqué pour favoriser la pénétration, dans le «monde vécu social», des élaborations plus strictement scientifiques des théories narratives, et ce, en vue d’augmenter le pouvoir de chacun·e à disposer techniquement ou méthodiquement des procédés narratifs. Et nous avons pour notre part voulu illustrer qu’avec cet outillage ce ne sont pas seulement les conceptions que les élèves se font des textes, mais aussi celles qu’ils se font leurs propres émotions qui peuvent s’en trouver étoffées, reconfigurées, rapprochées des produits culturels de notre sociohistoire.
Ce développement appelle à notre sens deux compléments. D’une part, il doit être tenu pour réducteur de considérer que la technique, la méthode et l’outil descendraient uniquement de la science comme semble le penser Habermas (2015 : 87) : c’est omettre qu’ils peuvent procéder conjointement, dans un mouvement cette fois ascendant, de la pratique elle-même – ce que démontre nettement le cas des sciences de l’éducation qui se sont justement scientificisées et disciplinarisées à partir de pratiques préexistantes (Hofstetter & Schneuwly, 2014). D’autre part, il convient de noter que l’affiliation de contenus de savoir aux catégories respectives de la praxéologie ou du modèle référable/référé à une théorie relève inévitablement d’«un classement de type culturel, ou plus précisément, de type institutionnel» (Johsua 1994 : 103). Autrement dit : les paramètres spécifiques d’un contexte institutionnel, en tant qu’ils orientent les manières de penser, de dire et d’agir de ses représentants, contribuent en large part à la catégorisation de contenus de savoirs comme relevant de savoirs pratiques, ou de modèles référables/référés à une théorie – ce dont on peut se convaincre en songeant au fait que l’élaboration de théories constitue, elle-même, une pratique parmi d’autres. Moyennant ces compléments, il nous semble que la réflexion introduite par Habermas aide à décrire comment les approches didactiques de la littérature et la narratologie peuvent, ensemble, renforcer le cercle vertueux entre théorie textuelle et enseignement qu’avec Baroni (2020 : § 18) nous appelons de nos vœux. Approcher scientifiquement les processus de transposition didactique des techniques narratologiques au sein des pratiques d’enseignement et d’apprentissage répond, en effet, à l’invitation d’Habermas de «[reprendre la] technique au sein du monde vécu de la pratique» (2015 : 87). De la sorte, plusieurs écueils peuvent être évités, parmi lesquels :
- - Celui de la (re)production et de la diffusion d’un «rapport rituel-fétichiste à des œuvres moribondes» (Chevallard, 1997, § 9) tout d’abord. À ce propos, soulignons le fait que si ces «œuvres» peuvent relever de textes ou de systèmes théoriques, cette différence n’empêche pas que leur transposition puisse soulever des problèmes analogues. L’essentialisation des normes et des valeurs qui président, sur un plan axiologique, à la réputation littéraire de (corpus de) textes peut être mise en correspondance avec ce qui, sur un plan cette fois scientifique, prend la forme d’une conception applicationniste des rapports entre théories du texte, concepts, techniques et pratiques d’enseignement.
- - Corrélativement, approcher scientifiquement les processus de transposition didactique des techniques narratologiques au sein des pratiques d’enseignement et d’apprentissage peut aider à éviter l’écueil de la dichotomie entre «science des objets» et «science des sujets» (Ligozat et al., 2014, p. 107) dont la didactique ne s’est pas (encore ?) systématiquement défaite. Notons ici que les deux termes de cette dichotomie peuvent fonctionner comme des analyseurs des critiques adressées à la narratologie scolaire : du côté de la science des objets, on situera les positionnements savants qui appliquent sans grande précaution, sur des contenus scolaires, des considérations théoriques issues d’un autre champ; du côté de la science des sujets, on situera cette fois les positionnements caractéristiques d’une éducation à la littérature qui, s’intéressant avec raison à la question de la subjectivité, préfère néanmoins les agencements notionnels vagues (sujet lecteur, bibliothèque intérieure, texte du lecteur, etc.) à la précision formelle de concepts.
Les concepts narratologiques et les concepts didactiques, de même que les méthodes et les outils qu’ils permettent d’affiner, aident à se départir de rapports plus ou moins spontanés où s’encourt toujours le risque de confondre l’objet que l’on souhaite décrire avec l’effet qu’il a sur nous. Dans cette perspective, que l’on soit chercheur·e en didactique ou en narratologie, enseignant·e de français ou élève, le concept, la méthode et l’outil font donc partie des moyens que nous avons à disposition pour nous déplacer à travers les dimensions personnelles, interpersonnelles, transpersonnelles et impersonnelles qui structurent l’ensemble des activités humaines (Clot 2008 : 180). Ainsi peut-on apprendre à contribuer, chacun·e à sa manière, ainsi qu’à la manière d’autrui, à leur histoire – à notre histoire.
Bibliographie
Barbusse, Henri (1917/2014), Le Feu, Paris, Garnier-Flammarion.
Baroni, Raphaël (2020), «Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement : schéma quinaire et focalisation en débat», Transpositio, n°2, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/pour-des-concepts-narratologiques-intelligibles-et-utiles-pour-l-enseignement-schema-quinaire-et-focalisation-en-debat
Baroni Raphaël (2016), «L’empire de la narratologie, ses défis et ses faiblesses», Questions de communication, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10766
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Brillant Rannou, Nathalie, François Le Goff, Marie-Josée Fourtanier & Jean-François Massol (dir.) (2020), Un dictionnaire de didactique de la littérature, Honoré Champion.
Bronckart, Jean-Paul (2017), «A la recherche de l’identité didactique», in Ana Dias-Chiaruttini & Cora Cohen-Azria (dir.), Théories-didactiques de la lecture et de l’écriture, Presses universitaires du Septentrion.
Brossard, Michel (2008), «Concepts quotidiens/ concepts scientifiques : réflexions sur une hypothèse de travail», Carrefours de l'éducation, 26, p.67-82.
Chevallard, Yves (1997), Les savoirs enseignés et leurs formes scolaires de transmission : un point de vue didactique, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Les_savoirs_enseignes_et_leur_transmission.pdf
Chevallard, Yves (1997), Questions vives, savoirs moribonds : le problème curriculaire aujourd’hui, Actes du colloque Défendre et Transformer l’école pour tous, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/YC_1997_-_Defendre_transformer.pdf
Chevallard, Yves (1985 [1991]), La transposition didactique, La Pensée Sauvage.
Clot, Yves (2008), «Le statut de la critique en psychologie du travail: une clinique de l’activité», Psychologie française, 53(2), p.173-193.
Compagnon, Antoine (1998), Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil.
Denizot, Nathalie (2021), La culture scolaire : perspectives didactiques, Presses universitaires de Bordeaux.
Dezutter Olivier, Julie Babin & Martin Lépine (2020), «Quel travail sur les textes littéraires dans les écoles québécoises de l’entrée à la sortie du secondaire?», Pratiques, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : https://doi.org/10.4000/pratiques.8962
Daunay, Bertrand (2016), «Quelques réflexions sur le sujetd’une description didactique», Éducation et didactique, n° 10(2), p.123-136, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL: http://educationdidactique.revues.org/2488
Daunay, Bertrand (2010), «Français et littérature : une ou des discipline(s)», Le Français aujourd'hui, n° 168, p. 23-30.
Daunay, Bertrand (2007a), «Le sujet lecteur : une question pour la didactique du français», Le français aujourd'hui, n° 157, p.43-51.
Daunay, Bertrand (2007b), «État des recherches en didactique de la littérature», Revue française de pédagogie, n° 159, p.139-189.
Dufays, Jean-Louis, Michel Lisse & Christophe Meurée (2009), Théorie de la littérature : une introduction, Louvain-la-Neuve, Belgique, Éditions Academia-Bruylant.
El Gousairi, Anass (2023), De la transposition didactique à ses réélaborations conceptuelles : des questions en débat, En ligne, consulté le 15 août 2023, URL : https://revues.imist.ma/index.php/Didactiques-et-Disciplines/article/view/36865/19005
Franck, Orianna (2017), A la recherche de l’archiélèvelecteur à travers l’analyse du geste de planification. Rôle des élèves dans les modifications de séquences d’enseignement, Thèse de doctorat, Université de Genève:Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation.
Gabathuler, Chloé, Bruno Védrines & Yann Vuillet (2019), «Didactique, réputation littéraire et connivences», Recherches. Revue de didactique et de pédagogie du français, n° 70, p.137-162.
Gabathuler, Chloé (2014), La relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires. Analyse comparative de pratiques effectives au fil des niveaux scolaires, Thèse de doctorat, Université de Genève : Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation.
Genette, Gérard (2011), Fiction et diction, Paris : Éditions du Seuil.
Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, PUF, collection «Que sais-je ?».
Habermas, Jürgen (2015), «Progrès technique et monde vécu social», in La technique et la science comme «idéologie», Jürgen Habermas, Tel Gallimard, p.75-96.
Hofstetter, Rita, Schneuwly, Bernard (2014), «Disciplinarisation et disciplination consubstantiellement liées. Deux exemples prototypiques sous la loupe: les sciences de l’éducation et les didactiques des disciplines», Disziplin - Discipline, Fribourg : Academic Press, p.27–46.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly, in Bernard Schneuwly (2008), Vygotski, l’école et l’écriture, FPSE, Cahiers de la Section des sciences de l’éducation.
Johsua, Samuel (1994), «La didactique des sciences et des mathématiques : une praxéologie ou un modèle théorique ?» In Proceedings of l’AFIRSE congress: Recherche scientifique et praxéologie dans le champ des pratiques éducatives, Aix-en-Provence, Département des sciences de l’éducation, Université de Provence. p.101-108.
Labouret, Denis, Guilhem Labouret, Sabine Mélone & Catherine Villy-Mottet (2019), Le français au lycée, Paris, Bordas
Larivaille, Paul (1974), «L'analyse (morpho)logique du récit», Poétique, n° 19, p.368-388.
Langlade, Gérard (2004), «Sortir du formalisme, accueillir les lecteurs réels», Le français aujourd’hui, n° 145, 85-96, En ligne, consulté le 16 août 2023, URL : https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2004-2-page-85.htm
Langlade, Gérard (2014), «La lecture subjective est-elle soluble dans l’enseignement de la littérature ?», Études de lettres, n° 1, p.47-64, En ligne, consulté le 16 août 2023, URL : http://journals.openedition.org/edl/608
Ligozat, Florence, Maryline Coquidé, Corinne Marlot, Ingrid Versheure & Gérard Sensevy (2014), «Didactiques et/ou didactique. Poursuivre le travail de problématisation», Éducation & Didactique, n° 8-1, p.101-115, En ligne, consulté le 16 août 2023, URL : https://journals.openedition.org/educationdidactique/1907
Lintier, Paul (1917), Le Tube 1233, Librairie Plon.
Muller, Alain (2009), Figures de l’activité distribuée sur les élèves et l’enseignant. Vers une approche descriptive et grammaticale du processus de structuration de la pratique d’enseignement. Thèse de doctorat, Université de Genève.
Péguy, Charles (1906), «De la situation faite à l’histoire et à la sociologie dans les temps modernes», Œuvres en prose complètes, t. II. Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.
Petitjean, André (2014), «40 ans d’histoire de la "lecture littéraire" au secondaire à partir de la revue Pratiques», Pratiques, n° 161-162, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : https://journals.openedition.org/pratiques/2155
Reuter, Yves (2000), «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n° 21 p. 7-22.
Reuter, Yves (1995), «La lecture littéraire : éléments de définition», Le français aujourd’hui, n° 112, p.65-71.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Peter Lang.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade,(dir.) (2004), Le sujet lecteur, lecture subjective et enseignement de la littérature, PUR.
Rouxel, Annie (2007), «Pratiques de lecture : quelles voies pour favoriser l’expression du sujetlecteur?», Le français aujourd’hui, n° 157(2), p.65-73, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2007-2-page-65.htm
Rouxel, Annie (2005), «Autobiographie de lecteur et identité littéraire», in Annie Rouxel, & Gérard Langlade (dir.), Le sujet lecteur, lecture subjective et enseignement de la littérature, PUR, 137-152.
Schneuwly, Bernard & Christophe Ronveaux (2021), «Une approche instrumentale de la transposition didactique. Quelques thèses illustrées par l’analyse de l’enseignement de quelques objets de la discipline "français"», Pratiques, n° 189-190, En ligne, consulté le 08 août 2023, URL : https://journals.openedition.org/pratiques/9418
Schneuwly Bernard, Jean-Paul Bronckart, Auguste Pasquier, Daniel Bain & Coline Davaud (1985), «Typologie de textes et stratégies d'enseignement», Le Français Aujourd'hui, n° 69, p.63-71.
Schneuwly, Bernard & Joaquim Dolz (2009), Des objets enseignés en classe de français, PUR.
Schneuwly, Bernard (2008), Vygotski, l’école et l’écriture, FPSE, Cahiers de la Section des sciences de l’éducation.
Schneuwly, Bernard (2005), «De l’utilité de la “transposition didactique”», in Jean-Louis Chiss, Jacques David & Yves Reuter, Didactique du français. Fondements d’une discipline, Bruxelles, De Boeck, p.47-59.
Schneuwly, Bernard (1990), «Didaktik / Didactiques», Bildungsforschung und Bildungspraxis, vol. 12, n° 3, p.213-220.
Séverac, Pierre (2022), Puissance de l’enfance. Vygostki avec Spinoza, Paris, Vrin.
Todorov, Tzvetan (2007), La Littérature en péril, Paris, Flammarion.
Todorov, Tzvetan (1969), Grammaire du Décaméron, The Hague, Paris, Mouton.
Van der Veer, René, & Jaan Valsiner (1994), The Vygotski Reader, Oxford, Blackwell.
Védrines, Bruno (2023), L’expérience de la subjectivité dans l’enseignement littéraire, Peter Lang, consulté le 19.08.2023, URL : https://www.peterlang.com/document/1352443
Védrines, Bruno (2017), L’assujettissement littéraire. Thèse de doctorat, Université de Genève, consulté le 13.08 2023, URL : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:102384
Vuillet, Yann, (2018), «Un poème entre réfractions littéraires et scolaires», Pratiques, n° 179-180, consulté le 13 août 2023, URL : https://journals.openedition.org/pratiques/5170
Vuillet, Yann (2017), A la recherche didactique de concepts pour penser, dire et agir le littéraire, Thèse de doctorat, Université de Genève, consulté le 13 août 2023, URL : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:129260
Vygotskij, Lev Semionovitch (1926-1933/2022), Imagination (Irina Leopoldoff Martin, trad.), in Bernard Schneuwly, Irina Leopoldoff Martin & Daniele Nunes Henrique Silva (Eds.), L’imaginationdans l’œuvre de Vygotskij, Peter Lang.
Vygotskij, Lev Semionovitch (1931/2014), Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures (Françoise Sève, trad.), Paris, La Dispute.
Vygotskij, Lev Semionovitch (1925/2005), La psychologie de l’art (Françoise Sève, trad.), Paris, La Dispute.
Vygotskij, Lev Semionovitch (1934/1997), Pensée et langage (Françoise Sève, trad.), Paris, La Dispute.
«Je comprends…
Si ces hommes sont heureux, malgré tout, au sortir de l’enfer, c’est que, justement, ils en sortent. Ils reviennent, ils sont sauvés. Une fois de plus, la mort, qui était là, les a épargnés» Barbusse ([1917] 2014 : 108).
Pour citer l'article
Bruno Védrines & Yann Vuillet, "La narratologie scolaire, objet de descriptions et de critiques", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/la-narratologie-scolaire-objet-de-descriptions-et-de-critiques
Voir également :
L'aventure scolaire de la narratologie
En 1974, l’éditorial du premier numéro de Pratiques (1974: 4) regrettait «l’ascientificité dans l’enseignement […] de la littérature»:
L’enseignement de la littérature passe par la méconnaissance de son objet et se réduit à être une transmission de valeurs morales et esthétiques de la classe dominante (les manuels imposent une lecture fondée sur la psychologie «abstraite» et sur la transparence des textes).
Il s’agissait donc, poursuivait l’éditorial, de «substitu[er] au bavardage esthético-psychologico-moral un enseignement réglé sur un ensemble de références théoriques». La liste de ces références théoriques (et leur ordre) donne la ligne de la nouvelle revue: «matérialisme historique, linguistique et sémiologie, psychanalyse, enfin logique dialectique qui permet de lier les différents apports». Le programme, on le voit, était vaste.
L'aventure scolaire de la narratologie
En 1974, l’éditorial du premier numéro de Pratiques (1974: 4) regrettait «l’ascientificité dans l’enseignement […] de la littérature»:
L’enseignement de la littérature passe par la méconnaissance de son objet et se réduit à être une transmission de valeurs morales et esthétiques de la classe dominante (les manuels imposent une lecture fondée sur la psychologie «abstraite» et sur la transparence des textes).
Il s’agissait donc, poursuivait l’éditorial, de «substitu[er] au bavardage esthético-psychologico-moral un enseignement réglé sur un ensemble de références théoriques». La liste de ces références théoriques (et leur ordre) donne la ligne de la nouvelle revue: «matérialisme historique, linguistique et sémiologie, psychanalyse, enfin logique dialectique qui permet de lier les différents apports». Le programme, on le voit, était vaste.
Près de 50 ans plus tard, l’enseignement de la littérature a en partie fait sa révolution: si le matérialisme historique et dialectique ou la psychanalyse restent des cadres théoriques sans doute peu explorés dans les cours, la linguistique et la sémiologie ont laissé des traces durables dans l’approche des textes, mais plus encore la narratologie, un champ neuf dans ces années 1970 et que l’éditorial de Pratiques n’identifiait pas encore comme un domaine autonome. En effet, comme le rappellent Baroni et Dufays (2020: 83), «ce néologisme a été introduit par Todorov en 1969 dans le but d’émanciper la jeune théorie du récit du champ des études littéraires». C’est cette aventure scolaire de la narratologie en France que je me propose ici d’analyser, depuis les années 1970 jusqu’à maintenant.
Après une rapide présentation méthodologique du corpus, je m’intéresserai tout d’abord à la manière dont la narratologie est devenue hégémonique dans les publications scolaires et didactiques des années 1990. Puis j’interrogerai le statut des savoirs narratologiques dans les textes institutionnels et les manuels, des années 1980 aux années 2020, avant de passer en revue les principaux outils narratologiques privilégiés par les manuels de méthode ainsi que les usages qui en sont faits.
Corpus et méthodologie
Pour cette petite histoire de la scolarisation1 de la narratologie, je ferai appel à plusieurs types de sources: outre les «Entretiens avec les acteurs de la scolarisation» (Dossier «Entretiens», Transpositio) je m’appuierai sur les textes institutionnels publiés depuis les années 1970, ainsi que sur plusieurs publications à destination des enseignants (revues de didactique, ouvrages pédagogiques). J’ai également constitué un corpus de 31 manuels de «méthodes» publiés entre 1984 et 2020. J’ai à la fois varié les éditeurs, pour pouvoir faire des comparaisons en synchronie, mais également constitué plusieurs séries de «collections»: je désigne ainsi (voir Denizot 2016) une succession en diachronie de manuels de même type (ici des manuels de méthode), chez un même éditeur, pris en charge par les mêmes coordinateurs et/ou par une équipe relativement stable d’une édition à l’autre. Cette notion de «collection» permet de suivre les évolutions dans le temps lors des refontes des manuels, même lorsque les collectifs d’auteurs changent en partie à chaque nouvelle version du manuel. C’est le cas en particulier chez Nathan, où certains auteurs assurent la transition d’une édition à l’autre et que je signale donc dans mon article sous cette dénomination de «collection» Nathan, pour les distinguer d’autres ouvrages de méthode parus chez ce même éditeur mais avec une équipe complètement différente2.
Les manuels «de méthode» correspondent à un type d’ouvrages scolaires apparus dans les années 1980 qui visent à exercer l’élève à la littérature. Pour ce faire, ils s’organisent autour des savoirs et des savoir-faire propres à la discipline. Ils remplacent ainsi les questionnaires guidant la lecture des textes par des «exercices», dont l’objectif est bien différent de celui des questionnaires: ces derniers sont liés à un texte particulier, alors que les exercices sont liés pour leur part à des notions, des savoirs, des savoir-faire, etc. Les manuels de méthode ont ainsi mis au point de nouveaux types d’exercices, ponctuels et centrés sur des micro-objectifs, et que je nomme (en reformulant Adam et Petitjean 1989) des exercices convergents – à distinguer donc des exercices divergents (commentaire, dissertation, etc.), visant différents objectifs et eux-mêmes susceptibles de générer des exercices convergents (Denizot 2015). Les exercices convergents, anciens en ce qui concerne le travail sur la langue (exercices d’orthographe, de langue, etc.), empruntent à ces derniers la logique leçon/exercice d’application. De ce point de vue, ils témoignent d’un changement dans le rapport à la littérature et à son enseignement, en tant qu’ils attestent qu’on peut «exercer» pleinement l’élève à la lecture du texte littéraire. Dans le cadre de ce travail sur la scolarisation de la narratologie, ce corpus de manuels de méthodes permet donc d’analyser les notions mises en avant dans ces ouvrages, ainsi que ce qui est proposé en termes de savoirs, d’exercices et de textes supports: dans ces manuels, ce sont en effet les textes qui accompagnent les exercices, et non l’inverse.
Dans cette analyse des manuels et des textes institutionnels, je me centre sur le travail proposé autour du récit (en tant que la narratologie est «la science du récit et l’étude de la narrativité», Baroni et Dufays, 2020: 83), sans m’interdire cependant de regarder ce qui concerne la description, par exemple, lorsque son étude est articulée à celle du récit, ou ce qui concerne le roman (particulièrement après 2000, lorsque le «roman» devient l’un des objets d’étude au programme). Je m’en tiens essentiellement à la scolarisation de la narratologie au lycée (sections générales et technologiques), dans la mesure où c’est à ce niveau de la scolarité que la littérature est en soi un objet de travail et d’étude. Elle suscite alors ces exercices spécifiques que sont l’explication de texte et ses avatars (lecture méthodique, lecture analytique, etc. ; pour une synthèse, voir Perret 2020), grands consommateurs d’ «outils» en tout genre – pour utiliser une métaphore courante en matière d’analyse de texte, et que l’on retrouve jusque dans les manuels de méthode les plus récents (par exemple Abensour et Dumaître, 2019 et sa partie sur les «Outils d’analyse littéraire», 59-87). Et si cette contribution est centrée sur l’enseignement en France, pour des questions de format et de compétence de son autrice, elle se veut une petite pierre dans une mise en perspective historico-didactique qui dépasserait les frontières de l’hexagone, et qui reste à élaborer.
Quand la narratologie est devenue hégémonique
Une comparaison entre des publications didactiques diverses (revues, ouvrages à destination des enseignants) et les premiers manuels de méthode montre que l’on passe très vite, dès les années 1980, d’un éclectisme théorique important (sémiotique, linguistique textuelle, narratologie) dans les premières propositions des revues de didactique à une hégémonie de la narratologie dans les manuels.
Les années 1970-1980, comme le soulignent tous les «acteurs de la scolarisation» interrogés, sont en effet des années de grands bouillonnements autour du «texte» et du «récit», devenus alors des concepts à part entière3: les théoriciens élaborent différentes théories du texte, du récit, du discours, etc. ; les pédagogues (qui ne sont pas encore des didacticiens) transposent pour la classe certaines de leurs théories dans les revues qui naissent alors (par exemple l’article emblématique de Halté et alii autour du Chat noir de Poe, dans le premier numéro de Pratiques, 1974) ou dans diverses publications à destination des enseignants (voir les ouvrages pionniers de Halté et Petitjean, Pratiques du récit, en 1977 ou celui de Dumortier et Plazanet, Pour lire le récit, en 1980). Or, ces premiers travaux qui cherchent à mettre à l’épreuve du réel des classes et des élèves les «pratiques textuelles […] inspirées du structuralisme» (pour reprendre les propos de Dumortier et Plazanet, 1980: 4), empruntent à une grande variété de théoriciens et de références théoriques, et visent à retravailler – sinon à articuler – la «sémiotique narrative» et les «élaborations théoriques émanant de la critique littéraire» (pour citer cette fois l’Avant-propos de Pratiques, 1977: 3). Les deux numéros de Pratiques consacrés au Récit (1976 et 1977) témoignent bien de cette forme d’éclectisme théorique, tant par la variété des auteurs cités dans les différents articles que par l’abondante bibliographie qui clôt le second numéro: élaborée par Yvan Darrault sous le titre «Sémiotique narrative. Éléments de bibliographie», elle ne compte pas moins de 114 références pour 60 auteurs différents… Dans les «entretiens», Jean-Michel Adam, Françoise Revaz et André Petitjean le soulignent d’ailleurs chacun à leur façon en revenant sur leur parcours: Adam rappelle comment son ouvrage sur le Texte narratif «replaçai[t] […] ces travaux narratologiques dans le cadre unifié de la linguistique textuelle» (Adam & Revaz 2023 : §26), Petitjean montre la cohérence des articles de Pratiques des années 1970-1980 qui mobilisaient des savoirs «à la croisée de la narratologie linguistique et de la linguistique textuelle» (Petitjean 2023 : §9). et Revaz se définit elle-même comme «narratologue-linguiste» (Adam & Revaz 2023: §46).
À côté de cette richesse théorique, synthétisée dès 1984 par la première édition du «Que sais-je ?» d’Adam sur le récit, dont la bibliographie divisée en rubriques («narratologie et poétique», «sémiotique», «énonciation», «linguistique textuelle» et «divers») témoigne elle aussi de cette pluri-référentialité, les ouvrages scolaires de ces années-là font un choix beaucoup plus restreint. Quelques manuels spécialisés – et sans doute davantage alors à destination des enseignants que des élèves, mais qui préfigurent ce que seront les manuels de «méthode» des décennies suivantes que j’analyserai ensuite – font une petite place à ces nouvelles approches autour de quelques concepts, essentiellement narratologiques. L’un des précurseurs est celui de Pagès et Pagès-Pindon (1984) qui intitulent un chapitre «Le récit» – dont la division en deux parties, fiction et narration, est d’inspiration très narratologique – et qui consacrent deux pages au «fonctionnement de la fiction» (essentiellement autour du schéma quinaire et des fonctions des personnages) et plus de trois pages au «fonctionnement de la narration» (essentiellement autour de l’ordre de la narration et du point de vue/focalisation4). Un autre manuel de cette fin des années 1980, les Techniques littéraires de Biet, Brighelli et Rispail (1988: 392 sqq.), se contente quant à lui de quelques notions narratologiques dans son chapitre sur «la lecture d’un roman ou le jeu du pacte»: distinction entre histoire et narration, entre récit diégétique et mimétique, et entre différents points de vue à partir d’une distinction des narrateurs qui conduit les auteurs à identifier 5 types de narrateurs (et 5 points de vue ?) différents. Cette même année, l’un des premiers manuels de méthodes à destination plus explicite des élèves5 (Crépin, Loridon et Pouzalgues-Damon, 1988: 77) propose une page sur les «personnages» et reformule le schéma actanciel de Greimas (en remplaçant «adjuvant» par «auxiliaire»).
Cette tendance ne fera que s’amplifier et la narratologie stricto sensu s’installe dans les années 1990 comme le cadre d’analyse hégémonique pour travailler le récit – et donc le roman – au lycée, au détriment des autres théories du texte et de la linguistique textuelle. Si l’on excepte le «schéma actanciel» (souvent renommé dans les manuels «fonctions des personnages», par exemple dans la collection chez Nathan), issu des travaux de Greimas mais annexé depuis à la narratologie (par exemple Lavergne, 1996), surnagent surtout pour la linguistique textuelle les «types de textes», inspirés de Jean-Michel Adam6. Mais ce travail sur les types de textes, bien présent dans les manuels des années 1990, où il fait généralement l’objet d’un chapitre distinct, disparait le plus souvent dans les éditions ultérieures, comme le montre par exemple l’évolution du manuel dirigé par Claude Éterstein et Adeline Lesot: un chapitre intitulé «Les types de texte», absent de l’édition de 1984, apparait dans celle de 1996 et disparait de la suivante, en 2000.
Les nouveaux outils privilégiés dans les chapitres «récit» ou «roman» des manuels de méthode des années 1980-1990 sont donc quasi exclusivement des concepts narratologiques, au détriment des autres cadres théoriques. Or, comme le dit Petitjean dans les entretiens, on peut en effet «d’autant plus regretter l’insuffisante articulation avec les Sciences du langage qu’elles sont un adjuvant incontournable pour l’analyse des récits» (André Petitjean 2023 : §14).
Statut de ces savoirs, entre disciplinaire, para- ou protodisciplinaire
Avant de voir plus précisément quels sont les outils narratologiques scolarisés dans les manuels et les publications à destination des enseignants depuis les années 1980, je me propose d’interroger tout d’abord le statut scolaire de la narratologie et des notions qui lui sont associées à partir d’une distinction inspirée de Chevallard (1991) entre savoirs disciplinaires (des notions à enseigner et à apprendre), savoirs paradisciplinaires (des notions outils) et savoirs protodisciplinaires (des prérequis). Je le ferai en suivant le fil des refontes des programmes depuis les années 1970, refontes rythmées par les alternances politiques et les changements de ministres. Comme on le verra, si le statut de la narratologie semble fluctuer au gré des programmes, il n’en va pas de même dans les manuels de méthode où il est remarquablement stable depuis des décennies.
Années 1980-2000: du disciplinaire au paradisciplinaire
Les années 1970-1980 sont des années de grand renouvèlement des programmes: de nouveaux textes (programmes et instructions) sont publiés suite aux «réformes Haby»7 (1977-1978 pour les classes de collège, et 1981 pour les classes de lycée) ; ils sont réécrits après l’accession de la gauche au pouvoir (1985 pour le collège, 1987-1988 pour le lycée). Mais contrairement aux manuels pionniers que j’ai évoqués ci-dessus (par exemple Pagès et Pagès-Pindon, 1984), il faut attendre les programmes de première de 1988 pour voir apparaitre explicitement, au milieu de catégories plutôt classiques («figures de style ou de rhétoriques», catégories «prosodiques», «dramaturgiques», ou de «stylistiques», «logiques» et «esthétiques»), quelques «catégories linguistiques8» (énonciation, locuteur, discours/histoire, etc.) et surtout «narratologiques»: «histoire, narration, récit ; temps de l’histoire ; temps du récit ; narrateur ; héros ; focalisation ; scène, sommaire, ellipse»9.
Toutes ces catégories se veulent explicitement au service de l’étude des textes, comme le souligne ce même texte officiel de 1988: «On exerce les élèves à employer exactement un certain nombre de catégories, concepts et termes efficaces pour l’analyse des textes». Elles sont plus particulièrement au service de la «lecture méthodique», longuement définie dans le programme de seconde de 1987 et qui veut «renforcer la scientificité de l’exercice [l’explication de texte], avec l’idée qu’une approche linguistique outillée permettra de lutter contre les inégalités scolaires» (Perret, 2020). Il s’agit donc d’étudier «méthodiquement» un texte, au moyen d’outils empruntés à divers champs de savoir – dont les savoirs issus de la linguistique ou des théories littéraires. Et de ce fait, les savoirs narratologiques deviennent dans cette décennie 1990 des savoirs disciplinaires à part entière, «construits» par des définitions précises, comportant des «propriétés» et des «occasions d’emploi», pour reprendre les propositions de Chevallard (1991 : 50). Ils font donc l’objet d’exercices dans les manuels, et l’édition 1988 (par exemple) du manuel de la collection Nathan co-écrit par Crépin, Loridon et Pouzalgues-Damon (1988: 69) comporte ainsi des définitions de l’intrigue (le schéma quinaire), la distinction temps de la fiction/temps de la narration, ainsi que des exercices d’application, selon la logique des exercices convergents (voir ci-dessus). Dans les années 1990, la plupart de ces savoirs narratologiques s’ancrent clairement dans les manuels de méthodes, qui proposent tous un petit outillage narratologique conforme aux programmes de 1987-1988. Le statut «disciplinaire» de ces notions ne fait pas de doute, comme en témoignent les «index de notions» ou les «glossaires» qui fleurissent dans ces ouvrages, et qui comportent de nombreuses notions narratologiques.
Lorsque les programmes sont à nouveau revus, en 2000-2001 pour les classes de lycée10, le statut de ces notions change: en effet, si aucune des notions narratologiques listées en 1987 n’apparait cette fois dans les programmes, les «documents d’accompagnement» de 2001 qui glosent généreusement les programmes11, intègrent plusieurs de ces notions, mais au détour d’un développement sur autre chose. Par exemple, les termes de «flash-back ou analepses», «anticipations ou prolepses» ou de «scènes, sommaires et ellipses» sont convoqués à propos du travail sur l’image mobile (2001: 85) ; quant au «point de vue», il est au centre d’un exercice écrit de transposition: «Transposer […] en faisant varier le mode de narration (modification du statut du narrateur, modification du point de vue)» (Ibid.: 93), mais ne fait pas l’objet d’un développement autonome. Les notions narratologiques sont ainsi clairement devenues dans les textes institutionnels des savoirs paradisciplinaires, qui «entrent dans le champ de perception didactique» de l’enseignant (Chevallard, 1991, p. 51) mais qui ne sont pas en tant que telles des notions à enseigner.
Après 2010: des savoirs quasi invisibles dans les textes institutionnels
En 2010, les textes institutionnels changent à nouveau12: outre les programmes, le ministère publie dans les années qui suivent via le site eduscol 13 ce qu’il appelle cette fois des documents «ressources» consacrés aux nouveaux objets d’étude. Si l’on regarde le programme et le document ressource le plus susceptible de convoquer la narratologie, celui qui correspond à l’objet d’étude «Le roman et la nouvelle au XIXe siècle: réalisme et naturalisme»14 (2012), on constate qu’aucune notion narratologique n’est mentionnée dans ces textes (pas même le point de vue). Plusieurs ouvrages du domaine sont pourtant en bibliographie du document ressource, mais pas nécessairement là où on les attendrait: l’ouvrage d’Adam et Petitjean sur le texte descriptif (1989/1998), celui d’Hamon sur le même sujet (1981) et les Figures II de Genette (1969) apparaissent en effet mais dans une rubrique intitulée «Pour accompagner l’étude de la langue», qui «vis[e] à mettre en évidence des questions de langue plus particulièrement liées à l’objet d’étude» (p. 14). C’est la stylistique qui est ici le champ théorique de référence explicitement convoqué pour travailler sur la «stylistique du récit réaliste» (p. 15), et qui constitue à son tour un domaine paradisciplinaire, au service de l’étude de la langue ; quant aux savoirs narratologiques, ils sont en quelque sorte annexés à la stylistique, et restent invisibles en tant que champ théorique autonome.
La dernière réforme des programmes (à ce jour)15, en 2019, réintroduit quelques notions narratologiques dans le programme, sans les référer particulièrement à un champ théorique spécifique: la présentation générale de «L’étude de la langue au lycée» indique ainsi «l’acquisition d’un vocabulaire technique permettant de décrire le fonctionnement de la langue et des discours, en particulier le discours littéraire» ; «ces connaissances linguistiques […] sont adossées à des termes (métaphore, adjectif, subordination, focalisation, assonance, etc.) dont elles proposent des définitions.» Certains objets d’étude sont également l’occasion d’évoquer le «système des personnages» (il s’agit de l’objet d’étude en seconde sur le théâtre et celui de première sur le roman et le récit). Mais si la focalisation semble timidement érigée en savoir disciplinaire (puisqu’il faut en proposer une définition), le «système des personnages» tout comme «l’analyse de la narration» (citée dans l’objet d’étude de première sur le roman et le récit) sont clairement quant à eux des savoirs paradisciplinaires. Dans tous les cas, ces notions ne sont ni référencées ni ancrées dans un champ théorique visible qui serait la narratologie. Elles sont même, dans le cas de la focalisation, noyées au milieu de notions éclectiques dans une liste fourre-tout qui ne permet guère de construire un cadre théorique cohérent.
Des savoirs devenus indésirables ?
Comment expliquer la disparition –moins de quinze ans après leur mise au programme explicite– des quelques notions narratologiques présentes dans les programmes de 1987-1988 ? Le passage d’un statut disciplinaire à un statut paradisciplinaire –voire à des formes de disparition– peut évidemment être justifié par le fait qu’au début du XXIe siècle, ces outils narratologiques sont devenus suffisamment ordinaires au lycée (notamment parce qu’ils sont également travaillés au collège) pour que l’on n’ait pas besoin de les mettre au programme ni de les lister. Peut-être même pourrait-on y voir des savoirs «protodisciplinaires» (de simples prérequis dont on n’a même plus besoin de rappeler l’existence aux enseignants) si d’autres indicateurs ne donnaient pas une vue d’ensemble un peu moins optimiste.
Il est difficile en effet de ne pas mettre cette disparition en lien avec différents phénomènes, qui ne favorisent pas particulièrement les approches narratologiques. Sur un plan institutionnel, un recentrage de plus en plus net des textes officiels s’est d’abord effectué vers des approches d’histoire littéraire, perceptibles déjà dans le programme de 2000-2001, et que Petitjean et Viala justifient dans un numéro de Pratiques entièrement dédié à la réforme des programmes16. À cela s’ajoute à partir de 2006 un autre recentrage – plus idéologique – vers une conception plus patrimoniale de la littérature. Il n’est pas possible ici de faire une analyse exhaustive de la réécriture des programmes après 2001. Mais le passage par exemple de l’objet d’étude «Démontrer, convaincre et persuader» (en 2001) à «Genres et formes de l’argumentation: XVIIe et XVIIIe siècle» (en 2010) puis à «La littérature d’idées et la presse du XIXe au XXIe siècle» (en 2019) peut donner une idée du glissement – et du recadrage vers des corpus plus littéraires – qui s’opère. Peut-être n’est-il pas inutile non plus de souligner qu’après les programmes de 2000-2001, écrits sous un gouvernement de gauche, les refontes successives ont toutes été le fait de ministres de droite17.
Par ailleurs, comme le souligne Reuter (2000: 7), les critiques qui se multiplient à la fin des années 1990 viennent «aussi bien de la part de théoriciens que de formateurs ou d’enseignants». Certaines de ces critiques, à l’intérieur du champ de la didactique du français, portent sur la «transposition» de ces objets (Nonnon, 1998a), sur le risque de création d’«artéfacts» (Nonnon, 1994), sans forcément remettre en cause les «bénéfices indéniables» que liste notamment Reuter (2000: 11). Mais pointent également en ce début des années 2000 des critiques issues de la «didactique de la littérature» en train de se constituer alors comme champ de recherche spécifique, autour de la littérature envisagée «comme discours spécifique» et «comme objet à penser dans sa spécificité» (Daunay, 2007: 149). C’est ainsi que dans l’ouvrage issu d’un colloque tenu en 1998 à Toulouse sur les enjeux didactiques des théories du texte18, Marie-José Fourtanier et Gérard Langlade (2000: 9) dénoncent les «catalogues de notions hétéroclites à faire acquérir» et l’ «euphorie didactisante» qui conduit «à la morcellisation des savoirs et au technicisme stérile», posant une question (Ibid.: 10) toute rhétorique qui sera l’un des fils directeurs de la plupart de leurs travaux à venir19:
Paradoxalement, une construction méthodique de savoirs ne risque-t-elle pas d’éloigner les élèves de l’expérience de lecture et de la dynamique interprétative que les savoirs ont pour vocation de servir?
Si les textes officiels pour le lycée n’ont encore jamais fait une place explicite à la notion de «sujet lecteur» (Rouxel et Langlade, 2004) qui émerge au début du XXIe siècle20, des échos sont pourtant perceptibles dans certains programmes, comme ce passage du programme de première de 2010 concernant l’objet d’étude «Le personnage de roman», où il semble clair qu’entre narratologie (jamais convoquée ici) et subjectivité du lecteur (reformulée ici avec un mélange d’ancien – l’admiration – et de moderne – l’émotion –), le texte institutionnel penche du côté de la «relation personnelle au texte», opposant d’ailleurs clairement «relation personnelle» et «analyse méthodique»:
Le fait de s’attacher aux personnages permet de partir du mode de lecture qui est le plus courant. On prête une attention particulière à ce que disent les romans, aux modèles humains qu’ils proposent, aux valeurs qu’ils définissent et aux critiques dont ils sont porteurs.
Dans cette appréhension de l’univers de la fiction, on n’oubliera pas que la découverte du sens passe non seulement par l’analyse méthodique des différents aspects du récit qui peuvent être mis en évidence (procédés narratifs et descriptifs notamment), mais aussi par une relation personnelle au texte dans laquelle l’émotion, le plaisir ou l’admiration éprouvés par le lecteur jouent un rôle essentiel.
Une petite recherche sur eduscol21 semble également confirmer cette analyse: le moteur de recherche indique 20 résultats pour la requête «sujet lecteur», et aucun pour «narratologie»…
Des savoirs disciplinaires incontournables dans les manuels
La situation de la narratologie dans les manuels est très différente. Malgré ce relatif silence (mépris ?) des textes institutionnels et ces prises de position critiques venues de contrées très diverses du champ didactique, les manuels de méthode parus entre 2000 et 2019 font de certains outils narratologiques de véritables savoirs disciplinaires, avec des définitions précises, des exercices pour s’exercer à leur emploi, et ne les oublient pas dans les index, glossaires ou lexiques de fin d’ouvrage. Avant de détailler les notions en jeu (je le fais ci-dessous), il faut souligner que tous les manuels de mon corpus entre 2000 et 2019 réservent des pages entières au travail sur le récit et sur la description, avec de nombreuses «leçons» et de nombreux exercices. Ce qui peut varier, ce sont les chapitres dans lesquels ces notions sont mises en œuvre: je prendrai l’exemple de trois éditions des ouvrages dirigés chez Bordas par Denis Labouret, en 2001, 2004 et 2011. L’édition 2001 propose deux chapitres très narratologiques («28. Qui raconte ? Qui voit ? Les modes de narration», p. 182, et «29. Les composantes de l’action romanesque», p. 190), comportant chacun 3 pages de leçon et 5 pages d’exercices, dans une partie consacrée aux «genres littéraires». L’édition suivante, en 2004, se contente d’une «fiche méthode» d’une page pour «les composantes du récit» (p. 187), suivie de 4 pages d’exercices, dans un chapitre sur «le roman et la nouvelle». Quant à l’édition 2011, elle regroupe «Récit et narration» (p. 209) dans une partie à nouveau plus «méthodologique» intitulée «Les outils d’analyse: langue et discours». Récit, narration, discours narratif, genre narratif, roman, c’est l’objet de l’analyse (et donc le savoir littéraire visé) qui fluctue plus que les outils (narratologiques) de cette analyse.
Quels outils pour quels usages ?
Pour analyser les outils narratologiques scolarisés, je me centrerai sur les ouvrages scolaires puisque, comme je l’ai montré ci-dessus, très peu de notions narratologiques ont été explicitement mises au programme par les textes officiels. Je les analyse ci-dessous par ordre de fréquence dans le corpus de manuels de méthodes, et je m’intéresse à la fois à leur fréquence et aux usages qu’on en fait.
Dans l’ensemble de mon corpus et pour toutes les périodes considérées, la notion la plus présente est – sans surprise – celle des points de vue. La notion est relativement stabilisée même si la plupart des manuels hésitent souvent entre «point de vue» et «focalisation» ou proposent la double dénomination «point de vue/focalisation»: dans près des trois quarts des manuels, les deux termes sont en effet donnés comme synonymes, et Éterstein et Lesot (1995: 134) sont les seuls à ajouter comme terme équivalent une troisième notion, les «modes de vision». Depuis le milieu des années 1990, tous les manuels consacrent un point plus ou moins important à cette notion, selon la typologie de Genette. L’évolution de la collection Nathan reflète bien cette institutionnalisation de la notion. La plus ancienne édition (1988) reformule les catégories de Genette à sa façon, en proposant (sous une courte rubrique de bas de page «Le lecteur et la découverte des personnages») les trois types suivants: «La découverte “de l’intérieur”» ; «la découverte “de l’extérieur”» et «le lecteur suit le personnage à la fois “de l’intérieur et de l’extérieur”» ; l’édition suivante (1992) ajoute juste une petite parenthèse après chacune de ces trois catégories: «focalisation interne», «externe» et «zéro» ; mais l’édition de 1996 s’aligne sur les manuels concurrents en consacrant cette fois une double page au «Point de vue dans un récit», et selon des formulations bien plus canoniques.
L’usage de la notion mériterait sans doute à elle seule un article (voir sur ce sujet Nonnon, 1998b, Paveau, 1992 et Paveau et Pecheyran, 1995). Je me contenterai d’esquisser quelques remarques. Il faut tout d’abord noter que le travail sur le point de vue se trouve, selon les manuels, dans différents chapitres, l’énonciation, le récit, le roman, le personnage ou la description, ce qui induit des exercices et des objectifs un peu différents. Mais le support des exercices est quant à lui beaucoup plus homogène puisque dans la plupart des manuels, à toutes les périodes, le travail sur le point de vue porte majoritairement sur des textes du XIXe siècle: sur les 168 textes supports d’exercices autour des points de vue de l’ensemble du corpus de manuels, près de 60 % sont des textes du XIXe siècle, contre à peine un tiers du XXe siècle (l’auteur le plus représenté est ici Camus, avec 15% des extraits du XXe siècle) ; la présence de textes d’autres siècles est quasi anecdotique, de l’ordre de 2 à 3 % pour les XVIIe et XVIIIe siècle. Il faut juste noter pour le XVIIe siècle la surreprésentation de Mme de La Fayette, qui compte à elle seule 4 des 6 extraits du siècle… Et si l’on regarde les auteurs du XIXe siècle supports d’exercices, la sélection est encore plus nette: un quart des textes du XIXe siècle sont extraits d’œuvres de Flaubert ; Stendhal et Zola fournissent chacun près de 20 % des textes, suivis par Balzac (14 %) et Hugo (7 %). Le travail sur le point de vue est donc majoritairement un travail sur le roman du XIXe siècle, et même sur une petite partie de la production romanesque du siècle, celle qui est la plus facilement compatible avec ces questions, dans la mesure où ces auteurs ont justement contribué à l’histoire de la subjectivisation du récit (Philippe et Piat, 2009: 135). Il est tentant de reprendre à ce sujet les mots de Nonnon (1998a: 156) à propos de la transposition des savoirs théoriques: «l’exemple est une théorie incarnée, les notions prennent corps dans des tâches et des exemples-types».
La seule notion capable de rivaliser avec le «point de vue» est celle de «narrateur». Mais si elle est présente dans tous les manuels du corpus depuis 1984, elle est diversement traitée et c’est une des notions dont les usages sont sans doute les plus variés: dans certains manuels relativement anciens, elle est construite autour de la distinction auteur/narrateur (par exemple Klein, 1998: 119-120, qui travaille ainsi la distinction «histoires vraies» et «fictions») ; mais le plus souvent, elle est traitée dans les «modes de narration» qui permettent de distinguer «narrateur-personnage», «narrateur qui raconte à la 3e personne», «narrateur invisible» (par exemple collection Nathan, 1996), quand elle n’est pas associée aux «points de vue» (par exemple Sabbah, 2008).
«Point de vue» et «narrateur» sont les seules notions incontournables. Mais elles sont suivies de près par celle de «rythme du récit», présente dans les trois quarts des manuels, à toutes les époques, certains manuels définissant même précisément des notions comme «pause», «sommaire», «scène» (11 sur 23 pour scène/sommaire), «ellipse» mais aussi «ralenti» ou «digression» (par exemple Klein, 2000: 177). Ce point est d’ailleurs intéressant, puisque scène/sommaire/ellipse font partie des quelques notions narratologiques explicitement mises au programme de 1988 à 2000: or, seulement 2 manuels sur les 6 du corpus parus entre 1992 et 1999 les définissent plus spécifiquement, alors qu’elles sont définies dans près de la moitié des manuels du corpus parus depuis 2000. La scolarisation de la narratologie suit clairement son propre chemin dans les manuels, qui n’est pas toujours parallèle à celui des textes institutionnels.
Viennent ensuite le «schéma narratif» et les «fonctions des personnages», tous deux présents dans près de 65 % des manuels, avec une grande stabilité dans la présentation. Seules certaines éditions de la collection Nathan se distinguent (par exemple Pouzalgues-Damon et alii 2004: 171) en expliquant la différence entre «intrigue simple» (les «cinq étapes successives qu’on appelle le schéma narratif») et «intrigue complexe» («de nombreux épisodes, constituant chacun une séquence narrative, se combinent entre eux»). Peut-être faut-il voir là une volonté de complexifier pour les élèves de lycée une notion déjà bien présente au collège ? Cette présentation se retrouve dans une édition plus récente (2011: 115), avec la disparition de l’expression «schéma narratif» au profit de «séquence narrative» («L’histoire se décompose en cinq étapes qui forment une séquence narrative») et la subdivision des intrigues complexes en «enchainement» ou «enchâssement» des séquences narratives. Pour ce qui est des «fonctions des personnages», il est notable qu’elles n’apparaissent en revanche dans aucun des trois manuels de 2019 et 2020 que j’ai consultés, alors même que deux d’entre eux lui faisaient une place dans de précédentes éditions (Labouret et collection Nathan). Les derniers programmes, très centrés sur l’histoire littéraire, sont sans doute moins propices à des approches de ce type.
Il faut enfin faire un sort aux questions tenant à l’ordre du récit, présentes dans près de 60 % des manuels à toutes les périodes, mais qui sont sans doute celles qui sont traitées de la manière la plus hétérogène: les notions sont ici présentées de manière plus ou moins détaillée et à travers une terminologie qui recourt rarement aux termes de prolepse et analepse mais plus souvent à des reformulations comme flashback, retour en arrière ou anticipation (par exemple Pagès, 2004: 53).
Une dernière remarque s’impose lorsque l’on parcourt tous les exercices proposés pour travailler toutes ces notions narratologiques: les manuels de méthode dans leur grande majorité spécialisent le champ de la narratologie à l’étude des seuls textes littéraires, avec quelques exceptions pour de rares incursions dans le domaine de la bande dessinée (par exemple une analyse de quelques cases de La Marque jaune d’Edgar P. Jacobs dans le Nathan, 2004: 55). Si l’on compare avec les premiers travaux à destination des enseignants (ceux de la revue Pratiques par exemple), la différence est grande: en effet, ces travaux ne se contentaient pas de scolariser de nouveaux concepts et de nouveaux modes d’analyse des textes, mais ils ouvraient en même temps le corpus des textes étudiés, pour ne pas le cantonner aux seuls textes classiques. En témoignent par exemple les sommaires des deux numéros Récit que j’ai déjà évoqués (Pratiques, 1976 et 1977), qui portent sur des genres de textes très divers: des contes populaires, un roman policier (Arsène Lupin) et un de science-fiction, une BD (Astérix et Obélix), des nouvelles (Mérimée, Buzzati) et des récits de presse. Au contraire, l’usage scolaire de la narratologie dans les manuels, à toutes les périodes, se limite non seulement à l’étude de textes, mais aux textes littéraires – ce qui d’une part est conforme à la culture disciplinaire au lycée, organisée essentiellement autour de la littérature, mais qui d’autre part correspond également, comme le montre Raphaël Baroni (2017a), à une conception étroite du récit chez certains narratologues, et notamment Genette. Rien d’étonnant donc que Genette reste à l’école le narratologue le plus utilisé: c’est celui dont les conceptions théoriques rencontrent le mieux les objets et les finalités de la discipline.
Conclusion
En 1970, analysant le traité de Fontanier qui venait d’être réédité (Fontanier, 1968), Gérard Genette regrettait que «l’histoire de la rhétorique [soit] celle d’une restriction généralisée»22. Sans doute aurait-il pu appliquer ce propos à l’histoire scolaire de la narratologie, que l’on pourrait lire également comme celle d’une «restriction généralisée»: restriction des concepts mobilisés, restriction à la littérature, voire à une part limitée de la littérature, restriction à des usages parfois un peu myopes et technicistes. Mais on ne saura jamais comment Genette voyait la scolarisation de la narratologie: s’il a beaucoup influencé les pratiques scolaires, il s’est en revanche peu intéressé, du moins dans ses écrits publics, à l’école de son temps et au devenir scolaire de son travail23 , au contraire de Jean-Michel Adam (Adam & Revaz 2023) ou – différemment et sur un mode rétrospectif en forme d’autoflagellation –, de Tzvetan Todorov dans son petit opuscule au titre pessimiste, La littérature en péril (2007).
Cela dit, au-delà de ce constat de restriction qu’il est sans doute possible en effet de faire, il faut aussi souligner à quel point la narratologie – ou du moins quelques-uns de ses concepts phares – est devenue incontournable dans les manuels de méthode qui cherchent à «outiller» les élèves dans leur travail sur les textes. Certes, cela se fait au prix d’une forme de syncrétisme avec d’autres approches: la «boite à outils» narratologique n’est pas isolée ni réellement autonome, et ce syncrétisme est sans doute source de confusion théorique. Mais il est aussi le signe d’une forme de banalisation de la narratologie, que les accusations de formalisme et les critiques en tout genre n’ont pas véritablement ébranlée, et qui poursuit son chemin dans les manuels quelle que soit la place que lui font les textes institutionnels. À l’école, la narratologie est loin d’être «moribonde»24, même si le «figement» que pointait Reuter en 2000 reste sans doute d’actualité. Le prochain chantier théorique est donc celui de sa «rénovation» souhaitée par les narratologues contemporains et la narratologie «postclassique» (Baroni, 2017b Patron, 2018). Mais c’est là une autre aventure…
Bibliographie
Dossier «Entretiens avec les acteurs de la scolarisation»
Dossier : «Entretiens avec les acteurs de la scolarisation», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/categories/view/entretiens
Jean Michel Adam & Françoise Revaz, «Témoignage», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-michel-adam-et-de-francoise-revaz
Jean-Paul Bronckart, «Témoignage», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-paul-bronckart
Jean-Louis Dumortier, «Témoignage», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-jean-louis-dumortier
André Petitjean, «Témoignage», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-andre-petitjean
Yves Reuter, «Témoignage», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-yves-reuter
Claude Simard, «Témoignage», in «Conversations critiques», Transpositio, 2023. En ligne, URL : https://www.transpositio.org/articles/view/temoignage-de-claude-simard
Ouvrages et articles
Adam, Jean-Michel (2005), «La notion de typologie de textes en didactique du français: une notion “dépassée” ?», Recherches n° 42, p. 11-23. En ligne, consulté le 2 juin 2023, https://www.revue-recherches.fr/wp-content/uploads/2014/06/42_011-023__adam_.pdf
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, PUF.
Adam, Jean-Michel et Petitjean, André (1989), Le texte descriptif, Paris, Nathan.
Baroni, Raphaël (2021), «Perspective narrative, focalisation et point de vue: pour une synthèse», Fabula-LhT, n° 25, en ligne, consulté le 28 aout 2023, URL: http://www.fabula.org/lht/25/baroni.html, DOI: https://doi.org/10.58282/lht.2647
Baroni, Raphaël (2017a), «Pour une narratologie transmédiale», Poétique,n° 182,p. 155-175. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: https://www.cairn.info/revue-poetique-2017-2-page-155.htm, DOI: https://doi.org/10.3917/poeti.182.0155
Baroni, Raphaël (2017b), Les rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël et Dufays, Jean-Louis (2020), «Narratologie», in N. Brillant Rannou et alii (dir.), Un dictionnaire de didactique de la littérature, Paris, Champion, p. 83-85.
Chevallard, Yves (1991), La transposition didactique (2e édition), Grenoble, La Pensée Sauvage.
Daunay, Bertrand (2007), «État des recherches en didactique de la littérature», Revue Française de Pédagogie, n° 159, p. 139-189. En ligne, consulté le 14 novembre 2020, URL: https://journals.openedition.org/rfp/1175, DOI : https://doi.org/10.4000/rfp.1175
Denizot, Nathalie (2021), La culture scolaire: perspectives didactiques, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux.
Denizot, Nathalie (2016), «Le manuel scolaire, un terrain de recherches en didactique ? L’exemple des corpus scolaires», Le français aujourd’hui, n° 194, p. 35-44. En ligne, consulté le 14 novembre 2020, URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2016-3-page-35.htm; DOI: https://doi.org/10.3917/lfa.194.0035
Denizot, Nathalie (2015), «L’exercice dans l’enseignement de la littérature», in C. Masseron, J.-M. Privat et Y. Reuter (dir.), Littérature, linguistique et didactique du français. Les travaux Pratiques d’André Petitjean, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, p. 107-115.
Douay-Soublin, Françoise (1990), «Non, la rhétorique française, au XVIIIe siècle, n’est pas “restreinte” aux tropes», Histoire Épistémologie Langage, tome 12, fascicule 1, p. 123-132. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: https://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_1990_num_12_1_2310; DOI: https://doi.org/10.3406/hel.1990.2310
Doubrovsky, Serge et Todorov, Tzvetan (1971), L’enseignement de la littérature, Paris, Plon.
Dumortier, Jean-Louis et Plazanet, Françoise (1981), Pour lire le récit, Bruxelles-Paris, Gembloux-De Boeck-Duculot.
Fontanier, Pierre (1968), Figures du discours, Paris, Seuil.
Fourtanier, Marie-José et Langlade, Gérard (dir.) (2000), Enseigner la littérature, Paris/Toulouse, Delagrave et CRDP Midi Pyrénées.
Genette, Gérard (2006), Bardadrac, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1970), «La rhétorique restreinte», Communications n° 16, p. 158-1714. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1970_num_16_1_1234 ; DOI: https://doi.org/10.3406/comm.1970.1234
Genette, Gérard (1969), Figures II, Paris, Seuil.
Halté, Jean-François, Martin, M., Michel, Raymond et Petitjean, André (1974), «Essai d’analyse structurale du "Chat noir" d’E.A. Poe. Pour une application pédagogique», Pratiques, n° 1-2, p. 5-28. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1974_num_1_1_897 ; DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1974.897
Halté, Jean-François et Petitjean, André (1977), Pratiques du récit, Paris CEDIC.
Hamon, Philippe (1981), Introduction à l’approche du descriptif, Paris, Hachette.
Langlade, Gérard (2010), «La didactique de la littérature entre corpus et théories», in B. Louichon et A. Rouxel (dir.), Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 153-163.
Lavergne, Gérard (1996), «Petit précis de narratologie», Cahiers de Narratologie n° 7, en ligne, consulté le 08 juin 2023. URL: http://journals.openedition.org/narratologie/11769 ; DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.11769
Nonnon, Élisabeth (1998a), «Quelle transposition des théories du texte en formation des enseignants ?», Pratiques, n° 97-98, p. 153-170. En ligne, consulté le 5 juillet 2023,URL: www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1998_num_97_1_2484; DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1998.2484
Nonnon, Élisabeth (1998b), «La notion de point de vue dans le discours», Pratiques, n° 100, p. 99-123. En ligne, consulté le 5 juillet 2023. URL: www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1998_num_100_1_1855; DOI: https://doi.org/10.3406/prati.1998.1855
Nonnon, Élisabeth (1994), «Ordre de l’homogène et cohérences dans la diversité: niveaux de cohérence dans les pratiques didactiques du récit au collège», Recherches, n° 20, p. 145-179. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: https://www.revue-recherches.fr/wp-content/uploads/2016/08/145_Nonnon_R20_version-site.pdf
Patron, Sylvie (dir.), Introduction à la narratologie postclassique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Paveau, Marie-Anne (1992), «Le point de vue des manuels», Le français aujourd’hui, n° 98, p. 36-39.
Paveau, Marie-Anne et Pecheyran, Isabelle (1995), «Focalisations: lectures de Genette et pratiques scolaires», Le français aujourd’hui, n° 109, p. 73-83.
Perret, Laetitia (2020), «L’explication de texte et ses avatars: des exercices en tension dans les programmes», Pratiques, n° 187-188. En ligne, consulté le consulté le 21 juillet 2021. URL: http://journals.openedition.org/pratiques/8812 ; DOI: https://doi.org/10.4000/pratiques.8812
Petitjean, André et Viala, Alain (2000), «Les nouveaux programmes de français au lycée», Pratiques n° 107-108, p. 7‑33. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2000_num_107_1_1893 ; DOI: https://doi.org/10.3406/prati.2000.1893
Philippe, Gilles et Piat Julien (2009), La langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard.
Pratiques (1977), n° 14, Récit (2). En ligne, consulté le 5 juillet 2023, URL: www.persee.fr/issue/prati_0338-2389_1977_num_14_1
Pratiques (1976), n° 11/12, Récit (1). En ligne, consulté le 5 juillet 2023, URL: www.persee.fr/issue/prati_0338-2389_1976_num_11_1
Pratiques (1974), n° 1/2. En ligne, consulté le 5 juillet 2023, URL: https://www.persee.fr/issue/prati_0338-2389_1974_num_1_1
Reuter, Yves (2000), «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», Repères n° 21, p. 7-22. En ligne, consulté le 2 juin 2023, URL: https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_2000_num_21_1_2325 ; DOI: https://doi.org/10.3406/reper.2000.2325
Rouxel, Annie et Langlade, Gérard (2004), Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, PUR.
Todorov, Tzvetan (1972), «Texte», in O. Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, p. 375-382
Corpus de manuels
Abensour, C. et Dumaître, M.-H. (dir.) (2019), Français 1ère. Langue et méthodes, Paris, WebLettres, Le Robert.
Amon, E. et Bomati, Y. (2000), Méthodes et pratiques du français au lycée, Paris, Magnard.
Armingaud, S., Desaintghislain, C., Hébert, S., Morisset, C., Wald Lasowski, P. (2016), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan]
Berthelier, M. (dir.) (2007), Français Méthodes 2de et 1ère, Paris, Hachette.
Berthelier, M. (dir.) (2004), Français Méthodes 2de et 1ère, Paris, Hachette.
Berthelier, M. (dir.) (2002), Français 1ère. Méthodes pour le bac, Paris, Hachette.
Bertrand, D., Desaintghislain, C., Hébert, S., Lequette, D., Morisset, C., Pouzalgues-Damon, É., Wald Lasowski, P. (2011), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan»]
Biet, C., Brighelli, J.-P., Rispail, J.-L. (1988), Littérature 2. Techniques littéraires, Paris, Magnard.
Crépin, F., Desaintghislain, C., Pouzalgues-Damon, E. (1996), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan»]
Crépin, F., Loridon, M., Pouzalgues-Damon, E. (1992), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan»]
Crépin, F., Loridon, M., Pouzalgues-Damon, E. (1988), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan»]
Éterstein, C. et Lesot, A. (2000), Les nouvelles pratiques du français, Paris, Hatier.
Éterstein, C. et Lesot, A. (1995), Les techniques littéraires au lycée, Paris, Hatier.
Éterstein, C. et Lesot, A. (1986). Pratique du français, Paris: Hatier
Éterstein, C., Lesot A., Dauvin S., Dauvin J., Éterstein C. et Aguettaz F. (2001), Les nouvelles pratiques du français. Première, Paris, Hatier.
Klein, C. (dir.) (2000), Littérature et langage, Paris, Hachette.
Klein, C. (dir.) (1998), Mieux lire, mieux écrire, mieux parler. Méthode pour les lycées, Paris, Hachette.
Labouret, D. (dir.) (2019), Le français au lycée, Paris, Bordas.
Labouret, D. (dir.) (2011), Français. Méthodes et pratiques, Paris, Bordas.
Labouret, D. (dir.) (2004), Français. Méthodes et pratiques, Paris, Bordas.
Labouret, D. et Meunier, A. (dir.) (2001). Méthodes du français. Seconde. Première, Paris: Bordas.
Labouret, D. et Meunier, A. (1995). Les méthodes du français au lycée, Paris: Bordas.
Pagès, A. (dir.) (2004), Français. Méthodes et activités, Paris, Nathan.
Pagès, A. et Pagès-Pindon, J. (1984), Le français au lycée. Manuel des études françaises (nouvelle édition conforme aux instructions de 1983 pour le baccalauréat), Paris, Nathan.
Pouzalgues-Damon, É., Desaintghislain, C., Morisset, C. et Wald Lasowski, P. (2007), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan»]
Pouzalgues-Damon, É., Desaintghislain, C., Morisset, C. et Wald Lasowski, P. (2004), Français. Méthodes et techniques, Paris, Nathan. [Appartient à ce que je nomme «collection Nathan»]
Sabbah, H. (2008), Le français méthodique, Paris, Hatier
Sabbah, H. (2004), Le français méthodique, Paris, Hatier
Sabbah, H. (1999), Le français méthodique au lycée, Paris, Hatier.
Sivan, P. (dir.) (2011), Français. Méthodes, Paris, Nathan
Sivan, P. (dir.) (2007), Français. Méthodes, Paris, Nathan
Pour citer l'article
Nathalie Denizot, "L'aventure scolaire de la narratologie", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/l-aventure-scolaire-de-la-narratologie
Voir également :
Situation et perspectives de l’étude du récit dans les classes de français aujourd’hui
L’objet de cet article est double.
Il s’agit d’abord de poser un regard sur la place qui est accordée actuellement à l’étude du récit dans l’enseignement obligatoire dans les pays francophones. Au départ des données de la recherche «Gary» (Brunel, Dufays, Emery-Bruneau et Florey, à paraitre), j’essaierai d’indiquer comment, à trois niveaux scolaires différents, les enseignants belges, français, québécois et suisses concernés par l’étude exploitent les aspects du texte narratif lorsqu’ils conduisent une séance d’étude sur une nouvelle et quelles opérations de lecture ils y associent.
Situation et perspectives de l’étude du récit dans les classes de français aujourd’hui
Introduction
L’objet de cet article est double.
Il s’agit d’abord de poser un regard sur la place qui est accordée actuellement à l’étude du récit1 dans l’enseignement obligatoire dans les pays francophones. Au départ des données de la recherche «Gary» (Brunel, Dufays, Emery-Bruneau et Florey, à paraitre), j’essaierai d’indiquer comment, à trois niveaux scolaires différents, les enseignants belges, français, québécois et suisses concernés par l’étude exploitent les aspects du texte narratif lorsqu’ils conduisent une séance d’étude sur une nouvelle et quelles opérations de lecture ils y associent2. Je m’attacherai également à montrer les liens qui peuvent être établis entre ces choix didactiques et les performances de lecture des élèves, qui ont été mesurées juste avant l’observation des pratiques de leurs enseignants3.
En second lieu, et beaucoup plus rapidement, j’ébaucherai une réflexion prospective basée sur ce que, compte tenu de l’enquête précitée et d’autres observations que j’ai pu faire en tant que chercheur et formateur d’enseignants, je perçois comme des priorités aujourd’hui en ce qui concerne l’étude du récit en classe de français.
1. Quels sont les aspects du texte narratif travaillés par les enseignants au fil de la scolarité?
1.1. Le projet Gary en deux mots
Le projet Gary est un projet de recherche international qui a impliqué une dizaine de chercheurs pendant sept ans (2015-2021) et s’est dédié à analyser et à mettre en relation les performances de lecture de 1987 élèves et les pratiques de leurs 69 enseignants à trois niveaux scolaires, en l’occurrence les niveaux 4, 7 et 10, correspondant aux élèves de 9, 12 et 15 ans. Deux ensembles de données ont été recueillies au départ: les réponses écrites des élèves à trois questions qui leur ont été soumises à la suite de la lecture autonome et silencieuse, en classe, de la nouvelle de Romain Gary «J’ai soif d’innocence» (ils disposaient pour cela de 50 minutes); et les films et les verbatims des séances (d’environ 50 minutes également) que les enseignants ont ensuite animées à propos de ce texte, en procédant comme ils le souhaitaient. Ces données ont fait l’objet de différents codages interjuges qui ont permis d’analyser finement d’une part les performances des élèves en ce qui concernait la compréhension, l’interprétation et l’appréciation du texte, et d’autre part les choix de leurs enseignants en ce qui concernait la guidance de ces mêmes opérations de lecture, les schèmes transversaux d’organisation du travail, les gestes didactiques mis en œuvre, les genres d’activité scolaire mobilisés et les aspects du texte narratif analysés. Sur la base des données ainsi traitées, les deux premiers volets de la recherche sont, logiquement, consacrés à l’étude des performances des élèves et des pratiques de leurs enseignants, et plus précisément à la mise en évidence de leur évolution au fil des niveaux ainsi qu’aux comparaisons internationales. Un troisième volet s’intéresse ensuite aux deux types de relations qui peuvent être établies entre ces deux ensembles: d’un côté les enseignants s’adaptent au niveau de leurs élèves, de l’autre les performances des élèves sont influencées par les pratiques habituelles de leurs enseignants.
Dans la présente contribution, seule est analysée la dernière dimension des pratiques d’enseignement, à savoir la place accordée dans les séances aux divers aspects du texte narratif.
1.2. Analyse au fil des niveaux
Les aspects du texte narratif constituent un ensemble hétérogène où ont été rassemblés à la fois les contenus diégétiques (construction narrative4, chute, personnages, relations entre eux, oppositions, cadre spatiotemporel, objets), les dimensions proprement narratives (narrateur, leçon ou morale, valeurs, référents culturels), les dimensions langagières et rhétoriques (titre, champs lexicaux, énonciation, éléments linguistiques) et les aspects extratextuels (auteur) susceptibles d’être thématisés dans les séances. Bien sûr, ces différentes catégories sont largement poreuses et le choix d’affecter une partie de verbatim à l’une plutôt qu’à l’autre peut être sujet à discussion. Si l’on considère en outre le nombre des catégories concernées, on comprendra que cette focale se soit avérée la plus complexe à coder. Il reste que le codage interjuge, qui a permis de lisser les éventuels désaccords interprétatifs, débouche sur un résultat assez clair dont atteste le graphique ci-dessous.
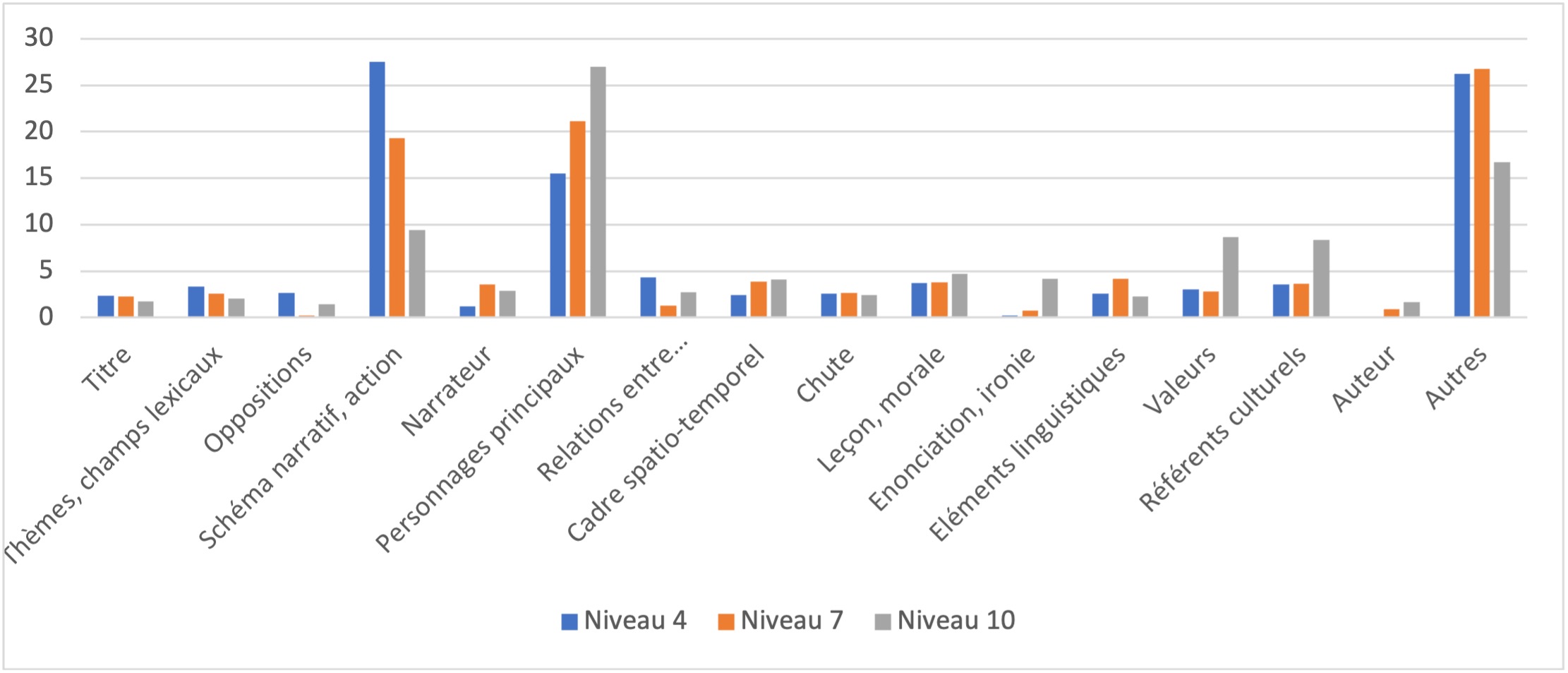
Graphique 1. Proportions de temps passé sur les 16 aspects du texte par niveaux (tous pays confondus)
L’analyse statistique nous révèle de claires convergences: même si leur part varie au fil des niveaux, certains aspects textuels sont privilégiés par les enseignants au sein des trois niveaux étudiés. En l’occurrence, trois d’entre eux sont mobilisés en priorité:
- - la construction narrative, qui représente plus d’un quart du temps d’enseignement des séances de niveau 4 (28 %), mais perd nettement de son importance au fil des niveaux (19 % au niveau 7 et 9 % au niveau 10)5;
- - dans un mouvement inverse, le prisme des «personnages», utilisé 16 % du temps par les enseignants de niveau 4 et 21 % au niveau 7, s’impose comme l’aspect du texte le plus abordé au niveau 10 (27 %)6;
- - enfin, la catégorie «autres», qui rassemble une série d’éléments hétéroclites ne pouvant être classés dans les autres colonnes, se montre très présente aux niveaux 4 et 7 (26 % et 27 %), mais chute assez nettement au niveau 10 (17 %).
À la suite des observations de Ronveaux et Schneuwly (2018), on pourrait lire dans ces variations la manifestation d’un «formatage» progressif de la séance de lecture de texte littéraire, qui irait de pair avec une centration sur des connaissances scolaires instituées (linguistiques, narratologiques…), au détriment du recours à d’autres instruments de lecture, plus proches de la vie quotidienne et du vécu des élèves et de l’enseignant.
La situation est moins claire en ce qui concerne les catégories les moins souvent mobilisées. Quelques éléments saillants peuvent être soulignés cependant. La rubrique «énonciation» est très peu représentée, surtout aux niveaux 4 et 7 (0,2 % et 0,7 %), de même que les passages abordant la question de l’«auteur» (0,1 % au niveau 4 ; 1 % au niveau 7; 2 % au niveau 10). En outre, la catégorie «référents culturels», qui représente 4 % du temps des verbatims de niveaux 4 et 7, passe à un remarquable 8 % au niveau 10. Cette observation, croisée à celles que nous avons formulées plus haut et aux conclusions de Ronveaux et Schneuwly (2018), renforce l’hypothèse selon laquelle le texte, au fil de la scolarité, serait traité de moins en moins comme un support à l’exercice de compréhension narrative linéaire et de plus en plus comme une occasion d’enrichir sa culture générale et théorique. Le travail de reconstitution de la logique du récit, qui est privilégié aux niveaux 4 et 7, serait donc perçu comme un préalable permettant, au niveau 10, de s’intéresser davantage à d’autres dimensions.
1.3. Comparaison internationale
Comme on va le constater, les tendances que nous venons de souligner à propos de la place accordée aux aspects du texte aux différents niveaux scolaires sont le lieu de disparités dès lors qu’on considère nos résultats sous l’angle de la comparaison entre les pays.
Observons d’abord les résultats pour le niveau 4, où nous avons observé les pratiques dans 8 classes belges et 8 classes françaises7.
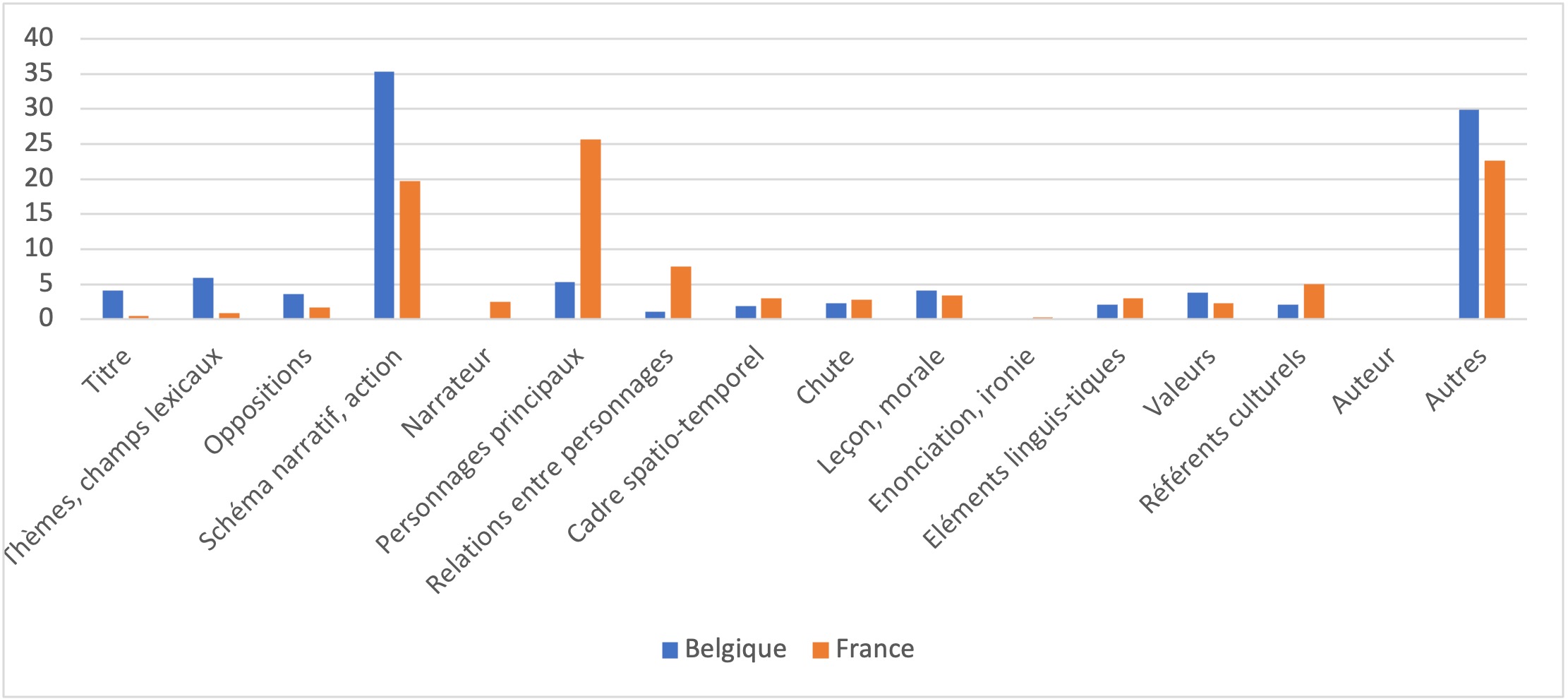
Graphique 2. Proportions de temps accordé aux aspects du texte au niveau 4 dans les deux pays
Comme on peut le constater, les 16 enseignants belges et français se distinguent assez fortement à différents égards. À propos des deux aspects majeurs d’abord: la construction narrative, qui est privilégiée presque deux fois plus par les enseignants belges (35 % vs 20 %) et les personnages et leurs relations, qui «pèsent» cinq fois plus chez leurs collègues français (6 % vs 33 %). En ce qui concerne les aspects plus minoritaires ensuite, on relève un travail plus important dans les classes belges sur le titre, sur les thèmes, les oppositions et les valeurs ainsi que sur les aspects «autres», tandis que les classes françaises consacrent davantage de temps au cadre spatio-temporel et aux référents culturels.
On voit ainsi se dégager une préférence pour le levier d’une lecture linéaire (construction narrative) chez les enseignants belges, et à l’inverse une préférence pour les aspects qui relèvent d’une lecture thématique (personnages, référents culturels) chez leurs collègues français. Cette différence pourrait s’expliquer par la formation universitaire des enseignants français du niveau 4: ceux-ci ont peut-être davantage été préparés à faire un usage modéré de la construction narrative, dont les limites sont de plus en plus souvent dénoncées par les chercheurs8.
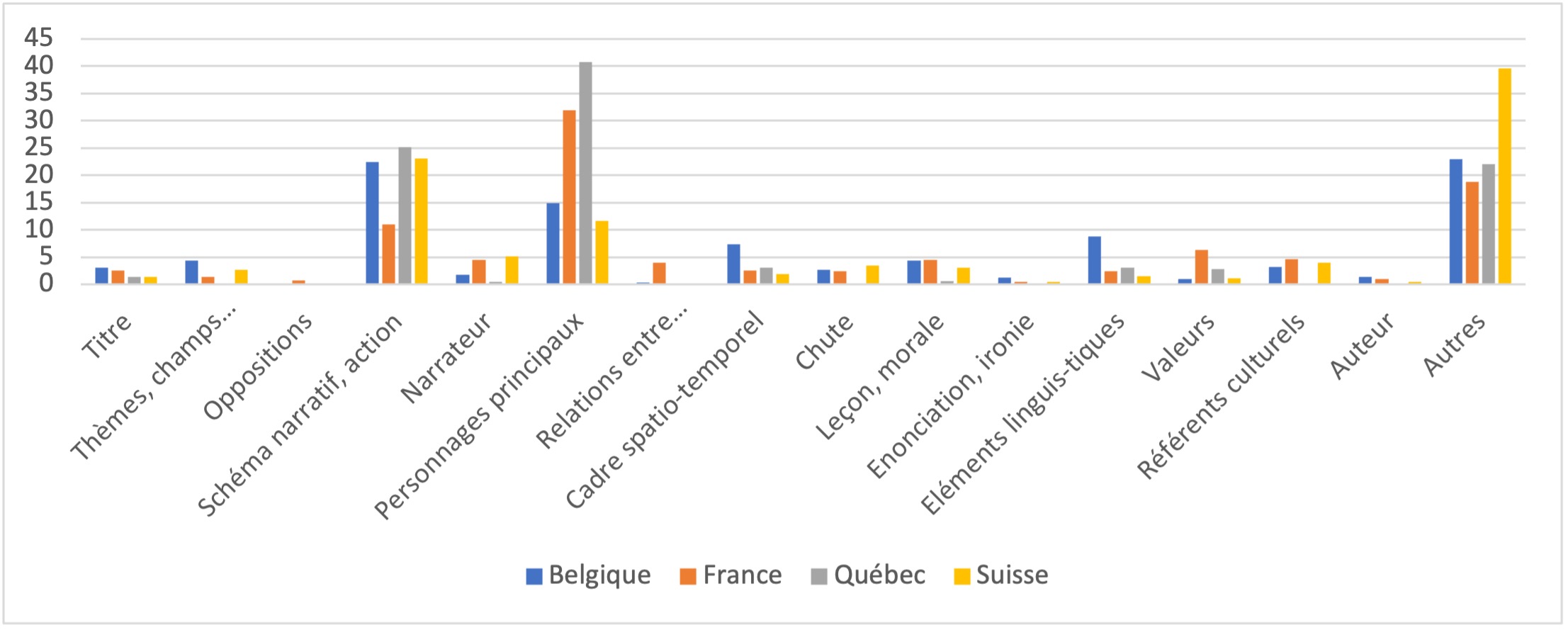
Graphique 3. Proportions de temps accordé aux aspects du texte au niveau 7 dans les quatre pays
Les variations internationales sont tout aussi importantes au niveau 7, où elles concernent tout particulièrement deux aspects du texte: la construction narrative, qui est privilégiée deux fois plus dans les classes belges, québécoises et suisses (entre 22 et 25 %) que dans les classes françaises (11 %); et les personnages et leurs relations, qui sont deux ou trois fois plus prisés par les enseignants français et québécois (36 % et 41 %) que par leurs collègues belges et suisses (15 % et 12 %). Qui plus est, les classes suisses se distinguent par un temps presque deux fois plus important accordé à d’autres contenus que les aspects du texte (40 % vs 23 % en Belgique, 19 % en France et 22 % au Québec).
Il semblerait ainsi que la différence constatée au niveau 4 se confirme ici, non plus entre les enseignants belges et français mais entre d’un côté les enseignants belges et suisses, plus adeptes des aspects linéaires du texte, et de l’autre leurs collègues français et québécois, plus axés sur des approches par thèmes (au sens large du terme). La formation des enseignants est moins aisée à mobiliser ici comme critère explicatif majeur, car seuls les enseignants belges du niveau 7 disposent pour le moment d’une formation plus courte et moins ancrée dans les savoirs universitaires. Il reste dès lors à supposer des tendances différentes dans la culture éducative des quatre pays.
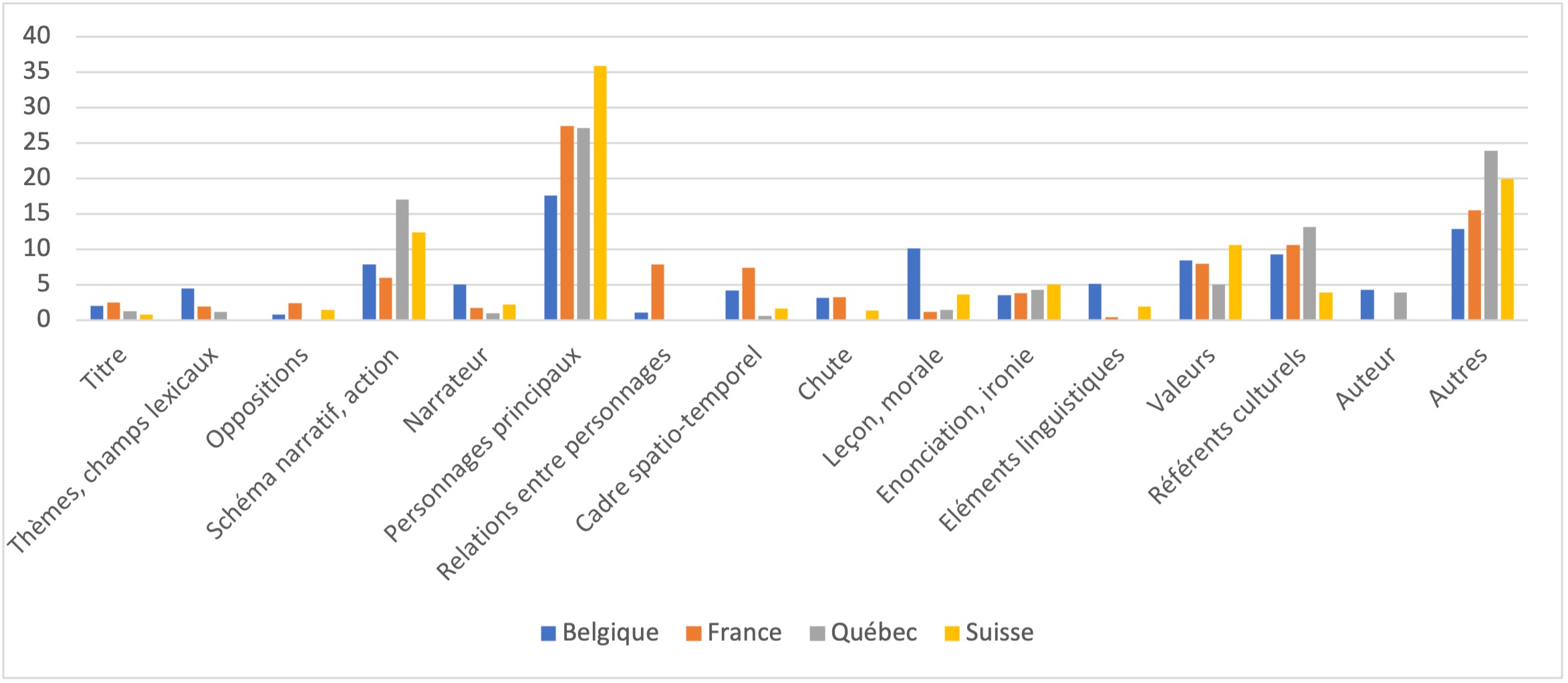
Graphique 4. Proportions de temps accordé aux aspects du texte au niveau 10 dans les quatre pays
En ce qui concerne enfin le niveau 10, trois différences assez nettes apparaissent:
- - la place accordée par les enseignants suisses à l’entrée «personnages» (36 %), qui est deux fois plus importante que chez leurs collègues belges du même niveau (18 %) et trois fois supérieure que chez leurs compatriotes du niveau 7 (12 %) ;
- - le poids persistant de la construction narrative chez les trois enseignants québécois, qui prisent cette entrée trois fois plus leurs collègues français (17 % vs 6 %) ;
- - et l’intérêt manifeste des enseignants belges pour la leçon ou la morale du récit, à laquelle ils accordent trois à neuf fois plus d’importante que leurs collègues des autres pays (10 % vs 1 %, 2 % et 4 %).
Ces constats confirment deux tendances que nous avons déjà pu dégager à propos des opérations de lecture au niveau 10, à savoir la montée en puissance du travail de l’interprétation dans les classes belges et suisses de notre échantillon (convergence avec l’attention portée à la morale de la nouvelle dans les premières et aux personnages dans les secondes) et l’attention toujours forte accordée à la compréhension dans l’échantillon québécois (en relation avec la mobilisation de la construction narrative).
1.4. Analyse qualitative: deux objets privilégiés dans les séances: les personnages et la construction narrative
Pour approfondir l’analyse, il est intéressant de souligner que les deux aspects du texte qui sont privilégiés dans l’ensemble des classes, à savoir les personnages et la construction narrative, rendent compte de l’impact des propriétés de l’objet enseigné (Schneuwly et Thévenaz-Christen 2006) en classe de littérature. Il s’agit donc de reconnaitre ici l’importance de l’«effet texte» sur les pratiques enseignées: face à une nouvelle à chute centrée sur la relation entre deux personnages, il n’est pas étonnant que les enseignants s’attardent prioritairement sur les personnages et sur la structure narrative.
1.4.1. Focus sur les personnages
D’abord, quand on considère l’importance que jouent les personnages au niveau de la compréhension des récits (Reuter 1988; Tauveron 1995; Glaudes et Reuter 1998; Aeby Daghé, Sales Cordeiro, Blanc et Coppola 2020), il est logique que les enseignants s’appuient largement sur eux pour aborder les textes. L’articulation entre le travail sur les personnages et la compréhension est ainsi confirmée par nos données. Mais on remarque également que plus on avance dans la scolarité, plus les échanges autour des personnages sont nombreux et approfondis et vont de pair avec un travail interprétatif. Pour affiner cette progression, nous distinguons quatre objectifs que l’enseignant peut viser lorsqu’il attire l’attention des élèves sur les personnages.
En premier lieu, il peut s’agir simplement de présenter un personnage, via une description physique ou psychique:
«On continue, présentation de Taratonga, page quatorze [pause pendant que les élèves cherchent la page quatorze].» (F10-05)
En second lieu, il est souvent question de vérifier un trait de caractère d’un personnage, objectivé via l’explicitation de pensées, de paroles ou de divers agissements:
«On était en train de dire que Taratonga [ENS écrit au tableau] ment; c’est ce qu’on était en train de dire, elle ment [inaudible] et on était en train de chercher, enfin ÉL10 était en train de chercher le passage, le passage où on voyait qu’elle mentait. Alors vas-y ÉL10, indique la ligne alors, on est page 18.» (F4-06)
Dans ces cas, le contenu soumis à la discussion se fait à partir de données plus ou moins littérales: les éléments de réponse «attendus» sont, à des degrés divers, explicités ou du moins évoqués dans la nouvelle, souvent numéros de ligne à l’appui. L’analyse est alors mise au service de la compréhension de la nouvelle «au ras du texte», à partir d’une hypothèse partagée par la classe, à qui il peut être demandé d’objectiver ou de justifier telle ou telle réponse. La validation s’effectue par le retour au texte (Falardeau 2003).
Une troisième forme de travail, plus complexe, est proposée lorsqu’il s’agit de saisir la raison du comportement d’un personnage:
«Je vais revenir au texte. "Je liquidai donc quelques affaires personnelles dont je disposais et je revins à Tahiti... Je fus déçu par Papeete". Pourquoi Il est déçu? Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu’il était déçu?» (B10-03)
Ici, le travail mobilise une compétence de lecture plus exigeante, en l’occurrence une opération de type inférentiel: l’élève doit construire un lien cohérent entre un passage particulier et la dynamique globale du récit. L’appui sur l’extrait seul ne suffit plus pour aboutir à la compréhension: il s’agit aussi de le mettre en rapport avec des informations qui sont fournies préalablement ou ultérieurement dans le texte et de produire ainsi des inférences complexes. Comme le soulignent les commentaires des enquêtes PISA et PIRLS, ce sont ces inférences qui s’avèrent les plus problématiques pour les élèves les plus faibles. Qui plus est, elles mobilisent des processus psychoaffectifs et exigent des élèves qu’ils se représentent les états mentaux du personnage (Cèbe et Goigoux 2009), voire qu’ils se rapprochent de lui à travers l’identification ou l’empathie fictionnelle (Jouve 2012).
Enfin, il arrive que l’enseignant convoque des extraits portant sur les personnages qui permettent à la classe de juger un comportement. Dans ce cas, il tend à solliciter explicitement l’avis voire l’évaluation subjective des élèves:
«Oh là il ne se moque pas encore quand même, vous avez l’impression qu’il se moque là? [ENS regarde le texte] Écoutez bien! [ENS lit le passage] "Toute la beauté mille fois décrite mais toujours bouleversante lorsqu’on la voit enfin de ses propres yeux, du paysage polynésien, s’offrit à moi au premier pas que je fis sur la plage".» (F7-02)
Ce type d’adresse, qui interpelle lui aussi la subjectivité des lecteurs, permet d’accéder progressivement à une diversité de points de vue, dont l’accueil par l’enseignant appelle une conduite didactique adaptée (Sauvaire 2013).
1.4.2. Focus sur la construction narrative
Le second aspect du texte qui est privilégié dans les séances concerne les éléments clés de la progression du récit. Comme nous l’avons déjà souligné, le temps accordé à la construction narrative tend à décliner au fil du curriculum, à l’inverse de celui qui est consacré aux personnages. Dans ce contexte, on constate que, si les grandes parties du «schéma narratif» (Barthes 1966 ; Propp 1970 ; Fayol 1985 ; Adam et Revaz 1996 ; Reuter 2016) sont toutes abordées par les extraits mobilisés, les rôles assignés aux extraits liminaires du récit (début et fin) sont particulièrement intéressants.
L’appui sur le début du récit sert principalement à rappeler le cadre général de l’intrigue:
«Donc je vous propose de relire ensemble les premiers paragraphes et puis de vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris» (B10-03).
On perçoit aisément ici l’importance didactique d’assurer une compréhension commune du cadre référentiel du récit, car c’est ce socle construit collectivement qui rend possibles des échanges portant sur des points plus complexes. Les autres extraits centrés sur la construction narrative servent également à rappeler la trame et le cadre de l’intrigue.
En contraste, l’appui sur la fin du récit sert à interpréter le texte et à témoigner de son appréciation:
ÉL: Moi ce qui m’a plu c’est la chute de l’histoire, parce qu’on s’y attend pas.
ENS: alors, le fait qu’on ne s’y attende pas, nécessairement, il va falloir en reparler, est-ce qu’il y en a qui n’ont pas du tout aimé le texte? Il n’est pas arrivé jusque-là, d’accord, est-ce que quelqu’un avait vu venir la chute? (F10-04)
C’est donc en prenant en considération la situation du passage dans le texte et en tenant compte de sa dynamique narrative que l’enseignant oriente les échanges vers telle ou telle opération de lecture.
1.5. Rapports entre les aspects du texte et les opérations de lecture
1.5.1. Opérations de lecture et aspects du texte
Demandons-nous ensuite si les opérations de lecture sont liées à certains aspects du texte plutôt qu’à d’autres. Pour le savoir, nous avons repéré les corrélations statistiques les plus significatives, puis nous les avons mises en évidence dans le tableau qui suit.
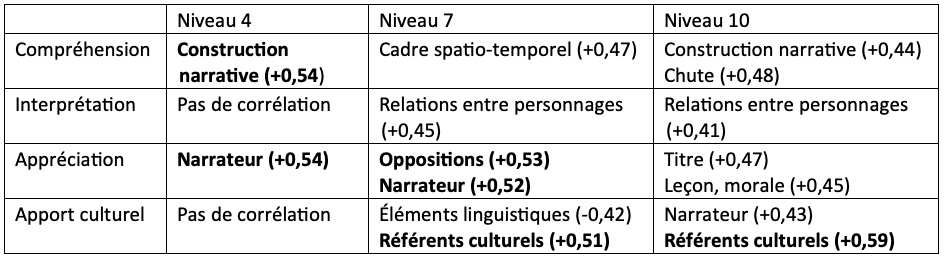 Tableau 1. Corrélations entre les opérations de lecture et les aspects du texte
Tableau 1. Corrélations entre les opérations de lecture et les aspects du texte
Plusieurs observations se dégagent de ce tableau. Les seuls aspects du texte qui sont associés intensément au travail de la compréhension sont la construction narrative (aux niveaux 4 et 10: 0,54 et 0,44) et le cadre spatio-temporel du récit (au niveau 7: 0,47), alors que le travail interprétatif semble concerner surtout les relations entre les personnages aux niveaux 7 et 10 (0,45 et 0,41). Ensuite, il est frappant de voir que le travail de l’appréciation est associé de manière privilégiée à trois aspects textuels, mais d’une manière contrastée entre les niveaux puisque, aux niveau 4 et 7, les élèves sont surtout invités à exercer leur jugement sur le narrateur (0,54 et 0,52) ou sur les oppositions (0,53 au niveau 7), tandis qu’au niveau 10, ce sont d’abord le titre de la nouvelle (0,47) et la leçon-morale (0,45) qui sont associés à l’appréciation. Quant à l’apport culturel, au niveau 7, il semble incompatible avec le travail sur les éléments linguistiques (-0,42) et, au niveau 10, il est notamment centré sur le narrateur (0,43). Il est par ailleurs logique qu’aux niveaux 7 et 10, les référents culturels soient surtout développés dans le cadre de l’opération de lecture qui privilégie précisément cette dimension (0,51 et 0,59).
1.5.2. Quels sont les objets de l’interprétation et de l’appréciation éthique?
Pour prolonger l’analyse, il nous a semblé intéressant d’examiner quels sont les aspects du texte qui font le plus l’objet d’interprétations et d’appréciations de type éthique, car la dimension éthique de la lecture est aujourd’hui, comme on l’a déjà vu, l’objet d’une forte préoccupation de la part de nombreux chercheurs et enseignants, et c’est à propos des contenus textuels qu’elle peut être le mieux appréhendée. Il y a lieu ici, soulignons-le, de distinguer les interprétations éthiques, qui consistent à identifier les jugements éthiques qui se dégagent du texte (qu’ils soient attribuables à un personnage, au narrateur, ou à l’auteur), et les appréciations éthiques, qui sont les jugements portés par le lecteur lui-même (qui peut être l’enseignant ou l’élève).
En reprenant certaines catégories distinguées par Gabathuler (2016), nous avons identifié quatre aspects du texte littéraire qui sont abordés sur ce plan dans les séances de notre corpus: les personnages, les situations narratives, la morale à tirer de la nouvelle et le thème de l’argent. L’exploitation de ces aspects dans les classes est relativement homogène entre les différentes classes d’âge. Bien que ceux du niveau 10 recourent à une plus grande diversité d’éléments textuels, les enseignants des trois degrés scolaires sollicitent l’interprétation ou l’appréciation éthique en premier lieu à propos des personnages.
Cet objet est en effet à lui seul plus mobilisé que les quatre autres réunis. Cette primauté des personnages confirme l’importance de cette instance dans les activités scolaires relatives à la littérature (Aeby Daghé et Sales Cordeiro 2020). En particulier, ses liens avec le travail sur la compréhension en font une clé d’accès précieuse à la fiction. Ici, ce sont principalement des traits de caractère ou certaines aspirations des personnages qui fonctionnent comme leviers pour aborder la question des valeurs. Nombreuses sont les interactions en classe qui thématisent le désir initial du narrateur de fuir un monde occidental nourri selon lui par des valeurs capitalistes:
ÉL: Par rapport à son caractère? il en a marre de l’argent, il a envie de liberté.
ENS: Il veut la liberté, il en a marre de l’argent, oui...
ÉL: Un endroit où il y a pas d’argent, où c’est plus des aides amicales, des échanges amicaux... et pas avec de l’argent.
ENS: Des échanges amicaux, oui, il a envie de s’éloigner du monde de l’argent. Très bien. Oui? (B7-01)
L’élément le plus commenté est l’opposition entre la quête de désintéressement du narrateur et son projet mercantile plus tardif de vente des toiles de Taratonga. Dans ce cas, les réactions peuvent se faire passionnelles et simplificatrices: «il est en quête d’argent en fait», indique par exemple un élève (F10-02). La contradiction qui habite le narrateur dans son rapport à l’argent fonctionne comme un principe d’accès fort à la question des valeurs. Le narrateur est d’ailleurs mentionné deux fois plus souvent que le personnage de Taratonga.
Deuxièmement, une situation narrative est souvent discutée sur le plan éthique: l’action de Taratonga de donner des gâteaux emballés dans de fausses toiles de Gauguin pour «appâter» le narrateur. Parmi les huit situations narratives relevées, cette action a suscité des réactions contrastées, Taratonga étant considérée soit comme une menteuse, soit comme voulant faire passer un message au narrateur. «Taratonga est presque une voleuse», estime un élève (CH7-01). La tromperie potentielle est ainsi très souvent mentionnée. Le personnage du narrateur n’est pas épargné non plus lorsqu’est évaluée son action d’échange des toiles contre une montre en or et de l’argent. Pour parler de sa cupidité, certains élèves n’hésitent pas à parler d’«arnaque».
Troisièmement, on observe dans bon nombre de séances la sollicitation par l’enseignant d’un regard éthique sur le thème de l’argent, présenté comme source de conflits avec les autres valeurs, en particulier celles de l’amitié et de l’innocence (revendiquée par ailleurs par le narrateur).
Enfin, le regard éthique sur la morale à tirer de l’histoire est fréquemment sollicité sous forme d’interrogation. Une enseignante suisse (CH10-01) invite ainsi clairement ses élèves: «quelle est d’après vous la morale? Il peut y avoir plusieurs morales». On notera que, même si c’est toujours l’enseignant qui ouvre la discussion au sujet de l’enseignement à tirer du récit de Gary, c’est également dans ce cas que la mise en mots des élèves se fait la plus généreuse.
L’analyse confirme en somme que le regard éthique s’intéresse aux différents aspects du texte qui avaient déjà été mis en évidence par Gabathuler (2016), à savoir les personnages, certains évènements de l’intrigue, et, dans l’après-coup de la lecture, la dimension didactique du texte.
1.6. Bilan intermédiaire
Ayant ainsi examiné sous divers angles la part consacrée par les enseignants aux différents aspects du texte de Gary, on peut résumer comme suit les éléments saillants de cette analyse:
- - deux aspects du texte sont particulièrement privilégiés tout au long de la scolarité, la construction narrative et les personnages, mais tandis que le premier perd nettement de son importance au fil des niveaux, le second à l’inverse voit son importance quasiment doubler entre les niveaux 4 et 10;
- - la centration sur les aspects narratologiques, linguistiques et culturels est globalement plus importante au niveau 10 qu’aux niveaux précédents, ce qui semble un indice de la «disciplination» croissante de l’activité d’analyse textuelle et confirme la thèse défendue par Schneuwly et Ronveaux (2018);
- - ces convergences apparentes vont cependant de pair avec de grandes disparités sur le plan international. Au niveau 4, la construction narrative est privilégiée deux fois plus par les enseignants belges que par les enseignants français, alors que les personnages et leurs relations, à l’inverse, le sont cinq fois plus par les enseignants français. L’écart entre les enseignants français et les autres se confirme au niveau 7, où la construction narrative est privilégiée deux fois plus dans les classes belges, québécoises et suisses que dans les classes françaises, alors que les personnages et leurs relations sont beaucoup plus prisés par les enseignants français et québécois que par leurs collègues belges et suisses. Enfin, les différences entre pays s’estompent en partie au niveau 10, même si les enseignants suisses, québécois et belges s’y distinguent, les premiers par une attention deux fois plus grande accordée aux personnages, les deuxièmes par leur intérêt persistant pour la construction narrative et les troisièmes par l’importance qu’ils portent à la leçon ou à la morale du récit;
- - enfin, quand on croise les résultats relatifs aux aspects du texte avec ceux qui concernent les opérations de lecture, il apparait que l’attention portée à la structure narrative est étroitement corrélée à la stimulation de la compréhension, alors que ce sont les relations entre les personnages qui suscitent le plus des appels à l’interprétation (aux niveaux 4 et 10) et à l’appréciation (au niveau 7). Plus précisément, aux trois degrés scolaires, ce sont les personnages qui font le plus l’objet d’une interprétation ou d’une appréciation sur le plan éthique: cela concerne surtout le comportement de Taratonga (quand elle utilise des toiles comme emballages en dissimulant leur origine), mais aussi plus largement la question du rapport à l’argent et la leçon morale qu’on peut tirer du récit.
1.7. Le traitement des aspects du texte dans les classes les moins et les plus performantes
Après avoir identifié les tendances dominantes dans les pratiques d’enseignement, nous les avons comparées aux performances lectorales des élèves, que nous avons mesurées sur la base de leurs résumés écrits de la nouvelle qui leur avait été soumise en lecture silencieuse individuelle avant la séance de travail collectif. Pour ce faire, nous avons distingué les classes de notre corpus en fonction de leur niveau moyen de performance en compréhension9 et en interprétation10, puis nous avons confronté ces deux ensembles aux données «enseignement» à l’aide des coefficients de Pearson et de tests de significativité11. Nous avons ainsi pu voir dans quelle mesure les choix des enseignants variaient ou non en fonction des performances de leurs élèves ou, à l’inverse, influaient sur celles-ci (les corrélations étant lisibles dans les deux sens, comme on le verra).
A cet égard, dès le niveau 4, nous constatons que les enseignants mobilisent beaucoup plus la construction narrative avec les classes en difficulté en compréhension (0,44) et en interprétation (0,38) qu’avec les classes plus à l’aise dans ce domaine (0,17 en compréhension et en interprétation). Dans ces dernières en revanche, les enseignants consacrent davantage de temps à l’étude des personnages (0,26 en compréhension et 0,22 en interprétation contre 0,11 avec les plus faibles compreneurs ou 0,12 avec les plus faibles interprètes).
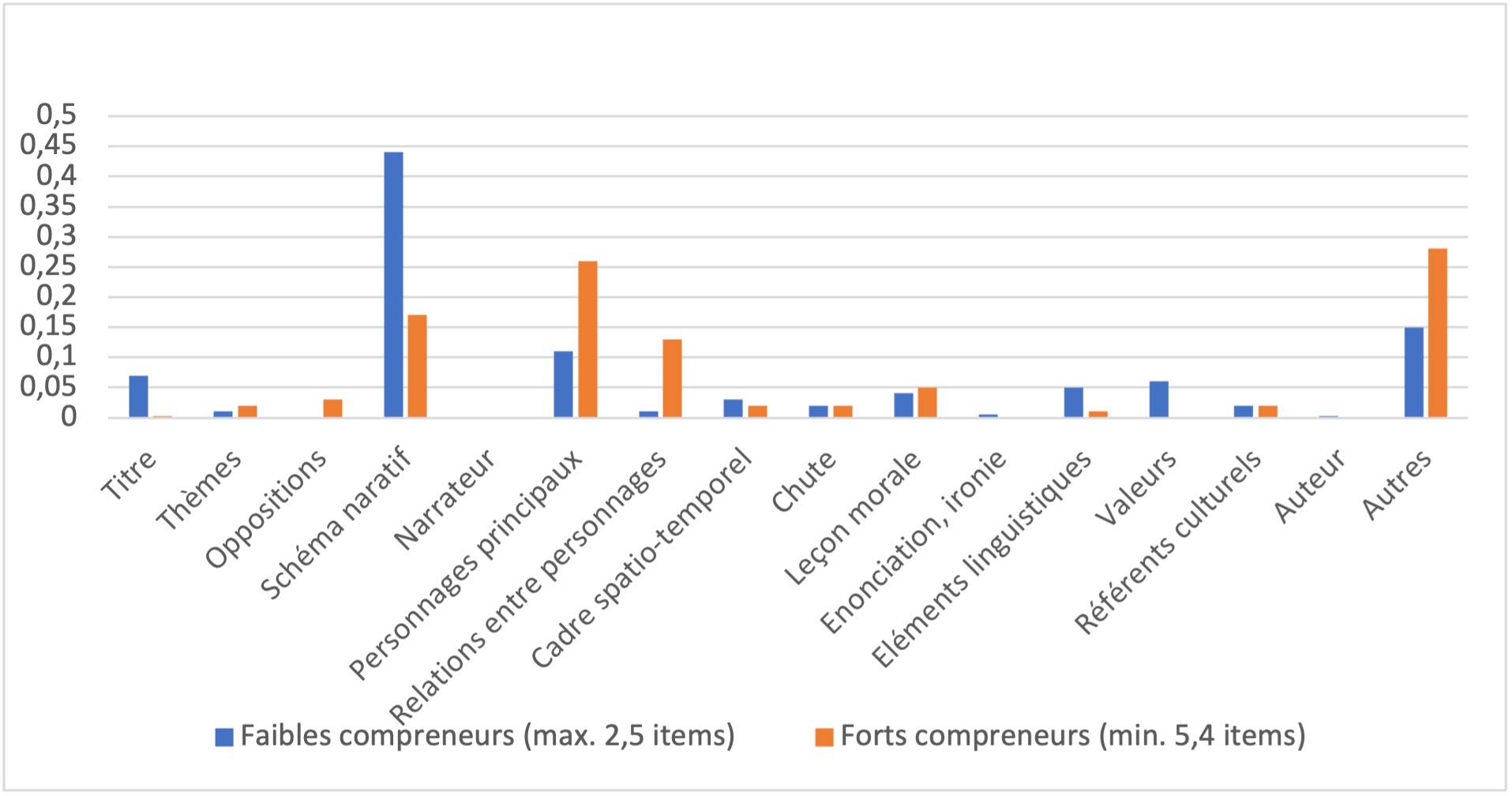
Graphique 5. Aspects du texte travaillés dans les classes
les moins et les plus performantes en compréhension au niveau 4
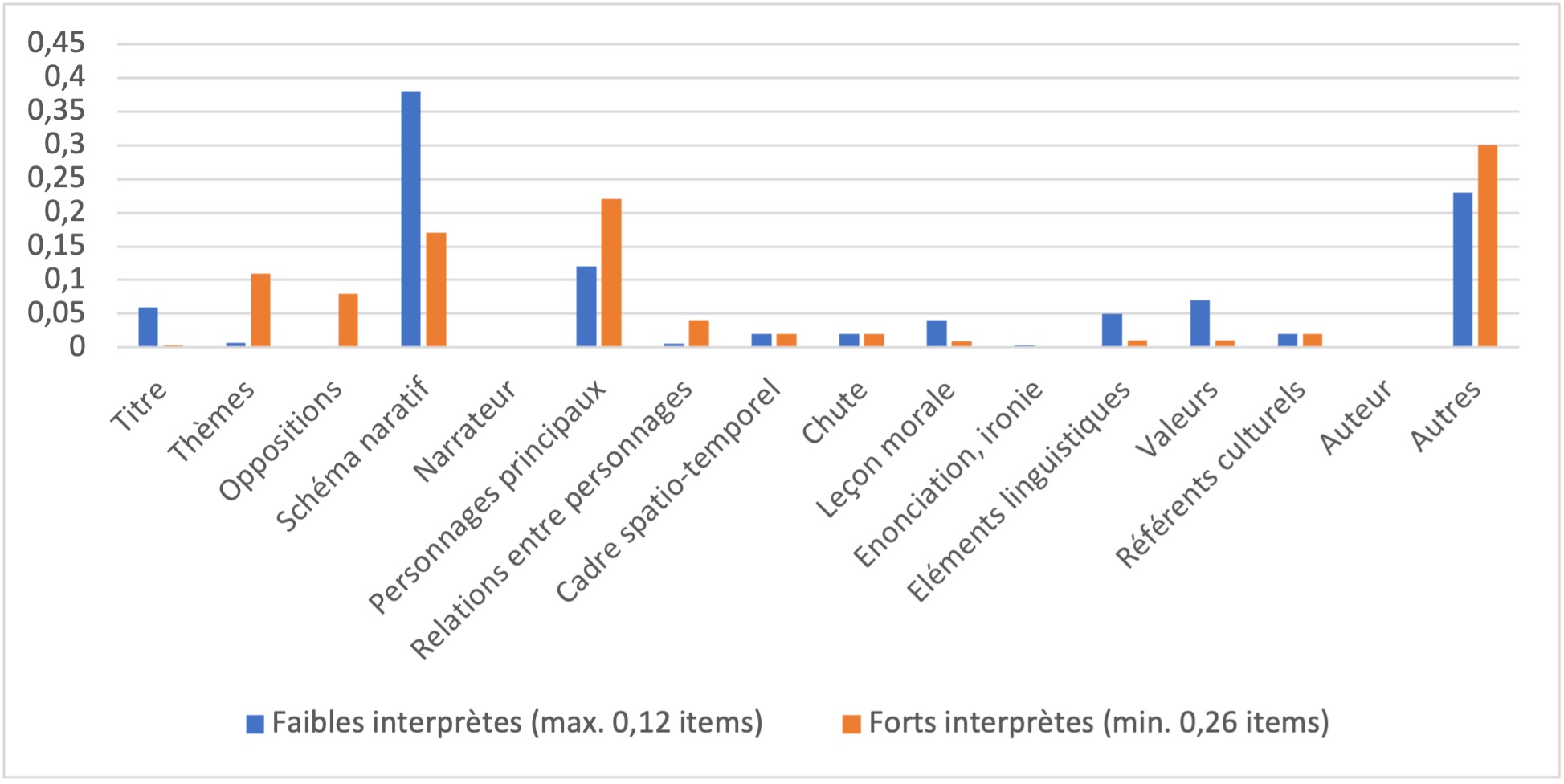
Graphique 6. Aspects du texte travaillés dans les classes
les moins et les plus performantes en interprétation au niveau 4
Au niveau 7, les compreneurs les moins performants se voient à nouveau proposer de travailler principalement sur la construction narrative (0,32), tandis que le second aspect mobilisé, bien plus faiblement, concerne les personnages (0,14). Cette tendance s’inverse avec les meilleurs compreneurs: les enseignants les invitent à s’intéresser principalement aux personnages (0,22), tandis que la construction narrative est bien moins étudiée (0,11). La tendance est d’ailleurs du même ordre si l’on regarde les aspects du texte traités par les enseignants avec les classes des plus faibles et des meilleurs interprètes.
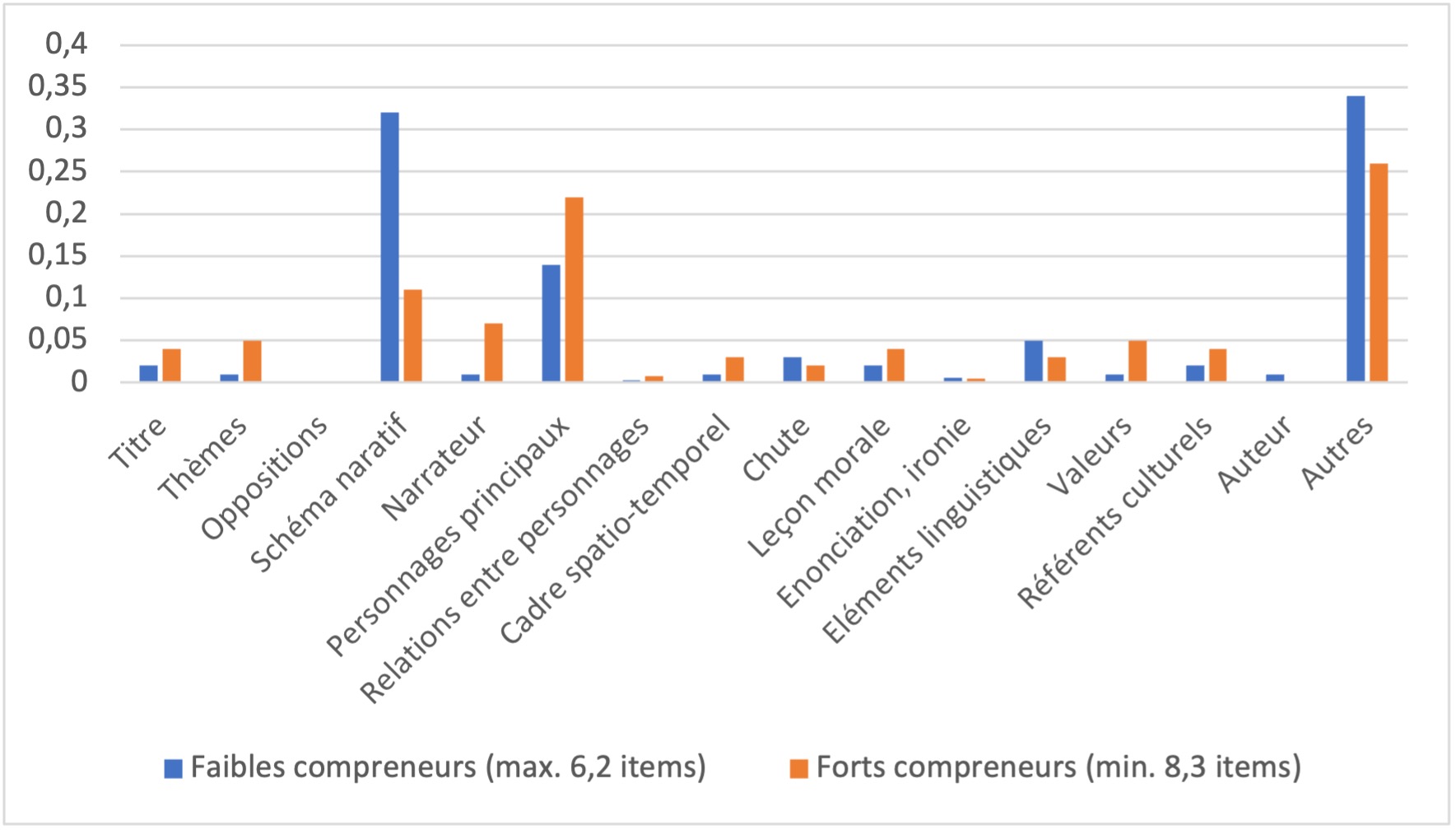
Graphique 7. Aspects du texte travaillés dans les classes les moins et les plus performantes en compréhension au niveau 7
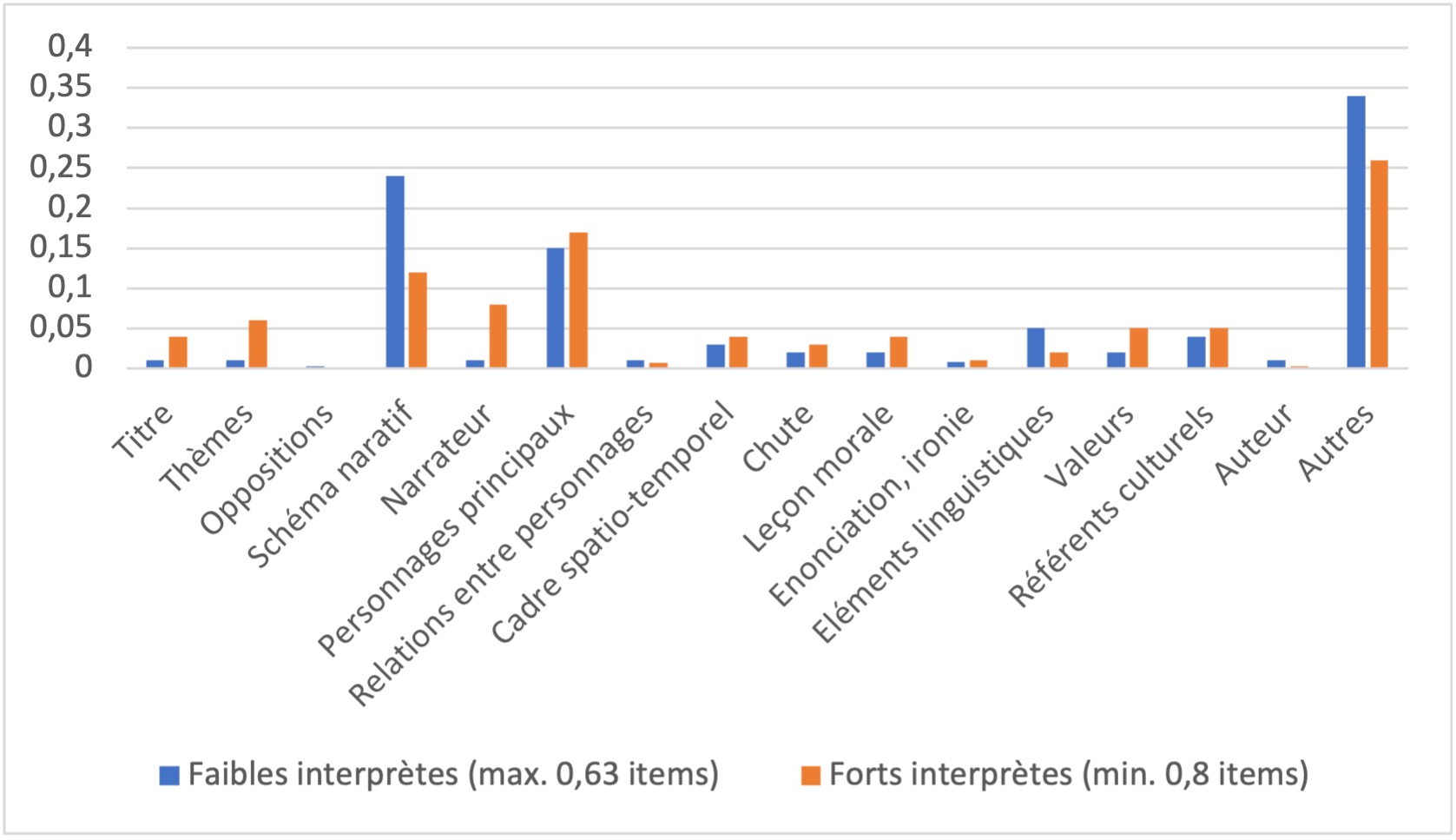 Graphique 8. Aspects du texte travaillés dans les classes les moins et les plus performantes en interprétation au niveau 7
Graphique 8. Aspects du texte travaillés dans les classes les moins et les plus performantes en interprétation au niveau 7
Au niveau 10 enfin, tandis que la construction narrative continue à être significativement travaillée avec les moins bons compreneurs (0,15), le travail sur les personnages devient l’aspect le plus traité (0,23). Avec les meilleurs compreneurs, la part consacrée à la construction narrative est plus faible (0,1) et la part consacrée aux personnages reste importante (0,22), tandis qu’est mobilisé significativement un troisième aspect, celui des référents culturels liés à l’œuvre (0,1). On repère également certains écarts si l’on s’intéresse au score en interprétation: avec les plus faibles interprètes, le travail le plus mobilisé concerne les personnages (0,27) et dans une moindre mesure les valeurs (0,14); avec les meilleurs interprètes, le travail sur les personnages est plus faiblement mobilisé, et le deuxième aspect du texte auquel les enseignants se consacrent est à nouveau à l’étude des référents culturels (0,11).
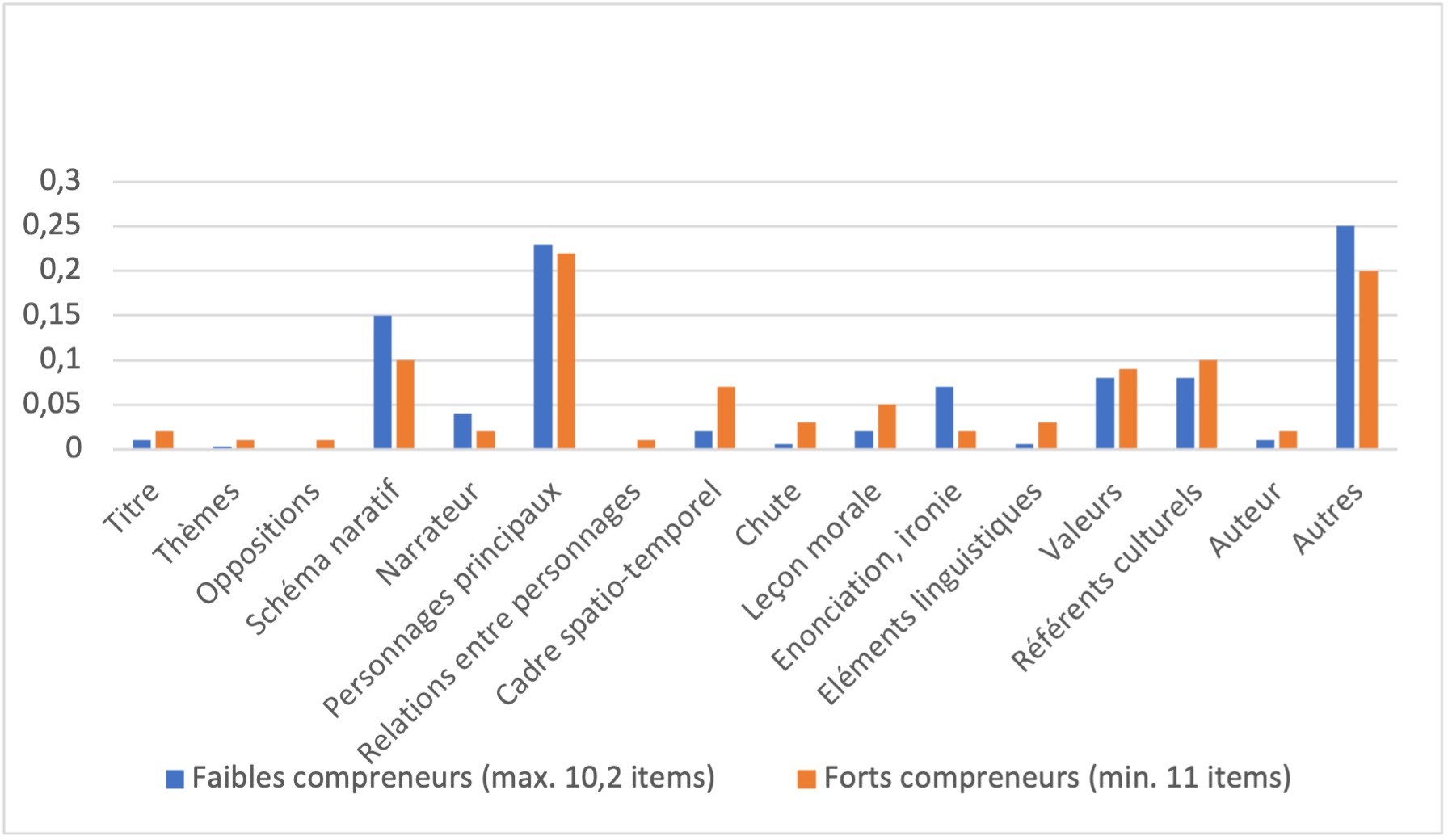
Graphique 9. Aspects du texte travaillés dans les classes les moins et les plus performantes en compréhension au niveau 10
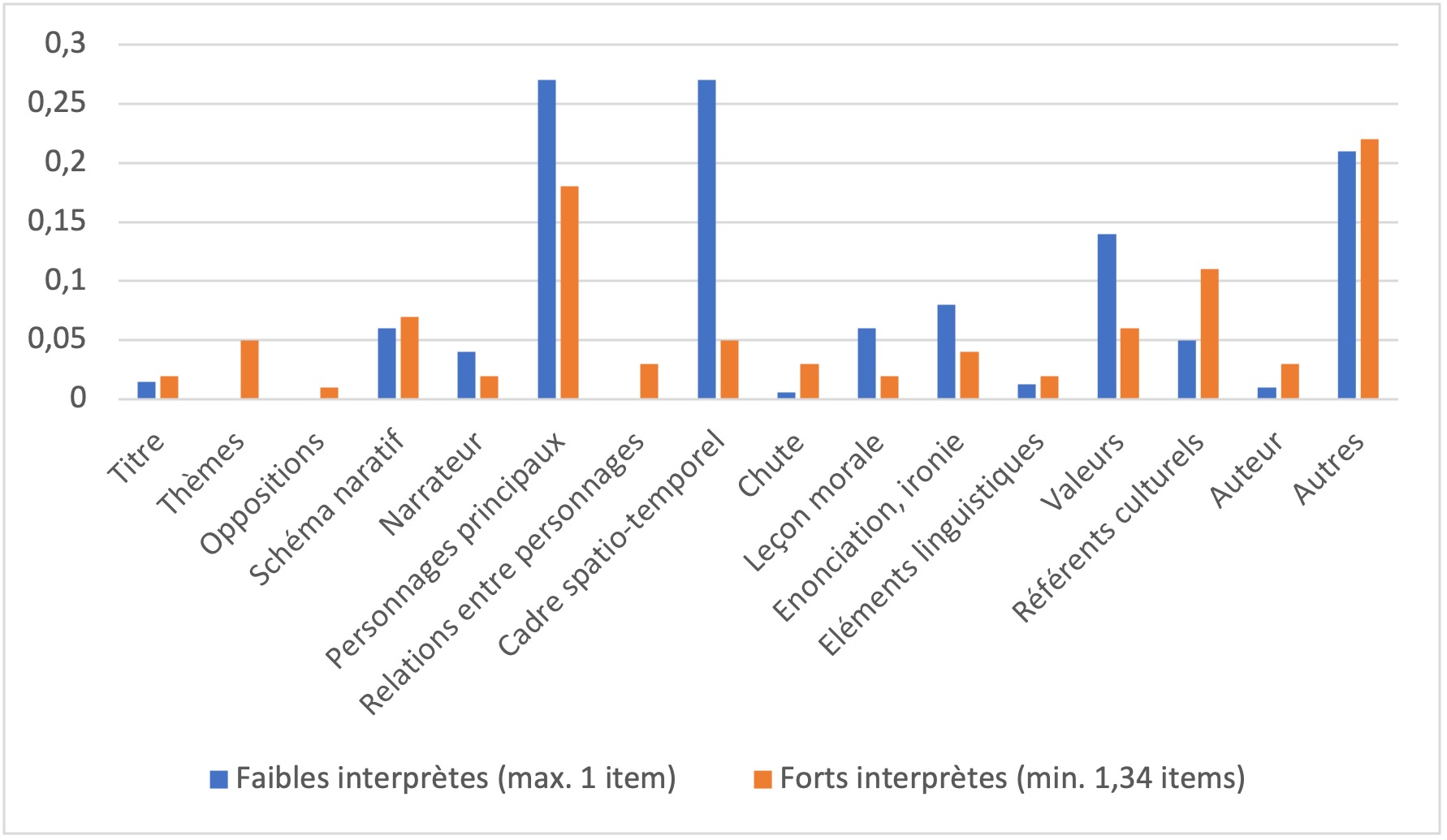
Graphique 10. Aspects du texte travaillés dans les classes
les moins et les plus performantes en interprétation au niveau 10
En somme, ici encore, l’adaptation des enseignants au niveau de performances de leurs élèves est patente, et celle-ci se manifeste non par paliers de niveau scolaire mais bien par stade de compétence. Et à l’inverse, on peut penser que le fait d’avoir affaire à des enseignants qui privilégient le recours à la construction narrative stimule moins les capacités interprétatives des élèves.
La construction narrative est visiblement considérée comme l’aspect structurant de la compréhension d’un récit, comme un préalable, et les enseignants y consacrent d’autant plus de temps que les élèves sont moins performants en lecture (compréhension et interprétation). Elle se trouve ainsi principalement sollicitée avec les élèves de niveau 4 et de niveau 7 les plus en difficulté. Enfin, ce travail sur les personnages s’enrichit peu à peu, avec les élèves les plus performants au niveau 10: les enseignants convoquent alors des référents culturels liés au texte. L’adaptation aux performances des élèves est donc bien repérable et elle se manifeste par un effet de décalage dans les aspects traités entre les élèves les plus faibles et les plus forts en lecture.
Mais si on analyse ces corrélations dans le sens inverse, on peut aussi considérer que l’enrichissement progressif des aspects traités (les personnages, les aspects culturels, voire les valeurs) favorise le développement des compétences des élèves confrontés à un texte littéraire. En effet, même si les données que nous avons recueillies chez les enseignants sont ultérieures aux réponses des élèves au questionnaire de lecture, elles ont été observées pour la plupart dans la deuxième moitié de l’année scolaire. Elles témoignent ainsi des pratiques d’enseignement ordinaires auxquelles les élèves de ces enseignants ont été habitués depuis plusieurs mois et qui les en partie ont stimulés – ou non – à devenir de meilleurs compreneurs et de meilleurs interprètes.
2. Quelles perspectives pour la narratologie dans les classes aujourd’hui?
Dans le second volet de cet article, je m’attacherai, de manière beaucoup plus rapide, à ébaucher une réflexion prospective basée sur ce que, compte tenu de l’enquête que je viens de présenter et d’autres observations que j’ai pu faire dans ma pratique de chercheur et de formateur d’enseignants, je perçois comme des priorités aujourd’hui en ce qui concerne l’étude du récit dans les classes de français. Puisqu’il s’agit ici de propositions, je n’ignore pas la part de convictions personnelles dont elles relèvent et n’ai aucune intention de les présenter comme des nécessités objectives qui émaneraient d’un constat de manques essentialisés.
2.1. Articuler travail sur le récit et travail de l’interprétation
La première priorité concerne les activités interprétatives. Comme le montrent les résultats de l’enquête Gary, si les enseignants qui travaillent le récit en classe suscitent de plus en plus son interprétation à mesure qu’ils «montent» dans les niveaux scolaires, le recours à cette opération reste relativement peu outillé. Quel que soit le niveau scolaire et le profil de performance des élèves, rares sont les séances où l’on voit des enseignants solliciter explicitement une diversité d’hypothèses interprétatives en distinguant celles qui relèvent d’une culture possiblement partagée –je pense ici aux différents schémas interprétatifs issus du «sens commun» comme, dans le cas du récit de Gary, l’arroseur arrosé ou la condamnation de l’appât du gain, mais aussi à la diversité des «interprétations externes» fondées sur des savoirs historiques, sociologiques, biographiques, intertextuels, psychologiques ou autres – des «interprétations subjectives» qui émanent de l’expérience et des représentations des élèves. Or il me semble que c’est en grande partie cette diversité d’interprétations qui donne à chaque lecture son épaisseur et sa plus-value. Je trouverais dès lors important que cette «opération»-là soit davantage sollicitée, non pas certes sous la forme d’explications «magistrales», mais dans le cadre de débats interprétatifs où l’enseignant invite les élèves à exploiter par eux-mêmes différents savoirs et ressources qu’il met à leur disposition12.
Bien sûr, il s’agit là d’une proposition qui excède de loin le cas spécifique de l’étude des récits. Je crois dès lors utile de préciser que, pour aborder les textes de ce type, c’est avant tout à des fins interprétatives (et aussi appréciatives, comme on le verra plus loin) qu’il importe de continuer à faire appel aux «outils» narratologiques que sont les schémas narratif et actantiel, les différentes typologies des personnages, les notions de narrateur, de rythme narratif, de focalisation et de point de vue. Mais tout l’enjeu selon moi est de présenter ces outils comme des moyens d’enrichir le sens plutôt que comme des conditions d’accès à celui-ci. Ceci concerne tout particulièrement le fameux «schéma narratif», qui, selon mes observations, est souvent considéré en classe comme la clé de toute compréhension. Or nul n’est besoin de se référer aux cinq étapes du schéma quinaire pour comprendre un récit. Il suffit pour cela de saisir quel est l’acteur (singulier ou collectif) de l’histoire, à quels problèmes (ou «quêtes» si l’on veut) il est confronté et comment il les résout ou non. Plutôt que le «schéma» de Greimas ou de Larivaille donc, c’est la séquence définie par Brémond qui me semble être l’outil premier de la compréhension des récits13. Les autres outils greimassiens, genettiens et autres ne sont utiles que dans un second temps, comme moyens de complexifier le sens et de l’ouvrir dans des directions multiples.
Un autre exemple: la notion de narrateur non fiable serait particulièrement pertinente pour interpréter le récit «J’ai soif d’innocence», car on y voit un protagoniste qui à la fois s’illusionne sur lui-même (ou fait mine de le faire) et, de ce fait, ne cesse de tromper le lecteur.
2.2. Articuler travail sur le récit et travail de l’appréciation
En second lieu, les résultats de la recherche Gary ont permis de constater la rareté, encore plus spectaculaire peut-être, de la stimulation des appréciations. A quelques exceptions près, lorsque cette opération est stimulée, c’est seulement pour tâter le niveau d’intérêt initial ou final des élèves à l’égard du texte, mais guère pour les inviter à mobiliser une diversité de critères d’appréciation ni à passer de leurs jugements de gout spontanés à un jugement de valeur étayé. Or il me semble qu’apprendre à formuler une appréciation argumentée sur une production culturelle – et donc notamment un récit – constitue l’un des objectifs les plus importants dans la perspective de l’éveil à l’esprit critique et d’une éducation dite citoyenne. A cet égard, comme j’ai eu l’occasion quelques fois de l’écrire (cf. notamment Dufays, 2019), quatre critères d’appréciation mériteraient selon moi d’être explicitement mobilisés tout au long de la scolarité, en l’occurrence le critère cognitif, qui permet de juger l’œuvre en fonction de sa lisibilité supposée (beaucoup de jeunes élèves tendent ainsi à apprécier davantage les textes qu’ils jugent faciles et à déprécier ceux qu’ils trouvent trop complexes), le critère référentiel, qui permet d’apprécier l’œuvre en fonction de l’univers référentiel qu’elle mobilise (beaucoup d’élèves apprécient ainsi certains récits du seul fait qu’ils se déroulent dans un cadre qui leur plait), le critère éthique, qui permet d’apprécier l’œuvre en fonction de la leçon morale qu’on peut en dégager (l’appréciation étant ici étroitement connectée à l’interprétation), et le critère esthétique, qui permet d’apprécier l’œuvre en fonction de l’intérêt qu’on épreuve pour sa construction ou son écriture (et c’est sur ce point que les outils narratologiques – schéma narratif, narrateur, rythme, focalisation, etc. – s’avèrent particulièrement précieux).
L’enseignant pourrait inviter les élèves à convoquer ces différents critères tant au début d’une lecture (après la découverte de l’incipit) qu’à la fin, ce qui leur permettrait d’ainsi mesurer l’évolution de leur jugement, mais surtout, il serait précieux de donner du temps aux élèves pour se partager mutuellement leurs appréciation afin d’une part de leur permettre d’argumenter à leur propos et d’autre part de relativiser leurs jugements en constatant la diversité des points de vue au sein de la classe14.
2.3. Articuler travail sur le récit et lecture littéraire… et donc notamment lecture immersive
La troisième priorité, qui s’appuie sur les deux premières tout en les dépassant, concerne l’approche générale de la lecture à adopter pour travailler les récits en classe. Je pars du principe que, dans l’enseignement obligatoire, ce qu’il s’agit avant tout d’apprendre aux élèves, tout au long de la scolarité, c’est une manière d’approcher et de lire les textes, quels qu’ils soient, afin de leur permettre de faire de la lecture une ressource pour accéder aux connaissances et aux expériences du monde dans leur diversité et leur complexité.
A cet égard, les récits, comme les textes poétiques, les textes dramatiques, les textes d’idées et les textes fonctionnels, sont des moyens pour développer ces modalités de la lecture qui ont été théorisées et nommées par un grand nombre de chercheurs sous des noms variés15, et que j’ai regroupées pour ma part, à la suite de Picard (1986), sous les catégories (larges) de «lecture participative ou impliquée» et «lecture distanciée ou analytique» (ou, pour faire court, «participation» et «distanciation»). En clair, lorsqu’on étudie des récits en classe, qu’ils soient courts ou longs, classiques ou contemporains, légitimés («réputés littéraires») ou non, textuels ou iconiques, il importe d’une part de les analyser comme des objets de savoir qui, pour pouvoir faire sens, requièrent un minimum de compréhension commune ancrée dans ce qu’il est convenu d’appeler les «droits du texte», et d’autre part d’inviter les élèves à les confronter à leurs représentations, à leurs expériences, à leurs émotions et à leurs valeurs, autrement dit à leurs «droits de lecteurs», sans faire de ce deuxième mouvement un simple prolongement d’une étude objectivante préalable, mais en la suscitant dès le début de la lecture en classe et tout au long de celle-ci.
C’est dans ce cadre d’un va-et-vient didactiquement organisé qu’il s’agit de penser la sollicitation et le partage de cette diversité d’interprétations et d’appréciations dont je parlais précédemment. Tant l’interprétation que l’appréciation gagnent en effet à s’appuyer alternativement sur des ressources communes et sur des ressources personnelles, et c’est précisément en activant davantage ces deux processus de lecture qu’on permet à l’élève de faire de sa lecture une expérience riche et motivante.
On sait par ailleurs que, outre ces deux opérations, les élèves, quel que soit leur âge, ont besoin d’être validés dans le rapport affectif qu’ils entretiennent avec les textes, ce qui passe par l’immersion référentielle dont parle Schaeffer (1999), par les activités fictionnalisantes dont parle Langlade (2007) (concrétisation imageante, cohérence mimétique, activité fantasmatique et réaction axiologique) et par l’identification aux personnages et aux situations narratives dont parlent Picard (1986) et Jouve (1993). Je tiens cependant à souligner que ces processus-là ne peuvent être que suscités mais que, contrairement à l’interprétation et à l’appréciation, ils ne peuvent jamais être garantis ni donc évalués. En effet, si tout texte peut être interprété et apprécié d’une manière ou d’une autre, tout texte ne suscite pas nécessairement une activité fantasmatique de la part du lecteur, si impliqué soit-il. Pour cette raison, la «lecture subjective», pour «souhaitable» qu’elle soit (en tant que source d’agrément et d’épanouissement du lecteur), ne peut constituer à mes yeux une condition de réussite de la lecture scolaire.
2.4. Articuler travail sur le récit et étude de la tension narrative
Enfin, c’est dans cette perspective – d’une lecture des récits en prise avec les émotions – que j’accorde une importance stratégique à la notion de tension narrative telle que l’a modélisée Raphaël Baroni (2007, 2017). Comme je l’ai écrit ailleurs (Dufays 2014), pour être porteuse de valeurs et d’apprentissages auprès des élèves, la lecture en classe des textes narratifs gagne à être conçue comme une activité collective qui amène l’ensemble des élèves à participer à la coconstruction du sens en interrogeant le texte dans sa progression et dans sa tension. Cela suppose de le découper en «lexies», en multipliant les «arrêts sur image» comme le faisait Barthes dans S/Z (1970), de manière à s’interroger pas à pas sur l’évolution non seulement de l’intrigue mais aussi de sa tension narrative et des effets thymiques que sont le suspense et la curiosité. Procéder de la sorte permet tout à la fois d’ancrer l’enseignement de la lecture dans une conception de la narratologie actualisée et plus en prise avec le fonctionnement des lectures effectives.
On l’aura compris, si l’on excepte ma suggestion finale sur la tension narrative, les propositions qui ponctuent ces quelques pages sont moins centrées sur les outils narratologiques proprement dits que sur leur usage et, plus précisément, sur les opérations de lecture auxquelles ils sont nécessairement associés. Cela étant, je tiens à réaffirmer le caractère clairement engagé de ces propositions. Au sein du récit des avatars scolaires de la narratologie, je n’ai guère l’illusion d’être le sujet-héros de la quête qui résoudra le manque de l’objet du désir: je me vois tout au plus comme un Petit Poucet qui s’échinerait à semer quelques cailloux pour tenter de ne pas trop se perdre en chemin.
Bibliographie
Adam, Jean-Michel & Revaz, Françoise (1996), L’analyse des récits, Paris, Seuil.
Aeby Daghé, Sandrine & Sales Cordeiro, Glaís (2020), «Coconstruire le système récit-personnages: un genre d’activité scolaire oral au service de la compréhension d’albums de littérature de jeunesse», Recherches, n°73, p. 173-191.
Aeby Daghé, Sandrine, Sales Cordeiro, Glaís, Blanc, Anne-Claire & Coppola, Anthony (2020), «Une notion didactique en construction: le système récit-personnages», La Lettre de l’AIRDF, n°67, p. 19-22.
Baroni, Raphaël (2020), «Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement: schéma quinaire et focalisation en débat», Transpositio, n°2. En ligne, consulté le 30 aout 2023, URL: https://www.transpositio.org/articles/view/pour-des-concepts-narratologiques-intelligibles-et-utiles-pour-l-enseignement-schema-quinaire-et-focalisation-en-debat
Baroni, Raphaël (2017), Les rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine érudition.
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative. Suspense, curiosité, surprise, Paris, Seuil.
Barthes, Roland (1970), S/Z, Paris, Seuil.
Barthes, Roland (1966), «Introduction à l’analyse structurale des récits», Communications, 8, p. 1-27.
Brunel, Magali, Dufays, Jean-Louis, Émery-Bruneau, Judith & Florey, S. (dir.) (à paraitre), La progression en lecture au fil de la scolarité: une recherche internationale, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Brunel, Magali, Dufays, Jean-Louis, Capt, Vincent, Barthélemy, Marie & Fontanieu, Valérie (2021), «Lire une nouvelle en extraits avec des élèves de 9 à 15 ans: quels aspects du texte et quelles variations?», Repères, n°64, p. 53-73.
Brunel, Magali, Dufays, Jean-Louis, Brun-Lacour, Isabelle & Fontanieu, Valérie (2020), «Lire et faire lire un texte littéraire au secondaire: quelle progression entre les niveaux 7 et 10 de la scolarité?», Repères, n°62, p. 91-111.
Cèbe, Sylvie & Goigoux, Roland (2009), Lector et Lectrix, Paris, Retz.
Dufays, Jean-Louis (dir.) (2023), Formuler une appréciation sur une œuvre culturelle. Des outils et des pistes d’action à développer au fil de la scolarité, Bruxelles, SeGEC.
Dufays, Jean-Louis (2019), «Comment évalue-t-on les textes littéraires? Une typologie des valeurs et des modes d’évaluation ou d’appréciation», Recherches & Travaux, n°94, Valeur(s) de/dans l’enseignement des textes littéraires, N. Rouvière (dir.). En ligne, consulté le 30 aout 2023, URL: https://journals.openedition.org/recherchestravaux/1605
Dufays, Jean-Louis (2014), «De la tension narrative au dévoilement progressif. Un dispositif didactique pour (ré) concilier les lectures du premier et du second degrés», in Les passions en littérature. De la théorie à l’enseignement, R. Baroni & A. Rodriguez (dir.), Lausanne, Etudes de lettres, 2014-1, p. 133-150.
Dufays, Jean-Louis (2010), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang (1re édition Mardaga, 1994).
Dufays Jean-Louis (1997), «Lire au pluriel. Pour une didactique de la diversité à l’usage des 14-15 ans», Pratiques, n°95, p. 31-52.
Falardeau, Éric (2003), «Compréhension et interprétation: deux composantes complémentaires de la lecture littéraire», Revue des sciences de l’éducation, 29 (3), p. 673–694.
Fayol, Michel (1985), Le récit et sa construction: une approche de psychologie cognitive, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature. La relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Glaudes, Pierre & Reuter, Yves (1998), Le personnage, Paris, P.U.F. (Que sais-je?)
Jouve, Vincent (1993), La lecture, Paris, Hachette (Contours littéraires).
Jouve, Vincent (2012), «De la littérature comme remède à la prostitution: "La Connaissance de l’amour" de M. Nussbaum», Acta fabula, vol. 13, 3, Après le bovarysme. En ligne, consulté le 30 aout 2023, URL: http://www.fabula.org/acta/document6897.php].
Langlade, Gérard (2007), La lecture subjective, Québec français, n°145, p. 71-73.
Picard, Michel (1986), La lecture comme jeu. Essai sur la littérature, Paris, Minuit.
Propp, Vladimir (1970), Morphologie du conte, Paris, Seuil (Points).
Reuter, Yves (2016), L’analyse du récit, Paris, Armand Colin (128).
Reuter, Yves (1988), «L’importance du personnage», Pratiques, n°60, p. 3-22.
Ronveaux, Christophe & Schneuwly, Bernard (dir.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang.
Sauvaire, Marion (2013), Diversité des lectures littéraires: comment former des sujets lecteurs divers? Thèse de doctorat, Québec, Université Laval.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction? Paris, Seuil.
Schneuwly, Bernard & Thévenaz-Christen, Thérèse (dir.) (2006), Analyses des objets enseignés. Le cas du français, Bruxelles, De Boeck.
Tauveron, Catherine (1995), Le personnage. Une clef pour la didactique du récit à l’école élémentaire, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Pour citer l'article
Jean-Louis Dufays, "Situation et perspectives de l’étude du récit dans les classes de français aujourd’hui", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/situation-et-perspectives-de-l-etude-du-recit-dans-les-classes-de-francais-aujourd-hui
Voir également :
Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction
LIMINAIRE Dans l’introduction de son ouvrage Les rouages de l’intrigue, Raphaël Baroni (2017) reconnait sans ambages avoir fondé sa proposition épistémologique et didactique de renouvellement narratologique sur des œuvres issues du canon littéraire, plutôt que sur un corpus davantage contemporain et notamment lié au phénomène avéré de Transmedia Storytelling (Jenkins, 2007; Jenkins, Ford et Greene, 2013), cela à son corps défendant
Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction
LIMINAIRE
Dans l’introduction de son ouvrage Les rouages de l’intrigue, Raphaël Baroni (2017) reconnait sans ambages avoir fondé sa proposition épistémologique et didactique de renouvellement narratologique sur des œuvres issues du canon littéraire, plutôt que sur un corpus davantage contemporain et notamment lié au phénomène avéré de Transmedia Storytelling (Jenkins 2007; Jenkins, Ford et Greene 2013), cela à son corps défendant:
J’ai donc exclu à la fois les productions romanesques des siècles précédents, les œuvres qui appartiennent à la littérature dite «populaire», et d’autres médias dans lesquels l’intrigue occupe une place centrale: le théâtre, le cinéma, les séries télévisées, la bande dessinée, les pratiques ludiques ou vidéoludiques, voire l’interaction entre ces différents médias, qui correspond à ce phénomène qu’Henry Jenkins a récemment baptisé le «transmedia storytelling». Il ne faudrait pas conclure de cette exclusion à un défaut d’intérêt de ma part ou à un mépris pour ces objets. Bien au contraire, je suis convaincu qu’il est nécessaire d’ouvrir l’étude du récit à l’ensemble des formes narratives, qu’elles soient élitistes ou populaires, expérimentales ou conventionnelles, littéraires ou extralittéraires, verbales ou visuelles, analogiques ou numériques (Baroni 2017: 19).
C’est en reprenant à mon compte la toute dernière proposition de l’extrait qui précède que je souhaite contribuer, dans ce bref essai, à une défense étayée, didactique et surtout actualisée de la problématique contemporaine du recours aux moyens et outils1 narratologiques en classe de français/littérature, cela à partir du cas précis du contexte pédagogique qui prévaut actuellement au Québec. La très persistante (r)évolution médiatique n’est pas sans générer certaines frictions socioculturelles entre groupes et sous-groupes sociaux de plus en plus réseautés, c’est-à-dire préoccupés par leurs intérêts mutuels propres (Jenkins, Ford et Greene 2013; Grumbach 2022; Lacelle, Acerra et Boutin 2023). Cette transformation progressive de l’espace de médiatisation de l’imaginaire et de la pensée (Gervais, 2023) ne cesse de générer, dans sa foulée, de nouvelles formes, souvent hybrides, du récit littéraire (Bootz 2011; Bouchardon 2014; Brunel, Quet et Massol 2018; Brehm et Lafleur 2019). De telles métamorphoses, qui vont de l’emprunt plutôt cavalier à certains fleurons de la tradition littéraire jusqu’à de radicales délinéarisations2 augmentées du temps et de l’espace narratifs, imposent, il me semble, une réelle ouverture des corpus narratifs mobilisés en enseignement du français. En cette époque de tous les possibles, ou presque, en matière de fiction (ré)inventée, un recours, même des plus modestes, à la narratologie contemporaine et à certains de ses outils, par exemple la mise en abîme de l’intrigue, semble nécessaire, voire incontournable, afin d’aider les lecteur·rice·s - en formation ou non - à mieux participer à toutes ces nouvelles expériences du récit (Jenkins, Ito et Boyd 2013; Serafini 2022) et, surtout, à en faire véritablement sens.
Le développement fulgurant des chaînes médiatiques spécialisées telles Netflix, Amazon Prime Video, HBO ou Disney+ ou, tout aussi frappant, celui de la transfiction (St-Gelais 2011), qui s’incarne dans une multitude de formes allant de l’adaptation classique (album illustré, bande dessinée, théâtre, cinéma, etc.) à la fanfiction la plus marginale, en passant par le jeu vidéo ou le comic-con, implique nécessairement une démocratisation des expériences de la fiction narrative. Comment la classe de français/littérature, traditionnellement dédiée à l’analyse du récit3 pourrait-elle logiquement faire l’impasse sur un tel développement? Cela lui permettrait, par la même occasion, de s'inscrire logiquement dans le mouvement actuel de révision de la narratologie classique.
1- Les programmes québécois sous la loupe narratologique
Souhaiter le renouvellement de l’enseignement/apprentissage du récit contemporain de fiction (Baroni 2017; Brunel et Bouchardon 2020; Dufays 2023; Dufays et Brunel 2023) en classe de français, à partir notamment d’un corpus davantage en correspondance avec ses formes actuelles et à venir, présuppose que les pratiques didactiques qui incarnent les contenus des instructions officielles en matière de narratologie soient minimalement l’objet d’une certaine cure de jouvence. C’est du moins le cas spécifique du Québec, où lesdits programmes de français n’ont plus été mis à jour depuis 1994 au collégial, 2001 au primaire et 2006 au secondaire… On constate alors, dans leur appareillage narratologique respectif, la présence d’éléments assurément familiers, car susceptibles d’incarner une certaine rigidité formaliste.
La figure 1 qui suit synthétise assez efficacement les éléments de contenu narratologique (compétences, savoirs, outils, approches préconisées etc.) promulgués en contexte québécois au primaire et au secondaire. Sans surprise, on y retrouve les usuels «éléments constitutifs d’une histoire», «suite d’évènements», «quête d’équilibre», «schéma narratif», «cohérence et organisation» et autre «justification», autant d’items conceptuels qui imposent une approche surplombante, voire carrément structuraliste, du système narratif, et ce, tout au long du parcours scolaire québécois.
Figure 1. Un extrait de la Progression des apprentissages au secondaire (MÉLSQ, 2011)
|
Dans la foulée, un examen encore plus minutieux des programmes québécois, ainsi que des progressions des apprentissages qu’on leur a associées, du moins au primaire et au secondaire, permet très rapidement d’en arriver au constat manifeste, car univoque, que les savoirs et approches didactiques liés à la narratologie y demeurent foncièrement formalistes. Cette approche traditionnelle des formes, structures et caractéristiques du récit de fiction repose effectivement sur les conventions d’un formalisme littéraire fortement arrimé aux propositions conceptuelles des Propp, Greimas, Stanzel, Todorov, Genette, Bremond et consorts. Dans ce sens, cette focalisation persistante sur le formalisme narratif4, aussi bien en réception littéraire qu’en production de fiction narrative, semble correspondre, grosso modo, à la situation qui prévaut encore dans les milieux éducatifs formels, comme le rappelle Baroni:
L’un des succès imputables à la narratologie formaliste tenait à sa capacité de forger des outils aisément mobilisables, permettant de décrire, plus ou moins objectivement et avec un vocabulaire standardisé, la manière dont les textes narratifs se structurent. Ce rendement heuristique a permis à ces outils [de] se pérenniser dans les pratiques d’enseignement: schéma actantiel, schéma quinaire, prolepses, analepses, temps, voix et modes du discours font désormais partie de la vulgate enseignée aux apprentis lecteurs (2017: 17)
On pourrait donc arguer que la destinée de la didactique du récit de fiction, sous l’influence des contingences naturelles de la pratique enseignante québécoise, s’est très rapidement métamorphosée en véritable enseignement/apprentissage d’une grammaire narrative, à l’instar de la très forte ascendance, en didactique de l’écriture, du poids constant des normes et usages grammaticaux. Conséquemment, on a vu se démultiplier en classe de français/littérature, aussi bien au primaire qu’au secondaire, les situations d’évaluation – très majoritairement sommatives – où l’élève québécois devait (re)produire, à l’aide des outils narratologiques formalistes, des discours très fortement attendus. En somme, au cours des cent dernières années, on serait passé au Québec, en matière de narratologie scolaire, d’un premier discours didactique fondé sur l’imitation du canon littéraire (Melançon, Moisan et Roy 1988) à un second, officiellement en rupture avec le premier, mais finalement – et paradoxalement – toujours «reproductif»: «…il [ l’élève ] est invité à s’inspirer des textes lus ou entendus pour, à son tour, construire un univers dans lequel il campera une mise en intrigue» (MÉLSQ 2011).
Je nuancerai quelque peu, toutefois, un constat qui peut paraitre sans appel. En effet, on retrouve certes, dans les instructions officielles du ministère de l’Éducation du Québec, quelques éléments qui peuvent être associés à une approche postclassique5 (Herman 1997; Prince 2008; Sternberg 2011, Baroni 2017) – post formaliste et post structuraliste –, de la narration de fiction. Il y est bel et bien question, par exemple, de la notion de «mise en intrigue». On souhaite visiblement que l’élève adopte une sorte de méthodologie narrative qui repose d’abord et avant tout, j’insiste, sur la reproduction formelle et sans doute monolithique du récit, évaluation oblige, plutôt que sur son analyse approfondie, ses potentialités, son éventuelle déconstruction, etc.
On demeure donc toujours loin du projet de Gerald Prince (2006): «au moyen de nouveaux instruments, de corpus élargis et d’inflexions originales, la narratologie post-classique nous encourage à identifier ou à (ré)examiner différents aspects du récit et à les (re)définir et les (re)configurer». Aucune proposition des textes officiels du Québec évoque, par exemple, la «curiosité», la «tension», les «voix» ou les «modes» narratifs (Baroni 2017 et 2020), pas plus que la «fonction» et la «signification» de la narration, le «récit comme processus» ou son «incorporation de la voix du lecteur/récepteur» (Prince 2006 et 2008).
Il semble toutefois inévitable que, sous l’influence de l’évolution massive du paysage techno médiatique, des enseignant·e·s québécois·e·s aient intégré, implicitement, certaines notions profanes, du moins aux yeux de notre ministère, ou même académiques, qui peuvent être associées à la narratologie post formaliste. Je pense, par exemple, à la relative montée en force, dans plusieurs classes de fin du secondaire, de l’autofiction et du récit autobiographique. Ces derniers aspects renversent, ou du moins questionnent, nombre de principes, codes et procédés narratifs classiques, comme le souhaite explicitement Prince, et interpellent de plus en plus la multimodalité sémiotique, notamment en contexte numérique (Brunel 2012; Lacelle, Boutin et Lebrun 2017), comme véhicule du récit (Florey, Jeanneret et Mitrovic 2019).
Espérons surtout que le tout récent rappel – juin 2023 – des programmes de français du primaire et du secondaire par l’actuel ministre de l’Éducation constituera, pour la didactique de la littérature en contexte québécois, l’occasion tant attendue de convaincre les autorités concernées de procéder enfin à un ajustement sensible des contenus des instructions officielles en matière de narratologie contemporaine. Entre rapport intuitif et rapport formaliste au récit (Baroni 2017; David 2014), ladite refonte sera l’occasion, cela s’impose, d’inscrire par exemple le recours à des outils narratifs contemporains au sein du cursus québécois. Il en va, au bout du compte, des dispositions de l’élève à (re)penser son imaginaire intrinsèque afin que celui-ci corresponde toujours mieux aux valeurs, attentes et appréhensions de son devenir (Gervais 2018).
2- Le labyrinthe comme métaphore narratologique: Vic, phénomène d'interaction narrative
Au-delà donc des écrits épistémologiques, conceptuels et ministériels, il me semble fondamental de réfléchir – notamment de façon phénoménologique (Boccaccini 2023; Dufourcq 2014) – aux ancrages pragmatiques d’une tension narrative (Baroni 2020) qui doit nécessairement justifier une certaine mobilisation – qu’elle soit formelle ou implicite – des outils proposés par l’actuel mouvement de rénovation de la narratologie. Il en va de sa contribution, notamment didactique, à la dynamique évolutive des imaginaires contemporains. Pour ce faire, j’aimerais brièvement convoquer, en deux courts tableaux (figures 2 et 3), la description synthétique d’un cas de lecteur empirique (Ahr 2010; Guillemette et Cossette 2006; Louichon 2009), bref, un phénomène individuel (Dufourcq, 2014) d’interaction narrative.
Figure 2. Un phénomène d’interaction narrative (Vic, partie I) Vic, 53 ans et parfois qualifié d’adulescent attardé, gagne très bien sa vie grâce notamment à sa maitrise relevée de la réception (lecture). En début d’adolescence, on lui impose, en classe de français, la lecture de La communauté de l’anneau, tome premier du Seigneur des anneaux de l’écrivain J.R.R. Tolkien. D’abord rebuté, il se laisse lentement prendre au piège des rouages de l’intrigue (Baroni, 2017). Narrativement séduit, Vic se tourne alors vers Les deux tours et Le retour du roi, deuxième et troisième tomes du roman, puis vers son adaptation théâtrale avec marionnettes géantes, puis encore une autre en dessins animés, puis une relecture complète de l'œuvre, puis Bilbo le Hobbit. Sans surprise et deux décennies plus tard, il profite pleinement des adaptations au grand écran de ces romans canoniques, du moins dans le registre fantastique. Toutefois, et durant tout ce temps, un texte narratif beaucoup plus colossal, réputé labyrinthique, mythique, voire inextricable, attire Vic sans qu’il ne se sente capable d’y entrer… |
«Plus qu’un simple lieu imaginé, le labyrinthe est un imaginaire» écrit B. Gervais (2008: 23). Si cela se confirme, tel que nous le pensons, la conjugaison de la mécanique et de l’essence de l’intrigue narrative propre aux œuvres de fiction est une sorte de labyrinthe de l’imaginaire, un monde possible parmi des mondes possibles – Possible Worlds – (Pavel 1988; Ryan 1991; Schaeffer 1999; Bell et Ryan 2019; Lavocat 2019; Bell 2019; Martin 2019). Tolkien, en l'occurrence, ne viendra jamais à bout de son imaginaire labyrinthique, finalement rejoint par le minotaure temporel. En effet, il faudra plusieurs décennies à son fils Christopher pour achever son Possible World. Or une véritable fin est-elle narrativement souhaitable ? «Le labyrinthe et la fin se rejoignent dans leur capacité à faire entendre nos appréhensions les plus graves sur le monde et son destin» (Gervais 2008: 197). Au-delà de ce questionnement en spirale, il n’en demeure pas moins que les récepteur·rice·s de la fiction narrative en arrivent invariablement, quelle que soit l’intrigue à dénouer, au même dilemme narratif: sortir du récit ou le prolonger aussi longtemps que possible, briser le cycle ou le faire durer.
Figure 3. Un phénomène d’interaction narrative (Vic, partie II) Novembre 2022. Vic s’est enfin décidé: il ouvre son édition anglaise de The Silmarillion. Heureux hasard, il tombe sur la carte – en insertion – du royaume mythique de Beleriand. Il entre dans l’archi labyrinthe de Tolkien: son legendarium. Plus d’une année passe et Vic y est toujours. Il dispose toutefois d’un support techno numérique qui lui permet d’évoluer, plus ou moins subjectivement, à travers un faisceau très complexe de nœuds, tensions et rouages trans narratifs. En effet, Vic se tourne vers The Nerd of the Ring, un booktubeur qui, comme son nom le laisse entendre, se révèle exégète du legendarium. Dans la foulée, Vic découvre The Tolkien Gateway, un wiki dédié aux mondes possibles de l’univers tolkienien. Il décèle aussi une présentation vidéo de L’atlas de la Terre du Milieu, cartographie de la géographie imaginée par Tolkien, puis se procure l’ouvrage en question. Insatiable, ou presque, Vic amplifie alors son intense déambulation narrative: lectures du Silmarillion en traduction française6, de la carte du Beleriand7, de La chute de Gondolin8, de Beren et Luthien9, de The Making of Middle-Earth. The Worlds of Tolkien and The Lord of the Rings10 et même d’un très universitaire Tolkien et les sciences11. Vic s’enfonce de plus en plus loin dans un espace-temps transfictionnel où des points de repère narratologiques se révèlent indispensables. |
La description de ce cas, tout à fait réel, de récepteur reconnu comme expert, mais volontairement captif du legendarium tolkienien, cherche à exemplifier le plus clairement possible, malgré sa singularité apparente, la prévalence confirmée de l’imaginaire – et donc du récit – comme besoin intrinsèque de l’existence (Gervais 2008; 2018; 2023). Un état de fait qui présuppose nécessairement un recours, même infime, à la narratologie, à ses outils et/ou à ses accointances épistémologiques lorsqu’on se retrouve plongé dans tout labyrinthe narratif, quelle qu’en soit l’envergure.
De là à amorcer l’actualisation du socle narratologique en classe de français/littérature, il n’y a, il me semble, qu'une distance millimétrique à franchir. Un tel devoir didactique semble d’autant plus évident et fondamental dans un contexte social que l’on devrait qualifier, désormais, de posthumaniste (Braidotti et Hlavajova 2018; Boutin 2019), et ce, dans le sens précis d’un «au-delà de l’humanisme» qui ne rejette en rien ce dernier et qui, surtout, relativise davantage le rôle de l’humain au sein de l’écosystème global (Besnier 2009; Braidotti 2013; Baquiast 2014). Y cohabitent maintenant, en guise d’illustration, des pratiques analogiques et/ou numériques du récit où la démultiplication, l'hybridation, la mise en communauté par réseau, le moissonnage par algorithme et la virtualisation entrent dans le jeu omniscient de la fiction narrative (Bouchardon 2014; Brunel 2021; Grumbach 2022; Lacelle, Acerra et Boutin 2023).
Or à quoi pourrait donc ressembler cette actualisation posthumaniste que je souhaite vivement à la classe de français/littérature québécoise, notamment en matière de narratologie? Les lignes qui suivent esquisseront, encore trop sommairement car la réflexion disciplinaire reste en ébullition, les grandes lignes d’un projet à consolider collectivement.
3- Quelles épistémologies, quels outils, quelles dispositions?
Spéculative il y a encore quelques années, force est de constater, à partir de l’exemple du récepteur Vic, que la théorie des mondes possibles en fiction correspond désormais à des pratiques réelles et signifiantes de la fiction narrative. Ces dernières sont d’ailleurs exacerbées par l’omniprésence du numérique qui les propulse dans des directions toujours plus inédites et novatrices (Bouchardon 2014; Brunel et Bouchardon 2020). Pour ces raisons éminemment pragmatiques, elle devrait être convoquée en enseignement formel du récit. De tels mondes possibles, en tant qu'univers fictionnels autonomes, possèdent chacun une valeur plausible et potentielle de vérité – une ontologie – qui transcende le monde fictif sous-tendu par l’articulation concrète de la narration (Pavel 1988).
D’ailleurs, Alice Bell (2019) fait remarquer que les fictions numériques se nourrissent assez systématiquement de cette ambiguïté ontologique, utilisant le virtuel numérique pour se jouer constamment de la frontière entre fiction et réalité. En fait, il m’apparait manifeste que les univers narratifs ontologiquement crédibles, par exemple le fameux legendarium de Tolkien, font mouche précisément parce qu’ils rendent plausible toute la densité de leur réseau propre d’intrigues par la création interne d’un ensemble de lois intelligibles qui respectent en tout temps l’intelligence (Martin 2019) tout comme l’imaginaire (Gervais 2023) et la subjectivité des lecteur·rice·s.
Toujours dans cette veine de l’ontologie narrative, Lavocat (2019) démontre comment, dans les multivers à vocation ludique, les environnements «multijoueurs» et les jeux à joueur unique, la trame narrative est constamment refaçonnée, remodelée, remixée par l’interaction de l’acteur – le récepteur/producteur – avec l’intelligence artificielle qui régit l’ensemble du récit-jeu. Ces «néo» formes de la narration, et toutes celles à venir, nécessitent donc qu’on ait recours à des clés narratives de compréhension et d’intégration – en élaboration – qui s’éloignent, sans toutefois les rejeter, des seuls outils formalistes et structuralistes – lire… humanistes – et qui, surtout, permettent aux lecteur·rice·s de mieux discerner et disséquer le sens qui y est mis en jeu (Prince 2006).
D’autre part, une didactique revampée de la littérature devrait nécessairement convoquer davantage des propositions conceptuelles résistantes, objectivantes et oh combien actuelles, mais fortement marginales en classe, du moins au Québec. Il est avéré, par exemple, que l’identification et surtout la prise en considération, par les lecteur·rice·s et/ou producteur·rice·s de récits, des stéréotypes narratifs facilitent, densifient et relancent leurs pratiques de la fiction (Brehm et Lafleur 2019; Dufays et Kervin 2010 et 2020; Dufays, Gemenne et Ledur 2015).
Je retiens d’abord, sans aucune surprise, la transfiction / transfictionnalité (Besson, 2007; Ryan, 2007; St-Gelais, 2011), appelée Transmedia Storytelling (Jenkins, 2007; Jenkins, Ford and Green, 2013) dans le monde anglo-saxon. Autant pour sa pertinence en tant que telle que pour son apport à une approche postclassique de la narratologie, la transfiction permet notamment de 1- cartographier la trajectoire (multi)médiatique d’un récit premier qui génère toute une arborescence de récits seconds, tiers, etc., 2- identifier et analyser les métamorphoses que les récits de ce nouveau réseau – et leurs différentes composantes narratives (tension, voix, modes, processus, etc.) proposent au récepteur, 3- relancer éventuellement cette chaîne d’histoires filiales par la production, grâce à différents outils narratifs, de nouvelles intrigues, de nouveaux cadrages et séquences, de nouvelles narrations, tensions, et dualités, etc. D’ailleurs, une seconde proposition qu’il me semble importante d’appeler en classe permet d’explorer avec encore plus de finesse et de profondeur l’évolution narrative des différentes œuvres de (trans)fiction: la mimèsis aristotélicienne (Ricoeur 1983; Baroni 2010), associée à la stéréotypie littéraire (Dufays 2010; Dufays et Kervyn 2010 et 2020; Daignault 2010; Connan-Pintado 2019). On pourra évidemment réserver pour le second cycle du secondaire un tel regard analytique sur la (re)production par leur appropriation, par exemple, de la diégèse, de l’intrigue et autres tensions.
En fin de parcours primaire, il serait même souhaitable de densifier cette longue et lente exploration de l’imaginaire, amorcée avant même le début de la scolarisation, voire dès le berceau, par une approche de lecture dialogique, qui tente précisément, et progressivement, d’aider les élèves à mieux discriminer, notamment à partir du matériel narratif et de ses différents outils, la vraisemblable objectivé de ce qui relève plutôt du fictif12. Dans ce cas précis, on suggère de discuter, à partir des récits de (semi)fiction historique, des différents rapports qui s'inscrivent entre discours savants et discours profanes dans l’élaboration de la mémoire et de la conscience collectives (Éthier et Lefrançois 2021). Bref, ces quelques approches ont chacune le mérite de proposer aux élèves une riche grille réflexive qui, adéquatement transposée en didactique de la fiction narrative, peut réellement contribuer à consolider leur rapport individuel et partagé aux récits qu’ils croisent tout au long de leur parcours scolaire, certes, mais aussi de leur vie adulte.
Une toute dernière piste d’émulation mérite, à mon avis, son paragraphe: la multimodalité13 narrative (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017; Serafini 2022). Rappelons d’abord les propos visionnaires de David Herman lorsqu’il précisait que «la narratologie peut maintenant s’employer pour désigner toute approche raisonnée de l’étude du discours narrativement organisé, qu’il soit littéraire, historiographique, conversationnel, filmique ou autre» (Herman 1997: 27).
Évoquant implicitement les travaux fondateurs du New London Group (1996), Herman ouvre ainsi la porte à la rencontre de l’épistémologie narratologique avec la sémiotique sociale. Comme le démontre Kress (1997; 2010) et tou·te·s les autres chercheur·euse·s qui le suivront, les unités de sens sont intrinsèquement polymorphes et les registres de signes qui les constituent interagissent pour mieux concrétiser et véhiculer le sens, et ce, aussi bien du côté sensoriel-perceptif que de manière cognitivo-affective. La transaction du sens entre les individus repose alors sur les différentes ressources sémiotiques, qui servent de véhicule aux modes porteurs du sens. Tous les récits du désormais vaste spectre narratif, qu’ils soient «traditionnels», davantage contemporains ou de l’extrême avant-garde, n’échappent plus à cette dynamique formelle intrinsèquement sémiotique et, dans ce sens, le travail de décryptage, de compréhension et d’intégration des signes, codes, modes et langages (Lacelle, Acerra et Boutin 2023; Serafini 2022) ne peut vraiment être accompli qu’avec la convocation de l’appareil conceptuel et des outils d’une narratologie actualisée.
Conclusion
Le lecteur en formation – formelle ou informelle – a plus que jamais besoin, en cette époque où pullulent tous les imaginaires (Gervais 2018) et encore tant d’autres à venir en autant de métavers (Lacelle, Acerra et Boutin 2023), de repères narratologiques. L’enseignement/apprentissage de la fiction narrative doit alors léguer à ce récepteur (inter/hyper)actif d’indispensables moyens de compréhension, certes, mais aussi de réaction et surtout d’engagement réel avec le fait fictionnel, car il en va de son rapport au monde qui a été, qui est, et qui, bien sûr, vient. Bref, son rapport au temps comme triple expérience du récit narratif (Picard 1989; Florey et Cordonier 2020): déchiffrement, fictionnalisation et mise hors-temps (mythification) du temps. Voilà, à mon humble avis, l’un des devoirs disciplinaires parmi les plus pressants pour le champ disciplinaire concerné.
Or il ne faudrait surtout pas se contenter de reproduire – assez bêtement – les pratiques cristallisées du passé à l’occasion d’une telle reconfiguration de la didactique du récit, c’est-à-dire remplacer, sans considération à l’égard de l’histoire scolaire des dernières décennies, une «grammaire» par une autre. Le préfixe post, dans «posthumanisme» comme dans «narratologie post classique», implique, j’ose le rappeler, de façon intrinsèque, et à partir des acquis d’hier et de jadis, de faire plus et surtout de faire mieux. Je ne voudrai jamais, personnellement, d’une classe de littérature où les élèves seront évalués, encore et toujours, en fonction de leur seule capacité à accumuler et à recracher sans raisonnement ancré, ni signifiance réelle pour leur propre imaginaire, des savoirs narratologiques manifestement déconnectés, tout aussi postclassiques qu’ils soient. Mieux vaudra alors, pour l’imaginaire individuel, de se perdre sans fin dans le labyrinthe de son choix.
Bibliographie
Acerra, Eleonora (2019), Les applications littéraires pour la jeunesse. Œuvres et lecteurs, thèse de doctorat, Montpellier, Université Paul Valéry.
Alber, Jan et Monika Fludernik (dir.) (2010), Postclassical Narratology: Approaches and Analyses, Columbus, Ohio State University Press.
Ahr, Sylviane (2009), D’une lecture empirique à une lecture subjective argumentée: quels processus cognitifs et langagiers mobiliser ?, Genève, Unige: https://www.unige.ch/litteratures2010/contributions_files/Ahr%202010.pdf
Baquiast, Jean-Paul (2014), Ce monde qui vient: sciences, matérialisme et posthumanisme au XXIe siècle, Paris, L'Harmattan.
Baroni, Raphaël (2020), «Tension narrative», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir), Paris, Honoré Champion, p. 266-269.
Baroni, Raphaël (2017), Les rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël (2010), «Ce que l’intrigue ajoute au temps. Une relecture critique de Temps et récit de Paul Ricœur», Poétique, n° 163, p. 361-382.
Besnier, Jean-Michel (2009), Demain les posthumains: le futur a-t-il encore besoin de nous ? Paris, Fayard.
Bell, Alice (2019), «Digital Fictionality: Possible Worlds Theory, Ontology, and Hyperlinks», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 249-271.
Boccaccini, Frederico (dir.) (2023), Phénoménologie de l’action. Perspectives contemporaines sur l’agentivité et le sujet, Leiden, Brill.
Bootz, Philippe (2011), «La littérature numérique en quelques repères», in Lire dans un monde numérique, C. Bélisle (dir.), Presses de l’enssib. https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.1095
Bouchardon, Serge (2014), La valeur heuristique de la littérature numérique, Paris, Hermann.
Boutin, Jean-François (2019), «Posthumanisme, éducation et littératie multimodale et médiatique: une injonction», R2LMM, vol. 10, https://doi.org/10.7202/1065533ar
Boutin, Jean-François et Virginie Martel (2021), «Le roman graphique - bande dessinée - historique: entre discours profane et discours savant… une lecture dialectique» , in Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire (deuxième édition revue et augmentée), M.-A. Éthier et D. Lefrançois, p. 281-295.
Braidotti, Rosi (2013), The Posthuman, Cambridge, Polity Press.
Braidotti, Rosi et Maria Hlavajova (dir.) (2018), Posthuman Glossary, Londres, Bloomsbury.
Besson, Anne (2007), La fantasy, Paris, Klinksieck.
Brehm, Sylvain et Maude Lafleur (dir.) (2019), Formes et enjeux de la transmission dans les fictions contemporaines pour adolescents et adolescentes, Montréal, Nota bene.
Brunel, Magali (2021), L'enseignement de la littérature à l'ère du numérique. Études empiriques au collège et au lycée, Rennes, PUR.
Brunel, Magali et Serge Bouchardon (2020), «Enseignement de la littérature numérique dans le secondaire français: une étude exploratoire», R2LLM, vol 11, https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2020-v11-rechercheslmm05499/1071476ar/
Brunel, Magali, François Quet et Jean-François Massol (dir.) (2018), L'enseignement de la littérature avec le numérique, Bruxelles, Peter Lang.
Connan-Pintado, Christiane (2019), «Stéréotypes et littérature de jeunesse», Hermès, n° 83, p. 105 à 110.
Daignault, Marie-Christine, (2010), La stéréotypie ou l'art de persuader, mémoire de maitrise, Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi.
David, Jérôme (2014), «Chloroforme et signification: pourquoi la littérature est-elle si soporifique à l’école ?», in Les passions en littérature. De la théorie à l’enseignement, R. Baroni et A. Rodriguez (dir.), Études de Lettres, n° 295, p. 19-32.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Dufays, Jean-Louis (2023), «Innover en didactique de la littérature: pourquoi ? Comment ? À quelles conditions ? Avec quels effets ? Retour sur trente années d’expériences», Tréma, n° 59, https://doi.org/10.4000/trema.8070
Dufays, Jean-Louis (2010 [1994]), Stéréotype et lecture. Essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang.
Dufays, Jean-Louis et Magali Brunel (2023), «Innovations en lecture et en écriture littéraires. Questions et perspectives pour la recherche en didactique du français», Tréma, n° 59, https://doi.org/10.4000/trema.8085
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne et Dominique Ledur, (2015 [1996]), Pour une lecture littéraire. Histoire, théories, pistes pour la classe, Bruxelles, De Boeck.
Dufays, Jean-Louis et Béatrice Kervyn (2020), «Stéréotype», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 197-200.
Dufays, Jean-Louis et Béatrice Kervyn (2010), «Le stéréotype, un objet modélisé pour quels usages didactiques ?», Éducation et didactique, vol. 4, n° 1, p. 53-80.
Dufourcq, Annabelle (dir.) (2016), Est-ce réel? Phénoménologies de l’imaginaire, Leiden, Brill.
Éthier, Marc-André et David Lefrançois (dir.) (2021), Mondes profanes. Enseignement, fiction et histoire (deuxième édition revue et augmentée), Québec, PUL.
Florey, Sonya et Judith Émery-Bruneau (2023), «Innover en didactique de la poésie: quelle pérennité ?», Tréma, n° 59, https://doi.org/10.4000/trema.8289
Florey, Sonya et Noël Cordonier (2020), «Temporalités de la lecture», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir), Paris, Honoré Champion, p. 321-322.
Gervais, Bertrand (2008), La ligne brisée. Logiques de l’imaginaire, tome II, Montréal, Le Quartanier.
Gervais, Bertrand (2018), «L’imaginaire contemporain: plongées et contreplongées», in Soif de réalité: plongées dans l’imaginaire contemporain, B. Gervais et al. (dir.), Québec, Nota Bene, p. 7-15.
Gervais, Bertrand (2023), Un imaginaire de la fin du livre. Littérature et écrans, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Guillemette Lucie et Josiane Cossette (2006), «La coopération textuelle», in Signo [en ligne], L. Hébert (dir.), http://www.signosemio.com/eco/cooperation-textuelle.asp
Grumbach, Stéphane (2022), L'empire des algorithmes. Une géopolitique du contrôle à l'ère de l'anthropocène, Paris, Armand Colin.
Herman, David (1999), Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis, Columbus, Ohio State University Press.
Herman, David (1997), «Scripts, Sequences, and Stories: Elements of a Postclassical Narratology», PMLA, n° 112 (5), p. 1046-1059.
Jenkins, Henry (2007), «Transmedia Storytelling 101», Pop Junctions, http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html#sthash.gSETwxQX.dpuf
Jenkins, Henry, Sam Ford et Joshua Green (2013). Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New-York, NYU Press.
Jenkins, Henry, Mizumo Ito et Danah Boyd (2015). Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics, Cambridge, Polity Press.
Kress, Gunther (2010), Multimodality, Londres, Routledge.
Kress, Gunther (1997), Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy, Londres, Routledge
Lacelle, Nathalie et Jean-François Boutin (2020), «Multimodal, Multimodalité», in Un dictionnaire de didactique de la littérature, N. Brillant Rannou, F. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 158-162.
Lacelle, Nathalie, Eleonora Acerra et Jean-François Boutin (2023), «Compétence numérique, réception et production de contenu. Conceptualisation, manifestations et projections», in La compétence numérique en examen (titre provisoire), F. Michelot et S, Collin, Québec, PUQ (sous presse).
Lacelle, Nathalie, Jean-François Boutin et Monique Lebrun (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique: outils conceptuels et didactiques, Québec, Presses de l’Université du Québec
Langlade, Gérard (2004), «Sortir du formalisme, accueillir les lecteurs réels», Le français d’aujourd’hui, n° 145, p. 85-96.
Lavocat, Françoise (2019), «Possible Worlds, Virtual Worlds», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 272-295.
Louichon, Brigitte (2009), La littérature après coup: contribution à une théorisation du sujet lecteur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Martin, Thomas L. (2019). «As Many Worlds as Many Artists: Possible Worlds Theory and the Literature of Fantasy», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 201-224.
Melançon, Joseph, Clément Moisan et Max Roy (1988), Le discours d'une didactique. La formation littéraire dans l'enseignement classique au Québec (1852-1967), Québec, Nuit blanche éditeur.
MÉQ (2006), Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉQ (2001), Programme de formation de l’école québécoise.Enseignement primaire, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉSLQ (2011), Progression des apprentissages au primaire. Français, langue d’enseignement, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉSLQ (2011), Progression des apprentissages au secondaire. Français, langue d’enseignement, Québec, Gouvernement du Québec.
MÉLSQ (2007), Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, deuxième cycle, Québec, Gouvernement du Québec.
New London Group (1996), «A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures», Harvard Educational Review, vol. 66, n° 1, p. 60-92.
Pavel, Thomas (1988), Univers de la fiction, Paris, Seuil.
Picard, Michel (1989), Lire le temps, Paris, Minuit.
Prince, Gerald (2008), «Classical and/or Postclassical Narratology», Esprit Créateur, n° 48 (2), p. 115-123.
Prince, Gerald (2006), «Narratologie classique et narratologie post-classique», Vox Poetica, http://www.vox-poetica.org/t/articles/prince.html
Rabatel, Alain (2004), Argumenter en racontant. (Re)lire et (ré)écrire les textes littéraires, Bruxelles, de Boeck.
Ricœur, Paul (1983), Temps et récit 1, Paris, Seuil.
Ryan, Marie-Laure (2007), «La transfictionnalité dans les médias», in La fiction ? suites et variations, R. Audet et R. Saint-Gelais (dir.), Québec, Nota Bene, p. 131-153.
Ryan, Marie-Laure (1991), Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington, Indiana University Press.
Ryan, Marie-Laure et Alice Bell (2019), «Introduction», in Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, Bell, Alice et Marie-Laure Ryan (dir.), Lincoln, University of Nebraska Press, p. 1-46.
St-Gelais, Richard (2011), Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Seuil.
Schaeffer, Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction ? Paris, Seuil.
Serafini, Frank (2022). Beyond the Visual: An Introduction to Researching Multimodal Phenomena, New-York, Teachers College Press.
Serafini, Frank (2013), Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy, New-York, Teachers College Press.
Sternberg, Meir (2011), «Reconceptualizing Narratology. Arguments for a Functionalist and Constructivist Approach to Narrative», Enthymema, n° 4, p. 35-50.
Pour citer l'article
Jean-François Boutin, "Fragments herméneutiques et phénoménologiques pour une actualisation narratologique en didactique de la (trans)fiction", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/fragments-hermeneutiques-et-phenomenologiques-pour-une-actualisation-narratologique-en-didactique-de-la-trans-fiction
Voir également :
Synthèse des entretiens avec quelques témoins de la scolarisation des théories du récit
C’est lors d’une réunion de la petite équipe DiNarr (acronyme pour didactique et narratologie), dans les débuts du projet Pour une théorie du récit au service de l’enseignement, qu’a émergé l’idée d’aller collecter les témoignages de celles et ceux qui avaient pu contribuer au processus de scolarisation de la narratologie ou du moins en être les témoins privilégiés. En effet, les personnes que nous avons sollicité ont participé aux premiers numéros des revues qui se créaient dans ce moment particulier des années 1960‑70 (Pratiques, Repères, Le Français aujourd’hui…) et certaines d’entre elles ont été à l’origine d’ouvrages de synthèse maintes fois réédités à destination plus ou moins directe du corps enseignant.
Synthèse des entretiens avec quelques témoins de la scolarisation des théories du récit

C’est lors d’une réunion de la petite équipe DiNarr (acronyme pour didactique et narratologie), dans les débuts du projet Pour une théorie du récit au service de l’enseignement1, qu’a émergé l’idée d’aller collecter les témoignages de celles et ceux qui avaient pu contribuer au processus de scolarisation de la narratologie ou du moins en être les témoins privilégiés. En effet, les personnes que nous avons sollicité ont participé aux premiers numéros des revues qui se créaient dans ce moment particulier des années 1960‑70 (Pratiques, Repères, Le Français aujourd’hui…) et certaines d’entre elles ont été à l’origine d’ouvrages de synthèse maintes fois réédités à destination plus ou moins directe du corps enseignant. Le plus souvent enseignant·e·s elles·eux-mêmes à leurs débuts (ou faut-il dire militant·e·s pédagogiques?), ces chercheur·e·s ont ensuite investi le domaine académique et/ou le champ de ce qu’on n’appelait pas encore la didactique du français. D’une manière ou d’une autre ils ou elles sont donc les signatures toujours convoquées quand on parle de théories du récit et de ses usages scolaires.
Il nous a semblé ainsi intéressant de procéder à des entretiens pour documenter le processus complexe qui voit l’école s’approprier des notions théoriques, auréolées alors d’un halo de scientificité et de nouveauté, qualités particulièrement attrayantes dans un contexte de volonté de rénovation de l’enseignement du français et d’effervescence théorique. L’époque voit ainsi Barthes coordonner en 1966 le numéro 8 de Communications consacré à l’analyse structurale du récit, Todorov proposer le néologisme «narratologie» dans sa Grammaire du Décaméron (1969), Greimas poser les fondements de la sémiotique narrative (1970) et Genette signer en 1972 l’essai «Discours du récit», qui deviendra la pierre angulaire de la théorie narratologique dans sa forme classique et l’un des piliers inamovibles de la narratologie enseignée.
Dès 1969, un futur acteur de la didactique du français, Jean Verrier – qui sera longtemps le rédacteur en chef de la revue de l’AFEF –, pouvait ainsi témoigner, dans une page du Monde consacrée à «la théorie de la littérature», de l’émergence «d’autres méthodes d’enseignement» au lycée:
Plusieurs professeurs de français appartenant au groupe de recherche Enseignement 70 utilisent depuis quelques années les travaux relatifs à la théorie de la littérature pour aborder en classe l’étude d’œuvres romanesques ou poétiques.
À partir des articles sur l’analyse structurale du récit, dans Communications 8, on a fait noter par les élèves une chronologie très détaillée d’Eugénie Grandet en utilisant les indications données par l’auteur «Vers la mi-novembre… le lendemain… à 16 heures Charles descendit… huit jours plus tard…». En regard de cette chronologie, on relève la pagination et l’on établit un rapport entre ces deux échelles.
Nombreux sont alors celles et ceux qui s’enthousiasment pour ces «autres méthodes d’enseignement», les notions narratologiques apparaissant comme les instruments légitimes d’une meilleure école en ces temps de massification scolaire: plus explicites, plus scientifiques et plus démocratiques. Comme l’écrit Yves Reuter dans un article-bilan (2000: 12) intitulé «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», «on a sans doute fonctionné à cette époque sur l'illusion qu'une "meilleure" théorie engendrerait un meilleur enseignement qui, lui-même engendrerait un meilleur apprentissage.»
En 2001 déjà, Jean-Louis Dumortier lui aussi jetait, à l’occasion de la publication de sa thèse sous le titre Lire le récit de fiction, un regard rétrospectif sur cette «scolarisation» de la narratologie:
Il faut le reconnaître, ces pionniers de la didactique du français, hérétiques compte tenu de la tradition académique, hérétiques encore compte tenu de la tradition pédagogique dans l'enseignement secondaire, se sont parfois abandonnés au «démon de la théorie», comme dit Antoine Compagnon (1998), et l'on a vu quelques diablotins assez effrayants hanter les classes de français. Il est facile, à une vingtaine d'années de distance, de dénoncer les dérives d'innovations sans encadrement institutionnel, mais il n'est utile de déplorer les errances que pour les éviter à l'avenir. Et pour les éviter, il convient de s'aviser des risques que l'on court en adaptant, au niveau secondaire, des démarches caractéristiques de la recherche scientifique. (Dumortier 2001: 456)
Dans la continuité de ces regards en arrière, il nous a paru utile de donner la parole à celle et ceux qui furent de ces pionniers, que ce soit en proposant des ouvrages de synthèse dont les enseignant·e·s se sont souvent inspirés, en dirigeant des ouvrages et des revues où la scolarisation de la théorie du récit était promue ou discutée, ou encore en allant jusqu’à proposer des utilisations didactiques des notions narratologiques. Leurs témoignages nous ont paru représenter une source de données particulièrement précieuse dans l’effort pour documenter cet ensemble de processus complexes aboutissant à la scolarisation (Denizot 2021) de la narratologie.
On découvrira donc ici six contributions de noms bien connus dans le champ de la didactique du français et issus des différents coins de la francophonie: Yves Reuter, Jean-Louis Dumortier, Claude Simard, André Petitjean, Jean-Paul Bronckart ainsi que Jean-Michel Adam et Françoise Revaz dans un témoignage à deux voix. Sollicité·e·s par écrit, ces sept chercheur·euse·s ont accepté de nous livrer leur regard rétrospectif et critique en revenant sur leur parcours et leur propre contribution à la scolarisation de la narratologie. Des témoignages où se mêlent, on le verra, quelques regrets (Dumortier évoque l’intérêt qu’il aurait eu à se «casser un poignet» plutôt que de commettre certains de ses travaux), des critiques parfois (pour défendre un héritage face à des évolutions vues comme des dérives), des prudences beaucoup, et une invitation, surtout, à poursuivre la réflexion sur ces acquis théoriques, le plus souvent jugés fructueux.
Six questions leur ont été posées:
1. Dans une perspective diachronique, si vous deviez retracer les grandes étapes de l’entrée dans les classes des savoirs issus de la narratologie, quels colloques, évènements pédagogiques (nouveaux programmes…) et publications citeriez-vous?
2. En conséquence, quelles seraient, selon vous, les modalités particulières du phénomène de transposition didactique des concepts narratologiques à l’époque de leur entrée dans les classes de français?
3. Quel regard rétrospectif portez-vous sur votre contribution à ce processus historique?
4. Selon vous, quels sont les concepts narratologiques les plus souvent mobilisés dans les classes et pour quelle raison ont-ils connu une telle fortune? Par ailleurs, quels autres concepts négligés auraient mérité un meilleur sort?
5. De votre point de vue, avec le recul dont vous disposez aujourd’hui, les concepts narratologiques tels qu’ils sont mobilisés dans l’enseignement ont-ils plutôt marqué un progrès ou ont-ils conduit à une détérioration de l’enseignement-apprentissage du français?
6. Comment percevez-vous la place de l’analyse du récit dans le cadre des évolutions actuelles du champ de la didactique du français et de la société en général?
En interrogeant ainsi des acteurs dont la plupart commencent leur carrière académique dans le milieu des années 70, nous proposons donc une plongée dans la préhistoire de ce qu’on n’appelle pas encore la didactique du français. Ou dans son néolithique plutôt, puisque les outils se forgent et que, sans le titre encore, le champ est en train de se constituer. Chacun, avec sa sensibilité, y retourne pour évoquer, fort du temps écoulé, ce qui fut finalement leur jeunesse. Ainsi, pour André Petitjean:
En parallèle à notre formation académique, nous dévorons les ouvrages de linguistique (Saussure, Benveniste, Hjemslev, Jakobson, Greimas…) dont nous n’avons jamais entendu le nom au cours de nos études. Il est difficile d’imaginer dans quel état de déréliction théorique peut se trouver, à cette époque, un étudiant de Lettres dans un collège littéraire universitaire de province, et il faut avoir conscience de la situation de l’université.
Bertrand Daunay (2007: 21) rappelle à ce propos les intéressants questionnements de Ropé (1990: 149), à la suite des analyses de Bourdieu (1984), sur «le lien entre l’engouement de certains professeurs de lettres pour le structuralisme et le fait qu’ils sont souvent provinciaux, non normaliens et issus de disciplines "inférieures"». Il ajoute qu’embrasser la théorie structuraliste, c’était une manière de "se rétablir sur le terrain de la science"».
Mais au-delà des parcours individuels, c’est surtout la spécificité d’une époque de réformes profondes de l’enseignement du français qu’on lit en filigrane de ces témoignages. Ce processus se caractérise notamment par la volonté de démocratiser l’enseignement avec le «plan Rouchette» en France (évoqué par Jean-Paul Bronckart), le plan de «rénovation des programmes» en Belgique (ainsi que le rappelle Jean‑Louis Dumortier), et «l’enseignement rénové» du français en Suisse (comme le détaille Françoise Revaz.
Dans ce mouvement, et dans une époque que Claude Simard qualifie, à la suite de Sarraute, d’«ère du soupçon», les savoirs de l’enseignement littéraire traditionnel apparaissent comme obsolètes et renvoyant au subjectivisme, à l’encyclopédisme et à une historicité arbitraire et élitiste. André Petitjean précise quant à lui que ce rejet est alors rendu possible par l’émergence de nouveaux savoirs dits «savants» contrastant avec les méthodes fondées sur l’érudition et l’intuition. Les rapports entre ces différentes approches des textes littéraires prennent parfois le tour conflictuel de «luttes symboliques et institutionnelles assez violentes entre "modernistes" et traditionalistes», souligne Yves Reuter en citant l’ouvrage publié en 1978 Assez décodé de René Pommier, professeur à la Sorbonne.
Dumortier voit dans cette «effervescence pédagogique» une conjonction favorable issue «des ruptures dans le champ de la recherche, dans les programmes et dans le rapport des maitres à l’institution», de sorte que s’opère une transposition rapide des propositions théoriques émanant de ce que le didacticien belge appelle la première narratologie (Genette, Barthes, Bremond). À l’inverse, selon lui, cette conjonction ne s’est pas reproduite pour les travaux ultérieurs intégrant les apports de la psychologie cognitive (Fayol) ou se centrant plus sur l’interaction entre récit et lecteur (Iser, Eco, Marghescou…) alors que ceux-ci étaient susceptibles,
au prix d’une transposition didactique accessible, avalisée par l’institution et largement diffusée par l’édition scolaire, d’ébranler et, à terme, de ruiner les pratiques de lecture excessivement «formalistes» auxquelles avait donné lieu la réception scolaire de la première narratologie. Est-ce que c’est ce qui s’est passé? Je pense que non et je le déplore.
De transposition didactique, il est naturellement beaucoup question dans ces témoignages. La conceptualisation proposée par Chevallard (1985/1991) n’était évidemment pas encore disponible lorsque nos témoins signaient, pour la plupart, leurs premiers travaux, tout comme n’avaient pas eu lieu encore les intenses débats sur l’adéquation de cette perspective théorique à la didactique du français2. Dans leurs réponses à la question qui convoquait ce concept, Reuter et Bronckart précisent d’ailleurs leurs réserves quant à l’approche de Chevallard: le premier pour rappeler que la notion d’élaboration didactique, alternative proposée par Jean-François Halté (1992), a sa préférence pour décrire la complexité de la construction des contenus scolaires; le second pour fonder ces réserves sur l’hétérogénéité des domaines auxquels renvoient les savoirs narratologiques, «mais en raison surtout de la diversité, du peu de clarté voire de la confusion des objectifs didactiques ayant trait à ces notions». En abordant ainsi la question des finalités associées à l’enseignement des théories du récit, Bronckart pointe, nous semble-t-il, une leçon du passé importante dans les réflexions sur la place et les usages de notions narratologiques alternatives potentiellement intéressantes pour le monde scolaire:
Comme Veck, Fournier & Lancrey-Javal (1990) l’avaient montré à propos de la notion de thème, la transposition dans les programmes de littérature prend régulièrement la forme d’un déplacement sémantique résultant de l’insertion de ce terme nouveau dans un paradigme de termes anciens de valeurs parentes.
À notre avis, le problème majeur en ce domaine n’a pas trait à la richesse ou même à l’hétérogénéité des données théoriques, mais plutôt au fait que les visées et objectifs didactiques en ce domaine, et en conséquence la place et le statut que peuvent y prendre les notions et/ou concepts narratologiques, ne sont aujourd’hui pas clarifiés.
Simard abonde dans le même sens et invite ainsi à une réflexion sur les modalités d’une transposition tenant compte des configurations disciplinaires:
Au cours des cinquante dernières années, l’enseignement littéraire dans la classe de français me semble donc être passé successivement de la centration sur l’auteur, sur le texte puis sur le sujet lecteur, ce qui montre que la transposition didactique est en bonne partie tributaire de l’objet d’étude auquel on accorde la priorité.
Quand il est question d’interroger les modalités de scolarisation de la narratologie, les évolutions plus ou moins récentes des approches didactiques de la littérature sont également envisagées par certains de nos témoins, parfois de manière assez critique. Reuter semble ainsi vouloir remettre en perspective quelques présupposés souvent énoncés comme des évidences:
j’étais surpris par la manière dont certains avancent deux idées sans grand fondement pour moi (je ne connais pas véritablement d’études précises sur ces questions): la narratologie aurait envahi le champ de l’enseignement du français et ses usages auraient été néfastes, notamment en ce qu’elle aurait généré des récits plus stéréotypés qu’auparavant.
De son côté, Dumortier affirme que «la plupart des contempteurs du formalisme dans l’enseignement littéraire se sont acharnés sur ces savoirs au lieu de s’intéresser aux plus récents, qu’il y avait bien des raisons de promouvoir». Quant à Petitjean, il regrette également le peu de prise en compte des théories cognitives et psycholinguistiques de la lecture développées depuis les années 1980.
En contrepoint, à partir de l’exemple du parcours scolaire de sa fille «sanctionnée pour la rédaction d’un récit d’imagination dont le seul défaut était qu’il ne comportait pas toutes les phases du schéma», Revaz témoigne du caractère dominant du schéma quinaire, transformé en outil normatif par ce que la didacticienne suisse appelle sa «grammaticalisation». De manière plus lapidaire encore, Bucheton ne disait pas autre chose déjà en 2002 quand elle incriminait les «sempiternels schémas quinaire ou actanciel (…) introduit[s] dans les manuels du primaire sans être véritablement des objets d'étude spécifiés par les programmes» (Bucheton 2002: 8).
La plupart de nos témoins rangent en effet le schéma quinaire dans le haut d’une liste restreinte de notions narratologiques ayant connu le succès dans les pratiques scolaires. S’y retrouvent également le schéma actantiel de Greimas, les notions de narrateur ou de personnage, ainsi que les typologies genettiennes (voix, mode et temps du récit). Notons que Petitjean, dans son exploration du corpus de Pratiques, établit une liste plus longue d’apports théoriques discutés dans la revue, tandis que Bronckart évoque la question des tiroirs verbaux et de leur valeur pragmatique, dont il s’est lui-même occupé dans ses travaux.
Pourquoi cette fortune dans l’enseignement, demandions-nous? Reuter, outre la nature des exemples qui servent de corpus d’exemplification dans les travaux des théoriciens3 et dans les manuels, voit la raison de ce succès dans l’apparente simplicité de maniement de ces notions. Néanmoins, il évoque également le risque d’une illusion quant à la possibilité d’un transfert direct de ces outils d’analyse vers les classes. Dumortier note à cet égard que:
La fortune de ces mots tient, selon moi, notamment au fait que la plupart d’entre eux peuvent entrer dans des oppositions binaires aisément mémorisables («situation initiale» vs «situation finale», «sujet» vs «objet», «focalisation interne» vs «focalisation externe», «analepse» (rétrospection) vs «prolepse» (prospection), «factuel» vs «fictionnel», etc.) et servent à opérer ces distinctions élémentaires devenues un nec plus ultra dans un enseignement piloté par le contrôle des acquis d’apprentissage.
Parallèlement, pour ce qui est des concepts ou des notions qui auraient pu (ou dû) mieux retenir l’attention du monde de l’enseignement, nos témoins font un certain nombre de propositions qui ne manqueront pas d’inspirer. Revaz et Adam invitent à reconsidérer le couple récit-discours ainsi que les notions de scène ou d’épisode, et ils proposent de voir dans les travaux sur les gradients de narrativité une piste productive pour envisager l’hétérogénéité textuelle et les effets liés à la dominance de certains traits. Dumortier estime de son côté qu’il serait prioritaire d’exploiter les modes de réception du personnage par le sujet lisant en se fondant sur les travaux de Vincent Jouve (1992), ainsi que les affects tels que théorisés par Raphaël Baroni (2007). Ces deux leviers permettent en effet de s’interroger sur la pragmatique du récit et sur les effets potentiels des procédés identifiés par Genette. Parmi les figures genettiennes qui ont été peu ou pas scolarisées, le didacticien belge propose également de retenir la métalepse, notion productive «pour susciter une bien nécessaire réflexion des élèves sur la fiction et le rapport du lecteur aux mondes fictionnels».
Reuter regrette pour sa part la place congrue accordée aux concepts «qui renvoyaient aux questions fondamentales de la textualisation des savoirs ou des valeurs, ou encore de l’énonciation». Plus fondamentalement encore, Simard, en partant de l’analyse des prescrits de l’école québécoise, déplore qu’on n’y trouve pas la distinction essentielle entre histoire et narration, indispensable selon lui pour appréhender ce qu’est un récit. Revenant justement sur le caractère «fâcheusement équivoque» de la notion de récit4, Petitjean estime pour sa part nécessaire une clarification conceptuelle, «équivalente à la réflexion sur les rapports entre contexte, texte, textualité et textualisation».
Pour clôturer cette introduction à des témoignages qui peuvent prendre des accents de bilan comptable – teinté parfois de regret mâtiné de persévérance (Dumortier) ou de défense d’un domaine de recherche menacé (Adam) – il nous semble utile de mettre en exergue une considération semble-t-il centrale qui porte sur la confusion entre savoirs pour l’enseignant et savoirs pour les élèves (Reuter 2000). Ce point avait déjà été soulevé il y a vingt-cinq ans par Elisabeth Nonnon (1998) dans le numéro que la revue Pratiques consacrait à la transposition didactique en français. Rappelant cette contribution, Petitjean insiste:
Aucun fatalisme en la matière, car utilisées à bon escient, les études narratologiques ont prouvé leur validité et leur rendement analytique, à condition de se poser la question du degré de leur formalisation. En effet, il n’est pas le même selon que l’on s’adresse aux enseignants ou aux élèves, eux-mêmes à différencier selon leur âge et leur socio-culture.
Bronckart est du même avis quant aux apports de la théorie du récit:
Réponse simple: au vu des ressources théoriques et conceptuelles antérieurement à disposition dans l’enseignement du français, l’introduction de concepts narratologiques ne pouvait que constituer un progrès ou en tout cas ne pas faire de mal, même si un travail important reste à faire en ce domaine, qui, comme indiqué plus haut, concerne certes le choix des cadres et notions théoriques, mais surtout la constitution de programmes didactiques qui soient utiles et pertinents pour les objectifs de maîtrise textuelle; ce qui implique à nos yeux que soient poursuivies et/ou mises en place des recherches proprement didactiques susceptibles de mettre en évidence les utilités et pertinences évoquées.
Sur ces inspirantes recommandations, il nous reste à remercier les auteurs et l’autrice de ces témoignages pour ce coup d’œil dans le rétroviseur, opération de conduite toujours nécessaire pour aller, un peu plus consciemment, de l’avant sur les voies tortueuses de la didactique du français.
Références
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative: suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil, coll. «Poétiques».
Bourdieu, Pierre (1984), Homo academicus, Paris, Minuit.
Bronckart, Jean-Paul & Itziar Plazaola Giger (1998), «La transposition didactique. Histoire et perspectives d'une problématique fondatrice», Pratiques, n° 97 (1), p. 35-58. URL: https://dx.doi.org/10.3406/prati.1998.2480
Bucheton, Dominique (2002), «Lire, comprendre, interpréter, sans expliquer», Tréma, n°19, p. 67-76. URL: https://journals.openedition.org/trema/1586
Chevallard, Yves (1985/1991), La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage, coll. «Recherches en didactique des mathématiques».
Cohn, Dorrit (2001), Le propre de la fiction, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Daunay, Bertrand (2007), Invention d’une écriture de recherche en didactique du français, Habilitation à diriger des recherches, Université Lille 3.
Daunay, Bertrand & Nathalie Denizot (2007), «Le récit, objet disciplinaire en français?», Pratiques, n° 133-134, p. 13-32. URL: https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2007_num_133_1_2136
Denizot, Nathalie (2021), La culture scolaire: perspectives didactiques, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. «Études sur l'éducation».
Halté, Jean-François (1992), La didactique du français, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je? ».
Nonnon, Elisabeth (1998), «Transposition des théories du texte en formation des enseignants?», Pratiques, n° 97 (1), p. 153-170. URL: https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1998_num_97_1_2484
Reuter, Yves (2000), «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n° 21, p. 7-22. URL: https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_2000_num_21_1_2325
Ropé, Françoise (1990), Enseigner le français. Didactique de la langue maternelle, Paris, Éditions universitaires.
Védrines, Bruno (2017), L'assujettissement littéraire, thèse de doctorat, Université de Genève.
Pour citer l'article
Luc Mahieu, "Synthèse des entretiens avec quelques témoins de la scolarisation des théories du récit", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/synthese-des-entretiens-avec-quelques-temoins-de-la-scolarisation-des-theories-du-recit
Voir également :
La narratologie en classe de français: premiers résultats d’une enquête internationale
Cette contribution vise à partager les premiers résultats de l’enquête lancée en 2021 pour documenter les pratiques enseignantes relatives à l’outillage narratologique. Issues d’une enquête par questionnaire menée en Belgique francophone, en France, au Canada francophone / Québec et en Suisse romande{{Par facilité, je ferai, dans la suite du texte, l’économie des adjectifs «francophone» pour la Belgique et «romande» pour la Suisse. Pour la même raison, j’omettrai la mention Canada francophone, ce qui correspondra au cadre finalement étudié, même si l’ambition initiale était de récolter également des données issues d’autres provinces que le Québec. }}, ces données permettent une première approche de la question qui guide ma recherche doctorale: quelle place accordent les enseignant·e·s aux outils narratologiques? Et pour quelles finalités d’apprentissage chez leurs élèves?
La narratologie en classe de français: premiers résultats d’une enquête internationale
Cette contribution vise à partager les premiers résultats de l’enquête lancée en 2021 pour documenter les pratiques enseignantes relatives à l’outillage narratologique. Issues d’une enquête par questionnaire menée en Belgique francophone, en France, au Canada francophone / Québec et en Suisse romande1, ces données permettent une première approche de la question qui guide ma recherche doctorale: quelle place accordent les enseignant·e·s aux outils narratologiques? Et pour quelles finalités d’apprentissage chez leurs élèves?
Cette recherche vise donc à établir, dans une perspective synchronique, un état des lieux des pratiques enseignantes relatives à l’outillage narratologique. Il s’agit ainsi de répertorier aussi précisément que possible les outils enseignés mais également d’en évaluer la place dans les pratiques et dans les conceptions des enseignant·e·s.
En s’attachant aux niveaux secondaires I et II (élèves de 12 à 18 ans), cette recherche ambitionne d’étudier les situations observables dans les quatre terrains susnommés, permettant ainsi une dimension comparatiste qui me semble profitable dans la discussion des résultats. Dans ces différents pays, en effet, la plupart des nouveaux programmes introduisent dès le plus jeune âge le texte littéraire (dans une acception très large du terme, allant jusqu’à l’album sans mots) afin d’exercer des compétences interprétatives de haut niveau pour améliorer in fine les compétences littératiées.
Avant d’exposer les premiers résultats de cette enquête, il n’est pas inutile de rappeler que cette entreprise de large consultation constitue la concrétisation d’une recherche qu’Yves Reuter appelait de ses vœux en 2000 dans le bilan qu’il proposait sur les rapports entre «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français» (titre de son article). Le didacticien y notait:
Depuis quelques années, les critiques se sont multipliées à rencontre de la narratologie et de ses utilisations dans le champ de la didactique aussi bien de la part de théoriciens que de formateurs ou d'enseignants. D'une certaine manière, ce numéro de Repères en constitue un écho. Serait-ce à dire qu'après une période d'enthousiasme, il serait urgent de jeter le bébé avec l'eau du bain? Cela me paraîtrait pour le moins hâtif. (Reuter 2000: 7)
Depuis son point de vue de chercheur, Reuter énumérait également (Reuter 2000: 11) un certain nombre d’acquis d’apprentissage qu’il s’agissait ainsi de mettre au crédit d’une narratologie scolarisée: analyses plus précises des textes donnés à lire, explicitation possible des notions adoptées, possibilité de décloisonnement entre analyse des textes et analyses des phrases, création d’activités et d’exercices renouvelant les pratiques d’apprentissage du récit… Mais le didacticien de souligner dans le même temps la nécessité d’une plus large enquête de terrain pour vérifier ces considérations. Ces bénéfices présumés ont ainsi constitué une source pour la section du questionnaire consacrée au «rapport à la théorie du récit» des enseignant·e·s. On verra ce que les enseignant·e·s en pensent donc, 20 ans plus tard…
1. Aspects méthodologiques
Cette part de l’étude, par la diffusion la plus massive possible d’un questionnaire autoadministré, ambitionnait donc de récolter un maximum de témoignages de pratiques déclarées en ce qui concerne la boite à outils narratologique des enseignant·e·s. Différentes sous-questions de recherche ont ainsi dirigé la construction de cet instrument d’enquête:
- - Quelle place accordent les enseignant·e·s aux outils narratologiques? Et pour quelles finalités d’apprentissage chez leurs élèves?
- - Quelles sont les notions enseignées? Au sein de quelles activités plus ou moins formalisées? Avec quelle terminologie?
- - Quels rapports particuliers entretiennent les enseignant·e·s à ces savoirs disciplinaires?
- - Observe-t-on des différences entre différentes traditions/cultures scolaires?
- - En quoi la connaissance des notions narratologiques est-elle considérée comme partie intégrante de la compétence d'analyse littéraire ou de la maitrise par l'élève de la discipline français?
- - Quels besoins expriment les enseignant·e·s en termes d’outils d’analyses du récit?
Le questionnaire et sa construction (octobre 2021 – mars 2022)
Ce questionnaire a d’abord bénéficié du projet pilote réalisé par Raphaël Baroni et Gaspard Turin dans le cadre d’une recherche exploratoire financée par la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne2. L’élaboration de cet instrument d’enquête a également reçu le soutien des partenaires internationaux du projet qui en ont assuré une lecture attentive aux spécificités des différents terrains d’enquête3.
Afin de s'assurer du caractère le plus inclusif possible du questionnaire dans le respect des sensibilités des répondant·e·s, le bureau de l'égalité de l’Université de Lausanne a été également été consulté. D'abord sollicité uniquement sur la question de la variable d'identification classiquement libellée «homme/femme», ce bureau de soutien à la communauté universitaire dans la prévention des discriminations a pu finalement opérer une relecture intégrale du questionnaire et proposer des modifications intéressantes pour rendre ce dispositif d’enquête le plus inclusif possible.
Sur les aspects méthodologiques enfin, la Plateforme technologique de Support en Méthodologie et Calcul Statistique (SMCS) de l’UCLouvain a fourni un soutien précieux dans l’architecture et la mise en forme des questions.
Suite à la transposition sur la plateforme de sondage en ligne LimeSurvey par le Centre informatique de l’UNIL, une version bêta du questionnaire a ensuite été testée par au moins deux enseignant·e·s dans chaque terrain afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de sa compréhensibilité.
Parallèlement à ces différentes étapes d’élaboration, un double travail conséquent de certification éthique de la recherche a été mené en Suisse et au Québec, suivi d’intenses prospections de partenaires potentiels afin de soutenir la diffusion de l’enquête dans les quatre terrains investigués. Suivant en cela l’exemple de Lépine (2017), une longue liste d’organismes pouvant relayer l’annonce de cette recherche a été constituée avec l’aide des correspondants académiques: associations et revues professionnelles, groupes d’intérêt sur les réseaux sociaux, Centres de services scolaires au Québec, réseaux d’enseignement en Belgique, services cantonaux de l’enseignement en Suisse…4
L’enquête (avril 2022 – février 2023)
À l’instar d’autres enquêtes relatives aux pratiques déclarées des enseignant·e·s au moyen d’un questionnaire auto-administré (Brunel 2021; Dezutter & Morissette 2007; Lépine 2017), il a été fait usage d’un échantillon non probabiliste, dit «de convenance», devant le caractère utopique de la constitution d’un échantillon représentatif, qui plus est dans les quatre terrains envisagés. On gardera donc en tête les limites d’une telle méthode de recueil de données dont celle que les répondants ne sont que des enseignant·e·s volontaires, pouvant donc se révéler atypiques par rapport à la population cible (Fortin & Gagnon 2022).
La diffusion du questionnaire, soutenue par de très nombreuses prises de contact, s’est effectuée par phases: en Belgique, France et Suisse d’avril à juillet 2022 et ensuite, mettant à profit un séjour de recherche à Montréal, au Québec de novembre 2022 à février 2023.
Le traitement des données (mars-juin 2023)
Avec le soutien méthodologique du SMCS, le traitement des données s’est traduit par la constitution d’un large document Excel et de nombreux tableaux croisés dynamiques avant d’importer, en une synthèse générale, tableaux et graphiques, en suivant la structure du questionnaire en sept parties:
- Utilisation des outils narratologiques
- Focus sur le narrateur et la focalisation
- Matériel didactique utilisé
- Rapport à la littérature et à son enseignement
- Rapport à la théorie du récit
- Formation et sentiment de maitrise des outils narratologiques
- Expériences professionnelles et contexte d’enseignement
Titres, sous-titres, et questions du questionnaire ont été réaménagés ou reformulés afin d’améliorer la lisibilité de cette note présentant les données.
Des catégorisations et regroupements ont par ailleurs dû être effectués: les différents niveaux d’enseignement aux appellations diverses ont ainsi été regroupés dans trois catégories: secondaire I, secondaire II et post-secondaire (tableau 1).
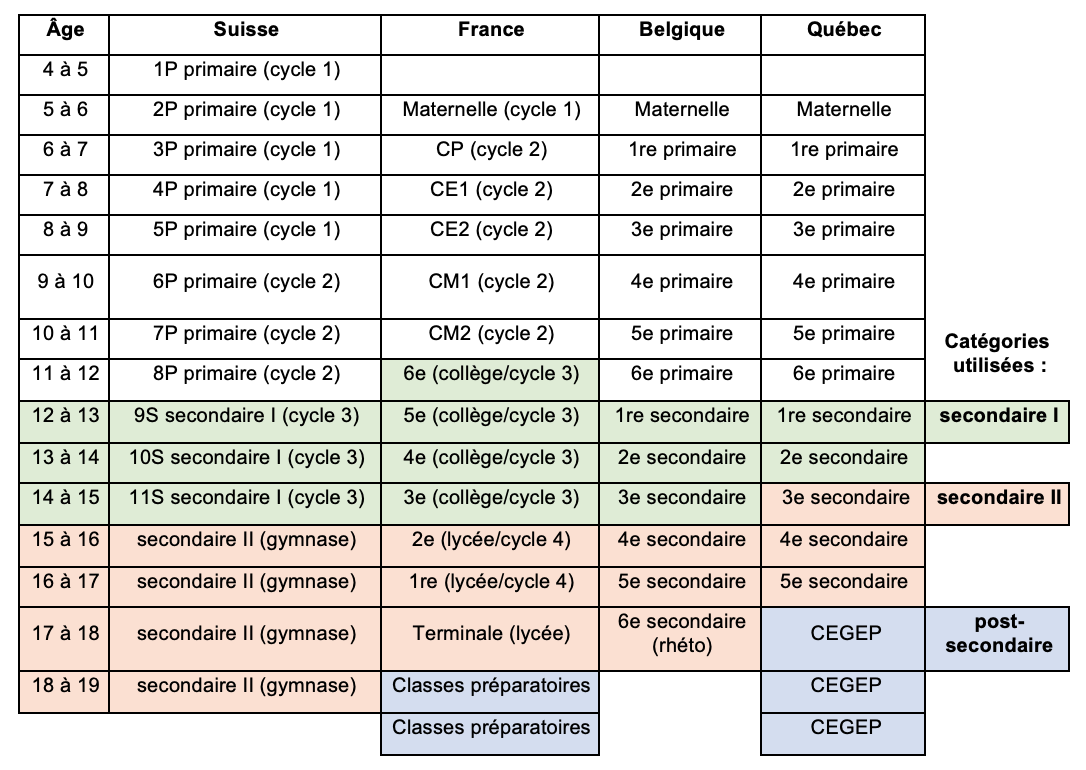
Tableau 1: équivalence des années et degrés scolaires observés
Une seconde phase de validation statistique est en cours (automne 2023), avec le soutien technique du SMCS, pour établir le caractère significatif au point de vue statistique des quelques résultats saillants qui l’exigeraient.
Données relatives au questionnaire
1385 personnes ont donc accédé au questionnaire en ligne et en ont ainsi découvert au moins la première page (page «0» dans la figure 1). Sur celle-ci étaient succinctement présentés le projet de recherche, la nature de la participation à celui-ci ainsi que les objectifs poursuivis.
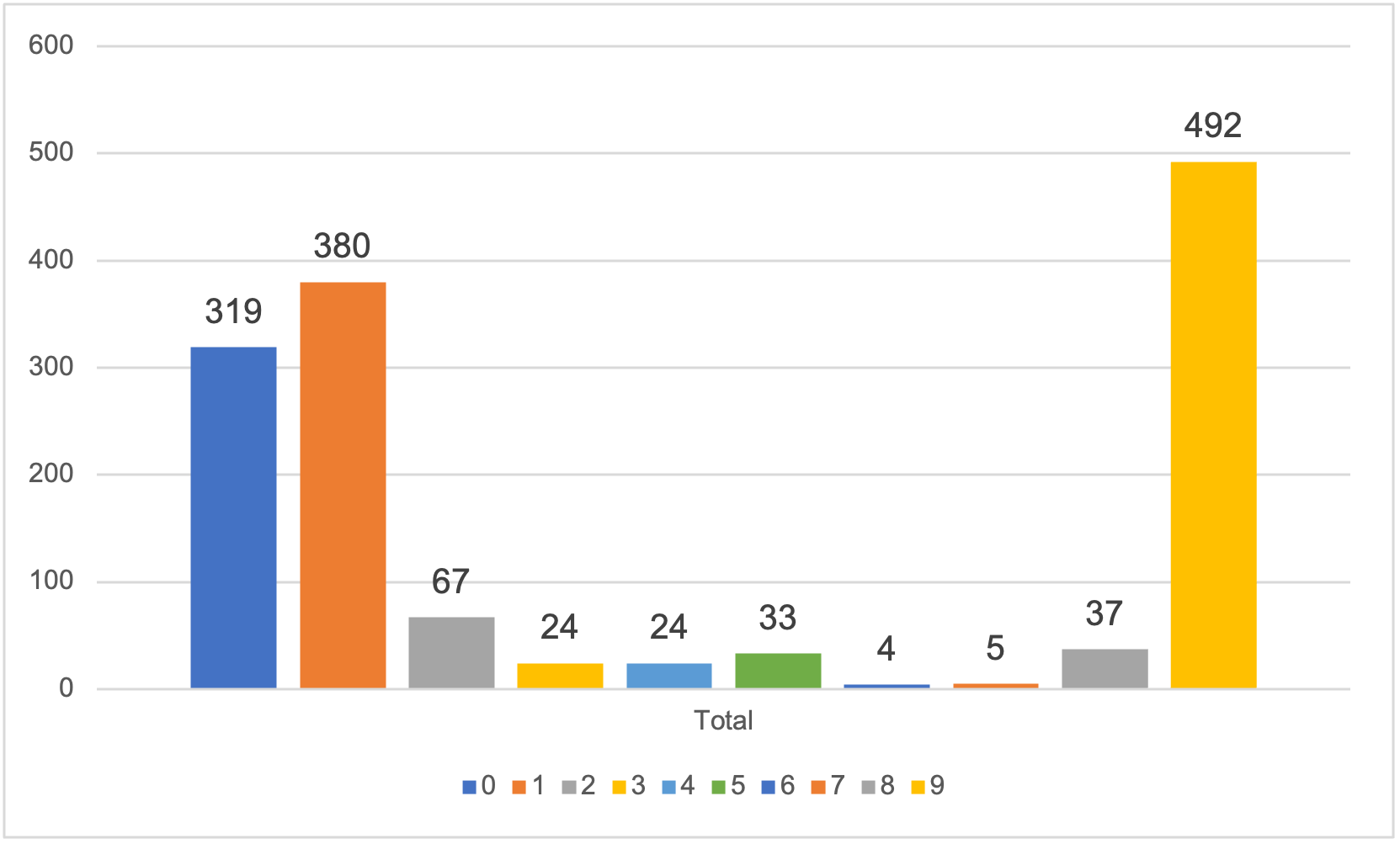
Figure 1: Niveau de complétion du questionnaire (dernière page complétée, de 0 à 9) (n=1385)
Pour constituer la base de données n’ont été prises en compte que les réponses complétées jusqu’à la page 8 ou 9. Cette dernière page ne récoltant que des informations relatives aux suites de la recherche (possibilité de s’inscrire à une infolettre ou de participer à un entretien…), il était donc possible de constituer le corpus définitif de 529 réponses utilisables en prenant en compte ces deux sous-ensembles.
2. Une enquête par questionnaire sur 4 terrains
En lançant cette enquête, nous nous donnions l’objectif de récolter 600 réponses réparties comme suit: 100 en Belgique, 200 en France, 200 au Québec et 100 en Suisse. À cette fin, un important travail de contact avec les personnes, les institutions et organismes pouvant diffuser le questionnaire – sur les 4 terrains – a été réalisé en parallèle de la création de celui-ci. En bout de course, nous avons pu récolter 529 réponses (figure 2), soit un objectif atteint à 86% au niveau global, dépassé pour ce qui est de la Belgique et de la Suisse, atteint à 80% pour la France et, non atteint, pour le Québec avec 49% de l’objectif fixé.
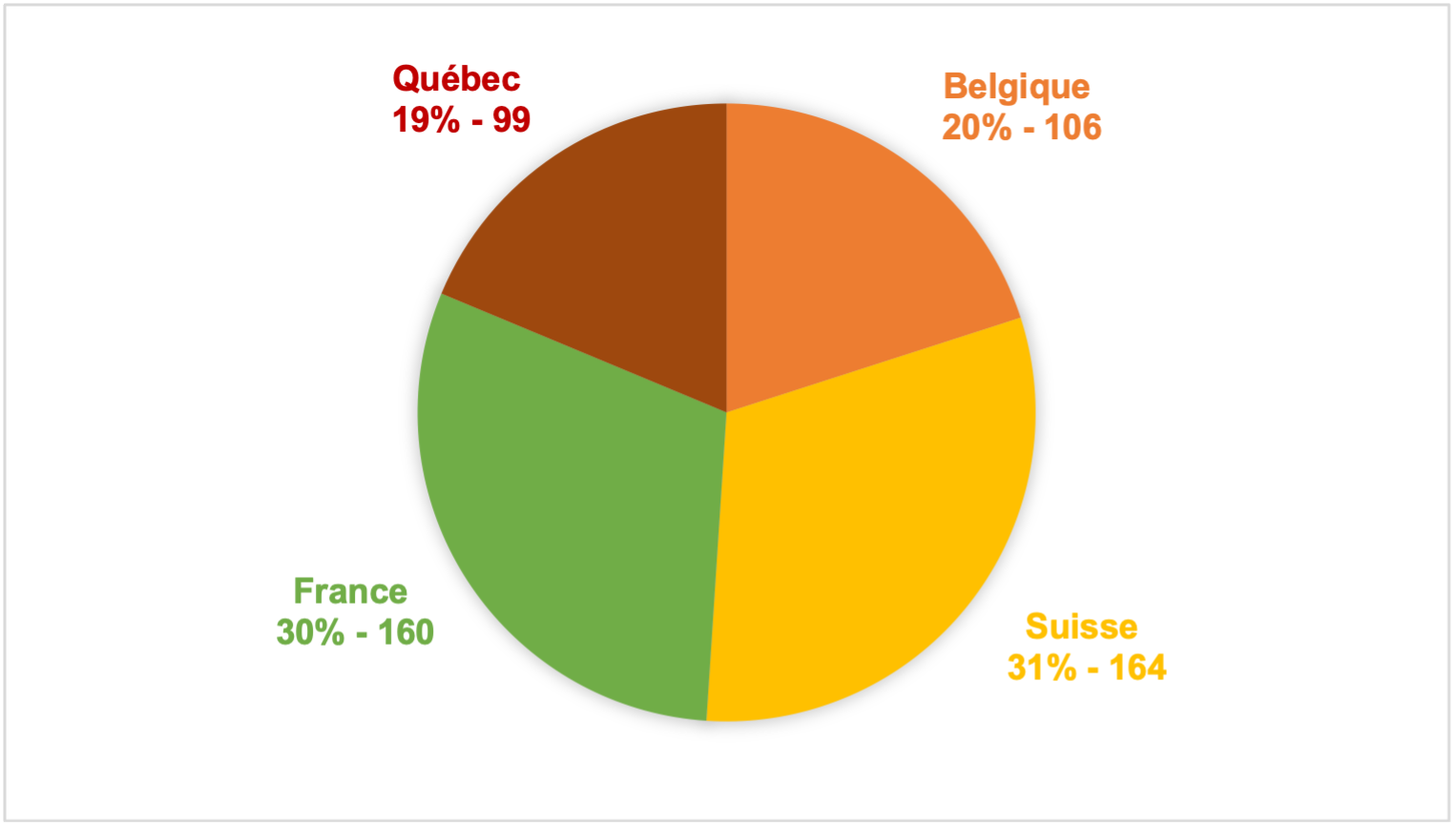
Figure 2: Pourcentage et nombre de répondant·e·s par terrain (n=529)
Pour mesurer l’ampleur de la tâche qu’a représentée travail de diffusion dans les 4 terrains, on peut prendre en considération le nombre de personnes ayant accédé à la première page du questionnaire (1385) et considérer que celui-ci représente environ 10% des personnes5 ayant eu accès à l’information, soit près de 14 000 enseignant·e·s.
Cet échantillon de convenances s’avère globalement équilibré en ce qui concerne l’expérience professionnelle des répondant·e·s, ainsi que pour les niveaux d’enseignements6 (figure 3):

Figure 3: Niveau d'enseignement des répondant·e·s (nombre et pourcentage / n = 529)
Il faut néanmoins noter une plus forte représentation d’enseignant·e·s du secondaire II en Belgique (67%) et au Québec (40%). Dans ce dernier terrain, plus d’un tiers des répondant·e·s est également issu du niveau des CEGEP (post-secondaire).
Dans les différences notables entre les terrains étudiés, deux éléments me paraissent devoir encore être relevés. D’une part, les enseignant·e·s déclarent, selon leur pays et leur niveau d’enseignement, une proportion variable dans le temps consacrée à la littérature dans leur enseignement (figure 4).
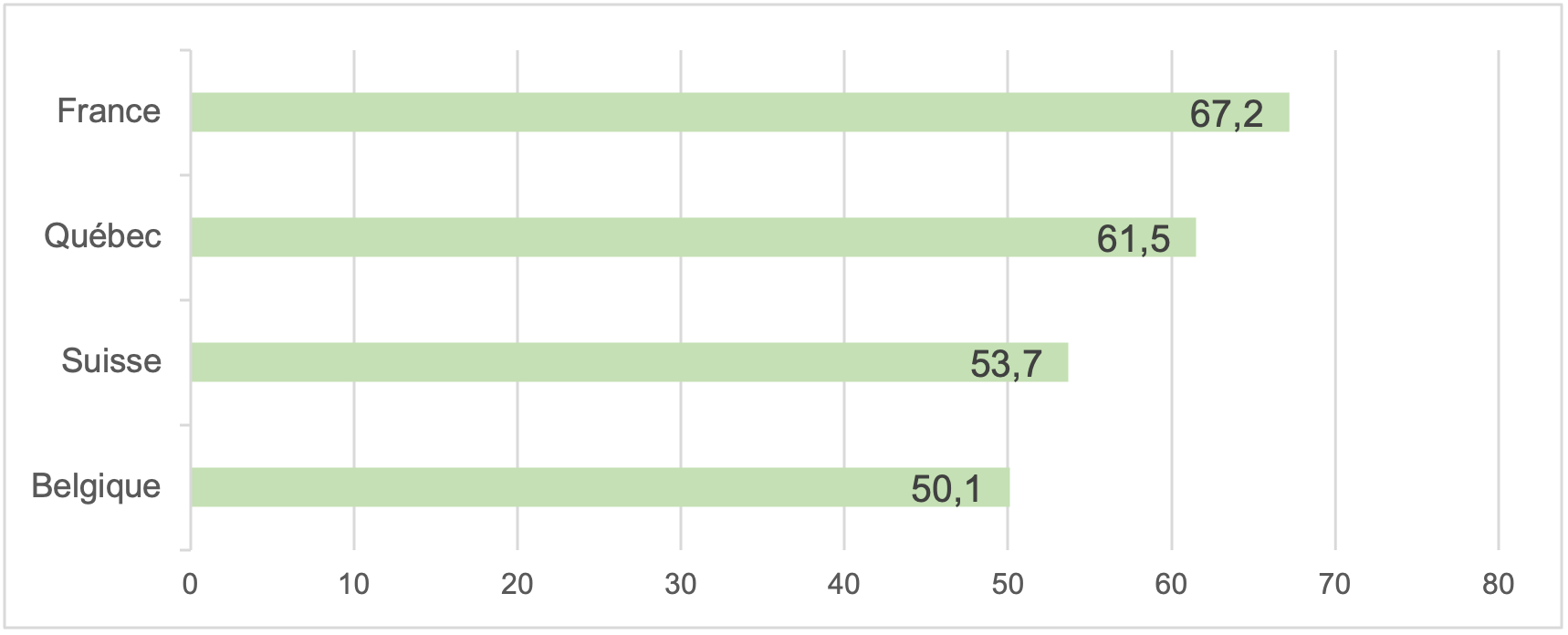
Figure 4: En moyenne, temps consacré à la littérature dans le cours de français selon le terrain ( % de temps hebdomadaire / n = 529)
Atteignant 67% du temps hebdomadaire parmi les répondant·e·s français, le temps consacré à la littérature est de 50% pour les répondant·e·s de Belgique. Le résultat québécois doit en revanche prendre en compte la part importante de réponses issues du niveau collégial où 83% du temps de cours de français est, selon les répondant·e·s, consacré à la littérature7. Notons que si n’était pris en considération que le niveau secondaire, ce temps hebdomadaire serait comparable au Québec à celui qui prévaut chez les répondant·e·s de Belgique.
En écho à cette caractéristique de l’échantillon, il est sans doute utile de mentionner que la très grande majorité des participant·e·s à l’enquête – mais faut-il s’en étonner? – déclarent aimer enseigner la lecture/appréciation des œuvres littéraires (figure 5):
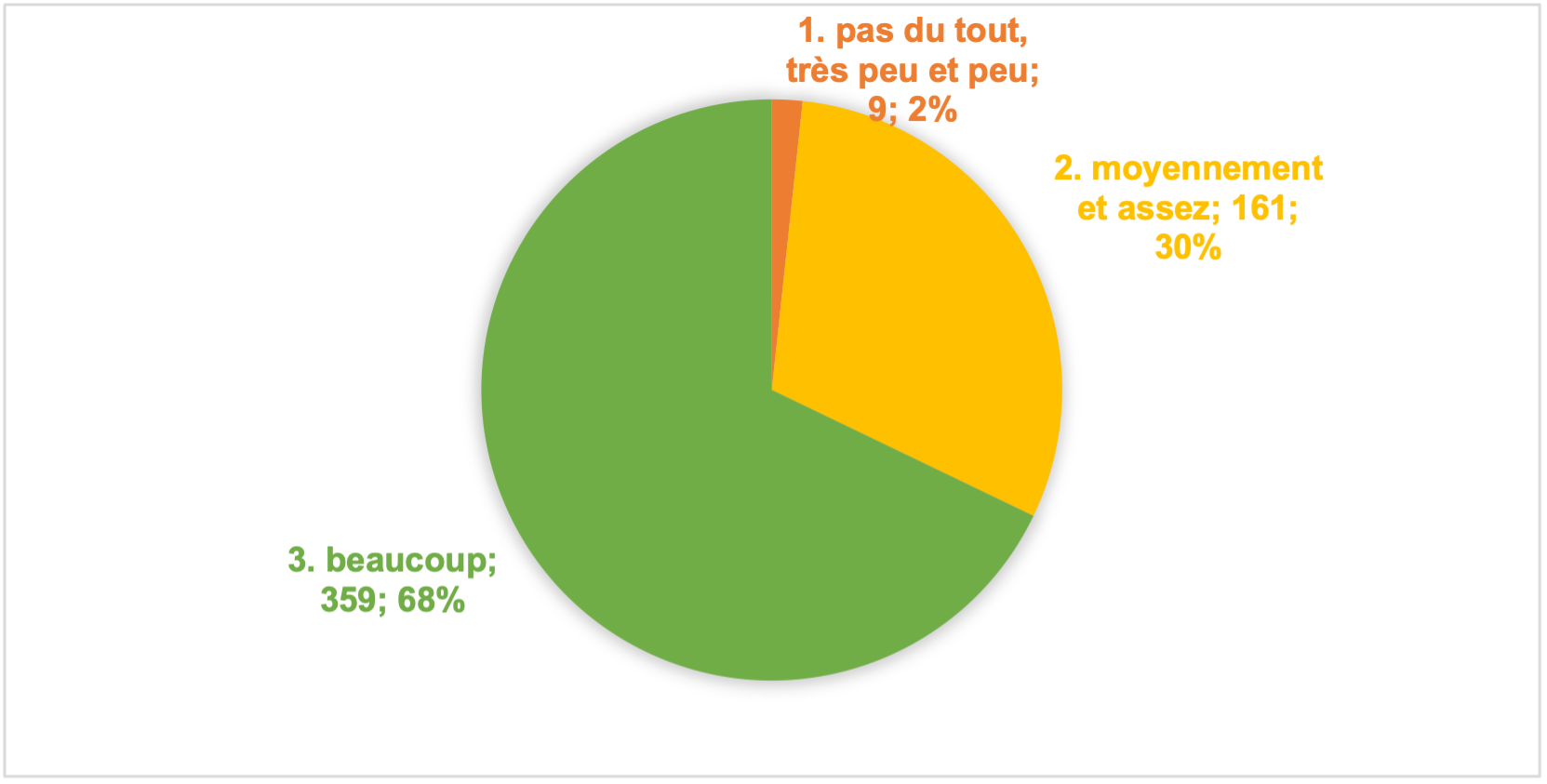
Figure 5: Est-ce que vous aimez enseigner la lecture/appréciation des œuvres littéraires? (n = 529 / nombre et pourcentage)
D’autre part, la formation initiale, dont on sait l’influence sur les enseignements, varie sensiblement d’un terrain à un autre. Si toustes les enseignant·e·s de Suisse passent, pour un bachelor ou un master, par une faculté de lettres avant de suivre les enseignements d’une haute-école pédagogique (HEP)8, la plupart de leurs homologues québécois – pour enseigner au secondaire – fréquentent les facultés de sciences de l’éducation pour un baccalauréat en enseignement secondaire (français langue première). Les enseignant·e·s du CÉGEP sont en revanche le plus souvent issu·e·s de formations disciplinaires en lettres.
En Belgique, les enseignant·e·s du secondaire I sont formé·e·s en haute école (Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur – bachelier en 3 ans9) alors que leurs collègues du secondaire II poursuivent un cursus à l’université: bachelier en langue et lettres françaises et romanes avant un master à finalité didactique, toujours en faculté des lettres. En France, enfin, toustes les enseignant·e·s actif·ve·s au secondaire sont détenteur·rice·s, après concours, d’un CAPES ou d’une agrégation en lettres classiques ou modernes, le plus souvent après une licence en lettres.
Dans notre échantillon, ces différences de cursus se marquent donc par une formation (ou un concours) disciplinaire différenciée: 97% des répondant·e·s français disposent d’une telle formation ou concours, 85% en Suisse, 58% en Belgique et 39% au Québec. Notons également que 10% des répondant·e·s français sont titulaires d’un doctorat, 6% en Suisse, 1 personne en Belgique, aucune au Québec.
3. Quelle place pour les outils narratologiques dans l’enseignement?
Le «top 8» des notions narratologiques en classe de français
Sur base des données recueillies, il est possible d’établir un classement des notions les plus fréquemment utilisées. Ainsi, en calculant les moyennes de fréquence d’utilisation (de 0 «jamais» à 5 «toujours») pour chacune des 28 notions interrogées, on obtient le classement suivant (tableau 2):
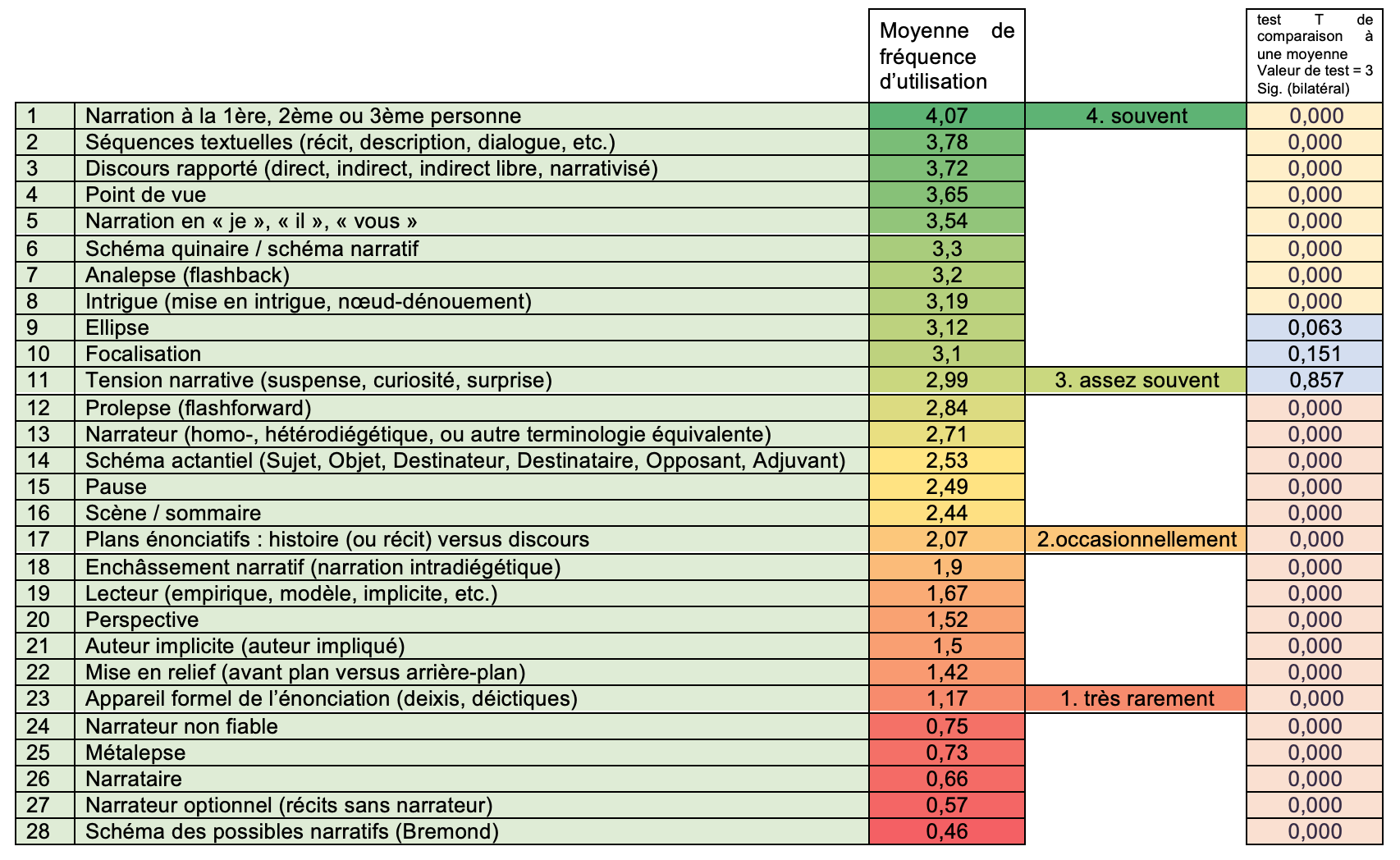
Tableau 2: moyennes de fréquence d'utilisation des notions narratologiques (de 0 «jamais» à 5 «toujours» / n = 529)
Une validation statistique (test T de comparaison à la moyenne) permet d’établir que les 8 premières notions du classement sont significativement supérieures au score de 3 («assez souvent»). Suivent trois notions pour lesquelles la différence à cette moyenne de 3 n’est pas significative (valeur de test supérieure à 0,05): ellipse, focalisation et tension narrative. Les autres notions sont, quant à elles significativement, moins utilisées.
Selon le mode de traitement, il est possible d’obtenir un classement légèrement différent, mais, pour l’essentiel, se dessine donc une boite à outils des enseignant·e·s qui comprend d’abord des notions relatives aux personnes de la narration, aux séquences textuelles et aux modes de discours (direct, indirect…); cette boite à outils inclut ensuite des notions peut-être plus proprement narratologiques telles que le point de vue, le schéma narratif, l’analepse et l’intrigue. Cet ensemble forme alors ce que j’appellerais le «top 8» des notions narratologiques régulièrement utilisées.
De façon intéressante, notons que les guillemets de protestation qu’utilise explicitement Genette dans Figures III (1972: 251) pour condamner «ces locutions courantes» que sont «récit à la première – ou à la troisième – personne» n’y font donc rien: la notion narratologique la plus utilisée, selon cette enquête, est celle renvoyant à l’énonciation adoptée dans le texte: «Narration à la 1ère, 2ème ou 3ème personne». Sans doute faut-il y voir l’influence du caractère extrêmement courant de celle-ci dans les consignes de rédaction (courts récits, continuation de début de nouvelles…)10? Ce hiatus entre la condamnation du narratologue, plus intéressé par la narrativité du récit que par sa textualité et l’intérêt inverse de l’enseignant·e a été ainsi pointé par Dumortier (2001: 73) qui remarque:
Si le texte en tant que formation linguistique a été négligé, c'est en outre parce que, d'une part, envisagé comme tel, il n'a plus grand-chose de spécifiquement narratif, et parce que, d'autre part, la linguistique textuelle était encore balbutiante. Le didacticien ne peut cependant pas ignorer que certains problèmes de compréhension du récit tiennent plus à sa «textualité» qu'à sa «narrativité».
Au «top 8» des notions régulièrement utilisées s’ajoutent des notions moins fréquemment usitées: ellipse, focalisation, tension narrative, les notions relatives au temps et rythme du récit (prolepse, pause, sommaire, scène), la notion de narrateur (avec ses différentes déclinaisons terminologiques – on y reviendra) et le schéma actantiel.
Ensuite, ne sont plus qu’occasionnellement ou que très rarement citées des notions qui appartiennent au champ de la narratologie postclassique – auteur implicite, narrateur non fiable, narrateur optionnel – ou des notions manifestement plus oubliées de l’héritage structuraliste: schéma des possibles narratifs, narrataire, métalepse11 mise en relief…
Des fréquences d’utilisation différenciées selon les terrains?
Les différences entre terrains étudiés sont de différents ordres, comme permet de le voir le tableau 3:
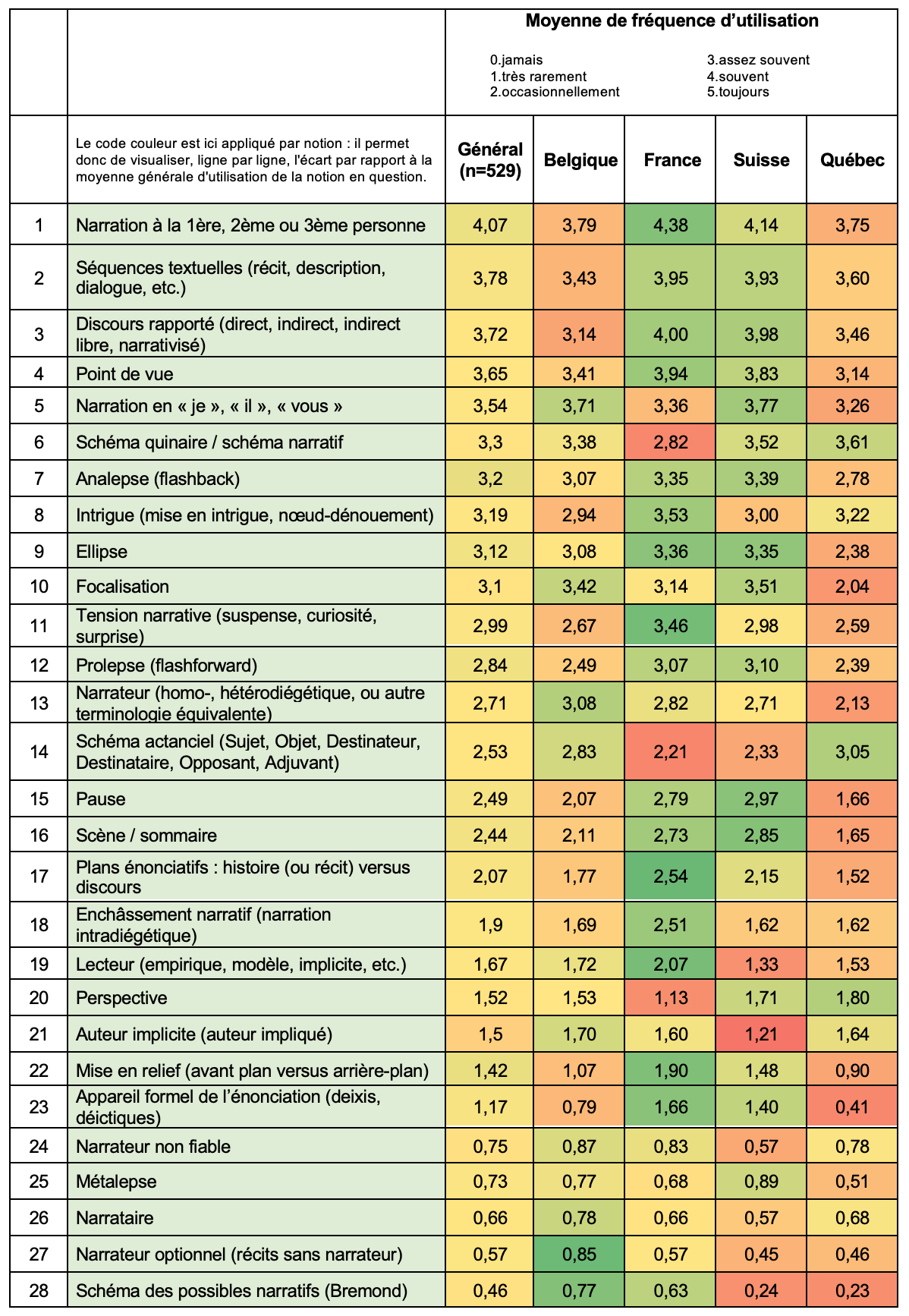
Tableau 3: moyennes de fréquence d'utilisation des notions narratologiques par terrain (de 0 «jamais» à 5 «toujours» / n = 529)
Les résultats recueillis montrent tout d’abord des moyennes d’utilisation globalement plus importantes parmi les répondant·e·s français et suisses et, dans l’ensemble, plus faibles en Belgique et au Québec.
À cette tendance générale s’opposent – ce ne serait pas sérieux sinon – des exceptions. Dans les résultats belges, les notions suivantes sont plus utilisées qu’en moyenne générale: Narration en «je», «il», «vous», Focalisation, Narrateur et Schéma actantiel. Au Québec, les deux schémas (quinaire et actantiel) et la perspective connaissent, de manière intéressante, les utilisations les plus élevées de notre corpus.
Ces différences sont de faible ampleur, mais sans doute faut-il y voir une influence, en France et en Suisse, d’une formation initiale plus disciplinaire et celle d’une place plus importante accordée à la littérature dans les cours de français. Cette tendance différenciée se remarque également sur l’importance accordée à la maitrise des outils narratologique dans le cadre de l’épreuve certificative finale dans ces deux terrains (voir infra).
Ensuite, si l’on se limite aux 10 notions les plus utilisées selon les terrains, on obtient des boites à outils qui se différencient, mais à la marge:
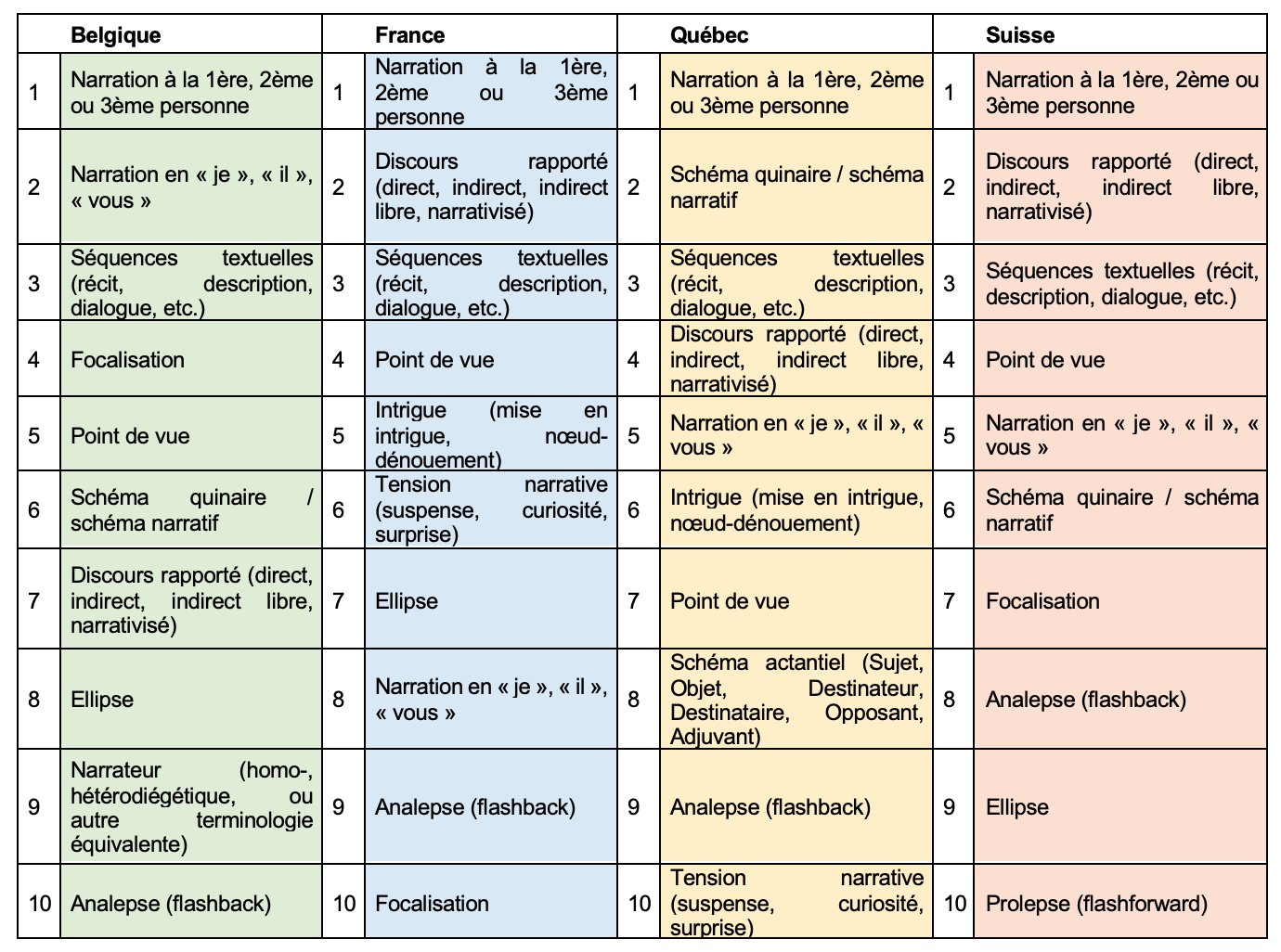
Tableau 4: Les 10 notions les plus utilisées selon les terrains observés (classement par la moyenne de fréquence d'utilisation / n = 529)
À la lecture des tableaux ci-dessus (ainsi que les autres croisements possibles avec les différentes variables telles que le niveau d’enseignement, les voies d’enseignement, les opérations de lectures priorisées…), plusieurs constats et questions émergent.
Le schéma narratif/quinaire est, à la différence des autres terrains, absent de ce «top 10» chez les répondant·e·s français (il occupe la 12e position), tout comme est absent le schéma actantiel, relégué en 18e place (fréquence: occasionnellement). Au contraire, le schéma narratif est le 2e outil plus utilisé au Québec, terrain qui place également le schéma hérité de Greimas parmi les 10 notions les plus utilisées.
L’utilisation globalement plus faible de l’outillage narratologie au niveau post-secondaire renvoie à la composition de cette catégorie, presque exclusivement constituée de répondant·e·s issus des CÉGEP québécois et à la nécessité pour ceux-ci de préparer leur public à la certification finale, l’épreuve uniforme de français qui s’apparente à une dissertation littéraire (Cellard & Goulet 2022) pour laquelle les notions narratologiques ne sont pas – ou très peu – mobilisées.
Le schéma des possibles narratifs de Bremond, qui apparait dans des séquences didactiques dans les années 70’ et 80’, n’est manifestement plus attesté dans les usages actuels. Influence des manuels qui ne s’en emparent pas? Voilà un point qui devra être investigué dans l’analyse diachronique, encore à venir, d’un corpus de manuels scolaires…
De légères variations des résultats d’utilisation apparaissent dans le croisement des fréquences d’utilisation avec les variables suivantes:
- - le gout à enseigner la lecture/appréciation des œuvres littéraires: augmentation de l’utilisation des outils narratologiques quand augmente ce gout;
- - voie d’enseignement au secondaire II: plus faible utilisation des notions dans la voie professionnelle;
- - contexte socioéconomique des établissements: plus faible utilisation des notions narratologiques dans les écoles moins favorisées.
Le caractère peu significatif de ces variations ne permet néanmoins pas de s’emparer plus loin de ces croisements de données.
Il faut noter que la question de la terminologie apparait comme une source éventuelle de complexité dans l’interprétation des résultats. Ainsi qu’en témoigne un·e enseignant·e belge, l’entrée dans le «jargon» de la théorie du récit et son utilisation sont éventuellement pensées par les acteurs de terrains dans une progression des apprentissages; un·e même répondant·e peut ainsi articuler différents usages terminologiques dans son enseignement:
J'adapte les termes en fonction des années d'enseignement. Par exemple, en 4ème année, je parle de "rétrospection" et d’"anticipation", mais en 6ème générale, j'utilise le terme "analepse" et "prolepse".
Conjugué à cet élément, il me semble que la faiblesse des écarts sur de nombreux croisements de variables doit ainsi inviter à la prudence dans l’interprétation des résultats au-delà des tendances globales énumérées ci-dessus.
4. Quelles finalités?
Afin d’approcher les finalités associées à l’apprentissage des notions narratologiques, un certain nombre d’activités ou de productions (s’identifiant souvent à des genres scolaires) a été proposé aux participant·e·s.
En production orale, la première activité-production dans le cadre de laquelle les enseignant·e·s estiment que leurs élèves sont amené·e·s à réinvestir des notions narratologiques est ainsi l’explication de texte, suivie par le débat interprétatif. Ce format classique de l’explication de texte est, on le voit dans le tableau 5, plus fréquemment cité par les répondant·e·s français et suisses (83% et 84%) que par leurs homologues belges (66%) et québécois (56%). En revanche, ces derniers tranchent par leur mention prioritaire (61%) des cercles et comités de lecture comme lieu de réinvestissement des notions issues de la théorie du récit.
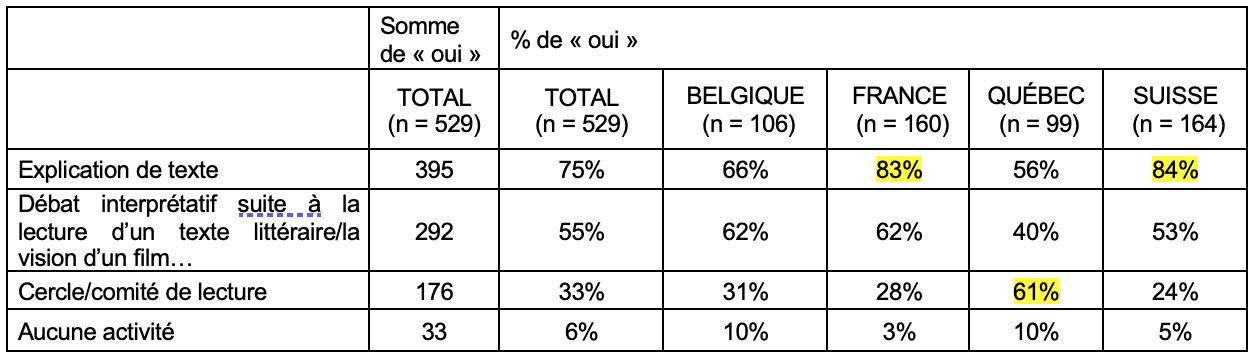
Tableau 5: Activités ou productions dans lesquelles l’élève est amené·e, dans votre enseignement, à réinvestir des notions narratologiques (PRODUCTION ORALE)
En production écrite (tableau 6), la première activité-production dans le cadre de laquelle les enseignant·e·s estiment que leurs élèves sont amené·e·s à réinvestir des notions narratologiques est le test de lecture destiné à vérifier la compréhension de l’histoire. Suit l’explication de texte, à nouveau premier objet dans les contextes français et suisse, avec un écart d’environ 30 point par rapports aux terrains belges et québécois.
L’objectif de vérification de la compréhension en réinvestissant ces notions est en revanche plus marqué dans les trois contextes non hexagonaux, puisque plus de 7 enseignant·e·s sur 10 y considèrent cette activité comme un lieu de réinvestissement.
Dans ce classement, suit un groupe de genres s’éloignant de l’activité de commentaire métatextuel incarné par l’explication de texte, le commentaire composé, la dissertation et cie. Le troisième objet le plus cité est ainsi la rédaction de récits de fiction, suivi par deux autres genres «créatifs»: les ateliers d’écriture et les suites de textes.
Il semble enfin intéressant de noter que la plupart des genres qu’on peut qualifier d’écrits de la réception (journal de lecture, de lecteur ou de personnage, autobiographie de lecteur…) sont manifestement considérés par moins de répondant·e·s comme d’éventuels lieux de réinvestissements des notions narratologiques (bas du tableau).
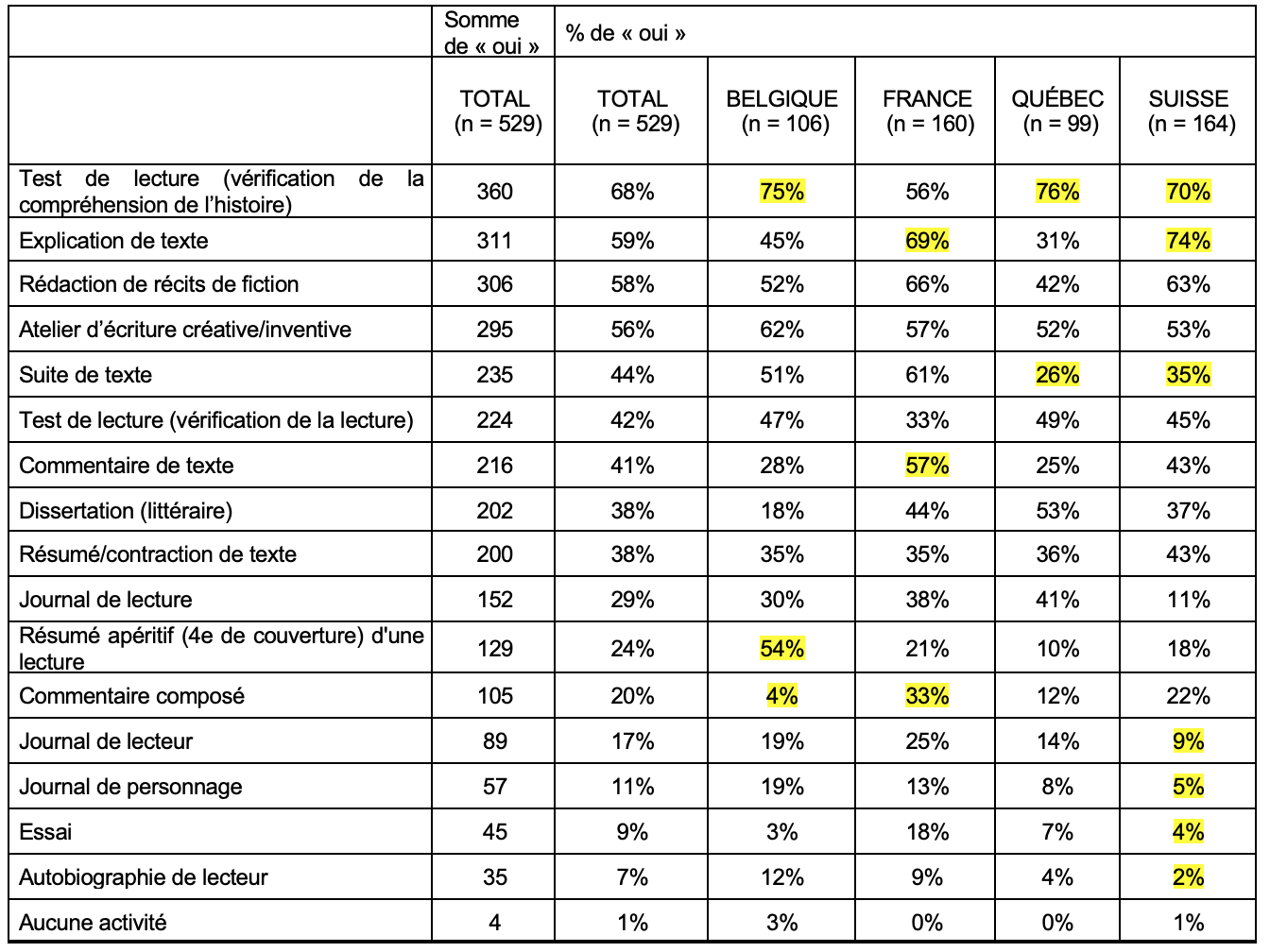
Tableau 6: Activités ou productions dans lesquelles l’élève est amené·e, dans votre enseignement, à réinvestir des notions narratologiques (PRODUCTION ÉCRITE)
Dans le registre des finalités d’apprentissage et des perspectives de réinvestissement dans le cadre scolaire des notions narratologiques, il n’est pas inutile d’observer ce que déclarent les répondant·e·s sur la question du poids de l’épreuve certificative finale (CESS en Belgique, épreuve anticipée de français du baccalauréat en France12, épreuve uniforme de français au Québec, bac de français en Suisse13).

Figure 6: Réponse à la question "La maitrise de notions narratologiques est nécessaire pour réussir l’épreuve certificative finale" (répartition par terrain / n = 529)
Comme on le voit dans la figure 6, les répondant·e·s belges estiment majoritairement que la maitrise des notions narratologiques n’est pas nécessaire à la réussite de cette épreuve finale14 (50% tout à fait ou plutôt en désaccord), au contraire d’une forte majorité de leurs collègues suisses (61% plutôt ou tout à fait d’accord). Une majorité de répondant·e·s français (54% plutôt ou tout à fait d’accord) suit leurs homologues suisses dans cette nécessité de maitrise des notions narratologiques. La distribution homogène des résultats pour le terrain québécois ne permet pas de tirer de conclusion définitive.
En ce qui concerne plus spécifiquement les notions de narrateur et de focalisation, une question ouverte a permis de recueillir plus de 300 courtes justifications de l’importance, selon les répondant·e·s, d’enseigner ces notions. Si une analyse systématique doit encore être menée, il s’agit néanmoins de relever plusieurs ensembles perceptibles à la lecture de ces réponses:
- - la meilleure compréhension des récits:
«comprendre le récit de façon plus approfondie, de comprendre que l'effet n'est pas le même selon le statut du narrateur et que l'auteur peut même jouer sur la quantité d'informations donnée au lecteur.» (Belgique, secondaire II)
- - la perception de la «subtilité» des choix narratifs:
«Comprendre et apprécier la finesse de certains récits (Flaubert par exemple, d’autres auteurs plus expérimentaux) et leur faire prendre conscience des différences entre auteur/narrateur/personnage.» (France, secondaire I et II)
- - la découverte de la polyphonie narrative, propice à l’apprentissage d’un esprit critique, voire d’un décentrement bénéfique face à l’altérité:
«La place du narrateur influe sur "l'esprit critique" du lecteur. Ces distinctions dépassent donc le cadre strict de la littérature pour s'insérer dans une perspective plus complète: l'éducation à la citoyenneté» (Belgique, secondaire I).
5. Quelles difficultés?
Différentes questions étaient posées afin de cerner les difficultés ressenties dans l’enseignement – apprentissage des notions narratologiques. Ainsi, du point de vue des enseignant·e·s ayant participé à l’enquête, les notions dont la définition est jugée peu claire et peu adaptée à l’enseignement sont, par ordre:
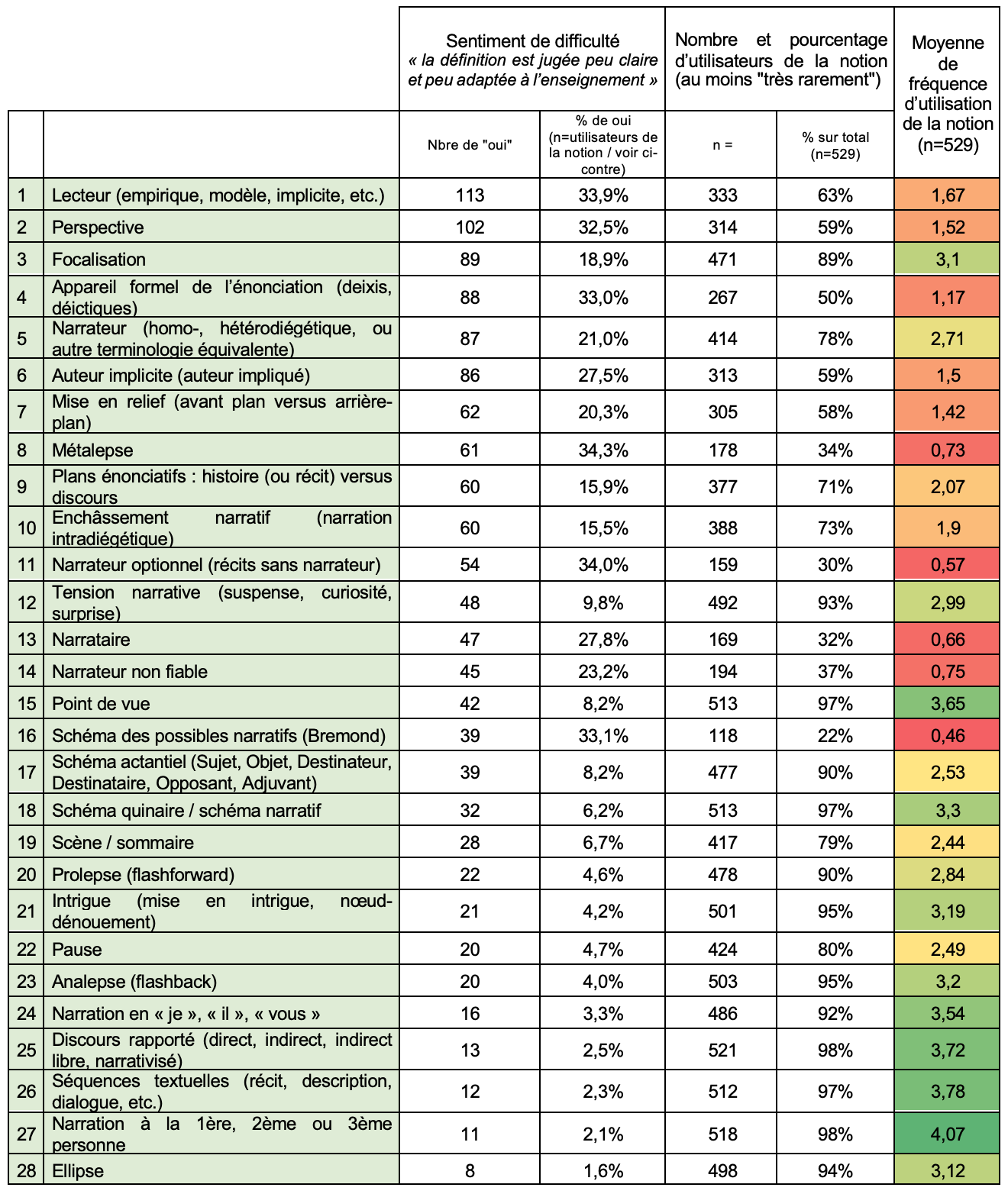
Tableau 7: Classement des notions dont la définition est jugée peu claire et peu adaptée à l'enseignement (n = variable selon l’utilisation des notions, cf. colonne 5 renseignant ce nombre d’utilisateur de la notion)
Comme on le voit en s’attardant à la fréquence d’utilisation en dernière colonne de ce tableau 7, seules deux notions – la focalisation et la question du narrateur – constituent à la fois des notions fréquemment utilisées et considérées comme difficiles pour l’enseignement par environ 1 enseignant·e sur 5. Pour le reste, s’observe une corrélation entre sentiment de difficulté et faiblesse de l’utilisation de la notion.
En isolant les 14 notions disposant d’une moyenne de fréquence d’utilisation supérieure à 2,5 afin d’interroger spécifiquement un ensemble d’outils à l’utilisation avérée, on obtient le classement suivant en se basant cette fois sur le pourcentage de «oui» (tableau 8):
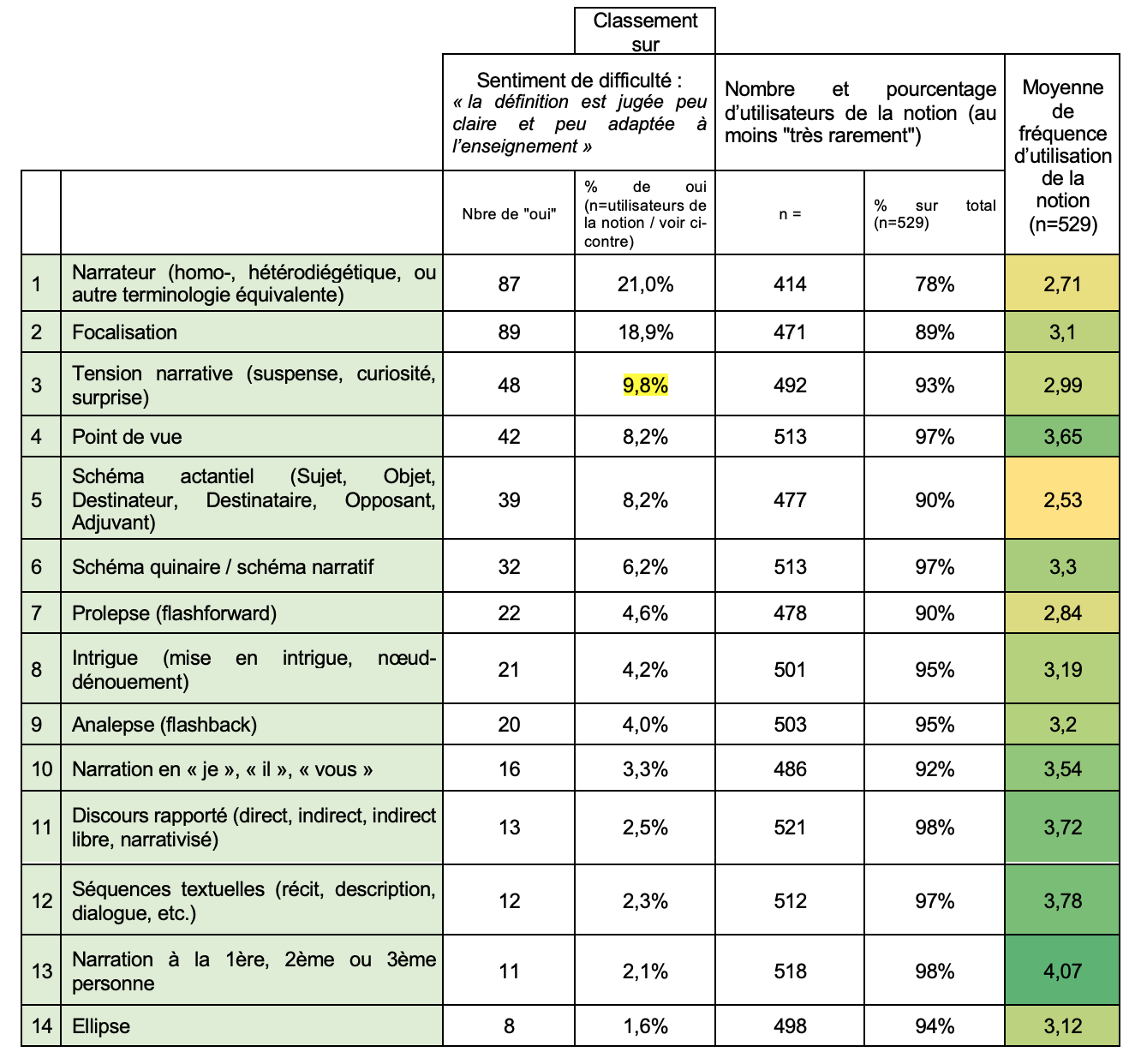
Tableau 8: Classement des 14 notions fréquemment utilisées et dont la définition est jugée peu claire et peu adaptée à l'enseignement (n = variable selon l’utilisation des notions, cf. colonne 5 renseignant ce nombre d’utilisateur de la notion)
Après la focalisation (en deuxième rang), on voit que le pourcentage de répondant·e·s considérant ces notions comme difficiles d’appréhension pour leurs élèves est de moins de 10%. Notons tout de même que la tension narrative semble représenter une source de difficulté pour 1 utilisateur sur 10.
Lorsqu’on demande par contre aux participant·e·s quelles sont les notions les plus difficiles à maitriser pour leurs élèves, les résultats changent sensiblement. En sélectionnant également les 14 notions disposant d’une moyenne de fréquence d’utilisation supérieure à 2,5, on obtient le classement suivant (tableau 9):
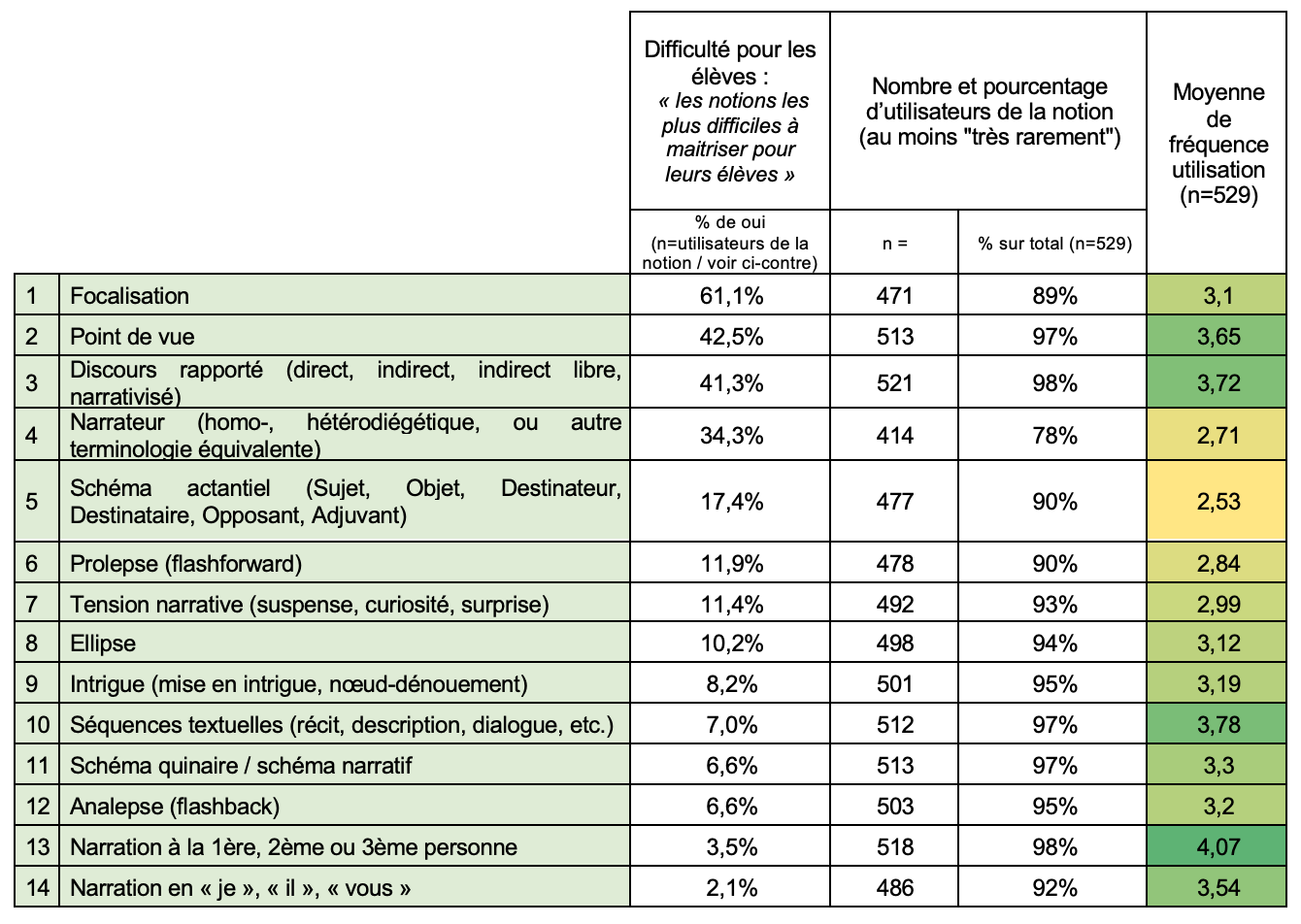
Tableau 9: Classement des 14 notions fréquemment utilisées et jugées difficilement maitrisables par les élèves (n = variable selon l’utilisation des notions, cf. colonne 5 renseignant ce nombre d’utilisateur de la notion)
De ces deux sources de données, on retient donc que 20% des enseignant·e·s jugent la notion de focalisation peu claire, peu adaptée à l’enseignement et que selon eux, 60% de leurs élèves éprouvent des difficultés à maitriser celle-ci. Le point de vue suit, source de difficultés pour 4 élèves sur 10 selon les enseignant·e·s.
Les différentes catégories de discours rapporté constituent la troisième source de difficulté pour les élèves – toujours de l’avis des enseignant·e·s – alors que, de façon intéressante, elles ne sont jugées problématiques au niveau de leur définition que par 2,5 % de leurs utilisateurs.
Enfin, selon les enseignant·e·s, la notion de narrateur (et vraisemblablement en lien avec les questions de focalisation/point de vue) représente une difficulté pour 1 élève sur 3.
Focus sur le narrateur et la focalisation
Un focus proposé dans le questionnaire sur le narrateur et la focalisation permet d’en apprendre un peu plus sur ces notions considérées comme importantes par la grande majorité des répondant·e·s. En effet, 86% d’entre eux estiment important ou très important d’enseigner ces notions de narrateur et de focalisation.
La difficulté à appréhender la notion de focalisation peut se retrouver dans les résultats obtenus à la question «Pour vous, quelle est la définition qui correspond le mieux à la notion de focalisation interne?». L’ambigüité notionnelle qui mêle filtrage par la subjectivité d’un personnage, quantité d’information ou focalisation sur un personnage se retrouve dans l’option la plus sélectionnée par les répondant·e·s (tableau 10):
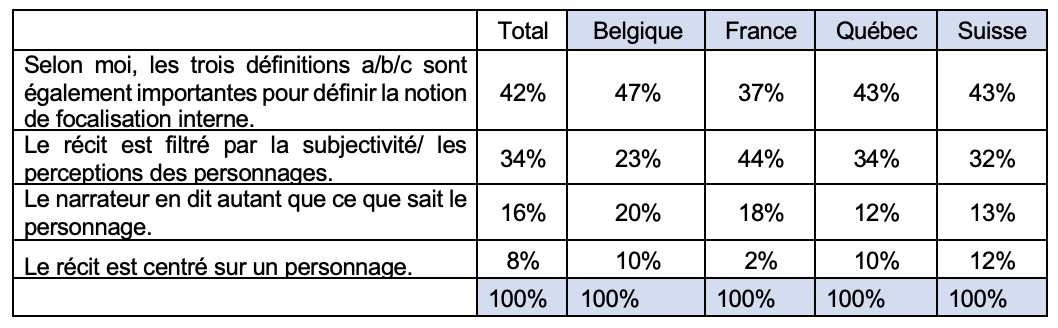
Tableau 10: Réponses à la question «Pour vous, quelle est la définition qui correspond le mieux à la notion de focalisation interne?» (pourcentages du total et par terrain / n=529)
La diversité terminologique quant à la notion de narrateur a été explorée au travers d’une question interrogeant les termes utilisés pour décrire aux élèves «un narrateur qui raconte une histoire à laquelle il a pris part» (tableau 11).
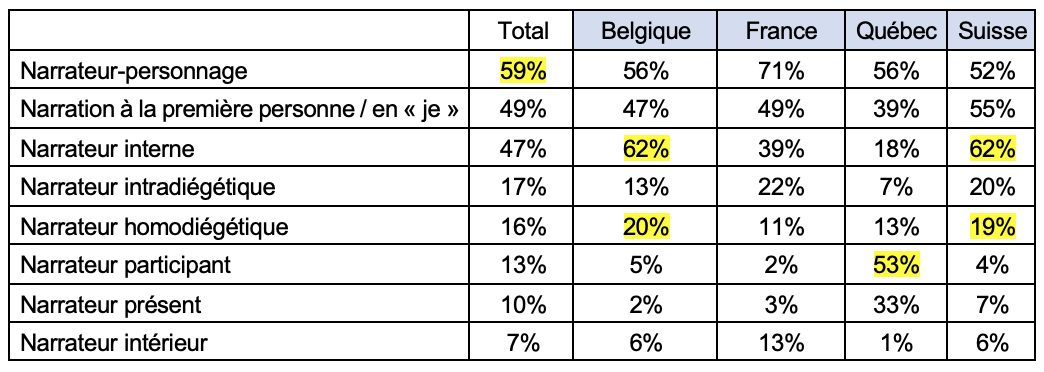
Tableau 11: Réponses à la question «Avec quelle terminologie décririez-vous à vos élèves un narrateur qui raconte une histoire à laquelle il a pris part?» (pourcentages du total et par terrain / n = 529)
Au-delà du très répandu «narrateur-personnage» utilisé par 2 enseignant·e·s sur 3 (par influence des publications françaises?), se constatent ici des variations par terrains: en Belgique et en Suisse, c’est le «narrateur interne» qui est le plus répandu, au Québec le «narrateur participant» fait jeu égal avec la variante la plus répandue. À noter: l’utilisation de la terminologie genettienne «homodiégétique» par environ 20 % des répondant·e·s belges et suisses.
D’autres variantes ont été encore proposées par les répondant·e·s:
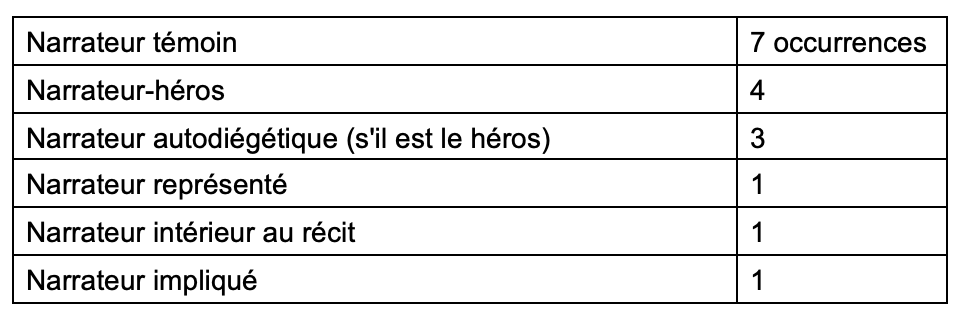
Tableau 12: Propositions alternatives soumises à la question «Avec quelle terminologie décririez-vous à vos élèves un narrateur qui raconte une histoire à laquelle il a pris part?»
6. Quel rapport à la théorie du récit?
Afin d’approcher le «rapport à» la théorie du récit15, le questionnaire proposait aux enseignant·e·s de marquer leur degré d’accord sur un ensemble de propositions, de 1. Tout à fait en désaccord à 5. Tout à fait d'accord.
À la lecture du tableau ci-dessous (tableau 13), on constate un accord global des répondant·e·s aux propositions que pouvait énumérer Reuter (2000) quant aux bénéfices présumés de la narratologie dans l’enseignement du récit (signalées en gras dans le tableau). Mise à part celle relative au décloisonnement entre analyse des textes et analyse des phrases (moyenne de 3,8), les enseignant·e·s des quatres terrains envisagés abondent ainsi dans le sens du didacticien quant aux apports de la théorie du récit telle que scolarisée, et, au premier chef, celui «de produire des analyses plus précises et mieux étayées des textes donnés à lire, écrire et analyser».
Parmi les autres atouts de l’outillage narratologique retenus par les participants, citons également l’amélioration des compétences de compréhension (accord le plus important: 4,3), l’intérêt pour discuter des effets de lecture (4,2) l’augmentation des compétences de réflexivité des élèves (4,1), ou encore une approche des textes qui s’inscrit dans un enseignement explicite de la lecture (4,0).
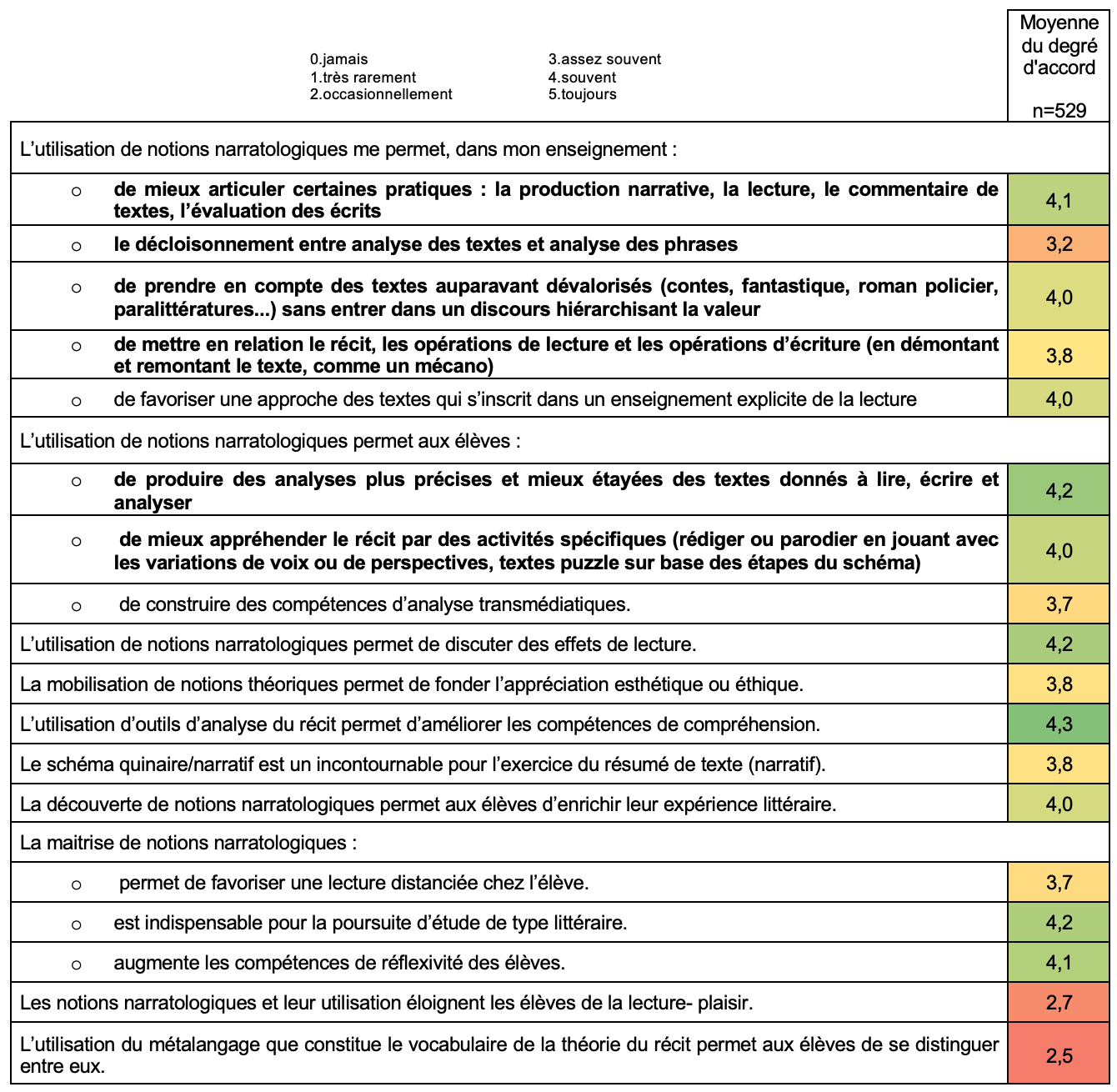
Tableau 13: Moyennes du degré d'accord (1. Tout à fait en désaccord - 5. Tout à fait d'accord) sur différentes propositions relatives au rapport à la théorie du récit (n = 529)
Un accord assez faible porte sur les propositions suivantes: permettre de construire des compétences d’analyse transmédiatique (3,7), de fonder l’appréciation esthétique ou éthique (3,8), de favoriser une lecture distanciée chez les élèves (3,7). Le schéma narratif est quant à lui considéré, toujours avec cet accord faible, comme un incontournable pour l’exercice du résumé de texte narratif (3,8).
A contrario, les répondant·e·s rejettent en majorité la vision de notions narratologiques éloignant les élèves de la lecture-plaisir (2,7). De la même façon, l’hypothèse selon laquelle l’utilisation du métalangage narratologique constituerait un outil de distinction au sein de la classe est rejetée (2,5)16.
Par ailleurs, on ne constate que très peu de variation en croisant ces données avec les différentes variables récoltées (origine géographique, niveau socio-économique des établissements…).
Le rapport à la théorie du récit peut également être approché par le mode d’évaluation que déclarent adopter les enseignant·e·s. On le voit à la lecture du tableau 14, la très grande majorité des répondant·e·s (92%) évaluent la maitrise des notions dans des utilisations en contexte. Un tiers néanmoins évaluent également cette maitrise en sollicitant une restitution de type théorique (être capable de définir, expliquer la notion). Cette dernière modalité est en revanche distribuée différentiellement selon les terrains: France et Suisse d’un côté (38% et 36%), Belgique et Québec de l’autre (23% chacun).
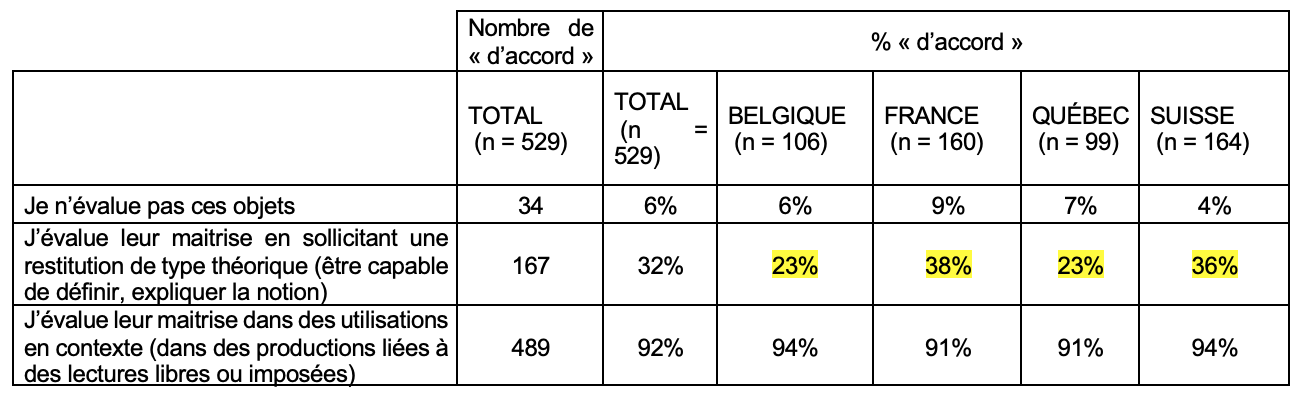 Tableau 14: Modalités d’évaluation employées par les répondants afin d’évaluer la maitrise des notions narratologiques par leurs élèves (pourcentages du total et par terrain / n = 529)
Tableau 14: Modalités d’évaluation employées par les répondants afin d’évaluer la maitrise des notions narratologiques par leurs élèves (pourcentages du total et par terrain / n = 529)
Le rapport à la théorie du récit des enseignant·e·s ayant pris part à cette enquête est donc marqué par un sentiment global de productivité de ces outils narratologiques. Tout en répétant la prudence quant à un échantillon ainsi constitué sur base volontaire, il faut souligner que la très grande majorité des répondant·e·s (94%) considèrent ainsi utile ou très utile que leurs élèves soient formés sur le plan de la théorie du récit.
7. Des besoins?
Quelques items du questionnaire permettent enfin d’approcher les besoins que peuvent exprimer les enseignant·e·s quant à l’enseignement des notions narratologiques.
Comme on le voit à l’aide de la figure 7, quand il s’agit de juger du soutien reçu pour l’enseignement de la théorie du récit dans le cadre de sa formation, la satisfaction est plutôt de mise parmi les répondant·e·s français et suisses. Le constat est légèrement plus nuancé en Belgique et au Québec, dernier terrain où l’option la plus choisie est insuffisant (35%).
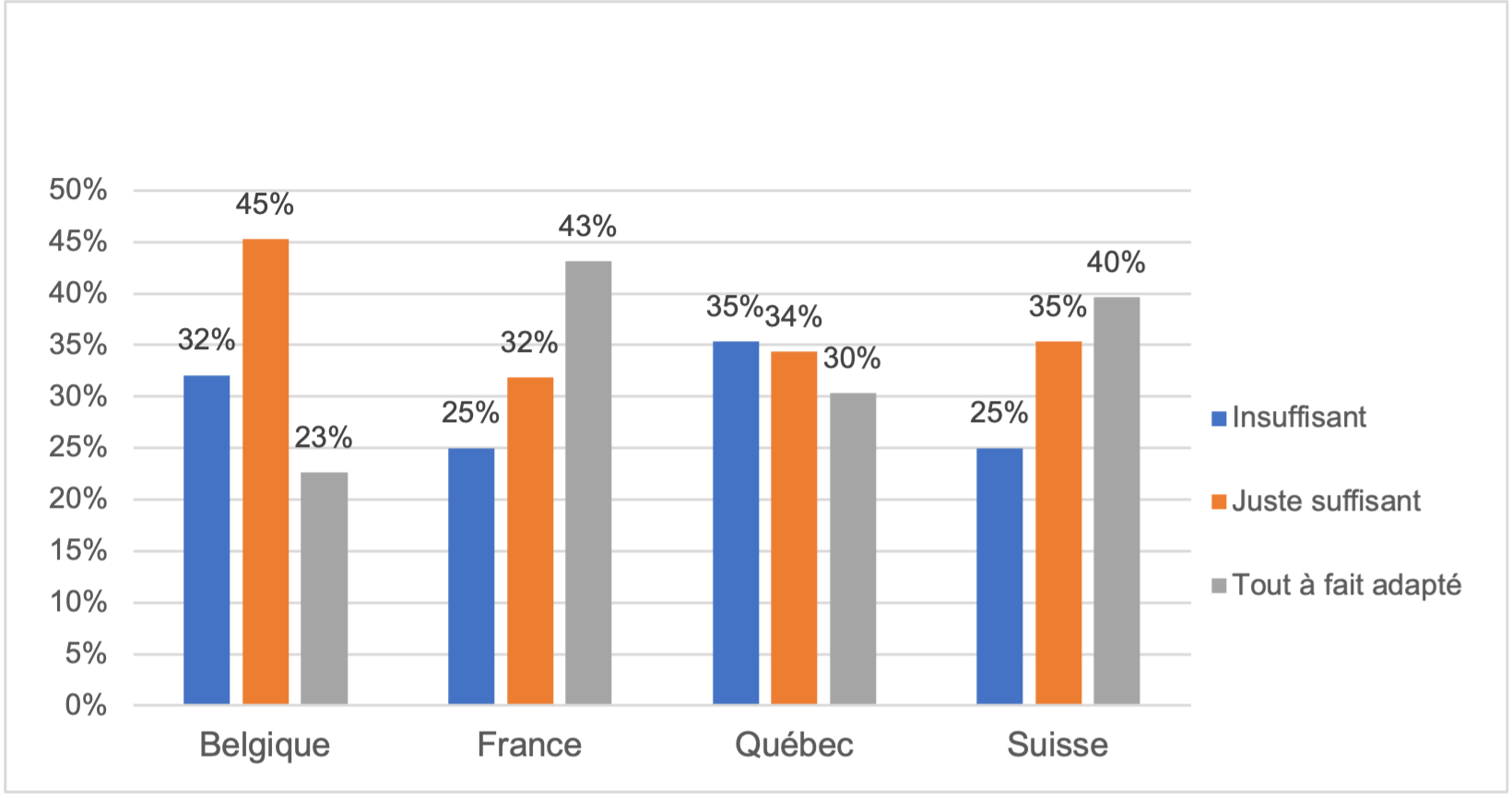
Figure 7: Réponses à la question «Comment estimez-vous le soutien dont vous avez bénéficié pour l’enseignement de la théorie dans le cadre de votre formation académique et/ou pédagogique?» (pourcentages selon le terrain / n = 529)
En ce qui concerne les manuels (figure 8), la majorité des répondants (bien qu’une petite majorité en Suisse: 48%) trouve «juste suffisant» le soutien qu’apportent les manuels ou les ouvrages de synthèse destinés aux enseignant·e·s. Une minorité (de 13 à 23% selon les terrains) juge cet apport des manuels insuffisant.
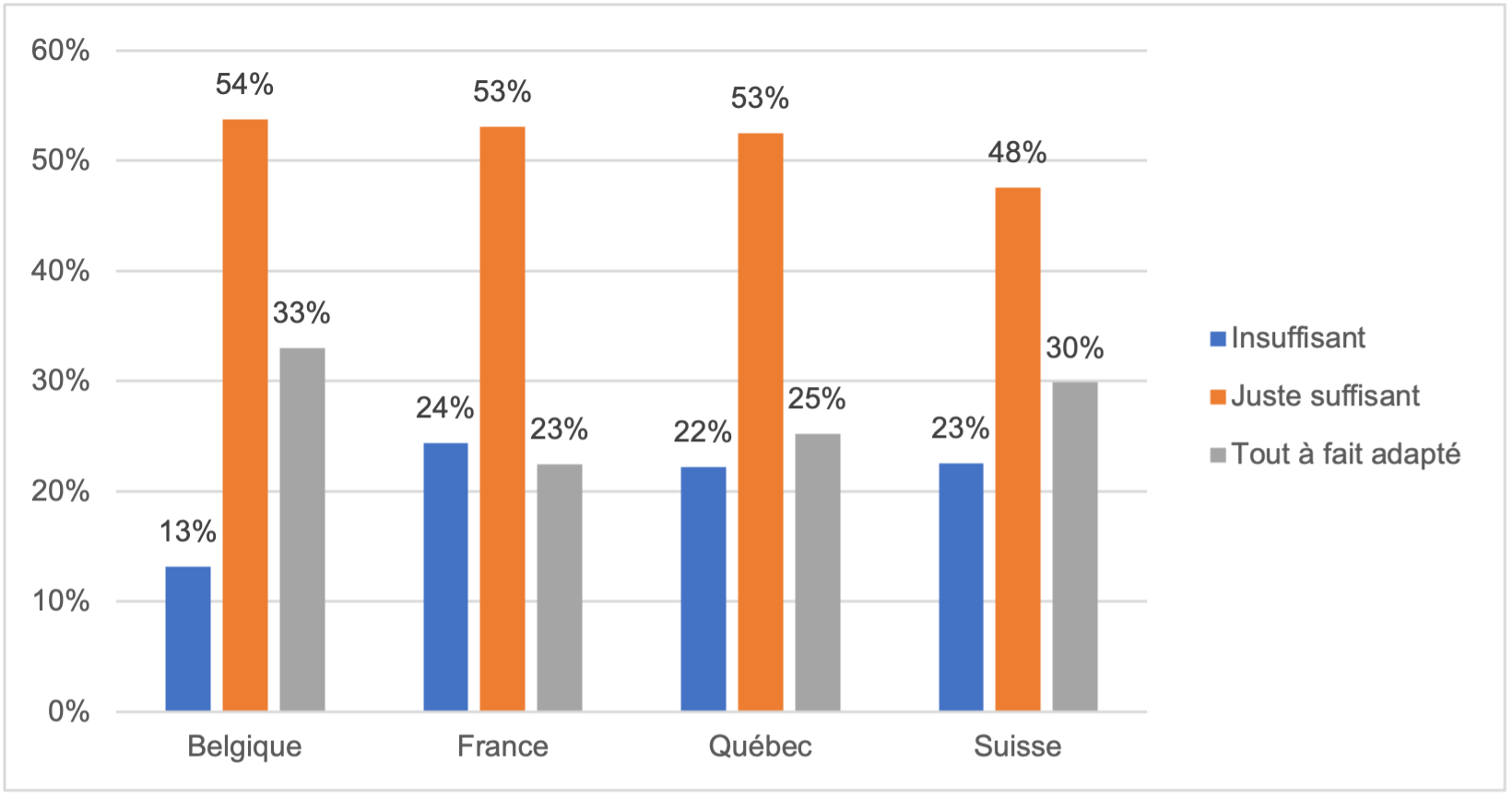
Figure 8: Réponse à la question «Comment estimez-vous le soutien dont vous pouvez bénéficier actuellement dans les manuels ou les ouvrages de synthèse destinés aux enseignant·e·s?» (pourcentages selon le terrain / n = 529)
Enfin, nous n’obtenons pas de réponse tranchée sur la place accordée à l’apprentissage de la théorie du récit dans la formation pédagogique des enseignant·e·s: 44% des répondants ne la jugent pas assez importante, 52% suffisante. Cette tendance se retrouve dans l’ensemble des terrains, exception faite du Québec où une légère majorité des enseignant·e·s (53%) ne juge pas cette place assez importante.
8. En guise de conclusion
Voulant ainsi prendre le pouls des pratiques déclarées par les enseignant·e·s, cette enquête menée en Belgique, en France, en Suisse et au Québec permet déjà quelques constats intermédiaires.
Tout d’abord, la narratologie et ses principales notions constituent – 50 ans après la publication des principaux travaux théoriques la fondant – des objets d’enseignement dans les pratiques des répondant·e·s. Une large majorité d’entre eux estiment ainsi cet outillage théorique important et utile pour leurs élèves. Associées principalement à des activités canoniques telles que le test de lecture et l’explication de texte, ces notions sont donc plus liées à des approches analytiques des textes littéraires et sont moins rapprochées, dans les réponses obtenues, à des écrits de la réception.
Quelques différences apparaissent entre les terrains: des moyennes d’utilisation globalement plus élevées en France et Suisse des notions narratologiques invitent donc à interroger la formation initiale des enseignant·e·s de ces deux pays ainsi que l’influence de l’épreuve finale (EAF en France, bac de français en Suisse) marquée par le format de l’explication de texte.
Par ailleurs, quand il s’agit des ressources privilégiées pour aborder ces contenus d’enseignements, les répondant·e·s déclarent utiliser en priorité des fiches-outils personnalisées17, ce qui peut être rapproché de la diversité terminologique constatée pour nombre de ces notions narratologiques et la nécessité d’alors adapter ces outils au contexte d’enseignement et aux vocables utilisés parfois très localement (la classe, le niveau, l’établissement…).
Enfin, l’outillage narratologique est largement considéré comme utile aux compétences de compréhension des élèves et aux compétences d’analyse, et ce sans éloigner les élèves du plaisir de lire. Mais au rang des principales difficultés émerge le fait que des notions pourtant souvent utilisées, celle de narrateur ou celle de focalisation, suscitent des difficultés dans leur maniement, participant sans doute à cette inflation terminologique18.
L’ensemble de ces constats, issus de cette large enquête internationale, doit maintenant s’enrichir de la confrontation à un autre grand ensemble de données recueillies. Parallèlement à la diffusion du questionnaire dont sont exposés ici les principaux enseignements, 34 entretiens ont en effet été conduits avec des enseignant·e·s en Belgique, en France, en Suisse et au Québec. Ces témoignages ne manqueront pas d’affiner et de complexifier les quelques constats établis ici quant à place de l’outillage narratologique dans les classes de français.
Bibliographie
Brunel, Magali (2021), L'enseignement de la littérature à l'ère du numérique. Études empiriques au collège et au lycée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. «Paideia».
Cellard, Karine & Camille Carrier Belleau (2021), L’enseignement de l’analyse littéraire en Français 101 : Enquête sur les pratiques déclarées des professeur.e.s de littérature au cégep, Montréal, Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature.
Cellard, Karine & Marcel Goulet (2022), «La dissertation critique: la "cousine québécoise" de la dissertation et du commentaire français», Repères, Recherches en didactique du français langue maternelle, (66), p. 143-160. URL: https://dx.doi.org/10.4000/reperes.5452
Dezutter, Olivier & Carl Morissette (2007), «Les finalités assignées à la lecture des oeuvres complètes: le point de vue d’enseignants québécois du dernier cycle du primaire à la fin du secondaire.», in Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire? Sens, utilité, évaluation, J.-L. Dufays (dir.), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 269-277.
Dumortier, Jean-Louis (2001), Lire le récit de fiction: pour étayer un apprentissage: théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck-Duculot, coll. «Savoirs en pratique: français».
Fortin, Marie-Fabienne & Johanne Gagnon (2022), Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes quantitatives et qualitatives, Montréal, Chenelière éducation.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Lépine, Martin (2017), L’enseignement de la lecture/appréciation des œuvres littéraires à l’école primaire: enquête sur les pratiques déclarées et les conceptions d’enseignants québécois, Thèse de doctorat, Université de Montréal.
Reuter, Yves (2000), «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», Repères, Recherches en didactique du français langue maternelle, n° 21, p. 7-22. URL: https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_2000_num_21_1_2325
Vuillet, Yann & Bruno Védrines (2021), «Science didactique et réputation littéraire: le sujet en question», Pratiques, n° 189-190. URL: https://journals.openedition.org/pratiques/9609
Pour citer l'article
Luc Mahieu, "La narratologie en classe de français: premiers résultats d’une enquête internationale", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/la-narratologie-en-classe-de-francais-premiers-resultats-d-une-enquete-internationale
Voir également :
Comment un théoricien du récit pourrait-il contribuer à améliorer l’outillage narratologique scolarisé?
En tant que narratologue travaillant en contexte académique, je suis arrivé il y a quelques années à un point où il m’a semblé légitime, et même nécessaire, de me pencher sur l’utilité des notions théoriques élaborées et débattues dans mon domaine de recherche{{Cet article s’inscrit dans le projet «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement» financé par le fonds national suisse (FNS n° 197612). Le groupe DiNarr, qui pilote ce projet, est dirigé par Raphaël Baroni et réunit également Vanessa Depallens, Luc Mahieu, Fiona Moreno et Gaspard Turin. Ce projet se fonde sur une enquête de terrain visant à cartographier les usages déclarés de la narratologie dans l’enseignement du français comme langue de scolarisation. Il vise également la création d’un site de ressources en ligne visant à faire évoluer l’outillage narratologique en répondant aux besoins des enseignants. Le projet inclut la collaboration de plusieurs partenaires dans le domaine de la didactique, dont plusieurs ont participé à ce numéro: Jean-François Boutin, Vincent Capt, Bertrand Daunay, Jérôme David, Nathalie Denizot, Jean-Louis Dufays et Chloé Gabathuler}}.
Comment un théoricien du récit pourrait-il contribuer à améliorer l’outillage narratologique scolarisé?
En tant que narratologue travaillant en contexte académique, je suis arrivé il y a quelques années à un point où il m’a semblé légitime, et même nécessaire, de me pencher sur l’utilité des notions théoriques élaborées et débattues dans mon domaine de recherche1. Il est en effet presque inévitable de se poser, à un moment ou à un autre de sa vie, la question de la valeur sociale de sa pratique professionnelle. Heureusement, si l’on en croit les travaux qui évoquent, depuis une trentaine d’années, le «tournant narratif» opéré dans les sciences sociales et les sciences humaines (Kreiswirth, 1992), on peut supposer que les notions narratologiques devraient être utiles pour un grand nombre de personnes impliquées dans des contextes sociaux variés. On constate en effet que la théorie du récit est souvent mobilisée dans les domaines du marketing et de la communication, mais aussi du droit, des sciences de l’éducation ou de la médecine, avec le retour des approches biographiques que l’on associe à l’empowerment et les théories concernant la dimension narrative de nos identités (Baroni, 2016a). Il semble néanmoins évident que la première utilité de la narratologie, du moins la plus visible socialement, réside dans l’outillage scolaire mis au service de l’étude des textes littéraires. Dans la formation obligatoire, la familiarisation avec les notions de focalisation, d’intrigue ou de narrateur passe en effet, dans les pays francophones du moins, par la classe de français, où cette «boite à outils» (Dawson, 2017) est non seulement mobilisée par les enseignants2, mais constitue aussi souvent un objet d’enseignement dès le collège en France, le premier degré du secondaire en Belgique et en Suisse, et le premier cycle secondaire au Québec.
Toutefois, un certain vertige existentiel saisit le narratologue soucieux de se mettre au service de la société civile quand il constate que cet outillage n’a pratiquement pas évolué en un demi-siècle, c’est-à-dire, précisément, depuis la parution de la «bible narratologique» (ou plus exactement du Livre de la Genèse de cette discipline) que constitue l’essai de Gérard Genette «Discours du récit», publié en 1972. Les institutions scolaires et la didactique du français auraient ainsi totalement ignoré les efforts consentis par celles et ceux qui ont tenté, au cours des dernières décennies, de faire évoluer la narratologie en la pensant au plus près des phénomènes verbaux, médiatiques, rhétoriques ou cognitifs qui sous-tendent les notions dégagées par les pères fondateurs3 de la discipline.
S’il fallait blâmer quelqu’un de cette indifférence à la théorie contemporaine, sait-on bien à qui il conviendrait d’adresser la critique? Est-il du devoir des enseignants ou des didacticiens d’aller traquer les actualités de la narratologie contemporaine mondialisée (c’est-à-dire anglicisée), quand cette discipline de recherche est à peine présente dans les formations initiales des pays francophones? Pour être tout à fait honnête, il faudrait ajouter que les théoriciens du récit se sont pour la plupart assez peu préoccupés des usages sociaux ou scolaires des notions dont ils débattent. Cette narratologie appliquée (comme il existe, en science du langage, un courant identifié comme relevant de la linguistique appliquée) reste ainsi souvent cantonnée dans les marges de la recherche, où elle consiste essentiellement, dans le droit fil de la critique platonicienne, à dénoncer (souvent à juste titre) les dérives d’un mécanisme de persuasion fondé sur la «contagion» ou la «séduction» (Salmon, 2007; Mäkelä et al., 2021; Brooks, 2022). La scolarisation de la théorie du récit semble quant à elle avoir presque toujours été exclue du champ de réflexion de la narratologie, comme si la théorie risquait de se dégrader au contact de son instrumentalisation scolaire. La tendance est plutôt à la dénonciation d’une approche réduite à une «boite à outil» (Dawson, 2017) ou à une critique condescendante et convenue du processus de scolarisation, dont certains estiment qu’il aurait transformé la théorie littéraire en une «petite technique pédagogique […] desséchante» (Compagnon, 1998, p. 11). Face à ce constat pour le moins discutable4, le risque serait d’en tirer la conséquence qu’aucune intervention significative orientée vers les milieux de l’éducation ne peut être envisagée, comme si les théoriciens avaient fait le job et que le «problème» émanait des milieux de la didactique ou de l’enseignement.
Ce constat de départ n’était à l’origine qu’une vague intuition, une hypothèse formulée par un narratologue qui avait été tenu éloigné de l’école obligatoire et post-obligatoire depuis plus de trente ans. Pour la confirmer ou l’infirmer, il fallait entreprendre une vaste enquête de terrain, ce qui impliquait de trouver des fonds permettant de recruter une équipe de recherche. Les fonds réunis, il a fallu conduire des dizaines d’entretiens avec des enseignants du secondaire I et II dans quatre pays francophones (la Suisse, la Belgique, la France et le Québec), ces données étant recoupées par un questionnaire en ligne auquel ont répondu plus de cinq cents enseignants de français5. Après un premier défrichage de ces données, le constat est bien là: la narratologie est toujours enseignée et parmi les notions les plus fréquemment mobilisées, on retrouve sans surprise les différentes instances de la narration, le point de vue, la focalisation, le schéma narratif ou quinaire, l’intrigue, l’analepse et l’ellipse.
Ajoutons, ce point est crucial, que les questionnaires et les entretiens semi-directifs font également ressortir le fait que certaines notions, bien que régulièrement mobilisées dans l’enseignement, sont jugées problématiques, que ce soit au niveau de leur transmission ou en raison de difficultés dans leur maniement par les élèves. Il s’agit en particulier des notions de focalisation, de point de vue et les distinctions entre différents types de narrateurs (homo-, hétérodiégétiques). Il est également intéressant de constater que suivant la terminologie employée, les difficultés ne sont pas les mêmes. Par exemple, les questionnaires analysés par Luc Mahieu montrent que les enseignants mobilisant la notion de focalisation rencontrent plus de difficultés que ceux mobilisant la notion de point de vue; la différence est encore plus marquée quand on compare les notions de narration à la première ou à la troisième personne (jugées peu problématiques) avec les notions de narrateur homo- ou hétérodiégétiques, jugées plus ardues, alors qu’elles renvoient plus ou moins aux mêmes phénomènes.
Trouver des fonds, mettre en place une enquête de terrain et analyser les données prend du temps. Trois années après sa crise existentielle, le narratologue est donc arrivé à ce constat qui ne fait que soulever de nouveaux dilemmes à mesure qu’il prend conscience, avec son équipe de recherche, de la complexité du domaine dans lequel il a eu l’impudence de s’aventurer. La question se pose ainsi en ces termes: sur la base de cet état des lieux, est-il possible d’intervenir pour tenter d’améliorer l’outillage narratologique mobilisé dans l’enseignement du français? Cette première interrogation entraine de nombreuses questions subsidiaires: que signifie améliorer l’outillage narratologique en contexte scolaire? Un narratologue est-il seulement apte à saisir les enjeux d’une narratologie scolarisée? Est-il légitime pour suggérer telle ou telle amélioration? Comment pourrait-il intervenir pour que ses suggestions aient la moindre chance de modifier les pratiques scolaires? Ne vaudrait-il pas mieux limiter ses ambitions à une approche purement descriptive de la narratologie scolarisée plutôt que de tenter d’agir sur la base de ce constat?
Derrière ces interrogations, il y a de nombreux enjeux qui dépassent le domaine de la narratologie. Critiquer les amalgames conceptuels inhérents à la théorie genettienne de la focalisation (Jost, 1989; Jesch & Stein, 2009; Niederhoff, 2009; Baroni, 2023a) ou souligner les angles morts du schéma narratif quand il s’agit de saisir la dimension rhétorique de la mise en intrigue (Baroni, 2017a) ne vous permet en aucun cas de conclure que l’analyse stylistique de la construction textuelle du point de vue ou l’étude des mécanismes présidant à la création de la tension narrative constitueraient des approches plus intéressantes pour aborder les textes littéraires dans le contexte scolaire d’un enseignement du français. On pourra par exemple opposer l’argument que le schéma narratif est un excellent outil pour construire des compétences en lecture au niveau du primaire, où la compréhension de la chronologie des événements et des liens de causalité entre les actions est un enjeu essentiel. Ce schéma constitue par ailleurs une aide efficace pour élaborer les grandes lignes d’une histoire dans une activité visant la production d’un récit cohérent et complet. Quant à la focalisation, en dépit des difficultés liées à son maniement, cette notion incontournable de l’explication de texte est un outil fortement «discipliné» et «sédimenté» dans les pratiques scolaires (Ronveaux & Schneuwly, 2018). On peut ainsi faire l’hypothèse que la constitution progressive d’une «culture scolaire» (Denizot, 2021, p. 191) – avec ses relais habituels: plans d’étude et manuels, mais aussi échanges informels entre pairs, création et transmission de moyens d’enseignement, etc. – compense largement les éventuels défauts de la théorie et font obstacle à toute velléité de réforme qui serait imposée de l’extérieur. Enfin, c’est la pertinence même de la narratologie comme outil scolaire qui peut être contestée, notamment par les milieux de la didactique qui l’assimilent parfois à des «dérives technicistes» (Langlade, 2004, p. 85), de sorte qu’une évolution des pratiques devrait, aux yeux de certains, conduire à un abandon pur et simple de l’outillage narratologique plutôt qu’à son perfectionnement6.
Bref, un narratologue n’est pas forcément la personne la mieux placée pour fournir l’impulsion qui pourrait faire évoluer la théorie enseignée et le danger est grand que ses suggestions en la matière apparaissent totalement infondées, car déconnectées des réalités du terrain et des enjeux disciplinaires qui constituent la réalité quotidienne des enseignants. Dans le pire des cas, on pourrait même le suspecter de vouloir faire du prosélytisme pour assurer une postérité à son œuvre ou à sa chapelle.
En dépit de ces limitations évidentes, il me semble malgré tout possible de souligner la nature spécifique de ce que pourrait être la contribution d’un théoricien du récit à une élaboration didactique de l’outillage narratologique. Tout d’abord, rappelons que la scolarisation de la narratologie a été en grande partie le résultat de l’enthousiasme spontané des enseignants eux-mêmes, qui ont embrassé cette approche renouvelée des textes littéraires à une époque où la théorie du récit bénéficiait d’une grande visibilité sociale7. On peut donc supposer que le décalage entre la narratologie enseignée et la théorie du récit contemporaine est dû en grande partie à la perte de visibilité de ce champ de recherche en constante évolution, raison pour laquelle je ne manque jamais une occasion de répéter un mantra: la narratologie n’est pas et n’a jamais été un moment structuraliste de la théorie littéraire. Si l’affirmation peut surprendre, elle invite surtout à dépasser un aveuglement (ou une invisibilité, suivant l’angle adopté) qui conduirait à une naturalisation ou un figement des concepts enseignés.
Le premier devoir du narratologue devrait donc être de prendre son bâton de pèlerin et de rappeler, dans le domaine de l’éducation et de la didactique, que la théorie du récit est née d’un intérêt pour toutes les formes médiatiques de la narrativité (pas seulement pour la littérature8), qu’elle est toujours bien vivante et que ses évolutions récentes sont porteuses de potentiels pour l’enseignement du français. Le travail de scolarisation pourrait alors reposer essentiellement, comme ce fut le cas il y a une quarantaine d’années, sur les épaules d’enseignants ou de didacticiens curieux et désireux d’explorer ces nouveaux outils susceptibles de répondre à leurs besoins. Porter cette parole ne va cependant pas sans difficultés, car la perte de visibilité de la narratologie est également sensible dans un contexte académique en crise, qui continue d’accorder le privilège aux approches historiques. Il s’agit donc d’intervenir aussi bien dans le domaine de la formation initiale des enseignants, en luttant sur le terrain des études académiques pour défendre la place des approches théoriques de la narrativité et de la fiction, que d’agir par le biais de formations continues en collaborant aussi étroitement que possible avec les lieux de formation pédagogiques.
Une autre raison qui pourrait justifier l’intervention d’un narratologue est lié à un aspect plus symbolique, à savoir l’extrême déférence envers quelques figures titulaires de la narratologie, en particulier Gérard Genette. Les entretiens que nous avons menés dans la phase préparatoire de notre enquête ont souvent fait ressortir la forte impression laissée par la lecture de Figures III, voire le fait que cette référence est la seule qui soit encore proposée dans le parcours de formation des enseignants, et parfois dans celle des élèves sous la forme d’extraits choisis:
J’étais une enthousiaste de la narratologie, j’étais éblouie par Figures III – j’ai fait mes études dans les années 80, hein, donc c’était vraiment une découverte géniale, et puis peut-être… pas une facilité, mais quelque chose qui est rassurant, qui est assez rassurant pour le prof.
Je connais les outils de Genette, principalement, et s’il y a eu de nouvelles choses, enfin tout ce qui vient après, je suis assez ignorant, parce que ma formation à l’université était, il me semble, surtout centrée là-dessus, en narratologie9.
L’indéniable puissance descriptive de ce modèle théorique et l’élégance du style de son auteur10 risquent ainsi d’induire une attitude de déférence excessive envers les typologies genettiennes, qui ont été largement adoptées par les milieux scolaires, tout en engendrant parfois des difficultés interprétatives liées à des phénomènes mal circonscrits ou abordés exclusivement dans une perspective classificatoire, en laissant dans l’ombre une réflexion sur les fonctions discursives des dispositifs identifiés. Or, s’il partage la même admiration, le narratologue sait quant à lui qu’il n’y a pas une seule notion introduite par Genette dans cette œuvre majeure qui n’ait fait l’objet de critiques ou de débats, parfois assez féroces11. Son rôle pourrait alors être de rappeler cette évidence: les typologies genettiennes ne représentent qu’un état de la question, une approche des phénomènes narratifs parmi d’autres concurrentes, et il n’est pas absolument certain qu’elle soit toujours la plus efficace quand il s’agit de discuter dans la classe de français du statut du narrateur, du régime de focalisation, de la construction temporelle d’un récit ou de sa mise en intrigue.
Il ne s’agit pas ici de céder à un simple effet de mode, mais simplement rappeler le statut historique de toute notion théorique et la nécessité de penser l’outillage scolaire au plus près de ses finalités et de ses usages. Le rôle essentiel d’un chercheur qui s’inscrit dans le champ de la narratologie consiste alors à rappeler que sa discipline est perfectible et que personne, aussi charismatique soit-elle, ne peut prétendre avoir élaboré un modèle définitif et parfait de la narrativité (ce qui serait un cas unique dans l’histoire des sciences humaines). Il y a toujours moyen de saisir le phénomène sous un autre angle, d’en révéler des aspects différents, voire de mettre au jour des problèmes de conceptualisation et des manières plus exactes (ou, disons, plus intéressantes, c’est-à-dire utiles) de rendre compte du fonctionnement d’un récit.
Un narratologue pourrait ainsi s’adresser aux usagers de sa boite à outils en leur prodiguant quelques conseils: par exemple si vous cherchez un outil qui vous permette de montrer comment le langage verbal produit un effet de subjectivation de la représentation en ancrant un récit dans le point de vue d’un personnage, alors vous feriez peut-être mieux de recourir à la conceptualisation stylistique de ce phénomène que propose Alain Rabatel (1998) plutôt que de vous appuyer sur la triple focalisation telle que définie par Gérard Genette. En revanche, si vous voulez montrer comment un récit peut créer un effet de suspense en informant le lecteur d’un danger ignoré par le protagoniste, ou comment il peut, alternativement, susciter de la curiosité en mettant en scène un personnage détenant des secrets, alors la typologie genettienne sera la plus efficace. Et si vous voulez jouer sur les deux tableaux, alors rien ne vous empêche d’articuler ces deux approches très différentes, mais peut-être aurez-vous alors besoin de recourir à une synthèse de ces deux modèles. Et si le besoin se fait sentir d’élargir la réflexion à la représentation de la subjectivité dans d’autres médiums que le texte littéraire, alors le cadre conceptuel offert par la narratologie transmédiale sera probablement le plus approprié, ce qui exigera quelques efforts de décentration des modèles logocentriques hérités du structuralisme (Baroni, 2016a).
Ce qui est en revanche assez questionnant pour un narratologue, c’est de constater que l’enseignement de la perspective narrative puisse avoir été identifiée depuis des lustres, par les enseignants aussi bien que par les didacticiens12, comme posant problèmes, sans que les ressources pour y remédier, pourtant disponibles depuis plusieurs décennies, ne soient mobilisées. Ce questionnement ne met pas en cause l’attitude des enseignants – qui remédient souvent, avec beaucoup d’ingéniosité, aux défauts de la théorie dont ils ont hérité durant leur formation initiale – ni celle des didacticiens – auxquels il n’est pas demandé de transposer les dernières théories à la mode, mais de décrire les pratiques effectives et de mettre au jour leurs logiques propres –, mais il invite surtout les narratologues eux-mêmes à s’impliquer dans les débats portant sur les usages scolaires de leurs modèles théoriques pour tenter de trouver des solutions pragmatiques en échangeant avec les acteurs qui président à la scolarisation des savoirs disciplinaires, qu’il s’agisse de praticiens, de formateurs, de prescripteurs ou de créateurs de manuels...
Reste qu’il n’est pas facile de cibler les objets pour lesquels une intervention est nécessaire, ni de définir précisément comment on passe de la réélaboration d’une théorie à sa mise au service de l’enseignement. Sur ce dernier point, il me semble que l’effort que devrait fournir le narratologue – parmi d’autres interventions émanant des enseignants, des didacticiens, des prescripteurs, etc. – consiste à penser la manière dont une notion théorique, généralement instable et soumise aux débats contradictoires de sa discipline, est susceptible de se transformer en outil-concept pour l’enseignement, de sorte que sa définition et sa dénomination se stabilisent (au moins provisoirement) tout en se soumettant à une finalité explicitement liée à des usages déterminés par des enjeux disciplinaires (Schneuwly, 2000; Reuter, 2013).
Ce processus qui conduit de la notion théorique à l’outil-concept pour l’enseignement dépend d’une élaboration didactique qui ne peut reposer entièrement sur les épaules du narratologue, dans la mesure où son action doit être orientée par des enjeux externes à son champ de recherche. Il ne s’agit pas d’un processus descendant qui consisterait à simplifier des savoirs de référence pour les rendre assimilables en contexte scolaire. Il s’agit, au contraire, de partir des besoins du terrain, de l’identification de manques ou de difficultés, pour fournir ensuite des solutions basées sur des outils-concepts forgés sur mesure pour des usages scolaires avérés. Il faut également être à l’écoute des solutions construites par les enseignants eux-mêmes et rester ouvert à des réélaborations conceptuelles ou des reconfigurations terminologiques fondées sur leurs expériences.
Quant à la manière de cibler les objets concernant lesquels une intervention est prioritaire, plusieurs voies sont possibles. La plus simple consiste à demander aux enseignants quels éléments de l’outillage narratologique leur paraissent incontournables tout en leurs posant des difficultés. Si ces difficultés ont aussi été identifiées dans les théories de référence et si des alternatives existent, alors une didactisation de ces nouveaux modèles pourrait être proposée, tout en portant attention aux solutions élaborées sur le terrain, quand ces dernières existent. En ce sens, il pourrait aussi être utile d’interroger les enseignants sur le rendement qu’ils attribuent à tel ou tel aspect du récit, avec parfois des jugements assez contrastés, à l’instar de ces deux enseignants:
Je trouve que… un premier aspect, celui qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est ce que fait Propp ou le schéma quinaire, c’est à dire qu’ils permettent de… la théorie permet d’aiguiller un nombre très important voire la majorité des œuvres. Parce que c’est applicable – le schéma du conte, il est applicable à la majorité des contes. Donc ça tout d’un coup, c’est intéressant, parce que c’est une théorie qui résume, en fait, et qui est applicable après dans la majorité des textes.
Alors le schéma narratif, mais j’en ai soupé, franchement. Ils [les élèves] en tirent rien…13
Dans ce cas, on constate qu’une notion dont l’intérêt repose sur son applicabilité à une très grande diversité de récits peut contraster avec la difficulté, pour une autre enseignante, d’en saisir l’intérêt lorsqu’elle est mise au service de l’interprétation. Dans ce cas, le rôle du narratologue pourrait être de signaler l’existence de modèles alternatifs, et de montrer quels usages potentiels peuvent en être tirés pour l’interprétation des récits. Si l’activité consiste à mettre en lumière une parenté entre un grand nombre de récits, ou de favoriser l’activité de «résumé», alors le «schéma quinaire» semble particulièrement approprié. En revanche, s’il s’agit de montrer comment un récit s’y prend pour nouer son intrigue et pour intéresser le lecteur, alors d’autres conceptualisation que le «schéma narratif» pourraient être proposées, à l’instar de l’approche de la mise en intrigue sous l’ange des mécanismes textuels présidant à la création de la «tension narrative» (Baroni, 2017a). Étant informés de ces alternatives, les enseignants pourraient simplement choisir le modèle le plus approprié aux finalités qui sont les leurs, et qui peuvent d’ailleurs différer sensiblement aux différents degrés de la scolarité et en fonction des objectifs de telle ou telle phase du cours.
Un autre aspect spécifique, déjà évoqué plus haut, concerne la question de l’élargissement des corpus étudiés au-delà des textes littéraires, et même au-delà des formes assimilables à une narrativité dite «monomodale» (Lebrun, Lacelle & Boutin, 2015). Sur ce plan, des enseignants amenés à aborder en classe un récit en bande dessinée peuvent se découvrir passablement désarmés face à la narrativité des récits graphiques. S’ils peuvent avoir tendance à se rabattre sur des notions narratologiques bien huilées, il n’est pas sûr qu’une typologie des narrateurs ou un modèle textualiste de la construction d’un point de vue se révéleront efficaces pour analyser une planche (cf. Schaer, 2023). Un effort de réarticulation transmédiale des notions narratologiques et la mise en évidence des effets des supports sur la forme des récits pourraient ainsi s’avérer nécessaire dès le stade de la formation initiale des enseignants.
Par ailleurs, s’il est relativement facile d’identifier les outils devenus incontournables, ceux qui se sont profondément ancrés dans les pratiques scolaires depuis des décennies quels que soient les difficultés inhérentes à leur maniement, il est en revanche beaucoup plus difficile de définir ceux qui font encore défaut, c’est-à-dire ceux qui manquent au répertoire des enseignants, sans que ces derniers n’en aient forcément conscience. Ainsi, quand on les interroge sur les lacunes de la théorie narrative, certains enseignants ne peuvent que se questionner sur l’existence de notions hypothétiques, à l’instar de cet enseignant:
Je pense qu’une grande difficulté des élèves, c’est l’ironie. De comprendre des fois les distances que l’auteur crée avec ou entre son personnage, ou le fait qu’il faut pas prendre de manière littérale… Alors je pense que s’il y avait des outils pour comprendre ce genre de distances, ça m’aiderait beaucoup14.
Une manière simple d’élargir le domaine des outils-concepts dont la valeur scolaire est plus ou moins garantie pourrait consister à élargir le spectre de l’enquête de terrain à des enseignements qui s’inscrivent dans d’autres langues ou cultures, dont certaines s’appuient sur des traditions narratologiques très différentes mais aussi durablement ancrées dans les pratiques scolaires. Les enseignants de français ignorent souvent que l’outillage narratologique de leurs collègues anglophones ou germanistes diffère profondément du modèle genettien, lequel parait si familier qu’il a fini par se naturaliser. À côté des narrateurs homo- ou extra-hétérodiégétiques, il existe ainsi des personnages-réflecteurs, des narrateurs auctoriaux ou non fiables, et même des auteurs implicites, qui font partie de la vulgate enseignée dans la formation initiale des enseignants d’allemand ou d’anglais15. Ce n’est pas le moindre des résultats de notre enquête que d’avoir constaté par exemple que les notions d’auteur implicite et de narrateur non fiable – qui permettent précisément de décrire les effets d’«ironie» ou de «distance» évoqués par l’enseignant que nous avons interrogé – sont pratiquement inconnues des enseignants de français dans les quatre pays que nous avons investigués, alors que cette approche est au cœur de la théorie anglo-saxonne initiée par les travaux de Wayne C. Booth (1983; 1977). Serait-il possible que les narrateurs francophones soient plus fiables que les autres? La question de la proximité ou de la distance entre les valeurs portées par l’écrivain et celles incarnées par son narrateur ou ses personnages serait-elle moins intéressante quand on lit Flaubert que quand on lit Nabokov? Il me semble qu’un tel décalage culturel mériterait pour le moins d’être identifié et problématisé dans la formation initiale ou continuée des enseignants.
Sur la base de ces différentes stratégies, il me semble possible de dégager quelques pistes susceptibles d’améliorer l’ergonomie de l’outillage narratologique pour le mettre véritablement au service des besoins des enseignants et des élèves. Sans entrer dans le détail de propositions encore en chantier, je dresserai ci-dessous un inventaire provisoire de quelques lieux d’intervention susceptibles de renouveler la narratologie scolaire en répondant aux besoins du terrain. Sans surprise, on retrouvera les grandes catégories narratologiques dont l’ancrage scolaire est le plus fort, notamment les catégories genettiennes de la voix (problématiques liées à la figure du narrateur), du mode (problématiques liées à la perspective narrative) et du temps (reconfiguration temporelle de l’histoire par le récit), mais aussi les notions d’intrigue et de personnage, qui entrent en correspondance avec certains des schémas la plus enseignés («schéma narratif» de Larivaille et «schéma actantiel» de Greimas). Pour chaque catégorie, j’indiquerai quelques évolutions possibles, en les associant à quelques références incontournables et, quand cela est possible, à des synthèses de ces travaux que j’ai proposées en vue d’en faciliter la scolarisation:
- Narrateur: en ce qui concerne la catégorie du narrateur, il pourrait être utile de considérer cette instance comme un élément optionnel du récit (Patron, 2009). Non seulement un film ou une bande dessinée peuvent s’en passer complètement, mais un récit mené à la troisième personne peut également faire l’économie d’un narrateur «scénographié» par le discours (Maingueneau, 2004). Le travail sur les traces énonciatives que laisse un éventuel narrateur permettrait de mieux articuler l’analyse de cette instance narrative avec ses manifestations verbales ou médiatiques. Définir le mode énonciatif du récit en s’appuyant sur les personnes de la narration (narration à la première personne vs. à la troisième personne, mais aussi éventuellement narration à la deuxième ou à la quatrième personne) pourrait aussi permettre de mieux saisir les spécificités de différentes manières de raconter. De toute évidence, la dichotomie entre intra- et extradiégétique est plus ou moins inenseignable en raison des confusions avec la dichotomie homo- et hétérodiégétique, alors que la notion d’enchâssement semble ne poser aucun problème conceptuel particulier. La question des «niveaux narratifs» devrait plutôt orienter la discussion sur les effets de transgression de ces niveaux liés par la figure de la «métalepse», aussi fréquente dans la littérature d’Ancien Régime ou contemporaine que dans la culture populaire (Wagner, 2002; Schaeffer & Pier, 2005; Klimek & Kukkonen, 2011; Lavocat, 2020). Par ailleurs, en se basant sur l’approche de Booth (1977), il pourrait être très productif d’introduire la problématique de la fiabilité du narrateur, et plus généralement, celle de la distance entre un auteur implicite, parfois ironique, et les différentes instances mises en scène par le récit (narrateurs et personnages), notamment pour aborder la littérature contemporaine (Wagner, 2016).
- Perspective (mode): Comme l’ont montré différents chercheurs (Jost, 1989; Paveau & Pecheyran, 1995; Niederhoff, 2001; Jesch & Stein, 2009; Baroni, 2021; 2023a), la focalisation genettienne semble particulièrement difficile à enseigner ou à manipuler pour analyser des récits, car sa théorisation amalgame des paramètres hétérogènes: a. les ancrages éventuels dans la subjectivité de différents personnages; b. des enjeux relevant d’une stylistique dite «de l’omniscience», face aux narrations dites «béhavioristes» ou «en flux de conscience»; c. l’orientation sélective du récit sur différentes parties prenantes de l’histoire et ses effets (empathie, focalisations multiples, etc.); d. l’extension du savoir mis à disposition du public quand on le compare à ce que savent différents personnages, dont dépendent différents effets de curiosité ou de suspense. D’un côté, pour faciliter les étayages interprétatifs par la mise en évidence d’indices formels, il pourrait être utile de mieux expliciter les procédés qui produisent un ancrage du récit dans la subjectivité d’un personnage, ce que Rabatel désigne comme la «construction textuelle du point de vue» (Rabatel, 1998) et ce que Jost (1989) rattache aux procédés audiovisuels d’ocularisation et d’auricularisation. Sur ce plan, il pourrait être utile également de sensibiliser les élèves aux spécificités médiatiques de ces processus de subjectivation de la représentation, par exemple en procédant à des comparaisons intermédiales entre cinéma et littérature, ou entre bande dessinée et littérature (Jost, 1989; Baroni, 2023a). Il peut aussi être utile de souligner les rapports étroits que l’on peut établir entre la dynamique de l’intrigue et différents régimes de savoir (restreint, équivalent ou élargi) ou de subjectivité (Baroni, 2017a; 2020a).
- Temps: les catégories liées au temps pourraient également être mieux articulées aux expériences immersives des lecteurs ou des spectateurs. En ce qui concerne les anachronies, on pourrait ainsi mieux distinguer, comme dans les études cinématographiques, le flashback (ou analepse «dramatisée») de l’analepse allusive (simple évocation du passé par un personnage ou par le narrateur), ainsi que les procédés stylistiques qui permettent un réancrage du récit dans le passé (Baroni, 2016b). On éclairerait ainsi une asymétrie entre l’analepse et la prolepse, cette dernière se limitant le plus souvent à une simple allusion à un futur possible ou avéré. Si le récit consiste bien à «monnayer un temps dans un autre temps» (Metz, 2013, p. 31), c’est surtout autour des anachronies «dramatisées» (flashbacks et flashforwards) ainsi que des changements de rythmes dans le récit que cette propriété des artefacts narratifs peut être explorée. L’opposition entre scène et sommaire devrait également être repensée sur la base de l’expérience immersive: tandis que la scène est une représentation qui nous replace dans la perspective temporelle de l’événement raconté, le sommaire se manifeste au contraire comme une narration distanciée, qui n’offre pas de points d’ancrage pour se représenter les événements dans l’actualité de leur développement (Baroni, à paraitre). Des travaux récents invitent aussi à repenser la question du «rythme» en se fondant sur les effets d’accélération et de ralentissement qui découlent d’une certaine organisation formelle du récit. Kathryn Hume a ainsi montré qu’un effet d’accélération du roman contemporain peut, paradoxalement, découler d’un effacement des sommaires (Hume, 2005), similaire à une succession rapide de plans courts dans le montage d’un film.
- Intrigue: le succès scolaire de la notion de schéma narratif fait écran à des formes alternatives d’organisation séquentielles des récits. Ce découpage de l’histoire en cinq phases, dérivé des travaux de Paul Larivaille (1974) et popularisé par la linguistique textuelle de Jean-Michel Adam (1997), demeure de toute évidence très utile pour soutenir des opérations de compréhension ou de résumé, ainsi que pour structurer la production de récits en donnant un cadre pour déterminer les actions principales qui constitueront la trame de l’histoire. En revanche, l’approche par la mise en intrigue permet de saisir des procédés narratifs visant à créer une tension dans la lecture (Baroni, 2017a; 2020b), offrant ainsi une approche susceptible d’articuler l’analyse des mécanismes textuels, graphiques ou audiovisuels avec la production d’un intérêt narratif. Il importe donc de clairement différencier trois manières très différentes d’envisager la séquence narrative: 1. comme trame de l’histoire (schéma narratif); 2. comme passage narratif contrastant, par exemple, avec la description ou le dialogue (séquence textuelle); 3. comme mise en intrigue par la création d’une tension lorsque le public progresse dans le récit (Baroni, 2020a; 2023b). Étudier la mise en tension du récit permet non seulement d’éclairer les actions racontées, mais aussi de mesurer leur valeur en les comparant avec les virtualités qui se dégagent du fil de l’histoire. Les possibles narratifs engagent non seulement un désir de progression vers le dénouement, mais ils soulèvent aussi des enjeux éthiques pour les personnages engagés dans des événements inextricables (Laugier, 2006; Baroni, 2023b).
- Personnage: il ne fait guère de doute que les personnages ne sauraient se limiter aux rôles actantiels qu’ils endossent dans l’intrigue. Parmi les pistes les plus intéressantes, il y a naturellement l’approche de Vincent Jouve sur l’effet du personnage, qui ménage une place fondamentale aux fonctions de support pulsionnel et d’identification (Jouve, 1992). Un cadre conceptuel potentiellement productif pour l’enseignement pourrait aussi être emprunté aux travaux du narratologue américain James Phelan, qui distingue trois fonctions fondamentales pour les personnages: la fonction mimétique (épaisseur, crédibilité du personnage envisagé comme personne), la fonction synthétique (prise en compte du rôle du personnage dans l’intrigue, lequel recouvre, entre autres choses, les rôles actantiels) et la fonction thématique (le personnage en tant que porteur de valeurs ou de symboles) (Phelan, 1989). D’une manière générale, il peut être utile de rappeler que l’épaisseur, mais aussi la relative opacité ou l’imprévisibilité d’un personnage sont des éléments essentiels de l’intérêt qu’on leur porte (Baroni, 2017a, p. 85-90; 2017c). Enfin, c’est évidemment en prenant le personnage au sérieux, c’est-à-dire en le considérant comme étant davantage qu’un simple «signe», qu’il devient possible de lui associer des enjeux de nature éthique, restituant ainsi à l’interprétation des formes narratives son plein potentiel pour une «éducation morale» (Laugier, 2006).
Si l’une ou l’autre de ces propositions devait susciter l’intérêt des enseignants, il faudrait alors procéder à une conceptualisation des propositions théoriques jugées en phase avec les finalités de l’enseignement du français, c’est-à-dire à une réduction du caractère instable de notions encore débattues dans le champ de la narratologie de manière à en fixer la terminologie et à produire des définitions intelligibles pour les élèves. Il y a de fortes chances que ce travail d’élaboration didactique soit le fait des enseignants eux-mêmes, pour autant qu’ils estiment que l’effort en vaut la chandelle. Ils sont en effet les mieux placés pour répondre, par exemple, aux questions relatives aux progressions curriculaires: faut-il commencer en fournissant des outils spécifiquement profilés pour l’enseignant, de sorte que ce dernier soit en mesure de sensibiliser les élèves aux enjeux narratologiques dès les premiers cycles, sans pour autant faire de ces outils des objets d’enseignement? Faut-il envisager des terminologies différenciées entre les degrés du secondaire 1 et du secondaire 2? Quel sont les outils-concepts les plus essentiels, ceux qu’il faudrait introduire en premier et ceux qui devraient être abordés ultérieurement? La métalepse et la narration à la deuxième personne doivent-ils être enseignés avant le stade de la formation post-obligatoire ou académique?
Du côté du narratologue, le problème tient surtout à la manière de faire entendre ses propositions, ce qui passe avant tout par la défense de la place de la théorie du récit dans la formation initiale et continuée des enseignants. Il faudrait également pouvoir entamer un dialogue autour des prescrits, proposer de nouveaux manuels, impliquer didacticiens et enseignants pour élaborer et mettre à l’épreuve de la classe ces nouveaux outils-concepts et évaluer leurs effets sur la formation des élèves. J’ajoute que cette épreuve du terrain est une chance extraordinaire pour la théorie elle-même, dans la mesure où les modèles narratologiques, la plupart élaborés dans une démarche purement hypothético-déductive, ont trop rarement été confrontés à des tests empiriques, de sorte que leur validité demeure le plus souvent douteuse. Pour ma part, c’est souvent lorsque j’étais confronté à ma perplexité d’enseignant ou aux résistances de mes étudiants que j’ai réalisé la nécessité de faire évoluer la théorie (je précise: faire évoluer non seulement la théorie enseignée, mais la théorie elle-même, dont on découvre les aspérités). Ainsi que le suggère Karl Canvat, le renouvellement des modèles narratologiques pourrait donc bien impliquer une confrontation plus étroite avec les pratiques scolaires:
L’applicationnisme est la forme que prend ordinairement la transposition didactique lorsqu’elle adopte un mouvement descendant. L’implicationnisme est la forme qu’elle prend lorsqu’elle injecte dans les savoirs enseignés de nouveaux savoirs issus des savoirs de référence, mais aussi qu’elle met ces nouveaux savoirs en relation avec les pratiques scolaires, voire que celles-ci interrogent les savoirs de référence et les incitent à se renouveler. (Canvat, 2000, p. 64)
Par ailleurs, le théoricien du récit ne peut demeurer entièrement sourd aux critiques qui ont été formulées envers sa discipline, parfois mêmes relayées par certains narratologues de la première heure (Todorov 2007); mais plutôt que de se défendre en affirmant qu’il serait dommage de «jeter le bébé avec l’eau du bain» (Reuter, 2000, p. 7), il pourrait être intéressant de tenter de mieux comprendre ce qui constitue la résilience de l’appareil narratologique en dépit des reproches qui lui sont adressés depuis une bonne vingtaine d’années16. En outre, il faudrait explorer les éventuelles convergences observables entre l’évolution de la didactique du français et les changements qui ont affecté parallèlement la théorie du récit, qui se présente aujourd’hui sous une forme assez éloignée du modèle structuraliste. Cette comparaison pourrait ainsi faciliter le repérage des modèles théoriques en phase avec les enjeux actuels de l’enseignement du français, que ce soit en mettant en lumière les mécanismes qui président aux expériences immersives, esthétiques et éthiques des lecteurs, en montrant comment l’étude des textes narratifs permet de mieux comprendre le fonctionnement du langage verbal ainsi que celui d’autres médias (le théâtre, la bande dessinée, le cinéma, voire le jeu vidéo…), ou qu’il s’agisse simplement de contribuer à un enseignement explicite, l’outillage narratologique ayant au moins la vertu d’objectiver les procédures par lesquelles il est possible d’interpréter un texte narratif.
Je pense que sans un changement profond de la réputation de la narratologie dans les domaines des études littéraires, de la didactique et de l’enseignement du français, tout changement de fond demeurera impossible. L’image figée d’une discipline qui a fait son temps, continue souvent de faire obstacle à l’exploration du potentiel des modèles actuels. Seule la construction d’un véritable dialogue interdisciplinaire fondé sur la reconnaissance de l’existence d’une narratologie contemporaine (qu’on acceptera d’appeler «postclassique» si cela contribue à faire comprendre qu’il existe autre chose que les typologies structuralistes des années 1960-1970) pourra ouvrir un horizon pour une amélioration de l’outillage narratologique dans la classe de français. Pour terminer sur une note optimiste, on peut entrevoir un signe encourageant dans le fait que la 24ème rencontre des chercheurs en didactique de la littérature ait récemment choisi comme thématique «les territoires de la fiction», son appel à contribution mentionnant trois fois la narratologie, non pour en dénoncer des dangers, mais pour envisager l’apport des «outils de la narratologie post-classique».
Références
Adam, Jean-Michel (1997), Les Textes: types et prototypes, Paris, Nathan.
Baroni, Raphaël (à paraitre), «Summaries and Scenes as Decelerators and Accelerators of Narrative Speed», in Slow Narrative Across Media, M. Caracciolo & E. Mingazova (dir.), Columbus, Ohio State University Press, coll. «Theory and Interpretation of Narrative».
Baroni, Raphaël (2023a), «Une perspective transmédiale sur la focalisation», Recherches. Revue de didactique et de pédagogie du français, n° 78, p. 9-44.
Baroni, Raphaël (2023b), «Des virtualités du monde de l’histoire à la mise en intrigue: une alternative au schéma narratif», Pratiques, n° 197-198.
Baroni, Raphaël (2022), Lire Houellebecq. Essais de critique polyphonique, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël (2021), «Perspective narrative, focalisation et point de vue: pour une synthèse», Fabula Lht, n° 25. URL: http://www.fabula.org/lht/25/baroni.html
Baroni, Raphaël (2020a), «La séquence? Quelle séquence? Retour sur les usages littéraires de la linguistique textuelle», Poétique, n° 188, p. 259-278. DOI: https://doi.org/10.3917/poeti.188.0259
Baroni, Raphaël (2020b), «Pour des concepts narratologiques intelligibles et utiles pour l’enseignement: schéma quinaire et focalisation en débat», Transpositio, n° 2.
URL: http://www.transpositio.org/articles/view/pour-des-concepts-narratologiques-intelligibles-et-utiles-pour-l-enseignement-schema-quinaire-et-focalisation-en-debat
Baroni, Raphaël (2017a), Les Rouages de l’intrigue, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël (2017b), «Pour une narratologie transmédiale», Poétique, n° 182, p. 155-175.
Baroni, Raphaël (2017c), «Le rôle des personnages dans les rouages de l’intrigue», Letras de Hoje, n° 52 (2), p. 156-166. DOI: https://doi.org/10.15448/1984-7726.2017.2.29185
Baroni, Raphaël (2016a), «L’empire de la narratologie contemporaine, ses défis et ses faiblesses», Questions de communication, n° 30, p. 219-239.
Baroni, Raphaël (2016b), «Dramatized Analepsis and Fadings in Verbal Narratives», Narrative, n° 24 (3), p. 311-329. DOI: https://doi.org/10.1353/nar.2016.0019
Booth, Wayne C. (1983 [1961]), The Rhetoric of Fiction, Chicago, The University of Chicago Press.
Booth, Wayne C. (1977), «Distance et point de vue. Essai de classification», in Poétique du récit, R. Barthes & e. al. (dir.), Paris, Seuil, p. 85-113.
Brooks, Peter (2022), Seduced by Story. The Use and Abuse of Narrative, New York, New York Review Books.
Canvat, Karl (2000), «Quels savoirs pour l’enseignement de la littérature? Réflexions et propositions», in Enseigner la littérature, Toulouse, Delagrave / CRDP.
Compagnon, Antoine (1998), Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil.
Dawson, Paul (2017), «Delving into the Narratological “Toolbox”: Concepts and Categories in Narrative Theory», Style, n° 51 (2), p. 228-246.
Denizot, Nathalie (2021), La culture scolaire: perspectives didactiques, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. «Études sur l'éducation».
Fludernik, Monika (2018), «De la narratologie naturelle: une synthèse rétrospective», in Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, S. Patron (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 69-94.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Hume, Kathryn (2005), «Narrative Speed in Contemporary Fiction», Narrative, n° 13 (2), p. 105-124.
Jesch, Tatjana & Malte Stein (2009), «Perspectivization and Focalization: Two Concepts—One Meaning? An Attempt at Conceptual Differentiation», in Point of View, Perspective, and Focalization, P. Hühn, W. Schmid & J. Schönert (dir.), Berlin & New York, De Gruyter, p. 59-78.
Jost, François (1989), L'Œil-caméra. Entre film et roman, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Jouve, Vincent (1992), L'Effet-personnage dans le roman, Paris, PUF.
Klimek, Sonja & Karin Kukkonen (2011), Metalepsis in Popular Culture, Berlin, New York, W. De Gruyter.
Kreiswirth, Martin (1992), «Trusting the Tale: The Narrativist Turn in the Human Sciences», New Literary History, n° 23 (3), p. 629-657.
Larivaille, Paul (1974), «L'analyse (morpho)logique du récit», Poétique, n° 19, p. 368-388.
Langlade, Gérard (2004), «Sortir du formalisme, accueillir les lecteurs réels», Le français aujourd'hui, n° 145(2), 85-96. DOI: https://doi.org/10.3917/lfa.145.0085
Laugier, Sandra (2006), Éthique, littérature, vie humaine, Paris, Presses Universitaires de France.
Lavocat, Françoise (2020), «Et Genette inventa la métalepse», Nouvelle revue d’esthétique, n° 26, p. 43-51. DOI: https://doi.org/10.3917/nre.026.0043
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (dir.) (2012), La littératie médiatique multimodale, Québec, Presses Universitaires du Québec.
Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola & Tytti Rantanen (2021), «Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy», Narrative, n° 29, p. 139-159.
Metz, Christian (1968), Essai sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck.
Maingueneau, Dominique (2004), Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Armand Colin.
Niederhoff, Burkhard (2001), «Focalisation und Perspektive: Ein Plädoyer für friedliche Koexistenz», Poetica, n° 33, p. 1-21.
Patron, Sylvie (2009), Le Narrateur, Paris, Armand Colin.
Paveau, Marie-Anne & Isabelle Pecheyran (1995), «Focalisations: lecture de Genette et pratiques scolaires», Le Français aujourd’hui, n° 109, p. 72-84.
Phelan, James (1989), Reading People, Reading Plots: Character, Progression, and the Interpretation of Narrative, Chicago, University of Chicago Press.
Pier, John & Jean-Marie Schaeffer (dir.) (2005), Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, Paris, Editions de l'EHESS.
Rabatel, Alain (1998), La Construction textuelle du point de vue, Lausanne et Paris, Delachaux et Niestlé.
Rabatel, Alain (1997), «L'introuvable focalisation externe. De la subordination de la vision externe au point de vue du personnage ou au point de vue du narrateur», Littérature, n° 107, p. 88-113.
Reuter, Yves (2000), «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n° 21, p. 7-22.
Reuter, Yves (2013), «Outils», in Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Y. Reuter, C. Cora-Azria, B. Daunay, I. Delcambre, D. Lahanier-Reuter (dir.), Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, p. 151-156.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Salmon, Christian (2007), Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte.
Schaer, Camille (2023), Les enseignant·e·s de français du secondaire I et II suisse romand et leur rapport à la bande dessinée: conceptions et pratiques en évolution, thèse de doctorat dirigée par R. Baroni et C. Bemporad, Université de Lausanne.
Schneuwly, Bernard (2000), «Les outils de l’enseignant. Un essai didactique», Repères, n°22, p. 19-38.
Stanzel, Franz Karl (1984), A Theory of Narrative, Cambridge, Cambridge University Press.
Stanzel, Franz Karl (1971), Narrative Situations in the Novel, Bloomington, Indiana University Press.
Stanzel, Franz Karl (1955), Die Typischen Erzählsituationen im Roman, Wien, Braumüller.
Sternberg, Meir (2011), «Reconceptualizing Narratology. Arguments for a Functionalist and Constructivist Approach to Narrative», Enthymema, n° 4, p. 35-50.
Todorov, Tzvetan (2007), La Littérature en péril, Paris, Flammarion.
Todorov, Tzvetan (1969), Grammaire du Décaméron, The Hague, Paris, Mouton.
Turgeon, David (2018), À propos du style de Genette, Montréal, Le Quartanier.
Wagner, Frank (2002), «Glissements et déphasages. Notes sur la métalepse narrative», Poétique, n° 130, p. 235-253.
Wagner, Frank (2016), «Quand le narrateur boit(e)… (Réflexions sur le narrateur non fiable et/ou indigne de confiance)», Arborescences, n° 6, p. 148-175. DOI: https://doi.org/10.7202/1037508ar
Pour citer l'article
Raphaël Baroni, "Comment un théoricien du récit pourrait-il contribuer à améliorer l’outillage narratologique scolarisé?", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/comment-un-theoricien-du-recit-pourrait-il-contribuer-a-ameliorer-l-outillage-narratologique-scolarise
Voir également :
Du scepticisme à l’optimisme: penser les contenus d’enseignement
En 1977, dans son ouvrage sur l’histoire de la grammaire scolaire au XIXe siècle, qui faisait suite à sa thèse, André Chervel consacrait un court dernier chapitre (p. 255-274) à «la grammaire scolaire depuis un siècle», qu’il concluait par une petite section (de quatre pages) sur «la grammaire dite “moderne”». Voici ce qu’on peut lire, à la toute fin de cette section(p. 273):
Du scepticisme à l’optimisme: penser les contenus d’enseignement
En 1977, dans son ouvrage sur l’histoire de la grammaire scolaire au XIXe siècle, qui faisait suite à sa thèse, André Chervel consacrait un court dernier chapitre (1977: 255-274) à «la grammaire scolaire depuis un siècle», qu’il concluait par une petite section (de quatre pages) sur «la grammaire dite “moderne”». Voici ce qu’on peut lire, à la toute fin de cette section (1977: 273):
Que restera-t-il, dans dix ou vingt ans, de l’actuelle grammaire moderne? Aura-t-elle, comme certains le pensent, laissé la place à un enseignement beaucoup plus «scientifique»? Ou s’effacera- t-elle graduellement en laissant à l’enseignement scolaire quelques souvenirs de son passage, comme les groupes nominaux et les niveaux de langue? Il est un peu tôt pour le dire. Mais l’histoire de la grammaire scolaire incite à la circonspection.
Ce propos témoigne – en creux – d’une époque: deux ans plus tard devait paraitre le livre d’Hélène Romian, Pour une pédagogie scientifique du français (1979), à la fin d’une décennie marquée à son début (1971) par la publication d’un «Plan de rénovation» visant, comme le proclame son introduction, «à fonder plus scientifiquement la rénovation profonde de cet enseignement que de nombreux pionniers de la pédagogie moderne avaient, il faut le dire, déjà entreprise1». Dans cette proclamation d’un document issu d’une «commission de rénovation de la pédagogie pour le premier degré» en France2 comme dans le titre de l’ouvrage d’une de ses membres les plus ardentes, résident quelques ingrédients importants de l’esprit de la «rénovation» de l’époque, qui a concerné de nombreux pays francophones: d’abord, il est réputé nécessaire de rénover l’enseignement; d’autre part, les enseignants, majoritairement, ne le font pas (seuls les pionniers s’y emploient, il faut le dire); par ailleurs, les contenus ne sont pas scientifiquement fondés, puisque leur rénovation doit l’être; enfin, il existe une science qui soit susceptible de fonder les contenus. Une telle conception est celle d’une époque, qui ne concernait pas que le primaire, mais aussi le secondaire, dans le sillage des travaux de la Commission Pierre Emmanuel3.
C’est dans ce contexte de forte incitation et d’adhésion à la rénovation sur une base scientifique – celui de la naissance d’une nouvelle génération de didactique du français, selon Bronckart (19894) – que prend place le relatif scepticisme de Chervel. Et il n’est pas difficile de reconnaitre qu’il s’est avéré assez juste. Il me semble que, comme souvent avec cet auteur, son propos peut se généraliser et nous aider à nous interroger sur le devenir de tout savoir de référence rénové, dans quelque domaine de connaissance que ce soit, y compris la narratologie, qui ne manque pas d’accointances avec la grammaire.
J’ouvre mon propos par un accès de scepticisme: la rénovation des contenus par une voie descendante semble avoir peu d’avenir; de ce fait, un projet qui envisagerait un «outillage narratologique» pensé dans une logique théorique pour supposer une amélioration de l’existant me semble ne pas pouvoir «répondre aux enjeux actuels de l’enseignement du français», pour reprendre les termes de l’appel à contribution de ces journées (Baroni dir. 2023). Et je crois qu’il faut encore se méfier de l’illusion qu’il y aurait à supposer possible d’améliorer les choses en modifiant le savoir disponible: certes, ce n’est pas la même illusion que celle de l’applicationnisme contre lequel la didactique s’est finalement construite, lequel pensait précisément suppléer aux manques scolaires, mais elle peut vite revenir…
Je poursuis cependant tout de suite par un accès d’optimisme, lié à la conception même du projet DiNarr, qui, dès le départ, s’est interrogé sur les liens possibles entre théorie de référence et pratiques d’enseignement: il ne s’agissait pas (seulement) d’interroger les insuffisances des contenus scolaires par rapport aux outils théoriques disponibles, ni de revisiter la théorie dans le (seul) but de faciliter la sélection et l’enseignement de savoirs scolaires. Le projet était plus ambitieux, car plus complexe: c’est sur l’esprit critique et la créativité des enseignants que se fonde le projet de penser une amélioration de la «boite à outils narratologique» (Baroni dir. 2020 – orthographe rectifiée). L’article récent de Baroni (2023) dans Recherches fait ainsi apparaitre comment l’ingéniosité des enseignants peut permettre à la fois de diagnostiquer les manques de la théorie et d’envisager, pour y suppléer, quelques «bricolages» – au sens de Lévi-Strauss (1962), adapté à l’école par Perrenoud (1983)5.
Il est de fait nécessaire de prendre en compte le processus de construction des savoirs scolaires, dans leur double conception, verticale et horizontale… J’entends par là, de façon commode et quelque peu caricaturale, les deux conceptions de la construction des contenus scolaires, qu’on pourrait qualifier plaisamment de transpositionniste et de créationniste, en référence aux conceptions issues des apports initiaux respectifs de Chevallard (1991 [1985], 1996) et de Chervel (1977, 1988, 1992). Ces auteurs dialoguent bien peu6, alors que nombre de didacticiens les font dialoguer – et c’est ce que je me propose de faire ici encore.
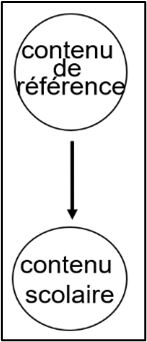
Figure 1
Schématisons ainsi (figure 1) la logique verticale de la transposition didactique, dans une version large qui concernerait tous les contenus (au sens de Daunay, 2015), au-delà des savoirs (savants ou experts, pour emprunter les termes respectifs de Chevallard 1985/1991, et de Johsua 1997), au-delà des savoir-faire ou autres pratiques sociales de référence (Martinand 1986). Ce schéma veut illustrer la transformation d’un contenu de référence en un contenu scolaire, du fait de contraintes propres au système d’enseignement, qui expliquent les phénomènes d’apprêt didactique (Chevallard 1991: 58), autrement dit de mise en texte (ibid.) du contenu.
On peut, tout aussi schématiquement, supposer que chaque changement de contenu de référence peut produire un changement de contenu scolaire, selon le même processus. Pour autant, une des caractéristiques du contenu scolaire est de garder, comme une empreinte, les traces des contenus scolaires antérieurs, qu’on y voie un processus de «feuilletage» (Veck 1994), de «sédimentation» (Schneuwly 2007), de «couches successives» (Chervel 1988), de «réemploi» ou de «recyclage» (Denizot 2013: 2687). Cette faculté de création de contenus «par l’école elle-même, dans l’école et pour l’école» (Chervel 1988: 66), que j’ai nommée plus haut créationniste représente la part horizontale du processus de construction des savoirs scolaires.
C’est du reste cette dernière qui peut expliquer la plasticité des contenus scolaires et qui explique, au moins en partie, le phénomène de transposition-transformation des contenus de référence – même si Chevallard, qui identifiait pourtant, dès le premier chapitre de son ouvrage, des «créations didactiques, suscitées par les “besoins de l’enseignement”» (1991: 39), n’établissait pas de lien entre ces dimensions transpositionniste ou créationniste. Or c’est ce lien que veut essayer de rendre la figure 2:
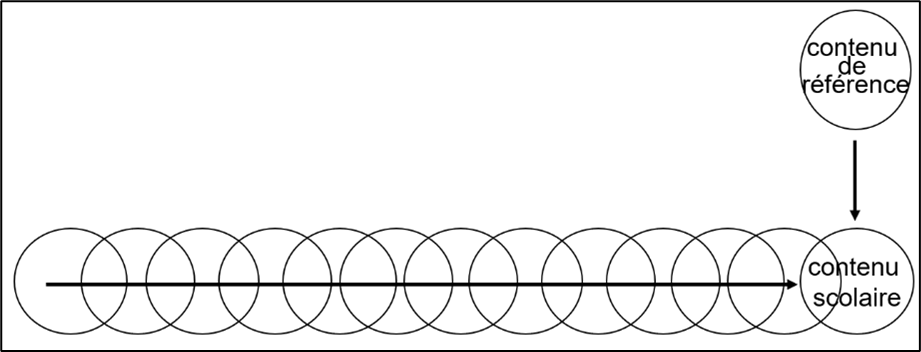
Figure 2
Bien sûr, une telle schématisation est discutable, ne serait-ce que parce qu’elle donne à penser un contenu de référence qui serait totalement intact, sans lien avec l’histoire de son élaboration ou avec le contexte de sa diffusion, négligeant que le processus de dogmatisation des savoirs s’observe dès leur phase d’élaboration, de la part des savants autant que des enseignants (Rumelhard 2011). À cet égard, rappelons que Guy Brousseau, d’un point de vue didactique, avait mis en avant la dimension communicative de la diffusion du savoir dans le monde savant, qui engendre notamment un travail de sélection (1986: 270):
L’organisation des connaissances dépend, dès leur origine, des exigences imposées à leur auteur par leur communication. Elle ne cesse pas d’être ensuite modifiée pour les mêmes motifs, au point que leur sens change assez profondément: la transposition didactique se déroule en grande partie dans la communauté scientifique et se poursuit dans les milieux cultivés (la noosphère plus exactement).
Il me semble cependant, malgré son imperfection, que cette schématisation permet de rendre compte du processus de construction des savoirs scolaires, compatible, je crois, avec l’analyse qu’en fait Nathalie Denizot (2013, 2021) à qui l’on doit la synthèse didactique la plus complète de ce processus, qu’elle appelle scolarisation et dont elle fait la source de la culture scolaire. Dans son dernier ouvrage (2021), elle montre avec une grande netteté les effets théoriques des conceptions principales (au premier rang desquels ceux dont s’inspirent mes schémas ci-dessus) qui ont contribué – y compris dans les discussions qu’elles ont suscitées et dans leurs avatars – à la compréhension didactique de la construction des contenus disciplinaires – même quand ces conceptions étaient issues d’autres champs théoriques que la didactique.
Pour en venir aux contenus qui nous concernent, les contenus narratologiques, ne seraient-ce précisément pas les modalités de construction des contenus disciplinaires scolaires qui expliquent le succès de la narratologie à l’école dans les années 1980 et qui peuvent aider à parier sur sa longévité dans les années qui viennent? Cela est assez vraisemblable, notamment parce que, dans sa fonction de «fabriquer de l“enseignable”» (Chervel 1988: 88), l’école se saisit assez facilement, en les modelant à sa manière, des savoirs qui peuvent se combiner à ceux qu’elle transmet déjà; et ce qui n’est pas exactement du savoir le devient vite, du fait même que le savoir est une «condition de “l’enseignabilité”», comme le dit Schneuwly (2014: 51), dans une référence implicite à Verret (1975) et pour argumenter dans le sens de la pertinence du concept de transposition didactique de savoirs savants au sens de Chevallard (1991).
Certes, a-t-on pu objecter, les savoirs ne font pas le tout d’une discipline comme le français, et moins encore de la littérature, comme se complaisent à le penser certains croyants en l’ineffable. Mais Bernard Schneuwly a montré que les objections faites au concept par ceux qui le jugeaient insuffisant pour rendre compte d’autres contenus, des savoir-faire aux savoir-être, ne tenaient pas au regard du principe scolaire suivant (2014: 51): si «tout enseignement vise en dernière instance toujours des savoir-faire, ou plus précisément vise à transformer la capacité d’agir dans des situations grâce à des savoirs utiles», il faut comprendre que
ces savoir-faire, ou plutôt ces manières d’être, de penser et de faire, pour devenir objet d’enseignement, passent nécessairement par une étape qu’on pourrait appeler de modélisation. Ce n’est jamais la pratique en tant que telle de l’écriture, du dessin, du chant ou du calcul qui devient objet d’enseignement, mais le savoir de l’écriture, du dessin, du chant ou du calcul. Pour être enseigné, un objet doit être su, sinon nécessairement dans le sens de savoir chanter au moins dans le sens de savoir ce qu’est chanter; sinon dans le sens de savoir écrire au moins dans le sens de savoir ce qu’est écrire.
Or que faire pour transformer un objet complexe comme la littérature en contenu(s) d’enseignement? Eh bien construire des savoirs… L’histoire littéraire avait parfaitement rempli ce rôle pendant près d’un siècle (et le joue encore) mais a subi une critique en règle dans les années 1960 et 1970, pour ce qu’elle charriait d’idéologie, comme les instruments pédagogiques qui l’accompagnaient: le «morceau choisi» et l’«explication de texte»; on ne reviendra pas sur cette histoire, maintes fois faite (pour une synthèse ancienne, voir Daunay 2007), mais il est intéressant de noter que ce n’était pas tant l’école qui était mise en cause que le savoir en jeu en amont de l’école, dont les contenus scolaires pouvaient être considérés comme le reflet: il était alors possible de poser soit que c’est à partir du «discours de l’école» que «se constitue, en fait, pour la plupart des usagers, la notion de littérature» (Kuentz 1972), soit que ce discours scolaire est révélateur d’une conception sociale de la littérature, largement partagée, jusqu’à l’université (Halté & Petitjean 1974). Mais, dans les deux cas, la question de la construction des contenus scolaires est négligée.
On peut supposer que c’est parce que l’histoire littéraire ne remplissait plus sa fonction de socle épistémologique légitime à une approche scolaire de la littérature que ce rôle a pu être rempli par un autre corps de savoir, opportunément apparu alors: la narratologie. Par la logique formaliste et taxonomique qu’elle autorisait (sans pour autant s’y réduire, malgré les critiques dont elle a été l’objet assez vite), par le lien étroit qu’elle entretenait avec les approches linguistiques (qui étaient précisément alors les référents théoriques de la rénovation du français), la narratologie a pu facilement s’imposer comme théorique de référence des contenus d’enseignement et d’apprentissage de la littérature au lycée, au collège et, plus tard mais avec force, jusqu’au primaire.
Mais elle a subi le destin que Chervel supposait à cette époque à la grammaire dite «moderne»: elle a disséminé ses contenus dans l’existant et s’est fondue dans la discipline telle qu’elle s’adaptait aux logiques contradictoires qu’elle connaissait alors – entre démocratisation des publics et origine élitaire des contenus, entre unification croissante du système scolaire et spécialisation accrue des enseignants du secondaire inférieur (le collège), entre transversalité grandissante et spécification des contenus des programmes.
Les rappels qui précèdent sur les modalités de construction des contenus scolaires évitent de prendre la position confortable mais ignorante d’un Antoine Compagnon dans Le Démon de la théorie (1998: 11):
La théorie s’est institutionnalisée, elle s’est transformée en méthode, elle est devenue une petite technique pédagogique souvent aussi desséchante que l’explication de texte à laquelle elle s’en prenait alors avec verve. La stagnation semble inscrite dans le destin scolaire de toute théorie […]. La nouvelle critique, même si elle n’a pas fait tomber les murs de la vieille Sorbonne, s’est solidement implantée dans l’Éducation nationale, notamment dans l’enseignement secondaire. C’est même probablement cela qui l’a rendue rigide.
Ce propos est athéorique non seulement par la reprise sans distance d’un propos de sens commun, que son ouvrage avait pour but pourtant d’interroger, mais aussi par la teneur nostalgique de sa description de l’aventure intellectuelle qu’il a cru vivre dans sa jeunesse8. Une telle position permet d’éviter d’avoir à se demander si les concepteurs des théories que privilégie Compagnon n’avaient pas eux-mêmes une certaine propension à la naturalisation des notions qu’ils élaboraient ou travaillaient.
Que va devenir la narratologie scolaire? Il est évidemment difficile d’en préjuger, mais il semble que rien n’empêche que son règne se poursuive. Un indice pourrait être la manière (contournée) dont elle est évoquée dans les nouveaux programmes des deux premières classes du secondaire supérieur en France (seconde et première du lycée); on peut lire en effet parmi les «aspects» que recouvre la «maitrise de la langue» (MÉN 2019):
L’acquisition d’un vocabulaire technique permettant de décrire le fonctionnement de la langue et des discours, en particulier le discours littéraire (connaissances linguistiques) et d’accéder à l’implicite. Ces connaissances linguistiques portent sur les classes grammaticales, les différents rapports qui s’établissent entre les mots au sein de la phrase et du texte, ainsi que sur les notions relatives au fonctionnement du discours littéraire. Elles sont adossées à des termes (métaphore, adjectif, subordination, focalisation, assonance, etc.) dont elles proposent des définitions.
Dans ce passage, il n’est pas fait mention explicite de la narratologie, mais il est question de faire acquérir aux élèves un «vocabulaire technique permettant de décrire le fonctionnement de la langue et des discours, en particulier le discours littéraire» et des «notions relatives au fonctionnement du discours littéraire», parmi lesquels peuvent prendre place les notions narratologiques. De fait, dans la courte liste illustrative des «termes» auxquels ces notions sont «adossées», on trouve la focalisation…
Certes, cette liste à la Prévert ramasse, sous la dénomination générique de «connaissances linguistiques», des concepts grammaticaux, rhétoriques et narratologiques, mais c’est précisément cet amalgame qui peut donner aux items de la liste une réelle destinée: accolés aux notions grammaticales, ils peuvent bénéficier du succès ancestral de ce contenu scolaire, même si l’insistance sur «l’étude de la langue au lycée» est une nouveauté dans les programmes du lycée français, en contrepoint d’une approche globalement historique et générique de la littérature.
Il n’est pas anodin que le seul concept proprement narratologique cité dans la liste soit la focalisation, dont Baroni (2023: 15 sq.) a montré le statut paradoxal: à la fois «l’acquis le plus important des études de narratologie pour l’explication des textes» (Bergez 2021: 38), mais dont la «belle carrière comme outil scolaire de lecture des textes littéraires» coexiste avec des «difficultés dans l’exploitation du concept par les enseignants et son maniement par les élèves», difficultés qui demandent à interroger la théorie comme sa version scolaire (Paveau & Pécheyran 1995: 72). Ces citations que fait Baroni rappellent que le destin scolaire d’un contenu ne dépend pas nécessairement de sa cohérence théorique ni de sa facilité de maniement pratique mais ressortit à des nécessités dont l’oubli peut être à la fois le motif et la cause d’échec de toutes les tentatives de bonne volonté, qui ressemblent bien souvent – pour emprunter les mots de Bernard Lahire (1993: 88) – à une entreprise d’«annulation magique des contraintes effectives».
Références
Baroni, Raphaël (2017), Les Rouages de l’intrigue. Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Baroni, Raphaël (2023), «Une perspective transmédiale sur la focalisation», Recherches, n° 77, p. 9-42.
Baroni, Raphaël (dir.) (2020), Pour une théorie du récit au service de l’enseignement, Projet présenté au Fonds national suisse.
Baroni, Raphaël (dir.) (2023), [Appel à contribution pour la] Journée d'étude DiNarr 6-7 juillet 2023, mail du 18/01/2023.
Bergez, Daniel (2021 [1989]), L’explication de texte littéraire, Malakoff, Armand Colin.
Bronckart, Jean-Paul (1989), «Du statut des didactiques des matières scolaires», Langue Française, n° 82, p. 53-66.
Brousseau, Guy (1986), «Quelques fondamentaux en didactique des mathématiques», in EPS. Contenus et didactique, P. Cardon, M. Chaigneau (dir.), Paris, SNEP, p. 269-277.
Chervel, André (1977), Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français. Histoire de la grammaire scolaire, Paris, Payot.
Chervel, André (1988), «L’histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche», Histoire de l’éducation, n° 38, p. 59-119.
Chervel, André (1992), «L’école, lieu de production d’une culture», in Analyser et gérer les situations d’enseignement-apprentissage, F. Audigier, G. Baillat (dir.), Paris, INRP, 1992, p. 195-198.
Chevallard, Yves (1991 [1985]), La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage.
Chevallard, Yves (1996), «Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives apportées par une approche anthropologique», in Didactique des mathématiques, J. Brun (dir.) Lausanne, Delachaux & Niestlé, 1996, p. 145-196.
Daunay, Bertrand (2007), «État des recherches en didactique de la littérature. Note de synthèse», Revue française de pédagogie, n° 159, Lyon, INRP, p. 139-189.
Daunay, Bertrand (2015), «Contenus et disciplines: une problématique didactique», in Les Contenus d'enseignement et d'apprentissage. Approches didactiques, B. Daunay, C. Fluckiger, R. Hassan (dir.), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2015, p. 19-41.
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Denizot, Nathalie (2021), La culture scolaire: perspectives didactiques, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux.
FEN (1971), L’enseignement du français vu par ceux qui l’enseignent. L’Enseignement public, supplément au nº 5.
Halté, Jean-François & Petitjean, André (1974), «Pour une théorie de l’idéologie d’un manuel scolaire. Le Lagarde et Michard: le cas Diderot», Pratiques, n° 1, p. 43-64.
IPN (1971), L’enseignement du français à l’école élémentaire. Principes de l’expérience en cours, Recherches pédagogiques, n° 47.
Johsua, Samuel (1997), «Le concept de Transposition Didactique peut-il étendre sa portée au-delà de la didactique des sciences et des mathématiques?», Skholê, n° 6, p. 15-24.
Kuentz, Pierre (1972), «L’envers du texte», Littérature, n° 7, p. 3-26.
Lahire, Bernard (1993), Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de «l’échec scolaire» à l’école primaire, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Lévi-Strauss, Claude (1962), La pensée sauvage, Paris, Plon.
Martinand, Jean-Louis (1986), Connaître et transformer la matière, Berne, Peter Lang.
MÉN [Ministère de l’Éducation nationale] (2019), Bulletin officiel de l’Éducation nationale, spécial n° 1 du 22 janvier 2019.
Paveau, Marie-Anne & Pecheyran, Isabelle (1995), «Focalisations: lecture de Genette et pratiques scolaires», Le Français aujourd’hui, n° 109, p. 72-84.
Perrenoud, Philippe (1983), «La pratique pédagogique entre l’improvisation réglée et le bricolage. Essai sur les effets indirects de la recherche en éducation», Éducation et recherche, vol. 5, n° 2, p. 198-212.
Romian, Hélène (1979), Pour une pédagogie scientifique du français, Paris, PUF.
Romian, Hélène (2014), «Un “plan de rénovation” de l’enseignement du Français à l’école élémentaire en 1970», La Lettre de l’AIRDF, n° 56, p. 33-44.
Rumelhard, Guy (2011 [1979]), «Le processus de dogmatisation», Recherches en didactiques, n° 11, p. 165-178.
Schneuwly, Bernard (2014 [2005]), «De l’utilité de la “transposition didactique”«, in Didactique du français: Fondements d'une discipline, J.-L. Chiss, J. David, Y. Reuter (dir.), Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014, p. 47-59.
Schneuwly, Bernard (2007), «Le “Français”: une discipline scolaire autonome, ouverte et articulée», in La Didactique du français. Les voies actuelles de la recherche, É. Falardeau, C. Fisher, C. Simard, N. Sorin (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, p. 9-26.
Veck, Bernard (dir.) (1994), La culture littéraire au lycée: des humanités aux méthodes, Paris, INRP.
Verret, Michel (1975), Le Temps des études, Paris, Librairie Honoré Champion.
Pour citer l'article
Bertrand Daunay, "Du scepticisme à l’optimisme: penser les contenus d’enseignement", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/du-scepticisme-a-l-optimisme-penser-les-contenus-d-enseignement
Voir également :
Introduction n°6: Pour une théorie du récit au service de l’enseignement
Le présent dossier trouve son origine dans une journée d’étude organisée en juillet 2023 à l’Université de Lausanne dans le cadre d’un projet de recherche financé par le fonds national suisse (n° 197612) intitulé «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement». Cet évènement regroupait l’équipe qui porte le projet – le groupe DiNarr, pour «didactique et narratologie», qui inclut R. Baroni, V. Depallens, L. Mahieu, F. Moreno et G. Turin – ainsi que ses partenaires scientifiques – J.-F. Boutin, V. Capt, B. Daunay, N. Denizot, J.-L. Dufays et C. Gabathuler. Parmi le public, cette journée accueillait également Y. Vuillet et B. Védrines, qui participent à ce numéro.
Introduction n°6: Pour une théorie du récit au service de l’enseignement
Introduction
Le présent dossier trouve son origine dans une journée d’étude organisée en juillet 2023 à l’Université de Lausanne dans le cadre d’un projet de recherche financé par le fonds national suisse (n° 197612) intitulé «Pour une théorie du récit au service de l’enseignement». Cet évènement regroupait l’équipe qui porte le projet – le groupe DiNarr, pour «didactique et narratologie», qui inclut R. Baroni, V. Depallens, L. Mahieu, F. Moreno et G. Turin – ainsi que ses partenaires scientifiques – J.-F. Boutin, V. Capt, B. Daunay, N. Denizot, J.-L. Dufays et C. Gabathuler. Parmi le public, cette journée accueillait également Y. Vuillet et B. Védrines, qui participent à ce numéro. En amont de cette journée, l’équipe DiNarr avait mené une enquête portant sur la scolarisation de la narratologie impliquant le recueil de témoignages de témoins privilégiés ayant peu ou prou accompagné ce processus, et un recueil de données mené par L. Mahieu sous la forme d’un questionnaire en ligne auquel ont répondu plus de 500 enseignant·e·s du secondaire dans quatre pays francophones, les participant·e·s de la journée d’étude ayant été informé·e·s de nos premiers résultats.
Avant d’en venir plus précisément aux contenus des communications et des échanges ayant eu lieu durant cette rencontre et auxquels font écho les articles réunis dans ce numéro, il nous parait utile de présenter brièvement le projet dans lesquels s'inscrivent ces réflexions. Notre recherche se situe au croisement de la didactique du français et de la théorie du récit. En retraçant rapidement l’évolution de la narratologie parallèlement à celle de la didactique du français, le but sera de mettre en évidence un espace d’opportunités pour un renouvèlement de ce que nous appellerons la boite à outils narratologique. Par cette métaphore1, nous entendons définir un éventail de concepts issus de la narratologie, articulés entre eux et orientés vers un usage instrumental en contexte éducatif, que ce soit dans le cadre d’activités d’analyse, d’interprétation ou de production de récits. Nous évoquerons ainsi les liens qui peuvent être établis entre un outillage conceptuel issu des efforts de théorisation des récits, cette perspective étant ressaisie ici dans toute son épaisseur historique, et ses usages scolaires envisagés dans une perspective socioconstructiviste de l’apprentissage. À l’intérieur de ce cadre, l’objectif de notre recherche consiste à documenter l’histoire de la scolarisation de la narratologie, d’esquisser les contours des outils mobilisés dans les classes de français, de mieux connaitre leurs usages effectifs pour en évaluer l’ergonomie – autrement dit, l’efficience éducative – de sorte qu’il devient possible de réfléchir à la pertinence d’une éventuelle mise à jour de certaines ressources pour l’enseignement du français.
1. Du moment structuraliste de la théorie littéraire à la narratologie «postclassique»
La théorie du récit a pris son essor en France à la fin des années 1960 dans une atmosphère de contestation des approches traditionnelles basées sur l’histoire littéraire et la biographie des auteur·e·s. Elle s’est fondée notamment sur la redécouverte et la traduction des travaux des formalistes russes ainsi que sur la vogue du structuralisme en sciences du langage. En 1969, Tzvetan Todorov invente le terme narratologie pour décrire cette jeune «science du récit», dont le champ devait s’étendre bien au-delà du périmètre de la théorie littéraire, puisque cet acte de baptême est justifié par le constat que les récits se rencontrent «dans d’autres domaines qui pour l’instant relèvent, chacun, d’une discipline différente (ainsi contes populaires, mythes, films, rêves, etc.)» (Todorov 1969: 10). Cette discipline émergente s’est attachée dans un premier temps à décrire les «structures narratives» sous la forme de schématisations de l’histoire racontée (Bremond 1964; Adam 1984) et de typologies des modalités du «discours du récit» (Genette 1972) liées à la «voix» (théorie du narrateur), au «mode» (théorie de la focalisation) et au «temps» (théorie des rapports entre temps raconté et temps du discours).
Les concepts issus de ces travaux se sont rapidement institutionnalisés à travers leur adoption dans les classes de français, leur scientificité entrant en résonance avec un désir de réforme de l’enseignement traditionnel2. En revanche, au niveau de la théorie littéraire, la vague structuraliste est rapidement retombée pour faire place à de nouveaux paradigmes: théories de la réception, histoire culturelle, analyse du discours, sociologie de la littérature, etc. On pourrait ainsi avoir l’impression que la narratologie n’a représenté qu’un «moment structuraliste» dans l’histoire de la théorie littéraire, et que sa survivance actuelle se résume à un corpus limité de notions fossilisées que l’on rencontre dans différents lieux de formation visant une maitrise des codes du récit (cours de littérature, cours d’écriture scénaristique, formations marketing, etc.). À rebours de cette idée, il faut rappeler que la théorie du récit n’a jamais cessé d’évoluer: elle s’est surtout internationalisée et s’est diversifiée, ses multiples courants actuels se rattachant peu ou prou à une narratologie qui a été qualifiée de «postclassique» (Herman 1997; Prince 2008; Patron 2018). L’identité disciplinaire de la théorie du récit se définit aujourd’hui davantage par sa finalité (décrire les structures, les fonctions et le fonctionnement des récits) que par une méthode spécifique pour atteindre cet objectif. Des progrès significatifs ont ainsi été accomplis pour mieux articuler l’analyse raisonnée des formes narratives (exprimées par des schémas ou des classements typologiques) à leurs fonctions discursives et à leurs matérialisations médiatiques. Autrement dit, la narratologie contemporaine se préoccupe autant des formes invariantes dans lesquelles se moulent tous les «avatars» de la narrativité (Ryan 2006) que de la manière dont ces dispositifs donnent naissance à une expérience narrative en se fondant sur des spécificités médiatiques qui les caractérisent, évoluant vers ce que Marie-Laure Ryan et Jan-Noel Thon ont appelé une «media-conscious narratology» (Ryan & Thon 2014).
Par rapport aux approches de la période 1960-1970, qui visaient à décrire les structures des récits littéraires, ces nouvelles orientations ont permis d’étendre le champ de la recherche pour inclure l’étude d’artefacts non-littéraires ou non-verbaux. Ces approches permettent de mieux saisir les mécanismes engendrant l’immersion et le désir de progresser dans le récit, ainsi que les processus cognitifs qui en découlent: phénomènes de simulation mentale ou d’incarnation dans le plan de l’histoire, construction mentale du monde raconté, recyclage ou reconfiguration des stéréotypes culturels, anticipations sous forme de réseaux de probabilités ou de cadrages interprétatifs conditionnant la négociation des valeurs. Ces nombreux développements soulignent l’existence de compléments et parfois d’alternatives pour tous les concepts hérités de la période structuraliste.
2. La théorie du récit dans la didactique du français
Il y a une vingtaine d’années déjà, Yves Reuter rappelait, à un moment où elle commençait à faire l’objet de critiques assez virulentes3, que l’entrée de la narratologie dans les pratiques enseignantes s’est faite à une période antérieure à l’essor de la didactique du français, ce qui aurait eu selon lui quelques conséquences fâcheuses. Il souligne en particulier une dogmatisation de la théorie, une tendance à l’applicationnisme, des confusions notionnelles et une occultation des débats internes et externes à la discipline aboutissant à un figement des concepts (Reuter 2000: 10). Ce constat semble rejoindre en partie celui dressé par Antoine Compagnon, qui affirmait qu’à la suite de son intégration dans les pratiques scolaires, la théorie serait «devenue une petite technique pédagogique souvent aussi desséchante que l’explication de texte à laquelle elle s’en prenait alors avec verve» (1998: 11). Il faut noter cependant que, contrairement à Compagnon, Reuter explique que la logique d’un tel figement ne met pas en cause seulement l’école, mais les conditions mêmes de la transmission des savoirs initiaux à l’école. Ainsi que l’a montré Bertrand Daunay (2010), ce qui est en jeu dans cette différence, c’est la relation entre savoirs de référence et savoirs scolaires, les premiers étant un peu rapidement exemptés par Compagnon de leur responsabilité dans le figement de leurs propres concepts. Dans un article retraçant l’histoire de la didactique, Daunay rappelle que lorsqu’elles ont été introduites, ces méthodes «avaient le mérite d’adosser l’enseignement de la littérature à une approche scientifique des textes, au risque d’une illusion scientiste très vite dénoncée d’ailleurs par la plupart des acteurs de l’époque» (Daunay 2007: §75, italiques d’origine).
Le risque était grand dès le départ – il s’est notamment vérifié plus tard dans les manuels et dans les instructions officielles –, d’un surcroît de formalisme et de technicisme dans l’approche scolaire des textes littéraires et de la construction d’une nomenclature théorique, passablement hétérogène d’ailleurs, devenue et restée encore aujourd’hui incontournable – qu’il s’agisse particulièrement de l’analyse des structures du récit (du repérage du schéma narratif dès les premières années du primaire à l’étude structurale du récit dans les plus grandes classes, via Propp, Greimas, Barthes, Larivaille, Bremond, Adam, etc.), des modalités de la narration (via la narratologie de Genette, essentiellement), des caractéristiques formelles de la poésie (via les nombreuses études inspirées des principes de Jakobson) ou, pour clore une liste non exhaustive, du fonctionnement du texte théâtral (via Ubersfeld, particulièrement). (Daunay 2007: §80)
En réaction à ce «technicisme», la notion qui a renouvelé en profondeur la didactique de la littérature dès les années 90 est celle de lecture littéraire. Malgré la modélisation dialectique inspirée de Picard (1986) que Dufays et d'autres en ont proposée (Dufays, Gemenne & Ledur 2015), cette notion a parfois été naturalisée et réduite à une pratique lettrée soumise aux droits du texte, comme l’observent Daunay (1999) et Daunay & Dufays (2016). En complément à cette approche, certain·e·s didacticien·ne·s – en particulier Rouxel & Langlade (2004) – ont alors jugé nécessaire de la préciser en l’orientant davantage du côté de la subjectivité, l’accent étant mis sur l’agentivité et la diversité potentielle des expériences esthétiques du lecteur ou de la lectrice, au risque de faire basculer la notion vers une pratique idiosyncrasique. Au-delà de leurs divergences, ces travaux permettent de concevoir la lecture des récits comme unva-et-vient entre lectures participative et distanciée, et l’interprétation est envisagée comme une démarche essentiellement inductive et dialogique, au lieu de se fonder sur des procédures normalisées par des cadres imposés, parmi lesquels l’outillage narratologique apparait comme l’une des ressources les plus saillantes.
En dépit de ces limites imposées aux approches mobilisant la théorie du récit dans la classe de français, Reuter – qui a lui-même rédigé un ouvrage de vulgarisation de la narratologie maintes fois réédité (Reuter 2016) – suggérait de ne pas «jeter le bébé avec l’eau du bain» (2000: 7), mais plutôt d'aborder la question dans une perspective proprement didactique en se demandant: «Quels savoirs pour qui? (chercheurs? formateurs? enseignants? élèves?) et pour quoi?» (2000: 7). Daunay ajoute que
mettre en cause une entreprise de négation de certains rapports au texte littéraire n’est pas prôner un retour à un subjectivisme empiriste dans l’approche scolaire des textes littéraires: un danger guette toujours, qui est celui d’un empirisme spontanéiste, qui négligerait la nécessité didactique de la construction d’outils conceptuels pour la lecture. (Daunay 2007: 46-47)
En effet, dans le prolongement des recherches de Lev Vygotski sur le développement des fonctions langagières (2019 [1934]), de nombreux travaux en didactique du français se sont intéressés aux outils mobilisés dans l’apprentissage du français. Dans le cadre d’une approche socioconstructiviste (Schneuwly & Bronckart 1985), ces outils sont pensés comme des médiatisations socialement construites qui élargissent la capacité du sujet d’interagir avec son environnement, et l’apprentissage est alors conçu comme un processus d’intégration:
L’action de l’homme sur la nature, le travail, n’est jamais immédiate, mais médiatisée par des objets spécifiques, socialement élaborés, fruits des expériences des générations précédentes et par lesquels, entre autres, se transmettent et s’élargissent les expériences possibles. […] Un outil médiatise une activité, lui donne une certaine forme. Mais ce même outil représente aussi cette activité, la matérialise. Autrement dit: les activités ne sont plus seulement présentes dans leur seule exécution. Elles existent en quelque sorte indépendamment d’elles dans les outils qui les représentent et par là-même signifient. L’outil devient ainsi le lieu privilégié de la transformation des comportements: explorer leurs possibilités, les enrichir, les transformer, les compléter sont autant de manières de transformer l’activité qui est liée à leur utilisation. L’existence matérielle, extérieure des médiateurs de l’activité est le présupposé de l’élargissement des possibilités. (Schneuwly 2008: 15-16)
Dans une telle perspective, «la construction d’outils conceptuels pour la lecture» (Daunay 2007: 47), qu’incarne, entre autres, l’outillage narratologique, ne fournit pas seulement un étayage de l’interprétation sous forme de procédures objectivables, cette médiatisation s’inscrit également dans un processus de socialisation, de construction du sens et d’élargissement des capacités du sujet d’interagir dans un monde tissé de récits.
Les dérives scientistes ou applicationnistes que les didacticien·ne·s associent parfois à la théorie du récit ne sont donc pas imputables à l’outillage narratologique en tant que tel, mais à certains usages institutionnels ou disciplinaires et, c’est là que nous proposons d’intervenir, à un défaut d’ergonomie de tel ou tel outil en particulier appelant à sa reconceptualisation en s’appuyant sur les ressources offertes par les théories contemporaines de la narrativité. Mais de tels défauts ne pourront être corrigés que lorsqu’aura été reconnue la valeur potentielle de l’outillage en général, en tant que médiatisation permettant le développement de compétences interprétatives, critiques ou rédactionnelles, ainsi que nous y invitent dans ce numéro Yann Vuillet et Bruno Védrine. Cette valeur explique certainement l’étonnante résilience de la narratologie enseignée, laquelle semble inusable en dépit des critiques répétées dont elle a fait l’objet dans les milieux de l’éducation, ainsi que le constatent Bertrand Daunay et Nathalie Denizot dans leurs articles respectifs.
Mais, alors que de nombreuses recherches en didactique se sont penchées sur les outils langagiers ou informatiques, et même sur le mobilier dont il est fait usage dans la classe de français (Plane & Schneuwly 2000), elles négligent le plus souvent l’examen de la boite à outils narratologique, qui continue pourtant d’être largement utilisé par les enseignant·e·s, ainsi que le montre l’étude de terrain présentée dans ce numéro par Luc Mahieu. Dufays et Brunel déplorent ainsi, dans un récent état des lieux, «le peu d’impact visible chez les didacticien·ne·s des derniers travaux de la narratologie» (Dufays & Brunel 2016: 252) et ce constat suggère que les questions adressées à la narratologie il y a plus de vingt ans par Reuter n’ont pas encore trouvé de réponses satisfaisantes, voire qu’elles n’ont en réalité presque jamais été posées.
Cette absence de dialogue entre narratologie et didactique apparait d’autant plus regrettable si l’on considère les convergences entre sciences du récit et sciences de l’éducation. La revalorisation d’une lecture «au premier degré» (David 2014), qui ménage une place aux expériences immersives des lecteurs et à la dynamique d’une progression aimantée par la mise en intrigue, n’est plus jugée incompatible avec un travail scolaire sur la forme du discours, les idées de l’écrivain ou son contexte historique. Cette remise au premier plan d’un rapport à la littérature autrefois méprisé ou négligé entraine en même temps la nécessité de renouveler les outils à même de construire une réflexion sur les mécanismes narratifs qui sont à la base de l’immersion, de la consistance des univers narratifs ou de l’engendrement d’une tension narrative. Comme l’explique Jérôme David:
On comprend qu’il faille s’appuyer dans cette démarche sur des savoirs historiques, mais également narratologiques ou poétiques. On devine également ce qui nous manque encore en termes de ressources analytiques pour décrire adéquatement les diverses façons dont la littérature sollicite le lecteur, l’attire dans chacun de ses univers, le constitue en sujet d’une expérience esthétique et, surtout, lui propose une ontologie inédite et l’inscrit dans une communauté de lecteurs avant de prendre congé de lui après un nombre de pages fixé d’avance. Ces lacunes (savoirs encore exploratoires, transposition didactique embryonnaire) rendent presque impossible, à l’heure actuelle, la transmission scolaire d’un savoir en la matière. (Raison de plus, je crois, pour s’y atteler sans retard). (David 2014: §37)
Dans le cas présent, la «lacune» évoquée découle surtout d’un manque de visibilité et d’accessibilité des ressources existantes, puisque les narratologies d’orientation rhétorique, stylistique ou cognitiviste offrent un attirail conceptuel très riche pour décrire les mécanismes textuels présidant à l’immersion dans le monde raconté ou à la dynamique de la tension narrative (Phelan 1989; Rabatel 1998; Patron 2009; Baroni 2017b; Caracciolo & Kukkonen 2021). Si David appelle de ses vœux une théorisation des phénomènes impliqués par un rapport à la littérature «au premier degré», le principal obstacle à la transmission scolaire d’un tel «savoir» consiste donc plutôt en un défaut de transposition de concepts narratologiques déjà disponibles. Par ailleurs, à un second degré également, de nombreuses approches narratologiques alternatives aux approches structuralistes (par exemple les théorisations portant sur les textes possibles, la construction textuelle du point de vue, la fiabilité des instances narratives, la polyphonie ou les virtualités actionnelles) permettraient d’éclairer la nature équivoque, plurivoque ou justement parfois trop univoque des situations mises en scènes par les fictions, offrant des leviers pour mieux en saisir les soubassements argumentatifs et idéologiques.
Il faut ajouter enfin, ainsi que le soulignent notamment Monique Lebrun, Nathalie Lacelle et Jean-François Boutin (2012), que l’évolution du contexte médiatique invite à repenser les «compétences littératiées» faisant l’objet d’un travail scolaire. Jacques Migozzi résume ce renouvèlement dans la didactique du français de la manière suivante:
[C]ertaines recherches de grande ampleur menées depuis une dizaine d’années au Québec […] ont conduit à la stabilisation théorique (et à la reconnaissance institutionnelle via la création récente d’une chaire à l’UQAM) de la notion de «littératie médiatique multimodale», définie […] comme la capacité d’un individu médiaculturel à recevoir, interpréter, évaluer mais aussi élaborer, créer et diffuser des messages articulant de manière diversifiée les modes iconiques, linguistiques, gestuels et auditifs, autrement qualifiés de «multitextes». (Migozzi 2019: §19)
Sur ce point également, il nous semble que l’orientation transmédiale de la narratologie contemporaine permet de réfléchir à la transférabilité des compétences mobilisées en classe pour l’analyse et la production de récits littéraires, vers une meilleure compréhension des incarnations non-verbales de la narrativité (Baroni 2017a). Les approches transmédiales n’ont pas seulement étendu l’applicabilité des concepts à d’autres médias, mais elle a également permis d’éclairer les effets induits par la matérialité des supports sur la construction des récits, mettant par exemple en lumière les caractéristiques des formes sérielles ou déployées sur des supports visuels, audiovisuels, graphiques ou composites. Du côté de la narrativité verbale, cela a également permis d’intégrer de manière beaucoup plus conséquente les approches stylistiques, qui ont considérablement enrichi la compréhension de phénomènes aussi essentiels que la construction du point de vue (Rabatel 1998) ou le statut optionnel d’un narrateur verbal (Patron 2009).
3. Le dossier
Notre recherche vise en premier lieu à inventorier aussi précisément que possible le corpus des outils habituellement enseignés au secondaire I et II dans les classes de français comme langue de scolarisation, tout en documentant les difficultés ou les limites que rencontrent les enseignant·e·s quand ils ou elles tentent de s’en servir. Il s’agit aussi, dans un deuxième temps, d’envisager la possibilité d’une amélioration de l’ergonomie de l’outillage narratologique en le pensant au plus près de ses usages scolaires et des réalités du terrain de l’enseignement. Cette seconde étape, à laquelle est liée l’organisation de la journée d’étude évoquée plus haut, passe par la reconstruction d’un dialogue entre narratologues et didacticien·ne·s du français, en surmontant un cloisonnement disciplinaire qui a trop longtemps prévalu et en se fondant sur des témoignages avérés de praticiens de la boite à outils dont il s’agit de discuter de la pertinence. Le dossier présenté dans ce numéro constitue ainsi un premier jalon dans cette enquête et dans ce dialogue interdisciplinaire dont on peut espérer qu’il contribuera à construire une réflexion productive sur la narratologie enseignée.
Le premier volet de ce dossier est donc consacré à quelques «grand·e·s témoins», acteur·rice·s de la scolarisation de la narratologie, à qui nous devons l’honneur d’un partage d’expérience de première ligne. Bien que leurs parcours soient distincts, un aspect commun apparait pour la majeure partie de ces témoins ; aspect qui étonne s’agissant de personnalités que nous pensions solliciter pour leur participation essentiellement théorique à la recherche narratologique: nombre d’entre eux font valoir avant tout une expérience de terrain, d’enseignement au niveau secondaire, voire primaire, ainsi qu’au niveau des formations continues. On remarque aussi à quel point l’époque a changé et combien l’ancienne porosité entre les mondes de la recherche et de l’enseignement s’est réduite. Pour le dire avec les termes de Dumortier: «Trente ans plus tard, les “courroies de transmission” du savoir narratologique que sont les revues pédagogiques, les ouvrages de vulgarisation scientifiques, la formation en cours de carrière, les programmes, les manuels, les conseils de l’inspection se sont distendues ou ont tout bonnement disparu». Un tel constat confirme en partie la pertinence de notre projet, puisqu’il s’agit pour nous de réactiver ou de reconstruire de telles «courroies de transmission».
Pour ce qui est de leurs constats communs, les contributeurs et la contributrice de ce dossier tombent d’accord sur une série importante d’observations qui retissent le fil de l’histoire récente de la discipline. Tous·tes reviennent sur les raisons historiques de l’apparition et de la fortune scolaire de la narratologie, souvent associées à un enjeu politique de démocratisation du littéraire, à un dégout de la «doxa commentative» (Reuter) alors au centre des pratiques universitaires, et à la volonté de renouvèlement de l’enseignement qui accompagne mai 68. Dans cette logique, Tous·tes mettent en avant l’importance des revues, en particulier Pratiques.
Cette revue est perçue comme un poste d’observation privilégié permettant de retracer avec nuance l’entrée de la narratologie dans les programmes éducatifs. Si nos témoins reviennent sur le danger d’une théorisation qui apparaisse comme directement applicable à ces programmes, ils reconnaissent aussi que ce danger n’a pas toujours été évité. D’où la reconnaissance, généralement partagée, d’une mise en crise de la narratologie issue du structuralisme, via l’accusation de technicisme, et la forte présence dans les programmes de concepts tels que le schéma quinaire, le schéma actantiel, ou d’autres étiquettes facilement exportables. On trouve enfin, pour beaucoup de nos spécialistes, le rappel d’un idéal visant la libération de la parole des élèves, cette émancipation impliquant une utilisation réfléchie des concepts.
Pour ce qui est des constats individuels, on observe chez Jean-Michel Adam et Françoise Revaz l’importance et la prééminence de catégories attachées au récit (les «gradients de narrativité») plutôt que le récit en tant qu’objet – une objectification coupable de fournir des structures immuables et réutilisables à des fins douteuses: le révisionnisme des fake news, ou plus généralement la perspective d’un tout-récit qui menace d’englober l’ensemble de nos expériences en nous coupant de la saine distance dont nous avons besoin pour les appréhender.
Dans sa contribution, Jean-Paul Bronckart met en garde contre l’usage des méthodes classiques de transposition didactique (théorisée par Chevallard) face à un objet hétérogène, et donc non unifié. Il appelle de ses vœux un cadrage didactique renouvelé et pertinent de la narratologie.
Jean-Louis Dumortier pose quant à lui un regard nuancé sur le problème, presque toujours soulevé par ses collègues, de la technicisation de la narratologie scolarisée. Si le didacticien belge relève bien entendu les accusations de dérive formaliste adressées à la narratologie, il précise aussi les avantages et les conséquences de la scolarisation de ces techniques d’analyse. Selon lui, nombre de notions narratologiques sédimentées dans l’institution scolaire doivent leur longévité à leur inscription dans des oppositions binaires, les rendant facilement mémorisables, donc évaluables. Si la critique est évidente, elle se double aussi d’une réévaluation, voire d’une réhabilitation, de ces «moyens» de la formation littéraire si souvent conspués.
Par un regard historique très exhaustif orienté sur la revue Pratiques qu’il a contribué à fonder et dirige depuis bientôt cinquante ans, André Petitjean offre une ouverture passionnante sur un monde en partie disparu mais dont demeurent certaines survivances. Disparues sans doute les années où enseignement dans le secondaire, activités intenses à l’avant-garde de la recherche et activisme politique pouvaient se conjuguer harmonieusement. Mais heureusement, une réflexion sur les enjeux de l’enseignement du français reste actuelle, à l’heure où l’importance de la narratologie se mesure à celle de faire écrire: «il importe de donner aux élèves la possibilité de "faire" de la littérature et pas uniquement de la commenter».
Yves Reuter, quant à lui, rappelle que cet engouement propre aux années post-68 n’était pas propre à la théorie des textes et que la narratologie naissante travaillait sur ce plan en concurrence avec la philosophie ou la politique. Partageant en cela l’avis de Bronckart, il ajoute qu’il faudrait mieux parler d’«élaboration» plutôt que de «transposition» didactique, le modèle chevallardien ne convenant pas, car pouvant être suspecté d’applicationnisme. Mais il remarque également, comme Dumortier, que c’est le caractère relativement autonome des exemples de la première narratologie qui a valu à celle-ci sa fortune scolaire. En conclusion, il estime que la mauvaise réputation de la narratologie est d’autant plus regrettable que les récits restent plus que jamais au centre de l’enseignement littéraire.
Enfin Claude Simard, représentant le versant outre-Atlantique de cette série de témoignages, rappelle que l’importance historique de la narratologie à l’école trouve aussi son explication dans les programmes ministériels québécois. À l’époque comme de nos jours, les directives institutionnelles ont eu beaucoup de poids dans le développement des programmes. Simard préconise en conclusion un équilibre «entre l’intellect et l’affect» pour développer via l’étude de la littérature une conscientisation des phénomènes narratifs, dans un monde où notre besoin de récits n’est pas près de s’éteindre.
Pour présenter plus en détail ces entretiens, Luc Mahieu propose une introduction à ceux-ci et rappelle le dispositif adopté pour recueillir la parole de ces grand·e·s témoins. Forme synthétique des réponses proposées, cette contribution permet également de percevoir au fil de ces discours des lignes de convergence (notamment autour de l’importance attribuée à un contexte de changement de configuration disciplinaire et d’émergence de la didactique en tant que champ de recherche) et de divergence (retours réflexifs contrastés sur les rôles joués par ces acteur·rice·s ou évaluations diverses sur les notions narratologiques qui auraient pu connaitre un autre sort en contexte scolaire).
Afin de compléter ces regards sur le passé de la scolarisation des théories du récit, Nathalie Denizot partage un regard sur «l’aventure scolaire de la narratologie» au lycée. La chercheuse y exploite les instructions officielles françaises publiées depuis les années 1970, un corpus de manuels publiés entre 1984 et 2020, ainsi que les entretiens présentés ci-dessus. Cette analyse historico-didactique lui permet de montrer que la narratologie devient dans les années 1990 le cadre d’analyse hégémonique pour travailler le récit, et ce aux dépens des autres théories du texte et de la linguistique textuelle. Mais l’analyse parallèle des programmes et des manuels permet également de voir qu’après une présence explicite des notions narratologiques dans les prescrits (de 1987-88) et dans les manuels scolaires, suit, à partir de 2000-2001, une période durant laquelle la théorie du récit disparait des instructions officielles, alors que les outils narratologiques perdurent dans les méthodes d’enseignement en tant que «véritables savoirs disciplinaires, avec des définitions précises, des exercices pour s’exercer à leur emploi». Plongeant plus en profondeur dans les manuels, Denizot montre que la notion la plus présente est sans conteste celle de «point de vue», tout en précisant que l'institutionnalisation des catégories genettiennes autour de celle-ci s’accompagne d’un travail d’exercisation sur des corpus d’extraits majoritairement issus de la production romanesque du XIXe siècle, et plus précisément de certains auteurs, tels que Flaubert, Stendhal ou Zola, qui ont «justement contribué à l’histoire de la subjectivation du récit». Si la chercheuse s’intéresse également aux autres notions présentes dans les manuels – narrateur, schéma narratif, fonction des personnages, catégorie relatives à l’ordre du récit –, c’est pour remarquer qu’à de rares exceptions près (lesquelles intègrent quelques bandes dessinées), le travail d’exercice proposé sur les notions narratologiques se fait sur la base exclusive des textes littéraires, se conformant ainsi à une conception étroite du récit partagée par certains narratologues, dont Gérard Genette. Banalisée, restreinte à des corpus littéraires et des exercices «parfois un peu myopes et technicistes», la narratologie n’en est pas moins devenue, selon Denizot, «incontournable dans les manuels de méthode qui cherchent à "outiller" les élèves dans le travail sur les textes».
Après avoir scruté le passé scolaire de la narratologie, deux contributions permettent d’explorer le présent des pratiques enseignantes. Dans une synthèse des premiers résultats de son enquête, Luc Mahieu propose d’exploiter les données issues d’un questionnaire complété par 529 enseignant·e·s du secondaire (élèves de 12 à 18 ans) en Belgique, en France, en Suisse et au Québec. S’en dégage une «boite à outils» narratologique relativement partagée dans les pratiques enseignantes, même s’il faut constater quelques différences (notamment dans la terminologie, la fréquence d’utilisation des notions ou l’importance de celles-ci dans la réussite de l’épreuve finale) qui renvoient à des configurations disciplinaires elles-mêmes différenciées selon les pays. Les répondant·e·s français·es et suisses semblent ainsi accorder une place plus importante à l’outillage narratologique que leurs homologues belges et québécois·es, ce qui renvoie parallèlement, dans ces deux ensembles, à des places différenciées accordées à la littérature dans les cours de français (plus importante en France et Suisse). Au-delà des fréquences d’utilisation, le sentiment d’utilité associé aux notions d’analyse du récit a également été sondé, conduisant à la constatation (est-ce une surprise?) que 94% des répondant·e·s estiment utile ou très utile que leurs élèves soient ainsi formés sur le plan de la théorie du récit. Parmi les nombreux résultats obtenus permettant de dresser un état des lieux des pratiques actuelles, il est en revanche plus surprenant de voir que les enseignant·e·s n’estiment pas que les notions narratologiques et leur utilisation éloignent les élèves de la lecture-plaisir.
La question narratologique est également envisagée par Jean-Louis Dufays à l’aune du projet Gary, une enquête qui éclaire en particulier l’implication des enseignant·e·s et la performance de lecture des élèves concerné·e·s. Dans le cadre de ce projet, on a fait lire une nouvelle de Romain Gary à près de 2000 élèves encadrés par 70 enseignant·e·s. À partir de ces observations, Dufays constate entre autres que le travail sur la construction narrative du texte se présente comme une base très sédimentée dans les pratiques scolaires. Si, dans l’ensemble, les compétences de lecture apparaissent étayées par l’approche narratologique, les compétences interprétatives semblent moins sollicitées. Dans le second volet de sa contribution, Dufays préconise la mise en parallèle de la compréhension et de l’interprétation, envisageant les «outils comme moyens d’enrichir le sens plutôt que comme conditions d’accès à celui-ci». Il ajoute à ces observations qu’il serait nécessaire de prendre en charge la question de l’appréciation des récits, la validation du rapport affectif qui lie les textes aux élèves, même s’il reste difficile à évaluer, pouvant représenter un aspect essentiel du travail scolaire.
Enfin, les derniers contributeurs à ce dossier nous invitent à nous tourner vers le futur de la narratologie enseignée.
Bertrand Daunay propose une contribution en deux parties, oscillant comme son titre l’indique entre scepticisme et optimisme quant à la possibilité d’améliorer les pratiques enseignantes relatives à l’outillage narratologique. Dans un premier temps, il revient sur les processus de construction des savoirs scolaires en distinguant deux conceptions – l’une transpositionniste et verticale (Chevallard 1985), l’autre créationniste et horizontale (Chervel 1988) – qu’il propose de croiser pour mieux envisager les processus complexes de scolarisation qui finissent par constituer ce que Denizot (2021) appelle la culture scolaire. Ce cadre planté, Daunay s’attache plus particulièrement aux contenus narratologiques en voyant justement dans leurs modalités de scolarisation un facteur d’explication de leur succès: l’école se saisit en effet d’autant mieux, en les remodelant, «de savoirs qui peuvent se combiner à ceux qu’elle transmet déjà». La narratologie a donc pu remplacer l’histoire littéraire comme socle épistémologique légitime d’une approche scolaire de la littérature. Sur ces bases, s’il juge difficile de préjuger de l’avenir de la narratologie scolaire, Daunay estime que «rien n'empêche que son règne se poursuive», voyant un indice de la présence continuée de la narratologie à l’école dans un extrait d’un récent programme du lycée (2019) évoquant la nécessaire «acquisition d’un vocabulaire technique» et mentionnant explicitement la focalisation.
Raphaël Baroni s’interroge quant à lui sur les raisons pour lesquelles un théoricien du récit s’est mis en tête d’améliorer l’outillage narratologique scolarisé et sur la complexité de cette quête ardue, si ce n’est impossible. Dans ce retour réflexif sur son propre parcours, Baroni envisage certains acquis du projet DiNarr lancé voici deux ans, dont les premiers résultats ont été publiés dans des revues de didactique du français (Baroni 2023a; 2023b). Puisque se confirme à la fois la résilience de la narratologie dans les pratiques scolaires et les difficultés dans le maniement de certaines notions (voir la contribution de Luc Mahieu), il s’agit dès lors de mesurer quelles peuvent être les contributions spécifiques d’un narratologue pour améliorer «l’ergonomie de l’outillage narratologique pour le mettre véritablement au service des besoins des enseignants et des élèves». Dans cette perspective, Baroni estime que le narratologue doit a minima légitimer une remise en question salutaire des modèles hérités, qui ont été parfois sacralisés sous la figure tutélaire de Gérard Genette, et il peut aussi informer enseignant·e·s et didacticien·ne·s de l’existence de débats autour des modèles hérités et d’alternatives à ceux-ci. Il termine son article en dressant un inventaire des éventuels lieux d’intervention en passant en revue les notions traditionnellement enseignées et la manière dont elles pourraient être renouvelées: narrateur, focalisation, temps du récit, intrigue, personnage. Si ces propositions doivent aller à la rencontre du terrain de la classe et du monde de l’école en général (prescrits, manuels, formations initiale et continue des enseignant·e·s…), il espère qu’en retour, c’est la théorie elle-même qui en sera enrichie par cette confrontation avec les usages qui peuvent en être faits. Il regrette en effet que les modèles narratologiques, souvent élaborés dans une démarche purement hypothético-déductive, aient «trop rarement été confrontés à des tests empiriques, de sorte que leur validité demeure le plus souvent douteuse».
Yann Vuillet et Bruno Védrines partent du constat selon lequel la narratologie reste d’actualité à l’école. Reste à interroger son sens, qui pour eux est double: le développement intellectuel de l’élève et sa compréhension des émotions. Il s’agit d’abord de renverser la hiérarchie académie-école: ce n’est pas la seconde qui doit ses matériaux et leurs développements à la première, ce serait bien plutôt à la scolarisation de leurs théories que les universitaires doivent la vitalité de celles-ci. Et de procéder ensuite à une explicitation par le terrain scolaire, afin de tordre le cou aux idées reçues selon lesquelles enseigner les techniques d’analyse du récit serait le signe d’une autosatisfaction théorique. À rebours de cette idée, ils estiment qu’«il vaut mieux partir d’un réel état des choses, sous peine de rêver la réalité plutôt que la décrire». Les auteurs s’appuient sur le modèle élaboré par Lev Vygotski pour rappeler la valeur des «concepts» enseignés, en particulier narratologiques. Dans une telle approche, ils soulignent que la question émotionnelle n’est pas absente de l’apprentissage conceptuel, tout simplement parce que l’émotion se conceptualise aussi, ce qui permet de la conscientiser et de la partager. L’enjeu central, rappellent-ils en conclusion, consiste à «se départir de rapports plus ou moins spontanés où s’encourt toujours le risque de confondre l’objet que l’on souhaite décrire avec l’effet qu’il a sur nous».
Jean-François Boutin se propose quant à lui d’élargir les corpus enseignés pour y inclure les productions transmédiatiques, jusqu’ici peu traitées dans le contexte scolaire, la narratologie contemporaine pouvant servir de levier pour permettre ce désenclavement. La nécessité d’adopter de nouveaux outils aptes à rendre compte de la nature hybride de ces productions transmédiatiques se pose en particulier au Québec, où les programmes scolaires semblent encore fortement alignés avec une narratologie classique très verbo-centrée. Assouplir le rapport à la théorie du récit implique-t-il aussi de remettre en question nos propres méthodologies? L’auteur le suggère en quittant les rivages prudents de l’analyse critique pour mettre en scène un sujet empêtré dans le labyrinthe des fictions transmédiatiques. Il s’agit dès lors d’en appeler à une plus forte adaptabilité des concepts théoriques face à une réalité fictionnelle qui se présente de plus en plus sous la forme d’expériences hybrides, foisonnantes et ultra-immersives, qui se révèlent réfractaires à une analyse fondée sur des outils critiques traditionnels. En somme, le rapport distancié (on pourrait dire: moderne) au concept est aujourd’hui insuffisant pour rendre compte de telles expériences, qui doivent se munir d’outils – y compris narratologiques – capables de répondre de cette hybridité en l’intégrant.
4. En guise de conclusion
Si la narratologie cesse d’être un épouvantail dans le domaine des recherches en didactique de la littérature, c’est sans doute parce que l’on commence à s’intéresser sérieusement à la notion de «réputation», en observant que celle de la narratologie n’est peut-être pas assez bonne, tandis que celle de la littérature l’est trop. Comme le montrent de récents travaux (Ronveaux et Schneuwly, 2018, et jusqu’à l’intervention de Y. Vuillet et B. Védrines dans ce dossier), l’enseignement de la littérature a été longtemps conditionné par la réputation littéraire des textes enseignés, et par son corollaire d’une fausse universalité, naturalisée, conduisant à une collusion d’initiés. Le rééquilibrage que ces travaux appellent de leurs vœux, pour s’émanciper d’une «sacralisation» de la littérature (Meizoz, 2023), rejoint la nécessité de réévaluer la réputation de la narratologie. Sans un changement profond de l’image de ce domaine de recherche dans les études littéraires, la didactique et l’enseignement du français, tout changement de fond demeurera impossible. L’ambivalence de Tzvetan Todorov est révélatrice sur ce point, car, comme le rappellent certains articles réunis dans ce dossier, il n’est pas seulement l’un des pionniers de la narratologie, il est aussi l’auteur de La littérature en péril (2007), ouvrage qui cumule ce double déséquilibre réputationnel: celui d’une littérature sanctifiée et d’une narratologie conspuée. Et si le «péril» est justement reconnu par quelques-uns des contributeur·ice·s de notre dossier comme étant lié à cette «analyse structurale» dont Torodov fut l’un des promoteurs (Todorov 2007: 23), «la littérature» serait à plaindre selon lui à cause d’une approche qui la priverait de «sens»:
Le lecteur ordinaire, qui continue de chercher dans les œuvres qu’il lit de quoi donner sens à sa vie, a raison contre les professeurs, critiques et écrivains qui lui disent que la littérature ne parle que d’elle-même, ou qu’elle n’enseigne que le désespoir. (Todorov 2007: 72)
Or ce «sens» évoqué par Todorov semble aujourd’hui bien difficile à admettre de manière unilatérale. Il le justifie par un principe téléologique hérité de Kant, selon lequel toute production narrative s’apparenterait à «un pas obligé de la marche vers un sens commun, autant dire vers notre pleine humanité» (p. 78). Il semble bien, plutôt, que l’on ait affaire à un effet implicite et inavoué de connivence (Gabathuler, Védrines & Vuillet 2019), dont on ne peut se satisfaire comme d’un donné universel, équitablement partagé. Délivré de cette connivence, le sens peut se remettre à exister, à condition de faire l’objet d’une reconstruction constante et communautaire dans les domaines de la scolarisation et de la médiation de la littérature. Ajoutons à cela le fait que Todorov, comme nombre d’universitaires spécialistes de critique littéraire (Gabriel, Gillain & Vrydaghs, 2020: 242), ne démontre aucune connaissance des travaux de didactique de la littérature, et nous pourrons en conclure que, sur le plan des rapports entre enseignement de la littérature et des théories du récit, ni la première ni les secondes ne sont en péril.
Bibliographie
Adam, Jean-Michel (1984), Le récit, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?».
Baroni, Raphaël (2023a), «Des virtualités du monde de l’histoire à la mise en intrigue: une alternative au schéma narratif», Pratiques, n° 197-198. URL: https://journals.openedition.org/pratiques/12755
Baroni, Raphaël (2023b), «Une perspective transmédiale sur la focalisation», Recherches. Revue de didactique et de pédagogie du français, n° 78, p. 9-44. URL: https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_E5B0EF1995A3.P001/REF
Baroni, Raphaël (2017a), «Pour une narratologie transmédiale», Poétique, n° 182, p. 155-175. DOI: https://doi.org/10.3917/poeti.182.0155
Baroni, Raphaël (2017b), Les Rouages de l’intrigue, Genève, Slatkine. URL: https://serval.unil.ch/fr/notice/serval:BIB_91F2FABBCF53
Bremond, Claude (1964), «Le message narratif», Communications, n° 4, p. 4-32.
Caracciolo, Marco & Karin Kukkonen (2021), With Bodies. Narrative Theory and Embodied Cognition, Columbus, Ohio State University Press.
Chervel, André (1988), «L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de recherche», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 59-119. URL: https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1988_num_38_1_1593
Chevallard, Yves (1985/1991), La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, Éditions La Pensée Sauvage, coll. «Recherches en didactique des mathématiques».
Compagnon, Antoine (1998), Le démon de la théorie: littérature et sens commun, Paris, Seuil.
Daunay, Bertrand (1999), «La "lecture littéraire": les risques d’une mystification», Recherches. Revue de didactique et de pédagogie du français, n° 30, p. 29-59.
Daunay, Bertrand (2007), «État des recherches en didactique de la littérature», Revue française de pédagogie, (159), p. 139-189.
Daunay, Bertrand (2010), «Français et littérature: une ou des discipline (s)», Le français aujourd'hui, n° 168 (1), p. 23-30. URL: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2010-1-page-23.htm
Daunay, Bertrand & Jean-Louis Dufays (2016), «La lecture littéraire en débat, pour en finir?», in Enseigner les littératures dans le souci de la langue, C. Ronveaux (dir.), Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, coll. «ThéoCrit’».
David, Jérôme (2014), «Chloroforme et signification: pourquoi la littérature est-elle si soporifique à l’école?», Études de lettres, n° 295, p. 19-32. URL: https://journals.openedition.org/edl/604
Dawson, Paul (2017), «Delving into the Narratological «Toolbox»: Concepts and Categories in Narrative Theory», Style, n° 51 (2), p. 228-246.
Denizot, Nathalie (2021), La culture scolaire: perspectives didactiques, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. «Études sur l'éducation».
Dufays, Jean-Louis (2016), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n°45, p. 9-17.
Dufays, Jean-Louis & Magali. Brunel (2016), «La didactique de la lecture et de la littérature à l’aube du XXIe siècle. État des recherches en cours et focus sur la perspective curriculaire», in Didactiques du français et de la littérature, A. Petitjean (dir.), Metz, CREM (Université de Lorraine), p. 233-266.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (2015), Pour une lecture littéraire: histoire, théories, pistes pour la classe, Louvain-la-Neuve, De Boeck, coll. «Pratiques pédagogiques».
Gabathuler, Chloé, Bruno Védrines & Yann Vuillet (2019), «Didactique, réputation littéraire et connivences», Recherches n°70, p. 137-162.
Gabriel, Jean-Benoît, Nathalie Gillain & David Vrydaghs (2020), «La didacticité des discours sur l’enseignement des lettres» in Diffusion et influence des recherches en didactique du français, O. Tremblay, É. Falardeau, P. Boyer, & I. Gauvin (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 241-257.
Genette, Gérard (1972), «Discours du récit», in Figures III, Paris, Seuil, coll. «Poétique».
Herman, David (1997), «Scripts, Sequences, and Stories: Elements of a Postclassical Narratology», PMLA, n° 112 (5), p. 1046-1059.
Langlade, Gérard & Annie Rouxel (2008), «Des références critiques, pour quoi faire?», Le Français aujourd’hui, n° 160, p. 53-60.
Lebrun, Monique, Nathalie Lacelle & Jean-François Boutin (2012), La littératie médiatique multimodale: de nouvelles approches en lecture-écriture à l'école et hors de l'école, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Meizoz, Jérôme (2023), «Le sacré littéraire résiduel. Une enquête», Contexte, varia, DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.11089
Migozzi, Jacques (2019), «Extension du domaine de la littérature: quelques propositions pour repenser la formation "littéraire" à l’Université inspirées de quelques recherches récentes en Littératures Populaires et Culture Médiatique», ELFe XX-XXI, n° 8. URL: https://dx.doi.org/10.4000/elfe.999
Patron, Sylvie (2018), Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Patron, Sylvie (2009), Le Narrateur, Paris, Armand Colin.
Phelan, James (1989), Reading People, Reading Plots: Character, Progression, and the Interpretation of Narrative, Chicago, University of Chicago Press.
Picard, Michel (1986), La Lecture comme jeu: essai sur la littérature, Paris, Editions de Minuit.
Plane, Sylvie & Bernard Schneuwly (dir.) (2000), Les outils d'enseignement du français, coll. «Repères: recherches en didactique du français langue maternelle».
Prince, Gerald (2008), «Classical and/or Postclassical Narratology», Esprit Créateur, n° 48 (2), p. 115-123.
Rabatel, Alain (1998), La construction textuelle du point de vue, Lausanne et Paris, Delachaux et Niestlé.
Reuter, Yves (2000), «Narratologie, enseignement du récit et didactique du français», Repères, n° 21, p. 7-22.
Reuter, Yves (2016 [1997]), L'analyse du récit, Paris, Dunod, coll. Topos.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (2004), Le Sujet lecteur. Lectures subjectives et enseignement de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Ryan, Marie-Laure (2006), Avatars of Story, Minnesota, University of Minnesota Press.
Ryan, Marie-Laure & Jan-Noël Thon (dir.) (2014), Storyworlds across Media. Toward a Media-Conscious Narratology, Lincoln, University of Nebraska Press.
Schneuwly, Bernard & Jean-Paul Bronckart (dir.) (1985), Vygotsky aujourd’hui, Paris, Delachaux et Niestlé.
Schneuwly, Bernard (2008), Vygotski, l’école et l’écriture, Genève, Cahiers de la section des sciences de l’éducation, n° 118.
Todorov, Tzvetan (2007), La Littérature en péril, Paris, Flammarion.
Todorov, Tzvetan (1969), Grammaire du Décaméron, The Hague, Paris, Mouton.
Vygotski, Lev (2019 [1934]), Pensée et langage, Paris, La Dispute.
Pour citer l'article
Gaspard Turin, Luc Mahieu, Raphaël Baroni, "Introduction n°6: Pour une théorie du récit au service de l’enseignement", Transpositio, n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives, 2023https://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-6-pour-une-theorie-du-recit-au-service-de-l-enseignement
Voir également :
Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français
Cet article propose une analyse documentaire et compréhensive de la place et de la fonction de l’image lors de la lecture de Sobibor de Jean Molla et de La Cour aux étoiles d’Evelyn Brisou-Pellen au Secondaire I.
Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français
Introduction
Dans la rubrique «Apprécier et analyser des productions littéraires diverses» (L1 35), le Plan d’études romand (2012) indique que cette dimension se travaille notamment «en découvrant des caractéristiques esthétiques (graphisme, mise en pages, …)» et «en prenant en compte la forme éditoriale et le paratexte». Aussi pouvons-nous à juste titre nous demander si et comment ces prescriptions sont effectivement mises en œuvre dans les classes lors de la lecture de textes. De quelle manière l’objet-livre et les images qu’il peut contenir sont-ils pris en compte dans l’enseignement de la littérature? Plus largement, nous nous intéressons ainsi à la manière dont les relations textes-images, tant au niveau éditorial que dans l’activité enseignante, nous disent quelque chose de la littérature scolarisée (Louichon 2018) et enseignée.
L’objet qui nous occupe est la fiction historique pour la jeunesse, que l’on peut considérer comme une forme particulière de roman historique, qui se caractérise par «une visée plus spécifiquement didactique», qui vise à «transmettre un savoir historique sur une époque, des évènements, des personnages» (Louichon 2016: 14). Cette dimension a un impact conséquent sur son utilisation dans le cadre de la discipline Français. Brunel a par exemple relevé que les enseignants de Français visent
[…] des objectifs de connaissances historiques plutôt que littéraires, et […] condui[sent] des dispositifs plus proches des tâches scolaires de la discipline Histoire que du Français (2013: 234).
De la même manière, Raimond note que
l’enseignant de Français semble en effet se substituer parfois à l’enseignant d’Histoire en utilisant le texte comme un réservoir de connaissances historiques (2018:147).
Pourtant, la réception de ce genre de texte, c’est-à-dire «un outil sémiotique historiquement et culturellement forgé» (De Pietro & Schneuwly 2003: 34), relève bien d’enjeux qui sont ceux de la discipline Français. Le roman historique s’inscrit dans l’activité langagière «raconter1»: il s’agit d’un récit fictif vraisemblable, qui se situe à une époque que l’auteur n’a pas connue, et qui doit s’appuyer sur des sources pour la reconstruire. Cela détermine la responsabilité de l'auteur «dans l’acte d'énonciation, c'est-à-dire en somme l'autorité que l’on peut lui reconnaître dans son rapport au réel et donc la créance et la confiance à lui accorder» (Védrines 2020: 48). Peyronie insiste sur la connaissance indirecte du contexte historique par l’auteur:
[…] est roman historique tout récit romanesque dont l’action se situe à une époque nécessitant pour son auteur un relais historiographique (2000: 280).
Pour le dire autrement, la situation de communication du roman historique implique une certaine prudence quant à l’usage du genre au service de la construction de savoirs historiques. En revanche, il peut constituer un objet singulièrement intéressant dans la discipline Français, notamment lors d’un travail sur le rapport au référent et le rôle du paratexte dans l’identification de certaines caractéristiques génériques. Il nous semble dès lors particulièrement opportun d’interroger comment le rapport texte-image participe de ce rapport au référent et de la circonscription de la situation de communication du texte, et comment l’image peut mettre à l’épreuve le texte et ses lectures possibles.
Notre objectif est la description et la compréhension des pratiques d’enseignement de la littérature au niveau Secondaire I du point de vue de la didactique de la discipline Français. Nous mobilisons ainsi le cadre théorique de la transposition didactique (Chevallard 1985) pour appréhender le passage de l’objet de savoir à l’objet à enseigner (transposition didactique externe), et de l’objet à enseigner à l’objet effectivement enseigné (transposition didactique interne). Ainsi, nous nous demandons de quelles manières, et avec quels objectifs, l’image est mobilisée au niveau de la transposition didactique externe et de la transposition didactique interne. Comment accompagne-t-elle le texte à lire? Est-elle mise au service de savoirs relatifs à l’Histoire et/ou à des connaissances historiques? Participe-t-elle de la compréhension du texte et de sa situation d’énonciation, et de la construction de savoirs relatifs à l’enseignement de la littérature? En outre, comment s’intègre-t-elle dans le déploiement des dispositifs d’enseignement? Pour répondre à ces questions, nous allons en premier lieu préciser notre ancrage théorique et nos choix méthodologiques, puis nous passerons à l’analyse de la transposition didactique externe et de la transposition didactique interne grâce à deux séquences d’enseignement de Français recueillies entre 2020 et 2021.
Cadre théorique et problématisation
Notre cadre théorique repose sur le concept de transposition didactique (Chevallard 1985; Schneuwly 1995; Bronckart & Plazaola Giger 1998), c’est-à-dire le passage d’un objet de savoir en objet à enseigner, puis en objet enseigné. Nous la mobilisons dans une double perspective: d’abord bourdieusienne, nous considérons que les savoirs sur la littérature sont caractérisés par les espaces sociaux qui les produisent. Ces espaces revendiquent notamment une légitimité à déterminer ce qui relève ou non de la littérature. Nous pouvons ainsi identifier l’espace des études littéraires académiques, celui du champ littéraire proprement dit (écrivains, éditeurs, prix littéraires, etc.) et celui de l’école. Notre perspective est ensuite sociohistorique, et permet de décrire l’épaisseur historique du processus de fabrication de l’enseignable, processus marqué par la disciplinarisation, c’est-à-dire l’organisation des savoirs en disciplines au sein du système scolaire (Schneuwly & Ronveaux 2021), et par la sédimentation, c’est-à-dire la persistance de certaines pratiques traditionnelles d’enseignement dans les nouvelles pratiques. D’autre part, nous effectuons une distinction entre la transposition didactique externe (désormais TD externe) et la transposition didactique interne (désormais TD interne) (Petitjean 1998): la première transforme l’objet de savoir en objet à enseigner, tandis que la seconde est aux mains des enseignants, qui transforment l’objet à enseigner en objet effectivement enseigné.
Nous avons mis en évidence dans notre travail doctoral (Boër 2023) une forme de brouillage générique dans la transposition didactique externe au niveau de l’espace des recommandations (Reuter 2004). Ce brouillage se caractérise par une labellisation sous l’étiquette «roman historique» de textes relevant d’activités langagières et de situation de communication pourtant distinctes (par exemple le Journal d’Anne Franck, Mon ami Frédéric d’Hans Peter Richter, ou encore Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor). Ce phénomène peut s’expliquer en partie par la scolarisation en soutien de la discipline Histoire des fictions historiques pour la jeunesse. En effet, si celles-ci avaient pour objectif, au début de l’école républicaine, d’accompagner la formation d’un futur citoyen et de développer l’amour de la patrie, depuis la deuxième moitié du XXe siècle ces fictions sont produites et scolarisées en lien avec les programmes d’Histoire (Manson 2013). Le développement de l’enseignement de questions mémorielles au début des années 2000 est concomitant à une nouvelle production éditoriale de fictions pour la jeunesse consacrées aux évènements violents du XXe siècle (Finet 2019). Sur le plan de la disciplinarisation, cela conduit à des difficultés dans les pratiques des enseignants de Français à voir le roman historique autrement que comme un objet au service de l’enseignement de savoirs historiques (Brunel 2013; Raimond 2018). Le roman historique devient ainsi dans les pratiques scolaires synonyme de «récit historique», un objet aux contours flous, avec un accent porté sur le référent, au détriment de la situation de communication du texte. Notons qu’au niveau des prescriptions officielles, le PER (2012) utilise le terme «récit historique», qui est conseillé dans le regroupement de genres du texte qui raconte au Secondaire I.
Lors de la lecture d’un roman historique en Français, quelles sont les dimensions du genre qui bénéficient d’un recours à l’image? Au niveau de la mise en texte, quelle sémiotisation de l’image est réalisée par le processus éditorial? Comment est-elle articulée avec le texte et les protocoles de lecture qui y sont déposés (Chartier 1985)? Au niveau de la transposition didactique interne, comment les enseignants mobilisent-ils l’image, pour la mettre au service de quels savoirs?
Méthodologie
Nos données sont constituées par deux séquences de Français dispensées dans deux classes du secondaire I en Suisse francophone, l’une dans le canton de Genève et l’autre dans la partie francophone du canton de Berne. Ces deux séquences ont été transcrites selon les conventions d’usage, et réduites grâce à la constitution de synopsis (Schneuwly et al. 2006). Les documents réalisés par les enseignants et distribués aux élèves ont également été recueillis et ont fait l’objet d’une analyse.
Au niveau de la transposition didactique externe et de la description de l’objet didactisé, nous analysons la matérialité éditoriale (Aeby Daghé 2014) des textes singuliers sélectionnés par les enseignants. En effet, selon Aeby Daghé,
prendre en compte la matérialité du texte, c’est donc considérer que les traces de l’insertion du texte dans un support disent quelque chose des pratiques de lecture en classe et leur confèrent un statut de pratique créatrice, inventive, productrice (2014: 56).
Nous tâchons ainsi de reconstruire les éventuels protocoles de lectures déposés dans l’objet culturel par le rôle conféré à l’image dans le processus de l’édition (Chartier 1985/2003), et les significations que les enseignants de Français peuvent potentiellement sémiotiser. Il s’agit ainsi d’analyser les effets de sens de la matérialité des signes, dont l’horizon d’attente est déterminé par la situation de lecture dans le cadre scolaire.
Au niveau de la transposition didactique interne et de l’analyse de l’objet effectivement enseigné, nous nous intéressons à la place de l’image dans les supports réalisés par les enseignants, considérés comme une mise en texte des savoirs scolaires et préfiguration d’un parcours de lecture (Thévenaz-Christen & Leopoldoff 2014), mais aussi comme traces du geste de planification (Franck 2017). Le découpage de la séquence en activités et l’analyse du geste didactique de mise en place de dispositifs didactiques (Schneuwly 2009) nous permet également de saisir les moments d’utilisation de l’image dans la séquence.
L’image dans la transposition didactique externe
Nous avons analysé deux séquences d’enseignement de la littérature au secondaire I en Suisse francophone. La première, dans une classe de 11e Harmos (14-15 ans), est consacrée au texte Sobibor de Jean Molla. Cette fiction met en scène une jeune adolescente appelée Emma, en proie à l’anorexie, qui trouve dans les affaires de sa grand-mère le journal intime d’un soldat français chargé de l’extermination des Juifs au camp de Sobibor en Pologne. A l’intérieur du récit à la première personne de la jeune fille sont insérés plusieurs extraits de ce journal. Nous relevons que l’enseignement de ce texte comme exemplaire singulier du genre «roman historique» constitue une manifestation du brouillage générique évoqué plus haut, puisqu’il propose une narratrice contemporaine qui ne vit pas directement les évènements historiques en question, mais qui est amenée à découvrir l’implication d’un membre de sa famille dans le génocide par le biais de son journal intime. Sobibor est publié pour la première fois en 2003. Recommandé par le ministère de l’Éducation Nationale français pour le cycle 4 (Secondaire I) pendant plusieurs années, il a bénéficié en 2017 d’une réédition chez Belin/Gallimard avec un dossier pédagogique réalisé par Marianne Chomienne, agrégée de lettres modernes. C’est cette version qui a été distribuée à la classe, et que nous allons à présent décrire.
Cette édition comporte trois images, placées en deuxième et troisième de couverture. Il s’agit d’une photographie en noir et blanc de l’arrivée de déportés au camp d’Auschwitz-Birkneau en juin 1944, d’une photographie en couleur de la sculpture de l’artiste Nandor Glid au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, ainsi que de la reproduction d’une planche de Tardi parue dans le journal Libération le 27 janvier 2000. Comme l’a souligné Cambier (2013), l’usage de sources photographiques dans les dossiers pédagogiques des fictions historiques consacrées à la Shoah vise à garantir l’authenticité des faits racontés. La photographie du mémorial vient souligner en complément la dimension mémorielle du texte. La planche de Tardi est particulièrement intéressante: elle se présente comme un conte (notamment par l’emploi de la formulette il était une fois), et se termine sur l’annonce de l’ouverture du Forum international sur l’Holocauste et la mémoire. La planche propose ainsi une comparaison implicite entre les responsables du génocide et les monstres des contes de fées, monstres qui s’enhardissent lorsqu’on les oublie. La dimension morale sur les dangers de l’oubli est donc particulièrement importante. Boulaire (2002) a mis en avant la proximité entre le conte merveilleux et le roman historique pour la jeunesse, proximité qui peut s’expliquer par certaines finalités morales de ces deux genres de textes, qui s’adressent spécifiquement à des jeunes lecteurs. La planche de Tardi est particulièrement significative, à la fois pour l’ancrage du texte dans le paysage des fictions historiques pour la jeunesse, mais également pour ses finalités éducatives et morales assumées. Finet (2018) nous rappelle que, dans la fiction historique pour la jeunesse sur la Shoah, et contrairement au roman historique traditionnel,
ce ne sont […] pas les personnages qui permettent d’acquérir les connaissances historiques, mais tous les dossiers et documents qui viennent compléter la fiction et qui lui donnent un caractère pédagogique (2018: 124).
Si le dossier pédagogique joue le rôle de garant de la véracité du processus de mise à mort industriel décrit dans le récit et renforce sa dimension didactique, cela sort le texte du champ de la littérature à proprement parler et dirige son usage à des fins éducatives qui dépassent l’enseignement de la littérature proprement dit. Nous pouvons aller plus loin dans notre propos en analysant comment le dossier pédagogique mobilise ces trois images. Elles font en effet l’objet de trois «lectures d’image», estampillées «Histoire des arts». Ces activités sont divisées en trois tâches: lire l’image, comparer le texte et l’image, et une tâche intitulée «à vous de créer». Sans entrer dans les détails, relevons que ces tâches sont marquées par une volonté de faire travailler l’argumentation des élèves et de pointer le message du texte. A titre d’exemple, voici la question posée dans la tâche «comparer le texte et l’image» pour la photographie du Mémorial: «Pensez-vous que la vision d’un monument commémoratif est plus efficace que la lecture d’un récit sur l’extermination? Vous justifierez votre réponse en développant au moins deux arguments» (2017: 186). Ces «lectures d’image» visent ainsi à entraîner l’élève à argumenter sur la nécessité d’entretenir la mémoire du génocide, parachevant ainsi le programme de cette édition de Sobibor, en le faisant passant de récepteur à producteur d’un discours mémoriel.
Relevons également la première de couverture de Sobibor2: il s’agit d’une photographie en gros plan d’une jeune adolescente, dont la souffrance psychique est visible. La première de couverture pointe ainsi non pas le génocide lui-même comme sujet, mais bien la souffrance de la narratrice, liée à la découverte du rôle de son grand-père dans le génocide. Le choix de cette image est également un bon révélateur de l’insertion de Sobibor dans la littérature qui s’adresse à la jeunesse, et qui veut tendre un miroir à son lecteur3, en partant de l’hypothèse que réside dans cette fonction l’intérêt dudit lecteur. Pourtant, comme l’ont souligné Jaubert et al.,
les romanciers, les éditeurs, les enseignants et certains didacticiens semblent poser comme une évidence que la fiction historique fonctionnerait par le biais de l’identification du lecteur au personnage. Or, cette affirmation demanderait à être vérifiée et peut-être surtout préalablement définie (2013: 15).
Nous constatons ainsi le rôle important que joue l’image, au niveau éditorial, d’une lecture orientée vers des fins mémorielles, une finalité explicitement voulue par l’auteur de Sobibor4. Passons à présent à l’analyse de la TD externe du deuxième texte qui nous occupe.
La deuxième séquence, donnée dans une classe de 10e Harmos (13-14 ans), porte sur La Cour aux étoiles d’Evelyne Brisou-Pellen. Publié pour la première fois en 1982, ce texte a connu de multiples rééditions, et est toujours disponible sur le marché de la littérature de jeunesse. Spécialiste du roman pour la jeunesse, Evelyne Brisou-Pellen est l’autrice de nombreux romans historiques, ainsi que de romans dont l’action est plus contemporaine. La Cour aux étoiles se déroule au XIVe siècle et met en scène un jeune serf, Renaud, qui s’enfuit de son domaine pour atterrir à Paris dans un repaire de brigand. Cette Cour aux étoiles est dirigée par Thibaud le Chevalier, qui va accompagner le jeune garçon dans son adaptation à cette nouvelle vie parisienne. Pour cette séquence, les enseignants ont travaillé avec l’édition 2019 de Rageot, qui ne comporte pas de dossier pédagogique, mais un certain nombre d’images, qui peuvent constituer des indices de lecture.
Sur la première de couverture5, deux personnages occupent la place centrale: un jeune adolescent et un personnage plus âgé, tous deux vêtus d’une façon qui évoque le Moyen Âge. Derrière eux, on distingue une foule dont deux personnages se détachent: une jeune fille brune sur la droite, et, en plus petit, un homme chauve et moustachu sur la gauche. Au dernier plan s’élancent les tours de Notre-Dame de Paris. Les vêtements des personnages indiquent le Moyen Âge, et la présence imposante de la cathédrale Notre Dame de Paris, symbole emblématique du roman historique qui se déroule au Moyen Âge6, complète la «forêt de signes» (Thaler & Jean-Bart 2002) destinée à plonger le lecteur dans l’époque concernée, avant l’entrée dans la lecture proprement dite. L’illustrateur a choisi de représenter Renaud et Thibaud avec des traits physiques plutôt semblables: ils sont tous les deux blonds, les yeux clairs, et le camaïeu de couleurs qui compose leurs tenues - gris en haut, marron en bas - est identique. Ainsi, leur ressemblance souligne leur relation père-fils symbolique, et leurs traits physiques les caractérisent comme les personnages positifs de l’histoire. Selon Boulaire (2002), dans le Moyen Âge des fictions historiques pour la jeunesse, «le type noble est parfaitement reconnaissable: blondeur, clarté du teint, traits fins, mais fermes, nez et menton volontaires, yeux clairs» (2002: 64).
La couverture ainsi que les illustrations de cette édition ont été réalisées par un illustrateur de métier, dont la notice biographique est présente sous celle de l’autrice, en dernière page. Ces deux notices sont les seuls éléments paratextuels proposés par cette édition, avec les illustrations qui escortent le texte. Celles-ci portent sur les contenus du récit (par exemple celle du chapitre 1 représente une chaumière), et leur fonction figurative accompagne ainsi l’activité langagière du texte qui raconte, le rapprochant du conte. La présence de ces illustrations, et l’importance accordée à l’illustrateur avec sa notice biographique, vont dans le sens d’une littérature de jeunesse qui se considère comme une littérature imagée, avec une volonté de créer un dialogue entre l’image et le texte (Louichon 2018). Bien que la fiction historique pour la jeunesse des années 1980-1990 s’attache à reproduire les mœurs d’une époque historique, et vise à accompagner les plans d’études de la discipline Histoire7 (Manson 2013), aucun document ou source historique ne vient authentifier le contexte historique du texte. Le processus éditorial semble avoir pris en compte les critiques adressés à la fiction historique pour la jeunesse (voir notamment Boulaire 2002 et Houssais 2011) pour inscrire le texte dans un registre plus proche du conte. C’est d’ailleurs sous cette appellation générique qu’est classée La Cour aux étoiles sur sa fiche Wikipédia8.
Nous voyons ainsi le rôle important que joue l’image dans la lecture possible proposée par la TD externe. Lors de la lecture concrète de ces textes en classe, les enseignants vont-ils dans le sens de cette orientation donnée par le processus éditorial? Les images que nous venons d’analyser sont-elles mobilisées par les enseignants pendant les leçons? Ont-ils recours à d’autres images, et avec quels objectifs?
L’image dans la transposition didactique interne
Pour la séquence sur Sobibor, l’enseignante a notamment créé un dossier papier qu’elle distribue aux élèves lors de la première leçon. Il comprend trois parties: la première est composée de quelques indications biographiques sur Jean Molla, et d’un petit texte qui résume les motivations de l’auteur à rédiger Sobibor. Cette partie est notamment illustrée par une photographie de Jean Molla (figure 1). La deuxième partie est constituée d’un questionnaire de soixante-deux questions, tandis que la troisième partie comprend un article de vulgarisation scientifique sur le secret de famille écrit par Serge Tisseron9. Ici, l’image est mise au service de la situation de communication du texte et de la personnification de l’auteur, dont la position en tant qu’enseignant de Lettres est soulignée. Finet (2019) a d’ailleurs mis en évidence comment les supports éditoriaux des fictions historiques pour la jeunesse consacrée à la Shoah insistent sur le fait que l’auteur soit également enseignant, de manière à légitimer l’usage du texte à des fins éducatives. De la même manière, ce pointage est planifié par l’enseignante dans le support qu’elle a réalisé.

Figure 1
La première leçon de la séquence est consacrée à une introduction sur le genre «roman historique», suivie de la lecture à haute voix du prologue. L’enseignante s’appuie sur des diapositives PowerPoint pour assurer cette introduction. Plusieurs images sont alors montrées à la classe, et les portraits d’Alexandre Dumas et de Gustave Flaubert («donc voilà comme ça vous avez quelques noms d’auteurs […] que vous pouvez euh retenir pour votre culture générale», SBB, 1-1/3, l. 208-211) sont montrés dans la partie sur l’histoire du genre. Cette entrée par l’histoire littéraire avec un pointage de la figure de l’Auteur est caractéristique de l’approche classique de l’enseignement de la littérature (Gabathuler 2016; Ronveaux & Schneuwly 2018), et témoigne d’une conception du texte littéraire comme un texte d’auteur avant tout.
Lorsque l’enseignante arrive à la présentation du texte singulier, elle montre notamment une carte de l’Europe avec l’emplacement du camp de Sobibor. Après avoir distribué les exemplaires du livre aux élèves, elle revient au tableau pour montrer trois images: une photographie d’archive du camp (figure 2), une image extraite du film Sobibor (Konstantin Khabenskiy, 2018) sur la révolte du camp (figure 3), ainsi qu’une photographie du Mémorial (figure 4), qu’elle commente rapidement («voilà donc là vous avez une photo d’époque de Sobibor un extrait du film euh de:: qui est sorti euh récemment sur euh sur Sobibor ce film il est un peu violent moi je l'ai pas vu mais:: je le passerais pas un truc aussi violent en classe», SBB, 1-1/3, l. 429-428 - SBB, 1-2/3, l. 16-17). Ce film a d’ailleurs déjà été mentionné au tout début de la séquence, afin de différencier les camps d’Auschwitz et de Sobibor:
ES: Sobibor est un petit moins connu euh mais il est connu pour euh une chose en particulier et c’est pour ça qu’il y a eu un film récemment euh sur euh sur Sobibor qui euh parle de laH d’une révolte de prisonniers donc il y a certains prisonniers qui ont décidé dans ce camp-là de se rebeller et de tenter ensuite de s’évader (SBB, 1-1/3, l.332-342)

Figure 210

Figure 311

Figure 412
Elle ne dit rien de la photographie du Mémorial du camp. Toutefois, sa présence, similaire à ce que l’on peut trouver dans le dossier pédagogique de l’édition 2017, semble pointer implicitement la dimension mémorielle du texte, comme c’est souvent le cas avec ces fictions: «ces récits […] se donnent moins une finalité didactique - la transmission d’un savoir historique - qu’une finalité éthique - le devoir de mémoire» (Cambier 2013: 51).
Dans cette séquence, l’image est mobilisée pour attester de la réalité historique du contexte historique du texte qui va être lu, sans pour autant que ne soit pointée la différence entre la photographie d’archive et l’extrait du film. L’image n’est pas ici source d’activité (comme une lecture d’image par exemple), mais utilisée pour préciser le contexte référentiel du texte.
Dans le reste de la séquence, l’image n’est plus sollicitée. En outre, l’enseignante ne pointe pas les images présentes dans l’objet-livre, tout en choisissant de montrer des images similaires (une photographie d’époque et une photographie d’un monument en hommage aux victimes du génocide). Au niveau de la TD interne, nous voyons comment l’image est d’abord mobilisée pour inscrire le nouvel objet d’enseignement dans un objet plus large, l’histoire littéraire. Toutefois, si l’enseignante précise que c’est pour la culture générale des élèves, elle institutionnalise néanmoins un savoir («que vous pouvez retenir»). Au moment de passer d’un objet macro (le genre) à un objet plus restreint (le texte singulier), l’image ne sert plus la situation de communication comme dans le dossier, mais la dimension référentielle du récit. Sur le plan didactique, cette utilisation de l’image peut être comprise comme la volonté de l’enseignante de s’assurer que ce référent soit le même et compris par tous les élèves avant d’entamer la lecture du texte. En outre, étant donnée la définition du genre qu’elle a donné en début de séquence («une fiction avec des personnages inventés mais qui auraient pu exister, dans un cadre historique réel»), l’utilisation de l’image vient ici souligner la réalité de ce cadre historique. Il s’agit donc de pointer le rapport au référent du texte. Passons à présent à l’analyse de la place de l’image dans la TD interne du texte d’Evelyne Brisou-Pellen.
La séquence sur La Cour aux étoiles se caractérise par un nombre plus important d’activités et de supports distribués aux élèves. Dans ces supports, nous constatons que l’image a une fonction que nous qualifierons d’illustration. Par exemple, la synthèse sur les caractéristiques du genre est illustrée par l’image suivante (figure 5), qui est la seule de tous les supports dont la source est indiquée:

Figure 5
De la même manière, l’aide-mémoire sur la notion de servage propose cette image:

Figure 6
Le matériel didactique réalisé par l’enseignant comprend également plusieurs questionnaires sur le texte. Celui sur les chapitres 1 à 4 se termine notamment avec cette image:

Figure 7
La première image (figure 5) est tirée d’une banque d’images (gettyimages.fr), et évoque à la fois l’esthétique d’un jeu vidéo et celle de la fantasy13. La deuxième image (figure 6) est tirée de l’article «paysan» de l’encyclopédie en ligne Wikipédia: il s’agit de la représentation du mois d’octobre du Brevarium Grimani, daté de 1510, et peut être considérée comme un document historique. Enfin, la dernière image (figure 7) est en réalité l’illustration de couverture de l’édition Cascade de 1996 de La Cour aux étoiles, sur laquelle on peut reconnaître le personnage principal Renaud, ainsi que Thibaud et d’autres personnages de cette Cour. Ces trois images ont des sources très différentes, mais bien le même statut. Il s’agit d’illustrer le contexte référentiel du récit, mais, contrairement à la séquence sur Sobibor, il ne s’agit pas de souligner son caractère factuel, mais plutôt de plonger l’élève dans une «ambiance» médiévale. Nous pouvons faire un parallèle avec l’argument de Boulaire (2002) qui avance que le Moyen Âge représenté dans les fictions historiques pour la jeunesse relève plus de stéréotypes littéraires (du roman historique romantique ou du cycle arthurien par exemple) que de la recherche historique proprement dite14. Les images mobilisées ici dans les supports adressés aux élèves ne visent pas l’exactitude historique, mais plutôt les représentations communes sur cette période historique. Ce travail d’illustration réalisé par l’enseignant au moment de la préparation des supports peut être interprété comme une volonté de soutenir la compréhension des élèves en leur fournissant une aide visuelle permettant de mieux se représenter l’époque historique dans laquelle le récit se déroule. Notons également que la source historique (figure 6) est utilisée dans un document visant à synthétiser les notions de serf et de servage, donc dans un support qui pointe des savoirs historiques, tandis que les images d’illustration sont utilisées dans des supports relevant strictement de la discipline Français (le genre et les questionnaires sur le texte). Nous pouvons faire l’hypothèse que cette distinction est voulue par l’enseignant, qui est par ailleurs également enseignant d’Histoire. Il n’évoque cependant pas ces images au cours de la séquence, ni celles du texte lui-même15.
Au cours de la séquence, l’image intervient dans un dispositif didactique particulier lors de la cinquième leçon. L’enseignant diffuse une vidéo tirée de la plateforme Youtube16 sur l’hygiène au Moyen Âge. Notons que l’hygiène est un objet d’enseignement du programme d’Histoire au cycle 3 (SHS32, Histoire du vêtement, de l'hygiène, du tourisme), mais que cette question de l’hygiène est également présente dans le récit, puisque Renaud va régulièrement aux étuves et attache une importance particulière à la propreté. Cette leçon commence d’ailleurs par une lecture à haute voix du passage dans lequel Renaud s’empare d’un balai pour nettoyer la Cour, sous les yeux médusés de ses habitants, puis se rend aux étuves. Juste avant de diffuser la vidéo, l’enseignant mène un petit échange avec les élèves pour faire émerger leurs représentations sur l’hygiène médiévale:
ES1: qui est-ce qui s'est un petit peu renseigné sur l'hygiène: à cette époque-là /
El: très sale
ES1: oui L(prénom de l’élève):
El1-L: eh en fait je me suis pas peu renseigné mais je la connais à peu près donc personne se lavait et eh: ben on vidait eh la pisse dans les rues tout ça / donc eh l'hygiène c'était pas forcément ce qu'on a maintenant
ES1: oui heureusement↓ mais H je suis pas tout tout tout à fait d'accord avec l'idée que personne se lavait
El1-L: oui
El2-M: non
El1-L: eh les riches se lavaient
ES1: eh: je suis non plus pas tout tout tout à fait d'accord: M(prénom de l’élève):
El2-M: eh non: XX ils avaient pas beaucoup d'argent ils préféraient aller ailleurs XXX que dans l’entretien du corps
ES1: oui c'est ça↓ au moins / alors: je vous passe une petite vidéo de six minute vingt-cinq: qui traite de ce sujet-là↓ // (LCAE, 5-2/2, l.23-40)
Le visionnage de cette vidéo vise ainsi à modifier les représentations des élèves sur les pratiques hygiéniques du Moyen Âge. Toutefois, son contenu n’est pas mis en relation avec le texte étudié, que ce soit sur le plan du contexte référentiel ou des exigences du personnage principal en termes de propreté. Comme nous avons pu le montrer ailleurs (Boër 2023), cette séquence se caractérise par une dilution de l’objet enseigné dans une série d’activités diverses qui relèvent d’un modèle «lecture-prétexte» de l’enseignement, dans lequel la littérature constitue «un objet-ressource mis au service d’autres compétences jugées plus fondamentales et/ou plus utiles pour la vie sociale» (Dufays 2006: 82). La séquence sur Sobibor relève au contraire d’un modèle d’enseignement plus classique de la littérature. En outre, l’enseignante rappelle à plusieurs reprises à la classe sa volonté de les préparer pour le Secondaire II. Les portraits des auteurs présentés pour la «culture générale» des élèves participent de cet objectif par l’inscription de l’objet enseigné dans l’histoire littéraire, et par la construction de savoirs que les élèves auront à mobiliser dans leur future scolarité.
Conclusion
Envisagées comme un lieu de sémiotisation de la littérature scolarisée et enseignée, les relations texte-image analysées ici lors de la lecture en classe de fictions historiques pour la jeunesse accordent une part importante au référent, et attestent des finalités scolaires possibles de la lecture de ces textes.
Au niveau de la TD externe, l’image, dans le livre Sobibor, a une triple fonction: présenter un miroir à l’élève lecteur pour favoriser son implication, assurer le rôle de garant factuel de la description historique, et pointer la finalité mémorielle que l’auteur du texte revendique. Nous constatons, au niveau de la TD interne, une neutralisation du protocole de lecture déposé dans l’objet-livre pour ancrer résolument la réception en classe du texte du côté de l’enseignement de la littérature dans son paradigme classique, avec une focale d’abord sur l’Auteur, puis sur le contexte historique dans lequel s’ancre le récit. L’image est ainsi mobilisée en début de séquence, pour accompagner la découverte de l’objet enseigné, et le passage du genre au texte singulier.
Pour La Cour aux étoiles, l’édition choisie par l’enseignant tend à situer le texte du côté du conte et de la «lecture-plaisir» (Chartier & Hébrard 2000) c’est-à-dire une lecture de divertissement, qui n’a pas directement une fonction éducative, et n’est pas destinée à faire l’objet d’un enseignement. Ce modèle de la lecture-plaisir concerne des textes longs qui se lisent individuellement, et qui doivent «donne[r] aux enfant le goût de lire et leur offr[ir] les moyens de devenir de bons consommateurs culturels» (Chartier & Hébrard 2000: 355). Contrairement à Sobibor, la TD interne est ici principalement en continuité avec la TD externe, puisque l’image dans les supports vise avant tout à illustrer l’histoire (le récit) par une représentation figurative de l’Histoire. Notons toutefois la vidéo montrée par l’enseignant qui vient pointer des savoirs historiques sur l’hygiène médiévale.
L’articulation en continuité entre TD externe et TD interne ne va ainsi pas de soi, et le travail de l’enseignant en tant que création proprement originale, qui peut maintenir ou pas certains éléments de la TD externe est à souligner. Dans les deux séquences analysées, l’image ne sert que ponctuellement à aborder des savoirs historiques, elle est avant tout mobilisée pour assurer la réception du texte et l’insérer dans les dispositifs traditionnels de l’enseignement de la littérature. Face à un objet complexe comme le roman historique, «genre hybride, contraint, paradoxal, critiqué aussi» (Louichon 2016: 17), les outils de la discipline font preuve d’une résistance qui est à souligner. Nous relevons toutefois la nécessité de distinguer les différents statuts des images au niveau de la TD interne, notamment la source de l’illustration. En effet, de la même manière que le rapport au référent est déterminé par l’activité langagière du texte, le rapport au référent de l’image diffère en fonction de son origine. Notre analyse de la place de l’image dans cette contribution vient ici compléter et confirmer notre thèse d’un brouillage générique dans les pratiques d’enseignement en Français, qui se manifeste par l’importance du référent au détriment des dimensions langagières des textes. En outre, nous constatons que la prescription du PER de prendre en compte la forme éditoriale et le paratexte ne fait pas l’objet d’un pointage dans ces deux séquences.
Bibliographie
Aeby Daghé, Sandrine (2014), Candide, La fée carabine et les autres : vers un modèle didactique de la lecture littéraire, Berne, Peter Lang.
Ahr, Sylviane (2006), L’enseignement de la littérature au collège, Paris, L’Harmattan.
Boër, Diane (2023), Le roman historique en classe de Français. Du genre de texte à enseigner au texte lu en classe, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Boulaire, Cécile (2002), Le Moyen Âge dans la littérature pour enfants, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Bronckart, Jean-Paul (1996), Activités langagières, textes et discours, pour un interactionnisme socio-discursif, Lausanne, Delachaux et Niestlé.
Bronckart, Jean-Paul & Plazaola Giger, Itziar (1998), «La transposition didactique. Histoire et perspectives d’une problématique fondatrice», Pratiques, 97 (1), p. 35‑58.
Brunel, Magalie (2013), «La fiction historique de jeunesse et les « grands hommes » de l’Histoire : quels intérêts didactiques dans l’appropriation des savoirs en français ? Le cas Molière», Repères, n° 48, p. 223-240.
Cambier, Agnès (2013), «Enjeux mémoriaux et littéraires des fictions pour la jeunesse autour de la Shoah», Repères, n° 48, p. 51-68.
Chartier, Anne-Marie & Hébrard, Jean (2000) Discours sur la lecture : 1880-2000, Paris, Fayard.
Chartier, Roger (1985/2003), «Du livre au lire», in Pratiques de la lecture, Paris, Payot & Rivages, p. 81‑117.
Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage.
Conférence Intercantonale de L'instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (2012). Plan d’études romand, CIIP.
De Pietro, Jean-François & Schneuwly, Bernard (2003), «Le modèle didactique du genre : un concept de l’ingénierie didactique», Les Cahiers Théodile, n° 3, p. 27‑52.
Dufays, Jean-Louis (2006), «La lecture littéraire, des « pratiques du terrain » aux modèles théoriques», Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues, n° 33, p. 79-101
Finet, Béatrice (2018), «Rôles du personnage dans les romans historiques pour la jeunesse», Le français aujourd’hui, 201 (2), p. 119‑127.
Finet, Béatrice (2019), La Shoah racontée aux enfants, une éducation littéraire ?, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
Franck, Orianna (2017). A la recherche de l’archiélève lecteur à travers l’analyse du geste de planification : rôle des élèves dans les modifications de séquences d’enseignement, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature : la relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Houssais, Yvon (2011), «Représentations du Moyen Âge dans la littérature de jeunesse : clichés et ruptures (2000-2006)», In Médiévalités enfantines : du passé défini au passé indéfini, C. Cazanave & Y. Houssais (dir.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 157‑170.
Jaubert, Martine, Lalagüe-Dulac, Sylvie & Louichon, Brigitte (2013), «Les fictions historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières», Repères, n° 48, p. 7‑16.
Louichon, Brigitte (2016), «Introduction», In Fictions historiques pour la jeunesse en France et au Québec, B. Louichon & S. Brehm (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, p. 11‑20.
Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels : quelle(s) image(s) de la littérature?», in Enseigner la littérature en dialogue avec les arts : Confrontations, échanges et articulations entre approches didactiques, J.-C. Chabanne (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 159‑174.
Manson, Michel (2013), «Roman historique», in Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d’enfance et de jeunesse en France, I. Nières-Chevrel & J. Perrot (dir.), Paris, Editions du cercle de la librairie, p. 822‑825.
Petitjean, André (1998), «La transposition didactique en français», Pratiques, 97 (1), p. 7‑34.
Raimond, Anne-Claire (2018) «Fonctions et finalités didactiques du roman historique pour la jeunesse au collège», in Fictions médiévales pour la jeunesse, Y. Houssais (dir.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 133‑148.
Reuter, Yves (2004), «Analyser la discipline : quelques propositions», La Lettre de l’AIRDF, 35 (2), p. 5‑12.
Ronveaux, Christophe & Schneuwly, Bernard (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation : enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Schneuwly, Bernard (1995), «De l’utilité de la «transposition didactique», in Didactique du français : état d’une discipline, J.-L. Chiss, J. David, & Y. Reuter (dir.), Paris, Nathan, p. 47‑62.
Schneuwly, Bernard (2009), «Le travail enseignant», in Des objets enseignés en classe de français, B. Schneuwly & J. Dolz (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 29‑44.
Schneuwly, Bernard, Dolz, Joaquim & Ronveaux, Christophe (2006) «Le synopsis : un outil pour analyser les objets enseignés», in Les méthodes de recherche en didactiques : actes du premier séminaire international sur les méthodes de recherches en didactiques de juin 2005, M.-J. Perrin-Glorian & Y. Reuter (dir.), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 175‑189.
Schneuwly, Bernard & Ronveaux, Christophe (2021), «Une approche instrumentale de la transposition didactique», Pratiques, n° 189‑190. https://doi.org/10.4000/pratiques.9515
Thaler, Danielle, & Jean-Bart, Alain (2002), Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, roman d’aventures, Paris, L’Harmattan.
Thévenaz-Christen, Thérèse & Leopoldoff, Irina (2014), «Les supports d’enseignement de la lecture et leurs entours», in La lecture enseignée au fil de l’école obligatoire : l’exemple genevois, T. Thévenaz-Christen (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 170‑212.
Védrines, Bruno (2020), «Enseignement de la fiction et connaissance», Recherches, n° 72, p. 47‑63.
Pour citer l'article
Diane Boër, "Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français ", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/place-s-et-fonction-s-de-l-image-dans-la-lecture-de-fictions-historiques-pour-la-jeunesse-en-francais
Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message
Comment ne pas appauvrir l’expérience du rapport à l'image dans un enseignement de littérature attentif à l'expression verbale?
Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message
Introduction
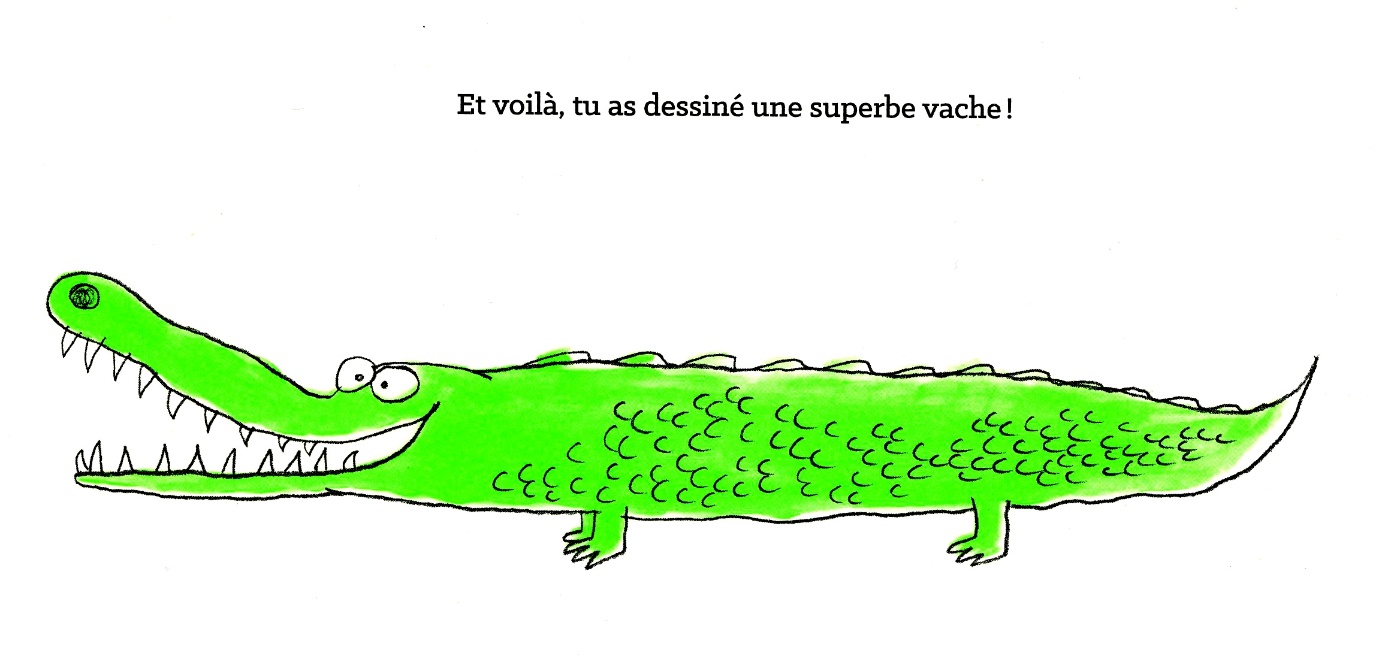
Figure 1: Extrait de Rice & Badel (2015) Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache
Comme le montre la Figure 1, les objets littéraires considérés dans cette contribution ne sont pas des textes accompagnés d’illustrations mais présentent une littérarité conjointement portée par un texte et une ou plusieurs images (Mitchell, 2013; Tauveron, 1999 & 2000). Construits sur le concept d’iconotexte (Nerlich, 1990), ces récits se composent de manière indissoluble de texte(s) et d’image(s) qui, par leur confrontation, mettent en tension de manière dynamique deux modalités sémiotiques sans les confondre (Montandon, 1990). En dirigeant l’attention vers le récit, les images comme les textes y dénotent leurs objets par leur coprésence (Peirce, 1997; Lefevre, 2011). Enseigner la lecture, la compréhension et l’interprétation d’un récit iconotextuel suppose ainsi de considérer à parts égales le rôle du texte et des images dans la production de sens.
En raison de l’organisation disciplinaire de l’institution scolaire liée au morcèlement des savoirs, l’image qui coconstruit un récit de manière multimodale trouve difficilement sa place dans les modélisations didactiques (Leclaire-Halté, 2008; Lépine, 2012; Lacelle et al, 2017; Lebreton Reinhard & Aubert, 2022). Lorsque l’image est prise en compte, c’est dans le rapport qu’elle entretient avec le texte qui reste le prisme par lequel l’enseignant·e est invité·e à utiliser ces supports.
La réflexion placée au centre de cette contribution s’appuie sur une approche sémiologique de ces objets littéraires pour en proposer une transposition didactique. L’enseignement-apprentissage de la littérature à l’école relevant majoritairement du travail du sens (Falardeau, 2003), l’approche sémiologique permet de partir de la réception du message et donc du sujet-lecteur pour élaborer un dispositif didactique.
L’anthropologie du sens (Michel, 2017) dissocie la compréhension de l’interprétation et permet de clarifier une confusion courante dans l’enseignement de la littérature (Falardeau, 2003). L’interprétation constitue cette compréhension différée lorsque le sens ne se donne pas spontanément. Dans le cas du récit iconotextuel, l’activité de compréhension dégage le potentiel sémantique et sémiotique de chaque modalité alors que l’activité d’interprétation, par la mise en relation du potentiel de chaque registre sémiotique, recontextualise la tension dynamique qu’ils génèrent à l’échelle du récit. Or les caractéristiques différentes de ces deux médiums mis en coprésence complexifient une lecture alors plurisémiotique (Kress, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2006) et posent des défis à l’enseignement de cette littérature. Le sens issu de la combinaison d’un texte et d’une image générant une tension dynamique au niveau sémiotique, la coconstruction est laissée au sujet-lecteur-récepteur qui n’a d’autre choix que de considérer l’ensemble des signes (Mitchell, 2013). L’approche disciplinaire, donc «par le texte», conduit ainsi à un décalage entre l’enseignement et la réception individuelle du récit (Leclaire-Halté, 2008).
En se basant sur une expérience menée grâce à la collaboration d’enseignant·es, de chercheur·euses et de didacticien·nes, la présente contribution rappelle le rôle de l’image sur la fabrication de sens en contexte narratif et propose un dispositif didactique. Le développement d’un outil testé par des enseignant·es dans le canton de Neuchâtel en Suisse dans les dispositifs des «Lecture-philo» entreprend de faire de la complexité des supports littéraires iconotextuels un levier pour travailler le rapport à soi et à l’autre. En effet, le champ de l’interprétation permet et oblige même le sujet-lecteur à négocier et renégocier cette signification complexe coconstruite par un texte et des images, ces dernières pouvant, «comme le texte, faire l’objet d’interprétations erronées (Tauveron, 2002: 49)».
Issus du courant anglosaxon des Social semiotics (Jewitt, 2011), l’approche multimodale des supports actuels permet de donner une place à la sémiose individuelle, entendue comme ce processus dynamique de signification impliquant le signe, son objet et son interprétant·e (Peirce, 1997), en dépassant l’approche verbocentrée. Le travail conjoint de l’image et du texte en contexte narratif est ici envisagé comme un outil au service du développement d’une compétence essentielle en didactique de la littérature: comprendre qu’on a compris.
Cadre théorique et problématisation
Nous nous centrons ici sur l’enseignement-apprentissage de la lecture d’un objet littéraire composite car construit sur l’interdépendance du texte et de l’image. Tous les supports composés de textes et d’images ne constituent pas des iconotextes. Si l’image joue un rôle sur la production de sens de par sa seule présence, le sens de l’iconotexte est conçu comme coporté par les deux registres sémiotiques. En littérature jeunesse, le terme album est utilisé pour qualifier ce type de récit à la complexité singulière puisque les images n’y occupent pas une fonction illustrative (Nerlich, 1990; Tauveron, 2000). Particulièrement proliférante et/ou résistante (Tauveron, 2000), la signification de ces images repose sur la combinaison de plusieurs signes aux caractéristiques intrinsèques différentes. Dans une perspective peircienne (Peirce, 1997) et multimodale (Kress, 2010), cette combinaison ouvre un espace de signification qui contraint une renégociation permanente du sens dont la temporalité permet d’y voir s’immiscer le connu et le vécu. La coprésence du texte et de l’image engendre une production mentale relevant de l’expérience sensible et intellectuelle (Bordron, 2011). En catégorisant les différences et les similitudes entre le texte et l’image, le sujet-regardant mobilise l’ensemble de ses connaissances et de ses expériences, expliquant la diversité des interprétations possibles des images (Rabatel, 2022).
Nos récentes recherches sur le rôle de l’image en contexte narratif (Lebreton Reinhard & Attanasio, 2022; Lebreton Reinhard & Aubert, 2022; Lebreton Reinhard & Azaoui, sous presse; Lebreton Reinhard & Kohler, 2023) montrent que l’activité de lecture d’un album commence par les images, notamment en raison de notre aptitude supérieure à traiter l’information visuelle (Gibson, 1950; Haupt & Huber, 2008). L’image, qui ne se décode pas, constitue ainsi la première voie d’accès au récit, voire la seule avant l’entrée dans l’écrit des élèves.
Les compétences littéraciques attendues chez le sujet-lecteur doivent donc lui permettre de prendre en charge de manière autonome les modalités verbales et visuelles puisque c’est dans leurs relations que le sens se construit. L’image, par la rapidité de sa perception, reste une opportunité pédagogique puisqu’elle offre au jeune sujet-lecteur le pouvoir d’accéder au récit même partiellement alors que les études démontrent que l’adulte s’en remet prioritairement au texte pour construire sa compréhension (Hétier, 2015; Leclaire-Halté, 2008).
Si de nombreux·ses auteur·ices maintiennent un flou conceptuel entre les termes compréhension et interprétation, voire les utilisent comme synonymes (Falardeau, 2003), l’anthropologie du sens (Michel, 2017) distingue les deux en considérant l’interprétation comme une compréhension différée lorsque le sens ne se donne pas spontanément. Dans le cas du récit iconotextuel, l’activité de compréhension peut ainsi permettre de saisir chacune des modalités dans son potentiel sémantique et sémiotique alors que l’activité d’interprétation vise la mise en relation de ces modalités et donc la recontextualisation de leurs relations à l’échelle du récit. Si la sémiose fonctionne de manière systémique et dynamique avec les signes qui s’offrent à elle, parvenir à décomposer le sens potentiel du texte et de l’image dans une étape de compréhension avant de les mettre en relation pour faire des choix dans le contexte du récit lors de l’interprétation permet au processus d’enseignement-apprentissage de transmettre des connaissances et des compétences littéraciques complexes.
Comme le montre la Figure 1, le verbal ne permet pas de saisir que l’animal dessiné est un crocodile ou que le texte s’adresse à un·e destinataire qui n’a pas dessiné une vache. Toute abstraction du texte ou de l’image supprime ici de facto l’accès au message: «Ce que tu as dessiné, c’est un crocodile!». La coconstruction du sens est laissée au sujet-lecteur qui doit négocier la signification pour produire le sens. Conjointement, c’est dans cette activité de construction du sens que se situe l’esthétisme littéraire voire l’expérience esthésique permise par la combinaison lorsqu’on comprend qu’on a compris. Didactiquement, que faire ici de l’image qui non seulement contredit le texte mais pilote le message? Comment dépasser l’identification du crocodile par l’observation?
L’image, porteuse d’un message propre, est énonciative. Passée l’identification d’un crocodile par analogie au connu, comment signifie-t-elle ce crocodile? Que disent du crocodile signifié la forme, la couleur, la position, le cadrage, l’interaction avec le spectateur, etc.? Pour les théoriciens de l’image (voir par exemple Emmanuel Alloa, Max Imdahl, Groupe Mu, Georges Didi-Hubermann, Jean-François Bordron), l’image trouve son sens dans la manière dont elle nous donne à voir ce qu’elle nous donne à voir. Par conséquent, elle s’analyse, notamment dans la manière dont elle traduit le monde et interagit avec le sujet-regardant (Alloa, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2006). En qualité de «traduction», son approche verbale est inévitable mais ne doit en aucun cas appauvrir l’expérience qu’elle représente. En effet, l’image ne dispose pas de caractéristiques alphabétiques, elle ne se décode donc pas; elle n’a pas d’équivalence verbale et ne pourra donc jamais être totalement restituée par la langue.
L’image à laquelle nous nous intéressons est une image particulière puisque dans un récit iconotextuel, l’image n’est image que dans le contexte narratif dans lequel elle s’inscrit. Elle n’a aucune existence propre – le texte non plus d’ailleurs – et, si elle peut et doit être prise en charge vu le rôle qu’elle joue dans la construction de sens, elle demeure inséparable du texte. Si les disciplines des arts visuels et des sciences de la communication nous fournissent une partie des outils pour aborder l’image, ces derniers ne sont pas suffisants ici puisqu’en arts visuels comme en histoire de l’art, l’image constitue une fin en soi, en création comme en réception. La discipline s’attache à la signification DE l’image et non la signification PAR l’image. Dans l’objet littéraire considéré ici, l’image est au service d’une narration, participe de la matérialité du récit et est donc médiatrice du message. Si la part verbale du récit est prise en charge par la didactique du français, la part iconique trouve difficilement sa place dans le cloisonnement disciplinaire de l’enseignement. La prise en charge didactique et pédagogique des images en contexte narratif fait ainsi défaut dans les pratiques actuelles, avec les conséquences que pointent Leclaire-Halté (2008), Lépine (2012), Lacelle et al. (2017), Lebreton Reinhard & Aubert (2022): l’approche par la langue écrite uniquement est inadaptée aux caractéristiques de l’album.
La prise en charge de l’image se limite au rapport qu’elle entretient avec le texte selon la typologie établie par Van der Linden (2006), dans des tâches qui ne permettent pas de considérer comment l’image signifie ce qu’elle signifie. Cette prise en charge demeure donc verbocentrée. Van der Linden (2008) elle-même, dont l’approche n’a pas une vocation directement didactique, montre les limites de sa typologie en analysant la variabilité des relations qu’entretiennent le texte et les images dans les supports littéraires iconotextuels au regard du rôle complexe que jouent les images.
Par conséquent, comment dépasser la monstration des images par l’enseignant·e pour travailler le récit iconotextuel dans toute sa complexité? Quels outils mobiliser pour accompagner le processus d’interprétation propre aux albums? Que travailler dans les albums dès lors qu’ils convoquent autant de prérequis iconiques, culturels, langagiers, accordent une telle confiance au sujet-lecteur et laissent une telle liberté interprétative?
C’est à ces questions que le matériel présenté dans la partie suivante a cherché à répondre.
Méthodologie
Dans le but de proposer une prise en charge didactique des objets littéraires iconotextuels qui permette de respecter leurs caractéristiques et d’utiliser leur potentiel pédagogique, une communauté de pratiques a été créée pour concevoir du matériel d’accompagnement de livres mis à disposition en série dans les médiathèques des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel en Suisse. Cette communauté de pratiques réunit des enseignant·es, des chargé·es de missions du service de l’enseignement du canton de Neuchâtel pour la scolarité obligatoire (cycles 1, 2, 3) et les autrices en qualité de chercheuse et didacticienne du français. Pour chaque livre, le matériel d’accompagnement est conçu collectivement et testé par les enseignant·es des cycles concernés, modifié au besoin, puis publié aux éditions de la HEP-BEJUNE dans une collection intitulée «Lecture-philo».
Dans un objet littéraire iconotextuel, la tension dynamique générée par la coprésence de deux registres sémiotiques induit une forte implication personnelle du sujet-lecteur en raison de la production de sens qui lui incombe. L’enseignement doit ainsi permettre d’utiliser le support pour ses caractéristiques narratives en développant tout d’abord la compréhension puis l’interprétation iconotextuelle. Notons qu’un support littéraire comme l’album appelle davantage d’interprétation qu’un support fonctionnel qui en raison de sa visée utilitaire doit être compris le plus directement possible (Simard, Dufays, Dolz & Garcia-Debanc, 2010: 232).
Cette implication du soi, du rôle des représentations et des références personnelles permet en outre le développement de compétences du sujet-lecteur en formation générale. Une telle perspective confère ainsi à la démarche pédagogique une visée largement transversale.
Une première thématique, très ancrée dans l’actualité scolaire et constituant ainsi une problématique à la fois individuelle et collective, a fait l’objet des deux premières années de travail collaboratif: «le harcèlement». Pour couvrir les trois cycles de la scolarité obligatoire (1, 2, 3), trois albums ont été choisis:
-«Rouge»1 est le récit d’un enfant qui, sur la base d’une remarque anodine, se retrouve stigmatisé et harcelé pour sa timidité rendue visible par ses joues continuellement rouges;
-«Un renard dans mon école»2 est le récit d’un élève qui voit l’arrivée d’un camarade dans son école. Ce camarade le harcèle et, à mesure que ses intimidations se développent en nombre et en type, prend la forme d’un renard puis d’un loup puis d’un tigre;
-«Corrida»3 est le récit d’une situation de harcèlement visible uniquement dans les images et coconstruit par un texte vantant la manière de faire une corrida.
Ces trois albums sont des récits coconstruits par le texte et les images. Pour en permettre une exploitation pédagogique, chaque matériel propose un ensemble de cinq séances. Quatre d’entre elles sont dévolues à la compréhension et l’interprétation de l’album et la cinquième est systématiquement consacrée à la tenue d’une discussion à visée philosophique sur la thématique du harcèlement.
Pour enseigner la compréhension et l’interprétation, les activités ciblent le texte, les images et leur combinaison iconotextuelle. L’enseignement se fait de manière explicite. Chaque séance débute par la présentation de l’objectif aux élèves et un rappel des stratégies de compréhension à mobiliser (CIIP, 2023). La séance se termine par un temps de rétroaction, au cours duquel l’enseignant·e reprend oralement le déroulement des tâches, puis institutionnalise les savoirs. Pour la discussion à visée philosophique, les élèves apprennent à formuler un avis critique, à se décentrer et à développer leur compréhension du monde et de l’altérité. En supplément des objectifs disciplinaires du Plan d’Études Romand ancrés en français dans les axes thématiques Compréhension de l’écrit et Accès à la littérature, le matériel permet de travailler la compréhension et l’interprétation de l’image en contexte littéraire.
Selon l’approche multimodale, nous proposons d’utiliser les outils développés par Kress et Van Leeuwen (2006) sur l’image en contexte plurisémiotique. Leurs travaux empiriques étayent la signification par l’image et les données produites montrent que toutes les composantes de l’image jouent un rôle sur le sens à construire: les formes dominantes, les lignes de force, la circulation du regard, les personnages, les actions et les réactions, les couleurs, la lumière, la profondeur, l’énonciation visuelle, l’interaction avec le spectateur, le cadrage, la profondeur, l’iconicité, la mise en scène, le champ et le hors-champ, les références culturelles et visuelles, etc.
Le travail du texte propose, lui, d’utiliser les outils fondamentaux sur le genre textuel dans la mesure où «comme outil d’enseignement, le genre fixe des significations sociales complexes» (Dolz & Gagnon, 2008). Dans un album ou sur tout autre support, un texte possède des caractéristiques qui sont identiques à celles d’autres textes qui ont été rédigés selon les mêmes dimensions: visée, situation de communication, principes communicatifs, réalisation matérielle, contenu, structure et textualisation/langue. Dans la mesure où, comme tout objet de recherche, les débats sur le concept de genre restent ouverts, les outils mobilisés pour leur identification ont volontairement été sélectionnés dans une référence romande, les «modèles didactiques des genres textuels», qui servent actuellement de socle à une partie des nouveaux moyens d’enseignement du français (Conti et al., 2022).
La prise en charge didactique d’un support narratif iconotextuel
Si l’image est perçue très rapidement, à la différence du texte, cette apparente accessibilité immédiate dessert son caractère interprétable. Nous proposons donc, pour «ralentir» sa signification, d’étapiser son approche didactique en respectant la distinction essentielle entre les activités de compréhension et d’interprétation (Falardeau, 2003). La compréhension est l’étape qui suit le décodage du texte, réorganise les informations pour les rendre intelligibles. Ce travail débouche sur la capacité à reformuler ce qui a été saisi par les sens. L’interprétation quant à elle est la direction que le sujet décide de prendre et qu’il pourra justifier. C’est d’ailleurs dans cette aptitude à la justification qu’il faudra concentrer la tâche de l’enseignement puisque le sens de l’album est à construire par la coprésence de texte(s) et d’image(s) et ne peut donc jamais être entièrement validé. Si la tradition herméneutique a toujours placé l’interprétation comme postérieure à la compréhension car plus complexe, le processus est dynamique, de surcroit lorsqu’il s’agit de combiner texte et image, et le sujet-lecteur négocie et renégocie en permanence le sens donné aux différentes composantes du message lors de la remise en contexte à l’échelle du récit.
Le dispositif décrit ci-après travaille l’album Corrida, illustré et écrit par Yann Fastier.



Figure 2: extraits de l’album Corrida de Yann Fastier
L’album (Figure 2) présente une succession d’images relatant une situation de harcèlement mise en présence d’un texte vantant la manière d’organiser une corrida, pratique culturelle espagnole mettant en scène un homme et un taureau qui s’affrontent jusqu’à la mort de l’animal.
L’enjeu de compréhension principal de l’album Corrida provient du rapport discontinu (Lebreton Reinhard & Aubert, 2022) entre le texte et les illustrations. La dureté et la violence du message destine la séquence à des élèves de 9e année - cycle 34.
Séance 1: Les élèves sont tout d’abord amenés à découvrir le titre, par étapes, sans voir l’album. Tout le travail sur le champ lexical de la corrida mène ensuite à des activités permettant de définir le concept de corrida.
Séance 2: Suite à la consolidation du concept de corrida via des tâches textuelles, les élèves découvrent la première et la quatrième de couverture de l’album. Il leur est proposé d’observer et analyser la typographie du titre. À ce stade débute le travail sur les illustrations, processus dynamique structuré en 4 étapes: observer, décrire, analyser et interpréter. Cette prise de contact est menée par l’enseignant·e qui guide les élèves, par ses consignes: Observez attentivement la première et la quatrième de couverture et répondez à la question «Que peuvent ressentir ces deux personnages?». Pour vous aider à répondre, une liste d’émotions est proposée. Sélectionnez-en deux au minimum et reportez-les dans la colonne correspondante». Observez la façon dont le titre est écrit. Que pouvez-vous en dire?
Le document destiné à l’enseignant·e liste des réponses possibles afin de faciliter les régulations interactives lors des échanges: Écriture difficile à déchiffrer. Lettres pas ajourées. «Corrida» fait immédiatement penser à la tradition espagnole de la tauromachie qui est un sujet controversé et chargé d'émotions. Rien qui évoque l’Espagne, à part la couleur jaune. Le C et le A de «Corrida» font penser à des cornes (cornes du taureau). Violet qui reprend la couleur de la cape du torero.
À chaque étape du dispositif, les élèves sont en mesure de justifier leurs interprétations. Afin de permettre l’engagement de chacun·e dans des tâches concrètes, les élèves remplissent par exemple un tableau dans lequel, pour chacune des deux illustrations de 1re et 4e de couverture, ils et elles doivent associer des émotions aux personnages dans la 1re colonne et justifier leur choix en 2e colonne en listant les éléments des illustrations. L’enseignant·e dispose du tableau rempli (Figure 3) afin de faciliter le travail de régulation en cours d’action.
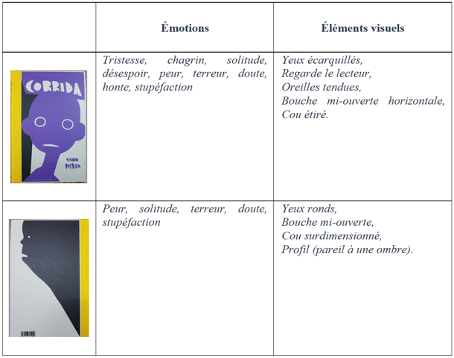
Figure 3: extrait du guide de l’enseignant·e
La suite consiste à émettre des hypothèses sur le possible contenu de l’histoire, par écrit, après que les stratégies de compréhension mobilisées depuis la 1re année ont été rappelées.
L’enseignant·e épingle les affiches du Moyen d’enseignement romand (MER) comme références pour la suite (Figure 4).
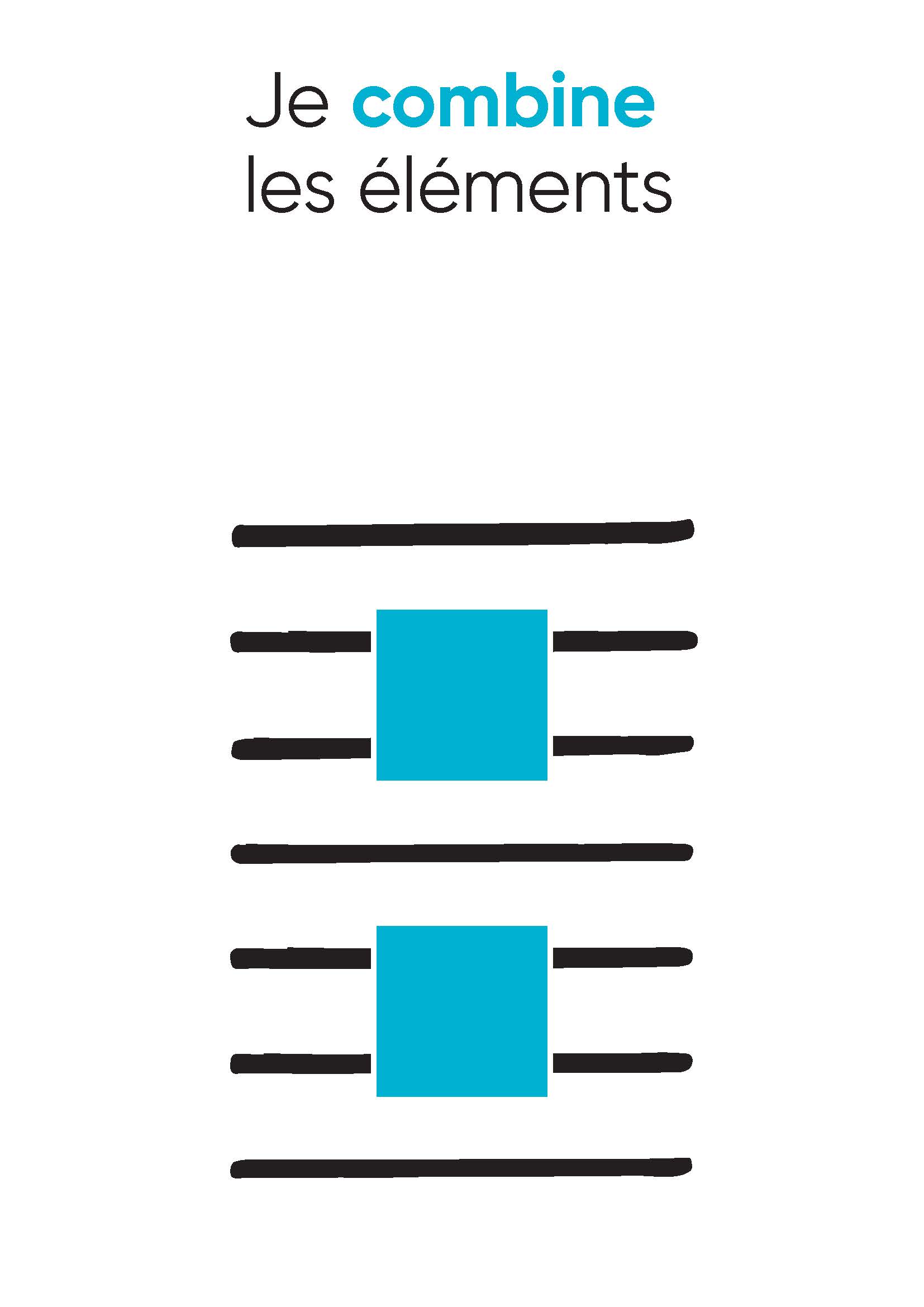


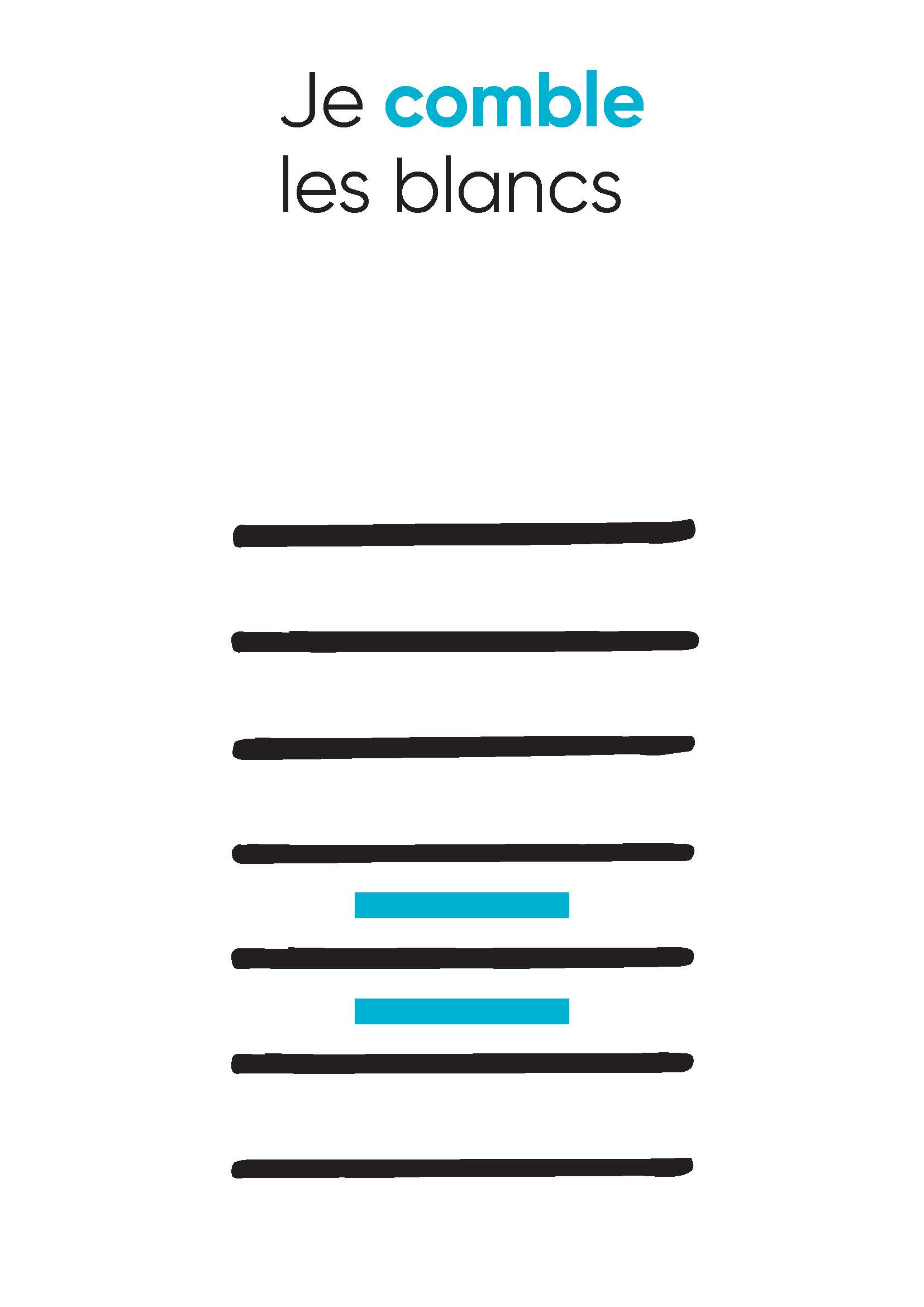

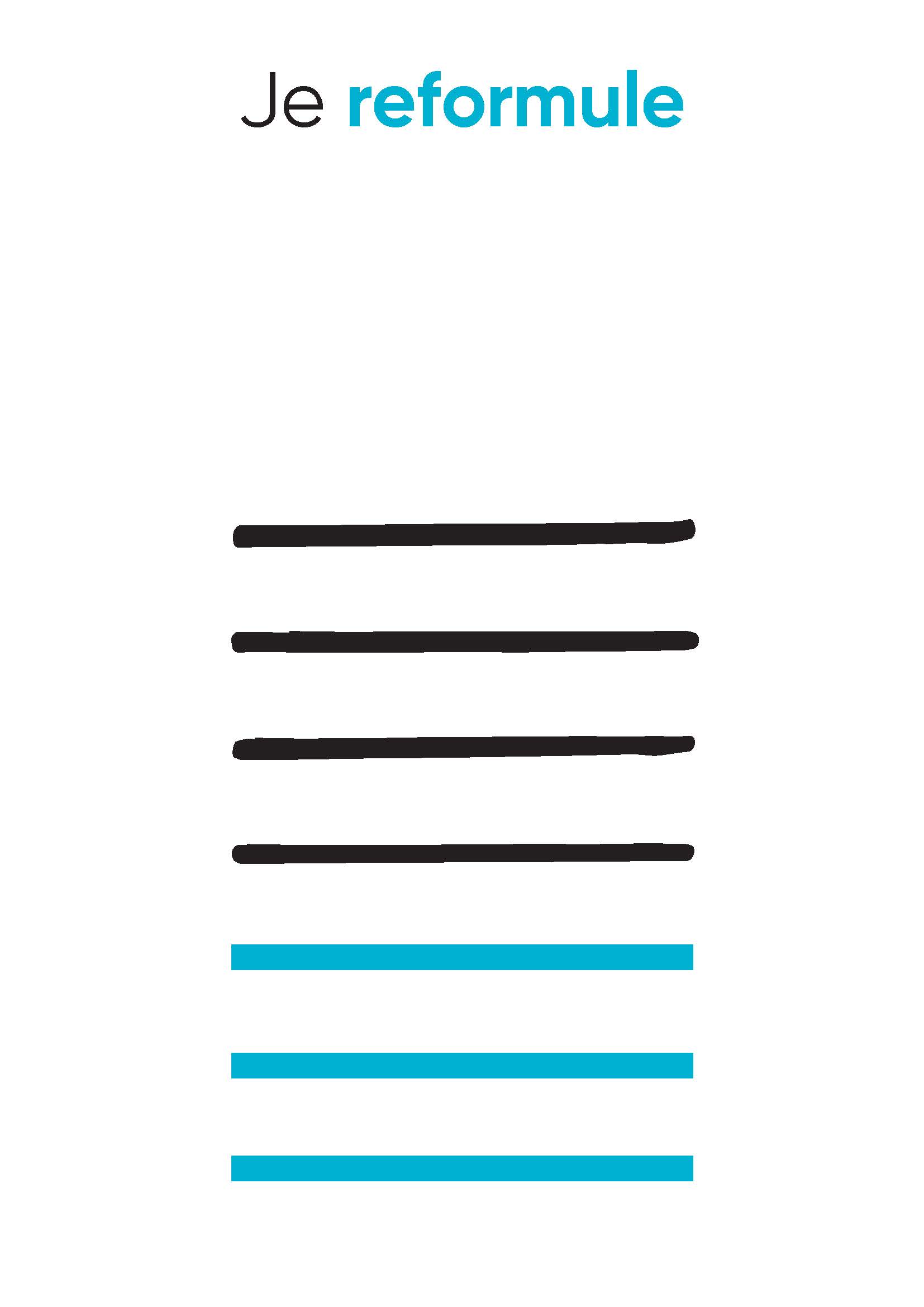
Figure 4: extrait des affiches des stratégies de compréhension du MER
Chaque séance se clôt par des rétroactions sur les procédures des élèves et le recours aux stratégies. Pour cette séance 2, l’enseignant·e est guidé vers des exemples de rétroactions:
- Lors de cette séance, vous avez observé attentivement tous les éléments présents sur la première et quatrième de couverture afin de les combiner avec des termes qui peuvent leur être associés.
- Vous avez sélectionné certaines propositions, jugées pertinentes et en adéquation avec les éléments visuels et vous en avez en écarté d’autres.
- Etc.
Séance 3: les élèves vont découvrir l’album complet, en partant d’abord du texte qu’ils et elles reçoivent sur un document séparé. Il est précisé que les images vont leur être montrées ensuite. Pour décomposer le processus, les modalités textuelle et visuelle sont traitées séparément pour faciliter l’accès à l’analyse:
Pour faire une corrida, il faut une arène et des gens,
un matador et ses assistants,
et un taureau.
Les assistants excitent le taureau…
le fatiguent.
Le sang ne tarde pas à couler.
Pour le matador, c’est le moment d’entrer en scène.
C’est le moment pour lui de montrer son habileté, et son courage.
Parfois, l’animal parvient à se défendre…
Mais le plus souvent, tout finit par la mise à mort.
Le fait qu’un texte singulier présente des caractéristiques communes à d’autres textes produits dans des situations similaires permet son repérage comme exemplaire d’un genre (Dolz & Gagnon, 2008). À ce stade, en l’absence des illustrations, l’hypothèse la plus probable après cette première rencontre avec le texte mène à l’identification d’une sorte de guide pour réussir une corrida, un texte appartenant au regroupement des genres de textes dont la visée est de régler des comportements, «de dire comment faire».
Une comparaison du texte de Corrida est faite avec une recette de Pain maison pour guider la réflexion sur les différences de visées. Les élèves ont pour tâche d’essayer de reformuler les deux textes au moyen d’un résumé en commençant par: C’est l’histoire de…
Si le texte de Corrida peut se résumer ainsi: «C’est l’histoire d’une corrida qui implique un taureau ainsi qu’un matador et ses assistants qui vont mettre à mort l’animal pour faire spectacle», le texte de la recette Pain maison ne peut pas se résumer en commençant par C’est l’histoire de.
Chaque élève reçoit alors l’album et est invité·e à le lire d’une traite avant de participer à une discussion collective permettant de faire émerger le fait que le texte ne parle pas d’une réelle corrida. Les élèves réalisent que les premières activités vécues en classe sur le concept de corrida les ont mené·es sur une fausse piste.
Comme lors de la séance 2, un travail est mené sur les ressentis face aux illustrations seules puis face au message iconotextuel de l’album. Le processus d’analyse des images à travers les 4 étapes sera spécifiquement mis en œuvre dans la séance 4.
La rétroaction de cette séance permet à l’enseignant·e de formaliser avec ses élèves que le choix d’un genre textuel apparemment non narratif pour ce qui est bien une narration à l’échelle du récit iconotextuel est délibéré et vise à faire réagir les sujets-lecteurs:
- Vous avez constaté que le texte de Corrida peut être résumé en quelques phrases, alors qu’un texte qui règle les comportement (Pain maison) ne peut pas être résumé en raison de sa nécessité à transmettre des détails précis et des étapes spécifiques si on veut pouvoir confectionner le pain.
- Le genre est un choix de l’auteur. Habituellement, à lui seul, le genre fournit des informations qui guident le sujet lecteur en l’aidant à anticiper sur le contenu et le but du texte. Ici, l’auteur a volontairement fait ce choix «multigenre» pour nous mener sur une fausse piste et nous forcer à réagir.
L’interaction des images et du texte qui permet d’accéder au message est formalisée également:
- En plus du genre littéraire, vous avez constaté que les images jouent un rôle crucial dans la compréhension d’un album. Illustrations et texte font passer un message dans lequel l’auteur cherche à susciter des émotions chez son public.
- En associant les images et le texte, vous avez vécu une expérience de lecture plus immersive. Dans le cas présent, vous avez réalisé que le personnage qui joue le rôle du taureau représente en réalité une victime de harcèlement. En parcourant l’album en entier, vous avez ressenti des émotions plus ou moins fortes.
Séance 4: l’analyse des doubles-pages se fait de manière approfondie, dans le but de développer chez les élèves des outils pour observer et comprendre des illustrations de manière critique.
Pour saisir ce processus dynamique, nous proposons de travailler en quatre étapes successives avec les élèves. Les deux premières portent sur la compréhension et les deux suivantes sur l’interprétation. Si le respect de la temporalité du processus permet de décomposer l’analyse pour y ancrer connaissances et compétences chez les élèves, chaque étape peut requestionner la précédente puisque la tension générée par les deux registres sémiotiques décuple la (re)négociation du sens du récit. Le travail d’analyse s’appuie sur un processus d’objectivation visant l’identification, la formulation d’hypothèses, la sélection et la proposition de signification argumentable.
Étape 1: observer
La pratique, toute évidente et naturelle qu’elle parait, demande du temps. Il faut donc accorder aux élèves du temps pour observer l’image avec rigueur, comme le ferait un·e scientifique devant son microscope qui, grâce au seul regard, devient spécialiste de ce qu’il ou elle a vu. Car l’observation désigne l’action de porter consciemment attention à l’objet de l’observation dans le but d’accroitre sa connaissance. Aucun critère ni aucune consigne n’oriente cette étape qui doit rester la plus ouverte possible.
Étape 2: décrire
La description, seconde étape de la compréhension, est une traduction verbale de l’observation. Si elle constitue une réduction de l’observation puisque l’image ne peut avoir d’équivalence verbale stricte, elle permet de consigner dans le détail tous les choix faits par l’illustrateur. Pour ritualiser la pratique, les élèves peuvent être invité·es à faire l’inventaire de tout ce qu’ils et elles voient comme le ferait un·e détective qui ne sait pas encore ce qu’il ou elle cherche.
Sur la base de cet inventaire, les élèves mobilisent leurs connaissances pour qualifier objectivement chaque élément observé. Ici, l’enseignant·e accompagne la réflexion en proposant de décrire les formes, les lignes, les personnages, ceux qui agissent et ceux qui réagissent, les couleurs, la lumière, la profondeur, qui ou que regardent les personnages, le cadrage, la profondeur, les ressemblances et les différences avec des images connues et reconnues, la mise en scène, ce qui est visible et ce qui est supposé, etc.
Étape 3: analyser
C’est la première étape de l’interprétation. Elle s’appuie sur les deux opérations précédentes et vise à mettre en relation les éléments observés, inventoriés, qualifiés. Cette mise en relation suppose de sélectionner les composantes de l’image qui, prises ensemble, produisent du sens. C’est également l’étape à laquelle les connaissances référentielles sont mobilisées, notamment pour expliquer la mise en relation des éléments. La visée didactique principale de cette étape est d’ailleurs la justification par les élèves de ce qu’ils et elles avancent, justification qui permet de mobiliser les deux étapes précédentes et d’apporter les connaissances référentielles, de les actualiser si elles existent.
En fonction du degré de complexité des images ou de l’exercice de mise en relation, l’enseignant·e peut renverser l’approche en demandant aux élèves de modifier chacune des composantes identifiées de l’image pour vérifier si la signification proposée reste la même. Cette approche dialogique favorise le questionnement chez l’élève et développe sa conscience critique. Par exemple, sur la figure 2, si le personnage en noir était proportionnellement plus petit que l’autre personnage, la signification de la scène serait-elle la même? Si le personnage qui tient un couteau regardait le spectateur, la signification de la scène serait-elle la même?
Étape 4: interpréter
C’est l’étape de la recontextualisation dans le récit, de la formulation d’hypothèses et de la proposition de signification. L’interprétation est une création du sujet-lecteur qui va au-delà du support original. Toute proposition n’est valable que justifiée grâce à tout ce qui est connu sur la double-page concernée et dans l’ensemble du récit, grâce au texte ET aux images. Le mécanisme de l’inférence abductive est ici mobilisé puisqu’il s’agit pour les élèves de créer des hypothèses explicatives pour parvenir, par déduction, à une conclusion concordante dans la combinaison du texte et des images.
C’est également l’étape de (re)mobilisation du texte signifiant directement relié à l’image considérée mais également de toutes les informations narratives cumulées jusque-là.
L’analyse du texte offre le même potentiel sémantique d’exploration des significations. En mobilisant ses connaissances et en repérant les pensées des personnages, le sujet-lecteur peut lever les inférences liées à la fausse piste du genre textuel et la visée réelle de l’auteur. Le travail mené en amont sur le lexique spécifique et le concept de la corrida permet de mettre en relation ces connaissances nouvellement acquises et la voie sur laquelle la modalité textuelle veut nous emmener: on nous RACONTE quelque chose sur un ton neutre et coupé de la situation d’énonciation.
La confrontation de l’analyse de l’image avec le texte permet de qualifier le rapport qu’entretiennent certains éléments verbaux avec certains éléments iconiques. Cette relation n’étant pas applicable à l’ensemble d’un récit iconotextuel ou même d’une double-page, cette étape de comparaison des informations fournies par le texte à celles fournies par l’image permet de requestionner l’étape de l’analyse et les significations possibles de l’image comme du texte. Cette renégociation offre l’opportunité de questionner les hypothèses proposées pour chaque modalité et de travailler la justification puisque l’ensemble de l’analyse aura permis de décomposer l’image comme le texte en autant d’éléments pouvant fonder les propositions de signification.
Pour rendre concret notre propos, nous proposons de partager une partie du matériel d’analyse des images élaboré pour travailler l’album Corrida de Yann Fastier.
L’analyse de l’album Corrida, qui avait fait l’objet d’une publication (Lebreton Reinhard & Richard, 2020), a permis d’arrêter le choix de trois objets de savoirs pour leur rôle particulièrement significatif dans la construction et la progression du récit:
- - L’énonciation visuelle ou le rôle confié au sujet-lecteur par les images
- - La matérialité du récit ou le rôle joué par les formes, les couleurs et les matières de l’album
- - La topographie des doubles-pages ou la mise en scène visuelle du récit
Pour chacun, les quatre étapes font l’objet de pistes de travail avec les élèves dont nous restituons des extraits.
L’énonciation visuelle ou le rôle confié par les images au sujet-lecteur:
Exemple 1
Pour l’étape d’observation, c’est la première de couverture qui est choisie (Figure 2.1).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier la forme particulièrement schématique; le faible nombre de couleurs; l’absence de profondeur et la distance créée avec celui qui regarde; la position, la composition et l’expression du visage.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever le minimalisme de la composition; l’absence de relief; le visage rond aux traits enfantins et en deux dimensions; les yeux écarquillés, les oreilles tendues, la bouche mi-ouverte horizontale, le cou étiré; le cadrage serré, la proximité avec le regard du sujet-lecteur; la peur et le danger qu’évoquent l’ensemble.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à se sentir regardés en tant que sujet-lecteur, à se questionner sur le rôle attendu du sujet-lecteur interpellé par le personnage dont tous les sens (ouïe, vue) sont en alerte.
Exemple 2
Pour l’étape de l’observation, c’est la double-page 1-2 qui est choisie (Figure 2.2).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier la position des personnages; la diversité de genres, de physique et les critères d’identification; les regards, les bouches, les oreilles, les expressions; les plans et la profondeur; les vides et les pleins.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever le minimalisme de la composition; les visages ronds aux traits enfantins et en deux dimensions; les filles aux cheveux longs et les garçons aux cheveux courts; la couleur noire de l’ombre, du taureau, symbole de la mort et du deuil; la couleur violette, froide, symbole du deuil atténué après le noir; les yeux ronds, tous ouverts, unidirectionnels; les bouches fermées ou tristes; les oreilles ouvertes et actives sauf une paire fermée par une croix; les expressions de voyeurisme, d’inquiétude, de colère ou d’hébétude.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à se sentir regardé·es par des individus interpellés, passifs, fâchés, sidérés; interrogé·es par les personnages qui attendent quelque chose des sujets-lecteurs.
La matérialité du récit ou le rôle joué par les formes, les couleurs et les matières de l’album
Exemple 3
Pour l’étape de l’observation, c’est la première de couverture qui est choisie (Figure 2.1).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier les couleurs, les matières, les textures, les traits et la technique.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever la présence de seulement deux couleurs avec le noir; l’absence de nuances, les aplats, les couleurs mates sans lumière; la couleur jaune, couleur maudite de la corrida car renvoyant aux morts et à la trahison; la couleur noire issue de la 4e de couverture qui renvoie au taureau tout en étant la couleur du deuil et de la mort; aux matières brutes (carton, toile) qui composent normalement la structure de la couverture; aux surfaces rugueuses (carton) et râpeuses (toile de la reliure); aux formes sommaires, découpées avec un outil tranchant.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à prendre position sur l’esthétique peu habituelle, en dehors du «beau» pour un livre dont le but ne semble ni de plaire ni de donner du plaisir; l’efficacité et les émotions provoquées par les images très minimalistes; la manière dont elles traduisent la violence et la barbarie du récit et le malaise lié au rôle attribué au sujet-lecteur.
Exemple 4
Pour l’étape de l’observation, c’est le «taureau» qui est choisi (Figure 2.3).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier les couleurs, les formes, le trait et la technique utilisée.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever le noir, couleur du taureau de la corrida mais aussi du deuil, de l’ombre, de la nuit; la rondeur et l’effet-masse en raison de l’aplat et de l’absence de nuance et de relief; le corps surdimensionné et les membres très courts comme le sont ceux du taureau-animal; la position jamais naturelle au fil des pages (sur un pied, à quatre pattes, à terre, etc.); la tête ronde, le visage neutre ou hébété; les formes découpées plus soignées et moins anguleuses en comparaison avec les autres personnages.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à prendre position sur la stigmatisation signifiée par la différence du personnage en regard de sa morphologie; la douceur des traits renforçant l’innocence du personnage; l’absence d’animosité dans l’expression faciale traduisant son statut de victime; l’expression d’incompréhension du personnage.
La topographie des doubles-pages ou la mise en scène visuelle du récit
Exemple 5
Pour l’étape de l’observation, c’est «l’arène» sur la double-page 1-2 qui est choisie (Figure 2.2).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier l’occupation de la double-page; la place de la reliure; la forme ronde; le rapport intérieur / extérieur; les personnages, leurs couleurs, leurs positions, les distances, les rôles.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever la rare apparition de l’arène sur seulement deux doubles-pages; sa position au centre ou sur la «belle» page (page de droite); sa figuration partielle traduisant une taille plus grande en réalité (hors-champ); la composition de l’arène avec la piste centrale, le couloir périphérique, le premier rang pour les journalistes et les photographes; le cadrage serré des personnages, noirs et violets, mi-cachés, mi-visibles, à l’intérieur et à l’extérieur.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à prendre position sur l’assimilation potentielle de tous les personnages à des taureaux en raison de leur couleur noire; l’assimilation potentielle de tous les personnages à des matadors en raison de leur couleur violette; l’assimilation de tous les personnages, y compris le lecteur, à des témoins privilégiés d’un spectacle de divertissement.
Exemple 6
Pour l’étape de l’observation, c’est la place du sujet-lecteur/spectateur qui est choisie (Figures 2.2, 2.3).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à consigner les directions des regards des personnages et le cadrage des personnages.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à formaliser la présence du sujet-lecteur dans tous les regards de face; le rôle de témoin extérieur·e quand le sujet-lecteur n’est pas regardé; la proximité avec les spectateur·rices quand le cadrage est serré; l’éloignement du matador, de ses assistants, du taureau quand le cadrage est large.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à se questionner sur leur rôle de taureau lorsque le sujet-lecteur est regardé par les spectateur·rices; leur rôle de témoin lorsque le sujet-lecteur est regardé par le taureau; leur rôle complice lorsque le sujet-lecteur est regardé par l’assistant et le matador; la manière dont ils et elles sont otages de la scène de harcèlement.
Conclusion
Ces quelques extraits du matériel pédagogique créé pour enseigner avec les images en contexte iconotextuel montrent que ce travail dans les albums peut non seulement dépasser leur simple monstration mais permet de saisir l’ensemble de l’expérience qu’offre l’album en raison de la part d’interprétation qu’il laisse au sujet-lecteur.
Ce matériel, testé et validé par les enseignant·es, a suscité l’intérêt des élèves, les étapes d’analyse des illustrations constituant un complément indispensable dans des démarches jusqu’alors focalisées sur l’analyse de texte. Or, si les éléments travaillés dans le texte de Corrida ne peuvent pas être tirés des images, les éléments travaillés dans les images de Corrida ne constituent pas davantage des éléments qui peuvent être tirés du texte. Ainsi, pour que l’interprétation émerge de la combinaison des images et du texte, l’indispensable recontextualisation à l’échelle du récit doit mobiliser pour chaque modalité ses propres outils d’analyse, intrinsèquement différents et spécifiques.
L’album Corrida constitue un exemple particulièrement signifiant du point de vue du rapport de discontinuité entre le texte et les images dans un support qualifiable d’iconotexte au sens de Nerlich (1990). L’iconotexte n’est pas un support composé de texte(s) et d’image(s) mais coconstruit par les deux registres sémiotiques qui sont indissociables et perpétuellement en tension du point de vue de la réception. La puissance de la discontinuité de cet album montre violemment le rôle et donc le pouvoir réciproque des images sur le texte. Dans le domaine disciplinaire du français mais également dans toutes les autres disciplines, la manière dont les images signifient est à travailler pour elle-même, ce que la présente contribution visait à montrer.
Évoluant dans un monde rempli d’images, les élèves manquent encore d’outils pour comprendre l’iconique. C’est pourquoi des dispositifs didactiques permettant d’enseigner avec les images développent chez les élèves des compétences littéraciques et une réflexivité allant au-delà de l’enseignement-apprentissage de la littérature. Le développement de la capacité d’observation et d’analyse des images élargit en effet la compréhension par rapport à une approche uniquement verbocentrée, en offrant au sujet-lecteur tous les outils nécessaires pour justifier, agir et se transformer, afin de pouvoir à son tour transformer le monde qui l’entoure.
Bibliographie
Alloa, Emmanuel,(2010), Penser l'image, Paris, Les Presses du réel.
Bordron, Jean-François (2011). L'iconicité et ses images: études sémiotiques, Paris, Presses Universitaires de France.
CIIP, (2023), Moyen d’enseignement de français, Stratégies de compréhension, https://portail.ciip.ch/mer/teaching-mediums/33/french56/track-step-activities/335
Conti, Virginie, De Pietro, Jean-François., Roduit, Philippe.& Sánchez Abci, Véronica. (2022). Modèles didactiques des genres textuels. IRDP. https://www.irdp.ch/institut/modeles-3731.html
Dolz, Joaquim & Gagnon, Roxane, (2008), «Le genre du texte, un outil didactique pour développer le langage oral et écrit», Pratiques [En ligne], p. 137-138.
Falardeau, Éric (2003), «Compréhension et interprétation: deux composantes complémentaires de la lecture littéraire», Revue des sciences de l'éducation, 29(3), p. 673-694.
Gibson, James J. (1950), The perception of Visual World, Boston, Houghton Mifflin.
Haupt, Corinna & Huber, Andrea B. (2008), «How axons see their way–axonal guidance in the visual system», Front Biosci, 13 (13), p. 3136-3149.
Hétier, Renaud, (2015), «Un tournant dans les albums de littérature de jeunesse: de l’enfant acteur à l’enfant auteur», Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, n° 38.
Jewitt, Carl (2011), The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, London, Routledge/Taylor & Francis Group.
Klinkenberg, Jean-Marie (2020), «Pour une grammaire générale de la relation texte-image», Pratiques, n° 185-186.
Kress, Gunther (2010), Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London, Taylor & Francis.
Kress, Gunther, & Van Leeuwen, Theo (2006), Reading Images: The Grammar of Visual Design, London, Routledge.
Lacelle, Nathalie, Boutin, Jean-François, & Lebrun, Marlène (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Montréal, Presses universitaires du Québec.
Lebreton-Reinhard, Maud, & Richard, Suzanne (2020), «Corrida ou le pouvoir des images», VoieLivres.ch
Lebreton Reinhard, Maud & Aubert, Florence (2022), «Faire évoluer les axes Accès à la littérature et Compréhension de l’écrit du Plan d’Études Romand en didactique du français: perspective sémiologique et approche multimodale», Atti del 5° Convegno sulle didattiche disciplinari, Locarno, p. 391-395.
Lebreton Reinhard, Maud & Attanasio, Rachel (2022), «La narration iconotextuelle au service de l’activité de création. Dispositif didactique et approche anthroposémiotique pour rendre l’élève cré-acteur·rice de ses apprentissages: recherche exploratoire menée au cycle 1 dans le canton de Vaud en Suisse», Revue internationale du CRIRES, 6 (3), p. 23-45.
Lebreton Reinhard, Maud & Azaoui, Brahim (à paraître), «Deux signes impensés de la lecture partagée en classe: le corps et l’image», In Actes du colloque Sémiotiques de terrain, Appiotti, S., Saemmer, A., Trehondart, N. (dir.), Namur, Editions Academia, coll. «Extensions sémiotiques».
Lebreton Reinhard, Maud & Kohler, Alaric (2023), «Place et enjeux de la sémiologie dans la formation et l’enseignement», Revue de Littératie Médiatique Multimodale, R2LMM 17, en ligne.
Leclaire-Halté, Anne (2008), «L’album de littérature de jeunesse: quelle description pour quel usage scolaire?», In Congrès Mondial de Linguistique Française, Les Ulis, EDP Sciences.
Lefebvre, Martin (2011), «Des images et des signes. À propos de la relation indexicale et de son interprétation», Recherches sémiotiques, 28 (3), p. 109-124.
Lépine, Martin (2012), «Étude théorique des relations texte-images dans l’album pour adolescents», Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 15/2, p. 97-118.
Michel, Johann (2017), Homo Interpretans, Paris, Hermann.
Mitchell, William T. (2013), Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, University of Chicago Press.
Montandon, A. (dir.) (1990). Iconotextes, Paris. Ophrys.
Nerlich, Michael (1990). «Qu’est-ce qu’un iconotexte? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La Femme se découvre d’Évelyne Sinassamy» In Iconotextes, Paris, Orphys.
Peirce, Charles S. (1997), Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking: The 1903 Harvard Lectures on Pragmatism, New York, Suny Press.
Rabatel, Alain (2022), «Des relations entre texte et image et, au-delà, entre linguistique et sémiotique», Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, n° 52, p. 153-167.
Simard Claude, Dufays Jean-Louis, Dolz Joachim & Garcia-Debanc Claudine (dir.) (2010), Didactique du français langue première, Bruxelles, De Boeck.
Tauveron, Catherine, (1999), «Comprendre et interpréter le littéraire à l'école: du texte réticent au texte proliférant», Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle, 19 (1), p. 9-38.
Tauveron, Catherine, (2000), Littérature de jeunesse ou nouvelle jeunesse pour la littérature et son enseignement? (En ligne).
Tauveron, Catherine, (2002), Lire la littérature à l’école. Pourquoi et comment construire cet apprentissage spécifique?, Paris, Hatier.
Van der Linden, Sophie, (2006), Lire l'album, Le Puy-en-Velay, Atelier du poisson soluble.
Van der Linden, Sophie, (2008), «L’album, le texte et l’image», Le français aujourd'hui, n° 2, p. 51-58.
Pour citer l'article
Maud Lebreton Reinhard & Florence Aubert, "Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/objets-litteraires-iconotextuels-travailler-avec-l-image-pour-interpreter-le-message
Voir également :
Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
Les éditions des Fables disponibles aujourd’hui sous la forme de reproductions numériques invitent à poser un nouveau regard sur l’articulation entre le texte et l’image.
Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
Les éditions des Fables disponibles aujourd’hui sous la forme de reproductions numériques invitent à poser un nouveau regard sur l’articulation entre le texte et l’image. La consultation désormais possible de reproductions d’éditions anciennes, rares, parfois même originales de textes grâce aux outils numériques les plus récents promet une expérience de lecture inédite et une attention renouvelée pour l’illustration.
Dans le cadre du projet de recherche intitulé «La Fontaine à l’école numérique», nous nous sommes intéressée à l’intégration dans les classes genevoises d’éditions numérisées des fables, dont certaines étaient illustrées. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes a engagé une importante réflexion sur l’articulation entre le texte et l’illustration. Pour accompagner au mieux une équipe d’enseignantes et d’enseignants du degré secondaire, plusieurs médiations didactiques1 ont été élaborées, qui nous renseignent sur les connaissances et compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de français.
Le projet «La Fontaine à l’école numérique» et les choix méthodologiques opérés
Issu d’un partenariat entre le Bodmer Lab de l’Université de Genève et le département de l’instruction publique genevois, le projet «La Fontaine à l’école numérique» a vu le jour à la rentrée scolaire de septembre 2019. Il s’agissait de réunir un groupe d’enseignantes et d’enseignants de français des degrés secondaire I et II et une équipe universitaire de recherche pluridisciplinaire, en vue de réfléchir à l’intégration dans les classes des éditions des Fables récemment numérisées par le Bodmer Lab. Le Bodmer Lab est un projet de recherche et de numérisation de l’Université de Genève, qui entend numériser, de manière raisonnée, une part significative de la collection Martin Bodmer aujourd’hui conservée dans une fondation située dans la région genevoise2.
Le soutien apporté par le DIP a pris la forme d’un appui logistique – dans la mesure où ce sont les équipes du service école-média du canton qui ont permis l’emprunt d’une trentaine de tablettes numériques – et celle d’un dégrèvement financier d’une heure d’enseignement par semaine pour les cinq enseignantes et enseignants du projet, soit une enseignante et deux enseignants du degré secondaire I (élèves de 12 à 15 ans, toutes filières) et deux enseignants du degré secondaire II (élèves de 15 à 19 ans, filière gymnasiale).
Le corpus choisi était alors celui des Fables de la Fontaine, et plus précisément celui des éditions des XVIIe et XVIIIe siècles numérisées par les spécialistes du Bodmer Lab. L’une des ambitions du projet consistait à permettre à l’enseignante et aux enseignants de créer des ressources didactiques pour l’enseignement des dimensions matérielles des Fables, qui soient ensuite diffusables à une plus large échelle. Très vite, la question de l’illustration – sa place dans l’ouvrage, sa fabrication ou encore l’intérêt accordé à celle-ci dans le processus interprétatif – s’est posée. Pour des enseignantes et enseignants de littérature, ayant pour habitude d’étudier le texte comme une abstraction sémiotique, il s’agissait alors d’intégrer de nouvelles perspectives et, notamment, de prendre en compte les images proposées dans les éditions numérisées. Il fallait par conséquent leur offrir un certain bagage de connaissances et de compétences leur permettant de se sentir à l’aise dans leurs classes pour enseigner le texte et les illustrations qui l’accompagnent.
Le projet de recherche a été mené en trois phases: une première phase de formation du groupe d’enseignant·es à l’approche matérielle des éditions, et à la découverte des outils, notamment numériques, créés par les chercheurs/euses donnant accès aux illustrations des Fables; une deuxième phase dédiée à l’élaboration du matériel pédagogique; et une troisième phase combinant mise en œuvre du matériel pédagogique créé dans les classes et retour d’expérience de la part de l’équipe enseignante. Dans cet article, nous nous intéresserons principalement aux deux premières phases du projet, car ce sont celles qui ont mené l’équipe enseignante à mobiliser les outils et les savoirs sur les illustrations mis à leur disposition par les chercheurs/euses universitaires. Nous reviendrons également sur le travail réalisé par les chercheurs/euses du Bodmer Lab, en amont du projet «La Fontaine à l’école numérique», pour détailler l’ensemble des savoirs et des outils produits autour de ces éditions numérisées et de leurs illustrations.
Le cadre théorique: modèle de recherche, approche matérielle des œuvres littéraires et relation texte-illustration
Modèle de recherche
La recherche alors mise en œuvre comporte de nombreux points communs avec le modèle de «recherche collaborative» élaboré par Serge Desgagné (Desgagné 1997, 2001). Dans les recherches de type collaboratives, des enseignant·es, désignés par Desgagné sous l’expression de «praticiens», sont mis en relation avec des chercheurs/euses et cela dans le but de produire une certaine émulation dont les répercussions toucheront les deux domaines:
La culture scolaire incite le praticien enseignant à se donner les moyens de développer et d’améliorer sa pratique, plus spécifiquement la qualité de son intervention auprès des élèves dont il a la responsabilité. La culture scientifique incite le chercheur universitaire à contribuer à la production des connaissances dans un domaine donné. L’entente collaborative consiste à faire en sorte qu’une même activité réflexive aménagée autour d’un projet d’exploration négocié́ fasse que ces attentes respectives soient comblées à la satisfaction des deux parties. La collaboration de recherche prend également le sens d’un souci d’interinfluence entre ces acteurs, praticiens et chercheurs, et leurs cultures respectives. En fait, le chercheur vise une production de connaissances qui inclue et tienne compte du point de vue du praticien et des contraintes de son contexte d’action. De même, on pourrait dire que le praticien vise un développement de pratique qui soit éclairé́ par le point de vue du chercheur et par les repères conceptuels qui guident sa production de connaissances. En ce sens, l’entente collaborative sous-tend aussi qu’il y ait interinfluence entre la pratique et la recherche. D’où l’idée de coconstruction (Cole, 1989) d’un savoir dans une “zone interprétative” partagée. (Desgagné 2001: 39)
Autrement dit, dans une recherche de type collaborative, enseignant·es et enseignant·es ne poursuivent pas les mêmes objectifs et n’effectuent pas les mêmes tâches, mais produisent des connaissances ou des pratiques enseignantes participant au développement de leurs domaines d’expertises respectifs. C’est ainsi que les enseignante et enseignants du projet ont pu acquérir une nouvelle perspective sur le texte en s’intéressant aux images, et que les enseignant·es ont pu voir le fruit de leur travail atteindre de nouveaux publics et voir émerger de nouvelles questions de recherches liées notamment aux requêtes de l’équipe enseignante. Les enseignant·es universitaires rencontré·es ont permis au corps enseignant de découvrir de nouvelles méthodes pour intégrer la lecture et l’interprétation d’illustrations dans leurs cours portant sur le texte littéraire. En parallèle, les enseignant·es ont réalisé des médiations prenant différentes formes, qui permettaient d’accéder de manière guidée aux connaissances qu’ils avaient établies sur les textes et sur les images issues des patrimoines numérisés.
À propos de la recherche collaborative, Vinatier & Morrissette précisent qu’il est important «d’établir un contrat de recherche collaborative» qui inclue les points suivants:
1/ tous les participants n’ont pas les mêmes responsabilités;
2/ l’existence d’un leadership où les rôles des différents partenaires sont clairement définis en fonction de leurs expertises spécifiques et de leurs complémentarités nécessaires
3/ une négociation préalable des modalités relationnelles et du partage des responsabilités de divers ordres au niveau interinstitutionnel. (Vinatier & Morrissette 2015: 152)
Le projet «La Fontaine à l’école numérique» a répondu à ces trois critères, dans la mesure où il a permis la mise en relation d’enseignant·es du degré secondaire avec des enseignant·es universitaires dont les domaines d’expertises allaient de la littérature française du XVIIe siècle à la matérialité des textes, en passant par l’histoire de l’art. Mais si les enseignant·es apportaient des connaissances sur les patrimoines numérisés, ce sont les membres de l’équipe enseignante, dont l’expertise repose sur la pratique d’enseignement devant un public d’adolescents, qui ont sélectionné ce qu’ils souhaitaient retenir et utiliser des différentes médiations proposées.
Enseigner des textes dans des matérialités nouvelles comme celles des reproductions numériques suppose de la part du corps enseignant la capacité à appréhender les textes selon une perspective inédite. Pour rendre justice aux patrimoines numérisés dans les classes, il convient en effet d’aborder ces textes d’une manière qui dépasse l’approche purement textuelle. Depuis les années 1960-70, les courants herméneutiques dominants pour enseigner le texte littéraire au degré secondaire privilégient en effet une certaine abstraction sémiotique du texte vis-à-vis des supports qui le donnent à lire. À la suite de la Nouvelle Critique et des approches structuralistes et formalistes du texte, les enseignantes et enseignants de littérature française étudient en classe le texte comme un ensemble de signes linguistiques à la fois sémantiques et syntaxiques. Il s’agit avant tout de fournir aux élèves des outils (narratologiques, rhétoriques, stylistiques) permettant de comprendre et d’interpréter les textes littéraires, et de les commenter de manière argumentée. Dans cette perspective, le texte littéraire est appréhendé indépendamment de son support, et donc de ses éventuelles illustrations. Or, il faut noter que pour certains textes la dimension iconographique fait partie intégrante de l’œuvre. C’est le cas de la plupart des éditions des Fables de La Fontaine: rappelons-le, l’édition originale proposait déjà cent dix-huit gravures pour cent vingt-quatre fables. Nous avons donc fait le pari, avec le projet «La Fontaine à l’école numérique», de proposer une approche des textes qui rende justice aux supports dans lesquels s’inscrit le texte. Cette approche, c’est celle de la matérialité des textes.
Approche matérielle des textes
Grâce au numérique et aux campagnes de numérisations menées depuis les années 2000, de nombreux textes sont aujourd’hui aisément consultables dans des versions anciennes voire originales. C’est le cas notamment de la toute première édition des Fables de La Fontaine, dont la Fondation Martin Bodmer possède deux versions3. En convoquant en classe une reproduction numérique de ce texte dans son édition originale, l’enseignant de français, habituellement formé à étudier la textualité des fables est bien emprunté et il lui faut recourir à d’autres approches pour valoriser la dimension esthétique plus large de l’objet consulté.
L’approche qui rend le mieux justice aux matérialités littéraires est celle de la bibliographie matérielle. Issue des sciences bibliographiques, elle étudie les inscriptions matérielles des textes sur leurs différents supports. Cette approche des textes considère que l’objet-livre – ou, de manière plus générale, le support du texte - est porteur de signes non sémantiques pouvant eux aussi contribuer à son analyse et à son interprétation. On doit la plupart des idées novatrices de cette approche herméneutique à Donald F. McKenzie, un chercheur d’origine néo-zélandaise pour qui non seulement le terme de «texte» ne se limite pas aux seuls livres manuscrits et imprimés, mais comprend aussi des «non-verbal texts» (cartes, images, plans, par exemple) et des versions orales de textes. Popularisée en France par l’historien Roger Chartier qui a fourni la préface de l’édition française de l’ouvrage de McKenzie intitulé La Bibliographie matérielle et la sociologie des textes (1991), ce domaine de la recherche bibliographique promeut également la prise en compte de la dimension sociale des textes, dès lors qu’on les étudie dans leurs différentes éditions. Pour McKenzie:
Le principe fondamental que je voudrais suggérer est celui-ci: la bibliographie est la discipline qui étudie les textes en tant que formes conservées, ainsi que leurs processus de transmission, de la production à la réception. Rien de profondément novateur dans cette formulation, cependant il importe de considérer que par «textes», j'entends toutes les formes de textes, et pas seulement les livres ou les signes tracés sur papier ou parchemin […]. Et il s’agit aussi d'accepter l'idée selon laquelle la tâche du bibliographe est de montrer que les formes ont un effet sur le sens. Cette définition nous amène également à ne plus nous contenter de décrire les procédés techniques de la transmission de «textes» mais à nous intéresser aussi à sa dimension sociale. Par sa spécificité́, elle permet de prendre en compte les textes qui ne sont pas des livres, leurs formes matérielles, leurs versions textuelles, leurs techniques de transmission, le contrôle institutionnel dont ils font l'objet, leurs sens perçus et leurs effets sociologiques. Elle appelle une histoire du livre et de toutes les formes imprimées, y compris les imprimés éphémères et utilitaires qui témoignent des changements culturels, soit dans la civilisation de masse, soit dans la culture minoritaire. (McKenzie 1991 [1986]: 30-31)
Il s’agit alors d’étudier les différentes traces matérielles présentes sur les éditions des textes – par exemple les traces liées à la fabrication de l’objet-livre – dans le but de comprendre ces objets textuels dans les contextes socio-culturels qu’ils ont traversés. Le sens accordé au texte pourrait ainsi être réinscrit dans la préoccupation de son temps, grâce à l’étude minutieuse des marques matérielles que pourrait comporter l’objet-livre:
Au premier degré, une sociologie des textes pourrait se contenter de décrire toutes les réalités sociales au service desquelles s’est mise l’imprimerie, des quittances aux bibles. Mais elle doit aussi nous amener à nous interroger sur les motivations et les interactions humaines qu’impliquent les textes aux différents stades de leur production, transmission et consommation. Elle doit nous faire réfléchir aux rôles des institutions, à leurs structures complexes, à la façon dont elles affectent les formes du discours social, passé comme présent. Telles sont les réalités que la bibliographie et la critique textuelle avaient, jusque dans un passé très récent, négligé́ de prendre en compte ou défini comme strictement non bibliographiques. (McKenzie 1991 [1986]: 33)
L’approche matérielle des textes proposée par McKenzie engage à considérer les différentes facettes de l’objet-livre, et dans cette optique, l’illustration se voit conférer un statut nouveau. La compréhension et l’interprétation du texte s’accompagnent ici d’une prise en compte de l’objet même qui le donne à lire et de toutes les dimensions que cela comprend: reliure, péritexte, et, pour ce qui nous intéresse ici, illustrations.
L’illustration: une partie intégrante de l’œuvre
L’illustration du texte fait partie intégrante de l’œuvre et l’approche par la matérialité permet de valoriser la prise en compte de celle-ci lors de la compréhension et de l’interprétation du texte. En effet, s’il n’est plus question d’étudier seulement la sémantique ou la syntaxe du texte, mais également l’inscription de celui-ci dans les différents supports qui le proposent à la lecture, alors les illustrations, les gravures, les ornements et autres culs-de-lampe4 qui ornent l’ouvrage peuvent eux aussi être pris en compte dans l’analyse et l’interprétation conférée au texte.
Les illustrations présentées dans les différentes éditions sont le résultat d’un processus de fabrication. Dans la première édition des Fables (1668)5, par exemple, les illustrations proposées sont des gravures sur bois dont les matrices ont également servi lors de l’édition de 16786, soit la deuxième édition du texte, parue dix ans plus tard. Ce souci économique exerce alors une certaine influence sur l’esthétique de l’objet et, par conséquent, sur l’expérience de lecture, car l’édition originale a été réalisée dans un format in-quarto, plus grand que l’édition in-octavo de 1678: l’espace accordé à l’image se trouve donc proportionnellement bien plus grand dans l’édition de 1678 que dans celle de 1668. Cet exemple montre qu’une attention particulière accordée à la dimension matérielle de l’œuvre, permet également de mettre en évidence les techniques et usages qui ont permis la réalisation de certaines images.
Prendre en compte la dimension matérielle d’une œuvre, c’est aussi réaliser que les illustrations proposées sont une première forme d’interprétation accordée au texte. En effet, l’image, et plus encore les vignettes dont sont pourvues les premières éditions des Fables, ne peuvent représenter l’ensemble des péripéties racontées dans la fable. Il existe un décalage entre les possibilités du texte et la temporalité qu’il présente, et le caractère instantané de la représentation iconographique. Ainsi, étudier la gravure d’une fable consiste également à regarder l’événement reproduit sur l’image et à le mettre en perspective avec l’ensemble du récit. L’illustration montre par conséquent une première interprétation de l’œuvre, dans la mesure où c’est l’illustrateur qui a décidé du moment qu’il convenait de faire figurer à l’image. Par exemple, dans la célèbre fable «Le Corbeau et le Renard», François Chauveau, l’illustrateur de la première édition du texte (1668), a décidé de représenter le moment où le renard attrape le fromage dans sa gueule, tandis que Jean-Baptiste Oudry7 (1755) a, lui, décidé de montrer le moment où le corbeau détient encore le fromage dans son bec. Les deux illustrateurs n’ont pas choisi de représenter le même moment de la fable; et cela montre l’interprétation qu’ils en proposent, sans même parler du style esthétique adopté par chacune de ces illustrations.
Dans le but d’accompagner au mieux les enseignant·es du projet «La Fontaine à l’école numérique» à prendre en considération les illustrations du texte, plusieurs médiations ont été réalisées par les enseignant·es du Bodmer Lab. En effet, grâce à la collaboration étroite entretenue avec le Bodmer Lab, le projet «La Fontaine à l’école numérique» a pu compter sur le soutien, essentiellement de deux chercheuses universitaires, pour étoffer leurs connaissances sur les illustrations. Il s’agit d’une chercheuse spécialiste de la littérature XVIIe siècle et d’une historienne de l’art ayant procédé à la mise en ligne sous la forme d’une iconothèque des quelques mille-huit-cents illustrations des Fables, qui se trouvaient dans les éditions numérisées par le Bodmer Lab. Cela a permis notamment de faire émerger certains questionnements mêlant approche matérielle de l’œuvre et rapport à l’image. Ainsi, dans le cadre des discussions entre les enseignant·es et les enseignant·es, la question de la place accordée à l’illustration dans l’ouvrage a été abordée tant pour parler de l’espace physique consacré aux représentations iconographiques, aux ornements et autres signes esthétiques de la typographie, que pour parler de l’articulation entre l’image représentée et le texte proposé. Enfin, parler de la place des illustrations suppose aussi que soient évoqués les mécanismes et les techniques qui permettent de les réaliser et de leur donner une existence matérielle.
Des médiations réalisées pour accompagner l’enseignement des Fables et de leurs illustrations
Au cours du projet «La Fontaine à l’école numérique», une série de médiations ont été réalisées pour permettre aux enseignant·es d’intégrer les illustrations à leurs enseignements. En tant qu’enseignant·es de français, ils n’étaient pas formés aux questions liées aux images et, pourtant, dès le début du projet, plusieurs d’entre eux ont formulé l’envie d’intégrer cette dimension en classe.
Des fiches thématiques pour les enseignant·es
C’est au cours d’une rencontre avec une spécialiste du XVIIe siècle que les premières questions portant sur les illustrations sont apparues. Il faut dire que jusque-là, les informations mises à disposition des enseignant·es avaient été présentées sous la forme de fiches d’informations présentant une synthèse de la question et une bibliographie sélective. Ces fiches avaient été réalisées par une chercheuse chargée d’enseignement au département de littérature de l’UNIGE. Elles se présentaient alors comme un bref descriptif de certains points de débats sur les Fables, alors recueillis dans la littérature secondaire, et en particulier dans les textes critiques portant sur les premières éditions des Fables. Parmi les dix-huit fiches créées par la chercheuse, il existe au moins trois fiches entièrement dédiées à la question des illustrations : la septième du dossier qui porte sur les techniques d’illustration et les douzième et treizième qui concernent le rapport entre le texte et l’image. Si la fiche dédiée à la question des techniques de fabrication propose la description succincte des différentes techniques employées pour la réalisation d’images (gravure sur bois, gravure sur cuivre, gravure à l’eau-forte ou encore lithographie), les fiches 12 et 13 portent davantage sur la problématique du rôle et de la place de l’illustration dans le corpus des Fables.
La douzième fiche du dossier présente un bref état des lieux de la question de l’image pour le corpus étudié. Trois types de questionnements y sont évoqués: la question du statut des illustrations vis-à-vis de l’œuvre de La Fontaine – et tout particulièrement vis-à-vis de la première édition du texte (1668); la question du rapport entre le genre de la fable illustrée et celui des emblèmes8 et, enfin, la question des liens entre les illustrations et le texte. Pour chacune de ces orientations, un bref paragraphe propose un état de la recherche ainsi que plusieurs références. Notons d’ailleurs que cette fiche est accompagnée d’une longue bibliographie, permettant aux enseignant·es, s’ils le souhaitaient, d’approfondir l’un ou l’autre des points mentionnés.
La treizième fiche propose tout d’abord un «questionnaire heuristique», emprunté à Stefan Schoettke (1997), élaboré dans le but de guider la lecture des images pour l’analyse des Fables de La Fontaine. Puis, une série de remarques portent sur les différents illustrateurs des éditions des Fables numérisées par le Bodmer Lab.C’est par le biais de ces fiches que les enseignant·es ont d’abord accédé à des informations sur les illustrations des Fables.
Une conférence sur les illustrations
Profitant de la collaboration étroite avec l’équipe de cherccheurs/euses du Bodmer Lab et dans le but d’approfondir la familiarisation des enseignant·es avec les illustrations proposées par les éditions numérisées des Fables, nous avons ensuite convié une historienne de l’art, membre de l’équipe du Bodmer Lab, à venir présenter le corpus des illustrations des Fables et les outils développés par le projet de recherche pour accéder à celles-ci. Il faut dire que, dès sa création, le Bodmer Lab a formulé une forte envie de partager le fruit de ses recherches avec un large public et notamment un public scolaire. Pour cela, le projet de recherche universitaire n’a pas hésité à créer des outils favorisant l’accès à ses textes mais aussi – et c’est ce qui nous intéresse ici – aux illustrations de celles-ci. Avec cette invitation, il s’agissait de permettre aux enseignant·esde découvrir non seulement l’étendue du corpus des illustrations des Fables numérisées, mais aussi l’iconothèque développée par le Bodmer Lab et disponible en ligne. Revenons à présent sur ces deux médiations.
Lors de sa participation au projet «La Fontaine à l’école numérique», l’historienne de l’art et chercheuse travaillant alors pour le Bodmer Lab, a proposé une conférence sur la question des illustrations présentes dans le corpus des éditions des Fables numérisées par le Bodmer Lab. Durant cette prise de parole, la chercheuse a d’abord procédé à une vaste introduction dont l’objectif consistait à dresser un état des lieux de la question de l’illustration des Fables au XVIIe siècle. Il s’agissait de donner à voir aux enseignant·es l’étendue des débats, mais aussi de pointer le manque de ressources disponibles pour les enseignant·es, portant sur l’articulation entre le texte et l’image. Ensuite, la chercheuse a proposé une plongée dans les premières illustrations de ce texte, à savoir les gravures de François Chauveau. Enfin, pour terminer, elle s’est attelée à présenter la dimension iconographique de cinq autres éditions conservées à la Fondation Martin Bodmer et numérisées par le Bodmer Lab.
Au cours de cette conférence, la chercheuse avait à cœur de fournir aux enseignant·es à la fois une vision globale des illustrations disponibles sur le site du Bodmer Lab, mais également quelques outils pour appréhender celles-ci. Ainsi, lorsqu’elle a procédé à la présentation des illustrations de François Chauveau, la chercheuse a présenté différentes manières d’aborder les images. Ses remarques ont alors porté sur le nombre d’illustrations présentes dans l’ouvrage, sur l’esthétique de celles-ci – en mentionnant entre autres le goût de l’illustrateur pour la peinture septentrionale ou ses nombreux emprunts à l’univers du théâtre. Elles ont aussi porté sur les péripéties racontées sur l’image, pour insister sur les choix opérés par Chauveau dans la représentation des événements racontés dans la fable. La spécialiste est également revenue sur la représentation des animaux et de la nature. Elle a montré aux enseignant·es comment analyser une image, notamment en comparant différents premiers, deuxièmes et troisièmes plans. Enfin, elle a procédé à un commentaire approfondi de l’illustration de «La Cigale et la Fourmi», notamment pour mettre en lumière certains débats portant sur l’illustration de cette fable. Dans la deuxième partie de son parcours dans les fables numérisées par le Bodmer Lab, la chercheuse a présenté, de manière comparative, cinq éditions différentes des Fables. Elle a parlé des contextes dans lesquels celles-ci s’inscrivaient et a insisté sur les rôles des différents intervenants dans la création de la gravure ou de la lithographie. Enfin, elle a étudié quelques illustrations notables pour chacune de ces éditions dans le but de montrer les différentes esthétiques adoptées et les points communs entre celles-ci. Il faut dire que la chercheuse avait une connaissance approfondie de l’ensemble des quelques 1800 illustrations des Fables disponibles dans la base de données du Bodmer Lab. En effet, c’est elle qui avait procédé à la mise forme et à la mise en ligne de celles-ci dans l’iconothèque9 développée par ledit projet de recherche.
Une iconothèque: un outil inédit
L’iconothèque est un outil développé par le Bodmer Lab pour faciliter un accès direct aux illustrations des Fables provenant des éditions numérisées par le projet de recherche. Il s’agit d’une plateforme disponible en ligne et renfermant les quelques 1800 illustrations extraites des pages qui les proposent à la lecture. Le site internet se veut intuitif; il est précisé dans la description de celui-ci que»[l]’interface permet de filtrer les illustrations par les champs “Titres des Fables” et “Artistes” qui peuvent être interrogés ensemble afin d’affiner les critères de recherche10.»
 Figure 1: Capture d'écran d'une page de l'iconothèque 11
Figure 1: Capture d'écran d'une page de l'iconothèque 11
L’avantage principal de cet outil est la navigation facilitée entre les différentes illustrations d’une même fable. En sélectionnant par exemple le titre d’une fable, il est possible de convoquer l’ensemble des illustrations de celles-ci et de les consulter en naviguant à l’aide des flèches présentes sur les côtés. Plusieurs informations sont renseignées sur la provenance de l’illustration ainsi que sur les artistes qui ont confectionné la gravure et trois options sont offertes sous l’image étudiée: agrandir l’image, consulter la page d’où elle provient ou, encore, la télécharger. Il est également possible de trier les images d’après des artistes qui les ont réalisées. Cela pourrait par exemple permettre de comparer la représentation d’un animal en particulier entre différentes fables et selon un même artiste. Enfin, soulignons que dans la description de cette iconothèque, nous trouvons quelques mots sur les coulisses de ce projet et notamment sur le travail effectué par les enseignant·es du Bodmer Lab pour recadrer l’illustration et la présenter indépendamment de la page dont elle provient, tout en conservant une qualité d’image suffisamment élevée.
À partir de ces rencontres et des outils qui leur ont été présentés, les enseignant·es ont élaboré des activités pédagogiques. Regardons à présent comment ces savoirs sur les illustrations des Fables ont été employés en classe.
De quelques activités pédagogiques sur les illustrations des Fables
Finalement, trois activités créées dans le cadre du projet «La Fontaine à l’école numérique» ont pour sujet principal la question des illustrations. Deux d’entre elles ont été élaborées par un enseignant du degré secondaire I et la troisième par deux enseignants du degré secondaire II. 12
«Les illustrateurs des Fables de La Fontaine»
La première de ces activités porte le titre «Les illustrateurs des Fables de La Fontaine». Il s’agit d’une activité dont le déroulement est prévu en quatre ou cinq périodes d’enseignement. Trois étapes la composent: une première étape de découverte et de présentation de l’iconothèque du Bodmer Lab, une deuxième consistant à répondre à des questions à travers un questionnaire écrit et une troisième de mise en commun et de correction des exercices réalisés. Les objectifs poursuivis dans cette activité sont les suivants:
- - Découverte du lexique de l’illustration
- - Présentation des illustrateurs des Fables
- - Sensibilisation aux différentes lectures d’un même texte que suscitent les illustrations
- - Sensibilisation aux fonctions des images (illustration vs interprétation) (Fiche d’activité «Les illustrateurs des Fables de La Fontaine» : 1)
Plus concrètement, dans un premier temps, les élèves sont amenés à découvrir le site internet du Bodmer Lab ainsi que l’iconothèque qu’il propose. Ils doivent choisir des illustrations et indiquer la raison de leur choix. À l’aide d’un questionnaire guidé et d’extraits de textes critiques, les élèves se familiarisent avec un vocabulaire lié à l’esthétique ainsi qu’aux fonctions de l’illustration dans Les Fables et tout particulièrement dans la première édition de ce texte. Ils poursuivent ensuite le questionnaire en naviguant dans plusieurs éditions des Fables et en consultant les illustrations de celles-ci. Il s’agit à la fois de développer les compétences des élèves en matière de navigation en ligne mais aussi leur aptitude à rechercher et à sélectionner des informations précises. Puis, une étude plus approfondie de «La Cigale et la Fourmi» propose aux élèves de comparer plusieurs illustrations entre elles ainsi qu’avec le texte. Il s’agit ici pour les élèves de constater l’existence d’une variété d’illustrations pour une seule et même fable. Les illustrations sont alors le fruit de décisions prises par les illustrateurs quant à la manière de faire apparaître les personnages de l’apologue ou encore quant à la scène de la fable représentée sur l’image. Enfin, l’activité se termine sur la comparaison de quatre illustrations de la fable «Le Chêne et le Roseau». Les élèves sont alors invités à reconnaître l’artiste ayant représenté la fable dans les différentes vignettes proposées, et il leur est demandé de préciser le «style de l’illustration».
Dans cette série d’exercices, nous retrouvons une grande partie des discussions qui ont été menées lors des rencontres avec les chercheuses du Bodmer Lab. Il est aussi intéressant de souligner que l’enseignant a cherché non seulement à familiariser les élèves avec plusieurs illustrations et plusieurs illustrateurs mais aussi avec les outils numériques développés pour donner accès à celles-ci. L’activité proposée par l’enseignant semble donc à l’image de la formation qu’il a reçue; celle-ci a consisté, d’un côté, à montrer l’étendue des données récoltées sur les illustrations par le Bodmer Lab et, de l’autre, à présenter des outils inédits pour atteindre ces illustrations.
«Rédaction d’une fable à partir d’une lecture d’image»
La deuxième activité par cet enseignant a pour objectif principal la rédaction d’une fable à partir d’une illustration. Dans le descriptif proposé par l’enseignant, quatre autres visées sont également mentionnées: approcher la notion de littérature secondaire, découvrir l’exercice de l’analyse d’une image, sensibiliser les élèves aux liens entre le texte et l’image et finalement les exercer à l’écriture de fables. Une nouvelle fois l’activité est pensée pour une durée d’environ cinq à six séances de cours. Les exercices présentés dans cette activité alternent entre la lecture d’extraits de textes de littérature secondaire portant sur les illustrations et des questions orientées visant à permettre aux élèves d’analyser l’illustration et ses relations avec le texte présenté. La progression dans l’activité est la suivante: après un questionnaire guidé sur la vignette de la fable de «La Cigale et la Fourmi» de l’édition originale, des exercices sont proposés autour de vignettes proposant plusieurs saynètes dans une seule et même illustration, distinguant notamment la morale des autres événements. Enfin, une image est proposée aux élèves, à partir de laquelle ils sont invités à élaborer le texte d’une fable.
L’activité imaginée ici s’inspire une nouvelle fois des médiations réalisées par le Bodmer Lab. Mais cette activité est effectuée exclusivement sous format papier. Cela signifie que les élèves ne manipulent pas directement les outils numériques créés comme l’iconothèque ou encore les éditions numérisées des textes. Ici c’est plutôt le rapport entre texte et illustration qui est étudié, dans la perspective de permettre aux élèves de cerner la structure générique d’une fable ainsi que le lien entre l’interprétation de la fable et l’illustration qui l’accompagne. Il s’agit alors de permettre aux élèves d’élaborer une fable dont l’illustration existe déjà. Le processus est inversé par rapport à la pratique habituelle qui voudrait que l’illustration se présente comme un complément au texte. Ici c’est le texte qui s’inspire de l’illustration et qui se construit autour de celle-ci.
«Liens entre le texte et les illustrations des Fables»
La troisième activité créée par des enseignants s’adresse d’abord à des élèves du degré secondaire II, puisque c’est avec une classe de 2ème année de maturité gymnasiale qu’elle a été expérimentée. L’activité s’intitule «Liens entre le texte et les illustrations des Fables» et elle présente une série de cinq objectifs:
- Découvrir l’iconothèque du Bodmer Lab, se familiariser avec son utilisation et être capable de l’exploiter pour une production écrite.
- Découvrir les illustrations anciennes des Fables présentes dans l’iconothèque du Bodmer Lab.
- Découvrir des outils pour analyser les illustrations et apprendre à les utiliser.
- Prendre conscience de l’impact de l’image au niveau de l’expérience de lecture et de l’interprétation du texte.
- Confronter différentes lectures d’une même fable, à travers la comparaison de différentes illustrations. (Fiche d’activité «Liens entre le texte et les illustrations des Fables»: 1)
À la fin de l’activité, il est attendu que les élèves effectuent des présentations orales du travail réalisé par groupe, en réponse à la consigne suivante:
«(1) Choisissez une fable que vous aimez tout particulièrement. (2) Recherchez dans l’iconothèque les différentes illustrations de la fable choisie. (3) Analysez chaque illustration, à l’aide du questionnaire.* (4) Choisissez l’illustration (ou les illustrations) qui, d’après vous: (a) présente(nt) au mieux l’histoire que la fable raconte; (b) rend(ent) au mieux la fable, sa morale, sa signification, l’interprétation que vous en donnez. (5) Justifiez votre choix!». (Fiche d’activité «Liens entre le texte et les illustrations des Fables»: 1)
Le document à destination des élèves contient une série de questions inspirées de la fiche réalisée par la chercheuse du Bodmer Lab portant sur le rapport entre le texte et l’illustration. Il s’agit d’une reprise du questionnaire heuristique emprunté à Stefan Schoettke (1997). Nous constatons ici que le travail de médiation réalisé par les chercheurs/euses du Bodmer Lab a été plus qu’intégré par les enseignant·es puisqu’ils ont repris les grandes lignes de ce document. Plus concrètement, l’articulation entre le texte et les illustrations est à découvrir en progressant dans le questionnaire de Schoettke. Les questions portent alors sur l’illustration, dans le but de cerner les personnages de la fable qui sont mis en scène dans l’image, le moment de l’histoire qui figure sur celle-ci, le traitement appliqué par l’artiste à la scène retenue, la question de l’anthropomorphisme ou encore la relation, plus globale, entre le texte et l’histoire racontée.
En somme, les médiations proposées aux enseignant·es pour intégrer la question de l’illustration dans les activités élaborées pour des élèves du degré secondaire ont, semble-t-il, été d’une grande utilité. En effet, elles ont permis non seulement de cerner l’étendue des enjeux et débats sur la question, mais également de diffuser de nouveaux outils utilisables depuis l’espace de la classe – iconothèque et plateforme de consultation des éditions numérisées. Si les rapports entre le récit de la fable et le moment représenté sur l’image fait l’objet de plusieurs activités, l’illustration est aussi traitée comme un objet d’analyse à part entière et cela vient peut-être du pari d’accorder à la matérialité de l’œuvre une attention particulière.
Conclusion
Cet article avait pour ambition de décrire les médiations mises en œuvre dans le cadre du projet «La Fontaine à l’école numérique» pour permettre aux enseignant·es d’intégrer les illustrations dans les activités proposées aux élèves.
Il nous semble pertinent de revenir sur l’articulation proposée entre approche matérielle des textes et prise en compte de l’illustration. À partir de ce travail effectué sur le corpus des Fables de La Fontaine en version numérisée, et en réfléchissant à la place que nous avons accordée dans les réflexions menées dans le cadre du projet sur les illustrations, il nous paraît cohérent de considérer l’illustration comme faisant partie intégrante de la dimension matérielle de l’œuvre. En effet, non seulement l’illustration est intrinsèquement liée à l’objet-livre dans lequel le texte est inscrit, mais en outre, l’analyse qui peut être menée sur celle-ci fait ressortir de nombreuses dimensions de l’approche matérielle des textes. L’étude des illustrations fait intervenir des questions liées au processus de fabrication de l’image autant qu’aux choix réalisé par l’illustrateur/trice (ou par l’éditeur/trice) quant à la représentation donnée du texte.
Constatant la prudence des enseignant·es à intégrer les illustrations lors d’exercices portant sur l’interprétation littéraire, nous avons pris le parti de compléter la formation de ceux-ci sur les premières illustrations des Fables. Grâce à un partenariat étroit avec le projet de recherche du Bodmer Lab, nous avons pu mettre en relation directe des enseignant·es du secondaire et des spécialistes de l’histoire de l’art ou encore de la littérature du XVIIe siècle. Cette collaboration a ensuite donné lieu à des activités pédagogiques destinées aux élèves, et inspirées de la formation que nous avions pu proposer. Le modèle de recherche – recherche collaborative – mis en œuvre dans cette recherche a facilité le déplacement des connaissances, du domaine de la recherche savante vers celui de la classe, tout en reconnaissant l’expertise de chacun durant le processus. Soulignons enfin l’importance des outils développés par les enseignant·es pour permettre aux enseignant·es de s’emparer de ces questions iconographiques – et donc de mettre à profit dans un tel projet à la fois leur expérience et leur expertise.
Bibliographie
Allott, Terence (2000), «Les éditions des Fables choisies mises en vers publiées du vivant de l’auteur et leur illustration», Le Fablier, no. 12, Paris, p. 9-34.
Chartier, Roger (1985), Pratiques de la lecture, Rivages, Paris.
Chartier, Roger, Jean, Lebrun (1997), Le livre en révolutions: entretiens avec Jean Lebrun, Les éditions Textuel, Paris, 1997.
Chartier, Roger (1998) «Chapitre XI» in Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et incertitudes, Albin Michel («Bibliothèque des histoires»), Paris.
Chartier, Roger (2015), La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur. XVIe-XVIIIe siècles, Gallimard [Folio histoire], Paris.
Citton, Yves (2017) «Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images», Transpositio, n°1, en ligne, URL: https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-dans-l-univers-des-techno-images (consulté le 19 avril 2024).
Cornuaille, Philippe, Alain Riffaud (2018) «Enquêtes sur les premières éditions des Fables de La Fontaine (1668)», Bulletin du bibliophile, no.2, Paris, p. 246-280.
Curat, Hervé (2016), «Regarder écouter lire. La dimension visuelle des Fables de 1668», Le Fablier, n° 27, p. 61‑71.
Serge Desgagné (dir.) (2001), «L'approche collaborative de recherche en éducation: un rapport nouveau à établir entre recherche et formation», Revue des sciences de l'éducation, volume 27, numéro 1, p. 33–64, en ligne, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2001-v27-n1-rse369/000305ar/ (consulté le 05.08.2022).
Jacob, Christian (2001), «La carte des mondes lettrés» in Des Alexandries, tome I. Du livre au texte, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2001.
Jacob, Christian (2001), «L’art de lire», in Des Alexandries, tome II. Les métamorphoses du lecteur, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2004.
Lacelle, Nathalie, Jean-François Boutin, Monique Lebrun (2018), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, LLM@. Outils conceptuels et didactiques, Presses de l'Université du Québec, Canada.
McKenzie, Donald (1991), La bibliographie et la sociologie des textes [1986], trad. Marc Aureville, Cercle de la Librairie, Paris.
Schoettke, Stefan (1997), «Réflexions sur les rapprochements entre la fable selon La Fontaine et le genre de l’emblème», Le Fablier, no. 9, p. 31-42.
Vinatier, Isabelle, Joëlle Morrissette (2015), «Les recherches collaboratives: enjeux et perspectives», Carrefours de l'éducation, vol. 39, no. 1, pp. 137-170, en ligne, URL: https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2015-1-page-137.htm (consulté le 15 août 2022).
Sites internet et éditions consultables en ligne
«Iconothèque», site rattaché au site du Bodmer Lab, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/iconotheque/#/lafontaine/1072035095_017_1_-edition:1818 (consulté le 25 janvier 2024).
Site internet du Bodmer Lab, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr (consulté le 25 janvier 2024).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, éd. Claude Barbin, 1668, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072035109 (consulté le 30 janvier 2023).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, éd. Denys Thierry, 1668, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072035108?page=109 (consulté le 30 janvier 2023).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, et par luy reveuës, corrigées & augmentées, éd. Denys Thierry, Claude Barbin, Paris, 1678, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072055785 (consulté le 30 janvier 2023).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. J. de La Fontaine, éd. Desaint & Saillant, Durant, Charles-Antoine Jombert, Paris, 1755, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072056065 (consulté le 30 janvier 2023).
il est permis à Claude Barbin Libraire à Paris, d’imprimer les Fables choisies par M. de la Fontaine, avec défense à tous autres d’en imprimer vendre ou débiter sans son consentement, d’autres que celles par lui imprimées, ou par Denys Thierry, Libraire à Paris, auquel il a cédé la moitié de son Privilège; & ce sous les peines portées les plus amplement par ledit Privilège. («Extrait du Privilège du Roi», Fables Choisies et mises en vers par M. de La Fontaine, 1668, [en ligne], consulté le 12.01.2024: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/mirador/1072035108?page=356, typographie modernisée par nos soins).
Pour citer l'article
Barbara Hurni-Siegrist, "Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/accompagner-des-enseignant-es-pour-parler-des-illustrations-le-cas-du-projet-la-fontaine-a-l-ecole-numerique
Voir également :
Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
L’approche en parallèle des versions romanesque et dessinée de Quelques mois à l’Amélie, de J.-C. Denis met en évidence certaines des caractéristiques propres à chaque genre ou forme.
Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
Introduction
Cette contribution vise à examiner l’intérêt d’une préparation spécifique à l’écriture d’invention 1(Denizot, 2022) ou écriture créative (Ulma et alii, 2022) qui soit axée sur les formes ou les genres textuels (Jacquin, 2018) mobilisés. La réflexion se fonde sur une expérience menée en classes de Terminale, qui porte sur la comparaison de deux versions (roman et bande dessinée) d’un même récit (Quelques mois à l’Amélie, de J.-C. Denis), pour en dégager les spécificités en termes de moyens expressifs et d’effets sur le lecteur. Le dispositif décrit s’inscrit dans l’optique d’une préparation à l’écriture d’invention, en l’occurrence une «transposition transgenre» (Abolgassemi 2001: 26), de la forme dessinée à la forme romanesque ou inversément.
Le contexte institutionnel
Les instructions officielles pour l’école secondaire en Belgique francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018)ont récemment consacré l’écriture d’invention, en la considérant comme une activité qui doit faire l’objet d’une évaluation. L’évolution qui a conduit à cette reconnaissance avait commencé avec les instructions de 1999 qui suggéraient déjà de «sensibiliser» à cette pratique. Les textes du prescrit légal imposent cependant une restriction importante, puisque l’Unité d’Acquis d’Apprentissage n°5 (UAA5) limite la pratique de l’écriture d’invention à trois formes, parmi beaucoup d’autres (Abolgassemi 2001: 26-27): l’amplification, la recomposition et la transposition. La créativité des élèves ne s’exerce donc pas ex nihilo, mais à partir d’œuvres artistiques ou littéraires dont la compréhension est indispensable pour la réalisation de la tâche demandée.
Le lien entre lecture et écriture est ici très fort, puisqu’il s’agit de s’appuyer sur une ou des œuvres lues pour en faire écrire une autre. C’est ce que Genette dénomme une «littérature au second degré», qui «s’écrit en lisant» (1982). Il ne s’agit donc pas de produire un commentaire mais un texte, au sens littéraire, ce qui implique d’aborder l’œuvre source ou «hypotexte» (Genette 1982: 11) avec une intention particulière, strictement encadrée dans le contexte scolaire belge, comme nous l’avons dit.
Le cas qui nous occupe est celui de la transposition, définie par Abolgassemi (2001: 26-27) comme la réécriture, avec action sur six indices: le mode, la focalisation, le style et les registres, le contexte, la versification ou la prose, le genre. En termes d’écriture d’invention, la tâche de transposition peut dès lors sembler faire l’objet d’une injonction apparemment contradictoire: l’élève doit développer une interprétation personnelle de l’œuvre source, tout en respectant celle-ci. Ainsi, «l’imagination personnelle des élèves est […] valorisée, mais seulement en tant qu’elle s’inscrit dans la démarche très précise indiquée par les protocoles d’écriture de l’énoncé.» (Abolgassemi 2001: 18). Il s’agit donc d’un «projet créatif complexe, tendu entre appropriation personnelle et imitation» (Brunel et alii 2023: 94).
Concrètement, dans les classes de Belgique francophone – que nous fréquentons depuis longtemps2 – les enseignants de français ont souvent tendance à mettre l’accent sur le respect de l’hypotexte: ils ne font en cela que suivre les instructions officielles. La tâche de transposition est alors préparée par une analyse, qui vise – dans le cas le plus fréquent – à dégager les contraintes propres à l’œuvre source qui devront être prises en compte dans la version nouvelle à produire. Or le problème spécifique de la «transposition transgenre» (c’est l’un des cas envisagés par Abolgassemi en 2001) est celui de la maitrise des deux genres ou formes mobilisés dans l’opération3. Nous utilisons ici la formule «genre ou forme», car nous sommes au carrefour de plusieurs contraintes en termes de concepts: d’une part, on sait quel flou entoure la notion de «genre» (Simons, 2018) reprise pourtant par Abolgassemi (2001), et très présente en didactique (Schneuwly, 1994), mais elle nous semble un peu restrictive face aux deux objets narratifs qui nous occupent, entre lesquels la différence peut être plutôt qualifiée de «formelle». Nous userons donc des deux termes simultanément.
Sur un plan plus général, Schneuwly avait déjà montré combien ce qu’il appelle le genre est utile face à tout type de tâche: «On pourrait […] considérer le genre comme un méga-outil, comme une configuration stabilisée de plusieurs sous-systèmes sémiotiques […] permettant d’agir efficacement dans une classe bien définie de situations de communication.» (Schneuwly 1994: 162). Son idée sera reprise par Simons, pour l’étendre au domaine des langues étrangères, en insistant sur les tâches de production: «La maitrise des caractéristiques d’un genre textuel est un outil qui permet d’agir dans une situation de communication donnée, tant en réception qu’en production.» (2018: 48).
Or, plus encore que dans d’autres tâches, la maitrise des caractéristiques génériques ou formelles est centrale dans le cas d’une telle transposition, puisqu’il s’agit de travailler sur le genre ou la forme de l’hypotexte fourni, pour en transformer les modalités, en vue de le conformer au genre ou à la forme de l’hypertexte à produire. On peut considérer, comme l’un des pères de la BD, le Suisse Rodolphe Töpffer (1840)4, que l’opération s’apparente à une forme de traduction d’un langage dans l’autre: en l’occurrence celui du roman et celui de la bande dessinée.
Le plus souvent, la forme romanesque est assez bien maitrisée par les enseignants (elle était au cœur de leur formation) et plutôt bien connue des élèves (elle est au programme). La BD est de plus en plus prise en compte par les didacticiens, comme en témoigne le numéro 4 de Transpositio (2021), mais elle reste par contre peu utilisée dans les séquences produites par les enseignants (Gennaï 2023: 23); sa lecture en classe est encore rare (Beghin 2021: 15, Depaire 2019), et «sa place [est] très marginale parmi les œuvres lues»(Blanchard & Raux 2019: 1). On l’explique souvent par le fait que la familiarisation avec le langage de l’image n’est pas une priorité dans la formation des enseignants de français. Une autre raison est le poids accordé à la littérature patrimoniale au collège et surtout au lycée. Enfin, selon Rouvière, confirmé récemment par Vrydaghs (2022: 4), l’approche de la BD – lorsqu’elle a lieu – est souvent marquée par l’importance «des questions d’observation formalistes et techniques, souvent détachées du sens…» (2012: 13).
Les finalités de l'activité proposée
L’activité que nous présentons se distingue tout à fait de l’analyse d’une œuvre classique, où la BD serait instrumentalisée comme un succédané du roman. Ce dispositif qui place la BD dans une situation ancillaire face à la littérature est assez fréquent (Ahr 2012: 198, Duvin-Parmentier 2020: 6; Vrydaghs 2022: 2), parfois dénoncé comme un «alibi» (Étienne & Mongenot 2023: 6) ou présenté comme une «ruse didactique» (Zakhartchouk 1999).
Notre objectif n’est pas l’acculturation – par un moyen détourné – à une œuvre du patrimoine, puisque le cas analysé est tout à fait particulier, voire exceptionnel: il n’y a pas ici de texte princeps (Étienne & Mongenot 2023: 12), ni de statut auxiliaire de la forme BD, qui ne s’inscrit donc pas dans la catégorie de ce que Louichon a dénommé «objets sémiotiques secondaires» ou OSS (2017: 24). Par ailleurs, le roman et la BD convoqués sont des œuvres contemporaines (2002), totalement dépourvues du prestige des classiques du patrimoine littéraire.
La confrontation des deux formes doit permettre de montrer certaines spécificités du roman et de la BD. L’idéal serait donc de proposer à l’analyse deux versions d’un même récit nées de la même plume, car on pourrait alors supposer l’existence d’une intention similaire (un seul et même créateur), servie par des moyens différents. Notre démarche répondrait ainsi au souhait de Sophie Beghin: «littérature et bande dessinée récolteraient toutes deux bien des avantages à s’envisager comme complémentaires, chacune pouvant éclairer les spécificités de l’autre pour autant qu’on les envisage dans leur nature propre (2021:19).
Nous souhaitons privilégier l’approche des formes ou genres et de ce qu’elles ou ils impliquent, de par leur nature, en termes de réception. La volonté est de mettre au jour certains invariants génériques des formes comparées, invariants qui conditionnent l’expérience de réception. La comparaison que nous proposons devrait donc permettre de mettre en évidence, aux yeux des élèves, combien les différences de moyens influencent leur expérience de lecture de l’œuvre. Cette activité d’analyse vise à les sensibiliser à ces paramètres,en vue des tâches de transposition qui leur seront ultérieurement demandées.
Nous souhaitons donc dépasser la simple comparaison, qui tient parfois lieu de finalité en soi (Gennaï 2023: 32), pour dégager des outils et des savoirs utiles à une tâche de création. Nous nous inscrivons ainsi dans «une démarche d’enseignement de la production par analyse et/ou imitation de textes-modèles» (Jacquin 2018: 22). Les enseignants de terrain savent que l’écriture d’invention pose un problème particulier: les tâches de création, même lorsqu’elles évitent le travail ex nihilo, fortement affecté par le syndrome de l’angoisse devant la page blanche, nécessitent de proposer aux élèves des productions qui ont valeur de modèles. C’est le constat de Rouvière (2017) lorsqu’il analyse son expérimentation (en classe de Seconde) d’une transposition de Nana en BD: il considère l’étude préalable d’un exemple comme nécessaire.
Les deux formes de l’œuvre
Dans la quasi-totalité des cas de transposition d’un roman en BD (Ahr 2012), le lecteur a affaire à des artistes différents, ce qui conduit presque naturellement le ou les créateurs de la nouvelle version à introduire des interprétations personnelles. Tout exercice de comparaison se heurte donc à une difficulté: comment faire le départ entre les changements forcés, liés à la forme (passage d’un langage à l’autre), et ceux qui sont choisis par le ou les artistes créateurs de la version seconde ?
Aborder la question des genres ou formes à travers une approche comparative exige de pouvoir disposer d’un matériau que nous oserons qualifier de très rare: deux versions d’une même œuvre, produites simultanément par un même artiste. Dans le cas qui nous occupe, l’auteur est unique mais s’exprime sous deux formes: les deux œuvres de Jean-Claude Denis (Grand Prix d’Angoulême, 2012) sont intitulées Quelques mois à L’Amélie (éditions PLG, 2002 - Dupuis, 2002).
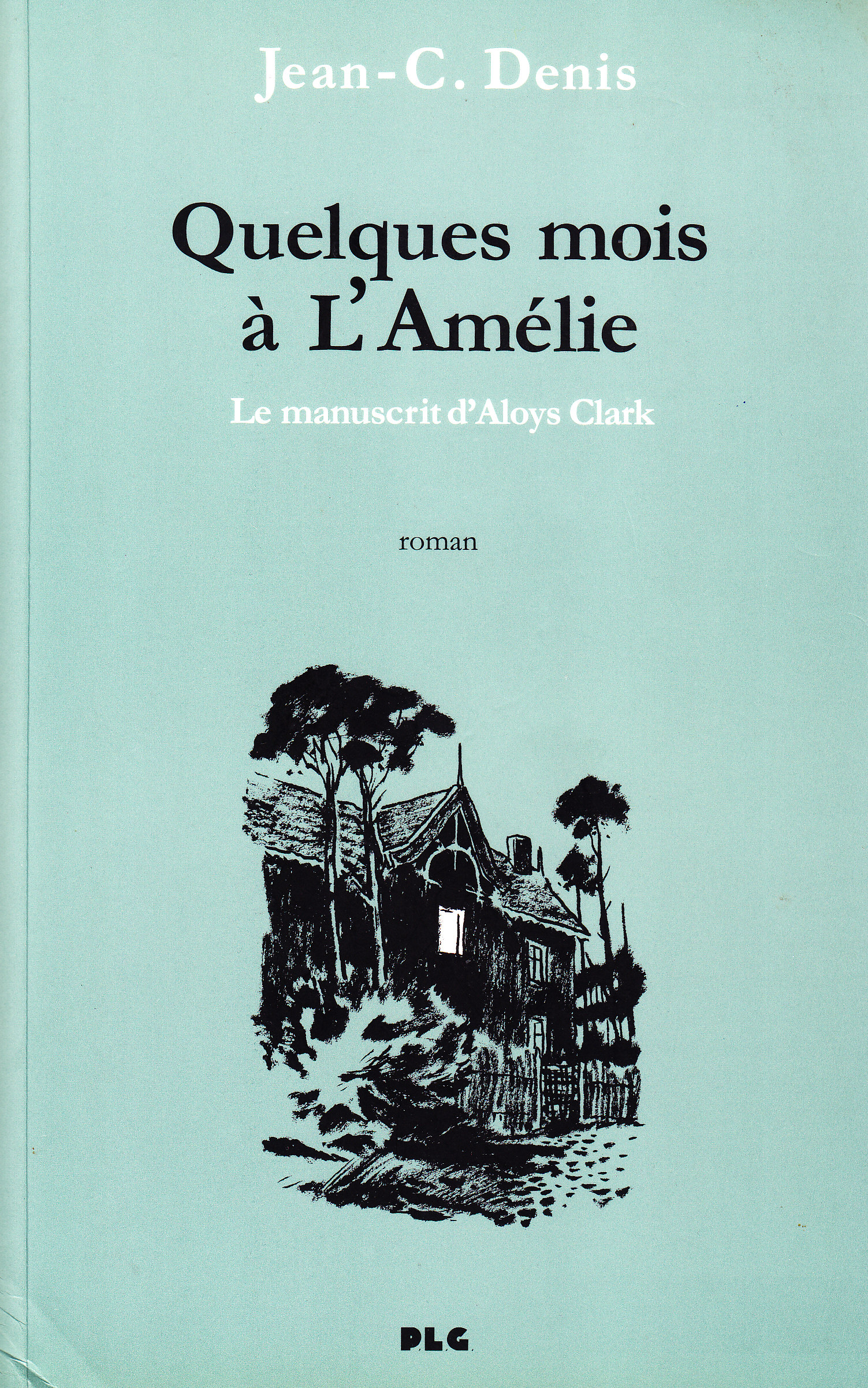

Images 1 et 2 - Les deux couvertures
Le héros est un écrivain en panne d’inspiration, qui se retrouve un peu par hasard dans un coin perdu du Sud-Ouest. Son histoire montre l’envers du décor du secteur de l’édition contemporaine et raconte comment une rencontre sentimentale relance son envie d’écrire.
Ces deux versions d’un même récit se présentent comme suit: la BD compte 72 pages, suivies de quelques pages d’un «Dossier» qui annonce l’existence du roman, écrit «parallèlement à la réalisation de [l]a bande dessinée», et donne trois extraits du texte, accompagnés de cinq illustrations. Le roman publié aux éditions PLG (92120 Montrouge) offre 213 pages, dont 36 occupées par des illustrations originales en noir et blanc et réalisées par l’auteur. En 2022, le catalogue de l’éditeur proposait «la version romancée de la bande dessinée du même nom» dans une nouvelle édition.
Il ne s’agit donc pas d’une transposition au sens strict, puisque nous ne savons pas (sauf à interroger l’auteur) quelle forme préexistait avant l’autre. Les deux versions entretiennent pourtant une relation particulière, vu que le roman est une autobiographie d’Aloys Clark, héros… de la BD, qui remet le manuscrit à Marianne, la femme qu’il aime, dans la dernière planche de l’album. Le roman est d’ailleurs sous-titré «Le manuscrit d’Aloys Clark» et dédicacé «à Marianne». À la fois objet intra-diégétique (Marianne va le lire) et extra-diégiétique (nous pouvons le tenir en main), le roman jouit donc d’un statut ambigu.
Le dispositif
Expérimentée personnellement en tant qu’enseignant de lycée en 2015-2016 et 2016-2017 auprès d’élèves de 17-18 ans inscrits dans l’enseignement qualifiant5, l’activité occupe au minimum deux heures consécutives et ne nécessite pas de lire les œuvres en entier. Le dispositif consiste à mettre en parallèle un court extrait des deux formes de l’œuvre; c’est ainsi que les trois premières planches, qui correspondent approximativement aux pages 5 à 9 du roman, ont été choisies. Outre l’intérêt de ce passage du récit pour notre propos, le choix de l’incipit a pour avantage de permettre à tous de commencer la lecture sans aucune préparation. Il s’agit donc «d’étudier [un] moment-clé dans deux systèmes sémiotiques différents» comme Castagnet-Caignec (2023: 122) le réalise avec des élèves du primaire à propos du Journal d’un chat assassin d’Anne Fine (École des loisirs/Rue de Sèvres, 1997/2021). La chercheuse en viendra à conclure (2023: 123) que l’étude simultanée des deux objets semble plus profitable aux élèves en termes de compétences de lecture littéraire.
Selon nous, l’analyse des deux formes de l’œuvre gagne à être menée en parallèle avec les élèves; elle suppose évidemment la projection en classe des deux supports (les planches de la BD et les pages du roman) et autorise un fonctionnement de leçon où l’enseignant conduit le groupe à travers un jeu de questions. Ce travail en parallèle pose la question de savoir par où commencer l’observation: la BD ou le roman ? Dans les lignes qui suivent, nous adoptons le plus souvent cet ordre, pour des raisons de clarté, mais il nous semble que, dans la pratique, on gagnerait à procéder en fonction des acquis des élèves, pour aller de la forme la plus connue vers la moins familière. Ajoutons que l’on pourrait prévoir dans la foulée une deuxième tâche où les élèves analyseraient, en autonomie, une autre planche et son correspondant romanesque, ce qui permettrait d’asseoir leurs acquis. Il va de soi aussi qu’un moment d’institutionnalisation des apports de l’activité est nécessaire pour fixer les découvertes dans l’esprit des élèves. Mais cette contribution entend se focaliser sur la première tâche de comparaison. Nous donnons ci-après un bref aperçu des contenus à dégager de cette première activité à mener avec les élèves.
L'analyse des deux formes
La première planche commence par un plan d’ensemble (vignette 1) puis un gros plan (vignette 2), là où le roman procède de manière classique pour un début (Verrier 1992): il précise lieu, temps, et relations. Dans la BD, la focalisation varie: d’abord externe pour donner à voir les lieux et les personnages, elle se fait vue subjective pour la troisième vignette. Le roman fonctionne plutôt comme un récit en «je» avec un narrateur-personnage (Dumortier 2001: 64) et dès la première page, un «récit de pensées» assez long permet d’entrer dans la vie intérieure du personnage. Ce choix est presque impossible pour la BD, qui recourt pourtant à un subterfuge avec la vignette 3 en nous donnant à voir, non pas ce qui est, mais ce que le personnage imagine (son père allongé dans son cercueil, mais habillé en uniforme militaire d’été).
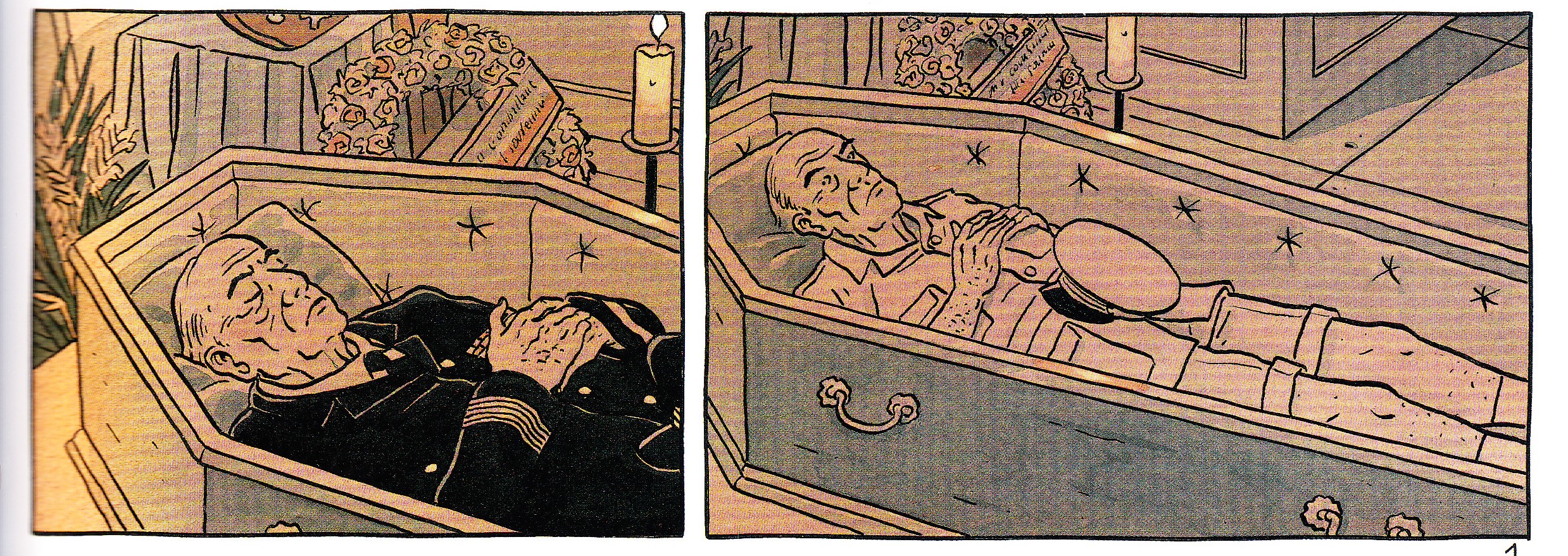
IMAGE 3- Vignette 3 de la planche 1
Le statut de toute cette scène du funérarium ne sera éclairci que dans la deuxième planche de la BD, alors que le roman signale dès la dixième ligne que nous sommes dans un souvenir du héros: «[…] la scène du funérarium me revenait souvent en mémoire».
La deuxième planche s’ouvre par une vignette dont la compréhension n’est pas évidente: certains détails de l’image sont en effet logiquement inconciliables (le costume noir porté en juin au funérarium et la pluie battante de décembre sur la vitre). L’action de la BD était pourtant située très clairement par une mention initiale du narrateur externe: «Paris, décembre 2000». La vignette ne représente donc aucune réalité, mais marque le moment d’une ellipse spatio-temporelle ou d’un retour au réel, la fin d’une rêverie, bien concrétisée dans la vignette suivante.

IMAGE 4 - Vignette 1 de la planche 2
Ce mouvement est bien plus clairement annoncé dans le roman, qui marque la transition en passant à la ligne et en donnant la réflexion d’une interlocutrice qui interrompt la rêverie. Cette transition est d’ailleurs explicitée dans le récit de pensée du narrateur qui se demande: «Depuis combien de temps étais-je debout devant cette fenêtre, à regarder tomber la pluie et à me repasser la scène du funérarium ?». Le roman bascule ensuite dans une scène aux dialogues très complets, assortis de réflexions personnelles nombreuses. Dans la BD, ce passage est rendu en huit cases, avec des dialogues réduits (vu le manque d’espace) et des cadrages très variés qui permettent de mettre en évidence des attitudes corporelles lourdes de signification (mais à décoder…). Alors que le roman doit consacrer quelques mots à décrire la jeune éditrice qui aborde le narrateur-héros, la BD n’en fait évidemment rien: les cadrages variés ont permis de décrire l’ambiance mondaine et de donner à voir le physique des personnages.
Après deux vignettes consacrées aux derniers échanges entre l’éditrice et le héros, la troisième planche marque une ellipse spatio-temporelle: ce dernier a quitté la soirée et se trouve dans un taxi.
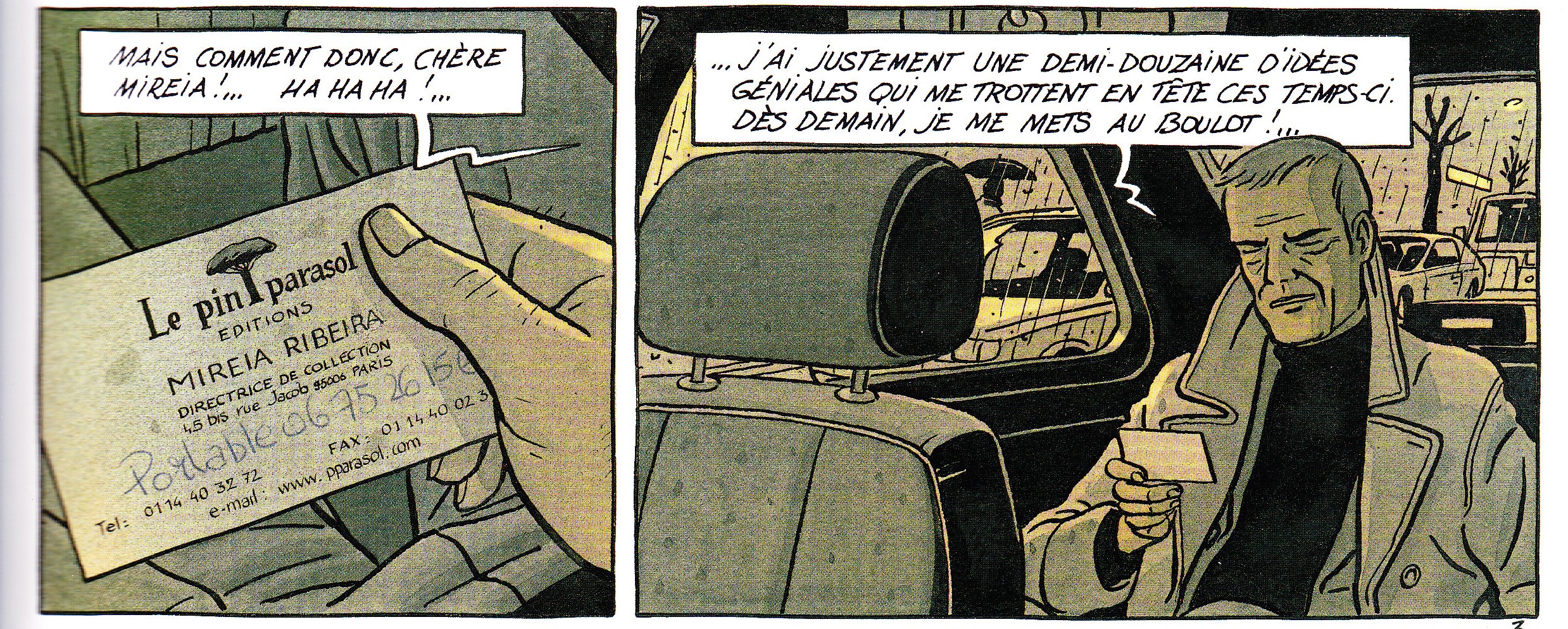
IMAGE 5 – Vignettes 3 et 4 de la planche 3
Nous ne le comprenons que progressivement, car la troisième vignette est une vue subjective (en gros plan) sur une carte de visite (reçue de la jeune éditrice). La quatrième nous montre le héros assis à l’arrière d’un véhicule, la carte en main. Dans un mouvement progressif d’éloignement, nous retrouvons la carte en morceaux qui tombe dans un caniveau. Une nouvelle fois, le roman se fait bien plus explicite, racontant le départ de la soirée, évoquant un dialogue avec le chauffeur de taxi, décrivant la carte de visite et livrant une interprétation de la démarche de l’éditrice.
Les apports de l'activité
De ces quelques éléments d’analyse, la première impression qui se dégage est sans doute que la lecture de la BD semble plus difficile que celle du roman, indépendamment d’un éventuel manque d’expérience des codes graphiques. Par exemple, là où le roman explicite verbalement une information, la BD exige du lecteur qu’il interprète des images ou un comportement traduit par celles-ci. On notera le même constat sur la difficulté chez Prévost (2023: 85) et Castagnet-Caignec (2023: 123) avec des œuvres adressées aux enfants, où le risque existe de créer de nouveaux problèmes pour les élèves, en introduisant des genres ou formes auxquels ils ne sont pas préparés (Bautier et alii 2012: 63). Raux fait la même observation avec un public adolescent (2021: 4) et nous avons rencontré les mêmes obstacles avec nos élèves de Terminale en options technologiques.
Quels seraient néanmoins les apports de cette comparaison, pour un enseignant de français et pour ses élèves ? On peut considérer que la première distinction qui risque d’apparaître sera celle du mode de représentation. En explicitant très souvent ce qui n’est que suggéré par la BD, le texte du roman raconte là où la BD ne fait que montrer, exigeant du lecteur qu’il décode et interprète ce qui est donné à voir. Ainsi, les attitudes corporelles visibles dans les vignettes qui montrent le dialogue (regard fuyant, gestes de mise à distance, évitement du face à face) doivent être analysées si l’on veut percevoir tout l’embarras de l’écrivain face à l’éditrice. Un embarras par contre explicitement affirmé par le narrateur-héros du roman, qui nous livre ses sentiments sans retenue. On retrouve ici la vieille distinction entre «montrer» et «raconter» initiée par Lubbock en 19216, développée par Genette («récit d’événements» et «récit de paroles» 1972: 186), et reformulée par Goldenstein (1999: 43) comme une opposition entre «représentation» et «relation». Conçue pour distinguer les formes de roman, cette distinction prend un tour particulier si on la mobilise dans une comparaison entre roman et BD. Car, sauf lorsqu’elle est pourvue d’un récitatif (Masson 1985: 26) équivalent d’une voix off cinématographique, mais absent dans nos trois planches, la BD ne fait que donner à voir, alors que le narrateur-héros du roman peut raconter et commenter, comme c’est le cas ici. Contrairement aux idées reçues, c’est donc bien la forme BD qui semble ici l’objet le plus «résistant» (Tauveron, 1999) à la sagacité du lecteur…
La tâche de comparaison présente en outre un intérêt très spécifique par rapport aux notions de base de la narratologie. En observant deux formes d’un même récit, où les choix effectués et les moyens mobilisés sont différents, les jeunes lecteurs perçoivent sans doute mieux les procédés et leur impact que s’ils étaient face à un texte romanesque. Ainsi la notion de «vitesse» (Genette, 1983: 22-25), de «cadence» narrative ou de «rythme» narratif (Dumortier 2001: 51) peut-elle émerger dans la lecture comparée des deux formes. Les élèves peuvent notamment mesurer combien la nécessité des descriptions romanesques et l’espace laissé aux monologues intérieurs du narrateur ralentissent le rythme du roman. Grâce à la comparaison, les procédés narratifs deviennent, comme le dit Rouvière (2021: 13), «littéralement visibles». En 2012 déjà, Meyer l’avait compris:
La particularité de la transposition […] sous la forme d’une bande dessinée est de faire voir la narration. […] Ce déploiement visuel du récit, monstratif, faudrait-il dire, est une entrée possible pour l’enseignement-apprentissage du récit en tant que forme, autrement dit le lieu d’une didactique du récit dans la classe. (Meyer 2012: 160-161).
Pour l’élève, l’activité permet de «réfléchir sur son activité de récepteur double» (Étienne & Mongenot 2023: 12) et sur l’interaction entre les deux lectures menées en parallèle. Il peut identifier quels moyens sont propres à chaque forme d’art et mesurer les difficultés pour rendre telle ou telle information accessible au lecteur (par exemple lors de l’analyse de la vignette 1 de la planche 2). Confronté à des systèmes sémiotiques différents (textuel versus iconotextuel), il perçoit combien la «transsémiotisation (passage d’un système sémiotique à un autre) […] modifie la réception du public» (Castagnet-Caignec 2023: 119). L’étonnement de l’élève ferait alors écho à celui de Töpffer lorsqu’il convertissait lui-même en roman (1840) son Docteur Festus: «Je fus tout surpris et amusé de voir par quoi les deux langues différaient, que, pour faire comprendre les mêmes choses, il fallait les prendre par un bout et les montrer par une autre face.»7
Cette confrontation aux deux formes permet aussi de montrer combien les effets produits sont parfois très différents. On rappellera qu’il s’agit du même auteur et de la même histoire, et que, s’il y a des différences, elles sont surtout inhérentes à la forme choisie8. Le dispositif de l’activité devrait donc assurer la perception de l’impact de la forme sur le récepteur, répondant ainsi au souhait d’Étienne et Mongenot: «développer le geste interprétatif par la comparaison entre systèmes différents» (2023: 7). On veillera aussi à dépasser deux écueils. Le premier consisterait à pratiquer un simple «décryptage techniciste» (Duvin-Parmentier 2020: 14). Le second pourrait laisser croire que roman et BD s’équivaudraient, considérant l’image comme «un équivalent iconique du texte littéraire, malentendu qui occasionne des simplifications de sa «lecture» et des transferts qui risquent de l’instrumentaliser et de l’affadir» (Duvin-Parmentier 2020: 14).
La découverte de la relation texte-image, se fait ici par l’approche du genre iconotextuel qu’est la BD. La planche, en tant qu’»énoncé pluricodé, […] scripto-iconique» (Klinkenberg: 2020) sera d’autant mieux réceptionnée qu’elle montre une parenté certaine avec le texte du roman, mais aussi des écarts flagrants. Ainsi, les dialogues des cases font écho à ceux du roman, souvent sous une forme légèrement abrégée, car l’interaction avec l’image permet au dialogue de la BD de se passer de certains mots. De la même manière, la représentation spatiale des échanges, dans la BD, traduit un comportement d’agacement qui sera rendu par un récit de pensées dans le roman. Concrètement, on réalise le programme défini par Lacelle, puisque «le passage d’une forme […] à l’autre permet de démonter chaque «machine narrative» en analysant les codes utilisés et les effets produits par ces codes.» (2012: 126).
Des outils pour l'écriture d'invention
Dans la perspective d’une tâche de création, quels peuvent être les apports de l’activité d’analyse décrite précédemment ? On peut pointer deux tâches auxquelles notre activité sur Quelques mois à l’Amélie offre une préparation directe: transposer un extrait de BD en roman, et transposer un extrait de roman en BD. La deuxième tâche pose cependant un problème de compétences graphiques chez les élèves: pour contourner cette difficulté, nous préconisons soit l’usage d’outils informatiques (souvent chronophages), soit un format que nous dénommons storyboard. Issue du cinéma, la notion désigne une série d’images qui donnent vie à un scénario avant le tournage. Nous l’employons ici pour désigner une forme de BD embryonnaire où seuls les arbitrages formels ont été esquissés, sans que le dessin soigné des images ait encore été réalisé. Cette dernière étape dépasserait en effet les compétences de la grande majorité des élèves. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourra recenser quelques-uns des apports de notre activité de comparaison comme suit.
Pour l’écriture du roman, les élèves auront perçu la nécessité de créer des pauses descriptives et d’effectuer des choix en la matière: tout ne peut pas être décrit et choisir d’évoquer telle ou telle réalité est un arbitrage de l’auteur. Autre apport probable, la compréhension du rôle majeur joué par les choix en matière de point de vue narratif. Ici on peut voir que la BD, en suivant sans cesse le même personnage et en pratiquant plusieurs fois la vue subjective, fait écho au choix romanesque d’Aloys Clark comme narrateur-personnage. D’autre part, la perception de l’importance des récits de pensée et de l’impact du mode de représentation de ceux-ci devrait conduire à les inscrire dans le texte du roman. Et enfin, les élèves auront été sensibilisés à la nécessité de travailler la mention des temps et lieux pour situer l’action.
Pour la transposition d’un extrait de roman en BD, et vu les compétences artistiques limitées de beaucoup d’élèves, l’enseignant de français pourrait s’en tenir à un travail sur le storyboard, ce qui réduit (?) la tâche au découpage de la page, à la réalisation du croquis des vignettes, à l’écriture des phylactères et du récit. Cependant, l’activité de comparaison aura permis d’approfondir chez ces élèves de lycée la compréhension de l’économie du récit en BD, ce que certains ont pu dénommer une «grammaire» (Vrydaghs 2022: 9) ou un «langage BD» (Rouvière, 2021: 3), à savoir le caractère elliptique de la narration en cases, l’importance des choix en termes de format et d’implantation des vignettes, le rôle de la triple interaction dessins/phylactères/récit du narrateur (même si ce dernier est absent dans les trois planches choisies) ou encore la «difficulté à expliciter le monde intérieur des personnages» (Dürrenmatt 2013: 45)…
Une des principales difficultés, si l’on demande aux élèves de produire un storyboard, risque d’être celle du découpage du récit en images, pour créer un «enchainement narratif visuel» (Rouvière 2021: 13). Trop souvent, cet aspect de la tâche n’est pas pris en compte dans la préparation, mais l’approche comparative que nous suggérons permettrait sans doute d’attirer l’attention des jeunes lecteurs sur les choix opérés par l’illustrateur et de les mettre en condition de réaliser leurs propres choix en connaissance de cause.
Sur un plan plus général, l’expérience menée nous conduit à partager l’opinion d’Étienne et Mongenot quant à l’impact de la comparaison qui permet de «déboucher sur la lecture affinée de textes ultérieurs et donc […] construire une réelle compétence de lecteur.» (2023: 14). Au-delà, nous pensons que la compétence de scripteur se trouvera elle aussi renforcée par la comparaison des versions, parce que l’on aura sensibilisé les élèves aux particularités formelles propres à chacune9. En définitive, la comparaison des deux formes devrait aider à la transposition de l’une dans l’autre.
Bibliographie
Abolgassemi, Maxime (2001), L’écriture d’invention: écrire pour lire, lire pour écrire, Rennes, CRDP de Bretagne.
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bande dessinée. Sacrilège ou tremplin ?», in Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. De Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 197-208.
Bautier, Elisabeth, Jacques Crinon, Catherine Delarue-Breton & Brigitte Marin (2012), «Les textes composites: des exigences de travail peu enseignées ?», Repères, n° 45, p. 63-79.
Beghin, Sophie (2021), «La bande dessinée dans les classes de littérature: entre prescription et pratique», Transpositio, n°4.
Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, p. 1-8.
Brunel, Magali, Karady, Albane & Friscia, Vanessa (2023). «Diversifier les réceptions sensibles pour préparer la lecture de l’œuvre littéraire. Comment Wang Fo fut sauvé en classe de Sixième», Le Français Aujourd’hui, n° 220, 91-104.
Castagnet-Caignec, Sonia (2023), «Lectures et contre-lectures du Journal d’un chat assassin en CE2-CM1: un éclairage interprétatif par la BD ?», Le Français aujourd’hui, n° 220, p. 117-130.
Denizot, Nathalie (2022), «Écriture d’invention, rhétorique et créativité dans l’enseignement secondaire» in Écritures créatives. Représentations contemporaines et enjeux professionnels, D. Ulma, A. Pauzet & A. Prouteau (dir.), Rennes, PU de Rennes, p.31-45.
Dumortier, Jean-Louis (2001), Lire le récit de fiction. Pour étayer un apprentissage: théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck Duculot.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: La place de la Bande dessinée dans l’enseignement, Paris, Syndicat national de l’Édition.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier.
Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n°187-188.
Étienne, Bénédicte & Mongenot, Christine (2023), «Adjuvants, auxiliaires ou substituts: les OSS transmodaux en question», Le Français aujourd’hui, n°220, p. 5-17.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1983), Nouveau discours du récit, Paris, Seuil.
Gennaï, Aldo (2023), «Adaptations transmodales: usages et effets projetés dans quelques séquences en ligne pour le cycle 3», Le Français aujourd’hui, n°220, p. 21-35.
Goldenstein, Jean-Pierre (1999), Lire le roman, Bruxelles, De Boeck & Larcier.
Jacquin, Marianne (2018), «Le genre textuel au carrefour des paradigmes de la recherche en didactique des langues étrangères: conceptualisations et finalités» in Les genres textuels en langues étrangères: entre théorie et pratique, M. Jacquin, G. Simons, & D. Delbrassine (dir.), Berne, Peter Lang, p. 11-35.
Klinkenberg, Jean-Marie (2020), «Pour une grammaire générale de la relation texte-image», Pratiques, n°185-186.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales. Une expérience vécue en classe à partir des bandes dessinées Paul et Persépolis», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle, J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses de l’Université de Québec, p. 125-140.
Louichon, Brigitte (2017), «La réception scolaire des œuvres patrimoniales ou les Objets Sémiotiques Secondaires à l’école», in Les formes plurielles des écritures de la réception (vol.1): Genres, espaces et formes, F. Legoff & M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 23-36.
Lubbock, Percy (1957 [1921]), The Craft of Fiction, New York, The Viking Press.
Masson, Pierre (1985), Lire la bande dessinée, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
Meyer Jean-Paul (2012), «À propos des albums de BD adaptés de romans: de la transposition littéraire à la transposition didactique», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, ELLUG, p. 157-170.
Prévost, Julie (2023), «La transmodalisation, un levier pour une inclusion efficiente des élèves allophones ?», Le Français aujourd’hui, n° 220, p. 77-88.
Raux, Hélène (2021), «La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser», Transpositio, n° 4.
Rouvière, Nicolas (2012), «Introduction», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, ELLUG, p. 7-18.
Rouvière, Nicolas (2017), «Adapter en classe des extraits de roman sous forme de BD: quels apports pour la lecture littéraire ?», Revue de Recherches en littératie médiatique multimodale, n°6.
Rouvière, Nicolas (2021), «Quelle didactique pour la bande dessinée ? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020», Transpositio, n°4.
Schneuwly, Bernard (1994), «Genres et types de discours: considérations psychologiques et ontogéniques», in Les interactions lecture-écriture: Actes du colloque Théodile-Credil (Lille, nov. 1993), Berne, Peter Lang, p. 155-173.
Simons, Germain (2018), «De la place des genres textuels dans les familles de tâches en langues modernes», in Les genres textuels en langues étrangères: entre théorie et pratique, M. Jacquin, G. Simons, & D. Delbrassine (dir.), Berne, Peter Lang, p. 37-70.
Tauveron, Catherine (1999), «Comprendre et interpréter le littéraire à l’école: du texte réticent au texte proliférant», Repères, n° 19, p. 9-38.
Ulma, Dominique, Anne Pauzet & Anne Prouteau (dir.) (2022), Écritures créatives. Représentations contemporaines et enjeux professionnels, Rennes, PU de Rennes.
Verrier, Jean (1992), Les débuts de romans, Paris, Bertrand-Lacoste.
Vrydaghs, David (2022), «Enseigner les compétences nécessaires à la lecture des bandes dessinées», Échanges, n°43, p. 2-10.
Zakhartchouk, Jean-Michel (1999), L’Enseignant, un passeur culturel, Paris, Éditions Sociales Françaises.
Documents officiels évoqués
Fédération Wallonie-Bruxelles (1999), Compétences terminales et savoirs requis en français: humanités générales et technologiques. (24 pages).
Fédération Wallonie-Bruxelles (2018), Compétences terminales et savoirs requis en français: humanités générales et technologiques. (71pages).
Pour citer l'article
Daniel Delbrassine, "Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/genres-et-ecriture-d-invention-preparer-la-transposition-par-la-comparaison-entre-deux-formes-bd-roman-d-un-recit
Enseigner Proust illustré
Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même.
Enseigner Proust illustré
Quel Proust?
Enseigner Proust commence par une question simple mais fondamentale: qu’est-ce qu’on peut entendre par «Proust»? Quatre réponses au moins, qui ne s’excluent pas les unes les autres, sont possibles: d’abord l’œuvre, puis l’homme et le contexte historique et culturel qui était le sien, ensuite l’histoire matérielle de son travail, et enfin l’histoire matérielle de ses publications. En simplifiant un peu, ces approches correspondent à quatre domaines de la recherche, aux frontières souvent peu étanches: la stylistique (pour l’étude de l’œuvre), l’histoire littéraire (pour l’étude de l’homme et de son époque), la génétique (pour ce qui est des manuscrits) et l’histoire du livre (pour ce qui est des textes publiés). Chacune de ces options soulève toutefois un certain nombre de problèmes didactiques.
S’agissant de l’œuvre, on peut se demander s’il est permis de réduire le travail de Proust à la seule Recherche, puis cette dernière à quelques extraits plus ou moins artificiellement détachés de l’ensemble, comme cela se fait la plupart du temps. Certains de ces fragments peuvent être très longs, comme Un amour de Swann, roman «autonome» enclavé dans la Recherche; d’autres, qu’on retrouve presque inchangés depuis bientôt cent ans, sont très courts, comme la scène de la madeleine ou la mort de Bergotte. Dans l’un et l’autre cas, il convient de se demander si pareille sélection n’est pas une défiguration de l’écriture proustienne. Quelque chose se gagne (c’est sans doute la seule manière possible de commencer à faire lire Proust à l’école), mais inévitablement le parti pris des morceaux choisis fait aussi perdre quelque chose. L’expérience du temps, si essentielle à une véritable expérience de la Recherche, est difficile à faire passer à travers cette approche anthologique (sur cette question fondamentale, voir Kuentz 1972). Mais comme le but de l’enseignement de Proust est aussi de pousser à faire découvrir l’ensemble de l’œuvre au-delà de ces quelques fragments, il peut être recommandé de confronter les élèves dès le début avec l’«autre» Proust, celui de la correspondance ou celui des pastiches, par exemple, et de pointer déjà vers le va-et-vient entre écriture fictionnelle et autres formes d’écriture. Comme pas mal d’autres auteurs de fiction, Proust n’arrête pas de recycler des textes de non-fiction (les siens et d’autres).
Or, le mot «Proust» ne désigne pas seulement le texte de l’auteur, c’est aussi une longue série de commentaires qui ont fini par faire corps avec la création initiale. La valeur d’une grande œuvre est en effet fonction de la qualité des lectures qu’elle est capable d’engendrer et en ce sens on devrait accepter pour Proust ce qu’on considère comme allant de soi pour Shakespeare ou Dante, à savoir que les analyses de l’œuvre ne sont pas de simples greffes ou ajouts, mais une partie essentielle de l’œuvre même. Lire «innocemment», sans connaissance des interprétations déjà existantes, n’est jamais qu’une illusion. Encourager les élèves à lire Proust implique nécessairement – le contraire serait une mutilation – les inciter à prendre connaissance de la réception de Proust à travers le temps. Je me permets d’insister sur la dimension diachronique de ce geste, pour éviter qu’on ne tombe dans les écueils du présentisme: Proust queer, certes, mais pas seulement. Le livre de Pierre Bayard sur Proust et la poétique de la digression (Bayard 1996) peut rendre ici de vrais services, d’autant plus qu’il permet aussi de réfléchir au geste de l’extraction de morceaux et à l’impossibilité de trancher entre narration (le «sujet») et digression (le «hors-sujet»). L’ouvrage de Bayard a l’avantage de privilégier les grandes questions de l’écriture comme de la lecture du texte proustien: comment donner forme à un univers d’une telle ampleur, comment s’y repérer? que faire de la tension entre le désir de tout dire et de tout lire d’une part et la difficulté de donner sa juste place à tout, c’est-à-dire à ne pas se perdre dans trop de détails (pour l’auteur) et ne pas céder à l’envie de sauter certains passages (pour le lecteur)? De plus, Bayard a aussi l’élégance et la sagesse de ne pas éviter le retour sur des morceaux connus, tout en aidant à décrisper l’écart entre le tout et la partie.
En deuxième lieu, enseigner Proust signifie également enseigner l’auteur et son époque. Ici aussi, les questions qui émergent sont immenses. Faut-il séparer l’homme et l’œuvre? La seule idée de pareil clivage paraît un contresens, mais tel n’a pas toujours été de l’avis des critiques. Même aujourd’hui, à l’époque du biographisme triomphant, il est parfaitement légitime, mais pas forcément toujours possible bien entendu, de lire l’œuvre sans trop tenir compte de l’homme. Et que faut-il entendre par contexte? Comment en circonscrire les extensions littéralement infinies? Comme le remarquait judicieusement Jonathan Culler: «Meaning is context bound, but context is boundless» (Culler 1997: 67). Que faire aussi de la notion d’anachronisme, qui est un des nombreux facteurs cassant l’homogénéité d’un contexte? Après tout, la Recherche évoque un monde qui, au moment de la percée de Proust, juste après la Première Guerre Mondiale, n'existait déjà plus, tandis que sa propre écriture et son grand projet romanesque n’ont rien de «moderne» (au sens de «contemporain»): la Recherche achève la tradition des grandes sommes romanesques du 19e plus qu’elle n’annonce Dada ou le surréalisme, mouvement littéraire soit hostile au roman, soit inventant comme sous le manteau de nouvelles formes de roman (Sermier 2022). Les questions liées à la biographie et à l’analyse contextuelle ne peuvent avoir de réponse concluante. Ne pas les poser n’est toutefois guère souhaitable.
Enfin, troisième approche, sur laquelle j’aimerais me concentrer dans les pages qui suivent, le mot «Proust» peut renvoyer aussi à une série d’objets matériels. Il y a d’abord les manuscrits, auxquels s’intéressent non seulement les études génétiques mais aussi les bibliophiles et, de plus en plus, les commissaires d’exposition, parfois dans une logique de «démédiation» de la littérature convertie en objet à voir, c’est-à-dire en création plastique ou sculpturale (Stewart 2010, Baetens et Sánchez-Mesa 2019). À cela s’ajoutent les diverses éditions des textes de Proust, sur lesquels se penchent les spécialistes en histoire du livre, devenue aujourd’hui l’histoire de toute la chaîne du livre (Darnton 1992).
Dans le cas de Proust, l’accent est massivement mis sur les manuscrits et ce dès le début de la diffusion plus large de son travail, avant même que la totalité de la Recherche n’ait vu le jour sous forme de livre (l’écriture de l’œuvre s’étend de 1906 à 1922, sa publication en sept tomes va de 1913 à 1927). En effet, le numéro d’hommage de la Nouvelle Revue française du 1er janvier 1923 consacre déjà l’essentiel de son dossier iconographique à la reproduction en fac-similé des cahiers et carnets de Proust – il est vrai des objets de toute beauté, mais qui prennent curieusement la place des «illustrations», absentes quant à elles. Il n’y a ainsi plus nulle trace des images ayant accompagné l’édition originale du premier livre de Proust, Les Plaisirs et les jours (1896), qui étaient pourtant de la main d’un des modèles de Madame Verdurin, à savoir Madeleine Lemaire.
On ne peut que s’étonner du relatif silence qui pèse sur le versant «imprimé» de l’œuvre proustienne, surtout du côté de la critique génétique, presque exclusivement focalisée sur les manuscrits (mais le regard porté sur les états imprimés du texte est également assez réduit du côté des chercheurs en histoire matérielle du livre). Certains aspects de la vie éditoriale de l’écrivain se voient inlassablement répétés, comme le refus du premier tome de la Recherche, la publication à compte d’auteur, chez Grasset, de ces pages en 1913, les discussions plus récentes, mais finalement pas trop vives, de la nouvelle version de l’œuvre en la Pléiade (aujourd’hui en quatre volumes, et non plus en trois comme au début), ou encore les réactions mi-sceptiques mi-admiratives devant l’édition anniversaire d’Un amour de Swann, «orné» en 2013 par Pierre Alechinsky. Sinon, Proust est étudié dans le texte (les manuscrits), mais «hors livre». La raison en est sans doute le prestige exceptionnel des manuscrits, qui monopolisent l’attention de quiconque s’intéresse à la matérialité de l’écrit proustien, mais la lacune des travaux sur les éditions de l’œuvre n’en est pas moins fort regrettable. La postérité éditoriale de Proust mérite un examen plus attentif, dont les avantages didactiques sont tout sauf négligeables. À cet égard, un aspect singulier se détache: les éditions illustrées de la Recherche.
Premiers écueils, premiers pas méthodologiques
Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, quand bien même il ne peut être question les considérer toutes (en pratique, bien des éditions de luxe à tirage hyper-réduit resteront par définition inaccessibles, tandis que les adaptations en bande dessinée relèvent en partie d’une approche un rien différente). D’abord parce que lire les illustrations prend moins de temps que lire un texte de trois mille pages (notes et variantes non comprises), ce qui est un critère pratique essentiel dans toute forme d’enseignement. Ensuite parce que l’accent mis sur la dimension visuelle de la littérature est plus proche de la culture d’accueil des jeunes, dont beaucoup ont pris le tournant visuel, autorisant ainsi un rapport plus direct et a priori plus empathique avec l’œuvre de départ. Le rapprochement entre sphères a priori non contiguës ne se limite pas à la proximité de cet aspect particulier de l’œuvre de Proust et des nouveaux modes de consommation culturelle. Il aide aussi à inscrire l’enseignement de la Recherche dans le retour en force des études historiques en littérature, après le triomphe des études formelles, pour ne pas dire formalistes, des années 60 et 70 dont les effets se font toujours sentir dans certains modèles pédagogiques. Enfin, la mise en avant des illustrations suit également la tendance de plus en plus «lourde» des arts de l’écriture d’abolir les frontières entre mots et images, hybridation tout à fait intégrée à la pratique des poètes contemporains, notamment au moyen ce qu’on a nommé le «livre de dialogue» entre écrivain, typographe, imprimeur et plasticien (Peyré 2001). Cette co-création est encore relativement rare en prose. En fait, la dernière grande époque d’une visualité foisonnante du livre date déjà des années de grand succès des clubs de livre après la Deuxième Guerre Mondiale (Faucheux, 1978, Massin 1989), alors qu’aujourd’hui la rencontre du visible et du lisible s’effectue d’abord dans le média un peu différent de la bande dessinée. L’exemple de Proust est tout à fait approprié pour rouvrir ce formidable dossier – déjà traité à deux reprises dans cette revue – à l’intérieur de la littérature au sens traditionnel du terme, même si, pour des raisons pratiques, il sera nécessaire de privilégier un seul exemple (celui de Faucheux/Massin, justement), choisi en fonction de son caractère stratégique.
La décision de lire Proust par illustrations interposées fait surgir tout de suite un certain nombre de difficultés. Pour commencer, la quantité d’images illustrant les différentes éditions de Proust est énorme, même si ce pan de l’œuvre reste largement méconnu (pour trois aperçus, voir Tadié 2013, Baetens 2022, Eells et Dezon-James, 2022). Il suffit toutefois de s’intéresser à «Proust illustré» pour que le matériau afflue de toutes parts, car il existe des dizaines d’éditions illustrées de la Recherche. La maîtrise purement matérielle du corpus s’avère ainsi tout aussi difficile que la traversée des textes mêmes. De plus, cette iconographie est tout sauf homogène, à la différence du texte, quand bien même la Recherche témoigne elle aussi de différences stylistiques parfois non négligeables. Ces variations de style sont toutefois nettement moins apparentes que les différences d’une série d’images à l’autre (le corpus des illustrations est un pot-pourri des images les plus conventionnelles et les plus expérimentales). C’est dire déjà que la notion de «culture visuelle» ne peut se penser qu’au pluriel, ce qui constitue une entrave à l’accès supposément direct aux images d’un texte: enseigner l’image, c’est aussi enseigner le passé, souvent un passé plus éloigné de la culture contemporaine que le passé de l’écrit, qui «vieillit» différemment (et surtout moins vite: une image est rapidement plus «datée» qu’un écrit). À cela s’ajoute la méfiance, tant du côté des auteurs que de celui des critiques, à l’égard de l’illustration en général, en tout cas pour ce qui est des fictions en prose. À l’instar de Flaubert, qui est sur ce point tout sauf isolé, beaucoup continuent à s’écrier: «Moi vivant, jamais on m’illustrera», comme si l’ajout d’une image au texte impliquait inéluctablement une dégradation du premier, l’image étant vue soit comme la béquille devant sauver un texte incapable de se défendre lui-même, soit comme une intervention injustifiable des éditeurs soucieux de tromper le client, soit encore comme une traduction, littérale ou métaphorique, dont les effets sur l’imagination du lecteur seraient toujours délétères.
La réalité culturelle, qui est également une réalité économique (l’édition, au même titre que le cinéma, est aussi une industrie), est cependant plus complexe. Dans la première moitié du vingtième siècle – mais la pratique est plus ancienne et elle n’a pas totalement disparu – les éditeurs offraient parfois deux éditions du même livre: une édition grand public, sans illustrations et bon marché, et une édition de luxe, illustrée, à tirage limité, destiné à un lectorat plus fortuné. L’ensemble de cette production parallèle constitue un des continents cachés de la littérature française: des pièces uniques peuvent être savamment commentées (il existe ainsi quelques articles sur l’édition de la Recherche illustrée par le peintre fauve Kees Van Dongen en 1947), mais il est très difficile de faire un surplomb général de la coexistence et peut-être aussi de la distance et de l’ignorance réciproque des versions illustrées et non illustrées des mêmes textes dans l’espace littéraire (les études sur les illustrations de Proust se concentrent souvent sur un seul objet, sans trop se pencher sur le contexte synchronique ou diachronique des images en question).
Dans le cas de Proust, faire l’histoire de ces «doubles» de l’œuvre – et de leur place dans les recherches proustiennes – n’est pas possible sans embrasser la totalité des aventures éditoriales de l’œuvre. Certes, les textes publiés de Proust ont vite fait l’objet de pareilles éditions de luxe, qui restent toutefois peu connues, tant à cause de la cherté de ces livres qu’en raison de la pléthore d’autres images qui se sont greffées ailleurs (par exemple dans les manuels scolaires) sur le texte de Proust. Cela dit, certaines illustrations se retrouvent aussi dans les publications pour le grand public, notamment dans les éditions de poche, et il y a de bonnes raisons (car ces documents sont faciles à trouver et peut-être même déjà connus des élèves) de partir de ces images-là plutôt que de ce qu’on trouve dans les éditions de luxe. En même temps, il importe de ne pas se laisser divertir par les «autres images» qui entourent l’œuvre de Proust: si tant de lecteurs se désintéressent de la question des illustrations, c’est aussi parce que le texte de Proust «hors livre», par exemple dans des catalogues d’exposition ou les coffee table books sur l’auteur et son monde, n’apparaît presque jamais sans images: portraits de l’auteur, photos de famille, tableaux évocateurs des personnages ou du milieu social peint par la Recherche, et ainsi de suite. Or, à l’époque – la nôtre – où la lecture du texte passe de plus en plus par le contact avec l’auteur et que dans le cas des auteurs décédés ce contact passe généralement par l’iconographie de l’auteur – sans appui visuel, il semble difficile aujourd’hui de canoniser ou de patrimonialiser une œuvre littéraire –, il ne faut pas s’étonner que de telles images prolifèrent et que leur seule abondance n’encourage guère à se lancer dans la quête des images plus «rares», comme celles qu’on trouve dans certaines éditions plutôt confidentielles.
Lire «Proust illustré» est ainsi tout sauf une évidence. Plutôt que de chercher à résoudre d’emblée ces premiers écueils, il vaudrait peut-être mieux «reculer pour mieux sauter», c’est-à-dire de prendre un minimum de distance par rapport au seul cas de Marcel Proust et de la Recherche, pour s’interroger sur les questions et les réponses plus générales qu’on peut dégager du caractère problématique de l’objet d’étude, à savoir ces illustrations dont personne ne conteste l’intérêt, sans pour autant trop connaître le corpus.
Questions générales et préparation du chantier
Face à ces difficultés (excitantes du point de vue de l’enseignant, et, plus encore, du concepteur de manuels ou d’autres moyens de documentation, le temps de préparation dont dispose l’enseignant étant fatalement limité !), il importe avant tout de faire un choix. Pour le dire très vite, et sans aborder ici la question épineuse mais autrement générale du copyright, trois grandes options au moins viennent tout de suite à l’esprit, qui du reste ne sont nullement exclusives. Les choix à faire ne seront donc jamais absolus, mais relatifs: c’est par goût mais aussi par manque de temps qu’on se tournera vers telle option plutôt que vers telle autre, tout en sachant qu’aucune analyse ne gagne jamais à rester totalement «pure» jusqu’à la fin.
La première approche, la plus classique sans doute, est celle des rapports concrets entre textes et images. Quand on part de l’image, réelle ou imaginaire, pour analyser sa conversion en objet textuel, la perspective choisie sera celle de l’ekphrasis, dont l’histoire, les thèmes, les figures et les exemples canoniques ont fait de très nombreuses analyses (l’ouvrage de référence reste ici Heffernan 1993). Le principe de l’illustration est à la fois symétrique et inverse: il concerne lui aussi le lien entre le lisible et le visible, mais le point de départ est ici le texte et le point d’arrivée, l’image. L’intérêt de l’œuvre de Proust est de combiner à bien des égards l’un et l’autre de ces mécanismes, ekphrasis et illustration, mais de manière non parallèle.
De son vivant, Proust ne s’est pas toujours opposé à l’illustration (rappelons les images de Madeleine Lemaire dans Les Plaisirs et les jours et quelques autres illustrations dans une revue de grand luxe ayant prépublié certains fragments de l’œuvre en cours), mais il n’est pas faux de penser qu’il s’est rapidement détourné du marché de l’édition restreinte et illustrée pour se tourner vers des types de publication très grand public et sans la moindre illustration. Les premiers volumes de la Recherche sont des exemples typiques de livres «pauvres» (Monnier 1931). Par contre, le rôle de l’ekphrasis y est capital et touche aussi bien à des modèles picturaux que musicaux. Dans la Recherche, le protagoniste a trois grands modèles artistiques (Vinteuil pour la musique, Elstir pour la peinture, Bergotte pour la littérature), qui ont toutefois en commun de s’éclipser devant le projet personnel du narrateur, qui découvre peu à peu sa propre vocation et sa propre manière de faire, c’est-à-dire d’écrire – d’où peut-être la frilosité grandissante de Proust face à l’image, qui «fige» la mobilité aussi bien que la densité et la profondeur temporelle de son travail sur la mémoire. Il importe de tenir compte de ce décalage entre illustration (refusée) et ekphrasis (assumé) au moment d’aborder les images qui accompagnent le texte de Proust et qui sont, à quelques exceptions près, toutes «posthumes». Il ne faut pas conclure de cet écart temporel que les artistes et plasticiens qui acceptent de se mesurer avec le texte de Proust , peuvent dès lors le faire de manière plus «libre»: les contraintes restent nombreuses, qui vont du poids de la tradition (on n’illustre pas Proust sans regarder du côté de ce qui s’est déjà fait, pour s’en distinguer ou pour s’en réclamer) aux exigences des commanditaires (les illustrations font toujours l’objet de commande et les éditeurs ont leur mot à dire dans le «look» des images). L’analyse de ces rapports de force est cependant une excellente introduction à une discussion sur la question plus générale de l’adaptation transmédiatique, continuation logique du travail en classe sur l’illustration.
La seconde approche est moins directement intermédiale, quand bien même il serait absurde de laisser tomber l’interaction entre visible et lisible. Elle analyse la manière dont les illustrations font partie d’un «espace élargi», en l’occurrence celui du livre. Il est utile de distinguer ici entre deux aspects, où les aspects littéraire et économiques se croisent sans arrêt.
D’un côté, le livre est un objet matériel et culturel, dont l’existence, de la première idée au dernier de tous ses usages produit une sphère culturelle à multiples actants: auteurs, éditeurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires, collectionneurs, lecteurs. Grâce aux travaux déjà cités de Darnton et de bien d’autres, dont en France surtout l’historien de la lecture Roger Chartier, nous savons du reste que ladite «chaîne» du livre, qui va en principe de l’auteur au lecteur, en passant par toute une série d’intermédiaires, n’est pas linéaire, mais qu’il y a force interactions créatrices entre nombre d’acteurs à plusieurs moments et à plusieurs endroits de cette chaîne.
De l’autre, le livre n’est pas un objet «homogène». Il existe beaucoup de types de livres et partant beaucoup de «chaînes» de livres, chacune d’elles avec sa propre logique interne. La pratique de l’illustration est directement affectée par ces différences: on n’illustre pas un livre de poche comme on illustre un livre pour bibliophiles, par exemple, tout comme on n’illustre pas de la même manière en France ou en Grande-Bretagne, ni en 1920 ou en 1970. Les illustrations de la Recherche sont un outil magnifique pour montrer ces dissemblances, qui obligent les élèves et étudiants (même si on vise ici un public scolaire, la réflexion méthodologique doit en effet se ménager la possibilité d’élaborer une stratégie en deux temps et à deux niveaux) à se faire sensibles à la rupture entre l’apparente stabilité du texte et la permanente métamorphose de présentation matérielle (même dans les cas, et ils sont très nombreux, où les livres se passent de toute illustration).
La troisième approche, qui prolonge les deux premières, est surtout diachronique. Il peut en effet être passionnant de d’analyser comment la présentation typographique du texte et le travail sur les éléments visuels, s’ils changent tous les deux sans arrêt, ne changent pas toujours au même rythme ni de la même façon. La multiplicité des versions proustiennes facilement accessibles en bibliothèque ou en librairie est un bel outil pour lancer une telle piste de réflexion. L’essentiel, ici, sera de comprendre la manière dont s’articulent les deux autres pistes, celle de l’intermédialité (rapports textes-images) et celle de la matérialité (le texte situé dans le cadre plus large de la chaîne du livre), mais toujours du point de vue synchronique aussi bien que diachronique. Plus spécifiquement, deux types de questions peuvent ici être posées. D’un côté: quels sont les mécanismes qu’on peut observer à quel moment et à quel endroit de la chaîne et quels sont les acteurs les plus directement concernés? De l’autre: quel est le rôle des illustrations? comment et surtout pourquoi est-ce qu’on les voit apparaitre ou disparaître?
Tout cela suppose évidemment que les élèves et étudiants ont réellement accès aux sources, ce qui est loin d’être une évidence en raison du caractère confidentiel de nombreuses publications. Quelques-unes des éditions illustrées, à haute valeur bibliophilique, n’existent même qu’à quelques exemplaires, s’il ne s’agit pas de créations plastiques totalement uniques, délicates à déplacer. De tels objets, si on peut utiliser ce terme un peu terre-à-terre, se trouvent souvent dans des collections privées, difficiles d’accès, alors que d’autres se trouvent dans des archives spécialisées où ils ne peuvent être consultés que sur place et sur rendez-vous. Pour les élèves, il peut être un bon exercice (par exemple en combinaison avec une visite de bibliothèque), en partant des aperçus existants (voir supra), de s’initier à l’heuristique littéraire, au sens très littéral du terme: Où et comment peut-on accéder aux documents originaux? Y a-t-il moyen de le faire en ligne? Quelle est la différence entre le contact avec les originaux et l’utilisation de sources en ligne? Y a-t-il aussi des créations purement numériques? Ou encore: Que faire pour combler les inévitables lacunes des répertoires existants? Quels que soient les obstacles qui surgissent au cours de pareils exercices, il est évident qu’ils aideront les élèves à se faire une idée plus nuancée et plus diversifiée des trois notions de texte, de livre et d’œuvre dont ils auront besoin pour passer ensuite à de nouvelles formes d’interprétation de Proust.
Idéalement, les trois grandes approches devraient pouvoir se combiner et se compléter. En pratique, on ne peut que le répéter, des choix s’imposent. Dans Illustrer Proust, je me suis par exemple concentré sur la troisième de ces pistes, n’étant ni un spécialiste de Proust, ni un spécialiste du livre (c’est peut-être ce qui m’a permis de me lancer dans ce projet, car parfois on est sauvé par sa propre naïveté). D’autres recherches se focalisent plutôt sur la lecture intermédiale, par exemple pour souligner l’apport créateur de certaines illustrations (c’est typiquement l’approche déjà citée de Eells et Dezon-James) ou montent en épingle les questions génétiques épineuses mais fascinantes de la transformation d’un manuscrit (finalement inachevé, c’est-à-dire moins bien relu et corrigé à la fin qu’au début et en ce sens fondamentalement inachevé) en livre (apparemment «fini», comme dans le cas du premier tome paru chez Grasset en 1913, mais immédiatement dénoncé comme «erroné» puisque bourré de coquilles, «incomplet» puisque rien d’autre que la porte d’entrée d’une somme dont l’auteur ne voyait pas encore les frontières, et «mal classé», puisqu’ayant paru chez un éditeur qui n’était pas celui qui allait vraiment faire rayonner l’œuvre de Proust).
Questions particulières et pistes de réflexion
Derrière ces premiers choix se dessine toute une série d’autres chantiers. Leurs enjeux et leur importance sont variables, mais tous reviennent sur la question fondamentale posée au début de ces pages: quel Proust, ou, si l’on préfère, que deviennent Proust et notre idée de Proust à la lumière du texte enrichi par l’illustration?
Cette question conduit au problème de l’«identité» du texte et de l’œuvre. L’intérêt pour les illustrations montre que l’œuvre d’un auteur ne coïncide pas avec le seul texte qu’il a produit. Si les «corps étrangers» qui l’entourent n’en font pas moins partie, on est en droit de s’interroger sur l’identité de l’instance derrière cette conception élargie de l’œuvre. En effet, les illustrations de Proust n’ont pas été «voulues» par Proust, et encore moins «pensées» par lui – à la différence de bien d’autres écrivains qui ont collaboré de leur vivant avec leurs illustrateurs et qui dans certains cas extrêmes comme celui de Raymond Roussel dans ses Nouvelles Impressions d’Afrique ont élaboré un dispositif très complexe pour l’intégration du texte, des images et de l’objet-livre (Busine 1995). Il en résulte que notre perception de l’œuvre, inéluctablement influencée par la présence d’éléments visuels (pas forcément sous la forme d’illustrations: la typographie peut être non moins déterminante), ne sera jamais «pure». L’énonciation d’un texte, du moment qu’il passe du manuscrit au livre, est par définition une énonciation plurielle, où interviennent nombre d’autres instances que le seul auteur. L’éditeur en est une, mais aussi le maquettiste ou l’illustrateur, entre autres (Souchier (2007). On peut toujours essayer de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais en pratique il n’est pas toujours facile de faire la part entre la manière dont on reçoit le texte tel qu’en lui-même (à supposer que ce texte ne relève que d’un seul auteur, ce qui est loin d’être toujours le cas) et celle dont on reçoit le texte tel qu’il est présenté matériellement (et cette présentation, on le sait, est hautement variable; elle se fait aussi très souvent hors de tout contrôle de l’écrivain). Dit autrement: ce que montre l’histoire éditoriale d’une œuvre , en l’occurrence d’un auteur dont le texte supposé immuable a fait l’objet d’une série incessante d’illustrations de styles et de contenus très variables, c’est la difficulté de fixer la voix «authentique» d’un auteur. Cette voix est toujours, non pas impure, mais complexe, plus étagée que celle du texte pris en lui-même.
Pareille idée ne devrait pas surprendre: nous acceptons aujourd’hui que l’interprétation d’un texte sera différente si nous le découvrons en audiolivre ou à travers d’autres formes d’adaptation (inutile de revenir sur l’exemple de la bande dessinée de Stéphane Heuet, pourtant très respectueuse du texte même de Proust, voir Baetens 2020); de la même façon, la critique savante accepte sans le moindre état d’âme qu’il n’est pas possible de lire un texte sans prendre en considération les successives lectures qu’on a pu en faire (quitte, bien sûr, à tenter de dépasser ces lectures en revenant au texte, comme le font les diverses formes de lecture créatrice illustrées par Pierre Bayard (1996) ou Maxime Decout (2021)). L’exemple des éditions illustrées de Proust peut pointer dans la même direction et faire comprendre que le sens d’une œuvre ne dépend jamais du «vouloir dire» d’une instance auctoriale unique. Il est incontestable que Proust a eu un «projet» et une «intention» en écrivant la Recherche, mais l’interprétation de ces éléments, pour autant qu’on les juge pertinents, dépasse toujours l’éventuelle réponse à la question apparemment simple mais finalement sans réponse finale possible: qu’est-ce que l’auteur a voulu dire? Ce débat, qui est ancien, peut paraître dépassé aux yeux de certains, mais il réapparaît à intervalles réguliers dans l’histoire de la critique. De nos jours, où l’on assiste à un retour presque agressif du biographisme et de la primauté de l’homme ou de la femme par rapport à l’œuvre, les questions de sens se posent de nouveau très fortement en référence au vouloir-dire de l’écrivain, de sa «sincérité», de son «engagement», de son «authenticité», de sa capacité à représenter une «communauté», et ainsi de suite (voir Louichon 2015 sur les enjeux de la patrimonialisation).
D’autres questions sont non moins importantes, comme celle de la définition du «corpus» historique de la littérature. Est-il possible de se focaliser sur les seuls textes, ou faut-il inclure dans l’œuvre tous les éléments qui accompagnent la transformation d’un manuscrit en livre? De nos jours, il est généralement admis, dans le sillage des travaux de Genette (1987), qu’il n’est plus possible de séparer les données textuelles et paratextuelles, qui ne sont pas de simples ajouts mais qui font partie intégrante de l’œuvre même (or, nous savons que la majorité de ces unités paratextuelles échappent totalement au contrôle de l’auteur, y compris sur le plan juridique). De la même façon, on estime que les avant-textes, les métatextes, les intertextes et l’architexte, en suivant toujours la terminologie de Gérard Genette dans Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982), font également partie de l’œuvre (il est toutefois intéressant de noter que le livre de Genette laisse de côté la dimension proprement visuelle de cette extension du livre: son travail sur le paratexte tend à mettre entre parenthèses les illustrations, par exemple).
Il faut maintenant faire un pas de plus et se demander dans quelle mesure il convient d’y ajouter aussi le domaine des adaptations (au cinéma, en bande dessinée, en audiolivre, en exposition, voire en parc de loisirs comme c’est aujourd’hui le cas d’Illiers-Combray). La question peut paraître exagérée, mais elle répond à une réalité de plus en plus visible: la littérature ne circule plus seulement sous forme de textes, mais aussi sous forme d’adaptations transmédiatiques, tantôt en complément par rapport à l’œuvre, tantôt en véritable substitut. Les lecteurs de Stéphane Heuet ne liront pas tous la Recherche, par exemple. Les spectateurs de l’adaptation cinématographique d’Un amour de Swann (Volker Schlöndorff, 1984, avec Jeremy Irons et Ornella Muti) ont fort bien pu en rester là dans leur expérience de l’univers de Proust – et il n’y a pas de raison pour leur en faire le reproche).
Le phénomène ne reste pas circonscrit à la production littéraire: il en va de même dans le domaine de la production cinématographique, où bien des films sont mieux connus à travers certaines extensions, imprimées ou numériques, qu’à travers les versions proprement cinématographiques (on connaît les affiches, les novellisations, les résumés de Wikipédia, et ainsi de suite, sans forcément avoir vu les films originaux, surtout pas dans leur totalité).
Bref, le cas en apparence singulier et relativement marginal des éditions illustrées de Proust aide non seulement à penser autrement la question de l’instance auctoriale (qui est responsable, à côté de l’auteur de l’œuvre, du texte mis en livre?) mais aussi la notion de texte et d’œuvre. D’une part leurs limites deviennent floues: quels sont les autres éléments qui se greffent sur le texte de départ? D’autre part le rapport entre œuvre originale et œuvre dérivée cesse également d’être clair: que penser d’une œuvre qu’on ne connaît que par l’intermédiaire de ses adaptations, par exemple, et comment la connaissance des variations transmédiatiques influe-t-elle sur le contact ultérieur avec l’œuvre d’origine? Questions très vastes qu’il est impossible de traiter ici en détail, mais qui soulignent une fois de plus à quel point la notion d’histoire littéraire échappe à la dichotomie élémentaire du moment de la publication initiale et de celui de la réception actuelle.
Une étude de cas: Pierre Faucheux vs Robert Massin et la Recherche dans «Le Livre de poche» vs Folio
Mais trêve de généralités. Il est temps de passer à un exemple concret, abordable pour les élèves en termes de quantité (un corpus modeste, facile d’accès) et de qualité (une intervention représentative et d’importance durable): les couvertures des sept volumes de la Recherche dans l’édition du «Livre de poche» conçue en 1965 par le maquettiste Pierre Faucheux. Ces volumes se trouvent encore facilement chez des bouquinistes, y compris en ligne, et au cas où il serait moins aisé de les réunir tous en classe, on a la certitude de pouvoir les consulter au moins sur internet (via une simple recherche «Google images»). Hautement appréciées par les collectionneurs et les amateurs de Proust, les sept couvertures de cette série, elle-même à la valeur commerciale négligeable, constituent une pièce stratégique dans l’histoire des éditions illustrées de Proust, où elle constitue un véritable tournant.
L’intérêt du travail de Faucheux se situe à deux niveaux. Le premier est externe et touche à la manière dont l’illustration de Proust révèle des mécanismes plus vastes de l’édition littéraire. Le second est interne et concerne la manière dont Faucheux a révolutionné non seulement l’illustration mais le design du livre en général. Pour étudier des divers aspects, il est conseillé d’avoir un minimum de connaissances de l’histoire de l’illustration dans l’édition française ainsi que de la place qu’y occupe le marché du livre de poche (format de publication opposé à ce qu’on appelle le «grand format», soit la première édition courante, à ne pas confondre avec l’éventuelle édition parallèle de luxe, et dont l’avènement n’a pas attendu le lancement du label «Le Livre de poche» en 1953). Sur tous ces points, l’information ne manque pas (on peut recommander par exemples certaines publications d’Olivier Bessard-Banquy, notamment 2012 et 2022) et les élèves peuvent lire avec grand profit quelques fragments des autobiographies richement illustrées des deux grands novateurs que sont Massin (1989) et Faucheux (1978).
Sans trop entrer dans les détails, on peut souligner la continuité éditoriale et culturelle entre, d’une part, les clubs de livre qui se créent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et, d’autre part, les collections de poche, dont le succès décolle avec «Le Livre de poche» en 1953. L’ambition des clubs, soucieux de démocratisation culturelle, est avant tout politique: fonctionnant par abonnement ou souscription, ils se proposent d’offrir à bas prix de «vrais» livres (c’est-à-dire des textes faisant partie du patrimoine littéraire, et non plus les divers avatars de la littérature de genre ou littérature populaire). Mais elle est aussi esthétique. Contrairement à ce qu’on observe en Angleterre, par exemple, le livre français est en règle générale plutôt «laid» (ce qui ne veut pas dire «pauvre», au sens technique que lui donne Adrienne Monnier). Typographie, papier, reliure, impression… n’encouragent pas toujours à la lecture, et l’absence d’illustrations dans les éditions courantes et beaucoup d’éditions de poche (à l’époque uniquement des réimpressions bon marché et en petit format) n’est pas toujours faite pour arranger les choses (pour une approche critique de la situation actuelle du livre français, voir Bessard-Banquy, 2022). Les clubs de livre vont mettre en place une politique typographique audacieuse, qui s’efforce d’améliorer et de moderniser la présentation du livre tout en baissant le prix.
Pour y arriver, les jeunes maquettistes auront recours à deux grandes techniques. D’une part, le recours à l’image et, plus généralement, à des formes de typographie mettant en valeur les aspects visuels de la page. D’autre part, l’invention du «déroulement», c’est-à-dire de la transformation de la zone paratextuelle en séquence visuelle, ce qui a pour effet de modifier de fond en comble l’architecture du livre, qui tend vers le modèle cinématographique. Quelques années plus tard, les collections de poche, où l’on retrouve les grands maquettistes ayant révolutionné le design du livre français, vont prendre le relais des livres de club. C’est la fin des déroulements, mais non de l’importance accrue de l’image (en couverture, la couverture des grands formats restant «blanche» dans le secteur de l’édition générale, dans bien des cas jusqu’à aujourd’hui). Tout à coup, les images envahissent les couvertures (les livres des clubs, soigneusement cartonnés, étaient généralement restés sans illustration de couverture), et leur importance déborde le seul espace du livre. L’omniprésence des couvertures bariolées dans les vitrines et, autre nouveauté, les présentoirs et autres tourniquets de livres, joueront un rôle clé dans les polémiques autour du «Livre de poche» (Baetens 2017).
Pour ce qui est des illustrations, l’intervention de Faucheux est radicalement novatrice, puisqu’il remplace les images traditionnelles qu’il juge vieillottes (dessins, gravures, peintures) par des photographies, si possible de «documents», ce qui a le double avantage d’éluder le tabou qui pèse encore sur l’illustration (dans le cas de Proust, le stéréotype qui revient sans arrêt est qu’ «on n’illustre pas Proust», l’image ne pouvant qu’entrer en conflit avec la nature et le prestige d’une écriture qui a vite accédé au rang de chef-d’œuvre incontesté de la littérature moderne) et de servir d’alibi à une forme d’illustration qui n’a plus besoin de dire son nom (Faucheux lui-même se plaira à dire, sans la moindre ironie, que les photographies ne sont pas des… illustrations, mais des éléments qui contribuent à faire du livre un objet à trois dimensions dont le modèle est l’architecture). Invité par Le Livre de poche à reprendre la maquette de la série des classiques (et aussi des policiers, mais c’est une autre histoire), Faucheux ne dévie pas de son credo esthétique. Son travail sur les sept volumes de la Recherche est reste une démonstration inégalée (Fig. 1).
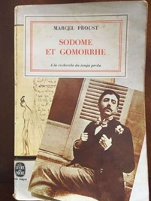
Figure 1: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Le Livre de Poche, 1965.
Cette maquette obéit à quatre grands principes. D’abord, le refus de toute forme d’illustration conventionnelle et son remplacement par des documents photographiques (concrètement, un mélange de photos de famille et de reproduction en fac-similé des manuscrits). Puis, la variation des caractères typographiques de la couverture dont l’esprit s’aligne sur celui de l’image. Ensuite, l’occupation de la totalité de la couverture par une composition unique et homogène (la distinction traditionnelle entre première et quatrième de couverture se trouve dépassée). Enfin, l’élaboration de la série sous forme séquentielle (la suite des sept volumes ne décline pas simplement des variations sur la même idée, mais les photos suivent chronologiquement la vie et l’écriture de Proust). Sur tous ces points, l’influence des clubs de livre est évidente, en dépit des contraintes techniques et commerciales du Livre de poche, qui exige une standardisation aussi poussée que possible de toutes les publications.
La force de ce dispositif, dont l’originalité continue à inspirer de nombreux typographes jusqu’à ce jour, se manifeste également dans les réactions suscitées à l’intérieur du champ de l’édition de poche. Lorsque quelques années plus tard, après la rupture entre Hachette et Gallimard en 1971, l’éditeur de Proust décide de créer son propre système de diffusion et ses proches collections de poche, dont en premier lieu la fameuse collection «Folio», créée en 1972 par un autre pionnier de l’époque des clubs, Robert Massin. L’édition Folio (Fig. 2) prendra soin de se distinguer à tous les niveaux du modèle de Faucheux, comme on le voit clairement dans sa version de la Recherche, également en sept volumes: couverture à fond blanc, présence d’une image «artisanale» (non photographique, non documentaire), séparation des première et quatrième de couverture, uniformisation complète des caractères typographiques (ceux de la série, non ceux de chaque publication indépendante, comme chez Faucheux).

Figure 2: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Folio, 1972.
Pour rapide que soit cette analyse, elle fait bien ressortir que les enjeux de l’illustration dépasse à la fois le travail du seul illustrateur et les rapports entre texte et image. Ce que font aussi bien Pierre Faucheux que Robert Massin est moins déterminé par quelque envie de trouver de nouvelles manières d’ajouter des images à l’écriture proustienne (Faucheux reprend des documents d’archive déjà fort connus, Massin se ressert des aquarelles ayant illustré une édition antérieure), que par le désir stratégique de monter en épingle une collection éditoriale (et il serait injuste de reprocher à l’édition d’être aussi une industrie, car elle l’est, et elle l’a toujours été). Les illustrations de Faucheux tendent à montrer que «Le Livre de poche» est capable d’innover, au moment où sa première ligne graphique était en train de s’essouffler, là où l’intervention de Massin cherche à imposer «Folio» comme la nouvelle référence en matière de poche. Il n’est évidemment pas question de généraliser cet exemple à tout prix, mais la lecture attentive de nombreux livres illustrés ne manquerait pas d’apporter de nouveaux arguments en faveur d’une telle hypothèse: l’étude de l’illustration qui se limite aux seuls rapports texte/image est toujours en danger de passer à côté d’aspects tout autres mais tout aussi importants du travail de l’illustrateur.
Conclusion
Lire Proust à l’aide des éditions illustrées de la Recherche, dont le diptyque Faucheux/Massin a présenté un exemple privilégié, n’a de sens que dans la mesure où l’on établit aussi des rapports avec les autres perspectives rapidement esquissées dans ces pages. La comparaison des illustrations et des fragments ekphrastiques, l’analyse de tout l’éventail de l’énonciation éditoriale, l’examen de la position historique des images insérées (tendent-elles à «actualiser» le texte et l’auteur, à les rendre «intemporels», ou au contraire à les ramener aux années de genèse, celles de la Belle Époque?), mais aussi la réflexion sur les manières dont se constitue l’objet de la lecture (pourquoi Proust dans telle édition plutôt que telle autre, par exemple?), ainsi que le retour sur les questions de l’auteur et de ses intentions, toutes ces pistes se prêtent sans trop de difficultés à une discussion en classe. Pareille discussion n’éloigne nullement du texte, elle le fait relire autrement. Elle aussi l’avantage non négligeable de son caractère générique: ce qui se fait autour de Proust, peut non moins se faire autour d’autres œuvres, voire autour de productions non littéraires comme le cinéma ou la bande dessinée.
Bibliographie
Baetens, Jan (2017), «Les livres de poche, une littérature ‘exposée?», Image & Narrative, 18 (4), p. 55-62, [en ligne].
Baetens, Jan (2020), Adaptation et bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Baetens, Jan (2022), Illustrer Proust. Histoire d’un défi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Baetens, Jan, et Sánchez-Mesa, Domingo (2019), «On ‘demediation’», Leonardo, 52 (3), p. 275-278.
Bayard, Pierre (1997), Le Hors-sujet. Proust et la digression, Paris, Minuit.
Bessard-Banquy, Olivier (2012), L’Industrie des lettres, Paris, Pocket.
Culler, Jonathan (1997), Literary Theory: A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press.
Darnton, Robert (1992), Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob.
Decout, Maxime (2021), Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit.
Eells, Emily, et Dezon-Jones, Élyane (2022), Illustrer Proust. L'art du repeint, Paris, Sorbonne Université Presse.
Faucheux, Pierre (1978), Écrire l'espace, Paris, Robert Laffont.
Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.
Heffernan, James (1993), Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, The University of Chicago Press.
Kuentz, Pierre (1972), «L’Envers du texte», Littérature, n° 7, p. 3-26.
Louichon, Brigitte (2015), «Le patrimoine littéraire: un enjeu de formation», Tréma, n° 43, p. 22-31.
Massin, Robert (1989), L’ABC du métier, Paris, Imprimerie nationale.
Monnier, Adrienne (1931), «Éloge du livre pauvre», Arts et métiers graphiques, n° 25, p. 345-348 (repris plus tard dans Adrienne Monnier, Rue de l’Odéon, Paris, Albin Michel, 1960).
Peyré, Yves (2001), Peinture et poésie, le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard.
Sermier, Émilien (2022), Une saison dans le roman, Paris, Corti.
Souchier, Emmanuël (2007). «Formes et pouvoirs de l’énonciation éditoriale», Communication & Langages, n° 154, p. 23–38.
Stewart, Garrett (2010). “Bookwork as Demediation”, Critical Inquiry, 36 (3), p. 410-457.
Tadié, Jean-Yves (2013), Swann illustré, Paris, plaquette accompagnant, sous coffret, l’édition par Antoine Compagnon de Du côté de chez Swann en Folio classique.
Pour citer l'article
Jan Baetens, "Enseigner Proust illustré", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-proust-illustre
Voir également :
Représenter sa réception d’un texte littéraire en images avec Midjourney: analyse des attentes des élèves et des productions générées par l’intelligence artificielle générative
L’article se propose d’interroger les rapports entre textes et images d’un corpus de productions numériques générées par le programme d’intelligence artificielle Midjourney.
Représenter sa réception d’un texte littéraire en images avec Midjourney: analyse des attentes des élèves et des productions générées par l’intelligence artificielle générative
lntroduction
L’avènement rapide des intelligences artificielles dans divers domaines de la société, de la culture et de l’art a profondément bouleversé les milieux culturels et éducatifs, en renouvelant des questions concernant, entre autres, la portée créative et l’esthétique des productions générées par les machines (Ganascia, 2017; Manovic, 2018), leur originalité et auctorialité (Bensamoun, 2020), leurs configurations sociotechniques (Velkovska et Relieu, 2021) et leurs démarches herméneutiques (Roberge et Lebrun, 2023). Dans les milieux éducatifs, sont soulevés, en plus d’enjeux éthiques et critiques (voir, entre autres, Collin et Marceau, 2021), des questionnements didactiques, liés, d’une part, aux compétences littéraciques et médiatiques nécessaires pour analyser des messages générés par le biais d’interactions humain-machine, d’autre part, à la manière dont les savoirs littéraires sont acquis, mobilisés ou réinvestis en travaillant avec les machines.
Inscrite dans une réflexion concernant la formation du sujet-lecteur/scripteur numérique et dans une démarche exploratoire d’analyse des productions générées par les intelligences artificielles, notre contribution se propose d’interroger un corpus de productions numériques générées dans une classe québécoise de 3e année de secondaire dans le cadre d’une activité de production et réception littéraires réalisée avec Midjourney, un programme d’intelligence artificielle générative (Gozalo-Brizuela et Garrido-Merchán 2023) qui permet de créer des images à partir de commandes textuelles. Dans un premier temps, nous examinerons les attentes que les élèves expriment par rapport à la capacité de l’intelligence artificielle à traduire en images des textes, en l’occurrence issus d’œuvres littéraires, pour ensuite observer l’analyse qu’iels feront des images tant par rapport au texte de départ qu’à leurs attentes initiales. Dans un deuxième temps, en nous intéressant aux images produites par Midjourney, nous chercherons à déterminer quelles formes de collaboration, de redondance ou de disjonction iconotextuelles (Van der Linden 2006; 2008; Nikolajeva et Scott 2006) semblent mises en œuvre dans le traitement de l’extrait sous forme d’images proposées par le logiciel d’intelligence artificielle générative.
1. Repères théoriques
1.1. Les intelligences artificielles génératives et leurs commandes
De plus en plus utilisées dans différents domaines, allant de la traduction au marketing, de l’art numérique à la médecine, les intelligences artificielles génératives se caractérisent par l’exploitation de modèles linguistiques et d’apprentissage automatique qui permettent de produire de nouveaux contenus à partir de ressources médiatiques existantes, comme des textes, des éléments graphiques, des contenus audios ou vidéos (Jovanović et Campbell 2022). En fonction des technologies et des logiciels, les intelligences artificielles génératives parviennent, par exemple, à générer des textes à partir d’autres textes, comme le fait ChatGPT, mais également à partir de vidéos (voir, par exemple, Phenaki), de contenus sonores (voir, par exemple, Jukebox) ou même de formules scientifiques (voir, par exemple, Galactica). D’autres intelligences artificielles génératives, en revanche, utilisent des données textuelles pour créer des images bidimensionnelles, à l’instar de Midjourney ou de Dall·e, ou tridimensionnelles (voir, par exemple, les productions possibles avec Dreamfusion). Ces données textuelles, dites prompts, sont à considérer comme de véritables instructions, en langage naturel, visant à enclencher une analyse de la part de l’intelligence artificielle et à orienter le rendu final (Lou, Zhang et Yin 2023)1.
Selon différentes analyses portant sur l’ingénierie des prompts, pour que l’intelligence artificielle puisse se servir de sa capacité d’analyse linguistique et d’autoapprentissage, remplissant ainsi la tâche demandée par l’utilisateur·rice, ces indications textuelles doivent avoir un certain nombre de caractéristiques: par exemple, être cohérentes tout au long du processus de négociation avec l’intelligence artificielle, suffisamment diversifiées pour provoquer des variations et clairement orientées vers une forme d’apprentissage de la machine (Lou, Zhang et Yin 2023). En ce qui concerne la génération d’images à partir de textes, à laquelle nous nous intéressons plus particulièrement dans le cadre de cette contribution, d’autres paramètres nécessitent d’être pris en compte. En s’appuyant sur différentes expériences, Liu et Chilton (2022) ont notamment constaté qu’une interaction réussie avec l’intelligence artificielle, c’est-à-dire menant à un résultat en accord avec les instructions fournies, implique, entre autres, l’utilisation de mots-clés identifiant le thème de l’image et le style artistique souhaités, la génération de plusieurs images d’essai et la sélection de thèmes dont le niveau d’abstraction s’arrime à celui du style choisi. Oppenlaender (2023) a, de son côté, élaboré une typologie de modificateurs de commandes susceptibles de faire varier le résultat et d’être exploités dans une visée artistique. Le premier type de modificateurs concerne l’identification d’un ou plusieurs sujets de l’image, qui permettent d’indiquer à l’intelligence artificielle le ou les objets souhaités: si la définition de ces éléments «est essentielle pour contrôler le processus de génération de l’image» (Oppenlaender 2023, notre traduction), elle n’est pas une condition nécessaire pour enclencher le processus et certains auteur·rice·s peuvent donner aux intelligences artificielles des instructions portant uniquement sur le style. Le deuxième type concerne justement le style et donc l’identification de courants, périodes et écoles artistiques, ou bien d’artistes, matériaux, techniques ou supports sur lesquels l’utilisateur·rice souhaite voir représentée l’image générée par l’intelligence artificielle. Le troisième implique le réinvestissement d’une ou plusieurs images d’essai en guise de nouvelles commandes: dans ce cas, l’intelligence artificielle est censée profiter de ses capacités d’autoapprentissage et élaborer des variations sur le thème de ses premières propositions, en reconfigurant ou enrichissant l’image initialement générée. Le quatrième modificateur concerne l’utilisation d’«amplificateurs de qualité», que l’utilisateur·rice peut mobiliser pour «augmenter les qualités esthétiques et le niveau de détail des images» (Oppenlaender 2023, notre traduction): iel peut, par exemple, demander aux intelligences artificielles de produire une image «avec des couleurs sublimes» ou «digne d’un prix d’art contemporain» (Oppenlaender 2023, notre traduction), en laissant donc à la machine la possibilité d’exprimer une représentation algorithmique de la beauté ou de la légitimité artistique. Le cinquième concerne la répétition de termes qui permettent de renforcer les associations sémantiques que l’intelligence artificielle est en mesure d’établir. Enfin, le dernier type de modificateurs concerne l’introduction de termes dits «magiques», soit sémantiquement distants du sujet de la commande et se référant, par exemple, à des qualités non visuelles, comme le toucher ou l’ouïe (Oppenlaender 2023).
Ces différentes caractéristiques et variables des prompts susceptibles de conditionner l’interaction avec les intelligences artificielles, ainsi que leurs productions, ont déjà mené à interroger la portée artistique de l’écriture des commandes («Is writing prompts really making art?», se demandent McCormack et collègues) et les compétences nécessaires pour les rédiger (Korzynski et al. 2023). D’autres questions ont ciblé plus largement les capacités artistiques et créatives des intelligences artificielles génératives ainsi que la nature des productions générées. Décrites tantôt comme des «machines à plagiat» (Chomsky, Roberts et Watumull 2023), tantôt comme des technologies porteuses d’une «créativité artificielle» (Gefen 2023), les intelligences artificielles génératives créent des contenus dont le statut et la genèse demeurent partiellement opaques. À cet égard, que se passe-t-il lorsque le prompt est une citation littéraire? Comment, plus particulièrement, se comporte une intelligence artificielle générative comme Midjourney, qui crée des images à partir de textes, lorsque la commande ne mentionne pas des objets ou des styles artistiques ou encore lorsqu’elle comporte des énoncés métaphoriques ou un langage symbolique? Comment analyse-t-elle l’extrait? Cherche-t-elle à le situer par rapport au cotexte ou, plus largement, par rapport à l’œuvre dont il est issu? Quelles formes de collaboration, de redondance ou de disjonction iconotextuelles (Van der Linden 2006; 2008; Nikolajeva et Scott 2006) peut-on constater? Sur quels indices sémantiques ou thématiques semble-t-elle fonder sa transposition iconique? Peut-on identifier, dans ses démarches de traitement et de reconfiguration des données textuelles, des choix, des parcours ou des reconfigurations algorithmiquement subjectifs?
1.2. Les intelligences artificielles et l’expression de la subjectivité lectorale
Si une intelligence artificielle générative comme Midjourney est appelée à interpréter des données textuelles, l’usager·e qui les a saisies se doit d’analyser à son tour les productions qu’elle génère à partir de ses instructions. Comment les reçoit-iel? Recherche-t-iel des échos des textes de départ ou bien considère-t-iel comme acceptables des transpositions très éloignées des univers, narratifs et stylistiques, des textes de départ? Négocie-t-iel avec le logiciel pour parvenir à des productions plus proches de ses images mentales? Répondre à ces questions et interroger la réception que les élèves font des propositions de Midjourney revient non seulement à examiner comment iels procèdent lorsqu’iels analysent conjointement des images et des textes, mais également à observer comment iels expriment leur subjectivité lectorale (Langlade 2006) dans l’interaction avec la machine. Nous supposons, en effet, que le cadre technologique offert par les intelligences artificielles génératives et le processus de négociation auquel elles invitent pourraient constituer un nouvel espace d’expression de la subjectivité lectorale, dont les manifestations seraient à la fois issues de ressources et processus cognitifs, épistémiques, socioculturels, psychoaffectifs propres à chaque individu, et de conditions matérielles, discursives et techniques propres aux environnements numériques génératifs, qui baliseraient et détermineraient les horizons de production et de réception. À cet égard, si les intelligences artificielles génératives conditionnent l’agir du sujet en fonction de leurs caractéristiques et propriétés algorithmiques, elles lui permettent également d’agir subjectivement, par exemple au moment de la sélection et de la saisie d’une information textuelle pour la machine, lors de l'analyse des résultats, ou encore lors de la réévaluation éventuelle des consignes à l’aune de ses réactions, intuitions, curiosités, désirs, intentions et attentes propres. Dans cette perspective, les logiciels d’intelligences artificielles génératives et les processus informatiques sur lesquels ils reposent ne se limiteraient pas à influencer les manifestations de subjectivité, mais ils les détermineraient, les opérations prédictives et performatives de traitement, moissonnage et analyse des données textuelles venant reconfigurer le regard que le lecteur porte sur le texte, voire conditionner — ou programmer informatiquement — sa manière de le lire, de le comprendre, de le penser. Le sujet-lecteur numérique (Robinson 2022; Andrejevic 2020; Kiepas 2020) s’exprimerait ainsi au sein et par le biais d’un inconscient algorithmique, qui «brouillerait, briserait et reformaterait» (Beller 2021: 50) les modes d’expression de sa subjectivité. Plus précisément, l’activité fictionnalisante du sujet-lecteur numérique (ses concrétisations imageantes, ses jugements axiologiques, ses activations fantasmatiques, ses perspectives de cohérence mimétique) (Langlade 2006) s’appuierait aussi bien sur une reconfiguration personnelle du texte que sur l’anticipation des potentialités créatives de l’intelligence artificielle générative.
2. Méthodologie
2.1. Design de la recherche
L’expérience ici analysée a été élaborée dans le cadre du projet de recherche-action Multinumeric (FRQSC 2020-2023), qui vise à soutenir le développement de la compétence numérique par la littératie médiatique multimodale chez des élèves du secondaire dans différentes disciplines scolaires (en français, en univers social et en art), par la cocréation, la mise en œuvre et l’analyse de pratiques pédagogiques faisant appel au numérique. Réalisée entre décembre 2022 et mai 2023, à l’issue d’une première année de travail sur la lecture littéraire numérique, la séquence conçue pour le volet du projet concernant l’enseignement du français a été élaborée par trois cochercheur·es de l’équipe et par une enseignante de français exerçant en 3e année d’école secondaire (14-15 ans) dans un collège privé montréalais2. Différentes rencontres de cocréation en format distanciel ont eu lieu, afin d’identifier la problématique de la séquence; d’arrimer les compétences numériques visées aux programmes d’enseignement en français; de choisir les logiciels et les outils pédagogiques qui auraient été utilisés (portfolio, journal de bord, carnet de lecture, questionnaires d’accompagnement de la lecture littéraire, etc.). Des échanges de courriels, des partages de documents (articles scientifiques et ressources théoriques sur la théorie de la lecture littéraire numérique; référentiels des compétences numériques, etc.) ont complété la démarche. Structurée autour d’une question bien précise, formulée par l’enseignante lors de la première rencontre de cocréation («Comment s’engager dans un monde dont le sens nous échappe?»), la séquence a comporté, dans un premier temps, la lecture et l’analyse d’un corpus de textes littéraires de genres variés sur les thèmes de l’engagement et du non-sens3, puis, dans un deuxième temps, la mise à l’essai de deux logiciels d’intelligence artificielle générative, ChatGPT et Midjourney, dans le cadre de différentes activités de réception et production littéraire.
2.2. Description de l'activité
Articulé en trois activités, le volet de la séquence didactique comportant l'utilisation du numérique se proposait d’impliquer les élèves dans une forme de «dialogue» avec des logiciels d’intelligence artificielle sur les thèmes de l’engagement et du non-sens. Pour la première activité, dont nous rendons compte dans le cadre de cet article, l’enseignante avait notamment prévu de travailler avec Midjourney dans une perspective interprétative et appréciative. Les élèves devaient sélectionner un extrait qu’iels avaient particulièrement aimé (issu du corpus de textes narratifs, théâtraux et poétiques analysés dans la première partie de la séquence) et justifier leur appréciation au vu de critères esthétiques et thématiques, ainsi que d’une définition personnelle de l’engagement et du non-sens. Iels devaient également formaliser leurs attentes visuelles vis-à-vis de Midjourney, en anticipant la capacité du logiciel à restituer une image de l’extrait plus ou moins conforme à son contenu, tel qu’iels l’avaient appréhendé et imaginé au moment de la lecture. Dans cette sélection, les élèves devaient notamment établir des «liens entre des éléments thématiques du texte et le fonctionnement de Midjourney» 4, en anticipant, par exemple, les types de requêtes possibles et le rendu graphique de l’image, puis générer quelques images et les analyser, dans l’optique d’en choisir une, qu’iels avaient ensuite à interpréter de manière plus approfondie, en la mettant en relation avec le texte de départ. Dans cette étape, iels devaient être en mesure de porter un regard esthétique et critique sur les productions Midjourney, tant par rapport à l’extrait qu’aux processus génératif et automatisé de création d’images proposé par l’intelligence artificielle. Conformément aux intentions de l’enseignante, cette activité présupposait ainsi une réflexion, analytique et subjective, sur le texte de départ, une interaction avec le logiciel d’intelligence artificielle générative, et un questionnement, analytique et sensible, de ses capacités à s’approprier les indications textuelles fournies et à les traduire en images. Ces différents aspects auraient ensuite fait l’objet d’une évaluation, l’enseignante se proposant d’interroger la capacité des élèves à choisir un extrait sur la base d’arguments subjectifs, liés, d’une part, au «retentissement artistique et thématique» de l’œuvre de départ sur soi, d’autre part, aux représentations des réponses possibles du logiciel et de sa capacité à restituer une image plus ou moins conforme à leurs attentes esthétiques et thématiques. Tous les travaux des élèves ainsi que les images produites par Midjourney devaient être consignés dans un portfolio numérique individuel, sur lequel nous baserons nos analyses et constats.
3. Présentation des données
Dans cette section, nous examinerons les attentes que les élèves expriment par rapport à la capacité de Midjourney à traduire en images l’extrait qu’iels ont sélectionné, pour ensuite nous intéresser à leur analyse des images produites par le logiciel d’intelligence artificielle tant par rapport au texte de départ qu’aux préfigurations initiales. Notre attention se portera plus spécifiquement sur cinq portfolios d’élèves, qui témoignent d’approches très contrastées en ce qui concerne aussi bien la formulation des attentes vis-à-vis de Midjourney et de sa capacité à restituer une image de l’extrait plus ou moins conforme à leurs représentations, que l’analyse des productions générées par le logiciel d’intelligence artificielle générative.
3.1. Analyse des portfolios: du texte littéraire à la production générative
3.1.1. Attentes de représentation de l’extrait
L’analyse des portfolios des élèves révèle tout d’abord que les attentes visuelles concernant les images que Midjourney sera en mesure de générer s’expriment au moins de trois manières différentes.
Une partie des élèves s’attache à décrire assez finement l’image attendue, en donnant des indications précises sur les caractéristiques des personnages, leurs attitudes, leurs traits physiques et états psychologiques:
En lisant ce passage5, j’avais en tête une image d’une jeune fille en habit simple avec le minimum de possession — une fille de bohème sur un train. Elle regarde dehors, on ne peut pas voir sa face ni son expression. Elle est détendue et semble à l’aise. On ne voit pas clairement ce qui se passe dehors, parce que le train part assez vite pour mettre tout l’extérieur en mouvement. Mais il y a beaucoup de couleurs dehors, même si on ne sait pas elles appartiennent à quoi6.
Extrait du portfolio de Parnika
Je m’attends à voir quelqu’un de visiblement déprimé et piteux (dû aux envies suicidaires) qui mange du chocolat et le tout très peu coloré à part peut-être le chocolat lui-même7.
Extrait du portfolio de Maxence
Comme le démontrent respectivement les propos de Maxence et de Parnika, ces indications peuvent s’appuyer soit sur la reprise d’éléments de l’extrait soit sur des interprétations subjectives des passage cités. Si les attentes du premier renvoient au texte sélectionné, dans lequel sont évoqués aussi bien le chocolat que des pensées suicidaires, celles de Parnika, qui mettent notamment l’accent sur l’image d’une jeune femme à l’air détendu, voyageant en train dans une direction indéterminée, font écho à son interprétation du passage et des états d’âme du personnage: «en le (= le passage) lisant, on ressent le contraste entre la mobilité et la tranquillité», écrit-elle, avant d’expliquer, en citant à deux reprises l’extrait, que le personnage est pris dans le «mouvement des choses», qu’il vit sereinement, car, d’une part, il semble apprécier ne pas être «statique» et, d’autre part, il sait que les changements sont inévitables:
En le (= le passage) lisant, on ressent le contraste entre la mobilité et la tranquillité. Suzanne s’est mise à la fois en dehors de ce mouvement puisqu’elle «[avale] tout des yeux tranquillement» comme si les mouvements ne la concernent pas, mais elle fait aussi partie de cette mobilité puisqu’elle est aussi en mouvement et aime le fait qu’elle n’est pas statique. De plus, c’est un peu fou de dire qu’on se sent à sa place quand il n’y a pas une place fixe pour nous de rester et qu’elle est dans le mouvement des choses. C’est lié à l’absurdité de la vie puisque tout est continuellement en train de changer, et on ne peut pas mettre pause sur le temps pour que les choses restent telles qu’elles sont. Je trouve que ce passage est aussi fortement lié au temps puisque le mouvement des choses autour de nous (et nous-mêmes) est comme le passage du temps; et comme quand le temps coule, on ne peut pas modifier la suite des choses puisqu’il n’y a pas de possibilité de le faire une fois qu’elles sont passées. (…) Mais ce passage montre aussi l’engagement dans ce monde dont on ne peut pas changer les choses. Suzanne est «installée» et se sent «à [sa] place» même si tout autour elle, les choses sont en train de se dérouler.
Extrait du portfolio de Parnika
En revanche, pour une autre partie des élèves, à l’instar de Saynoon, les attentes visuelles de transposition de l’extrait sont formulées de manière plus vague, en indiquant simplement qu’iels espèrent recevoir une image qui exprime l’atmosphère du récit ou les émotions des personnages:
En ce qui concerne mes attentes visuelles/esthétiques pour l’extrait choisi8 dans Midjourney, j’aimerais voir une représentation visuelle qui reflète la profondeur émotionnelle de la phrase. Je souhaite que l’image capturée transmette la tristesse et la détresse des personnes.
Extrait du portfolio de Saynoon
Enfin, quelques formulations des attentes vis-à-vis de Midjourney témoignent de la volonté de certain·es élèves de mettre à l’épreuve l’intelligence artificielle et de tester ses capacités de figuration des extraits. Les propos de Maxence semblent justement valoriser le potentiel créatif du logiciel, auquel il reconnait la faculté d’articuler des termes et des images appartenant à des champs éloignés. Dès lors, son choix de l’extrait, explique-t-il dans le portfolio, est justifié par le désir de voir une image qu’«un humain» pourrait difficilement élaborer, car elle présuppose l’articulation de «deux termes qui ont normalement un symbolisme presque opposé». Il s’en explique en insistant sur l’incongruité apparente de l’extrait textuel choisi, dans lequel le narrateur établit un lien de causalité entre le fait d’être dans un état de profonde détresse («Quand on a envie de crever») et celui d’éprouver un plaisir inédit d’une expérience banale («le chocolat a meilleur gout que d’habitude»).
3.1.2. Analyse de l’interprétation des images produites par Midjourney
L’interprétation et l’appréciation des images produites par Midjourney, livrées également dans les portfolios, permettent d’examiner la manière dont les élèves s’attachent à identifier des liens thématiques entre les images et les textes de départ, voire expriment leur jugement esthétique sur les productions de l’intelligence artificielle générative. Dans ce cas aussi, les travaux considérés témoignent de démarches très différentes, allant d’une lecture des productions de Midjourney apparemment décorrélée des extraits à une analyse plus attentive à l’identification des liens entre les images et les textes de départ.
Les analyses contenues dans les portfolios de Saynoon, de Maxence et d’Anderson sont représentatives d’une lecture centrée sur l’image générée par Midjourney qui fait abstraction de l’extrait textuel de départ. Saynoon, par exemple, analyse la transposition proposée par Midjourney d’une citation du roman de Romain Gary La vie devant soi («C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes») et pointe des éléments qui contribuent, à son avis, à restituer l’atmosphère du passage et l’état d’âme des personnages, qu’elle avait auparavant décrits comme empreints de «tristesse et de détresse». Dès lors, elle décrit les «couleurs chaudes» de l’image et sa «lumière tamisée», qui créent un environnement «doux», «introspectif», «invitant à la contemplation». Elle s’attache également à décrire les «ombres» sur le visage du personnage, qui «ajoutent une mélancolie à l’image», et ses yeux, qu’elle définit, de manière assez paradoxale, comme «légèrement embués, suggérant une tristesse contenue».
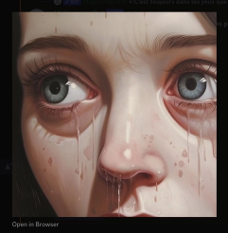
Figure 1. Image et analyse tirées du portfolio de Saynoon.
Extrait: «C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes» de La vie devant soi.
Après avoir exploré différentes options, j’ai choisi une image d’un visage aux yeux qui pleurent dans une lumière douce et tamisée. Les yeux du sujet sont légèrement embués, suggérant une tristesse contenue. Le visage est encadré par des ombres, ajoutant une dimension de mélancolie à l’image. J’ai opté pour cette image car elle capture la subtilité et l’intensité émotionnelle des yeux, tout en maintenant une certaine beauté esthétique. Les couleurs chaudes et la lumière tamisée créent une atmosphère douce et introspective, invitant à la contemplation.
L’élève, qui souhaitait retrouver, dans l’image de Midjourney, «la profondeur émotionnelle de la phrase» de Gary ainsi que «la tristesse et la détresse des personnes», semble désormais se concentrer uniquement sur l’image, dont elle justifie le choix en n’invoquant que des critères issus de son analyse de quelques éléments iconiques: «J’ai opté pour cette image car elle capture la subtilité et l’intensité émotionnelle des yeux, tout en maintenant une certaine beauté esthétique». Elle semble également faire abstraction de l’écart entre la représentation de la jeune fille en larmes proposée par le logiciel d’intelligence artificielle générative et celle de Monsieur Hamil, le vieux marchand de tapis, musulman pieux, auquel la citation fait référence. Dans son analyse, les différences entre les caractéristiques physiques des deux personnages ne sont pas discutées. La «tristesse contenue» du personnage n’est pas non plus analysée en tenant compte de celle du personnage dans l’extrait du roman. En effet, Monsieur Hamil, dans le passage en question, est chagriné par les questions que Momo lui pose à propos de ses parents, de son âge et de ses origines, car il n’est pas en mesure de lui répondre. En revanche, si les causes de cette tristesse teintée de gêne, d’affection, de pitié et d’empathie, ne sont pas discutées dans l’analyse de l’image, l’élève reconnait à la production de Midjourney la capacité à restituer la «profondeur émotionnelle» qu’elle avait attribuée à l’extrait.
De même, face à la production de Midjourney issue de la citation de Gary, «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude», Maxence se saisit de la représentation du personnage, des couleurs prédominantes et de l’organisation graphique des différents éléments pour analyser l’image à partir d’une interprétation sommaire de la citation. L’élève semble faire abstraction du contexte de l’extrait et ne revient pas sur l’association possible entre la condition du personnage de Momo, auquel renvoie la citation, et celui de la petite fille représentée dans l’image de Midjourney. L’analyse proposée par l’élève convoque, au contraire, des aspects qui ne font pas partie de l’imaginaire véhiculé par le texte de départ et qui semblent relever de préoccupations propres à l’élève, concernant la solitude, la dépression et l’aliénation du travail. Ainsi, la relative monochromie de l’image produite par l’intelligence artificielle est mise en relation avec la supposée dépression du personnage sur l’image, qui guetterait la mort; la présence d’une petite fille «encerclée de chocolat» et l’absence de voies d’issues («et il n’y a nulle part où elle peut sortir») sont comparées à l’enfermement d’une personne «dépressive ou déprimée (qui) pourrait se sentir emprisonnée par des mauvaises pensées et par la tristesse»; l’expression neutre de la petite fille, ni joyeuse ni vraiment triste, est justifiée par l’ambivalence de la scène, le personnage ayant envie de mourir, mais étant entouré d’un produit qu’il est censé considérer comme délicieux («la petite fille n’a pas l’air si déprimée, mais elle n’a pas l’air joyeuse non plus. Cela est probablement dû au fait qu’elle est supposée vouloir crever, mais qu’elle doit paraître aimer le chocolat»). Enfin, la tenue, l’air relativement serein et l’allure routinière avec laquelle la petite fille semble se charger de la décoration des chocolats évoquent pour l’élève l’absurdité de certaines tâches professionnelles, répétitives et aliénantes: «Alors on pourrait aussi dire qu’elle est enfermée dans la routine et la répétition ce qui revient à l’absurdité de la répétition dans le monde dans lequel on vit».

Figure 2. Image et analyse tirées du portfolio de Maxence.
Extrait: «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude» de La vie devant soi.
Premièrement, la petite fille n’a pas l’air si déprimée, mais elle n’a pas l’air joyeuse non plus. Cela est probablement dû au fait qu’elle est supposée vouloir crever, mais qu’elle doit paraître aimer le chocolat. De plus, l’image est monotone. Elle est principalement brune avec du chocolat, mais même la petite fille est habillée en brun. La diversité de couloir est souvent associée à la joie et à d’autres bonnes choses tandis que le contraire signifie souvent la déprime. Je pense que le fait que l’image soit monotone marche bien avec l’extrait car elle est supposée vouloir mourir. De plus, on peut observer que dans cette image, la fille est encerclée de chocolat et il n’y a nulle part où elle peut sortir. On pourrait dire qu’elle est enfermée et encerclée par le chocolat comme une personne dépressive ou déprimée pourrait se sentir emprisonnée par des mauvaises pensées et par la tristesse. Finalement, de la façon dont la fille est habillée et de la façon qu’elle présente le chocolat elle à une allure de travailleuse comme si elle était une caissière qui vend du chocolat. Elle à l’air habitué et tranquille comme si elle faisait ça chaque jour et que c’était rendu une routine. Alors on pourrait aussi dire qu’elle est enfermée dans la routine et la répétition ce qui revient à l’absurdité de la répétition dans le monde dans lequel on vit.
De manière similaire, l’image générée par Midjourney à partir d’une citation d’En attendant Godot, «Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable», amène Anderson à mettre en relation avec l’extrait des éléments visuels proposés par l’intelligence artificielle qui ne semblent pas renvoyer au texte de Beckett. À cet égard, l’élève juge «intéressants» deux éléments dont le lien avec la citation n’est pas explicité dans le portfolio. Le premier concerne la mise en scène d’un personnage amputé, le second la représentation, à son avis peu claire, du pied absent («l’intelligence artificielle ne nous montre pas clairement lequel de ses pieds n’est pas là»). Comme dans l’exemple précédent, l’élève se livre moins à une interprétation de relation texte-image qu’à une interprétation de l’image elle-même. Ainsi, plutôt que de se questionner sur la pertinence des éléments visuels introduits par Midjourney, sans liens apparents avec la citation du texte de Godot, Anderson semble plutôt chercher à comprendre, sans les discuter, les choix interprétatifs du logiciel: «l’intelligence artificielle a décidé que son pied coupable ne devrait juste pas exister». De même, si l’élève n’interroge pas, dans son analyse, le choix de l’intelligence artificielle générative de représenter, en premier plan, une chaussure disproportionnée par rapport à taille du personnage, il propose, en revanche, une interprétation de la couleur utilisée: «La couleur rouge peut dire beaucoup de choses comme comment le soulier est blâmé et coupable». En acceptant de facto la pertinence interprétative de la proposition iconique de Midjourney, non seulement l’élève affranchit cette dernière de l’épreuve de la confrontation au texte, mais, de plus, il justifie lui-même les choix interprétatifs du logiciel en leur conférant de la cohérence et du sens, même s’ils ne semblent pas fondés sur le contenu de la citation.

Figure 3. Image et analyse tirées du portfolio d’Anderson.
Extrait: «Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable» de En attendant Godot.
Dans cette photo le monsieur manque un pied, je trouve que c’est un détail très intéressant car l’intelligence artificielle a décidé que son pied coupable ne devrait juste pas exister. C’est aussi très intéressant comment l’intelligence artificielle ne nous montre pas clairement lequel de ses pieds n’est pas là. L’image nous présente un homme plutôt triste et malheureux, il manque son pied droit ou gauche (c’est pas très clair). Le soulier rouge peut être interprété en étant coupable, mais c’est vraiment le pied qui est coupable même si c’est le monsieur qui blâme son soulier. La couleur rouge peut dire beaucoup de choses comme comment le soulier est blâmé et coupable.
Si, dans ces exemples, le texte de départ parait entièrement ou partiellement occulté dans l’analyse des élèves, dans d’autres productions, la reconfiguration subjective des images et des textes de départ, dont témoignent les justifications, les descriptions et les interprétations des productions de Midjourney, est plus explicitement reconduite à l’extrait.
Ainsi, la description d’une image générée par Midjouney, auquel une autre élève (Parnika) a soumis une citation de La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette («Le paysage se déroule et s’éloigne, tu avales tout des yeux tranquillement. Tu sens que tu es à ta place, pour la première fois. Installée dans le mouvement des choses»), révèle que l’élève tente d’établir un lien avec le texte de départ. Parnika souligne la redondance entre des éléments de l’images et certains passages de la citation («la fille regarde calmement dehors»; «voit du champ sans fin qui passe en arrière d’elle») et renvoie à des moments ou des évènements précédents de l’histoire («cette scène nous rappelle aussi de quand Suzanne est venue à Montréal pour la première fois pour son concours d’art oratoire»). Parnika mobilise également des éléments issus aussi bien de son imaginaire et de sa compréhension/interprétation de l’œuvre. Elle fait, par exemple, référence au «soleil (qui est) en train de [se] coucher dehors» — et qu’on ne voit pas pour autant dans l’image —; elle interprète le regard du personnage comme étant orienté vers «l’horizon, vers un futur que personne ne peut prédire» et elle commente son voyage «vers l’inconnu», en affirmant, de manière solennelle, qu’«il n’y a pas de recul, pas de ralentissement». Interprété de manière métaphorique par l’élève, ce voyage du personnage, qui lui rappelle un passage précédent de l’histoire, au cours duquel Suzanne, lors de son premier séjour à Montréal, a découvert «la vraie signification de l’art libre», devient aussi l’occasion d’anticiper des évènements futurs. En effet, Parnika décrit cette nouvelle fuite du personnage comme celle qui lui permettra de «rester temporairement avant de partir de nouveau» et qui lui fera également «découvrir un nouveau milieu qui lui donnera l’inspiration pour créer de l’art». La description de l’image montre, enfin, que l’élève l’analyse au prisme des connaissances sur le genre littéraire et artistique (l’avant-garde automatiste) acquises durant le cours consacré au roman de Barbeau-Lavalette: «On peut voir qu’elle est au milieu de la campagne, et c’est comme tous les autres artistes/automatistes. En effet, la plupart d’entre eux finissent par adopter une vie en campagne pour leur création artistique».

Figure 4. Image et analyse tirées du portfolio de Parnika.
Extrait: «Le paysage se déroule et s’éloigne, tu avales tout des yeux tranquillement. Tu sens que tu es à ta place, pour la première fois. Installée dans le mouvement des choses» de La femme qui fuit.
Dans l’image, la fille (qui peut représenter Suzanne) regarde dehors et voit du champ sans fin qui passe en arrière d’elle. Le Soleil est en train de coucher dehors, et elle est dans ce train qui l’amène vers l’inconnu. Il n’y a pas de recul, pas de ralentissement. La fille regarde calmement dehors. En fait, elle regarde l’horizon — comme écrit au début du roman, Suzanne lève ses yeux et regarde l’horizon, vers un futur que personne ne peut prédire. On peut voir qu’elle est au milieu de la campagne, et c’est comme tous les autres artistes/automatistes. En effet, la plupart d’entre eux finissent par adopter une vie en campagne pour leur création artistique. De plus, cette scène nous rappelle aussi de quand Suzanne est venue à Montréal pour la première fois pour son concours d’art oratoire — elle était dans un train et regardait le paysage qui l’amenait à une ville dans laquelle elle va découvrir la vraie signification de l’art libre. Donc, cette fois, quand elle prend le train de nouveau pour trouver une autre place pour rester temporairement avant de partir de nouveau, c’est comme si elle allait découvrir un nouveau milieu qui lui donnera l’inspiration pour créer de l’art.
Si l’exemple précédent a permis d’établir que Parnika est parvenue facilement à établir des liens entre l’extrait et l’illustration proposée par Midjourney, le logiciel ayant traduit en images quelques éléments de la citation (le paysage qui déroule et s’éloigne; un personnage féminin qui regarde dehors), le travail d’Arthur, quant à lui, montre comment il est possible de trouver une correspondance entre le texte et la production de l’intelligence artificielle, même lorsque celle-ci semble sans lien apparent avec la citation de départ. Ainsi, dans son analyse de l’image générée à partir d’une autre citation issue de La femme qui fuit, «On est allé trop loin, trop vite», l’élève souligne d’emblée «la grande diversité et l’absurdité» des «composant(e)s» de l’illustration fournie par Midjourney, qui représente des «objets n’allant pas du tout ensemble et n’étant pas du tout à leur place». Tentant tout de même d’arrimer la proposition du logiciel au texte de Barbeau-Lavalette, l’élève associe «cet(te) absurdité et ce mélange d’objets» aux sentiments «d’inconfort et de confusion» que Suzanne Meloche devait avoir éprouvés au moment du passage. Pour ce faire, il mobilise sa subjectivité en invoquant, plus spécifiquement, son propre inconfort face à l’ensemble hétéroclite d’éléments indéfinissables qui composent l’image, qu’il compare à celui éprouvé par le personnage du roman de Barbeau-Lavalette. De plus, il interprète le caractère «extravagant» de la production de Midjourney comme la représentation métaphorique du franchissement des frontières de la raison: «Je crois que cela signifie le fait d’être aller trop loin, d’avoir pris un trop gros pas et de s’être retrouvé à quelque part où nous ne sommes pas supposé être». La reprise de l’expression «aller trop loin», présente dans la citation, témoigne de la volonté de l’élève d’interpréter l’image moins pour ce qu’elle évoque en soi que pour ce qu’elle représente du texte qui a déterminé sa génération.

Figure 5. Image et analyse tirées du portfolio d’Arthur.
Extrait choisi: «On est allé trop loin, trop vite» de La femme qui fuit.
Cet extrait m’a marqué parce que j’y trouve beaucoup de vérité quant à la façon dont nous vivons ces jours ci. On se dépêche trop vite pour vivre notre vie et cela peut ruiner notre perception des vraies choses. Mon attente pour l’image reliée à cet extrait est un humain marchant sur un chemin qui a l’air d’aller à l’infini. Par contre, L’image que Midjourney m’a procuré pour cet extrait a été bien différente de ce que je m’attendais. J’ai choisi l’image ci-dessus en particulier car les autres ne représentaient que des grenouilles et une maison en champignons, deux aspects qui ne m’ont pas marqué. L’image que j’ai choisie m’a marqué due à la grande diversité et à l’absurdité de ses composants. Cette absurdité et ce mélange d’objets n’allant pas du tout ensemble et n’étant pas du tout à leur place me donne un sentiment d’inconfort et de confusion, les mêmes sentiments que Suzanne Meloche ressentait lorsqu’elle a dit la phrase que j’ai choisie. Aussi, les composants de cette image m’ayant été procurée sont tout droit sortie d’un imaginaire extravagant. Je crois que cela signifie le fait d’être aller trop loin, d’avoir pris un trop gros pas et de s’être retrouver à quelque part où nous ne sommes pas supposé être, ou nous ne savons pas la façon dont les choses marchent.
3.2. Analyse des images produites par Midjourney: quelles modalités de traitement de l’extrait?
Après avoir examiné les attentes de représentation des élèves vis-à-vis de Midjourney ainsi que leurs analyses des productions retenues, il convient de s’arrêter sur les images produites par le logiciel d’intelligence artificielle, afin d’identifier les modalités du traitement des informations textuelles opérées par la machine. Quelles formes de collaboration, de redondance ou de disjonction iconotextuelles (Van der Linden, 2006; 2008; Nikolajeva et Scott, 2006) sont mises en œuvre par l’intelligence artificielle générative? Quels éléments de l’extrait semblent retenus dans chaque cas?
Nous avons repéré et distingué trois types de rapports textes-images. Le premier s’apparente à la redondance, qui, selon la définition de Van der Linden (2006), implique une congruence, totale ou partielle, entre les informations portées par les textes et par les images. Dans cette catégorie figure, par exemple, l’illustration proposée par Midjourney à Parnika à partir de la citation de La femme qui fuit «Le paysage se déroule et s’éloigne, tu avales tout des yeux tranquillement. Tu sens que tu es à ta place, pour la première fois. Installée dans le mouvement des choses». La représentation d’une femme, le regard plongé dans le panorama qui défile devant elle, véhicule en effet les mêmes informations que l’extrait, dont elle reprend plusieurs éléments: le personnage représenté est en effet une femme (ce qui n’est signalé, dans l’extrait, que par l’accord en genre du participe passé «installée»), en mouvement, face à un paysage qu’elle observe «tranquillement» (dans l’image, la jeune femme contemple un paysage à travers la fenêtre d’un train en marche).
Le deuxième type de rapport textes-images identifiable dans les propositions de Midjourney relève de la collaboration ou de la complémentarité. Dans cette configuration, selon la définition de Van der Linden (2006), deux contenus, partiellement discordants, «travaillent conjointement en vue d’un sens commun» (p. 120). Cette collaboration, que l’on retrouve dans plusieurs propositions de l’intelligence artificielle, se fonde généralement sur la reprise d’un seul élément de l’extrait et est accompagnée de l’introduction de personnages, de lieux ou de représentations d’actions qui ne figurent pas dans le texte de départ. Ainsi, dans l’image issue de la citation de Gary «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude», l’intelligence artificielle extrait du texte la référence au chocolat, mais elle ajoute, dans l’image, le personnage d’une petite fille, assez élégamment vêtue, qui le décore. De la même manière, dans la production générée à partir de la citation de Beckett «Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable», on retrouve les éléments «homme» et «chaussure». Cependant, l’image du personnage privé d’un pied résulte d’une intervention du logiciel, basée peut-être sur la tentative de restituer la mention d’un homme «tout entier» qui s’attaque à la partie de soi qu’il estime coupable. On observe le même type de congruence partielle entre les informations véhiculées par les textes et par les images dans celle générée à partir de la citation de La vie devant soi: «C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes». D’une part, la proposition de l’intelligence artificielle semble fondée sur la reprise de quelques éléments de l’extrait, et notamment sur la référence aux «yeux» et à leur capacité à laisser transparaitre la tristesse des gens. D’autre part, elle introduit des éléments qui ne sont pas évoqués par le texte et qui, comme nous l’avons vu, n’appartiennent pas au passage en question. Dès lors, les larmes, tout comme la caractérisation d’un personnage féminin, sont une réélaboration de Midjourney, qui se trouve à faire dire quelque chose de plus ou de légèrement différent (Eco, 2003) au texte de Gary.
Le troisième type de rapport textes-images identifiable dans le corpus d’images consignées dans les portfolios peut être associé à la syllepse. Définie comme un cas extrême de contrepoint (Nikolajeva et Scott 2006), elle désigne la disjonction entre les informations textuelles et celles véhiculées par l’image. L’image générée par Midjourney à partir de la citation de La femme qui fuit, «On est allé trop loin, trop vite», en constitue un parfait exemple, car l’écart entre ce qu’exprime le texte de départ et ce que représente l’image générée par l’intelligence artificielle est maximal. Cette dernière, en effet, donne à voir une maison entourée de créatures fantastiques, réduites à des bouches et des yeux exorbités, guettant l’horizon ou rejetant une pluie de petits objets, autour d’une maison près de laquelle apparait un homme à l’air résigné.
4. Discussion des données
4.1. Du texte de départ à la génération d’images
4.1.1. Du texte de départ à la génération d’images: attentes littéraires et attentes technologiques
L’étude des portfolios révèle que les attentes de transposition iconique des élèves reposent essentiellement sur la reprise de quelques éléments de l’extrait qui ont attiré leur attention. Iels espèrent notamment que Midjourney puisse générer des images qui expriment une redondance, ou du moins une forme de collaboration, avec les textes. Dès lors, iels retiennent, pour leurs analyses interprétatives, les productions qu’iels jugent les plus conformes à la citation et, lorsque l’intelligence artificielle leur propose des images très éloignées de l’univers des extraits, iels cherchent à rétablir des liens avec les textes en revenant sur leurs émotions: ainsi, si Parnika sélectionne l’image qui «décrit le mieux le passage» et Maxence écarte celles qui «correspondent moins à l’extrait», Arthur en conserve une qu’il juge absurde et recrée un lien avec le texte de Barbeau-Lavalette en assimilant son «inconfort» pour la proposition de Midjourney à celui que le personnage éprouve dans le passage cité. Cette attente d’une certaine congruence entre des éléments de la citation et la transposition iconique s’accompagne d’une autonomisation de l’extrait par rapport au contexte. Que l’extrait présente des contenus plus abstraits («aller trop loin, trop vite») ou des référents plus concrets (chocolat, yeux, etc.), les attentes ne sont pas fondées sur la citation et son contexte, mais considérées de manière relativement indépendante. Si la citation offre des référents concrets (par exemple «chocolat»), ils sont réinvestis dans la formulation des attentes sous la forme d’une reprise mot-à-mot; si, en revanche, l’extrait présente des contenus plus abstraits («aller trop loin, trop vite»), les élèves introduisent de nouveaux éléments («un humain marchant sur un chemin qui a l’air d’aller à l’infini»), qui ne renvoient que partiellement au texte de départ.
On constate, de plus, une faible valorisation de la polysémie de l’image et de sa capacité potentielle à enrichir les textes de départ, à en expliciter les non-dits ou bien à développer des narrations parallèles. Un seul élève, en effet, choisit parmi les différentes propositions de Midjourney l’image qui, à son avis, peut se prêter à de multiples interprétations («J’ai choisi cette image car il y a plusieurs façons de l’interpréter», Extrait du portfolio de Maxence).
Par ailleurs, la formulation d’attentes impliquant une mise à l’épreuve des potentialités — créatives ou technologiques — du logiciel est plutôt rare: dans un cas seulement, on trouve explicitée la volonté d’interroger la capacité de Midjourney à générer une image à partir d’éléments textuels considérés comme difficiles à représenter pour un être humain. Si la nouveauté de l’expérience et de l’exercice d’interaction avec l’intelligence artificielle a certainement conditionné les attentes des élèves ainsi que leurs manières de les formuler, nous pouvons néanmoins considérer que l’on s’attend avant tout de Midjourney qu’il sache lire et comprendre le texte, puis le transposer en une image qui mobilise et réinvestit de manière cohérente les éléments jugés saillants.
Cette recherche d’une adhésion à la citation détermine peut-être la relative imprécision des indications concernant la représentation des personnages ou des lieux de l’extrait. En effet, les attentes visuelles des élèves sont généralement exprimées de manière sommaire, avec peu de références aux images mentales élaborées au moment de la lecture. On peut dès lors supposer que les élèves ne s’attendent pas à ce que l’intelligence artificielle soit en mesure de s’arrimer à leur interprétation ni qu’elle puisse être utilisée pour donner à voir les reconfigurations subjectives qu’iels opèrent en lisant. Cela pourrait également expliquer le fait que les élèves ne cherchent pas à obtenir des images plus proches de leurs représentations mentales en donnant des indications supplémentaires à Midjourney. Leur démarche d’interaction avec l’intelligence artificielle se limite à la réinsertion de la citation et à l’attente d’une nouvelle proposition, plus conforme à la lettre du texte. Dans cette perspective, Midjourney serait considéré davantage comme une machine de traduction intersémiotique, dont l’efficacité s’évalue en fonction de la cohérence des articulations textes-images proposées, que comme une machine d’appropriation littéraire (Shawky-Milcent, 2014).
4.1.2. Du texte de départ à l’analyse des images: analyses iconotextuelles à géométrie variable
L’analyse des images retenues dans les portfolios montre que les élèves tendent à décrire et à interpréter les propositions de Midjourney de manière décorrélée de l’extrait. Les cinq travaux examinés montrent qu’une élève seulement, Parnika, s’attache à associer les éléments visuels proposés par le logiciel d’intelligence artificielle à la citation, en identifiant, dans le portrait de la jeune fille dans le train, des liens avec l’attitude, l’environnement et les actions du personnage de Suzanne. Les autres élèves se livrent, en revanche, à des analyses fortement descriptives, qui semblent oublier le texte — et ce même si leurs interprétations initiales mobilisaient de manière assez précise des éléments de la citation ou renvoyaient, de manière plus large, aux thématiques de l’œuvre. Ainsi, Seynoon, qui avait fait référence, dans son appréciation critique de l’extrait de Gary, à la question de la marginalité ainsi qu’à la solitude et à la vieillesse des personnages du roman, décrit ce «visage aux yeux qui pleurent dans une lumière douce (…) et introspective, invitant à la contemplation» sans en interroger la cohérence par rapport à la citation. De manière similaire, Anderson ne relève pas, dans son analyse de la symbolique de la couleur du soulier et la représentation d’un homme sans pied, l’introduction d’éléments absents de l’univers narratif de Beckett. Maxence, de son côté, analyse longuement la monochromie de l’image, l’aspect de la petite fille représentée et sa position au milieu de centaines de petits chocolats à l’aune de thématiques qui n’appartiennent pas à l’œuvre citée. Il semble ainsi que l’image générée par la machine se superpose au texte, s’interpose dans le processus de réception de celui-ci et lui fasse littéralement écran, en amenant les élèves à réagir uniquement à ce qu’ils voient.
Or, si l’exercice de la citation, qui implique d’isoler et de décontextualiser des phrases marquantes, pourrait avoir favorisé l’oubli du texte, on peut également supposer que les élèves acceptent les productions de Midjourney comme étant des formes de concrétisation imageante de la machine, c’est-à-dire comme le résultat d’un processus de figuration des personnages, des lieux et des évènements d’un récit (Langlade 2006), et qu’iels recherchent une liaison systématique, bien que non nécessairement visible, avec l’extrait. Par exemple, dans l’analyse d’Arthur, qui a constaté l’absurdité de la proposition fantastique de Midjourney par rapport à la citation de La femme qui fuit («On est allé trop loin, trop vite»), le lien avec l’extrait est justifié par l’adhésion de l’élève aux émotions du personnage: en effet, son «inconfort», qu’il rattache à l’égarement supposé du personnage dans le texte, est perçu comme un signe de l’absurdité de l’image et, donc, de son adéquation avec la citation. L’image, superposée au texte, enclenche un discours sur l’œuvre qui permet de raconter ses émotions, sa propre lecture de l’image. Dès lors, pour Arthur, tout comme pour ses camarades, le discours sur le texte est reconfiguré par une analyse de l’image qui devient l’occasion pour parler de soi, de ses préoccupations et de sa vision du monde. Ainsi, si les élèves ne décèlent pas les incohérences entre les textes et les images ou, du moins, s’iels ne semblent pas particulièrement gêné·es par les écarts constatés, c’est parce que l’image se trouve à être interprétée à la place du texte.
4.2. Rapports textes-images: ce que Midjourney fait à l’extrait
Que fait donc l’intelligence artificielle générative aux extraits? Comment les réélabore-t-elle et que peut-on dire de sa démarche de transposition?
On constate tout d’abord que Midjourney n’est pas en mesure d’identifier la citation ni d’en restituer le cotexte. L’introduction, dans presque toutes les images, de personnages, d’éléments et de décors étrangers aux textes de départ montre, en effet, que le traitement du texte n’implique pas une consultation de bases de données littéraires ni l’exploitation d’informations relatives à l’œuvre, à son auteur·rice ou à son époque. À l’instar des élèves, l’intelligence artificielle générative ne reconnait pas la citation comme telle, mais la traite au contraire comme toute commande textuelle (ou prompt), en isolant des mots et des phrases clés (Oppenlaender 2023). Ainsi, d’une part, l’intelligence artificielle procède à la transposition en images d’indices sémantiques plus ou moins facilement identifiables, d’autre part, elle propose des illustrations assez proches les unes des autres d’un point de vue graphique et visuel, malgré les différences génériques et stylistiques des textes de départ.
Par ailleurs, dans sa démarche transpositive, Midjourney semble générer plus aisément des images ayant une relation de symétrie avec les textes lorsque ceux-ci contiennent des références à des éléments concrets, tandis qu’il propose des associations moins immédiates lorsque la citation revêt une valeur aphoristique ou convoque des concepts abstraits, des états d’âme ou des émotions. Dans ce cas, l’intelligence artificielle procède soit en substituant des images plus concrètes à des références abstraites, le chagrin étant, par exemple, traduit par l’image d’une jeune fille en pleurs, soit en introduisant de nouveaux éléments, plus ou moins éloignés de la citation et de son cotexte. Ces interventions peuvent être reliées aux textes de départ par le biais de métaphorisations, qui permettent, par exemple, de reconnaitre dans le personnage sans pied représenté par Midjourney la condition de l’«homme tout entier» de Beckett, ou bien elles peuvent être considérées comme des réécritures iconiques à part entière. Par exemple, l’image proposée à partir de la citation de La femme qui fuit «On est allé trop loin, trop vite» et, dans une moindre mesure, celle issue de la citation de Gary «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude» témoignent de ces procédés de traitement des informations textuelles «magiques» (Oppenlaender 2023), qui ne permettent pas d’identifier les indices sémantiques exploités par la machine, mais qui «introduisent un caractère aléatoire dans l’image, pouvant conduire à des résultats surprenants» (Oppenlaender 2023, notre traduction). Il semblerait ainsi que lorsque l’intelligence artificielle ne parvient pas à isoler et à transposer de manière symétrique des indices textuels, elle insère des variables impondérables, qui témoignent d’une forme de créativité algorithmique.
Conclusion
Bien que le caractère exploratoire de notre recherche et la nouveauté de l’expérience pour les élèves n’invitent pas aux généralisations, il nous semble que les propos des participant·es, leurs attentes et analyses puissent témoigner de manières de penser et construire le sens produit par une intelligence artificielle dans le cadre d’une activité de réception/production littéraire.
Tout d’abord, nous avons vu que les images générées par l’intelligence artificielle sont traitées comme une transposition iconique des citations et qu’elles sont rarement remises en question par rapport au texte de départ ou à son cotexte. Analysées à la place du texte, elles sont, au contraire, regardées et interprétées en acceptant d’emblée l’ensemble d’associations et reconfigurations imageantes, plus ou moins éloignées des citations, proposées par Midjourney.
Dans cet exercice, qui les mène parfois à s’éloigner de l’horizon littéraire des textes de départ, les élèves révèlent un autre horizon d’attente, d’ordre technologique, qui les conduit à projeter, envisager ou fantasmer les capacités et les limites de l’intelligence artificielle. Les références à la transposition d’éléments textuels et le nombre relativement limité d’indications concernant la capacité de Midjourney à associer des indices sémantiques pour créer des images poétiques, imagées, décalées ou au contraire fidèles au texte de départ montrent que, sans un enseignement des manières d’interagir avec les intelligences artificielles, les élèves s’attendent avant tout à ce que le logiciel sache bien lire, comprendre et transposer les textes en images plutôt qu’intervenir de manière créative, en proposant de nouveaux éléments, des réinterprétations ou des reconfigurations stylistiques particulières.
Et pourtant, les images produites par Midjourney montrent que l’intelligence artificielle opère des remaniements profonds du texte de départ, en proposant, parfois, des univers graphiques dans lesquels aucun élément des citations n’est identifiable. D’où viennent ces images? Sont-elles l’expression d’une manière — subjective — de la machine de concevoir les thèmes des extraits sélectionnés pour l’article, soit la tristesse, le besoin d’un coupable, le constat d’être allé trop loin, trop vite? Peut-on considérer la combinaison opaque d’indices sémantiques comme une forme de réécriture créative des extraits? Peut-on comparer l’analyse que Midjourney fait de la citation, décorrélée de l’extrait, à celle qu’en font les élèves? Les propositions visuelles de Midjourney forcent-elles les élèves à construire des relations sémantiques qui déforment, voire dénaturent le sens du texte à l’origine de la commande, ou encore leur propre concrétisation imageante? Dans un contexte où les élèves seraient davantage formé·es aux moyens, aux processus et aux formes d’interaction avec une intelligence artificielle, verrions-nous davantage apparaitre leur propre subjectivité, mise en jeu avec celle anticipée de la machine? Si ces questions ne semblent pas, pour le moment, avoir de réponse, elles nous semblent tout à fait pertinentes en contexte didactique, aussi bien dans une perspective de développement de compétences littéraires que littéraciques numériques.
Bibliographie
Andrejevic, Mark (2020), Automated Media, New York et Abingdon, Routledge.
Bensamoun, Alexandra (2020). «Ceci est… une œuvre d’art! La question des créations générées par une intelligence artificielle», L’Observatoire, 55 (1), p. 104-106.
Beller, Jonathan (2021), The World Computer: Derivative Conditions of Racial Capitalism, New York, Duke University Press, [en ligne].
Chomsky, Noam, Roberts, Ian et Watumull, Jeffrey (2023), «The false promise of ChatGPT». The New York Times, 8 mars 2023, [en ligne].
Collin, Simon et Marceau, Emmanuelle (2021). L’intelligence artificielle en éducation: enjeux de justice » Formation et profession, 29 (2), p. 1–4, [en ligne].
Dusi, Nicola (2000), «Per una ridefinizione della traduzione intersemiotica», In N. Dusi et S. Nergaard (dir.). Sulla traduzione intersemiotica. Versus, n° 85-87, p. 3-54.
Eco, Umberto (2003), Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani.
Fernandez, Perter (2022), «Technology behind text to image generators, Library Hi Tech News», n° 39(10), p. 1-4 [en ligne].
Ganascia, Jean-Gabriel (2017). «Une machine ne peut pas être créative.», In J. Ganascia (dir.), Intelligence artificielle: vers une domination programmée?, Le Cavalier Bleu, p. 107-115.
Gefen, Alexandre (dir.) (2023), Créativités artificielles. La littérature et l'art à l’heure de l'intelligence artificielle, Paris, Presses du réel.
Gozalo-Brizuela, Roberto et Garrido-Merchán, Eduardo (2023), «ChatGPT is not all you need. A state of the art. Review of large generative AI models», AI Frameworks Discussion of Abeba Birhane’s Algorithmic Injustice and Social Impact Articles, 1 (1), [en ligne].
Jovanović Mladjan et Campbell, Mark (2022), «Generative Artificial Intelligence: Trends and Prospects», Computer, 55 (10), p. 107-112. (DOI: 10.1109/MC.2022.3192720)
Kiepas, Andrzej (2020), «Human Subjectivity in the Dawn of Digital Society», International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, 7 (1), p. 31-38.
Korzynski, Pawel, Mazurek, Grzegorz, Krzypkowska, Pamela et Kurasniski, Artur (2023), «Artificial intelligence prompt engineering as a new digital competence: Analysis of generative AI technologies such as ChatGPT», Entrepreneurial Business and Economics Review, 11 (3), p. 25‐37, [en ligne].
Langlade, Gérard (2006), «L’activité fictionnalisante du lecteur». Modernités 23. Les enseignements de la fiction, in M. Braud, B. Laville et B. Louichon (dir.), p. 163-176.
Le Goff, François et Fourtanier, Marie-Josée (dir.) (2017), Les Formes plurielles des écritures de la réception. Volume I: Genres, espaces et formes. Volume II: Affects et temporalités, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Diptyque».
Liu, Vivian et Chilton, Lidia B. (2022), «Design guidelines for prompt engineering text-to-image generative models», CHI ’22: Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing systems, New York, Association for computing machinery.
Lou, Renze, Zhang Kai et Yin Wenpeng, (2023), «Is prompt all you need? No. A comprehensive and broader view of instruction learning», arXiv, [en ligne].
McCormack, Jon, Gambardella, Camilo Cruz, Rajcic, Nina, Krol, Stephen, James, Llano, Maria Teresa et Yang Men (2023), «Is writing prompts really making art?», In Artificial Intelligence in Music, Sound, Art and Design, S. Adkins, P. Sarmento et M. Barthet (dir.), Cham, Springer, p. 196-211 [en ligne].
Nikolajeva, Maria et Scott, Carole (2006), How picturebooks work, New York, Routledge.
Oppenlaender, Jonas (2023), «A taxonomy of prompt modifiers for text-to-image generation», Behaviour & Information Technology, [en ligne].
Roberge, Jonathan et Lebrun, Tom (2021). «BERT, GPT-3, Timnit Gebru et nous: l’intelligence artificielle à la conquête du langage», Sociologie et sociétés, 53 (1-2), p. 235-257, [en ligne].
Robinson, David G. (2022), Voices in the Code: A Story about People, Their Values, and the Algorithm They Made. Russell Sage Foundation [en ligne].
Shawky-Milcent, Bénédicte (2014), L’Appropriation des œuvres littéraires en classe de seconde, Thèse de doctorat soutenue à l’université de Grenoble.
Van der Linden, Sophie (2006), Lire l’album, Le Puy-en-Velay, L’Atelier du poisson soluble.
Van der Linden, Sophie (2008). «L’album, le texte et l’image», Le français aujourd’hui, 161 (2), p. 51-58.
Velkovska, Julia et Relieu, Marc (2021). «Pour une conception "située" de l’intelligence artificielle. Des interactions hybrides aux configurations socio-techniques», Réseaux, 229 (5), 2021, p. 215-229.
Pour citer l'article
Eleonora Acerra, Sylvain Brehm, Nathalie Lacelle, "Représenter sa réception d’un texte littéraire en images avec Midjourney: analyse des attentes des élèves et des productions générées par l’intelligence artificielle générative", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/representer-sa-reception-d-un-texte-litteraire-en-images-avec-midjourney-analyse-des-attentes-des-eleves-et-des-productions-generees-par-l-intelligence-artificielle-generative
Voir également :
Quels usages des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels de français pour le collège?
Cet article examine les usages que six collections de manuels de français pour le collège font d’adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires.
Quels usages des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels de français pour le collège?
Les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires constituent une importante porte d’entrée pour le cinéma dans les manuels de français: un dépouillement des manuels en vigueur en France pour le collège1 fait en effet apparaitre que plus d’une activité sur deux consacrées à un film concerne une adaptation d’œuvre littéraire.
Cette situation ne trouve pas son explication dans les programmes: les indications de corpus dans les prescriptions «proposent des ouvertures vers l’éducation aux médias et vers d’autres formes d’expression artistique (particulièrement des oeuvres picturales et cinématographiques)»2, et sur quatre occurrences du cinéma parmi les pistes plus précises ouvertes pour les classes de collège, une seule suggère qu’on peut «s’appuyer sur une adaptation cinématographique ou télévisuelle d’un roman ou d’une nouvelle réaliste ou naturaliste»3. Parmi les compétences visées pour les classes de collège, la compétence «lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la photographie, à la publicité et au cinéma en fondant sa lecture sur quelques outils d’analyse simples» figure par ailleurs au même niveau que celles qui concernent la lecture de textes littéraires («lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art» et «élaborer une interprétation de textes littéraires»). Les programmes prévoient donc un travail à part entière sur le cinéma, sans donner de priorité en termes de corpus à des adaptations d’œuvres littéraires.
Cette forte présence des adaptations dans les manuels traduirait-elle alors l’affirmation d’un mode de traitement des films, qui répondrait au besoin identifié par Le Français aujourd’hui en 2009, d’une «didactique à inventer» en ce qui concerne les relations texte / film? Les pages consacrées à ces adaptations feraient-elles écho à des réflexions et propositions de didacticiens de la littérature, comme Langlade (2012) qui invite à prendre au sérieux les interprétations proposées par des adaptations pour ouvrir le jeu interprétatif dans la lecture des textes,ou Louichon (2015) qui établit l’intérêt d’aborder des œuvres patrimoniales à partir de leurs relectures et réécritures contemporaines, notamment au cinéma? Dans quelle mesure les activités organisées s’attachent-elles aux spécificités des compétences que doivent respectivement mobiliser le lecteur d’œuvres littéraires et le spectateur de films (Lacelle, 2011)?
Cet article propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur, ou avec, des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? Comment est organisée la mise en relation entre texte et film? Dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre? À quelles conditions la confrontation se fait-elle l’occasion d’un dialogue dynamique entre les œuvres?
Corpus et méthode
L’analyse s’appuie sur le dépouillement de six collections françaises de manuels pour le collège, qui regroupe les quatre premières années du cycle secondaire en France: Fleurs d’encre (Hachette), Colibris (Hatier), Jardin des Lettres (Magnard), Terre des Lettres (Nathan), Envol des Lettres (Belin) et Passeurs de textes (Robert).
L’ensemble des questionnaires consacrés à une séquence filmique dans ces vingt-quatre manuels a d’abord été repéré: ont été retenus les questionnaires portant sur un ensemble de photogrammes, sur un extrait ou dans certains cas sur la bande-annonce, à l’exclusion de questions parfois proposées sur un photogramme isolé mis en regard d’un texte, car dans ce cas les questions n’engagent pas la narration par séquences d’images animées, et à l’exclusion des pages souvent placées en fin de groupements de textes, invitant à visionner des bande-annonce pour suggérer des films en prolongement de la séquence, car ils ne présentent pas de questionnement spécifique adapté à l’œuvre concernée. Ce dépouillement aboutit à un total de 66 questionnaires parmi lesquels la part des adaptations est très importante puisqu’elle s’élève à 39 questionnaires, soit bien plus de la moitié du corpus.
Ce corpus de questionnaires a été examiné pour identifier les objectifs du travail envisagé sur ces adaptations et la nature des activités attendues de la part des élèves. Cette analyse a été ponctuellement complétée par la consultation des guides à destination des enseignants («livre du professeur»), pour confirmer certaines hypothèses ou éclairer les attentes liées à certaines questions ou activités. Les propositions de manuels ne sont évidemment pas un reflet des pratiques effectives dans les classes, mais elles témoignent de logiques disciplinaires et sont révélatrices de représentations et d’usages prégnants (Perret-Truchot, 2015). L’étude du corpus a permis d’établir une typologie, qui s’organise autour des manières de constituer (ou non) l’adaptation comme une ressource didactique pour mieux appréhender textes et films et/ou d’en faire un objet de réflexion à part entière.
Typologie des usages d’adaptations cinématographiques
Des adaptations invisibles: un paradoxe?
Un premier constat étonne: dans plus du tiers des questionnaires organisant un travail sur une adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire, aucune mise en relation entre le film et le texte n’est établie (cette situation concerne 15 des 39 questionnaires du corpus). Le fait que le film soit une adaptation apparaît pourtant systématiquement parmi les informations fournies, titre et auteur du roman figurant aux côtés du nom du réalisateur, de l’année de création et d’éventuelles autres précisions, sur l’obtention d’un prix par exemple. Le statut d’adaptation est même mentionné quand le lien à l’œuvre est ténu, par exemple dans le cas du Roi et l’oiseau (Grimaut et Prévert), dont le manuel Terre des Lettres 5e précise qu’il est «tiré du conte d’Andersen La Bergère et le ramoneur». Dans un seul cas, l’œuvre littéraire que le film adapte n’est pas citée (Fantastic Mr Fox de Wes Anderson, dont Passeurs de textes 6e ne signale pas qu’il adapte un roman de Roald Dahl), mais un autre lien est curieusement instauré avec la littérature: la troisième et dernière activité proposée, intitulée «du livre au film d’animation», demande aux élèves de «retrouve[r], pour chaque élément du récit, l’élément correspondant du film», en remplissant dans un tableau la colonne consacrée au film en regard d’une colonne listant les personnages et péripéties du Roman de Renart (par exemple, «Renart et Hermeline» ou «Renart et Chantecler le coq»). Le film se voit ainsi traité comme une réécriture du Roman de Renart, sans considération pour le roman de Roald Dahl qui constitue le chaînon manquant entre cette œuvre patrimoniale et le film de Wes Anderson. Ce cas atypique associe invisibilité du processus d’adaptation de l’œuvre littéraire et travail explicite sur des enjeux intertextuels, avec une œuvre autre que celle adaptée par le film. Mais dans les autres cas, l’invisibilité de l’adaptation prend la forme d’un travail centré sur le film sans mise en relation explicite avec l’œuvre littéraire. Le processus d’adaptation peut ne faire l’objet d’aucun travail spécifique quand bien même la page porte un titre orientant l’attention vers cet enjeu – «l’adaptation cinématographique: Germinal de Claude Berri» (Colibris 4e) ou «Cinéma: adapter une nouvelle réaliste à l’écran» (Passeurs de textes 4e à propos de La Parure de Claude Chabrol) –, situation qui se présente quand le texte littéraire figure dans les pages qui précèdent l’activité consacrée au film. La double page sur l’adaptation de Germinal par Claude Berri dans Colibris 4e conclut ainsi un chapitre sur le récit réaliste au XIXe siècle, comportant notamment un extrait du roman, mais la séquence du film retenue pour l’analyse ne concerne pas le même passage et aucune question ou commentaire n’invite à mettre en relation ces deux extraits d’œuvres, traités indépendamment l’un de l’autre.
Cette situation apparaît paradoxale: pourquoi tant d’adaptations parmi les films présentés, si, en l’absence de mise en relation explicite avec l’œuvre adaptée, ces films ne sont pas traités en tant qu’adaptations? La proximité avec la littérature peut sans doute produire un effet de légitimation d’œuvres cinématographiques dans une discipline prioritairement tournée vers l’acquisition de compétences de lecture littéraire. Mais aucun discours explicite ne vient à l’appui de cette hypothèse, difficile à étayer. Sans être exclusif de cet enjeu de légitimité, un autre paramètre est plus objectivable: en France, le cinéma a fait son entrée dans les examens de la discipline français avec l’introduction de films au programme de l’enseignement de littérature pour les classes de terminale de spécialité littéraire, entre 1995 et 2019; or les œuvres mises au programme ont été très majoritairement des adaptations d’œuvres littéraires, figurant conjointement au programme. Quelles que soient les raisons de cette situation, cette place faite au cinéma dans les épreuves certificatives de la fin du lycée sous la forme prioritaire d’adaptations n’a pas pu ne pas modeler des habitudes de travail des enseignants de français, qui se sont ainsi familiarisés avec des films comme objets d’enseignement dans le cadre d’un travail de confrontation entre des œuvres littéraires et leur adaptation filmique. Cela peut contribuer à expliquer la familiarité des enseignants de français avec un corpus d’adaptations cinématographiques, qui se voient alors sans surprise surreprésentées parmi les films envisagés pour un travail en classe de français. Cet éclairage par un pan important de l’histoire de l’entrée du cinéma dans les objets de la discipline n’explique cependant pas le paradoxe qui demeure, de la non mise en relation des films avec les textes. Le travail de mise en relation entre texte et film paraît peut-être suffisamment familier aux enseignants pour que les auteurs de manuels présupposent qu’ils sauront s’emparer s’ils le souhaitent de cette piste pour compléter le travail proposé sur le film? Rien n’étant spécifié dans ce sens dans les livres de l’enseignant, il est difficile d’aller plus loin que ces quelques hypothèses explicatives. Mais la fréquente invisibilité du processus d’adaptation mérite d’être remarquée et interrogée.
L’adaptation comme ressource pour faciliter l’accès au texte
Une deuxième situation regroupe les cas dans lesquels un rôle de médiation est confié aux adaptations cinématographiques, mobilisées pour faciliter l’accès des élèves à un texte. Cette approche se voit parfois formulée de manière très explicite à travers le titre des pages consacrées aux films concernés: deux manuels abordent ainsi des adaptations de Cyrano de Bergerac avec l’objectif explicite d’»entrer dans la pièce grâce à des adaptations filmiques» (Fleurs d’encre 4e) ou de «découvrir la pièce avec le film de Jean-Paul Rappeneau» (Terre des Lettres 4e). Cette intention est parfois moins explicite mais on l’identifie aussi dans un questionnaire sur une scène de Topaze qui commence par une question sur deux photogrammes de la version filmée, et où un extrait du film vient ponctuellement à l’appui de la compréhension du texte, en donnant l’occasion d’observer la gestuelle qui accompagne les paroles des personnages (Jardin des Lettres 5e). Même si la fonction d’auxiliaire à la lecture reste ici plutôt implicite, on identifie dans ce questionnaire la même intention que celle explicitée dans le livre du professeur de ce manuel quand un extrait du film La Planète des singes précède deux extraits du roman de Pierre Boulle, à savoir que «l’entrée dans le roman par le film permet de comprendre immédiatement la confrontation des deux espèces».
Cette situation est bien différente de la première décrite puisque ces films se voient ici attribuer un rôle en tant qu’adaptations d’œuvres littéraires; toutefois, ce travail avec plutôt que sur les adaptations les place dans une situation de quasi-transparence, leur rôle d’auxiliaire à la lecture n’étant pas l’occasion d’un travail sur ce qui ferait par exemple l’originalité ou l’intérêt de l’œuvre cinématographique.
Cette situation est assez peu représentée dans le corpus, à quatre reprises seulement, et il est notable que trois de ces quatre occurrences concernent des adaptations de textes dramatiques: il semble bien que les adaptations de pièces de théâtre soient utilisées prioritairement pour faciliter une représentation mentale de personnages et/ou de contextes culturels qui ne sont pas décrits dans les extraits lus, tout en donnant à entendre un texte conçu pour être mis en voix. Une comparaison avec l’usage que les mêmes manuels font d’images ou d’extraits de captations de représentations théâtrales serait utile pour savoir si le même usage est fait de ces images ou si le travail s’organise davantage en direction d’une ouverture des interprétations possibles du texte joué, mais cela demanderait de constituer un autre corpus que celui étudié ici. Les manuels investigués permettent encore de distinguer trois types d’usages de l’adaptation qui constituent celle-ci en ressource pour mieux outiller la lecture des textes et/ou des films.
La comparaison au service d’un approfondissement de la lecture
Le travail de mise en relation entre les œuvres littéraires et leurs adaptations cinématographiques prend la forme de diverses approches comparatives dont les objectifs varient, allant de l’évaluation de la fidélité de l’adaptation à une confrontation dynamique des interprétations proposées ou suggérées par chaque œuvre, en passant par une approche plus orientée vers l’appréhension des procédés visuels propres au médium cinéma.
La question de la fidélité traverse de nombreux questionnaires, sans jamais en constituer l’orientation principale ou unique. Elle est l’occasion d’un trajet qui mène du film vers une relecture approfondie du texte. Pour évaluer si telle représentation est conforme au texte ou laquelle de deux représentations y serait la plus fidèle, les élèves sont invités à se lancer dans un travail de compréhension et de relevé des passages du texte qui correspondraient, ou non, à divers éléments des films. Le livre du professeur accompagnant le Jardin des Lettres 3e explicite cette attente liée à une question sur la «conformité» au texte de plusieurs représentations de Frankenstein au cinéma:
La question vise à écouter les réponses des élèves et à juger de l'acribie de leur lecture du texte, à l'épreuve de représentations visuelles [...]. Faire travailler les élèves sur le rapport entre texte et image implique de questionner la justesse de leur lecture du texte, le degré d'adaptation qu'il permet et la fidélité des interprétations.
Ainsi, les représentations visuelles mettent à l’épreuve et exercent la rigueur de lecteurs qui doivent être attentifs à ce qui est indiqué, ou non, par le texte. Le repérage des points communs et différences est plus ou moins guidé selon les questionnaires: certains pointent précisément un élément à observer («quels objets magiques Jean Cocteau a-t-il ajoutés au conte?», Jardin des Lettres 6e), quand d’autres posent la question de manière plus ouverte (« D’après la bande-annonce et les documents de cette double page, le film vous semble-t-il fidèle au récit de J.D. Bauby? Justifiez». Fleurs d’encre 3e). Il est important de préciser que ce repérage constitue une étape dans un parcours qui qui ne s’en tient jamais à évaluer la fidélité de l’adaptation au texte, mais se prolonge dans deux directions distinctes.
La comparaison pour appréhender des procédés cinématographiques
Le travail initial d’observation des écarts et d’évaluation de la fidélité prépare dans certains questionnaires un travail de lecture des images cinématographiques, dont l’objectif est l’acquisition de notions sur des procédés visuels courants au cinéma. La double page d’Envol des Lettres 4e consacrée à La Parure, qui annonce ainsi l’ objectif de «comparer une œuvre littéraire et son adaptation télévisuelle», fournit comme ressource pour traiter les questions un encadré de vocabulaire comportant les définitions du fondu enchainé, du gros plan, du travelling et du zoom avant. Une partie des questions invite à mettre en relation les choix de procédés de Claude Chabrol avec les éléments de la nouvelle qu’ils transposent à l’écran: par exemple,
quand mme Loisel se regarde dans le miroir, quelles autres images d’elle apparaissent? Comment appelle-t-on ce procédé? En quoi illustre-t-il l’extrait de la nouvelle de Maupassant p. 26?
La comparaison devient confrontation intermédiale et sert, autant sinon plus qu’à vérifier la rigueur de la lecture du texte, à favoriser l’observation des procédés cinématographiques utilisés pour «restituer»4 les éléments du texte en les faisant passer à l’écran. Cette orientation de la lecture vers un outillage technique de la lecture des images cinématographiques est présente (sans être exclusive) dans 10 questionnaires sur les 24 qui organisent une mise en relation entre film et texte. Les procédés abordés sont variés et il semble que l’appui sur la confrontation avec le texte adapté favorise une approche des films attentive à la diversité des ressources cinématographiques exploitées et à l’originalité de chaque création: les procédés examinés dans les pages n’établissant pas de mise en relation avec l’œuvre littéraire présentent en effet moins de diversité (elles sont centrées sur les angles de vue et cadrages et ne proposent que rarement l’analyse d’effets liés au montage, aux éléments sonores ou autres caractéristiques qui distinguent les images cinématographiques d’images fixes) que dans celles qui s’appuient sur la confrontation au texte, où se voient abordés plus régulièrement ces enjeux propres à la création de séquences d’images animées accompagnées de sons. Fleurs d’encre 3e développe ainsi un dossier en plusieurs doubles pages où une confrontation intermédiale entre des extraits d’autobiographies et leur adaptation en BD ou en film est systématiquement organisée; à l’appui de ce travail, une fiche méthode distingue explicitement les niveaux d’analyse entre étude de photogrammes et de séquences filmiques, et précise quels procédés sont propres à ce deuxième niveau:
Pour analyser une séquence filmique, observer et interpréter:
- l’organisation des plans (succession linéaire des plans, parallélismes, jeux d’opposition, effet de champ/contre-champ, effet de pause, ralenti, accélération, zoom, etc.);
- les effets créés au montage pour enchainer les séquences (fondu au noir, fondu enchaîné, coupe franche, etc.)
- les bruitages et la bande-son.
Ces aspects de la narration filmique5 ne se voient qu’exceptionnellement abordés quand les adaptations ne sont pas mises en relation avec l’œuvre littéraire. De manière complémentaire, trois questionnaires invitent les élèves à consulter des documents sur la réalisation du film pour découvrir soit une technique d’animation particulière (l’imitation de l’esthétique du vitrail par papier découpé dans l’adaptation de Bisclavret de Marie de France par Emilie Mercier, Envol des Lettres 5e), soit la diversité des métiers et des enjeux techniques de la réalisation d’un film autour du tournage de La Bête humaine par Jean Renoir (Jardin des Lettres 4e), soit l’accueil critique du film (Fleurs d’encre 4e sur La Parure). Sans que cette approche résulte du travail de mise en relation entre texte et film, il s’avère que les trois dossiers qui présentent des éléments sur le «making-of» des films se trouvent dans des questionnaires fortement structurés autour d’une approche comparative des deux œuvres.
Une autre approche du langage cinématographique, rare dans le corpus, se trouve également exclusivement associée au prolongement d’une confrontation entre texte et film: il s’agit d’activités plaçant les élèves en situation de manier le langage cinématographique pour planifier une séquence adaptée d’un extrait de l’œuvre – Fleurs d’encre 4e propose de créer un storyboard en dessinant schématiquement les plans qui permettraient de transposer un passage de La Parure; pour la 4e également, Le Jardin des Lettres propose un travail équivalent en conclusion du travail sur La Bête humaine.
Dans l’ensemble du corpus, on observe donc que les approches comparatives vont de pair avec une appréhension plus approfondie du langage cinématographique que lorsque les adaptations ne sont pas traitées en rapport avec l’œuvre source. Ce constat ne permet pas de conclure qu’une approche comparative serait une condition pour déployer une étude rigoureuse du cinéma en classe de français, mais il est intéressant de relever cette corrélation qui suggère que la situation de confrontation entre texte et film, en même temps qu’elle fournit des supports d’activités familiers aux enseignants, est peut-être aussi de nature à clarifier le projet de lecture dans lequel le film trouve sa place et à favoriser l’identification des spécificités de l’écriture cinématographique pertinentes à analyser au regard de ce projet.
Des interprétations mises en dialogue
Outre l’approche des procédés cinématographiques, le travail de comparaison prévu dans une première étape des questionnaires prépare également une réflexion sur les écarts interprétatifs entre les œuvres littéraires et leurs adaptations. Cette réflexion dépasse le cadre strict de la comparaison examinée plus haut en ce qu’il ne s’agit pas seulement de repérer les différences, mais d’engager une réflexion à un autre niveau.
A un premier niveau, dans plusieurs questionnaires le travail de comparaison aboutit à une question orientée vers une appréciation personnelle, comme dans cette question «bilan» qui suit la comparaison de deux versions cinématographiques de La Belle et la Bête, entre elles et avec le conte qui en est la source:
Lequel de ces deux films vous semble le plus fidèle au conte? Lequel préférez-vous? Justifiez vos réponses. (Envol des Lettres 6e).
Ce type de questions vise non pas un jugement de gout mais un «jugement de valeur» construit et argumenté, selon la distinction de Dumortier (2012): c’est après une observation rigoureuse des différences entre les œuvres et une réflexion sur les effets produits par les choix opérés que les élèves ont à exprimer et justifier une préférence, qui a vocation à être mise en discussion.
Mais plus souvent qu’à exprimer leur «préférence», des questions invitent les élèves à s’interroger sur les représentations des personnages ou les modifications apportées:
Que penses-tu de la façon dont Gwynplaine est représenté? (Jardin des Lettres 5e)
Quels personnages du film n’existent pas ou presque pas dans le livre? Quel est l’intérêt d’avoir créé ces personnages? (Terre des Lettres 6e)
Relevez ce que le réalisateur a ajouté par rapport au roman. Ces ajouts vous semblent-ils respecter l'esprit du roman? Justifiez votre point de vue. (Fleurs d’encre 5e)
Proposez des hypothèses pour expliquer les choix du réalisateur et échangez vos points de vue. (Fleurs d’encre 3e)
Les réponses attendues reposent sur une confrontation des adaptations avec l’œuvre littéraire, mais à la différence des questions portant sur la fidélité ou pointant les écarts et transpositions à repérer pour étayer la compréhension littérale du texte, la réflexion, ici plus ouverte, porte sur le sens qui peut être donné aux œuvres: les éventuelles divergences entre texte et adaptation(s) créent un espace dans lequel chaque lecteur est encouragé à s’interroger sur le sens qu’il donne à l’œuvre, l’effet qu’elle produit sur lui, et ainsi à préciser sa propre interprétation – «l’esprit du roman» pouvant faire l’objet de différentes lectures et d’échanges de points de vue argumentés.
A un second niveau, quelques dossiers engagent un travail explicite sur la dynamique interprétative des réécritures et constituent le processus de l’adaptation en objet de réflexion. Cette orientation est surtout saillante dans les manuels de la collection Fleurs d’encre. Le travail sur La Parure pour des 4e se prolonge ainsi en un débat sur la question «Pourquoi adapter un texte littéraire au cinéma?» et se termine avec une activité de rédaction d’un projet d’adaptation filmique «de la nouvelle de Maupassant en la transposant dans le monde d’aujourd’hui». Le processus d’adaptation est aussi constitué en objet de réflexion dans le manuel de 3e qui consacre un chapitre d’une vingtaine de pages aux «récits autobiographiques et réécritures», le sous-titre «atelier lecture et cinéma» précisant qu’il s’agit d’étudier des adaptations cinématographiques de récits autobiographiques. Chaque étape du chapitre organise une analyse comparative d’extraits du texte et du film, de manière assez conforme à ce que la plupart des autres manuels proposent, mais quelques questions atypiques font écho au débat proposé dans l’édition destinée aux 4e, comme les suivantes qui accompagnent la lecture d’une critique du Scaphandre et le Papillon adapté par Julien Schnabel et une étude de passages de L'Enfant noir:
Pourquoi la fidélité du film à l’esprit du livre revêt-elle une telle importance pour le critique? Proposez des hypothèses explicatives.
Quels liens les réécritures de L’Enfant noir entretiennent-elles avec le roman de C. Laye? Définissez le terme «réécriture» à partir des réponses précédentes.
Ces questions qui émaillent les différents questionnaires préparent une activité finale de débat sur le sujet: «Regarder l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire peut-il remplacer la lecture de cette œuvre?». Ce chapitre, certes unique du point de vue de l’ampleur donnée à ce travail, se montre soucieux à la fois de l’approche des procédés cinématographiques et de l’ouverture des interprétations, et il approfondit la réflexion en problématisant explicitement ce qu’engage l’adaptation d’une œuvre littéraire en film. Ce cas particulier illustre comment une problématisation explicite du statut des adaptations est favorable à l’articulation des différents objectifs décrits précédemment.
Conclusion
L’étude des pages de manuels consacrées à des adaptations cinématographiques a permis de distinguer différentes approches de ces films et différentes manières de travailler sur les liens qu’ils entretiennent avec une œuvre littéraire. À partir de ces usages et de leur catégorisation, on peut identifier quelques caractéristiques de la place accordée au cinéma par la discipline français dans le secondaire en France.
D’abord, on constate que le cinéma est pleinement entré parmi les objets d’étude de la discipline. Par rapport à la situation décrite par Archat-Tatah en 2013, force est de constater que les manuels proposent bien plus de travailler sur les films qu’avec eux. Même si la situation d’invisibilité dans laquelle sont placées une grande partie des adaptations traitées dans les manuels suggère que les enjeux liés au choix des films et à la définition des objectifs d’apprentissage restent en partie implicites voire impensés, cette situation traduit en même temps une certaine autonomisation des œuvres cinématographiques, appréhendées indépendamment d’une relation privilégiée avec la littérature.
Il convient ensuite de souligner à quel point la mise en relation d’une adaptation avec l’œuvre littéraire qui l’a inspirée ne se réduit pas à donner aux films une fonction ancillaire. Les cas où des adaptations sont mobilisées pour faciliter l’entrée dans un texte sans autre attention portée à son intérêt en tant qu’œuvre originale sont en effet rares dans le corpus, et concernent quasiment exclusivement des textes de théâtre qu’ils permettent de faire entendre aux élèves. Mais la plupart des questionnaires déploient une approche bien différente, dans laquelle la confrontation du texte et du film est l’occasion d’une certaine réciprocité des éclairages. Le travail de comparaison consistant à repérer les points communs et les différences, qui apparaît comme un passage obligé de la mise en relation des deux œuvres dans un premier temps des questionnaires, prépare un autre niveau de lecture, dans deux directions: le travail peut se tourner vers l’appréhension des procédés cinématographiques éclairés par la confrontation aux passages du texte «traduits» à l’écran, ou orienter la réflexion vers les choix et déplacements opérés dans le film, pour mettre en évidence l’ouverture interprétative permise par l’œuvre et encourager les élèves à élaborer leur propre interprétation. Ces deux orientations sont plus ou moins articulées l’une avec l’autre selon les questionnaires et semblent être d’autant mieux mises en cohérence que le projet de lecture problématise le statut d’adaptation du film et son inscription dans une dynamique de réécriture.
Ainsi, loin d’apparaitre comme le signe que le cinéma resterait dans l’enseignement du français inféodé à la littérature, l’importance donnée au travail sur des adaptations semble bien plutôt correspondre à une forme de didactisation du cinéma qui se stabiliserait dans la discipline – mais qui ne peut concerner qu’un pan du cinéma: restent alors à questionner d’autres formes de didactisation qui pourraient convenir pour le répertoire cinématographique avec lequel cette voie ne peut pas être empruntée.
Bibliographie
Archat-Tatah, Caroline (2013), Ce que l’école fait avec le cinéma, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Dumortier, Jean-Louis (2012), «Contribuer à la formation d’amateurs éclairés», in La Rencontre avec l’œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture, J.-C. Chabanne, M. Parayre et E. Villagordo, Paris, L’Harmattan, p. 159-172.
Le Français aujourd’hui (2009), Films et textes: une didactique à inventer.
Lacelle, Nathalie (2011), «Modèle de lecture-spectature, à intention didactique, de l'œuvre littéraire et de son adaptation filmique», La Lettre de l'AIRDF, n°49, p. 32-36.
Langlade, Gérard. (2012). «Lectures cinématographiques comparées d’une œuvre patrimoniale: La Princesse de Clèves», in Les patrimoines littéraires à l’école, Usages et enjeux, Ahr S. et Denizot N., Namur, Presses universitaires de Namur, p. 17-31.
Louichon, Brigitte (2015). «Le patrimoine littéraire: du passé dans le présent», in Les patrimoines littéraires à l’école. Tensions et débats actuels, M.-F. Bishop, et A. Belhadjin (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 93-106.
Perret-Truchot, Laetitia (2015), Analyser les manuels scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Pour citer l'article
Hélène Raux, "Quels usages des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels de français pour le collège? ", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/quels-usages-des-adaptations-cinematographiques-d-oeuvres-litteraires-dans-les-manuels-de-francais-pour-le-college
Passer par la peinture pour enseigner la littérature : un détour à l’épreuve de la recherche
Faire du commentaire pictural un détour pour favoriser l’apprentissage du commentaire littéraire est séduisant. L'enquête dont est issu cet article documente et interroge les tenants et les aboutissants d'une telle ambition.
Passer par la peinture pour enseigner la littérature : un détour à l’épreuve de la recherche
Introduction
Le projet de passer par des exercices de réception de l’image comme médiation pour les enseignements/apprentissages en lecture de la littérature est séduisant. Il repose sur deux présupposés: les images se liraient à la manière dont se lisent les textes; les élèves, plus familiers du visuel que du textuel, y seraient moins en difficulté. Ainsi, un rapport de l’Inspection générale, en France, affirmait, en 2000, que la «lecture de l’image» était un «détour opérant» pour apprendre à lire la littérature, «un apport méthodique indéniable, dans la mesure où la démarche d’analyse pour "déchiffrer" une image est plus spontanément reçue par les élèves» (Waysbord-Loing, 2000: 16).
Or l’institutionnalisation scolaire de l’expression lecture de l’image1 n’est pas sans poser problème, en tout cas concernant les œuvres picturales, souvent évoquées parmi les images à étudier, et auxquelles cet article se consacre plus particulièrement. D’abord, un tableau ne se lit pas, en tout cas au sens propre du mot lire, car les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits, pour significatives qu’elles soient, ne font pas l’objet d’un encodage de type linguistique. Si la sémiologie picturale est à l’origine de l’expression, ses propositions théoriques déconstruisent cependant aisément le présupposé d'une identité entre lecture littéraire et réception picturale: il y a forcément métaphore à parler «de vocabulaire ou de lexique picturaux, de syntaxe figurative» (Marin, 1971: 9). Ainsi faut-il prendre garde aux «assimilations hâtives que cautionne l’application au visuel de termes appartenant à la terminologie linguistique ou rhétorique.» (Vouilloux, 2006: 137). Ensuite, il est douteux que les élèves reçoivent «plus spontanément» la peinture que la littérature. Selon Bourdieu et Darbel (1966), affirmer que «l’homme de la culture de l’image serait immédiatement doté de la culture nécessaire pour déchiffrer l’œuvre picturale, image entre les images» (p. 16), c’est s’autoriser à ne pas enseigner à tous ses codes spécifiques pour la réserver aux «âmes bien nées» (p. 15). D’ailleurs, il est contestable qu’une œuvre picturale soit une image car elle n’est pas forcément figurative, et quand elle l’est, ses composantes ne peuvent se réduire à leur fonction mimétique, elles prennent sens pour le récepteur par leurs caractéristiques plastiques et pas seulement iconiques (Vouilloux, 2004).
Or, si les programmes actuels, du moins en France, soulignent plus que par le passé la spécificité des deux langages2, il est toujours question, par exemple dans les programmes de lycée, d’«éclairer la lecture des œuvres et des textes littéraires (…) par leur mise en relation avec les autres arts»3 C’est pourquoi nous souhaitons interroger ici, d’un point de vue socio-didactique, les conditions d’un passage par le commentaire4 de la peinture pour favoriser l’enseignement/apprentissage du commentaire de la littérature. Le transfert, au profit de la littérature, de compétences qui auraient été construites en travaillant sur la peinture est-il possible malgré les écarts sémiotiques entre les deux arts et les écarts herméneutiques qui en résultent? A quelles conditions? Par ailleurs, d’après les enquêtes en sociologie de la culture, par exemple celles d’Olivier Donnat (2011: 28), il demeure en France «une forte stratification sociale des pratiques culturelles». Comme en 1966 «la fréquentation des musées est presque exclusivement le fait des classes cultivées» (Bourdieu & Darbel: 35). Le commentaire pictural n’est-il accessible qu’aux élèves à qui leur parcours scolaire et extrascolaire rend familière la culture picturale 5? le projet de détour, étant alors facilitateur pour les uns et pas pour les autres, serait-il susceptible de renforcer les inégalités sociales de réussite?
1. Méthodologie et cadre théorique
Nous nous appuierons sur une recherche basée sur une double enquête (Claude, 2015, 2016a, 2016b). La première auprès de 350 élèves de troisième et de seconde scolarisés dans des établissements de l’académie de Créteil au recrutement socialement contrasté (parmi les PCS des parents – Professions et Catégories Socio-professionnelles – le taux des «Employés», «Ouvriers», «Personnes sans activité professionnelle», va de 10,7% à 51 % selon les classes enquêtées). La seconde auprès de 200 enseignants de français de la même région.
Pour ce qui est des élèves, chacun d’entre eux a écrit, en deux heures, deux commentaires. Le premier sur une des six reproductions picturales et le second sur un des six extraits littéraires que nous leur avions proposés, choisis parce qu’ils présentaient d’après notre analyse des difficultés équivalentes (voir Claude, 2017)6. Les modalités d’exécution du travail étaient les mêmes pour les deux exercices et la consigne était rédigée semblablement: «écrivez dix lignes (au minimum) pour commenter (donnez quelques-unes de vos impressions)». Suivait une phrase autorisant à ne pas traiter l’un des deux objets en expliquant pourquoi. Le corpus a fait l’objet d’une double analyse comparative, entre commentaire littéraire et pictural d’une part, entre profils sociaux des élèves d’autre part. Puis des entretiens post passation ont été menés avec 11 groupes de 2 à 4 élèves, l’enquêteur les invitant à revenir sur leurs travaux et à expliquer pourquoi ils préféraient l’un ou l’autre des deux exercices ou s’y sentaient plus compétents. L’analyse des transcriptions a permis d’affiner la compréhension des conduites d’élèves dans les deux exercices.
Du côté des enseignants, nous avons soumis un questionnaire à 211 enseignants de français de l’académie de Créteil. Ils étaient interrogés sur les objectifs qu’ils se donnaient concernant chacun des deux arts, les difficultés qu’ils y rencontraient, et leurs critères pour considérer les exercices comme réussis, critères qui se sont avérés de même nature pour les deux objets. Ceci nous a permis de disposer d’une référence à l’aune de laquelle comparer les commentaires. Le but de cette recherche n’était donc pas de tester un dispositif d’enseignement, mais de comparer, au regard des attendus, les dispositions culturelles et langagières que les élèves étaient susceptibles d’importer de leur expérience antérieure au départ d’un projet de détour par la peinture.
L’appui théorique des registres de l’apprentissage, tels que les définissent Elisabeth Bautier et Patrick Rayou (2013), nous a permis d’analyser le corpus. Selon ce modèle, une activité d’apprentissage est analysable comme configurant trois registres. Le premier est celui des opérations cognitivo-langagières qui sont mises en œuvre. Le second, culturel, est constitué des savoirs généraux et spécialisés qui y sont engagés. Le troisième, identitaire symbolique, concerne les modes d’engagement de soi dans l’activité et de la prise en compte d’autrui. Nous avons cherché à comprendre, d’après les réponses des enseignants, comment ils attendaient que soient configurés les trois registres, et d’en déduire des critères pour notre analyse comparative des commentaires des élèves. Ce qui nous a permis de connaître, pour chacun des deux arts et pour les différents profils sociaux, la proportion des commentaires plus ou moins proches de la mobilisation des registres que les enseignants souhaitaient y trouver.
2. Aperçu des résultats: des commentaires picturaux plus proches des attendus que les commentaires littéraires
Les élèves ont été sensiblement plus nombreux à s’emparer de l’autorisation qui leur était donnée de ne pas faire l’exercice pour le texte (30.5%) que pour la peinture (5.5%). L’écart est plus net encore si nous ne retenons que les travaux des élèves des classes de recrutement majoritairement défavorisé (1.5% ne traitent pas la peinture et 47.5% ne traitent pas la littérature). Ils ont donc vraisemblablement le sentiment d’être plus compétents en commentaire pictural. Pour savoir s’ils l’étaient effectivement, nous avons comparé les commentaires à l’aune des attentes des enseignants.
2.1. Ce qui est attendu des enseignants dans les trois registres
Dans le registre cognitif, les enseignants souhaitent que les élèves appréhendent avec justesse un sens qu’on peut considérer comme consensuel, mais aussi interprètent, c’est-à-dire conçoivent d’autres directions de sens, si possible plurielles. Ils voudraient aussi que les élèves sachent montrer ces sens interprétés comme acceptables par le texte ou le tableau commenté, en s’appuyant sur une observation minutieuse de cet objet, notamment de sa forme (pour la peinture teintes, texture, composition, lignes; pour la littérature sonorités, rythmes, figures de style, composition…) mais aussi en tenant compte du contexte artistique et historique. Dans le registre culturel, ceci suppose que les élèves disposent de savoirs linguistiques et iconographiques pour accéder à la part consensuelle du sens mais aussi de savoirs leur permettant de justifier et de nourrir leur interprétation. Dans le registre identitaire symbolique, une majorité des enseignants disent attendre que les élèves s’engagent subjectivement dans une transaction avec l’œuvre, en y mettant de ce qu’ils sont vraiment, de leurs émotions, de leurs valeurs, car c’est nécessaire pour qu’ils puissent concevoir personnellement du sens. Mais comme l’interprétation produite doit être justifiée par une analyse du texte ou du tableau, il faut aussi qu’ils acceptent de ressaisir cette réception subjective, de la retravailler (ce qui rappelle le processus de va et vient dialectique défini par Jean-Louis Dufays, 2016). Ce processus est généralement perçu par les enseignants enquêtés comme successif: il faut donc s’investir puis se désinvestir, en prenant ses distances avec l’objet, tout en conservant trace des éléments interprétatifs permis par la projection de soi. C’est donc une façon très spécifique d’être soi qui est attendue dans le registre identitaire symbolique.
2.2. Les commentaires des élèves à l’aune de ces attendus
D’une analyse qualitative fine d’une trentaine de commentaires, nous avons induit des caractéristiques langagières correspondant aux différents critères que nous avons définis d'après les réponses des enseignants. Ceci nous a permis, pour l’approche quantitative, de classer chacun des 700 commentaires, pour chacun des critères, dans un type plus ou moins proche des attendus. Nous ne pouvons détailler ici les indicateurs pour chaque critère de chaque registre (voir Claude, 2015), en voici deux exemples qui pourront en donner une idée: pour déterminer, dans le registre cognitif, si l’élève concevait des directions de sens relevant d’une interprétation, nous avons observé s’il y avait écart entre le lexique objectivement attaché à la description du tableau ou à l’univers diégétique du texte et un lexique s’en abstrayant, manifestant la part prise par le récepteur dans la création de significations (par exemple, à propos de la Nativité de Georges de la Tour, le vocabulaire abstrait, «mort», «enfers», «paradis», «froideur», «crainte», qui ne relève pas de la seule observation du tableau, signale que le commentateur prend en charge la proposition d’un sens symbolique).
Autre exemple, dans le registre identitaire symbolique, certains indicateurs signalent l’investissement subjectif : marques de la première personne, modalisateurs, adverbes («personnellement, je pense que…» ; «franchement c’est un beau tableau»), formules explicitant l’activité du récepteur («il me semble…», «on dirait que…», «je comprends que…», «je propose d’y voir»….), indices lexicaux de l’appréciation ou de la dépréciation, comme des adjectifs péjoratifs ou mélioratifs (le texte ou le tableau est «intéressant», «incompréhensible», «émouvant» ; les couleurs sont «belles», «criardes», «joyeuses»….). D’autres indicateurs permettent de repérer la ressaisie de cet engagement pour le partager avec autrui, notamment les marques de l’articulation justifiée entre caractéristiques de l’œuvre et interprétation proposée (tel élément «montre que….», «donne l’impression que…». Cette impression «est le fait de…», «vient de…», «s’explique par…», «est produite par…»)
D’après notre étude, les commentaires picturaux des élèves présentent les opérations cognitivo-langagières attendues des enseignants plus souvent que leurs commentaires littéraires. 81% des commentaires picturaux sont analysables comme relevant de l’interprétation alors que c’est le cas de 60 % des commentaires sur la littérature. Dans 39% des commentaires picturaux et seulement 22% des commentaires littéraires les élèves proposent des directions de sens plurielles. 73 % des commentateurs prennent en compte les caractéristiques formelles pour la peinture alors que c’est le cas de seulement 45 % pour la littérature, où ils les traitent de surcroît plus souvent de façon purement descriptive, sans leur associer d’effets de sens. Pour chaque critère du registre cognitif, l’écart de réussite se creuse nettement en faveur de la peinture pour les élèves des établissements de recrutement défavorisé (un seul exemple: pour ce sous-groupe, des pistes interprétatives sont repérables dans 78 % des commentaires picturaux, et 34 % des commentaires littéraires seulement).
Dans le registre culturel, la peinture met en revanche les élèves en difficulté plus souvent que la littérature: beaucoup de commentaires manifestent que leur auteur ne dispose pas de certaines connaissances dont on peut considérer qu’elles seraient nécessaires pour lui permettre d’appréhender une part du sens dont on peut considérer, en contexte scolaire, qu’elle doit faire consensus. 40 % des élèves sont mis difficulté pour leur compréhension de la peinture, contre 27% pour la littérature. Par exemple, 60% des élèves n’identifient pas les personnages comme un troupe de comédiens dans le tableau de Picasso, La Famille de Saltimbanques. 75 % de ceux qui travaillent sur La Nativité ou Le Nouveau-né de Georges de la Tour n’identifient pas les personnages évangéliques7. Pour les textes, les savoirs linguistiques, notamment lexicaux, peuvent certes faire défaut, mais plus rarement empêcher l'appréhension du sens global du texte (Cèbe, Goigoux & Thomaset, 2003). En revanche, les élèves sont sensiblement plus nombreux pour le tableau (20%) que pour le texte (10 %) à convoquer des savoirs culturels pour étayer leur interprétation, notamment des références à d’autres œuvres.
Dans le registre identitaire symbolique enfin, les élèves acceptent mieux le double mouvement d’implication subjective et de ressaisie de cette implication, d’après nos indicateurs, concernant la peinture (40% des commentaires contre 20% en commentaire littéraire; dans les établissements les plus défavorisés, l’écart se creuse nettement: 36 % pour la peinture et 5 % seulement pour la littérature).
Donc notre analyse montre que les conduites d’élèves dans les trois registres sont très différentes d’un art à l’autre. Par rapport aux commentaires littéraires, les commentaires picturaux sont plus proches des attendus des enseignants pour la majorité de nos critères; ils n’en sont plus éloignés que pour une partie des critères du registre culturel. Que les élèves s’approchent plus souvent de normes scolaires quand ils travaillent sur la peinture confirme que le projet de faire jouer un rôle de médiation à cet exercice pour enseigner le commentaire littéraire doit être pris au sérieux. Mais il faut comprendre, pour chacun des registres, ce qui explique que les conduites d’élèves soient différentes. C’est nécessaire pour tenter de définir quel accompagnement pourrait les aider à transférer ce qu’ils savent faire d’un art à l’autre, afin d’éviter que le détour soit sans retour (Claude & Rayou, 2020).
3.Propositions d’explication des différences
Si les élèves ne réussissent pas semblablement les deux activités, c’est, d’après nous, parce que les différences sémiologiques entre deux objets ont des incidences sur l’activité requise dans les trois registres; mais c’est aussi parce que les élèves ne perçoivent pas les deux objets de la même façon.
3.1. Les incidences des différences sémiologiques entre les deux objets
3.1.1. Des savoirs culturels exigeants pour la peinture.
Certes, il n’existe pas de lexique pictural. Pour autant, les signes picturaux ne font pas sens naturellement, même s’il n’y a pas de corrélation arbitraire entre signifiant et signifié (Eco, 1992). Certains motifs ou configurations plastiques sont conventionnellement dotés, préalablement à leur réalisation dans le tableau, de contenus de sens. Un exemple en est la connaissance, souvent utile pour le genre de la peinture d’histoire8 de l’iconographie9. Erwin Panofsky définit deux stades de l’appréhension d’un tableau figuratif: le premier, pré-iconographique, est celui de la reconnaissance de ce qui est figuré, c'est-à-dire des «motifs artistiques»; il permet d’appréhender les significations «primaires ou naturelles». L’«expérience pratique» (1967: 17, 18) d’un récepteur ordinaire y suffit le plus souvent (sont représentés un homme et une femme nus, un paon…). Le second stade est celui de l’iconographie, par lequel le spectateur accède aux significations conventionnelles des motifs, en reconnaissant les thèmes ou concepts (ce sont Adam et Eve, c’est l’attribut d’Héra…). Appréhender ces contenus de sens requiert des connaissances parfois savantes, d’autant que ces conventions sont variables pour le même thème d’un foyer culturel à l’autre.
3.1.2. Un langage qui ne s’appuie pas sur une langue
C’est au récepteur de la peinture de postuler des corrélations entre forme (combinaisons de teintes, de textures et de traits) et sens, sans l’appui d’un code de type linguistique (Eco, 1992). Ceci réclame de lui une participation active, mais moins contrainte, et peut expliquer que les élèves se sentent plus autorisés à produire une interprétation. Par ailleurs, les signes picturaux sont à la fois des désignants (au sens où ils représentent un figuré) et des signifiants à valeur expressive (au sens où les caractéristiques picturales produisent certaines impressions) (Marin, 1971), ils ont une double nature, iconique, du fait qu’ils participent à la figuration, et plastique, du fait qu’ils se caractérisent par une certaine qualité matérielle (Groupe µ, 1992), ce qui peut expliquer pourquoi les élèves construisent plus souvent du sens en articulant les deux aspects du signe. Pour un tableau non figuratif, les caractéristiques plastiques doivent suffire au récepteur pour concevoir sa compréhension/interprétation. Certes, dans la discipline, le lecteur doit aussi donner sens aux caractéristiques sensibles de la forme du texte: mais l’existence du code linguistique peut masquer à une partie des élèves cette modalité de production de sens.
Une autre différence réside dans la temporalité de l’appréhension. Commenter un texte selon les réquisits scolaires suppose des relectures à même de faire émerger diverses interprétations. Cependant, la successivité s’impose à la première lecture. Au contraire, si le tableau présente généralement des jalons au parcours du regard, jalons parfois très visibles, notamment dans un tableau de facture classique, il laisse néanmoins au spectateur le choix d’ordonner les composantes de diverses façons, de sorte que «le tableau n’offre pas une lecture, mais un système de lectures» (Marin, 1971: 21). Ceci peut inciter l’élève à construire une pluralité de sens. Bernard Vouilloux souligne la «labilité des indices qui autorisent l’interprétation figurative» (2006: 142): il dépend du spectateur que telle ou telle caractéristique d’un tableau soit retenue comme signifiante, ce qui peut favoriser, à l’échelle d’un groupe voire au cours de la réception d’un même sujet, des propositions interprétatives diverses.
L’élève récepteur de la peinture pourrait par conséquent se sentir plus encouragé à donner sens à l’œuvre, y compris à sa forme, à concevoir une interprétation plurielle. La peinture est donc telle, par ses caractéristiques propres, qu’elle est susceptible d’encourager les opérations cognitives attendues des enseignants. Mais c’est à la condition que l’élève s’engage effectivement dans la réception, qu’il accepte et s’autorise ce travail de récepteur actif. Ceci suppose un certain rapport à l’objet: dans le registre culturel, un certain mode de valorisation de l’objet; dans le registre identitaire symbolique, un engagement subjectif dans l’interaction avec lui.
3.2. Un rapport différent des élèves aux deux objets
Les entretiens post-passation avec les élèves font apparaître, quand on les compare avec les verbatims des enseignants, un rapport10 à l’œuvre picturale plus favorable aux attendus de ces derniers que leur rapport à l’œuvre littéraire. Nous confronterons dans cette partie des verbatims d’enseignants et d’élèves, afin de mettre en lumière des écarts de conception qui ne peuvent qu’être sources de malentendus.
3.2.1. Le texte du récepteur
Si une minorité des enseignants se réfèrent à une conception du sens des œuvres comme immanent, c’est-à-dire contenu dans l’œuvre même, réduit à l’intentio operis (Eco, 1992), pour la majorité d’entre eux, il s’agit bien de co-construire ce sens, comme l’exprime Yvon 11 (enseignant au lycée):
Il ne s'agit pas d'un matériau mort et figé (…), mais [le texte] est le résultat de deux phases créatives: celle réalisée, parfois dans la douleur, par son auteur, et la recréation, qui la complète, par l’opération de lecture.
Le rapport que les élèves ont au tableau apparaît bien plus compatible avec cet attendu que le rapport qu’ils ont au texte. Sarah (élève de seconde) explique par exemple en entretien: «le tableau, c’est notre opinion, alors qu’un texte, c’est l’opinion de l’auteur… C’est ça qu’il faut dire en commentaire… Dans une peinture c’est plus facile, on est libre». Pour Amélie (élève de troisième): «Sur le tableau il y a rien d’écrit, c’est à nous d’écrire, alors que sur le texte il y a ce qu’il y a déjà écrit». Commentaire et objet du commentaire étant de nature linguistique, elle les perçoit comme concurrents, et ne se sent de ce fait pas autorisée à produire son texte de lectrice (Mazauric, Fourtanier & Langlade, 2011). Cette idée est exprimée par plusieurs élèves de notre corpus. Au contraire, pour la peinture, le langage de l’objet et le métalangage du commentaire sont hétérogènes, ce qui autoriserait le texte de réception. Dayane (élève de seconde) explique par exemple: «une peinture… il y a pas de texte… je veux dire c’est nous on imagine… alors qu’un poème il y a des textes, alors…».
Une partie des enseignants aimeraient que leurs élèves s’appuient sur un investissement subjectif entier (au sens du paradigme du sujet lecteur, Langlade & Rouxel, 2004), sur leurs émotions notamment. Chloé (enseignante en lycée) écrit par exemple: «Je leur demande: - de formuler, d’exprimer leurs émotions – de repérer comment l’émotion a été possible, par quels procédés l’auteur a réussi à la faire naître.». Ils font même parfois de l’émotion une condition incontournable de la compréhension/interprétation des oeuvres, comme Pascal (enseignant en lycée):
Je souhaite qu’ils comprennent que [le texte] est un lieu vivant, de pure émotion, de plaisir, qui doit faire réagir très vite. Si l’émotion n’est pas transmise, il faut savoir faire un sort expéditif à ce texte en expliquant pourquoi (même rapidement), puis tendre les bras à un autre auteur.
Or les élèves, quant à eux, dénient souvent à la littérature tout pouvoir de les émouvoir, au contraire de la peinture:
Hafza: Les émotions du texte moi je les sens pas!
Dayane : Émotifs on n’est pas trop émotifs (rires)
Enquêtrice: Et sur les tableaux ça vous fait quelque chose davantage?
Sarah: Oui parce que il y a des couleurs (…)
Selim: Bien sûr on voit si on voit quelqu’un de mort ça va nous faire quelque chose bien sûr.
Si tous ne sont pas aussi péremptoires, aucun, dans nos entretiens, n’exprime son émotion de lecteur, alors qu’ils sont nombreux à se dire sensibles à la peinture.
3.2.2. La pluralité de l’interprétation
Adrien (enseignant en lycée), comme beaucoup de ses collègues, insiste sur la pluralité de sens qui fait la richesse de l’œuvre littéraire:
Avec mes élèves, je compare volontiers le texte à un mille-feuille. Tous les deux se savourent, et tous les deux ont une multitude de strates. Et plus il y a de strates, meilleur c’est. Les strates d’un chef d’œuvre sont infinies…
Pour les élèves au contraire, si c’est possible de donner plusieurs sens à un tableau, ce n’est pas le cas pour un texte. Ainsi, selon Amélie (élève de troisième): «le texte il peut avoir qu’un seul sens et un tableau il peut avoir plusieurs sens». Dans un autre entretien, Sarah, Hafza et Dayane débattent de l’interprétation de La Nativité de George de la Tour. Pour Hafza: «c’est la naissance de Jésus». Mais pour Sarah: «Non moi j’aurais vu n’importe quelle naissance». Hafza affirme alors la possibilité de la pluralité interprétative: «Ça dépend de la personne qui regarde…» Les deux élèves iront jusqu’ à dépasser leur désaccord interprétatif: non pas un sens ou l’autre, mais une intégration des deux directions de sens :
Hafza: C’est les deux. C’est un commencement.
Sarah: C’est l’espoir… c’est un espoir…
L’enquêtrice tentant alors de les amener au même type d’échanges à propos d’un texte se heurte à une fin de non-recevoir:
Enquêtrice.… mais il n’y a pas deux manières de comprendre?
Ensemble: Un texte? Ben non… un texte, non…
3.2.2. Une forme signifiante
Autre composante du rapport aux œuvres d’art qui sous-tend les attendus scolaires, la forme de l’expression doit être appréhendée comme riche de virtualités connotatives à actualiser: «j’attends qu’ils parviennent à montrer que l’écriture fait sens» (Emma, enseignante en lycée). Presque tous les enseignants regrettent que leurs élèves se contentent souvent de décrire des caractéristiques formelles sans rien en faire, comme l’écrit Maria (enseignante en lycée): «Je voudrais éviter le formalisme sans construction du sens (les élèves décrivent la forme, relèvent des figures de style, des champs lexicaux, décrivent la prosodie mais n’en font rien)». Cet échange entre des élèves à propos de «Stances à Marquise» de Corneille12 nous semble illustrer ce que Maria souhaite éviter: pendant qu’Hafza tente de construire du sens, Sarah et Dayane s’évertuent à décrire la versification:
Sarah: C’est un poème… (à propos de Stances à Marquise de Corneille)
Dayane: Il y a des rimes… Des rimes plates ou des rimes embrassées…
Hafza: Mais c’est un vieux…
Sarah: Croisées… je crois?
Dayane: Ah oui croisées
Hafza: …une personne âgée qui fait une déclaration…
Sarah: Il y a des strophes…des… quatre… quatrains.
En revanche, concernant la peinture, ils évoquent très souvent les caractéristiques plastiques, notamment les couleurs, pour expliquer comment ils s’y prennent pour commenter, comme Akim (élève de seconde): «Dans le tableau il y a les couleurs qui nous annoncent… les sentiments, la joie ou… et comme il y a des couleurs chacun fait des hypothèses…».
Au-delà des caractéristiques sémiologiques de la peinture, le rapport des élèves à cet art peut donc expliquer que leurs productions écrites sont plus proches de ce que valorisent les enseignants quand il s’agit de peinture que quand il s’agit de littérature. Le statut des deux exercices dans les évaluations, très différent, y contribue sans doute. En effet, si les programmes français prescrivent la «lecture de l’image» à tous les niveaux du secondaire, elle est beaucoup moins présente que la littérature dans les épreuves certificatives, ce qui fait que les élèves sont moins souvent soumis à des exercices d’entraînement notés. Or, plusieurs nous disent en entretien, comme Fatiha, que «si dans un commentaire on dit quelque chose qui nous plaît et qu’on développe, peut-être que Mme E (son enseignante) c’est pas ça qu’elle voulait comme idée et on n’aura pas une bonne note». Cette crainte contribue sans doute à construire leur rapport différent aux deux arts. Certains des enseignants qui ont répondu à notre enquête le soulignent, comme Pascal (enseignant en lycée): «ils parlent plus facilement devant un tableau (…) que devant un texte dont la forme écrite rappelle immédiatement la contrainte de la copie, du devoir sanctionné par une note».
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les enseignants cherchent à faire de la peinture une médiation pour la littérature. Une enseignante en collège dit en entretien: «Ce travail les aide à revenir au texte: ils comprennent enfin ce que j’attends!» Or, si nous sommes en mesure de confirmer que les élèves, notamment dans les collèges les plus défavorisés, y rencontrent moins de difficultés, nous constatons que cette facilitation provient des écarts entre les deux arts: l’activité de compréhension/interprétation ne peut donc être transposée à l’identique, son transfert d’un art à l’autre nécessite une adaptation.
4. L'accompagnement didactique nécessaire
Notre enquête auprès des enseignants fait apparaître trois types de posture concernant le transfert des apprentissages d’un art à l’autre.
Quelques enseignants font le choix délibéré de cacher à leurs élèves la finalité du travail qu’ils proposent aux élèves sur la peinture: comme ce travail plaît aux élèves, ils craignent de perdre leur implication en faisant explicitement le lien avec la littérature. Ainsi Delphine (enseignante en collège) écrit-elle: «Ils aiment tellement ça que j’essaie de ne pas casser l’ambiance en leur rappelant qu’en réalité on fait du français». Marie (enseignante en lycée) se réjouit quant à elle que les élèves «sont comme Monsieur Jourdain, avec la peinture ils apprennent le commentaire sans le savoir!». Il s’agirait donc, en somme, pour préserver l’engagement des élèves dans l’exercice quand il porte sur la peinture, d’invisibiliser la finalité du retour à la littérature.
Les enseignants d’un second groupe, majoritaires, explicitent la finalité du retour à la littérature mais considèrent que le passage d’un art à l’autre va de soi. Julien (enseignant en collège), écrit: «Ils voient bien que le principe est le même: être à l’écoute de ses réactions à l’œuvre et en faire quelque chose.» La médiation par la peinture risque fort de rester lettre morte si l’enseignant n’aide pas ses élèves à prendre conscience, d’une part des apprentissages qu’ils ont réalisés et, d’autre part, des transformations qu’il est nécessaire de faire subir à ces apprentissages pour les adapter à un objet de nature différente. On peut craindre que seuls ceux qui disposent déjà du rapport à la littérature requis par l’exercice ne soient en mesure de prendre en charge par eux-mêmes le retour du détour, les autres restant tributaires de représentations qui font obstacle à leur réussite.
Les enseignants d’un dernier groupe disent s’attacher à accompagner le travail de recontextualisation, au profit du commentaire littéraire, des compétences acquises par la pratique du commentaire pictural. Ainsi Emma, enseignante en lycée, détaille en entretien l’accompagnement didactique qu’elle a opéré suite à une remarque fortuite d’un de ses élèves:
J’ai travaillé sur le Radeau de la Méduse; il fallait observer, réagir, construire une interprétation à partir de là. Quand je leur ai demandé de faire le bilan de ce que nous avions fait un élève a dit: ‘’c’était bien aujourd’hui, ce qu’on a fait était mieux que d’habitude’’. Un autre a répondu: ‘’on a fait exactement la même chose que d’habitude’’. J’étais ravie, je les ai fait travailler à partir de là: ce que nous avions fait, les points communs et les différences avec ce que nous faisons sur la littérature (…) pour que ça serve à quelque chose il faut arriver à ce qu’ils fassent le lien.
Pour ces enseignants, il est nécessaire de faire identifier aux élèves l’opération intellectuelle qui leur a permis de commenter la peinture, de manière à ce qu’ils puissent la décontextualiser et la recontextualiser au profit de la littérature. Compte tenu de ce que notre recherche nous a appris du rapport très différent des élèves aux deux arts, qui s’ajoute aux différences sémiotiques, on peut affirmer que c’est une condition pour faire jouer à la peinture un rôle de médiation vers la littérature.
Conclusion
Passer par la peinture pour favoriser les apprentissages en commentaire de la littérature (au sens large que nous donnons au mot commentaire) est un projet légitime. En effet, par rapport à la littérature, les élèves s’approchent davantage de ce qui est attendu des enseignants quand on leur demande, en amont de tout dispositif didactique, d’écrire leur compréhension/interprétation d’un tableau. Ils partent de moins loin des normes scolaires en commentaire pictural qu’en commentaire littéraire. Ce sont, d’après nos analyses, les écarts sémiotiques et surtout le rapport différent des élèves aux deux arts qui expliquent cette meilleure réussite: beaucoup d’élèves que nous avons rencontrés en entretien manifestent un rapport à la peinture qui est compatible avec les réquisits scolaires; au contraire, concernant la littérature de nombreux malentendus apparaissent, qui affectent nos trois registres. On peut considérer ces malentendus comme socio-scolaires (Rayou, 202O), du fait que les écarts entre réussite en commentaire pictural et en commentaire littéraire s’accroissent, dans notre recherche, pour les élèves des établissements de recrutement très populaire. Par conséquent, la préconisation d'une médiation par la peinture peut être illusoire si elle présuppose l’évidence d’un transfert entre les deux processus de compréhension/interprétation: si l’enseignant considère que c’est la même activité, donc qu’il n’y aucune difficulté à transposer à la littérature ce qu’on sait faire sur la peinture, les malentendus risquent de rester entiers. Les inégalités de réussite concernant la littérature ont de ce fait peu de chances de diminuer. En revanche, le détour par la peinture est prometteur si l’enseignant prend en charge, dans les trois registres que nous avons définis, l’étayage du retour à la littérature, c’est-à-dire qu’il accompagne ses élèves dans le transfert, au profit du commentaire littéraire, de ce qu’ils sont capables de faire en commentaire pictural.
Bibliographie
Bautier, Élisabeth, Rayou, Patrick (2013), Les Inégalités d’apprentissage: programmes, pratiques et malentendus scolaires, Paris, Presses universitaires de France.
Bourdieu, Pierre, Darbel, Alain (1966), L’Amour de l’art: les musées et leur public, Paris, Minuit.
Cèbe, Sylvie, Goigoux, Roland, Thomazet, Serge (2003), Enseigner la compréhension: principes didactiques, exemples de tâches et d’activités, Direction de l’enseignement scolaire.
Charlot, Bernard (1997). Du Rapport au savoir. Éléments pour une théorie, Paris, Anthropos.
Claude, Marie-Sylvie (2015), «Commenter la peinture, commenter la littérature: ce que les enseignants attendent, ce que les élèves entendent», Recherches en didactiques, 20 (2), p. 9-21.
Claude, Marie-Sylvie. (2016a), «Commentaire de la peinture et commentaire de la littérature: étude comparée de l’activité des élèves», in, Didactiques du français et de la littérature, André Petitjean (dir.), Université de Lorraine.
Claude, Marie-Sylvie. (2016b), «Lire la peinture, lire le texte littéraire à l’école: une activité de même nature?», Éducation & didactique, 10 (1), p. 67-76.
Claude, Marie-Sylvie (2017), «Peinture et littérature face aux pratiques, gouts et savoirs culturels des élèves du second degré», Pratiques, p. 175-176.
Claude, Marie-Sylvie, Rayou, Patrick (2020), «Aider à la réussite scolaire: des détours sans retours? Peinture et littérature en classe de Français», Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 7 (hors-série), p. 65-85.
Daunay, Bertrand (2004), «Le commentaire: exercice, genre, activité?», Cahiers Théodile n° 5, p. 49-61.
Donnat, Olivier (2011), «Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales». Culture études n° 7, Paris, Département des études de la prospective et des statistiques, Ministère de la culture.
Dufays, Jean-Louis (2016), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n° 45, p.9-17.
Eco, Umberto (1992), La Production des signes, Paris, Librairie générale française.
Falardeau, Éric & Sauvaire, Marion (2015), «Les composantes de la compétence en lecture littéraire», Le français aujourd’hui, 191(4), p. 71-84.
Groupe µ. (1992), Traité du signe visuel, Paris, Seuil.
Langlade, Gérard, Rouxel, Annie (dir.) (2004). Le sujet lecteur: lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Marin, Louis (1971), Etudes sémiologiques. Ecritures, peintures, France, Klincksieck.
Mazauric, Catherine, Fourtanier, Marie-José & Langlade, Gérard (dir.) (2011), Le texte du lecteur, Bruxelles, PIE-Peter Lang.
Panofsky, Erwin (1967), Essais d’iconologie: thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance, Paris, Gallimard.
Rayou, Patrick (2020), «Des registres pour apprendre», Éducation & didactique, 14 (2), p. 49-64.
Vouilloux, Bernard (2004), L'Œuvre en souffrance. Entre poétique et esthétique, Paris, Belin.
Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n°146, p. 131-146.
Waysbord-Loing Hélène (2000), L’Image dans l’enseignement des lettres. Rapport de l’inspection générale, Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
«Marquise, si mon visage / A quelques traits un peu vieux, / Souvenez-vous qu'à mon âge / Vous ne vaudrez guère mieux.»
Pour citer l'article
Marie-Sylvie Claude, "Passer par la peinture pour enseigner la littérature : un détour à l’épreuve de la recherche", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/passer-par-la-peinture-pour-enseigner-la-litterature-un-detour-a-l-epreuve-de-la-recherche
Voir également :
Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Que pourraient nous apprendre les images dans les manuels de lecture et les anthologies sur l’enseignement de la littérature au primaire et au secondaire? Le cas de la Suisse romande, entre les années 1870 et les années 1970.
Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Introduction
Poser la focale sur l’image dans les manuels scolaires de langue maternelle1dans le cadre d’une enquête historico-didactique peut sembler au premier abord inattendu. Que pourrait nous apprendre l’analyse des images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires, supports privilégiés pour l’enseignement de la littérature? Celles-ci ne participent-elles pas avant tout d’une stratégie éditoriale visant à garantir l’attractivité du manuel? Sans nier l’importance de cette dimension, nous postulons, à l’instar de Perret (2018) pour la France, que les images dans les manuels constituent des indicateurs clés de l’histoire des disciplines scolaires. Louichon (2018) a montré notamment comment l’analyse des images associées aux textes littéraires permet de mettre en lumière des représentations de la littérature scolarisée contrastées selon les niveaux d’enseignement et qui évoluent en fonction des périodes. Qu’en est-il donc en Suisse romande?
Cette étude se donne pour but d’historiciser les relations entre l’image et le texte, en particulier littéraire, dans les manuels de lecture du primaire et les anthologies du secondaire inférieur de Suisse romande, et ce entre les années 1870, marquées par une première tentative d’harmonisation intercantonale, et les années 1970, qui voient l’adoption de manuels communs à tous les cantons romands dans le cadre d’un nouveau paradigme disciplinaire (Schneuwly et al. 2016). Comme le relèvent Ferran et al. (2017), la notion d’image est complexe. En posant la focale sur «l’image» dans les manuels scolaires, nous définissons provisoirement l’image comme toute représentation visuelle qui n’est pas du texte.
Nos questions de recherche sont donc les suivantes:
- Quels manuels de lecture comprennent des images? Quelle est, dans ces manuels, la proportion d’images par rapport aux textes? Quelle est la nature de ces images, sont-elles conçues ou non pour les manuels et qui en sont les auteurs?
- Quel est le statut de ces images par rapport aux textes? Y a-t-il des propositions didactiques et des activités proposées dans les manuels sur ces images, seules ou en lien avec certains textes?
- Enfin, quelles sont les fonctions assignées à ces images? Viennent-elles simplement illustrer le manuel pour le rendre plus attrayant? Sont-elles au service de la compréhension, voire de l’interprétation du texte? Ou encore tiennent-elles lieu de texte destiné à être lu et interprété?
Précisions méthodologiques
Pour traiter cette problématique, cette étude, qui s'inscrit dans le cadre du projet intitulé «Histoire de l’enseignement de la littérature en “Français” et en “Italien” (Suisse romande et Tessin, mi-XIXe-XXe siècles)» (requête FNS n°100019_197600/1), adopte une approche comparative de type historico-didactique qui s’inspire de la démarche développée par Bishop (2017).
Ainsi, les manuels2 constituent le terrain de recherche principal (Denizot 2016) de cette étude (cf. tableaux 1 et 2 en annexe). Ils constituent des objets aux multiples facettes qui conjuguent des enjeux éditoriaux, économiques, culturels et scolaires (Choppin 2008). Notre corpus est constitué de 46 ouvrages pour les degrés intermédiaire (élèves de 9 à 11 ans) et supérieur (élèves de 12 à 15 ans) du primaire et le degré inférieur du secondaire3 (élèves de 12 à 15 ans) prescrits officiellement par les autorités scolaires des cantons romands. Celui-ci est mis en regard, d’une part, des plans d’études et des programmes édités par les cantons4, d'autre part des articles tirés des revues professionnelles5 qui portent sur la question de la place et de la fonction des images dans les pratiques pédagogiques et dans l'enseignement de la langue maternelle.
Cette étude recourt ensuite, par le croisement de sources, à un jeu d’échelles qui permet les comparaisons. En Suisse, comme nous l’avons dit plus haut, le système scolaire relève au niveau politique principalement de la compétence des cantons. Ainsi, pour notre période, les plans d’études et programmes sont cantonaux. Les manuels scolaires se situent dans un espace intermédiaire: certains sont adoptés par un seul canton, d’autres par plusieurs cantons. Enfin, les revues pédagogiques dépassent largement les frontières cantonales, se faisant l’écho de débats et controverses qui se situent au niveau d’une région linguistique, voire au niveau suisse.
Par ailleurs, cette étude pose la focale plus particulièrement sur quatre cantons contrastés du point de vue de la question de la laïcité à l’école et de la religion6: Genève (protestant et laïque), Vaud (protestant et non laïque mais confessionnellement neutre), les parties francophones de Berne (catholique et protestant, non laïque) et de Fribourg (catholique et non laïque). Ces quelques constats nous permettent d'ores et déjà de supposer que les textes et les images dans les manuels diffèrent d'un canton à l'autre selon la place de la religion et de l'Église dans la gestion de l'Instruction publique et dans les enseignements. Alors que Fribourg se constitue en République chrétienne avec un pouvoir conservateur renforcé qui va au-delà de l’entre-deux-guerres (Praz 2005: 52), il est à supposer que le rôle conféré à l’image dans la tradition catholique – entre autres instruire, émouvoir et marquer l’esprit – (Saint-Martin 2010: 303) puisse se retrouver dans les livres de lecture. À l’inverse, le processus de sécularisation qui touche par exemple la société vaudoise a pu amener les auteurs et éditeurs à faire d'autres choix iconographiques pour leurs manuels.
Enfin, l’analyse de ces données prend appui sur des concepts qui se situent à l’articulation entre les champs de l’histoire de l’éducation et de la didactique de la littérature. Il s’agit notamment de celui de littérature scolarisée. Utilisé au départ par les historiens de l’éducation (Hébrard 1988), le concept de scolarisation désigne, comme le rappelle Denizot (2021), les processus complexes qui sous-tendent la fabrication des objets scolaires en tant que partie de la culture scolaire. Cette dernière est ici envisagée comme une culture qui prend ses racines et s’élabore dans le milieu scolaire, présentant ainsi une spécificité propre par rapport à la culture de la société globale (Chervel, 1992). Il a été montré qu’en Suisse romande - comme en France - la constitution des corpus littéraires s’opère dans la discipline Français entre la fin du XIXe siècle et les années 1970, essentiellement au sein des manuels scolaires par le biais d’extraits (Monnier 2021). Les manuels participent donc pour la période qui nous occupe à la fabrication de la littérature scolarisée, c’est-à-dire de la littérature comme objet scolaire.
Le texte s'organise enfin sur la base d’une périodisation en trois temps, inspirée de travaux antérieurs (Schneuwly et al. 2016). Nous nous centrons d'abord sur la période qui va des années 1870 aux années 1910. Celle-ci se caractérise par la constitution du Français en discipline scolaire et par le développement de l'enseignement intuitif et de la leçon de choses. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1910 aux années 1940, au cours de laquelle, sous l’influence de l’Éducation nouvelle7, les images se diffusent largement au sein des manuels scolaires. Nous terminons avec une focale sur les années 1940-1970 qui se caractérisent par une absence d’évolution et une prégnance moins forte de l’Éducation nouvelle, non sans impact sur la nature, la place et la fonction des images.
Première période (1870-1910). Les images au service du développement des connaissances
Même si dès le début du XIXe siècle des ouvrages scolaires dédiés à l’apprentissage de la lecture courante sont édités au sein des cantons romands, force est de constater que ce n’est qu’à partir des années 1870 que certains moyens d’enseignement sont officialisés, voire généralisés. Cette période est ainsi marquée par une première tentative d’harmonisation des moyens d’enseignement et par l’adoption d’ouvrages de lecture communs qui se concrétisent par la constitution d’une commission romande et par la parution en 1871 de deux livres de lecture adoptés par les cantons de Berne, Vaud et Genève et dédiés aux écoles primaires (Tinembart 2015): le premier, comportant 166 pages, est destiné au degré intermédiaire (Renz 1871) alors que le second, produit à l’échelle romande, comportant 420 pages, est édité pour le degré supérieur (Dussaud & Gavard 1871). Ces deux ouvrages de lecture comprennent près de deux tiers de textes à caractère encyclopédique. Les autres écrits se répartissent entre des récits et des anecdotes diverses, des lettres, ainsi que des poésies narratives ou lyriques. En revanche, les images sont peu présentes. Seules 24 gravures en taille-douce représentant toutes des animaux ont été relevées dans les parties non littéraires du Renz (1871). Il est également intéressant de constater que ces images sont parfois orientées dans un autre sens que le texte par gain de place et qu’elles sont dissociées de l'extrait auquel elles pourraient se rapporter. Nous pouvons en déduire que la fonction de l’image, tout comme celle du texte, est alors de transmettre des connaissances sans pour autant que les deux soient en relation directe. A titre d’exemple, une image d’éléphant est insérée à côté d’une image de dromadaire dans un extrait de texte de Lenz (sans prénom), adapté par Renz, dédié aux animaux domestiques de nos contrées, et qui ne contient de fait qu’une seule phrase sur les charges que peut porter le pachyderme.
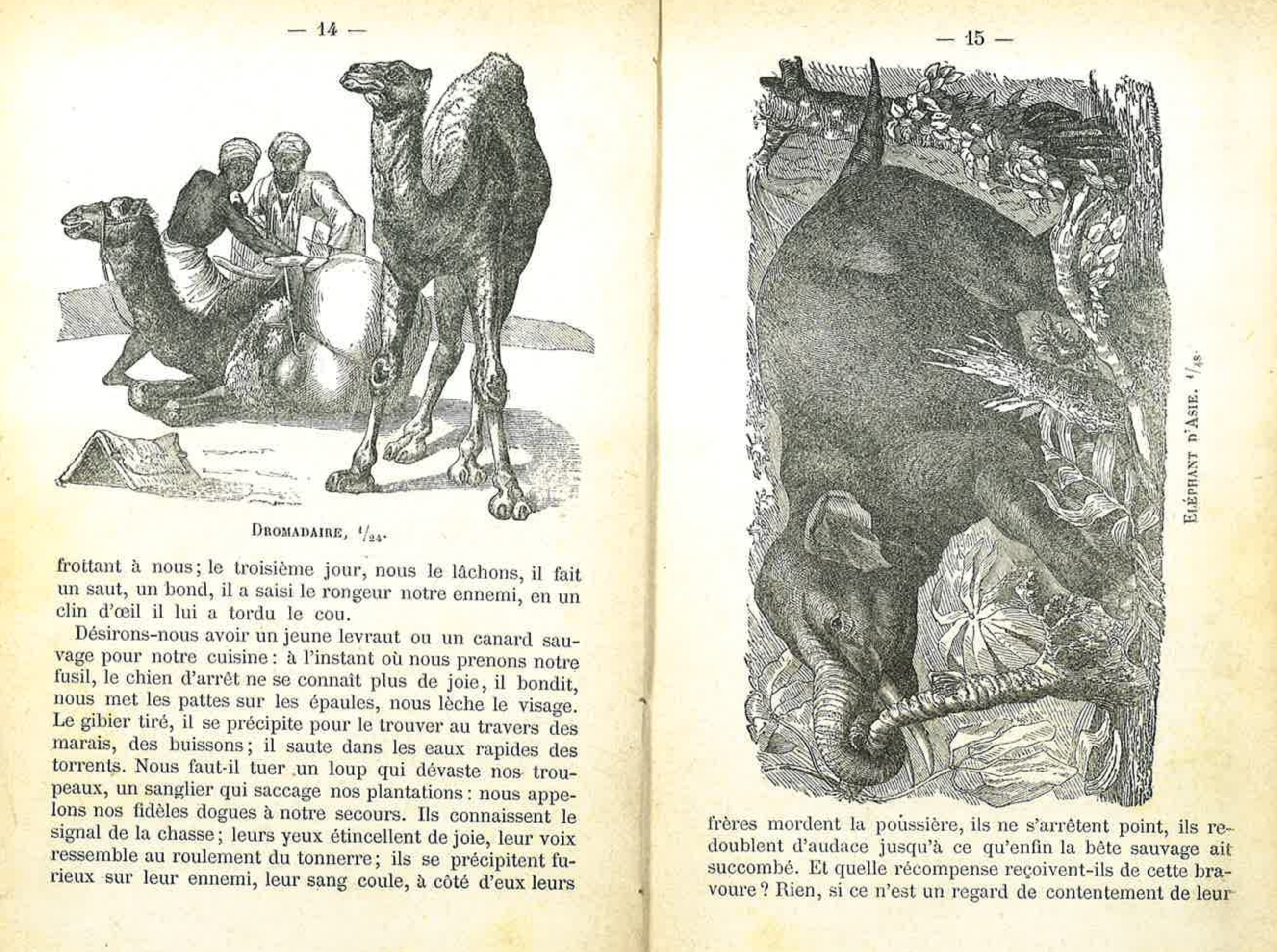
Figure 1: Éléphant d’Asie, 1/48 (Renz 1871: 15)
En revanche, dans le Dussaud et Gavard (1871), le texte dédié à l’éléphant, écrit par le zoologiste Henri Milne Edwards (1800-1885), n’est pas illustré et revêt un caractère plus scientifique, parce qu'il s'adresse aux élèves des degrés supérieurs du primaire et est utilisé dans les premiers degrés des écoles secondaires. Il est intéressant de constater que, dans l’adaptation fribourgeoise de ce même ouvrage en 1881 (Dussaud & Gavard 1881), le texte de Lenz figurant dans le Renz (1871) est alors repris et qu’une autre image d’éléphant y est insérée8.
Entre 1880 et 1900, la génération suivante d’ouvrages officiels de lecture dans les cantons romands conservent leur caractère encyclopédique, mais associent plus étroitement illustrations et textes encyclopédiques. Les images jouent alors un rôle propédeutique quant à la découverte et à la formation au savoir. Cela s’explique notamment par le fait que les plans d’études (à l’instar du Plan d’études pour les écoles primaires du Canton de Vaud du 29 février 1868: 16, qui prescrit «une collection de tableaux pour servir aux leçons d’intuition, une collection de tableaux de lecture et un manuel de lecture») préconisent l’usage de la méthode intuitive dès la fin des années 1860.
Les principes de l’enseignement intuitif9 s’articulent avec la leçon de choses qui apparait dans les programmes romands à partir des années 1870. Selon Kahn, la leçon de choses «se fonde sur la préconisation du recours à l’intuition et n’est pas spécialement associée à un enseignement disciplinaire déterminé, l’enseignement scientifique» (2002: 2).
Aussi, les ouvrages de lecture, en particulier ceux du degré moyen ou intermédiaire, encore majoritairement à caractère encyclopédique en Romandie entre 1880 et 1900, intensifient la présence d’images en lien avec les textes pour permettre aux enseignants d’appliquer la méthode intuitive ou de concevoir des leçons de choses. Certains auteurs renforcent le nombre d’images de sciences naturelles comme dans le Trésor de l’écolier (1885) du canton de Berne. D’autres, comme Le livre de lecture pour les écoles primaires de Fribourg, Degré supérieur (1899), n’illustrent que la partie historique.
Dans les cantons catholiques, à l’instar du canton de Fribourg, certains manuels comme le Livre de lecture pour les écoles primaires du canton de Fribourg, Degré moyen (1889) sont en revanche illustrés dans toutes les parties. Cependant, les deux ouvrages de lecture fribourgeois de 1889 et de 1899 comportent une première partie consacrée aux textes moraux et religieux qui n’existent plus dans les livres des cantons protestants. Au degré moyen (1889), nous trouvons des textes tels que «Dieu notre créateur»; ce premier extrait est illustré par un Dieu ténébreux montrant sa colère depuis les cieux. En revanche, l’ouvrage destiné au degré supérieur (1899) ne contient pas d’image religieuse. La différence majeure entre les ouvrages des cantons protestants et catholiques réside donc dans le fait que les premiers n’incluent pas de textes relatifs à la religion et pas d’images chrétiennes, puisque des ouvrages d’histoire biblique sont édités en parallèle. Les cantons catholiques conservent des textes dits à caractère religieux dans les ouvrages de lecture courante.
Au début du XXe siècle, nous observons une mue dans les ouvrages de lecture. Des auteurs comme Dupraz et Bonjour (1899) expurgent de leurs nouvelles publications les textes à caractère encyclopédique parce qu’ils déclarent «tenir compte aussi de la prochaine publication de manuels spéciaux (histoire, sciences naturelles)» (Dupraz & Bonjour 1903: préface). Dès lors et pour répondre également aux prescriptions cantonales, leurs manuels ne comportent que des textes d’auteurs reconnus non illustrés. Si la littérature a d’ores et déjà fait son apparition dans une moindre mesure dans les ouvrages de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871), il n’en demeure pas moins que les Dupraz et Bonjour (1899/1903) marquent un véritable tournant. Les deux Vaudois affirment que «les livres de lecture s'étaient peu à peu transformés en petites encyclopédies ou abrégés scientifiques d’un attrait et d’une utilité problématique pour l’élève» (Dupraz & Bonjour 1899: III). Ils puisent alors «largement dans la littérature contemporaine» (1899: IV) en proposant des extraits variés organisés en thématiques et non imagés.
Dans les filières secondaires des cantons protestants, les ouvrages à caractère encyclopédique et imagés de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871) sont également utilisés avec les plus jeunes élèves de la filière secondaire. En revanche, pour les élèves plus âgés, ce sont les trois tomes de la Chrestomathie française de Vinet (revue et augmentée par Eugène Rambert) qui sont utilisés. Ces volumes, qui comprennent exclusivement des textes littéraires, n’ont aucune image. Ces Chrestomaties, dès leur parution, obtiennent un large écho qui les pérennise dans leur forme pendant près d’un siècle et marquent durablement l’enseignement du français. Cela met en lumière le phénomène suivant: la lecture et l’étude des textes n’a pas la même fonction dans les deux filières. Au primaire, les livres de lecture sont un vecteur d’acquisition de connaissances; au secondaire, les chrestomathies et les anthologies visent à développer la culture littéraire et langagière de l’élève dans un enseignement encore marqué par les principes rhétoriques.
Au cours de cette première période, l’image est donc présente dans les parties encyclopédiques des livres de lecture du primaire, mais déconnectée du texte.
Deuxième période (1910-1940). Les images comme portes d’accès à la lecture des textes littéraires
Cette deuxième période se caractérise par un contraste fort entre les anthologies et chrestomathies prescrites pour les filières du secondaire qui, à l’instar de la première période, ne comportent généralement aucune image, et les manuels de lecture du primaire où les images vont se multiplier, aussi bien dans le degré moyen que dans le degré supérieur10.
Or, contrairement à la période précédente, où les images étaient présentes dans les parties scientifiques des manuels, on assiste à partir des années 1910 à une augmentation du nombre d’images désormais étroitement associées aux textes littéraires, centraux dans les manuels de lecture du primaire (Muller 2007).
Ce phénomène se retrouve dans les manuels de tous les cantons. Sous l’influence de l’Éducation nouvelle, comme le montre Renonciat à propos des albums du Père Castor publiés en France dans l’entre-deux guerres, l’image va en effet être envisagée comme une porte d’accès privilégiée «aux acquisitions – sensorielles, motrices, psychologiques et intellectuelles – nécessaires à l’exercice d’une «lecture "intelligente", qui ne se réduit pas à un simple mécanisme de déchiffrement» (2009: 68).
L’inspecteur scolaire Louis Henchoz publie un article dans l’Éducateur en 1930 sur la question de l’illustration dans les manuels scolaires. Il rappelle que c’est chez Hachette que les premiers manuels avec gravures paraissent dans les années 1850, non sans remous: on parle alors à Paris de «profanation de la littérature» et «d’atteinte à la gravité de l’enseignement» (1930: 279). Il défend alors l'idée suivante:
Il faudra trouver de bons artistes pour les originaux. [...] bannissons résolument toute excentricité, toute présentation grotesque ou banale. Allons à ceux qui cherchent de fixer avec sincérité ce qui [...] ‘caractérise avec la plus absolue vérité les personnalités et les faits’. Tous nos manuels doivent avoir un cachet artistique qui emporte l’approbation générale immédiate. (1930: 280)
Si les images se généralisent dans l’ensemble des disciplines scolaires, Henchoz précise la place et le rôle que celles-ci devraient occuper dans les manuels pour l’enseignement de la langue maternelle:
Dans les manuels de lecture qui viendront successivement, les gravures seront toujours en rapport avec le texte. On veillera à ne rien admettre qui soit pure fantaisie. Pour les dernières années, les reproductions d’œuvres d’art, peinture, sculpture, architecture, d’une portée éducative incontestable, pourront être intercalées comme hors-texte, en nombre restreint toutefois. (1930: 281)
Les images, avec les textes avec lesquels elles forment un tout, constituent pour l’inspecteur des moyens par excellence pour le développement intellectuel et artistique des élèves; et ce dernier de conclure: «elles auront préparé le terrain pour l’observation visuelle, pour l’analyse». (Henchoz 1930: 281)
Dès 1910, les manuels sont en effet illustrés par des dessins d’un artiste suisse reconnu, le plus souvent nommé explicitement.
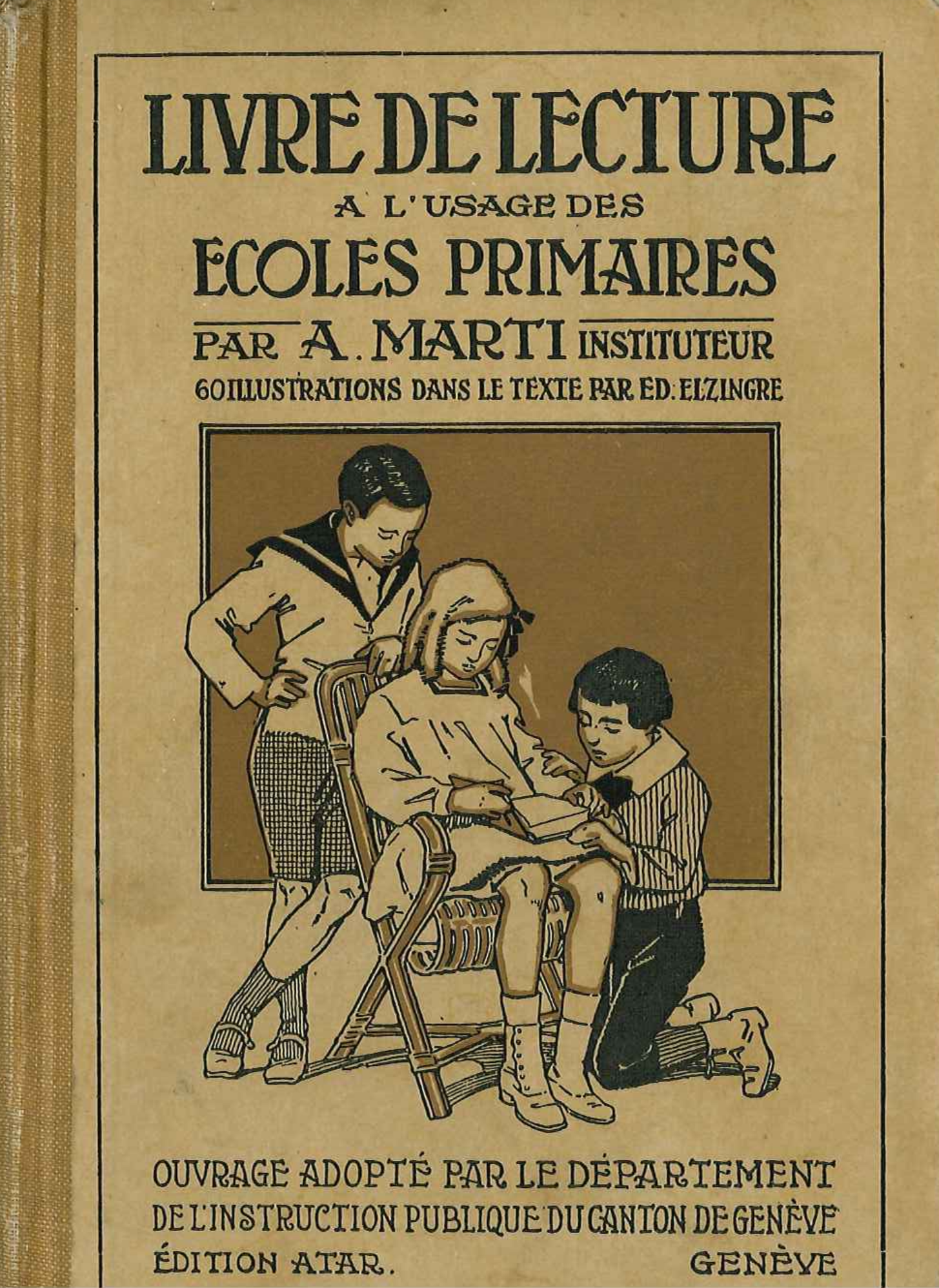
Figure 2: Première de couverture du Livre de lecture à l’usage des écoles primaires (Marti 1916)
Dans la première version du manuel genevois de Marti (réédité en 1936 sous le titre Heures claires), on compte ainsi 60 dessins d’Edouard Elzingre11pour 231 extraits «puisés chez les grands écrivains […] et dans ceux de leurs livres qui traitent de psychologie enfantine, ou qu’ils ont spécialement écrits pour la jeunesse» (Marti 1916: 4). Ces illustrations visent à faciliter l’accès des élèves à la «lecture expliquée»12 des morceaux; elles «ajoute[nt] un attrait de documentation pittoresque et peu[ven]t donner matière à d’intéressants exercices d’élocution» (1916: 4).
A partir des années 1930, la photographie fait son apparition dans les manuels scolaires. C'est le cas dans Lectures (Bonjour & Jeanrenaud 1931), destiné aux degrés supérieurs du primaire. C'est le cas également dans J’aime lire (1929), élaboré par une commission présidée d’abord par Albert Malche, puis par Albert Atzenwiler très largement influencé par l’Éducation nouvelle. Se voulant résolument moderne et novatrice, cette commission s‘inscrit contre ceux qui reprochent à la photographie une mauvaise définition de l’image rendant sa lisibilité insuffisante auprès des enfants (Renonciat 2009). 60 dessins, photographies, schémas cartographiques ou encore des reproductions de tableaux viennent ainsi illustrer les 140 morceaux d'écrivains reconnus – Charles Ferdinand Ramuz, Blaise Cendrars, Jules Renard ou Jean de La Fontaine – «qui leur [aux élèves] plaisent, et par la beauté de la forme et par l’attrait du récit» (Préface, p. 8). Cette diversification de l’image et le nouveau statut qu’elle prend par rapport au texte est en lien avec les avancées graphiques et techniques de l’époque.
Corollairement, si l'image, à l‘instar des définitions de certains mots de vocabulaire placés en note de bas de page, vise avant tout à faciliter la compréhension du texte et à enrichir la culture de l’élève, dans certains extraits, elle tend à perdre son statut de subordonnée. Par exemple, le tableau intitulé Pasteur dans son laboratoire d’Albert Edelfelt est explicitement cité dans l’extrait de Louis Pasteur par E. de Villeroy qui en propose une brève description: «un tableau connu le représente dans son laboratoire, regardant le contenu d’une éprouvette à la lumière du jour: toute la vie du savant est là» (J’aime lire 1929: 138).
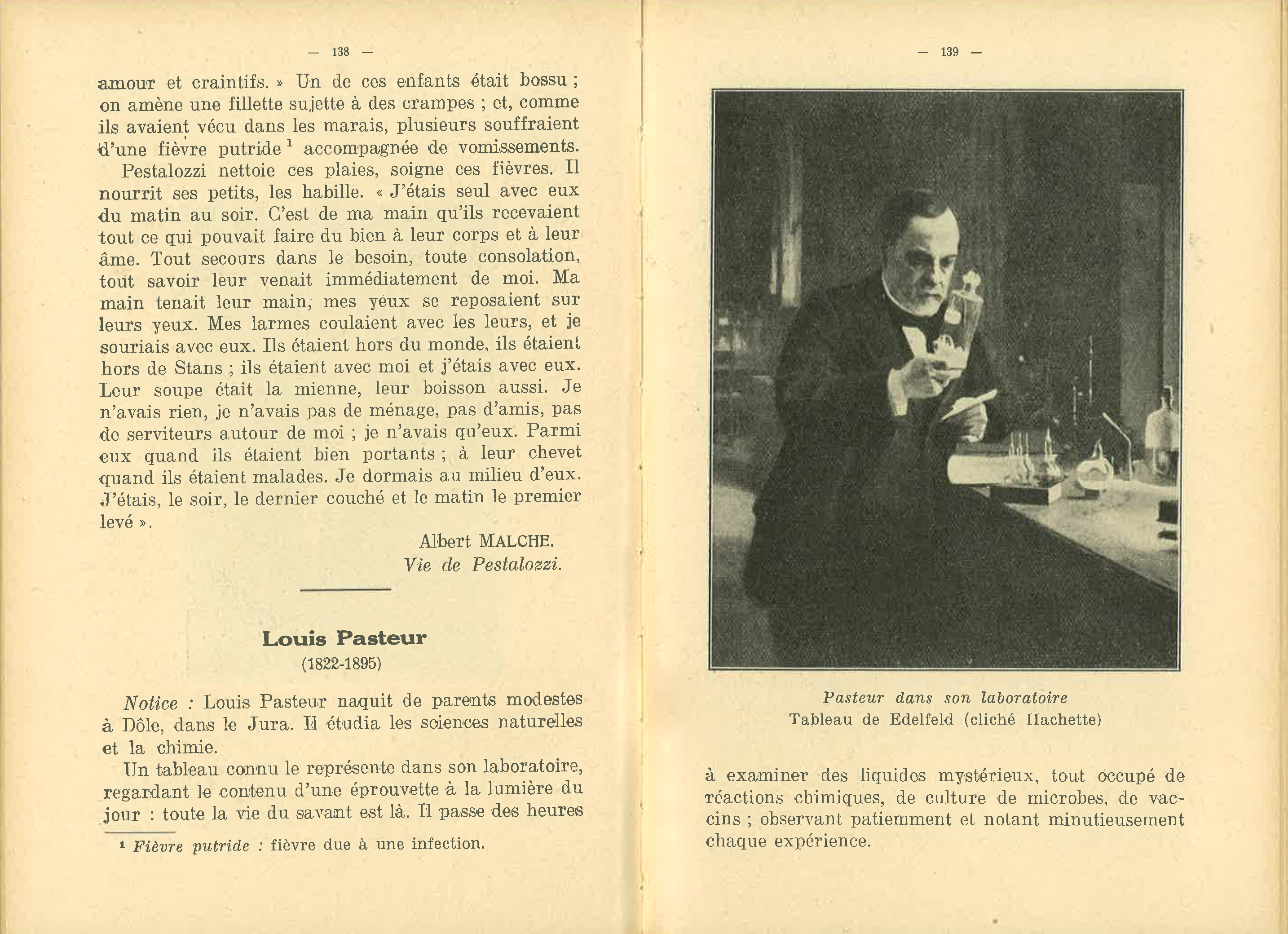
Figure 3: «Pasteur dans son laboratoire», Tableau de Edelfelt (cliché Hachette) (J’aime lire 1929: 139)13
A contrario, dans les manuels en vigueur dans les cantons non laïques, l’image, par la dimension émotionnelle qu’elle véhicule, a avant tout pour fonction de renforcer le sentiment patriotique et religieux des élèves. Cela est le cas aussi bien dans les manuels bernois que dans les manuels fribourgeois. Ainsi, dans Mes Lectures (1934), destiné aux élèves fribourgeois du primaire supérieur, les textes d’auteurs et d’autrices avant tout contemporains, ainsi que les dessins du peintre moderne fribourgeois Gaston Thévoz et du dessinateur bernois M. R. Sager, ont été sélectionnés sur les critères suivants:
a) qu’ils ne blessent en rien la foi et la morale chrétienne; b) qu’ils ne soient ni trop difficiles ni trop imagés; c) qu’ils soient irréprochables en ce qui concerne la correction de la langue, sa pureté, et même la ponctuation; d) enfin, que l’illustration ne soit pas un mystère à éclaircir. (Protocoles de la Commission permanente des études, Archives de l’État de Fribourg, DIP III 14)
Ainsi, les images sélectionnées par la Commission ne doivent pas être un obstacle à la compréhension du texte qui constitue un modèle pour l’apprentissage de la langue.
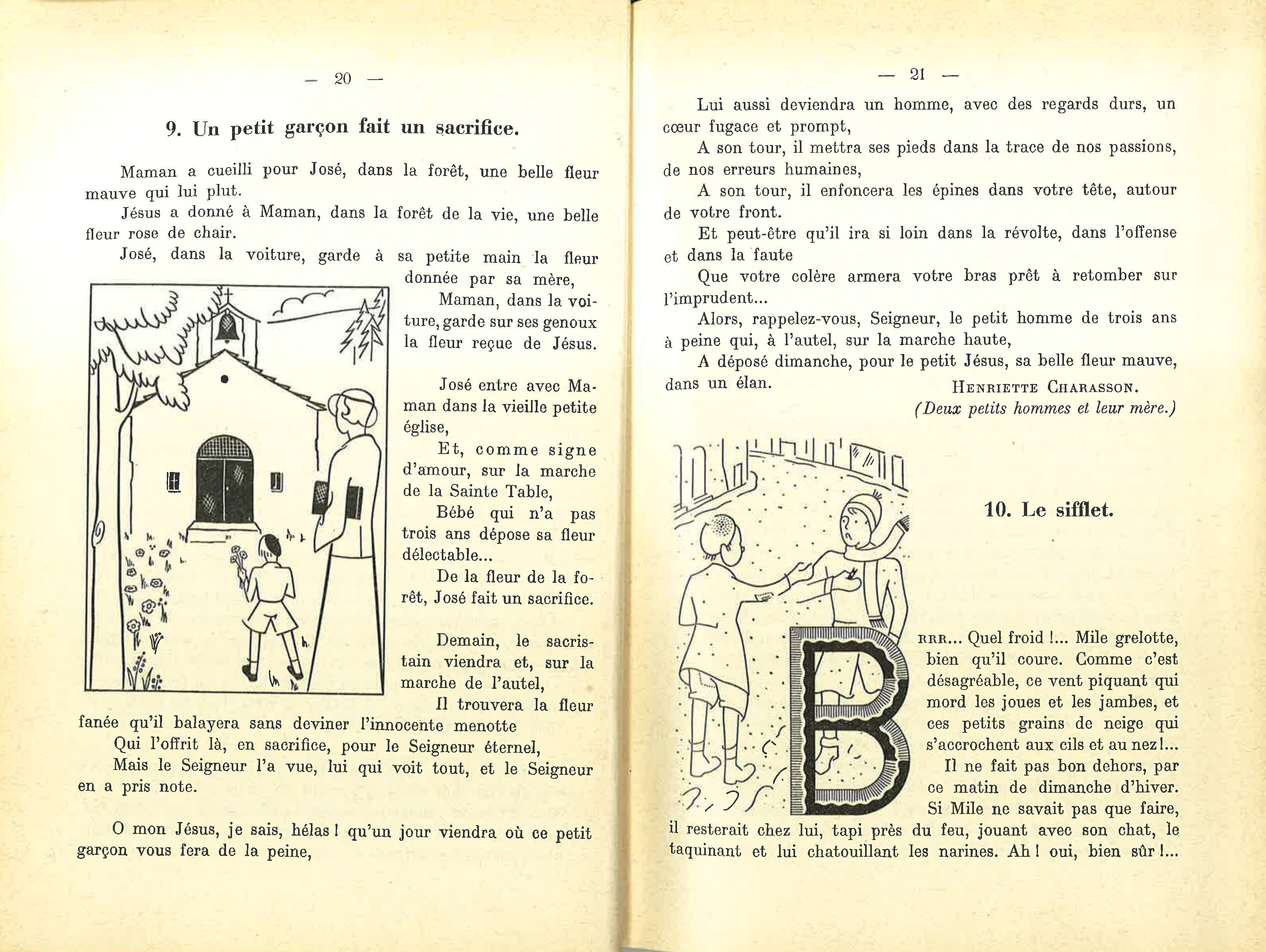
Figure 4: Extrait de «Deux petits hommes et leur mère» d’Henriette Charasson (Mes Lectures 1934: 20)
Enfin, alors que l’image est désormais, contrairement à la période précédente, largement présente dans les manuels de lecture destinés au primaire supérieur, elle continue à être absente dans les anthologies et les chrestomathies destinées aux élèves des filières secondaires. Une seule exception est celle de l'anthologie belge de Procès (1927), Modèles français, extraits des meilleurs écrivains, utilisée au collège à Fribourg. Les textes y sont regroupés par auteurs classés de façon chronologique, et chaque rubrique s’ouvre sur un portrait de l’écrivain, comme ici.
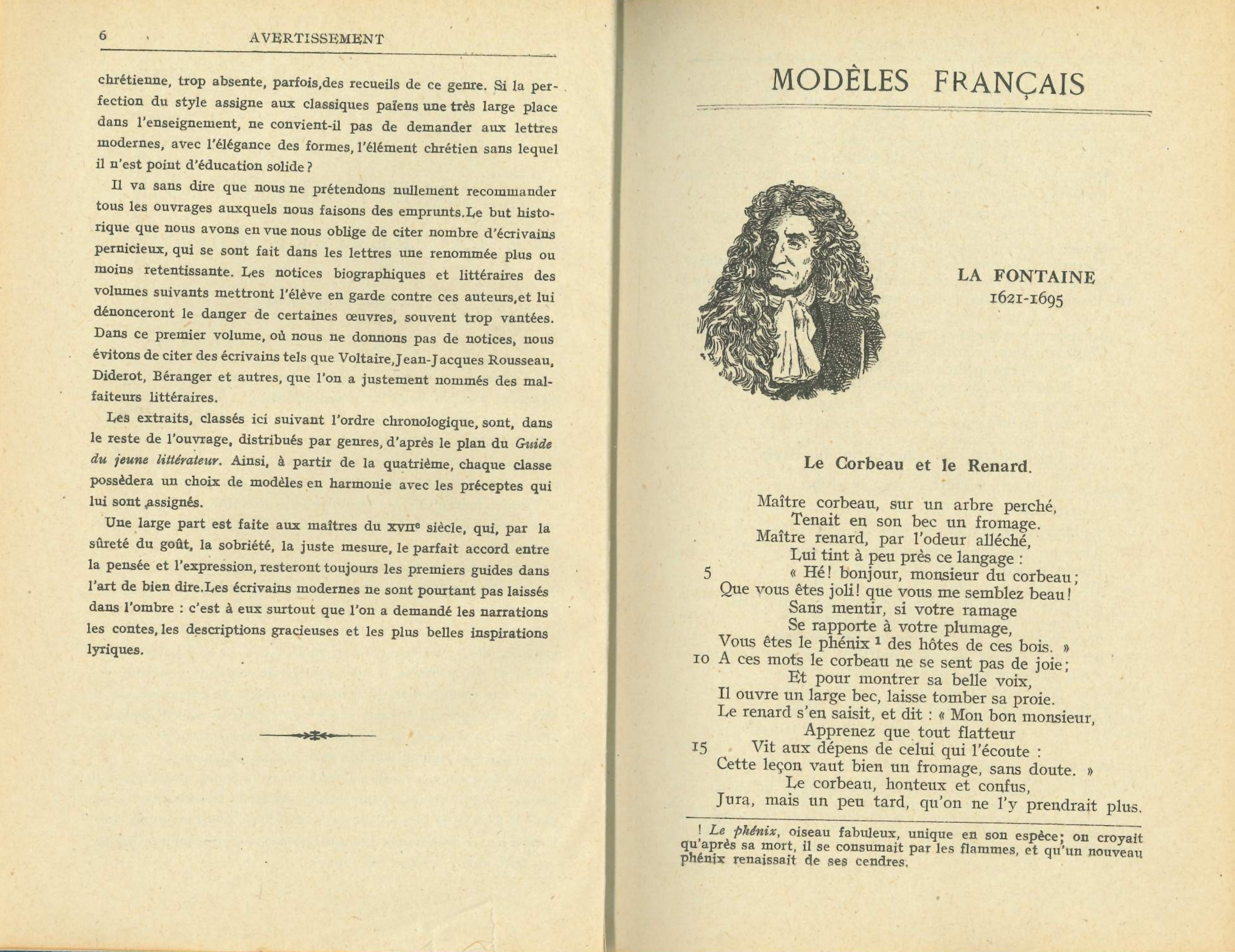
Figure 5: Portrait de La Fontaine (Procès 1927: 7)
Ces images figuratives (Perret 2019: 101) viennent ainsi renforcer la finalité du manuel qui constitue une initiation à l'histoire de la littérature centrée sur l’admiration de l’auteur, dans la continuité de l’enseignement rhétorique qui perdure dans les pratiques sous forme de couches sédimentées. On est donc ici dans une conception de la littérature scolarisée très différente de celle en vigueur au primaire à cette période.
Troisième période (1940-1970). L’image dans les manuels: lieu de résistance au monde audio-visuel qui concurrence la lecture de textes littéraires?
Les années d’après-guerre voient une généralisation de certaines techniques d’impression, rendant possible un recours plus systématique à la couleur, à des mises en page qui ne se contentent pas de juxtaposer le texte et l’image à la reproduction de photographies, le tout à bas coûts (Perret 2019: 98). Ce développement technique s’inscrit dans une expansion économique et industrielle plus large en Suisse, et s’accompagne de l’entrée dans les foyers et dans les classes de nouveaux moyens audiovisuels, avec la radio et la presse magazine qui s’affirment d’abord, avant que la télévision ne s’impose à la fin des années 1960 (Clavien 2017). Les milieux de l’édition connaissent néanmoins un léger décalage. Marqués dans un premier temps par la Défense spirituelle14 qui a prévalu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui les ont amenés à publier des textes conformes aux valeurs du mouvement, ils trouvent une nouvelle dynamique à la fin des années 1950 avec la littérature de jeunesse et la publication de nouveaux écrivains issus de la scène romande (Corsini & Vallotton 2011). Dès lors, nous pouvons nous demander si, depuis la Deuxième Guerre mondiale, certaines prémices à cette place donnée à l’image par rapport au texte peuvent être observées dans les manuels scolaires en langue maternelle, alors que les composantes de la discipline tendent à rester stables durant cette période (Vollenweider en cours).
La présence exponentielle de l’imagerie visuelle n’est pas ignorée par les pédagogues. Dans l’Annuaire, Samuel Roller, co-directeur des études pédagogiques à Genève, observe que «le monde se voit envahi par l’image» (1957: 84) et relève la nécessité de former aux images à l’école:
Dès lors, on voit pour [l’école] apparaître une tâche nouvelle: aider l’enfant à faire son chemin dans ce monde d’images qui le sollicitent; autrement dit le mettre en état, après avoir éprouvé toutes choses, de «retenir ce qui est bon». Il résulte de cela que les instituteurs ne peuvent pas écarter l’image de leur enseignement. (1957: 84)
Mais cette apparente ouverture aux images s’accompagne d’une inquiétude: va-t-elle détrôner le «texte imprimé», s'interroge Roller? Pour ce dernier, l’image est un instrument de culture qu’il s’agit d’accueillir et de rendre intelligible.
La relative ouverture de Roller n’est toutefois pas partagée dans tous les milieux pédagogiques, comme en témoignent les directives officielles dans le canton de Fribourg. L’image est strictement encadrée dans le programme général de Fribourg en 1967. Les recommandations de ce programme n’accordent pas le même statut à l’image qu’au texte et à la lecture. L’image y est sujette à une certaine méfiance et sert à réaffirmer la valeur du texte écrit:
[…] l’image visuelle est naturellement plus attirante qu’une page de lettres à déchiffrer. L’apprentissage de la lecture se heurte de ce fait à une sérieuse concurrence. Les illustrations des manuels y remédient quelque peu. […] Il n’y a pas de vraie culture par l’image seule. L’école se doit donc, même aujourd’hui, 1° de défendre la «civilisation du livre»; 2° de ne pas bouder les moyens audio-visuels, mais de se servir de leur stimulant pour orienter l’élève vers un approfondissement de leur rapport par la lecture et la réflexion personnelle. (1967: 1.2)
Cette instrumentalisation de l’image contre elle-même souligne que les images sélectionnées pour accompagner les morceaux dans les manuels de lecture fribourgeois ont pour principale fonction d’amener au texte et de savoir ensuite s’effacer pour laisser la place seulement à la lecture de textes. Elles ne doivent pas les concurrencer.
Ce statut donné à l’image s’observe notamment dans les manuels de lecture fribourgeois du primaire moyen (1955) et supérieur (1954) qui sont prescrits jusqu’à la fin des années 1960. Les améliorations techniques récentes n’ont pas amené de grands bouleversements dans la mise en page. Si la couleur y fait son entrée, elle est utilisée avec parcimonie. Textes et dessins – il n’y a presque jamais de reproductions de gravures ou de photographies15 – s’enchaînent généralement, et la mise en page ne les juxtapose ou les superpose16 rarement. La présence des images se renforce toutefois.
Elle se renforce également dans les manuels genevois et vaudois; son utilisation ne semblant pas faire l’objet d’autant de réserve qu’à Fribourg. Les manuels vaudois et bernois présentent quelques particularités au regard du reste du corpus. L’ouvrage vaudois pour le degré moyen (Foretay 1944) adopte une mise en page particulièrement variée, du point de vue de la disposition de l’image sur la page comme de l’habillage du texte (cf. figure 6).
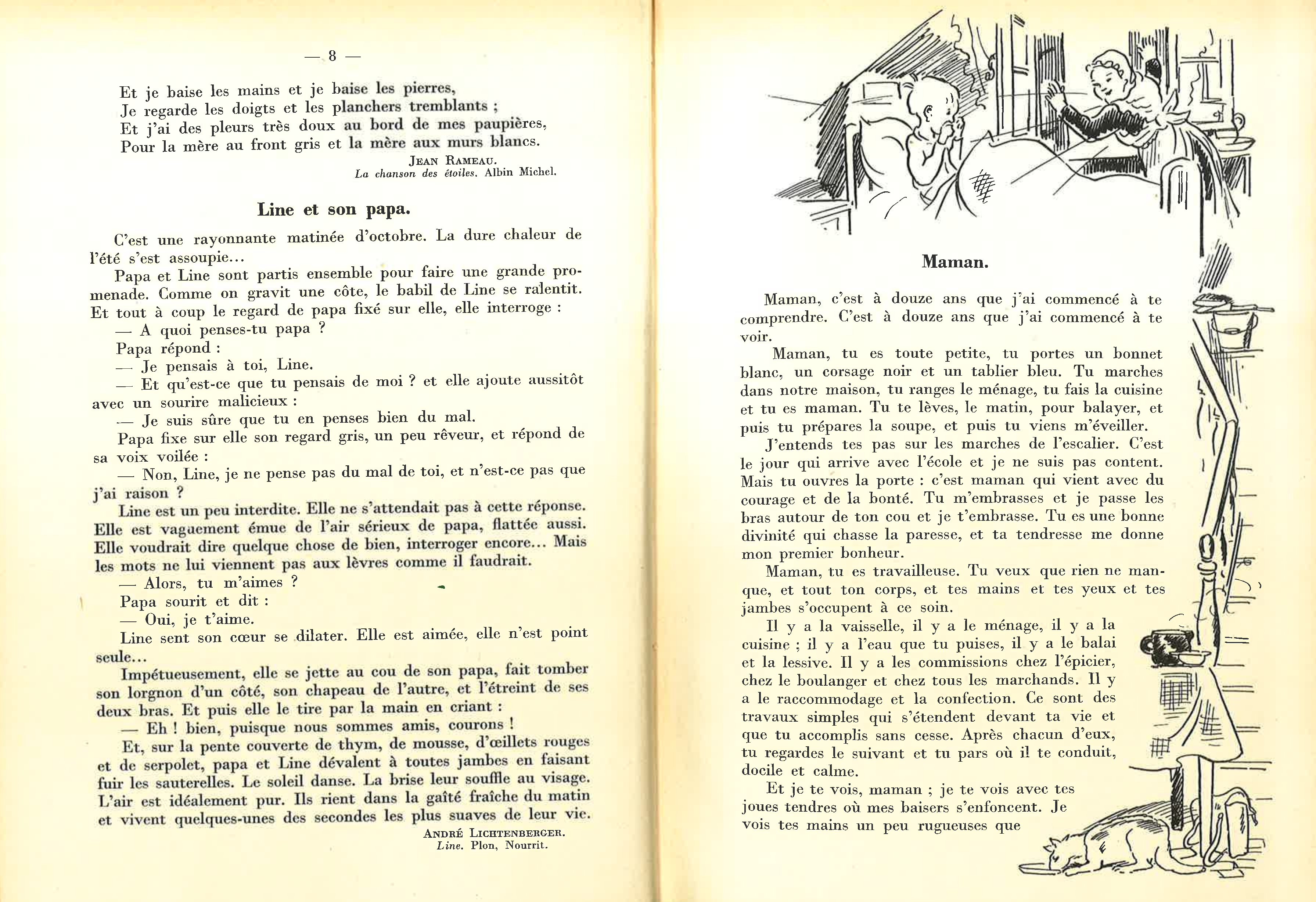
Figure 6: Illustration du texte «Maman» (Foretay 1944: 9)
Quant à l’ouvrage vaudois pour le degré supérieur (Foretay & Jeanrenaud 1946) et le manuel bernois pour le degré moyen (Jeanprêtre et al. 1961), ils contiennent presque exclusivement des photographies. Enfin, seuls des tableaux des XIXe et XXe siècles sont reproduits dans le manuel bernois pour le degré supérieur (Devain et al. 1964), non à des fins d’illustration des textes, mais pour amener une culture artistique et parce que «ces œuvres correspondent certainement à la sensibilité de l’enfant aujourd’hui.» (p. 5)
A l’instar des périodes précédentes, la majorité des images sont réalistes et renvoient au quotidien. Par exemple, dans le manuel fribourgeois Lecture et poésie (1955), les images n’illustrent pas des situations ou des objets décrits dans les textes qui pourraient être inconnus des élèves, mais au contraire les accompagnent vers une réalité qu’ils connaissent: des animaux, le foyer, le travail aux champs, des vues de la ville de Fribourg. Cette fonction de représentation est plus prégnante au degré moyen où les manuels contiennent plus d’images qu’au degré supérieur, et ce dans tous les cantons.
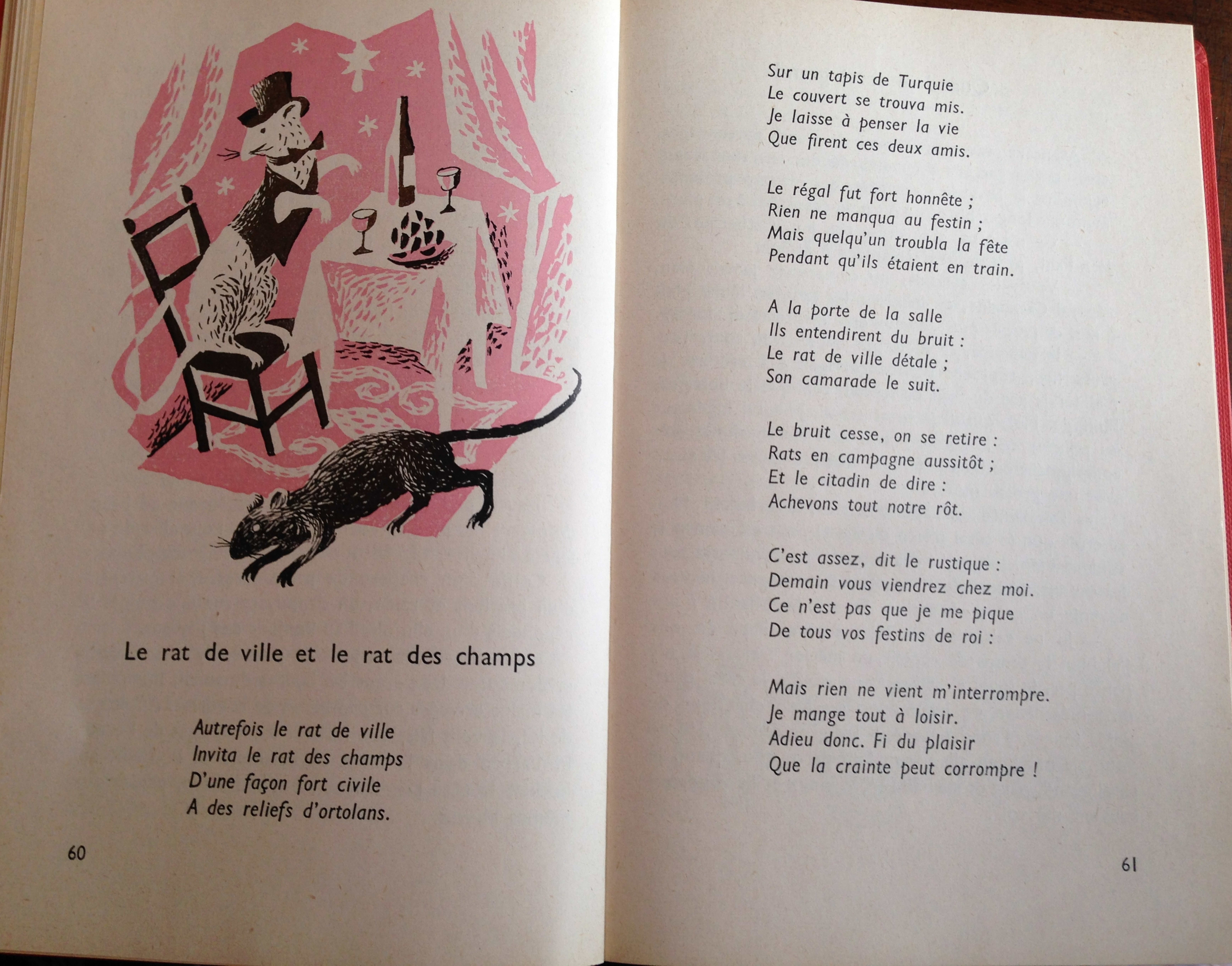
Figure 7: Illustration de la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (Lecture et poésie 1955: 60)
Quelques exceptions peuvent être relevées lorsque les images qui illustrent des textes de fiction ouvrent sur l’imaginaire. Comme on le voit dans la figure 7 extraite du manuel fribourgeois pour le degré moyen, la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (1955: 60-61) est illustrée par deux rats, dont l’un est assis à une table et habillé d’un haut-de-forme et d’un gilet, alors que l’autre, à quatre pattes et de couleur noire, n’a aucun attribut civilisé. Le contraste entre les deux animaux sert à saisir la comparaison qui fait l’objet de la fable. Ce contraste demande aussi une capacité d’interprétation qui n’est soutenue par aucune consigne ou légende.
Nonobstant ces dessins particuliers et les tableaux reproduits dans le manuel bernois de 1964, la majorité des images réalistes ont une fonction référentielle qui participe à canaliser l’imagination (Perret 2019: 104) vers la réalité connue des élèves. Roller souligne effectivement qu’elle tient le rôle de medium entre l’élève et la réalité:
L’image met l’enfant en présence du réel et il importe que cette rencontre soit telle que ce même enfant réagisse «comme si» la réalité concrète s’offrait véritablement à son regard. Si dès lors l’image atteint à ce pouvoir évocateur, c’est qu’elle est devenue document, c’est-à-dire qu’elle est au sens étymologique du terme, instrument d’enseignement (documentum, qui sert à instruire). (Roller 1957: 83)
A Fribourg, en continuité avec les périodes précédentes, les images servent également à garantir la présence du religieux, alors que les textes dans certaines sections des manuels ne traitent pas de la foi. Dans les parties «Notre pays», «La vie à la campagne» ou «Jeux et travaux» du manuel du primaire moyen (1955), figure à chaque fois au moins une représentation d’un établissement religieux. Ainsi, le morceau instructif «Qui construit nos demeures?» et le morceau moral «Demain ou jamais!» sont accompagnés par le dessin de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg (p. 165) alors qu’aucun des deux ne l’évoque ou n’a pour thème la chrétienté.
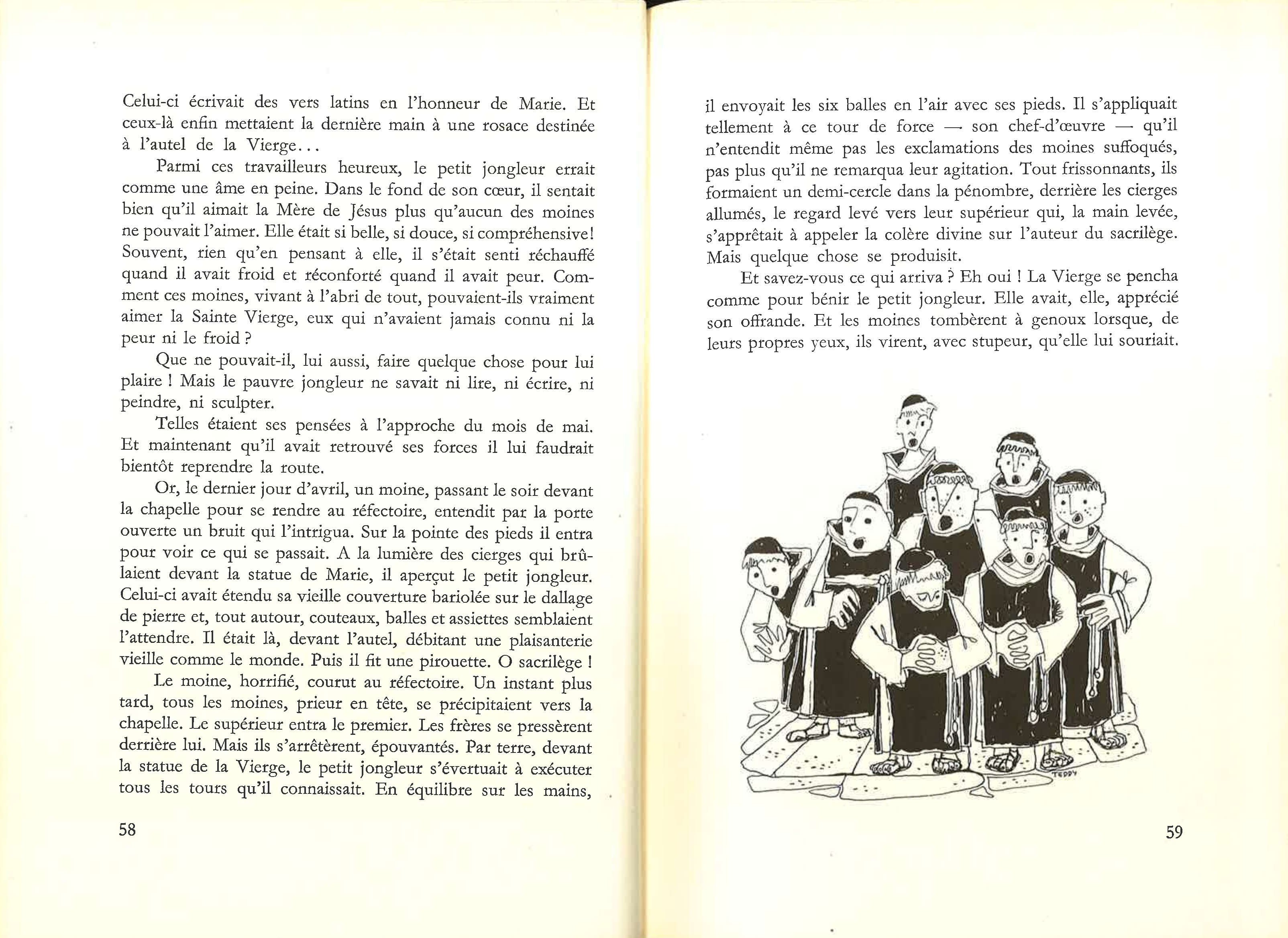
Figure 8: Image accompagnant «Le jongleur de Notre Dame», récit d’un auteur inconnu (Mes lectures 1954: 59)
Sans compter ces représentations réalistes d’établissements religieux, le manuel compte 22 images qui renvoient au catéchisme, à la vie des saints ou à des scènes de la vie chrétienne. Cette fonction religieuse de l’image n’a pas été relevée dans les autres cantons.
Au secondaire, la présence prégnante de l’image dans la société ne paraît pas non plus avoir eu d’impact sur la place donnée à l’image. En effet, les manuels conservent les habitudes éditoriales de la période précédente et cela est assumé explicitement:
Soucieux de fournir avant tout de beaux textes, nous avons renoncé à toute illustration comme à tout commentaire, et réduit les notes à la simple référence aux sources. La plus belle des images ne trahit-elle pas celle que le texte se réserve d’éveiller? Quel commentaire ne pâlit auprès du texte et ne l’encombre? (Pidoux et al. 1945: 5)
La collection de manuels de Kohler fait exception. Elle compte de nombreuses reproductions d’enluminures, de gravures, de miniatures et de portraits d’auteurs. Les images d’origine, contemporaines à l’époque étudiée dans le manuel, contribuent donc à contextualiser les textes littéraires. Leur rôle n’est pas d’illustrer des récits, mais de compléter la culture artistique des élèves relativement aux différentes périodes littéraires. Elles sont par ailleurs légendées, dans le but de permettre aux lecteurs de les situer dans le contexte historique. Ces images s’inscrivent pleinement dans le projet du manuel, qui sert de support pour un enseignement de l’histoire littéraire.
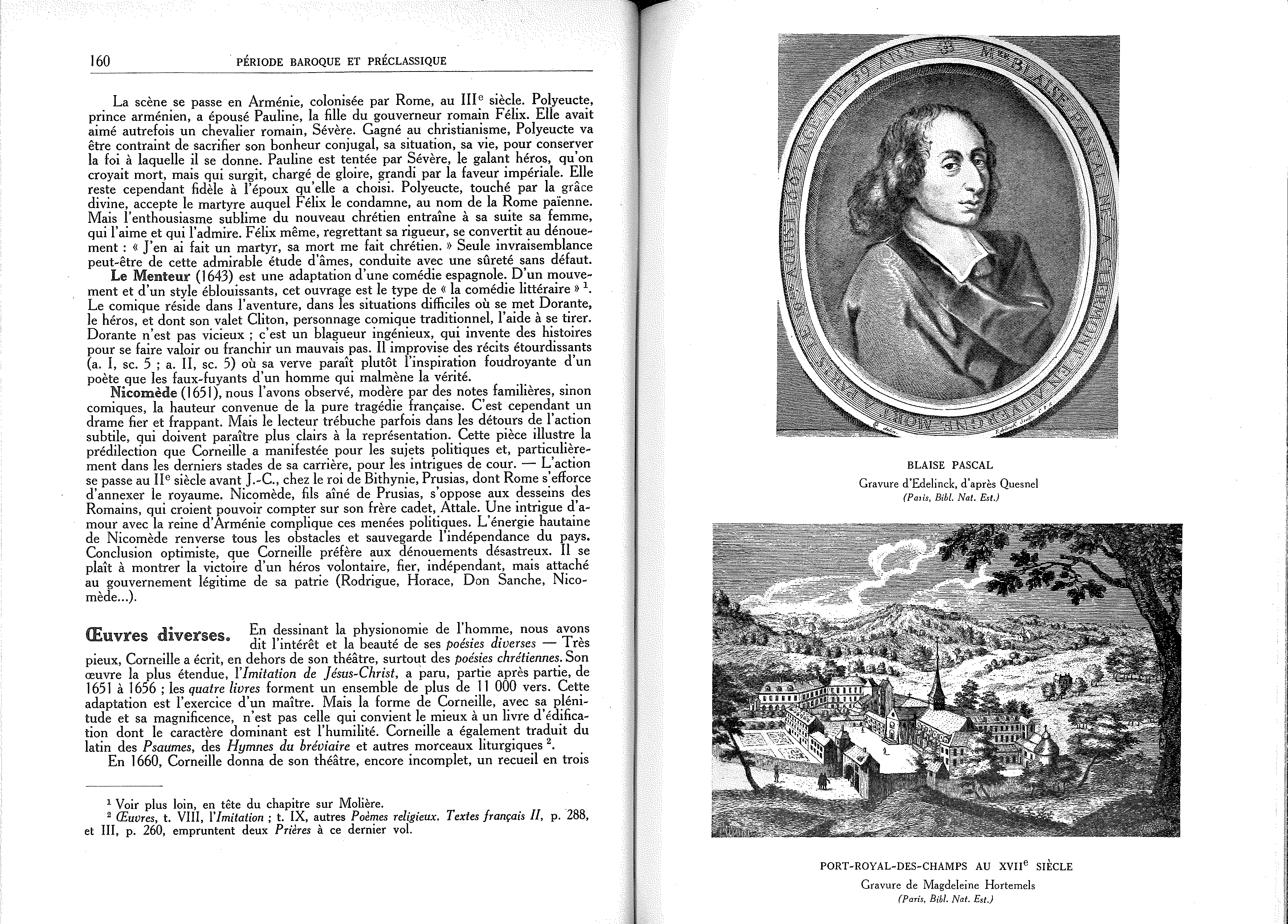
Figure 9: Page extraite du manuel de Kohler (1947: 161)
Ainsi, cette période se situe dans une certaine continuité avec la période précédente, et ce malgré les avancées éditoriales et médiatiques.
Conclusion
Ce parcours historique montre qu’entre les années 1870 et les années 1970, les images se développent largement dans les manuels du primaire, alors qu’elles restent, sauf exception, absentes des anthologies utilisées dans le secondaire, ce dernier restant méfiant à leur égard. Cette méfiance est liée au souci de permettre aux élèves de la filière secondaire d’avoir un accès direct au texte littéraire, sans médiation. On peut s’étonner que l’implosion de l’image dans la société des Trente Glorieuses n’entraîne pas de changements profonds dans l’utilisation des images au secondaire. Pour nous, cette stabilité est à mettre en lien avec un enseignement de la littérature qui, destiné à une élite, reste fondé sur l’histoire littéraire.
Au primaire, une évolution quant à la nature, au statut et à la fonction des images peut être mise en lumière. Entre les années 1870 et les années 1910, les images – essentiellement des gravures qui ne sont pas au départ conçues pour les manuels scolaires – ont une fonction de représentation (en fixant une définition visuelle du référent) et de vecteur de culture, laïque à Genève et Vaud, à connotation religieuse dans les cantons de Berne et de Fribourg. Tout en gardant cette fonction, elles acquièrent à partir du début du XXe siècle une fonction esthétique (en renforçant la dimension artistique et littéraire du manuel, et en participant au développement du goût artistique des élèves), et d'apprentissage (comme adjuvant aux activités de lecture et comme support aux exercices d’élocution). Les dessins conçus par des artistes locaux reconnus - Édouard Elzingre par exemple - viennent en effet illustrer les extraits littéraires, comme dans la littérature de jeunesse. Dès les années 1930-1940, les images – des dessins d’artistes, mais aussi des photographies en noir et blanc, puis progressivement en couleur - gagnent une certaine reconnaissance parmi des pédagogues qui y voient un moyen de documenter la réalité. Cependant, ce rôle qui leur est conféré exclut généralement toute image qui serait de nature abstraite ou qui ouvre à l’interprétation, surtout au degré moyen. Une transformation du statut de l’image intervient donc dans les années 1970, lorsque la littérature scolaire est redéfinie, intégrant la littérature de jeunesse et la bande dessinée, non seulement au primaire, mais aussi au secondaire qui se démocratise.
Bibliographie
Bishop, Marie-France (2017), «Une question de méthode: l’approche historico-didactique en français», in Théories-didactiques de la lecture et de l'écriture: fondements d'un champ de recherche en cheminant avec Yves Reuter, A. Dias-Chiaruttini & C. Cohen-Azria (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Septentrion, p. 225-240.
Buisson, Ferdinand (dir.) (1911), Nouveau dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette.
Chervel, André (1992), «L’école, lieu de production d’une culture», in Analyser et gérer les situations d’enseignement-apprentissage, F. Audigier & G. Baillat (dir.), Paris, INRP, p. 195-198.
Choppin, Alain (2008), «Le manuel scolaire, une fausse évidence historique», Histoire de l'éducation, n° 117, p. 7-56.
Clavien, Alain (2017), Histoire de la presse romande, Lausanne, Éditions Antipodes.
Corsini, Silvio & François Vallotton (2011), «Suisse, histoire du livre et de l’édition», in Dictionnaire encyclopédique du Livre, vol. 3, P. Fouché, D. Péchoin & Ph. Schuwer (dir.), Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 775-778.
Darme-Xu, Anouk, Anne Monnier & Sylviane Tinembart (2020), «L'approche historico-didactique pour penser l'avènement du texte littéraire dans l'enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)», Transpositio, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Denizot, Nathalie (2021), «Transposition, scolarisation et culture scolaire: la question de la construction des savoirs scolaires», Pratiques, n° 189-190, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Denizot, Nathalie (2016),«Le manuel scolaire, un terrain de recherches en didactique? L’exemple des corpus scolaires», Le Français aujourd’hui, n° 194, p. 35-44.
Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthyse (dir.), Paris, Honoré-Champion, p. 9-55.
Gervereau, Laurent (2020), Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La Découverte (URL: https://doi.org/10.3917/dec.gerv.2020.01).
Hameline, Daniel, Arielle Jornod & Malika Lemdani Belkaïd (1995), L'École active: Textes fondateurs, Paris, Presses universitaires de France.
Hébrard, Jean (1988), «La scolarisation des savoirs élémentaires à l'époque moderne», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 7-58, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Henchoz, Louis (1930), «L’illustration des manuels scolaires», L’Éducateur, n° 66,p. 278-282.
Kahn, Pierre (2002), «Histoire d’une leçon de choses», in La leçon de choses: Naissance de l’enseignement des sciences à l’école primaire, P. Kahn, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels: quelle(s) image(s) de la littérature?», Dyptique, n° 37, p. 159-174.
Monnier, Anne (2021), «L’histoire des relations entre l’extrait et l’œuvre littéraire dans l’enseignement du français en Suisse romande (1830-2020)», in L’extrait et la fabrique de la littérature scolaire, A. Belhadjin & L. Perret (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 161-177.
Muller, Christian (2007), Histoire de la structure, de la forme et de la culture scolaires de l’enseignement obligatoire à Genève au XXe siècle (1872-1969), Thèse de doctorat, Université de Genève.
Perret, Laetitia (2018), «Places et rôles des images des manuels dans l’évolution des disciplines scolaires», DIRE, n° 10, p. 89-99, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Perret, Laetitia (2019), «Place et rôle de l'image dans les manuels (1870-1960): point de vue méthodologique», in Le manuel scolaire, objet d'étude et de recherche: enjeux et perspectives, S. Wagnon (dir.), Peter Lang, p. 97-110.
Praz, Anne-Françoise (2005), De l’enfant utile à l’enfant précieux. Filles et garçons dans les cantons de Vaud et Fribourg (1860-1930), Lausanne, Antipodes.
Renonciat, Annie (2009), «De l’Orbis sensualium pictus (1658) aux premiers albums du Père Castor (1931): formes et fonctions pédagogiques de l’image dans l’édition française pour la jeunesse», in La pédagogie par l'image en France et au Japon, M. Simon-Oikawa & A. Renonciat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Roller, Samuel (1957), «De l’image au document: réflexions sur le rôle que l’image peut jouer dans l’enseignement», Annuaire de l’instruction publique en Suisse, n° 48, p. 83-94.
Saint-Martin, Isabelle (2010), «Christianisme», in Dictionnaire mondial des images, L. Gervereau (dir.), Paris, Nouveau Monde.
Schneuwly, Bernard, Thomas Lindauer, Anouk Darme, Julienne Furger, Anne Monnier, Rebekka Nänny & Sylviane Tinembart (2016), «Enseignement de la langue première “Deutsch” – “Français”, Remarques sur l'histoire de la discipline en Suisse (~ 1840 à ~ 1990)” dans une perspective comparative», Forumlecture, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Vollenweider, Emmanuelle (en cours), Histoire de la lecture de textes littéraires enseignée aux élèves. Analyse des représentations (1880-1980), Thèse de doctorat, Université de Genève.
Annexes
- Sources utilisées pour le primaire
Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte (ou page) par manuel |
Genève | Programme de l’enseignement dans les écoles enfantines et dans les écoles primaires, 1889. Programme de l’enseignement dans les écoles primaires, 1923. Plan d’études de l’école primaire, 1942. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1951. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1966. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Gavard, Alexandre (1893), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires de Suisse romande. Degré intermédiaire, Genève, C.-E. Alioth. Dussaud, Bernard & Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Mercier, Louis & Marti, Adolphe (1911), Livre de lecture à l’usage du degré supérieur des écoles primaires, Genève, Edition Atar. Marti, Adolphe (1916), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Genève, Edition Atar. DIP GE (1929), J’aime lire. Livre de lecture destiné à la 4ème année de l’école primaire du canton de Genève. Genève, DIP. DIP GE (1940, réimpression de 1955), Fleurs coupées,Choix de textes littéraires pour le 6e degré de l’école primaire, Genève, DIP. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Gavard (1893): 92 images / 236 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Mercier & Marti (1911): 106 images / 277 textes Marti (1916): 60 images / 231 textes DIP GE (1929): 60 images / 140 textes DIP GE (1940/1955): 55 images / 251 textes |
Vaud | Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires, 1899. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1926. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1935. Plan d’études et instructions générales pour les classes primaires supérieures, 1937. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1953. Plan d’études et instructions générales pour les Ecoles enfantines et les Ecoles primaires du canton de Vaud, 1960. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dussaud, Bernard, Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Borgeaud. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur. Bonjour, Émile, (1925), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Degré intermédiaire, Lausanne, librairie Payot. Bonjour, Émile & Jeanrenaud, Henri (1931), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Payot. Foretay, Charles (1944), Lectures à l'usage du degré moyen des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. Foretay, Charles & Jeanrenaud, Henri (1946), Lectures à l'usage du degré supérieur des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Dupraz & Bonjour (1899): 0 image / 244 textes Dupraz & Bonjour (1903): 0 image / 266 textes Bonjour (1925): 50 images / 215 textes Bonjour & Jeanrenaud (1931): 67 images / 244 textes Foretay (1944): 89 images / 185 textes Foretay & Jeanreneaud: 31 images / 250 textes |
Fribourg | Programme général des écoles primaires du canton de Fribourg, 1899. Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932. Écoles françaises de Fribourg, programme 1949-1950. Guide et plan d’études, 1967, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg avec approbation de la commission des études, Lausanne, L. Vincent. DIP FR (1889), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1899), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1925), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Fribourg, DIP. DIP FR (1934), Mes lectures. Écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Fribourg, DIP. DIP FR (1955), Lecture et poésie: Livre de lecture, degré moyen des écoles primaire, Fribourg, DIP. DIP FR (1954, nouvelle édition), Mes lectures. Degré supérieur des écoles primaires du canton de Fribourg, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881): 49 images / 259 textes DIP FR (1889): 62 images / 222 textes DIP FR (1899): 78 images / 252 textes DIP FR (1925): 123 images / 189 textes DIP FR (1934): 75 images / 200 textes DIP FR (1955): 126 images / 205 textes DIP FR (1954): 81 images / 193 textes |
Berne | Plan d’enseignement pour les écoles primaires du canton de Berne, 1878, Schuler, Berne. Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Berne, 1925, H. Kramer, Tavannes. Plan d’études pour les écoles primaires de langue française du canton de Berne, Edition provisoire, 1968, Berne, Librairie de l’État. | DIP BE (1885), Le Trésor de l’écolier.Livre de lecture à l’usage des écoles primaires françaises du canton de Berne. Degré supérieur, Lausanne, librairie Payot. Gobat, Henri & Allemand, Fritz (1911), Livre de lecture destiné aux écoles primaires du Jura bernois. Cours moyen (8e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel (1927), Notre camarade. Choix de lectures à l’usage des écoles primaires. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Bessire, Paul-Otto (1931), L’écolier jurassien. Choix de lectures à l’usage des écoles supérieures. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Jeanprêtre, Charles, Monnerat, Joseph, Stähli, Roland, Terrier, Pierre & Zbinden, Jean (1961), Horizons nouveaux. Livre de lecture à l’usage des cinquième et sixième années scolaires, Berne, Libraire d’État. Devain, Henri, Henry, Pierre, Pecaut, Armand, Pellaton, Jean-Paul & Stähli, Roland (1964), Les belles années: livre de lecture à l’usage du degré supérieur de l’école primaire, Berne, Librairie d’État. | DIP BE (1885): 13 images / 392 textes Gobat & Allemand (1911): 178 images / 299 textes Marchand (1927): 37 images / 253 textes Bessire (1931): 0 image / 249 textes Jeanprêtre et al. (1961) 17 images / 200 textes Devain et al. (1964): 16 images / 167 textes |
2. Sources utilisées pour le secondaire
Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte par manuel |
Genève | Programme pour l’année 1901-1902, École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1901, Genève, Paul Richter. Programme d’enseignement pour l’année 1900-1904, Collège de Genève, 1900, Genève, DIP. Programme pour l’année 1923-1924. École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1923, Genève, Klein. Programme pour l’année 1925-1926, Collège de Genève, 1925, Genève, Klein. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1962, Genève, DIP. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1977-1978, Genève, DIP. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes |
Vaud | Programme de l’année scolaire 1873-1874 pour le collège cantonal, l’école industrielle et les collèges communaux du canton de Vaud. Collège cantonal, Programmes des cours, année scolaire 1877-1878. Collège cantonal, Programme des cours, année scolaire 1896-1897. Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud, 1910. Collèges et gymnase scientifiques cantonaux, Renseignements, année scolaire 1921-1922. Collège classique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1922-1923. Collège scientifique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1935-1936. Collège classique cantonal. Programme des cours, année scolaire 1936-1937. Programmes des cours des collèges secondaires vaudois, 1960. Programmes des cours des collèges secondaires, 1971. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre (1948), Histoire de la littérature française. Tome 2. Du milieu du XIXe siècle à nos jours avec une histoire de la littérature romande. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre, Guisan, Gilbert & Pidoux, Edmond (1949), Histoire de la littérature française. Tome 3. Le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image/132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages Kohler (1948): 31 images / 564 pages Kohler et al. (1949): 31 images / 806 pages |
Fribourg | Programme des études du Collège St-Michel à Fribourg pour l'année scolaire 1881-1882. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des filles de la ville de Fribourg pour l’année 1882-1883. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1901-1902. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des jeunes filles de la ville de Fribourg pour l’année 1901-1902, Programme pour l’année scolaire 1902-1903. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1912-1913. Compte-rendu de l’Ecole Secondaire des Jeunes Filles de la ville de Fribourg pour l’année 1912-1913, Programme pour l’année scolaire 1913-1914. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1922-1923. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1923-1924. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1938-1939. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1951-1952. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1965-1968. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1970-1973. | Broeckaert, Joseph (1869), Modèles français recueillis d'après le plan du guide du jeune littérateur avec des remarques propres à en faciliter l'étude, vol. 1, Bruxelles, H. Goemaere. Lebaigue, Charles (1887), Morceaux choisis de littérature française. Auteurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (prose et poésie) avec remarques et questions. Deuxième année, Paris, Librairie classique E. Belin. Lebaigue, Charles (1889), Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) avec remarques et questions. Première année (2e éd.), Paris, Librairie classique E. Belin. Des Granges, Charles-Marc (1910), Histoire de la littérature française à l'usage des classes de Lettres et de divers examens (3e éd.), Paris, Hatier. Des Granges, Charles-Marc (1917), Morceaux choisis des auteurs français du Moyen âge à nos jours (842-1900) préparés en vue de la lecture expliquée. Classes de lettre 2e cycle (9e éd.), Paris, Hatier. Procès, Edmond (1927), Modèles français extraits des meilleurs écrivains avec notices. Cours inférieur (12e éd.), Bruxelles: Albert Dewit. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest, & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Broeckaert (1869): 0 image / 223 textes Lebaigue (1887): 0 image / 158 textes Lebaigue (1889): 0 image / 140 textes Des Granges (1910): 0 image / 927 pages Des Granges (1917): 0 image / 504 textes Procès (1927): 23 images / 206 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages |
Berne | Programme de l’école cantonale de Porrentruy, 1897. Programme d’enseignement. Progymnase, gymnase, section commerciale, École cantonale de Porrentruy, 1929, Porrentruy, «Le Jura S.A.». Plan d’études des écoles secondaires et progymnases de langue française, 1961. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Marchand, Marcel (1917), Notre ami, lectures françaises à l’usage des écoles secondaires (2e éd.),Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1937), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1938), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes supérieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1943), Notre ami III. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des écoles progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Marchand (1917): 0 image / 258 textes Marchand et al. (1937): 0 image / 94 textes Marchand et al. (1938): 0 image / 88 textes Marchand et al. (1943): 0 image / 205 textes |
Pour citer l'article
Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider, Anouk Darme-Xu , "Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970) ", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/les-images-dans-les-livres-de-lecture-et-les-anthologies-scolaires-suisse-romande-1870-1970
Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations. Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes. Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature».
Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
Redéfinir le sens: l’intégration des médiations texte/image dans l’enseignement de la littérature
Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations (Demougin, 2002; Delbrassine, 2019). Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes (Peirce, 1978). Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature» (Baroni & Turin 2021).
Cette problématique s’inscrit dans les fondements de la sémiotique, qui a étendu les principes de la linguistique structurale à d’autres formes de signification, comme les publicités (Barthes, 1964; Eco, 1972), les œuvres picturales (Marin, 1969), les bandes dessinées (Peeters, 2009), les films (Metz, 2014) ou encore les images diagrammatiques (Bertin, 2013). Ce cadre a permis de conceptualiser une pluralité de «langages visuels», reflétant la diversité des pratiques médiatiques.
De l’image-illustration à l’image-texte: perspective historique
Dans le cadre scolaire, l’articulation entre texte et image ne va pas de soi, dans la mesure où l’image est un objet à la fois attractif et énigmatique. Attractif, parce que sa lecture est immédiate et joue avec les émotions ; énigmatique, dans le sens où, en tant qu’icône, l’image délivre un message qui n’est pas net et doit être décodé par le lecteur (Peirce, 1978).
Il n’en demeure pas moins que la place et le statut de l’image s’inscrivent dans une longue tradition pédagogique, même si les finalités qui lui ont été assignées ont évolué au fil du temps, comme le montrent Ferran et al. (2017). Ces derniers rappellent que Comenius, au XVIIe, crée des ouvrages qui contiennent des gravures accompagnées de petites légendes, avec l’idée selon laquelle il faut «voir pour savoir». Dès le XVIIIe le nouveau marché de la littérature de jeunesse va recourir à l’illustration pour favoriser sa diffusion. Avec l’instauration de l’école obligatoire pour tous à la fin du XIXe siècle, l’image est introduite dans les manuels, avec l’idée de rendre le savoir accessible à tous les milieux, y compris les plus populaires. Les développements techniques, notamment l’arrivée de la photographie, vont également transformer le statut de l’image. On passe progressivement des planches pédagogiques à la reproduction de documents authentiques qui sont désormais étudiés pour eux-mêmes ou en lien avec un extrait de texte (Ferran et al., 2017).
En Français, l’arrivée des finalités communicationnelles dans les années 1980, en France (Demougin, 2002) comme en Suisse romande (Darme-Xu et al., 2020), fait de l’image un «genre de texte» qu’il s’agit de lire :
Lire c’est prendre connaissance d’un message qu’on a sous les yeux. Ainsi, au sens large, toute communication visuelle suppose de quelque manière une lecture, qu’il s’agisse d’une simple image, d’images avec textes ou de textes proprement dit. (DIP 1980: p. 14 1)
Cette nouvelle manière d’appréhender l’image entraine l’arrivée de nouvelles activités dans lesquelles texte et image, désormais placés sur un pied d’égalité, sont mis en regard l’un de l’autre, comme dans l’exemple ci-dessous tiré des Activités sur les textes pour les élèves de 15 ans (DIPC 1987: p. 132):
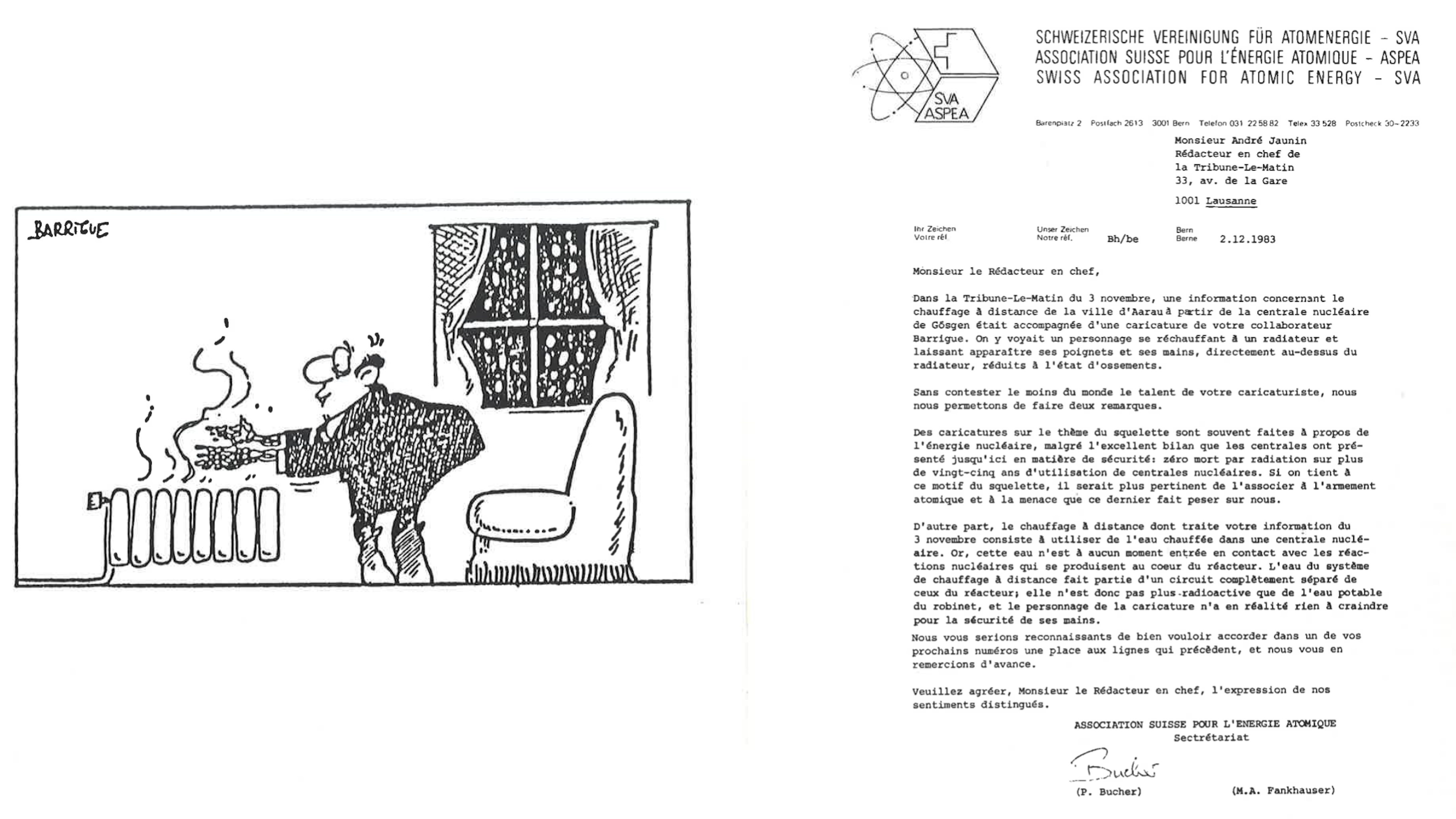
Dans cet atelier destiné à travailler avec les élèves l’argumentation, la caricature du dessinateur humoristique français Barrigue est posée en regard d’une lettre de l’Association suisse pour l’énergie atomique qui conteste l’information parue dans la Tribune-Le-Matin. Le contenu de cette lettre est le suivant:
Monsieur le rédacteur en chef,
Dans la Tribune-Le-Matin du 3 novembre, une information concernant le chauffage à distance de la ville d’Aarau à partir de la centrale nucléaire de Gösgen était accompagnée d’une caricature de votre collaborateur Barrigue. On y voyait un personnage se réchauffant à un radiateur et laissant apparaître ses poignets et ses mains, directement au-dessus du radiateur, réduits à l’état d’ossements.
Sans contester le moins du monde le talent de votre caricaturiste, nous nous permettons de faire deux remarques.
Des caricatures sur le thème du squelette sont souvent faites à propos de l’énergie nucléaire, malgré l’excellent bilan que les centrales ont présenté jusqu’ici en matière de sécurité: zéro mort par radiation sur plus de vingt-cinq ans d’utilisation de centrales nucléaires. Si on tient à ce motif du squelette, il serait plus pertinent de l’associer à l’armement atomique et à la menace que ce dernier fait peser sur nous.
D’autre part, le chauffage à distance dont traite votre information du 3 novembre consiste à utiliser de l’eau chauffée dans une centrale nucléaire. Or, cette eau n’est à aucun moment entrée en contact avec les réactions nucléaires qui se produisent au cœur du réacteur. L’eau du système de chauffage à distance fait partie d’un circuit complètement séparé de ceux du réacteur; elle n’est donc pas plus radioactive que l’eau potable du robinet, et le personnage de la caricature n’a en réalité rien à craindre pour la sécurité de ses mains.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder dans un de vos prochains numéros une place aux lignes qui précèdent, et nous vous en remercions d’avance.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’expression de nos sentiments distingués.
ASSOCIATION SUISSE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE, Secrétariat, (F. Bucher) (M.A. Fankhauser)
Comme on peut le constater ici, c’est moins l’image qui est subordonnée à la compréhension et à l’interprétation du texte que la lettre qui aide à «lire» l’image, dans la mesure où elle décrit précisément ce qu’on voit et donne le contexte.
L’intégration de la littérature comme composante de la langue première dès les premiers degrés de la scolarité au tournant des années 2000 ramène la question des relations entre texte et image au sein de l’enseignement de la littérature.En Suisse romande, ces liens font l’objet de recommandations précises de la part de la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP 2006). La littérature y est définie comme englobant des œuvres telles que les films et bandes dessinées, nécessitant de fait «le développement d’une pédagogie de l’image et des médias» (CIIP 2006, p.40). Il s’agit donc, dès l’entrée dans l’écrit, de mettre l’élève au contact des livres (CIIP 2006, p.23), en l’amenant progressivement à différencier le texte de l’image et à réfléchir aux liens entre ces deux composantes (CIIP 2006, p.38). Ces recommandations se concrétisent dans le plan d’études romand (PER 2010) qui couvre l’ensemble de la scolarité obligatoire, par une attention à porter sur les liens entre texte et image «dans un album, sur une affiche, ...» (PER 2010, L1 15), en vue de donner à l’élève des clés pour apprécier des ouvrages littéraires variés.
Cependant, comme le relève Duvin-Parmentier (2020), force est de constater que les enseignant·es expriment aujourd’hui des difficultés à didactiser la lecture de l’image. Autrement dit, la place, le rôle et la fonction de l’image dans l’enseignement du Français demeurent encore souvent équivoques pour les enseignant·es, qui ne se sentent pas formé·es pour faire découvrir aux élèves la «grammaire de l’image» par l’analyse de formes iconiques variées.
État de la question du point de vue des recherches en didactique de la littérature
Cette intégration de la littérature comme objet d’enseignement dès les premières années de la scolarité, conjuguée à l’essor de la révolution numérique offrant un accès sans précédent à une multitude d’images, a ainsi conduit à un renouvellement des recherches en didactique de la littérature. Ces travaux explorent notamment les frontières médiatiques de la littérature et interrogent l’hétérogénéité des supports mobilisables en classe, au-delà des formes strictement textuelles. Les interactions entre littérature et arts (Chabanne, 2018), l’analyse des albums pour la jeunesse (Lépine, 2012 ; Leclaire-Halté, 2014; Specogna, 2015; Delbrassine, 2019), des œuvres multimodales (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2012) ou encore de la littérature nativement numérique (Acerra, 2017; Brunel, 2021), ainsi que les dynamiques de circulation intermédiatique (Castagnet-Caignec, 2021) sont autant de domaines d’investigation en plein développement. Ces recherches participent à l’élargissement des objets d’étude en littérature, tout en invitant à repenser les objectifs, les méthodes et les corpus mobilisés dans l’enseignement.
En parallèle, les études récentes sur la bande dessinée (Baroni, 2018; Rouvière, 2012; Raux, 2023) offrent des perspectives particulièrement enrichissantes, notamment parce qu’elles conduisent à interroger les limites traditionnelles de la littérature. Cependant, comme l’ont souligné Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), il subsiste un important travail de formation à destination des enseignant·es, visant à leur permettre de développer des gestes interprétatifs adaptés, en prenant en compte la complexité propre à ce médium hybride qui articule dimensions textuelles et graphiques.
Ce numéro a, quant à lui, pour ambition d'examiner différentes perspectives d'analyse, en s'attachant d'abord à retracer l'évolution historique des interactions entre texte et image et leur institutionnalisation dans les pratiques scolaires, avant de mettre l'accent sur des approches didactiques diversifiées, ainsi que sur des observations empiriques effectuées en milieu scolaire. Il apparaît que l'interaction entre texte et image ne compromet pas le sens intrinsèque de l'un ou de l'autre, mais le reconfigure, ou encore le réinterprète, en fonction du contexte inédit dans lequel il s'inscrit.
S’interroger sur les transformations de la relation texte-image à l’heure du numérique (et sur leurs conséquences pour l’enseignement de la littérature) implique de revisiter une histoire complexe, pour reconnaître les héritages et évaluer la nouveauté qui se fait jour dans les pratiques contemporaines.
On se demandera notamment comment la relation texte-image, jusqu’à son renouveau dans les pratiques numériques, peut revivifier l’enseignement de la littérature. Quel rôle peut jouer l’imbrication du texte et de l’image aujourd’hui pour stimuler les productions écrites des élèves ou leur travail de lecture et d’interprétation?
Nous nous proposons d’interroger les relations qu’entretiennent littérature et image selon les axes suivants:
Axe 1. Enjeux pédagogiques et didactiques des éditions illustrées dans l'enseignement
Ce premier axe vise à mettre en avant à la fois les pratiques pédagogiques spécifiques liées aux éditions illustrées et les questionnements didactiques qui en découlent. Pourquoi privilégier, en tant qu’enseignant·e, une édition illustrée d’une œuvre donnée? Quels dispositifs didactiques mettre en œuvre? Avec quels apprentissages potentiels pour les élèves?
Jan Baetens se penche sur cette question en prenant le cas de Proust et des illustrations dont son œuvre a fait l’objet. Il note que, si enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche du temps perdu semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, il n’en est rien: le critique analyse les difficultés sous-jacentes à ce choix pédagogique et les moyens d’y remédier, en prenant notamment en compte l’absence d’homogénéité de cette iconographie et la complexité de la culture visuelle en place.
Partant d’une expérience pratiquée en classe de terminale dans l’enseignement belge, Daniel Delbrassine montre comment l’approche en parallèle de deux genres d’un même récit, produits par le même auteur au même moment, permet de mettre en lumière les spécificités et contraintes de chacun des genres. Cette comparaison représente selon lui une étape indispensable pour préparer l’élève à la transposition de genre, tout en lui permettant d’acquérir des outils clés pour affiner ses compétences d’analyse en vue des lectures ultérieures.
Barbara Hurni-Siegrist, quant à elle, aborde la question de l’articulation entre texte et illustration par le biais d’éditions numérisées des Fables de La Fontaine auprès d’élèves du degré secondaire à Genève. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes permet de mieux appréhender les compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de Français.
Axe 2. Les manuels scolaires à l'ère de l’image : histoire, fonctions et usages pédagogiques
Ce deuxième axe explore la place et la fonction des images dans les manuels scolaires destinés à l’enseignement du Français. Les articles présents se concentrent sur la diversité des images présentes dans ces manuels – allant des photographies aux caricatures en passant par les représentations de tableaux et les bandes dessinées – et leur rôle à la fois dans l’attractivité du matériel pédagogique et dans l’atteinte des objectifs didactiques. Les auteurs analysent aussi bien l’évolution des relations entre texte et image dans les manuels scolaires à travers l’histoire que l’exploitation des adaptations cinématographiques dans les manuels français ou l’usage des images dans le cadre de séquences d’enseignement de fictions historiques pour la jeunesse.
L’article d’Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider et Anouk Darme-Xu retrace les rapports entre texte et image dans les manuels de lecture et les anthologies scolaires édités en Suisse romande entre 1870 et 1970. Il montre comment l’image donne à voir une représentation de la littérature scolarisée qui diffère en fonction des périodes et des publics d’élèves visés.
Hélène Raux porte son attention sur les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels français pour le collège et propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? comment est organisée la mise en relation entre texte et film? et enfin dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre?
Diane Boër analyse deux séquences d’enseignement basées sur des fictions historiques pour la jeunesse. Elle observe que la transposition didactique interne, médiée par l’enseignant·e, ne s’aligne pas toujours sur la transposition didactique externe, proposée par l’édition. Ainsi, en classe, les images sont principalement utilisées pour soutenir la compréhension du texte par les élèves, indépendamment des volontés éditoriales.
AXE 3. Enjeux didactiques de la compréhension visuelle dans l’approche des textes littéraires par les élèves
Ce dernier axe explore l’utilisation de l’image dans l’enseignement de la littérature, en particulier sa fonction dans la compréhension, l’analyse et l’interprétation des textes littéraires, que ce soit dans les genres de l'album illustré, de la littérature jeunesse, du roman ou de la poésie. Il s’agit de comprendre comment les mots et le texte se donnent à voir et comment l’image s’écrit en littérature, en explorant les relations concrètes des textes (notamment poétiques) et de l’image depuis le XIXe siècle jusqu’aux créations contemporaines. L’accent est mis sur les méthodes pédagogiques permettant aux élèves d’intégrer les images dans leur lecture. En s'appuyant sur plusieurs études de cas, cette partie questionne la pertinence et les limites de la lecture d’image en tant que médiation, notamment lorsqu’il s’agit d’œuvres picturales, où les codes visuels diffèrent des structures linguistiques. Il met également en lumière des pratiques pédagogiques concrètes et innovantes, telles que l’utilisation de programmes d’intelligence artificielle pour générer des images à partir de textes littéraires.
Marie-Sylvie Claude traite ici d’un paradoxe inhérent à la lecture de l’image lorsque celle-ci est une œuvre picturale. En effet, les programmes de français du lycée en France encouragent les enseignant·es à utiliser la lecture de l’image comme médiation pour les enseignements en lecture de la littérature. Or l’institutionnalisation scolaire d’une œuvre picturale n’est pas sans poser problème dans la mesure où un tableau ne se «lit»pas – les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits ne faisant pas l’objet d’un encodage de type linguistique. La critique met notamment en garde contre les assimilations hâtives qui appliquent au visuel des termes appartenant à la terminologie linguistique.
L’article de Maud Lebreton Reinhard et Florence Aubert présente un extrait du matériel pédagogique qu’elles ont élaboré à l’attention des enseignant·es du primaire et du secondaire 1 pour travailler l’image au sein d’albums illustrés. Prenant appui sur l’iconotexte Corrida de Yann Fastier, il met en lumière la nécessité de considérer à part égale le rôle du texte et des images dans la production de sens.
L’article de Eleonora Acerra, Sylvain Brehm et Nathalie Lacelle porte sur une expérience dans laquelle les élèves sont invités à générer une image par un programme d’intelligence artificielle à partir d’une citation choisie librement au sein d’un corpus d’œuvres littéraires proposé. L’analyse porte d’une part sur les attentes des élèves, d’autre part sur leur capacité à porter un regard esthétique et critique sur les productions du logiciel.
Conclusion
L’approche adoptée dans ce dossier a consisté à donner la parole aux didacticien·nes ainsi qu’aux expert·es des médias, de la littérature et de l’histoire culturelle, afin qu’ils et elles analysent la relation complexe, à la fois mémorielle, imaginaire et historique, qui unit texte et image. Leurs articles couvrent différents degrés, du primaire à l’université, et différents systèmes éducatifs – la Suisse romande, la Belgique, la France ou le Québec.
Ces articles, chacun à leur manière, mettent en évidence que la signification originale d’un texte ou d’une image n’est pas altérée par l’interaction entre ces deux médiums, mais plutôt ajustée et potentiellement réinterprétée en fonction de son nouveau contexte de diffusion. La manière dont l’ensemble des contributions interrogent cette relation conduit finalement à une réflexion sur ce qu’on met sous le terme de «littérature», tant en tant que pratique sociale qu’en tant qu’objet d’enseignement. Les relations entre objet textuel et objet iconique développées dans ce numéro ouvrent ainsi de nouvelles pistes pour l’enseignement de la littérature.
Bibliographie
Baroni, Raphaël & Turin, Gaspard (2021), "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n° 4, Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, en ligne, consulté le 6 décembre 2024.
Baroni, Raphaël & Goudmand, Anaïs (dir.) (2018), «Les avatars du chapitre dans la bande dessinée», Cahiers de narratologie, n° 34, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.8662)
Barthes, Roland, «Rhétorique de l’image» (1964), Communications, n° 4, p. 40-51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024.
Bertin, Jacques (2013), Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, Éd. de l’EHESS.
Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818)
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2006). Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations. Neuchâtel, CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2010). Plan d’études romand. Neuchâtel, CIIP, en ligne, consulté le 3 décembre 2024, URL : https://portail.ciip.ch/per/domains
Darme-Xu Anouk, Monnier Anne, Schneuwly Bernard & Tinembart Sylvianne (2020), «Émergence de la didactique du français et rénovation de l’enseignement en Suisse romande (1970-1990)», in Diffusion et influences des recherches en didactique du Français, O. Tremblay, E. Falardeau, P. Boyer & I. Gauvin (dir.), Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 203-222.
Delbrassine, Daniel (2019). «L’album pour enfants entre texte et image», Textyles, n° 57, p. 139-156.
Demougin, Françoise (2002), «Littérature et image: d’une lecture à l’autre», Tréma, n° 19, p. 1-11.
Département de l’Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud (1987), Activités sur les textes, Français 9ème, Lausanne, Éd. Loisirs et Pédagogie SA.
Département de l’Instruction publique (DIP) du canton de Genève (1980), Méthodologie de la lecture, 7e, 8e, 9e, Maître I. Genève, DIP.
Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n° 187-188, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.
Eco, Umberto (1972), La structure absente, Paris, Mercure de France.
Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthuyse (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 9-55.
Guillou Marlène & Claudine Dubois (dir.) (2009), Des images pour lire et pour écrire, SCÉRÉN CRDP Nord – Pas de Calais.
Lacelle, Nathalie & Monique Richard (2020), Croiser littératie, art et culture des jeunes, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Lacelle, Nathalie (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Leclaire-Halté, Anne (2014), «Valeurs et rapport texte/image dans l’album de littérature de jeunesse: étude d’un exemple, Le Génie du pousse-pousse», Pratiques, n° 163-164, en ligne, consulté le 22 février 2023.
Marin, Louis (1969), «Éléments pour une sémiologie picturale», Les Sciences humaines et l’œuvre d’art, Bruxelles, Éd. La Connaissance, «Témoins et témoignages», p. 109-142.
Metz, Christian (2014), «Existe-t-il une approche sémiologique de l’esthétique ?», 1895. Revue d'histoire du cinéma, n° 70, p. 154-167.
Peeters, Benoît (2009), Écrire l’image, Bruxelles,Éd. Impressions nouvelles, coll. «Réflexions faites».
Peirce, Charles Sanders (1978), Écrits sur le signe, trad. G. Deledalle, Paris, Seuil.
Specogna, Antonietta (2015), «Relation texte-image: pratiques d’enseignement dans les situations de lecture d’albums au cycle 3». Recherches en éducation, n° 22, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.
Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n° 146, p. 131-146.
Pour citer l'article
Zeina Hakim & Anne Monnier, "Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image", Transpositio, n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image, 2024https://www.transpositio.org/articles/view/introduction-n-7-le-texte-litteraire-a-l-epreuve-de-l-image
Voir également :
Sur Facebook