Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations. Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes. Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature».
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- Vanessa Depallens et Sonya Florey - Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande
- Claire Detcheverry - La narratologie transmédiale pour la lecture d’albums jeunesse au primaire
- Sandrine Aeby Daghé & Glaís Sales Cordeiro - Le système récit-personnages: un outil conceptuel pour penser l’enseignement de la compréhension en lecture
- Marie Béguin & Sonya Florey - Renouer avec la passion du récit avec (ou malgré) le schéma narratif au secondaire I
- Vanessa Depallens - Écrire un récit «réussi»: une des finalités de l’école obligatoire vaudoise. Le cas de la description
Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
Introduction n° 7: Le texte littéraire à l’épreuve de l’image
Redéfinir le sens: l’intégration des médiations texte/image dans l’enseignement de la littérature
Notre réflexion sur les interactions entre texte et image dans l’enseignement de la littérature part d’un postulat central: l’image constitue un outil permettant aux élèves de se distancier du texte pour mieux en saisir les significations (Demougin, 2002; Delbrassine, 2019). Toutefois, la relation entre texte et image, loin de se limiter à une simple correspondance analogique dans laquelle l’image serait subordonnée au texte, révèle des processus de production de sens complexes (Peirce, 1978). Ce numéro vise ainsi à explorer les statuts et fonctions possibles de l’image dans l’enseignement de la littérature, se situant dans la continuité du dossier n°4 de Transpositio qui s’intitulait «Enseigner la bande-dessinée comme (de la) littérature» (Baroni & Turin 2021).
Cette problématique s’inscrit dans les fondements de la sémiotique, qui a étendu les principes de la linguistique structurale à d’autres formes de signification, comme les publicités (Barthes, 1964; Eco, 1972), les œuvres picturales (Marin, 1969), les bandes dessinées (Peeters, 2009), les films (Metz, 2014) ou encore les images diagrammatiques (Bertin, 2013). Ce cadre a permis de conceptualiser une pluralité de «langages visuels», reflétant la diversité des pratiques médiatiques.
De l’image-illustration à l’image-texte: perspective historique
Dans le cadre scolaire, l’articulation entre texte et image ne va pas de soi, dans la mesure où l’image est un objet à la fois attractif et énigmatique. Attractif, parce que sa lecture est immédiate et joue avec les émotions ; énigmatique, dans le sens où, en tant qu’icône, l’image délivre un message qui n’est pas net et doit être décodé par le lecteur (Peirce, 1978).
Il n’en demeure pas moins que la place et le statut de l’image s’inscrivent dans une longue tradition pédagogique, même si les finalités qui lui ont été assignées ont évolué au fil du temps, comme le montrent Ferran et al. (2017). Ces derniers rappellent que Comenius, au XVIIe, crée des ouvrages qui contiennent des gravures accompagnées de petites légendes, avec l’idée selon laquelle il faut «voir pour savoir». Dès le XVIIIe le nouveau marché de la littérature de jeunesse va recourir à l’illustration pour favoriser sa diffusion. Avec l’instauration de l’école obligatoire pour tous à la fin du XIXe siècle, l’image est introduite dans les manuels, avec l’idée de rendre le savoir accessible à tous les milieux, y compris les plus populaires. Les développements techniques, notamment l’arrivée de la photographie, vont également transformer le statut de l’image. On passe progressivement des planches pédagogiques à la reproduction de documents authentiques qui sont désormais étudiés pour eux-mêmes ou en lien avec un extrait de texte (Ferran et al., 2017).
En Français, l’arrivée des finalités communicationnelles dans les années 1980, en France (Demougin, 2002) comme en Suisse romande (Darme-Xu et al., 2020), fait de l’image un «genre de texte» qu’il s’agit de lire :
Lire c’est prendre connaissance d’un message qu’on a sous les yeux. Ainsi, au sens large, toute communication visuelle suppose de quelque manière une lecture, qu’il s’agisse d’une simple image, d’images avec textes ou de textes proprement dit. (DIP 1980: p. 14 1)
Cette nouvelle manière d’appréhender l’image entraine l’arrivée de nouvelles activités dans lesquelles texte et image, désormais placés sur un pied d’égalité, sont mis en regard l’un de l’autre, comme dans l’exemple ci-dessous tiré des Activités sur les textes pour les élèves de 15 ans (DIPC 1987: p. 132):
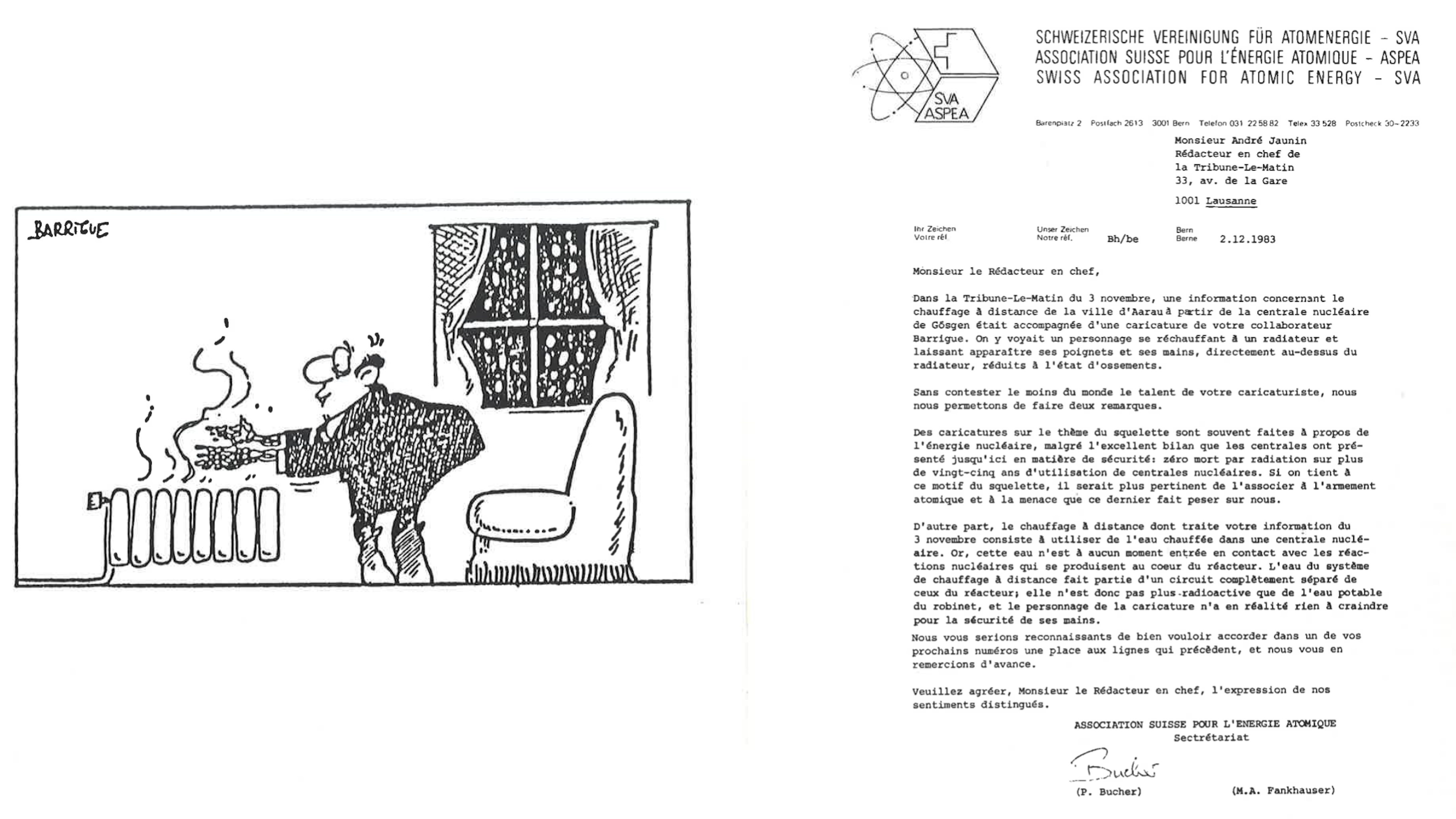
Dans cet atelier destiné à travailler avec les élèves l’argumentation, la caricature du dessinateur humoristique français Barrigue est posée en regard d’une lettre de l’Association suisse pour l’énergie atomique qui conteste l’information parue dans la Tribune-Le-Matin. Le contenu de cette lettre est le suivant:
Monsieur le rédacteur en chef,
Dans la Tribune-Le-Matin du 3 novembre, une information concernant le chauffage à distance de la ville d’Aarau à partir de la centrale nucléaire de Gösgen était accompagnée d’une caricature de votre collaborateur Barrigue. On y voyait un personnage se réchauffant à un radiateur et laissant apparaître ses poignets et ses mains, directement au-dessus du radiateur, réduits à l’état d’ossements.
Sans contester le moins du monde le talent de votre caricaturiste, nous nous permettons de faire deux remarques.
Des caricatures sur le thème du squelette sont souvent faites à propos de l’énergie nucléaire, malgré l’excellent bilan que les centrales ont présenté jusqu’ici en matière de sécurité: zéro mort par radiation sur plus de vingt-cinq ans d’utilisation de centrales nucléaires. Si on tient à ce motif du squelette, il serait plus pertinent de l’associer à l’armement atomique et à la menace que ce dernier fait peser sur nous.
D’autre part, le chauffage à distance dont traite votre information du 3 novembre consiste à utiliser de l’eau chauffée dans une centrale nucléaire. Or, cette eau n’est à aucun moment entrée en contact avec les réactions nucléaires qui se produisent au cœur du réacteur. L’eau du système de chauffage à distance fait partie d’un circuit complètement séparé de ceux du réacteur; elle n’est donc pas plus radioactive que l’eau potable du robinet, et le personnage de la caricature n’a en réalité rien à craindre pour la sécurité de ses mains.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder dans un de vos prochains numéros une place aux lignes qui précèdent, et nous vous en remercions d’avance.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l’expression de nos sentiments distingués.
ASSOCIATION SUISSE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE, Secrétariat, (F. Bucher) (M.A. Fankhauser)
Comme on peut le constater ici, c’est moins l’image qui est subordonnée à la compréhension et à l’interprétation du texte que la lettre qui aide à «lire» l’image, dans la mesure où elle décrit précisément ce qu’on voit et donne le contexte.
L’intégration de la littérature comme composante de la langue première dès les premiers degrés de la scolarité au tournant des années 2000 ramène la question des relations entre texte et image au sein de l’enseignement de la littérature.En Suisse romande, ces liens font l’objet de recommandations précises de la part de la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP 2006). La littérature y est définie comme englobant des œuvres telles que les films et bandes dessinées, nécessitant de fait «le développement d’une pédagogie de l’image et des médias» (CIIP 2006, p.40). Il s’agit donc, dès l’entrée dans l’écrit, de mettre l’élève au contact des livres (CIIP 2006, p.23), en l’amenant progressivement à différencier le texte de l’image et à réfléchir aux liens entre ces deux composantes (CIIP 2006, p.38). Ces recommandations se concrétisent dans le plan d’études romand (PER 2010) qui couvre l’ensemble de la scolarité obligatoire, par une attention à porter sur les liens entre texte et image «dans un album, sur une affiche, ...» (PER 2010, L1 15), en vue de donner à l’élève des clés pour apprécier des ouvrages littéraires variés.
Cependant, comme le relève Duvin-Parmentier (2020), force est de constater que les enseignant·es expriment aujourd’hui des difficultés à didactiser la lecture de l’image. Autrement dit, la place, le rôle et la fonction de l’image dans l’enseignement du Français demeurent encore souvent équivoques pour les enseignant·es, qui ne se sentent pas formé·es pour faire découvrir aux élèves la «grammaire de l’image» par l’analyse de formes iconiques variées.
État de la question du point de vue des recherches en didactique de la littérature
Cette intégration de la littérature comme objet d’enseignement dès les premières années de la scolarité, conjuguée à l’essor de la révolution numérique offrant un accès sans précédent à une multitude d’images, a ainsi conduit à un renouvellement des recherches en didactique de la littérature. Ces travaux explorent notamment les frontières médiatiques de la littérature et interrogent l’hétérogénéité des supports mobilisables en classe, au-delà des formes strictement textuelles. Les interactions entre littérature et arts (Chabanne, 2018), l’analyse des albums pour la jeunesse (Lépine, 2012 ; Leclaire-Halté, 2014; Specogna, 2015; Delbrassine, 2019), des œuvres multimodales (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2012) ou encore de la littérature nativement numérique (Acerra, 2017; Brunel, 2021), ainsi que les dynamiques de circulation intermédiatique (Castagnet-Caignec, 2021) sont autant de domaines d’investigation en plein développement. Ces recherches participent à l’élargissement des objets d’étude en littérature, tout en invitant à repenser les objectifs, les méthodes et les corpus mobilisés dans l’enseignement.
En parallèle, les études récentes sur la bande dessinée (Baroni, 2018; Rouvière, 2012; Raux, 2023) offrent des perspectives particulièrement enrichissantes, notamment parce qu’elles conduisent à interroger les limites traditionnelles de la littérature. Cependant, comme l’ont souligné Marianne Blanchard et Hélène Raux (2019), il subsiste un important travail de formation à destination des enseignant·es, visant à leur permettre de développer des gestes interprétatifs adaptés, en prenant en compte la complexité propre à ce médium hybride qui articule dimensions textuelles et graphiques.
Ce numéro a, quant à lui, pour ambition d'examiner différentes perspectives d'analyse, en s'attachant d'abord à retracer l'évolution historique des interactions entre texte et image et leur institutionnalisation dans les pratiques scolaires, avant de mettre l'accent sur des approches didactiques diversifiées, ainsi que sur des observations empiriques effectuées en milieu scolaire. Il apparaît que l'interaction entre texte et image ne compromet pas le sens intrinsèque de l'un ou de l'autre, mais le reconfigure, ou encore le réinterprète, en fonction du contexte inédit dans lequel il s'inscrit.
S’interroger sur les transformations de la relation texte-image à l’heure du numérique (et sur leurs conséquences pour l’enseignement de la littérature) implique de revisiter une histoire complexe, pour reconnaître les héritages et évaluer la nouveauté qui se fait jour dans les pratiques contemporaines.
On se demandera notamment comment la relation texte-image, jusqu’à son renouveau dans les pratiques numériques, peut revivifier l’enseignement de la littérature. Quel rôle peut jouer l’imbrication du texte et de l’image aujourd’hui pour stimuler les productions écrites des élèves ou leur travail de lecture et d’interprétation?
Nous nous proposons d’interroger les relations qu’entretiennent littérature et image selon les axes suivants:
Axe 1. Enjeux pédagogiques et didactiques des éditions illustrées dans l'enseignement
Ce premier axe vise à mettre en avant à la fois les pratiques pédagogiques spécifiques liées aux éditions illustrées et les questionnements didactiques qui en découlent. Pourquoi privilégier, en tant qu’enseignant·e, une édition illustrée d’une œuvre donnée? Quels dispositifs didactiques mettre en œuvre? Avec quels apprentissages potentiels pour les élèves?
Jan Baetens se penche sur cette question en prenant le cas de Proust et des illustrations dont son œuvre a fait l’objet. Il note que, si enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche du temps perdu semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, il n’en est rien: le critique analyse les difficultés sous-jacentes à ce choix pédagogique et les moyens d’y remédier, en prenant notamment en compte l’absence d’homogénéité de cette iconographie et la complexité de la culture visuelle en place.
Partant d’une expérience pratiquée en classe de terminale dans l’enseignement belge, Daniel Delbrassine montre comment l’approche en parallèle de deux genres d’un même récit, produits par le même auteur au même moment, permet de mettre en lumière les spécificités et contraintes de chacun des genres. Cette comparaison représente selon lui une étape indispensable pour préparer l’élève à la transposition de genre, tout en lui permettant d’acquérir des outils clés pour affiner ses compétences d’analyse en vue des lectures ultérieures.
Barbara Hurni-Siegrist, quant à elle, aborde la question de l’articulation entre texte et illustration par le biais d’éditions numérisées des Fables de La Fontaine auprès d’élèves du degré secondaire à Genève. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes permet de mieux appréhender les compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de Français.
Axe 2. Les manuels scolaires à l'ère de l’image : histoire, fonctions et usages pédagogiques
Ce deuxième axe explore la place et la fonction des images dans les manuels scolaires destinés à l’enseignement du Français. Les articles présents se concentrent sur la diversité des images présentes dans ces manuels – allant des photographies aux caricatures en passant par les représentations de tableaux et les bandes dessinées – et leur rôle à la fois dans l’attractivité du matériel pédagogique et dans l’atteinte des objectifs didactiques. Les auteurs analysent aussi bien l’évolution des relations entre texte et image dans les manuels scolaires à travers l’histoire que l’exploitation des adaptations cinématographiques dans les manuels français ou l’usage des images dans le cadre de séquences d’enseignement de fictions historiques pour la jeunesse.
L’article d’Anne Monnier, Sylviane Tinembart, Emmanuelle Vollenweider et Anouk Darme-Xu retrace les rapports entre texte et image dans les manuels de lecture et les anthologies scolaires édités en Suisse romande entre 1870 et 1970. Il montre comment l’image donne à voir une représentation de la littérature scolarisée qui diffère en fonction des périodes et des publics d’élèves visés.
Hélène Raux porte son attention sur les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels français pour le collège et propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? comment est organisée la mise en relation entre texte et film? et enfin dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre?
Diane Boër analyse deux séquences d’enseignement basées sur des fictions historiques pour la jeunesse. Elle observe que la transposition didactique interne, médiée par l’enseignant·e, ne s’aligne pas toujours sur la transposition didactique externe, proposée par l’édition. Ainsi, en classe, les images sont principalement utilisées pour soutenir la compréhension du texte par les élèves, indépendamment des volontés éditoriales.
AXE 3. Enjeux didactiques de la compréhension visuelle dans l’approche des textes littéraires par les élèves
Ce dernier axe explore l’utilisation de l’image dans l’enseignement de la littérature, en particulier sa fonction dans la compréhension, l’analyse et l’interprétation des textes littéraires, que ce soit dans les genres de l'album illustré, de la littérature jeunesse, du roman ou de la poésie. Il s’agit de comprendre comment les mots et le texte se donnent à voir et comment l’image s’écrit en littérature, en explorant les relations concrètes des textes (notamment poétiques) et de l’image depuis le XIXe siècle jusqu’aux créations contemporaines. L’accent est mis sur les méthodes pédagogiques permettant aux élèves d’intégrer les images dans leur lecture. En s'appuyant sur plusieurs études de cas, cette partie questionne la pertinence et les limites de la lecture d’image en tant que médiation, notamment lorsqu’il s’agit d’œuvres picturales, où les codes visuels diffèrent des structures linguistiques. Il met également en lumière des pratiques pédagogiques concrètes et innovantes, telles que l’utilisation de programmes d’intelligence artificielle pour générer des images à partir de textes littéraires.
Marie-Sylvie Claude traite ici d’un paradoxe inhérent à la lecture de l’image lorsque celle-ci est une œuvre picturale. En effet, les programmes de français du lycée en France encouragent les enseignant·es à utiliser la lecture de l’image comme médiation pour les enseignements en lecture de la littérature. Or l’institutionnalisation scolaire d’une œuvre picturale n’est pas sans poser problème dans la mesure où un tableau ne se «lit»pas – les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits ne faisant pas l’objet d’un encodage de type linguistique. La critique met notamment en garde contre les assimilations hâtives qui appliquent au visuel des termes appartenant à la terminologie linguistique.
L’article de Maud Lebreton Reinhard et Florence Aubert présente un extrait du matériel pédagogique qu’elles ont élaboré à l’attention des enseignant·es du primaire et du secondaire 1 pour travailler l’image au sein d’albums illustrés. Prenant appui sur l’iconotexte Corrida de Yann Fastier, il met en lumière la nécessité de considérer à part égale le rôle du texte et des images dans la production de sens.
L’article de Eleonora Acerra, Sylvain Brehm et Nathalie Lacelle porte sur une expérience dans laquelle les élèves sont invités à générer une image par un programme d’intelligence artificielle à partir d’une citation choisie librement au sein d’un corpus d’œuvres littéraires proposé. L’analyse porte d’une part sur les attentes des élèves, d’autre part sur leur capacité à porter un regard esthétique et critique sur les productions du logiciel.
Conclusion
L’approche adoptée dans ce dossier a consisté à donner la parole aux didacticien·nes ainsi qu’aux expert·es des médias, de la littérature et de l’histoire culturelle, afin qu’ils et elles analysent la relation complexe, à la fois mémorielle, imaginaire et historique, qui unit texte et image. Leurs articles couvrent différents degrés, du primaire à l’université, et différents systèmes éducatifs – la Suisse romande, la Belgique, la France ou le Québec.
Ces articles, chacun à leur manière, mettent en évidence que la signification originale d’un texte ou d’une image n’est pas altérée par l’interaction entre ces deux médiums, mais plutôt ajustée et potentiellement réinterprétée en fonction de son nouveau contexte de diffusion. La manière dont l’ensemble des contributions interrogent cette relation conduit finalement à une réflexion sur ce qu’on met sous le terme de «littérature», tant en tant que pratique sociale qu’en tant qu’objet d’enseignement. Les relations entre objet textuel et objet iconique développées dans ce numéro ouvrent ainsi de nouvelles pistes pour l’enseignement de la littérature.
Bibliographie
Baroni, Raphaël & Turin, Gaspard (2021), "Introduction n°4 - Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature", Transpositio, n° 4, Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature, en ligne, consulté le 6 décembre 2024.
Baroni, Raphaël & Goudmand, Anaïs (dir.) (2018), «Les avatars du chapitre dans la bande dessinée», Cahiers de narratologie, n° 34, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/narratologie.8662)
Barthes, Roland, «Rhétorique de l’image» (1964), Communications, n° 4, p. 40-51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024.
Bertin, Jacques (2013), Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, Éd. de l’EHESS.
Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, en ligne, consulté le 8 décembre 2024. (DOI: https://doi.org/10.4000/trema.4818)
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2006). Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations. Neuchâtel, CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2010). Plan d’études romand. Neuchâtel, CIIP, en ligne, consulté le 3 décembre 2024, URL : https://portail.ciip.ch/per/domains
Darme-Xu Anouk, Monnier Anne, Schneuwly Bernard & Tinembart Sylvianne (2020), «Émergence de la didactique du français et rénovation de l’enseignement en Suisse romande (1970-1990)», in Diffusion et influences des recherches en didactique du Français, O. Tremblay, E. Falardeau, P. Boyer & I. Gauvin (dir.), Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 203-222.
Delbrassine, Daniel (2019). «L’album pour enfants entre texte et image», Textyles, n° 57, p. 139-156.
Demougin, Françoise (2002), «Littérature et image: d’une lecture à l’autre», Tréma, n° 19, p. 1-11.
Département de l’Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud (1987), Activités sur les textes, Français 9ème, Lausanne, Éd. Loisirs et Pédagogie SA.
Département de l’Instruction publique (DIP) du canton de Genève (1980), Méthodologie de la lecture, 7e, 8e, 9e, Maître I. Genève, DIP.
Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n° 187-188, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.
Eco, Umberto (1972), La structure absente, Paris, Mercure de France.
Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthuyse (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 9-55.
Guillou Marlène & Claudine Dubois (dir.) (2009), Des images pour lire et pour écrire, SCÉRÉN CRDP Nord – Pas de Calais.
Lacelle, Nathalie & Monique Richard (2020), Croiser littératie, art et culture des jeunes, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Lacelle, Nathalie (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Leclaire-Halté, Anne (2014), «Valeurs et rapport texte/image dans l’album de littérature de jeunesse: étude d’un exemple, Le Génie du pousse-pousse», Pratiques, n° 163-164, en ligne, consulté le 22 février 2023.
Marin, Louis (1969), «Éléments pour une sémiologie picturale», Les Sciences humaines et l’œuvre d’art, Bruxelles, Éd. La Connaissance, «Témoins et témoignages», p. 109-142.
Metz, Christian (2014), «Existe-t-il une approche sémiologique de l’esthétique ?», 1895. Revue d'histoire du cinéma, n° 70, p. 154-167.
Peeters, Benoît (2009), Écrire l’image, Bruxelles,Éd. Impressions nouvelles, coll. «Réflexions faites».
Peirce, Charles Sanders (1978), Écrits sur le signe, trad. G. Deledalle, Paris, Seuil.
Specogna, Antonietta (2015), «Relation texte-image: pratiques d’enseignement dans les situations de lecture d’albums au cycle 3». Recherches en éducation, n° 22, en ligne, consulté le 15 novembre 2024.
Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n° 146, p. 131-146.
Voir également :
Enseigner Proust illustré
Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même.
Enseigner Proust illustré
Quel Proust?
Enseigner Proust commence par une question simple mais fondamentale: qu’est-ce qu’on peut entendre par «Proust»? Quatre réponses au moins, qui ne s’excluent pas les unes les autres, sont possibles: d’abord l’œuvre, puis l’homme et le contexte historique et culturel qui était le sien, ensuite l’histoire matérielle de son travail, et enfin l’histoire matérielle de ses publications. En simplifiant un peu, ces approches correspondent à quatre domaines de la recherche, aux frontières souvent peu étanches: la stylistique (pour l’étude de l’œuvre), l’histoire littéraire (pour l’étude de l’homme et de son époque), la génétique (pour ce qui est des manuscrits) et l’histoire du livre (pour ce qui est des textes publiés). Chacune de ces options soulève toutefois un certain nombre de problèmes didactiques.
S’agissant de l’œuvre, on peut se demander s’il est permis de réduire le travail de Proust à la seule Recherche, puis cette dernière à quelques extraits plus ou moins artificiellement détachés de l’ensemble, comme cela se fait la plupart du temps. Certains de ces fragments peuvent être très longs, comme Un amour de Swann, roman «autonome» enclavé dans la Recherche; d’autres, qu’on retrouve presque inchangés depuis bientôt cent ans, sont très courts, comme la scène de la madeleine ou la mort de Bergotte. Dans l’un et l’autre cas, il convient de se demander si pareille sélection n’est pas une défiguration de l’écriture proustienne. Quelque chose se gagne (c’est sans doute la seule manière possible de commencer à faire lire Proust à l’école), mais inévitablement le parti pris des morceaux choisis fait aussi perdre quelque chose. L’expérience du temps, si essentielle à une véritable expérience de la Recherche, est difficile à faire passer à travers cette approche anthologique (sur cette question fondamentale, voir Kuentz 1972). Mais comme le but de l’enseignement de Proust est aussi de pousser à faire découvrir l’ensemble de l’œuvre au-delà de ces quelques fragments, il peut être recommandé de confronter les élèves dès le début avec l’«autre» Proust, celui de la correspondance ou celui des pastiches, par exemple, et de pointer déjà vers le va-et-vient entre écriture fictionnelle et autres formes d’écriture. Comme pas mal d’autres auteurs de fiction, Proust n’arrête pas de recycler des textes de non-fiction (les siens et d’autres).
Or, le mot «Proust» ne désigne pas seulement le texte de l’auteur, c’est aussi une longue série de commentaires qui ont fini par faire corps avec la création initiale. La valeur d’une grande œuvre est en effet fonction de la qualité des lectures qu’elle est capable d’engendrer et en ce sens on devrait accepter pour Proust ce qu’on considère comme allant de soi pour Shakespeare ou Dante, à savoir que les analyses de l’œuvre ne sont pas de simples greffes ou ajouts, mais une partie essentielle de l’œuvre même. Lire «innocemment», sans connaissance des interprétations déjà existantes, n’est jamais qu’une illusion. Encourager les élèves à lire Proust implique nécessairement – le contraire serait une mutilation – les inciter à prendre connaissance de la réception de Proust à travers le temps. Je me permets d’insister sur la dimension diachronique de ce geste, pour éviter qu’on ne tombe dans les écueils du présentisme: Proust queer, certes, mais pas seulement. Le livre de Pierre Bayard sur Proust et la poétique de la digression (Bayard 1996) peut rendre ici de vrais services, d’autant plus qu’il permet aussi de réfléchir au geste de l’extraction de morceaux et à l’impossibilité de trancher entre narration (le «sujet») et digression (le «hors-sujet»). L’ouvrage de Bayard a l’avantage de privilégier les grandes questions de l’écriture comme de la lecture du texte proustien: comment donner forme à un univers d’une telle ampleur, comment s’y repérer? que faire de la tension entre le désir de tout dire et de tout lire d’une part et la difficulté de donner sa juste place à tout, c’est-à-dire à ne pas se perdre dans trop de détails (pour l’auteur) et ne pas céder à l’envie de sauter certains passages (pour le lecteur)? De plus, Bayard a aussi l’élégance et la sagesse de ne pas éviter le retour sur des morceaux connus, tout en aidant à décrisper l’écart entre le tout et la partie.
En deuxième lieu, enseigner Proust signifie également enseigner l’auteur et son époque. Ici aussi, les questions qui émergent sont immenses. Faut-il séparer l’homme et l’œuvre? La seule idée de pareil clivage paraît un contresens, mais tel n’a pas toujours été de l’avis des critiques. Même aujourd’hui, à l’époque du biographisme triomphant, il est parfaitement légitime, mais pas forcément toujours possible bien entendu, de lire l’œuvre sans trop tenir compte de l’homme. Et que faut-il entendre par contexte? Comment en circonscrire les extensions littéralement infinies? Comme le remarquait judicieusement Jonathan Culler: «Meaning is context bound, but context is boundless» (Culler 1997: 67). Que faire aussi de la notion d’anachronisme, qui est un des nombreux facteurs cassant l’homogénéité d’un contexte? Après tout, la Recherche évoque un monde qui, au moment de la percée de Proust, juste après la Première Guerre Mondiale, n'existait déjà plus, tandis que sa propre écriture et son grand projet romanesque n’ont rien de «moderne» (au sens de «contemporain»): la Recherche achève la tradition des grandes sommes romanesques du 19e plus qu’elle n’annonce Dada ou le surréalisme, mouvement littéraire soit hostile au roman, soit inventant comme sous le manteau de nouvelles formes de roman (Sermier 2022). Les questions liées à la biographie et à l’analyse contextuelle ne peuvent avoir de réponse concluante. Ne pas les poser n’est toutefois guère souhaitable.
Enfin, troisième approche, sur laquelle j’aimerais me concentrer dans les pages qui suivent, le mot «Proust» peut renvoyer aussi à une série d’objets matériels. Il y a d’abord les manuscrits, auxquels s’intéressent non seulement les études génétiques mais aussi les bibliophiles et, de plus en plus, les commissaires d’exposition, parfois dans une logique de «démédiation» de la littérature convertie en objet à voir, c’est-à-dire en création plastique ou sculpturale (Stewart 2010, Baetens et Sánchez-Mesa 2019). À cela s’ajoutent les diverses éditions des textes de Proust, sur lesquels se penchent les spécialistes en histoire du livre, devenue aujourd’hui l’histoire de toute la chaîne du livre (Darnton 1992).
Dans le cas de Proust, l’accent est massivement mis sur les manuscrits et ce dès le début de la diffusion plus large de son travail, avant même que la totalité de la Recherche n’ait vu le jour sous forme de livre (l’écriture de l’œuvre s’étend de 1906 à 1922, sa publication en sept tomes va de 1913 à 1927). En effet, le numéro d’hommage de la Nouvelle Revue française du 1er janvier 1923 consacre déjà l’essentiel de son dossier iconographique à la reproduction en fac-similé des cahiers et carnets de Proust – il est vrai des objets de toute beauté, mais qui prennent curieusement la place des «illustrations», absentes quant à elles. Il n’y a ainsi plus nulle trace des images ayant accompagné l’édition originale du premier livre de Proust, Les Plaisirs et les jours (1896), qui étaient pourtant de la main d’un des modèles de Madame Verdurin, à savoir Madeleine Lemaire.
On ne peut que s’étonner du relatif silence qui pèse sur le versant «imprimé» de l’œuvre proustienne, surtout du côté de la critique génétique, presque exclusivement focalisée sur les manuscrits (mais le regard porté sur les états imprimés du texte est également assez réduit du côté des chercheurs en histoire matérielle du livre). Certains aspects de la vie éditoriale de l’écrivain se voient inlassablement répétés, comme le refus du premier tome de la Recherche, la publication à compte d’auteur, chez Grasset, de ces pages en 1913, les discussions plus récentes, mais finalement pas trop vives, de la nouvelle version de l’œuvre en la Pléiade (aujourd’hui en quatre volumes, et non plus en trois comme au début), ou encore les réactions mi-sceptiques mi-admiratives devant l’édition anniversaire d’Un amour de Swann, «orné» en 2013 par Pierre Alechinsky. Sinon, Proust est étudié dans le texte (les manuscrits), mais «hors livre». La raison en est sans doute le prestige exceptionnel des manuscrits, qui monopolisent l’attention de quiconque s’intéresse à la matérialité de l’écrit proustien, mais la lacune des travaux sur les éditions de l’œuvre n’en est pas moins fort regrettable. La postérité éditoriale de Proust mérite un examen plus attentif, dont les avantages didactiques sont tout sauf négligeables. À cet égard, un aspect singulier se détache: les éditions illustrées de la Recherche.
Premiers écueils, premiers pas méthodologiques
Enseigner Proust à travers les éditions illustrées de la Recherche semble à première vue plus facile qu’enseigner l’œuvre même, quand bien même il ne peut être question les considérer toutes (en pratique, bien des éditions de luxe à tirage hyper-réduit resteront par définition inaccessibles, tandis que les adaptations en bande dessinée relèvent en partie d’une approche un rien différente). D’abord parce que lire les illustrations prend moins de temps que lire un texte de trois mille pages (notes et variantes non comprises), ce qui est un critère pratique essentiel dans toute forme d’enseignement. Ensuite parce que l’accent mis sur la dimension visuelle de la littérature est plus proche de la culture d’accueil des jeunes, dont beaucoup ont pris le tournant visuel, autorisant ainsi un rapport plus direct et a priori plus empathique avec l’œuvre de départ. Le rapprochement entre sphères a priori non contiguës ne se limite pas à la proximité de cet aspect particulier de l’œuvre de Proust et des nouveaux modes de consommation culturelle. Il aide aussi à inscrire l’enseignement de la Recherche dans le retour en force des études historiques en littérature, après le triomphe des études formelles, pour ne pas dire formalistes, des années 60 et 70 dont les effets se font toujours sentir dans certains modèles pédagogiques. Enfin, la mise en avant des illustrations suit également la tendance de plus en plus «lourde» des arts de l’écriture d’abolir les frontières entre mots et images, hybridation tout à fait intégrée à la pratique des poètes contemporains, notamment au moyen ce qu’on a nommé le «livre de dialogue» entre écrivain, typographe, imprimeur et plasticien (Peyré 2001). Cette co-création est encore relativement rare en prose. En fait, la dernière grande époque d’une visualité foisonnante du livre date déjà des années de grand succès des clubs de livre après la Deuxième Guerre Mondiale (Faucheux, 1978, Massin 1989), alors qu’aujourd’hui la rencontre du visible et du lisible s’effectue d’abord dans le média un peu différent de la bande dessinée. L’exemple de Proust est tout à fait approprié pour rouvrir ce formidable dossier – déjà traité à deux reprises dans cette revue – à l’intérieur de la littérature au sens traditionnel du terme, même si, pour des raisons pratiques, il sera nécessaire de privilégier un seul exemple (celui de Faucheux/Massin, justement), choisi en fonction de son caractère stratégique.
La décision de lire Proust par illustrations interposées fait surgir tout de suite un certain nombre de difficultés. Pour commencer, la quantité d’images illustrant les différentes éditions de Proust est énorme, même si ce pan de l’œuvre reste largement méconnu (pour trois aperçus, voir Tadié 2013, Baetens 2022, Eells et Dezon-James, 2022). Il suffit toutefois de s’intéresser à «Proust illustré» pour que le matériau afflue de toutes parts, car il existe des dizaines d’éditions illustrées de la Recherche. La maîtrise purement matérielle du corpus s’avère ainsi tout aussi difficile que la traversée des textes mêmes. De plus, cette iconographie est tout sauf homogène, à la différence du texte, quand bien même la Recherche témoigne elle aussi de différences stylistiques parfois non négligeables. Ces variations de style sont toutefois nettement moins apparentes que les différences d’une série d’images à l’autre (le corpus des illustrations est un pot-pourri des images les plus conventionnelles et les plus expérimentales). C’est dire déjà que la notion de «culture visuelle» ne peut se penser qu’au pluriel, ce qui constitue une entrave à l’accès supposément direct aux images d’un texte: enseigner l’image, c’est aussi enseigner le passé, souvent un passé plus éloigné de la culture contemporaine que le passé de l’écrit, qui «vieillit» différemment (et surtout moins vite: une image est rapidement plus «datée» qu’un écrit). À cela s’ajoute la méfiance, tant du côté des auteurs que de celui des critiques, à l’égard de l’illustration en général, en tout cas pour ce qui est des fictions en prose. À l’instar de Flaubert, qui est sur ce point tout sauf isolé, beaucoup continuent à s’écrier: «Moi vivant, jamais on m’illustrera», comme si l’ajout d’une image au texte impliquait inéluctablement une dégradation du premier, l’image étant vue soit comme la béquille devant sauver un texte incapable de se défendre lui-même, soit comme une intervention injustifiable des éditeurs soucieux de tromper le client, soit encore comme une traduction, littérale ou métaphorique, dont les effets sur l’imagination du lecteur seraient toujours délétères.
La réalité culturelle, qui est également une réalité économique (l’édition, au même titre que le cinéma, est aussi une industrie), est cependant plus complexe. Dans la première moitié du vingtième siècle – mais la pratique est plus ancienne et elle n’a pas totalement disparu – les éditeurs offraient parfois deux éditions du même livre: une édition grand public, sans illustrations et bon marché, et une édition de luxe, illustrée, à tirage limité, destiné à un lectorat plus fortuné. L’ensemble de cette production parallèle constitue un des continents cachés de la littérature française: des pièces uniques peuvent être savamment commentées (il existe ainsi quelques articles sur l’édition de la Recherche illustrée par le peintre fauve Kees Van Dongen en 1947), mais il est très difficile de faire un surplomb général de la coexistence et peut-être aussi de la distance et de l’ignorance réciproque des versions illustrées et non illustrées des mêmes textes dans l’espace littéraire (les études sur les illustrations de Proust se concentrent souvent sur un seul objet, sans trop se pencher sur le contexte synchronique ou diachronique des images en question).
Dans le cas de Proust, faire l’histoire de ces «doubles» de l’œuvre – et de leur place dans les recherches proustiennes – n’est pas possible sans embrasser la totalité des aventures éditoriales de l’œuvre. Certes, les textes publiés de Proust ont vite fait l’objet de pareilles éditions de luxe, qui restent toutefois peu connues, tant à cause de la cherté de ces livres qu’en raison de la pléthore d’autres images qui se sont greffées ailleurs (par exemple dans les manuels scolaires) sur le texte de Proust. Cela dit, certaines illustrations se retrouvent aussi dans les publications pour le grand public, notamment dans les éditions de poche, et il y a de bonnes raisons (car ces documents sont faciles à trouver et peut-être même déjà connus des élèves) de partir de ces images-là plutôt que de ce qu’on trouve dans les éditions de luxe. En même temps, il importe de ne pas se laisser divertir par les «autres images» qui entourent l’œuvre de Proust: si tant de lecteurs se désintéressent de la question des illustrations, c’est aussi parce que le texte de Proust «hors livre», par exemple dans des catalogues d’exposition ou les coffee table books sur l’auteur et son monde, n’apparaît presque jamais sans images: portraits de l’auteur, photos de famille, tableaux évocateurs des personnages ou du milieu social peint par la Recherche, et ainsi de suite. Or, à l’époque – la nôtre – où la lecture du texte passe de plus en plus par le contact avec l’auteur et que dans le cas des auteurs décédés ce contact passe généralement par l’iconographie de l’auteur – sans appui visuel, il semble difficile aujourd’hui de canoniser ou de patrimonialiser une œuvre littéraire –, il ne faut pas s’étonner que de telles images prolifèrent et que leur seule abondance n’encourage guère à se lancer dans la quête des images plus «rares», comme celles qu’on trouve dans certaines éditions plutôt confidentielles.
Lire «Proust illustré» est ainsi tout sauf une évidence. Plutôt que de chercher à résoudre d’emblée ces premiers écueils, il vaudrait peut-être mieux «reculer pour mieux sauter», c’est-à-dire de prendre un minimum de distance par rapport au seul cas de Marcel Proust et de la Recherche, pour s’interroger sur les questions et les réponses plus générales qu’on peut dégager du caractère problématique de l’objet d’étude, à savoir ces illustrations dont personne ne conteste l’intérêt, sans pour autant trop connaître le corpus.
Questions générales et préparation du chantier
Face à ces difficultés (excitantes du point de vue de l’enseignant, et, plus encore, du concepteur de manuels ou d’autres moyens de documentation, le temps de préparation dont dispose l’enseignant étant fatalement limité !), il importe avant tout de faire un choix. Pour le dire très vite, et sans aborder ici la question épineuse mais autrement générale du copyright, trois grandes options au moins viennent tout de suite à l’esprit, qui du reste ne sont nullement exclusives. Les choix à faire ne seront donc jamais absolus, mais relatifs: c’est par goût mais aussi par manque de temps qu’on se tournera vers telle option plutôt que vers telle autre, tout en sachant qu’aucune analyse ne gagne jamais à rester totalement «pure» jusqu’à la fin.
La première approche, la plus classique sans doute, est celle des rapports concrets entre textes et images. Quand on part de l’image, réelle ou imaginaire, pour analyser sa conversion en objet textuel, la perspective choisie sera celle de l’ekphrasis, dont l’histoire, les thèmes, les figures et les exemples canoniques ont fait de très nombreuses analyses (l’ouvrage de référence reste ici Heffernan 1993). Le principe de l’illustration est à la fois symétrique et inverse: il concerne lui aussi le lien entre le lisible et le visible, mais le point de départ est ici le texte et le point d’arrivée, l’image. L’intérêt de l’œuvre de Proust est de combiner à bien des égards l’un et l’autre de ces mécanismes, ekphrasis et illustration, mais de manière non parallèle.
De son vivant, Proust ne s’est pas toujours opposé à l’illustration (rappelons les images de Madeleine Lemaire dans Les Plaisirs et les jours et quelques autres illustrations dans une revue de grand luxe ayant prépublié certains fragments de l’œuvre en cours), mais il n’est pas faux de penser qu’il s’est rapidement détourné du marché de l’édition restreinte et illustrée pour se tourner vers des types de publication très grand public et sans la moindre illustration. Les premiers volumes de la Recherche sont des exemples typiques de livres «pauvres» (Monnier 1931). Par contre, le rôle de l’ekphrasis y est capital et touche aussi bien à des modèles picturaux que musicaux. Dans la Recherche, le protagoniste a trois grands modèles artistiques (Vinteuil pour la musique, Elstir pour la peinture, Bergotte pour la littérature), qui ont toutefois en commun de s’éclipser devant le projet personnel du narrateur, qui découvre peu à peu sa propre vocation et sa propre manière de faire, c’est-à-dire d’écrire – d’où peut-être la frilosité grandissante de Proust face à l’image, qui «fige» la mobilité aussi bien que la densité et la profondeur temporelle de son travail sur la mémoire. Il importe de tenir compte de ce décalage entre illustration (refusée) et ekphrasis (assumé) au moment d’aborder les images qui accompagnent le texte de Proust et qui sont, à quelques exceptions près, toutes «posthumes». Il ne faut pas conclure de cet écart temporel que les artistes et plasticiens qui acceptent de se mesurer avec le texte de Proust , peuvent dès lors le faire de manière plus «libre»: les contraintes restent nombreuses, qui vont du poids de la tradition (on n’illustre pas Proust sans regarder du côté de ce qui s’est déjà fait, pour s’en distinguer ou pour s’en réclamer) aux exigences des commanditaires (les illustrations font toujours l’objet de commande et les éditeurs ont leur mot à dire dans le «look» des images). L’analyse de ces rapports de force est cependant une excellente introduction à une discussion sur la question plus générale de l’adaptation transmédiatique, continuation logique du travail en classe sur l’illustration.
La seconde approche est moins directement intermédiale, quand bien même il serait absurde de laisser tomber l’interaction entre visible et lisible. Elle analyse la manière dont les illustrations font partie d’un «espace élargi», en l’occurrence celui du livre. Il est utile de distinguer ici entre deux aspects, où les aspects littéraire et économiques se croisent sans arrêt.
D’un côté, le livre est un objet matériel et culturel, dont l’existence, de la première idée au dernier de tous ses usages produit une sphère culturelle à multiples actants: auteurs, éditeurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires, collectionneurs, lecteurs. Grâce aux travaux déjà cités de Darnton et de bien d’autres, dont en France surtout l’historien de la lecture Roger Chartier, nous savons du reste que ladite «chaîne» du livre, qui va en principe de l’auteur au lecteur, en passant par toute une série d’intermédiaires, n’est pas linéaire, mais qu’il y a force interactions créatrices entre nombre d’acteurs à plusieurs moments et à plusieurs endroits de cette chaîne.
De l’autre, le livre n’est pas un objet «homogène». Il existe beaucoup de types de livres et partant beaucoup de «chaînes» de livres, chacune d’elles avec sa propre logique interne. La pratique de l’illustration est directement affectée par ces différences: on n’illustre pas un livre de poche comme on illustre un livre pour bibliophiles, par exemple, tout comme on n’illustre pas de la même manière en France ou en Grande-Bretagne, ni en 1920 ou en 1970. Les illustrations de la Recherche sont un outil magnifique pour montrer ces dissemblances, qui obligent les élèves et étudiants (même si on vise ici un public scolaire, la réflexion méthodologique doit en effet se ménager la possibilité d’élaborer une stratégie en deux temps et à deux niveaux) à se faire sensibles à la rupture entre l’apparente stabilité du texte et la permanente métamorphose de présentation matérielle (même dans les cas, et ils sont très nombreux, où les livres se passent de toute illustration).
La troisième approche, qui prolonge les deux premières, est surtout diachronique. Il peut en effet être passionnant de d’analyser comment la présentation typographique du texte et le travail sur les éléments visuels, s’ils changent tous les deux sans arrêt, ne changent pas toujours au même rythme ni de la même façon. La multiplicité des versions proustiennes facilement accessibles en bibliothèque ou en librairie est un bel outil pour lancer une telle piste de réflexion. L’essentiel, ici, sera de comprendre la manière dont s’articulent les deux autres pistes, celle de l’intermédialité (rapports textes-images) et celle de la matérialité (le texte situé dans le cadre plus large de la chaîne du livre), mais toujours du point de vue synchronique aussi bien que diachronique. Plus spécifiquement, deux types de questions peuvent ici être posées. D’un côté: quels sont les mécanismes qu’on peut observer à quel moment et à quel endroit de la chaîne et quels sont les acteurs les plus directement concernés? De l’autre: quel est le rôle des illustrations? comment et surtout pourquoi est-ce qu’on les voit apparaitre ou disparaître?
Tout cela suppose évidemment que les élèves et étudiants ont réellement accès aux sources, ce qui est loin d’être une évidence en raison du caractère confidentiel de nombreuses publications. Quelques-unes des éditions illustrées, à haute valeur bibliophilique, n’existent même qu’à quelques exemplaires, s’il ne s’agit pas de créations plastiques totalement uniques, délicates à déplacer. De tels objets, si on peut utiliser ce terme un peu terre-à-terre, se trouvent souvent dans des collections privées, difficiles d’accès, alors que d’autres se trouvent dans des archives spécialisées où ils ne peuvent être consultés que sur place et sur rendez-vous. Pour les élèves, il peut être un bon exercice (par exemple en combinaison avec une visite de bibliothèque), en partant des aperçus existants (voir supra), de s’initier à l’heuristique littéraire, au sens très littéral du terme: Où et comment peut-on accéder aux documents originaux? Y a-t-il moyen de le faire en ligne? Quelle est la différence entre le contact avec les originaux et l’utilisation de sources en ligne? Y a-t-il aussi des créations purement numériques? Ou encore: Que faire pour combler les inévitables lacunes des répertoires existants? Quels que soient les obstacles qui surgissent au cours de pareils exercices, il est évident qu’ils aideront les élèves à se faire une idée plus nuancée et plus diversifiée des trois notions de texte, de livre et d’œuvre dont ils auront besoin pour passer ensuite à de nouvelles formes d’interprétation de Proust.
Idéalement, les trois grandes approches devraient pouvoir se combiner et se compléter. En pratique, on ne peut que le répéter, des choix s’imposent. Dans Illustrer Proust, je me suis par exemple concentré sur la troisième de ces pistes, n’étant ni un spécialiste de Proust, ni un spécialiste du livre (c’est peut-être ce qui m’a permis de me lancer dans ce projet, car parfois on est sauvé par sa propre naïveté). D’autres recherches se focalisent plutôt sur la lecture intermédiale, par exemple pour souligner l’apport créateur de certaines illustrations (c’est typiquement l’approche déjà citée de Eells et Dezon-James) ou montent en épingle les questions génétiques épineuses mais fascinantes de la transformation d’un manuscrit (finalement inachevé, c’est-à-dire moins bien relu et corrigé à la fin qu’au début et en ce sens fondamentalement inachevé) en livre (apparemment «fini», comme dans le cas du premier tome paru chez Grasset en 1913, mais immédiatement dénoncé comme «erroné» puisque bourré de coquilles, «incomplet» puisque rien d’autre que la porte d’entrée d’une somme dont l’auteur ne voyait pas encore les frontières, et «mal classé», puisqu’ayant paru chez un éditeur qui n’était pas celui qui allait vraiment faire rayonner l’œuvre de Proust).
Questions particulières et pistes de réflexion
Derrière ces premiers choix se dessine toute une série d’autres chantiers. Leurs enjeux et leur importance sont variables, mais tous reviennent sur la question fondamentale posée au début de ces pages: quel Proust, ou, si l’on préfère, que deviennent Proust et notre idée de Proust à la lumière du texte enrichi par l’illustration?
Cette question conduit au problème de l’«identité» du texte et de l’œuvre. L’intérêt pour les illustrations montre que l’œuvre d’un auteur ne coïncide pas avec le seul texte qu’il a produit. Si les «corps étrangers» qui l’entourent n’en font pas moins partie, on est en droit de s’interroger sur l’identité de l’instance derrière cette conception élargie de l’œuvre. En effet, les illustrations de Proust n’ont pas été «voulues» par Proust, et encore moins «pensées» par lui – à la différence de bien d’autres écrivains qui ont collaboré de leur vivant avec leurs illustrateurs et qui dans certains cas extrêmes comme celui de Raymond Roussel dans ses Nouvelles Impressions d’Afrique ont élaboré un dispositif très complexe pour l’intégration du texte, des images et de l’objet-livre (Busine 1995). Il en résulte que notre perception de l’œuvre, inéluctablement influencée par la présence d’éléments visuels (pas forcément sous la forme d’illustrations: la typographie peut être non moins déterminante), ne sera jamais «pure». L’énonciation d’un texte, du moment qu’il passe du manuscrit au livre, est par définition une énonciation plurielle, où interviennent nombre d’autres instances que le seul auteur. L’éditeur en est une, mais aussi le maquettiste ou l’illustrateur, entre autres (Souchier (2007). On peut toujours essayer de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais en pratique il n’est pas toujours facile de faire la part entre la manière dont on reçoit le texte tel qu’en lui-même (à supposer que ce texte ne relève que d’un seul auteur, ce qui est loin d’être toujours le cas) et celle dont on reçoit le texte tel qu’il est présenté matériellement (et cette présentation, on le sait, est hautement variable; elle se fait aussi très souvent hors de tout contrôle de l’écrivain). Dit autrement: ce que montre l’histoire éditoriale d’une œuvre , en l’occurrence d’un auteur dont le texte supposé immuable a fait l’objet d’une série incessante d’illustrations de styles et de contenus très variables, c’est la difficulté de fixer la voix «authentique» d’un auteur. Cette voix est toujours, non pas impure, mais complexe, plus étagée que celle du texte pris en lui-même.
Pareille idée ne devrait pas surprendre: nous acceptons aujourd’hui que l’interprétation d’un texte sera différente si nous le découvrons en audiolivre ou à travers d’autres formes d’adaptation (inutile de revenir sur l’exemple de la bande dessinée de Stéphane Heuet, pourtant très respectueuse du texte même de Proust, voir Baetens 2020); de la même façon, la critique savante accepte sans le moindre état d’âme qu’il n’est pas possible de lire un texte sans prendre en considération les successives lectures qu’on a pu en faire (quitte, bien sûr, à tenter de dépasser ces lectures en revenant au texte, comme le font les diverses formes de lecture créatrice illustrées par Pierre Bayard (1996) ou Maxime Decout (2021)). L’exemple des éditions illustrées de Proust peut pointer dans la même direction et faire comprendre que le sens d’une œuvre ne dépend jamais du «vouloir dire» d’une instance auctoriale unique. Il est incontestable que Proust a eu un «projet» et une «intention» en écrivant la Recherche, mais l’interprétation de ces éléments, pour autant qu’on les juge pertinents, dépasse toujours l’éventuelle réponse à la question apparemment simple mais finalement sans réponse finale possible: qu’est-ce que l’auteur a voulu dire? Ce débat, qui est ancien, peut paraître dépassé aux yeux de certains, mais il réapparaît à intervalles réguliers dans l’histoire de la critique. De nos jours, où l’on assiste à un retour presque agressif du biographisme et de la primauté de l’homme ou de la femme par rapport à l’œuvre, les questions de sens se posent de nouveau très fortement en référence au vouloir-dire de l’écrivain, de sa «sincérité», de son «engagement», de son «authenticité», de sa capacité à représenter une «communauté», et ainsi de suite (voir Louichon 2015 sur les enjeux de la patrimonialisation).
D’autres questions sont non moins importantes, comme celle de la définition du «corpus» historique de la littérature. Est-il possible de se focaliser sur les seuls textes, ou faut-il inclure dans l’œuvre tous les éléments qui accompagnent la transformation d’un manuscrit en livre? De nos jours, il est généralement admis, dans le sillage des travaux de Genette (1987), qu’il n’est plus possible de séparer les données textuelles et paratextuelles, qui ne sont pas de simples ajouts mais qui font partie intégrante de l’œuvre même (or, nous savons que la majorité de ces unités paratextuelles échappent totalement au contrôle de l’auteur, y compris sur le plan juridique). De la même façon, on estime que les avant-textes, les métatextes, les intertextes et l’architexte, en suivant toujours la terminologie de Gérard Genette dans Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982), font également partie de l’œuvre (il est toutefois intéressant de noter que le livre de Genette laisse de côté la dimension proprement visuelle de cette extension du livre: son travail sur le paratexte tend à mettre entre parenthèses les illustrations, par exemple).
Il faut maintenant faire un pas de plus et se demander dans quelle mesure il convient d’y ajouter aussi le domaine des adaptations (au cinéma, en bande dessinée, en audiolivre, en exposition, voire en parc de loisirs comme c’est aujourd’hui le cas d’Illiers-Combray). La question peut paraître exagérée, mais elle répond à une réalité de plus en plus visible: la littérature ne circule plus seulement sous forme de textes, mais aussi sous forme d’adaptations transmédiatiques, tantôt en complément par rapport à l’œuvre, tantôt en véritable substitut. Les lecteurs de Stéphane Heuet ne liront pas tous la Recherche, par exemple. Les spectateurs de l’adaptation cinématographique d’Un amour de Swann (Volker Schlöndorff, 1984, avec Jeremy Irons et Ornella Muti) ont fort bien pu en rester là dans leur expérience de l’univers de Proust – et il n’y a pas de raison pour leur en faire le reproche).
Le phénomène ne reste pas circonscrit à la production littéraire: il en va de même dans le domaine de la production cinématographique, où bien des films sont mieux connus à travers certaines extensions, imprimées ou numériques, qu’à travers les versions proprement cinématographiques (on connaît les affiches, les novellisations, les résumés de Wikipédia, et ainsi de suite, sans forcément avoir vu les films originaux, surtout pas dans leur totalité).
Bref, le cas en apparence singulier et relativement marginal des éditions illustrées de Proust aide non seulement à penser autrement la question de l’instance auctoriale (qui est responsable, à côté de l’auteur de l’œuvre, du texte mis en livre?) mais aussi la notion de texte et d’œuvre. D’une part leurs limites deviennent floues: quels sont les autres éléments qui se greffent sur le texte de départ? D’autre part le rapport entre œuvre originale et œuvre dérivée cesse également d’être clair: que penser d’une œuvre qu’on ne connaît que par l’intermédiaire de ses adaptations, par exemple, et comment la connaissance des variations transmédiatiques influe-t-elle sur le contact ultérieur avec l’œuvre d’origine? Questions très vastes qu’il est impossible de traiter ici en détail, mais qui soulignent une fois de plus à quel point la notion d’histoire littéraire échappe à la dichotomie élémentaire du moment de la publication initiale et de celui de la réception actuelle.
Une étude de cas: Pierre Faucheux vs Robert Massin et la Recherche dans «Le Livre de poche» vs Folio
Mais trêve de généralités. Il est temps de passer à un exemple concret, abordable pour les élèves en termes de quantité (un corpus modeste, facile d’accès) et de qualité (une intervention représentative et d’importance durable): les couvertures des sept volumes de la Recherche dans l’édition du «Livre de poche» conçue en 1965 par le maquettiste Pierre Faucheux. Ces volumes se trouvent encore facilement chez des bouquinistes, y compris en ligne, et au cas où il serait moins aisé de les réunir tous en classe, on a la certitude de pouvoir les consulter au moins sur internet (via une simple recherche «Google images»). Hautement appréciées par les collectionneurs et les amateurs de Proust, les sept couvertures de cette série, elle-même à la valeur commerciale négligeable, constituent une pièce stratégique dans l’histoire des éditions illustrées de Proust, où elle constitue un véritable tournant.
L’intérêt du travail de Faucheux se situe à deux niveaux. Le premier est externe et touche à la manière dont l’illustration de Proust révèle des mécanismes plus vastes de l’édition littéraire. Le second est interne et concerne la manière dont Faucheux a révolutionné non seulement l’illustration mais le design du livre en général. Pour étudier des divers aspects, il est conseillé d’avoir un minimum de connaissances de l’histoire de l’illustration dans l’édition française ainsi que de la place qu’y occupe le marché du livre de poche (format de publication opposé à ce qu’on appelle le «grand format», soit la première édition courante, à ne pas confondre avec l’éventuelle édition parallèle de luxe, et dont l’avènement n’a pas attendu le lancement du label «Le Livre de poche» en 1953). Sur tous ces points, l’information ne manque pas (on peut recommander par exemples certaines publications d’Olivier Bessard-Banquy, notamment 2012 et 2022) et les élèves peuvent lire avec grand profit quelques fragments des autobiographies richement illustrées des deux grands novateurs que sont Massin (1989) et Faucheux (1978).
Sans trop entrer dans les détails, on peut souligner la continuité éditoriale et culturelle entre, d’une part, les clubs de livre qui se créent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et, d’autre part, les collections de poche, dont le succès décolle avec «Le Livre de poche» en 1953. L’ambition des clubs, soucieux de démocratisation culturelle, est avant tout politique: fonctionnant par abonnement ou souscription, ils se proposent d’offrir à bas prix de «vrais» livres (c’est-à-dire des textes faisant partie du patrimoine littéraire, et non plus les divers avatars de la littérature de genre ou littérature populaire). Mais elle est aussi esthétique. Contrairement à ce qu’on observe en Angleterre, par exemple, le livre français est en règle générale plutôt «laid» (ce qui ne veut pas dire «pauvre», au sens technique que lui donne Adrienne Monnier). Typographie, papier, reliure, impression… n’encouragent pas toujours à la lecture, et l’absence d’illustrations dans les éditions courantes et beaucoup d’éditions de poche (à l’époque uniquement des réimpressions bon marché et en petit format) n’est pas toujours faite pour arranger les choses (pour une approche critique de la situation actuelle du livre français, voir Bessard-Banquy, 2022). Les clubs de livre vont mettre en place une politique typographique audacieuse, qui s’efforce d’améliorer et de moderniser la présentation du livre tout en baissant le prix.
Pour y arriver, les jeunes maquettistes auront recours à deux grandes techniques. D’une part, le recours à l’image et, plus généralement, à des formes de typographie mettant en valeur les aspects visuels de la page. D’autre part, l’invention du «déroulement», c’est-à-dire de la transformation de la zone paratextuelle en séquence visuelle, ce qui a pour effet de modifier de fond en comble l’architecture du livre, qui tend vers le modèle cinématographique. Quelques années plus tard, les collections de poche, où l’on retrouve les grands maquettistes ayant révolutionné le design du livre français, vont prendre le relais des livres de club. C’est la fin des déroulements, mais non de l’importance accrue de l’image (en couverture, la couverture des grands formats restant «blanche» dans le secteur de l’édition générale, dans bien des cas jusqu’à aujourd’hui). Tout à coup, les images envahissent les couvertures (les livres des clubs, soigneusement cartonnés, étaient généralement restés sans illustration de couverture), et leur importance déborde le seul espace du livre. L’omniprésence des couvertures bariolées dans les vitrines et, autre nouveauté, les présentoirs et autres tourniquets de livres, joueront un rôle clé dans les polémiques autour du «Livre de poche» (Baetens 2017).
Pour ce qui est des illustrations, l’intervention de Faucheux est radicalement novatrice, puisqu’il remplace les images traditionnelles qu’il juge vieillottes (dessins, gravures, peintures) par des photographies, si possible de «documents», ce qui a le double avantage d’éluder le tabou qui pèse encore sur l’illustration (dans le cas de Proust, le stéréotype qui revient sans arrêt est qu’ «on n’illustre pas Proust», l’image ne pouvant qu’entrer en conflit avec la nature et le prestige d’une écriture qui a vite accédé au rang de chef-d’œuvre incontesté de la littérature moderne) et de servir d’alibi à une forme d’illustration qui n’a plus besoin de dire son nom (Faucheux lui-même se plaira à dire, sans la moindre ironie, que les photographies ne sont pas des… illustrations, mais des éléments qui contribuent à faire du livre un objet à trois dimensions dont le modèle est l’architecture). Invité par Le Livre de poche à reprendre la maquette de la série des classiques (et aussi des policiers, mais c’est une autre histoire), Faucheux ne dévie pas de son credo esthétique. Son travail sur les sept volumes de la Recherche est reste une démonstration inégalée (Fig. 1).
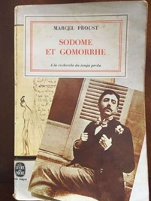
Figure 1: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Le Livre de Poche, 1965.
Cette maquette obéit à quatre grands principes. D’abord, le refus de toute forme d’illustration conventionnelle et son remplacement par des documents photographiques (concrètement, un mélange de photos de famille et de reproduction en fac-similé des manuscrits). Puis, la variation des caractères typographiques de la couverture dont l’esprit s’aligne sur celui de l’image. Ensuite, l’occupation de la totalité de la couverture par une composition unique et homogène (la distinction traditionnelle entre première et quatrième de couverture se trouve dépassée). Enfin, l’élaboration de la série sous forme séquentielle (la suite des sept volumes ne décline pas simplement des variations sur la même idée, mais les photos suivent chronologiquement la vie et l’écriture de Proust). Sur tous ces points, l’influence des clubs de livre est évidente, en dépit des contraintes techniques et commerciales du Livre de poche, qui exige une standardisation aussi poussée que possible de toutes les publications.
La force de ce dispositif, dont l’originalité continue à inspirer de nombreux typographes jusqu’à ce jour, se manifeste également dans les réactions suscitées à l’intérieur du champ de l’édition de poche. Lorsque quelques années plus tard, après la rupture entre Hachette et Gallimard en 1971, l’éditeur de Proust décide de créer son propre système de diffusion et ses proches collections de poche, dont en premier lieu la fameuse collection «Folio», créée en 1972 par un autre pionnier de l’époque des clubs, Robert Massin. L’édition Folio (Fig. 2) prendra soin de se distinguer à tous les niveaux du modèle de Faucheux, comme on le voit clairement dans sa version de la Recherche, également en sept volumes: couverture à fond blanc, présence d’une image «artisanale» (non photographique, non documentaire), séparation des première et quatrième de couverture, uniformisation complète des caractères typographiques (ceux de la série, non ceux de chaque publication indépendante, comme chez Faucheux).

Figure 2: Première de couverture de Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, Paris, Folio, 1972.
Pour rapide que soit cette analyse, elle fait bien ressortir que les enjeux de l’illustration dépasse à la fois le travail du seul illustrateur et les rapports entre texte et image. Ce que font aussi bien Pierre Faucheux que Robert Massin est moins déterminé par quelque envie de trouver de nouvelles manières d’ajouter des images à l’écriture proustienne (Faucheux reprend des documents d’archive déjà fort connus, Massin se ressert des aquarelles ayant illustré une édition antérieure), que par le désir stratégique de monter en épingle une collection éditoriale (et il serait injuste de reprocher à l’édition d’être aussi une industrie, car elle l’est, et elle l’a toujours été). Les illustrations de Faucheux tendent à montrer que «Le Livre de poche» est capable d’innover, au moment où sa première ligne graphique était en train de s’essouffler, là où l’intervention de Massin cherche à imposer «Folio» comme la nouvelle référence en matière de poche. Il n’est évidemment pas question de généraliser cet exemple à tout prix, mais la lecture attentive de nombreux livres illustrés ne manquerait pas d’apporter de nouveaux arguments en faveur d’une telle hypothèse: l’étude de l’illustration qui se limite aux seuls rapports texte/image est toujours en danger de passer à côté d’aspects tout autres mais tout aussi importants du travail de l’illustrateur.
Conclusion
Lire Proust à l’aide des éditions illustrées de la Recherche, dont le diptyque Faucheux/Massin a présenté un exemple privilégié, n’a de sens que dans la mesure où l’on établit aussi des rapports avec les autres perspectives rapidement esquissées dans ces pages. La comparaison des illustrations et des fragments ekphrastiques, l’analyse de tout l’éventail de l’énonciation éditoriale, l’examen de la position historique des images insérées (tendent-elles à «actualiser» le texte et l’auteur, à les rendre «intemporels», ou au contraire à les ramener aux années de genèse, celles de la Belle Époque?), mais aussi la réflexion sur les manières dont se constitue l’objet de la lecture (pourquoi Proust dans telle édition plutôt que telle autre, par exemple?), ainsi que le retour sur les questions de l’auteur et de ses intentions, toutes ces pistes se prêtent sans trop de difficultés à une discussion en classe. Pareille discussion n’éloigne nullement du texte, elle le fait relire autrement. Elle aussi l’avantage non négligeable de son caractère générique: ce qui se fait autour de Proust, peut non moins se faire autour d’autres œuvres, voire autour de productions non littéraires comme le cinéma ou la bande dessinée.
Bibliographie
Baetens, Jan (2017), «Les livres de poche, une littérature ‘exposée?», Image & Narrative, 18 (4), p. 55-62, [en ligne].
Baetens, Jan (2020), Adaptation et bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Baetens, Jan (2022), Illustrer Proust. Histoire d’un défi, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
Baetens, Jan, et Sánchez-Mesa, Domingo (2019), «On ‘demediation’», Leonardo, 52 (3), p. 275-278.
Bayard, Pierre (1997), Le Hors-sujet. Proust et la digression, Paris, Minuit.
Bessard-Banquy, Olivier (2012), L’Industrie des lettres, Paris, Pocket.
Culler, Jonathan (1997), Literary Theory: A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press.
Darnton, Robert (1992), Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob.
Decout, Maxime (2021), Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit.
Eells, Emily, et Dezon-Jones, Élyane (2022), Illustrer Proust. L'art du repeint, Paris, Sorbonne Université Presse.
Faucheux, Pierre (1978), Écrire l'espace, Paris, Robert Laffont.
Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.
Heffernan, James (1993), Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago, The University of Chicago Press.
Kuentz, Pierre (1972), «L’Envers du texte», Littérature, n° 7, p. 3-26.
Louichon, Brigitte (2015), «Le patrimoine littéraire: un enjeu de formation», Tréma, n° 43, p. 22-31.
Massin, Robert (1989), L’ABC du métier, Paris, Imprimerie nationale.
Monnier, Adrienne (1931), «Éloge du livre pauvre», Arts et métiers graphiques, n° 25, p. 345-348 (repris plus tard dans Adrienne Monnier, Rue de l’Odéon, Paris, Albin Michel, 1960).
Peyré, Yves (2001), Peinture et poésie, le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard.
Sermier, Émilien (2022), Une saison dans le roman, Paris, Corti.
Souchier, Emmanuël (2007). «Formes et pouvoirs de l’énonciation éditoriale», Communication & Langages, n° 154, p. 23–38.
Stewart, Garrett (2010). “Bookwork as Demediation”, Critical Inquiry, 36 (3), p. 410-457.
Tadié, Jean-Yves (2013), Swann illustré, Paris, plaquette accompagnant, sous coffret, l’édition par Antoine Compagnon de Du côté de chez Swann en Folio classique.
Voir également :
Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
L’approche en parallèle des versions romanesque et dessinée de Quelques mois à l’Amélie, de J.-C. Denis met en évidence certaines des caractéristiques propres à chaque genre ou forme.
Genres et écriture d’invention: préparer la transposition par la comparaison entre deux formes (BD/roman) d’un récit
Introduction
Cette contribution vise à examiner l’intérêt d’une préparation spécifique à l’écriture d’invention 1(Denizot, 2022) ou écriture créative (Ulma et alii, 2022) qui soit axée sur les formes ou les genres textuels (Jacquin, 2018) mobilisés. La réflexion se fonde sur une expérience menée en classes de Terminale, qui porte sur la comparaison de deux versions (roman et bande dessinée) d’un même récit (Quelques mois à l’Amélie, de J.-C. Denis), pour en dégager les spécificités en termes de moyens expressifs et d’effets sur le lecteur. Le dispositif décrit s’inscrit dans l’optique d’une préparation à l’écriture d’invention, en l’occurrence une «transposition transgenre» (Abolgassemi 2001: 26), de la forme dessinée à la forme romanesque ou inversément.
Le contexte institutionnel
Les instructions officielles pour l’école secondaire en Belgique francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018)ont récemment consacré l’écriture d’invention, en la considérant comme une activité qui doit faire l’objet d’une évaluation. L’évolution qui a conduit à cette reconnaissance avait commencé avec les instructions de 1999 qui suggéraient déjà de «sensibiliser» à cette pratique. Les textes du prescrit légal imposent cependant une restriction importante, puisque l’Unité d’Acquis d’Apprentissage n°5 (UAA5) limite la pratique de l’écriture d’invention à trois formes, parmi beaucoup d’autres (Abolgassemi 2001: 26-27): l’amplification, la recomposition et la transposition. La créativité des élèves ne s’exerce donc pas ex nihilo, mais à partir d’œuvres artistiques ou littéraires dont la compréhension est indispensable pour la réalisation de la tâche demandée.
Le lien entre lecture et écriture est ici très fort, puisqu’il s’agit de s’appuyer sur une ou des œuvres lues pour en faire écrire une autre. C’est ce que Genette dénomme une «littérature au second degré», qui «s’écrit en lisant» (1982). Il ne s’agit donc pas de produire un commentaire mais un texte, au sens littéraire, ce qui implique d’aborder l’œuvre source ou «hypotexte» (Genette 1982: 11) avec une intention particulière, strictement encadrée dans le contexte scolaire belge, comme nous l’avons dit.
Le cas qui nous occupe est celui de la transposition, définie par Abolgassemi (2001: 26-27) comme la réécriture, avec action sur six indices: le mode, la focalisation, le style et les registres, le contexte, la versification ou la prose, le genre. En termes d’écriture d’invention, la tâche de transposition peut dès lors sembler faire l’objet d’une injonction apparemment contradictoire: l’élève doit développer une interprétation personnelle de l’œuvre source, tout en respectant celle-ci. Ainsi, «l’imagination personnelle des élèves est […] valorisée, mais seulement en tant qu’elle s’inscrit dans la démarche très précise indiquée par les protocoles d’écriture de l’énoncé.» (Abolgassemi 2001: 18). Il s’agit donc d’un «projet créatif complexe, tendu entre appropriation personnelle et imitation» (Brunel et alii 2023: 94).
Concrètement, dans les classes de Belgique francophone – que nous fréquentons depuis longtemps2 – les enseignants de français ont souvent tendance à mettre l’accent sur le respect de l’hypotexte: ils ne font en cela que suivre les instructions officielles. La tâche de transposition est alors préparée par une analyse, qui vise – dans le cas le plus fréquent – à dégager les contraintes propres à l’œuvre source qui devront être prises en compte dans la version nouvelle à produire. Or le problème spécifique de la «transposition transgenre» (c’est l’un des cas envisagés par Abolgassemi en 2001) est celui de la maitrise des deux genres ou formes mobilisés dans l’opération3. Nous utilisons ici la formule «genre ou forme», car nous sommes au carrefour de plusieurs contraintes en termes de concepts: d’une part, on sait quel flou entoure la notion de «genre» (Simons, 2018) reprise pourtant par Abolgassemi (2001), et très présente en didactique (Schneuwly, 1994), mais elle nous semble un peu restrictive face aux deux objets narratifs qui nous occupent, entre lesquels la différence peut être plutôt qualifiée de «formelle». Nous userons donc des deux termes simultanément.
Sur un plan plus général, Schneuwly avait déjà montré combien ce qu’il appelle le genre est utile face à tout type de tâche: «On pourrait […] considérer le genre comme un méga-outil, comme une configuration stabilisée de plusieurs sous-systèmes sémiotiques […] permettant d’agir efficacement dans une classe bien définie de situations de communication.» (Schneuwly 1994: 162). Son idée sera reprise par Simons, pour l’étendre au domaine des langues étrangères, en insistant sur les tâches de production: «La maitrise des caractéristiques d’un genre textuel est un outil qui permet d’agir dans une situation de communication donnée, tant en réception qu’en production.» (2018: 48).
Or, plus encore que dans d’autres tâches, la maitrise des caractéristiques génériques ou formelles est centrale dans le cas d’une telle transposition, puisqu’il s’agit de travailler sur le genre ou la forme de l’hypotexte fourni, pour en transformer les modalités, en vue de le conformer au genre ou à la forme de l’hypertexte à produire. On peut considérer, comme l’un des pères de la BD, le Suisse Rodolphe Töpffer (1840)4, que l’opération s’apparente à une forme de traduction d’un langage dans l’autre: en l’occurrence celui du roman et celui de la bande dessinée.
Le plus souvent, la forme romanesque est assez bien maitrisée par les enseignants (elle était au cœur de leur formation) et plutôt bien connue des élèves (elle est au programme). La BD est de plus en plus prise en compte par les didacticiens, comme en témoigne le numéro 4 de Transpositio (2021), mais elle reste par contre peu utilisée dans les séquences produites par les enseignants (Gennaï 2023: 23); sa lecture en classe est encore rare (Beghin 2021: 15, Depaire 2019), et «sa place [est] très marginale parmi les œuvres lues»(Blanchard & Raux 2019: 1). On l’explique souvent par le fait que la familiarisation avec le langage de l’image n’est pas une priorité dans la formation des enseignants de français. Une autre raison est le poids accordé à la littérature patrimoniale au collège et surtout au lycée. Enfin, selon Rouvière, confirmé récemment par Vrydaghs (2022: 4), l’approche de la BD – lorsqu’elle a lieu – est souvent marquée par l’importance «des questions d’observation formalistes et techniques, souvent détachées du sens…» (2012: 13).
Les finalités de l'activité proposée
L’activité que nous présentons se distingue tout à fait de l’analyse d’une œuvre classique, où la BD serait instrumentalisée comme un succédané du roman. Ce dispositif qui place la BD dans une situation ancillaire face à la littérature est assez fréquent (Ahr 2012: 198, Duvin-Parmentier 2020: 6; Vrydaghs 2022: 2), parfois dénoncé comme un «alibi» (Étienne & Mongenot 2023: 6) ou présenté comme une «ruse didactique» (Zakhartchouk 1999).
Notre objectif n’est pas l’acculturation – par un moyen détourné – à une œuvre du patrimoine, puisque le cas analysé est tout à fait particulier, voire exceptionnel: il n’y a pas ici de texte princeps (Étienne & Mongenot 2023: 12), ni de statut auxiliaire de la forme BD, qui ne s’inscrit donc pas dans la catégorie de ce que Louichon a dénommé «objets sémiotiques secondaires» ou OSS (2017: 24). Par ailleurs, le roman et la BD convoqués sont des œuvres contemporaines (2002), totalement dépourvues du prestige des classiques du patrimoine littéraire.
La confrontation des deux formes doit permettre de montrer certaines spécificités du roman et de la BD. L’idéal serait donc de proposer à l’analyse deux versions d’un même récit nées de la même plume, car on pourrait alors supposer l’existence d’une intention similaire (un seul et même créateur), servie par des moyens différents. Notre démarche répondrait ainsi au souhait de Sophie Beghin: «littérature et bande dessinée récolteraient toutes deux bien des avantages à s’envisager comme complémentaires, chacune pouvant éclairer les spécificités de l’autre pour autant qu’on les envisage dans leur nature propre (2021:19).
Nous souhaitons privilégier l’approche des formes ou genres et de ce qu’elles ou ils impliquent, de par leur nature, en termes de réception. La volonté est de mettre au jour certains invariants génériques des formes comparées, invariants qui conditionnent l’expérience de réception. La comparaison que nous proposons devrait donc permettre de mettre en évidence, aux yeux des élèves, combien les différences de moyens influencent leur expérience de lecture de l’œuvre. Cette activité d’analyse vise à les sensibiliser à ces paramètres,en vue des tâches de transposition qui leur seront ultérieurement demandées.
Nous souhaitons donc dépasser la simple comparaison, qui tient parfois lieu de finalité en soi (Gennaï 2023: 32), pour dégager des outils et des savoirs utiles à une tâche de création. Nous nous inscrivons ainsi dans «une démarche d’enseignement de la production par analyse et/ou imitation de textes-modèles» (Jacquin 2018: 22). Les enseignants de terrain savent que l’écriture d’invention pose un problème particulier: les tâches de création, même lorsqu’elles évitent le travail ex nihilo, fortement affecté par le syndrome de l’angoisse devant la page blanche, nécessitent de proposer aux élèves des productions qui ont valeur de modèles. C’est le constat de Rouvière (2017) lorsqu’il analyse son expérimentation (en classe de Seconde) d’une transposition de Nana en BD: il considère l’étude préalable d’un exemple comme nécessaire.
Les deux formes de l’œuvre
Dans la quasi-totalité des cas de transposition d’un roman en BD (Ahr 2012), le lecteur a affaire à des artistes différents, ce qui conduit presque naturellement le ou les créateurs de la nouvelle version à introduire des interprétations personnelles. Tout exercice de comparaison se heurte donc à une difficulté: comment faire le départ entre les changements forcés, liés à la forme (passage d’un langage à l’autre), et ceux qui sont choisis par le ou les artistes créateurs de la version seconde ?
Aborder la question des genres ou formes à travers une approche comparative exige de pouvoir disposer d’un matériau que nous oserons qualifier de très rare: deux versions d’une même œuvre, produites simultanément par un même artiste. Dans le cas qui nous occupe, l’auteur est unique mais s’exprime sous deux formes: les deux œuvres de Jean-Claude Denis (Grand Prix d’Angoulême, 2012) sont intitulées Quelques mois à L’Amélie (éditions PLG, 2002 - Dupuis, 2002).
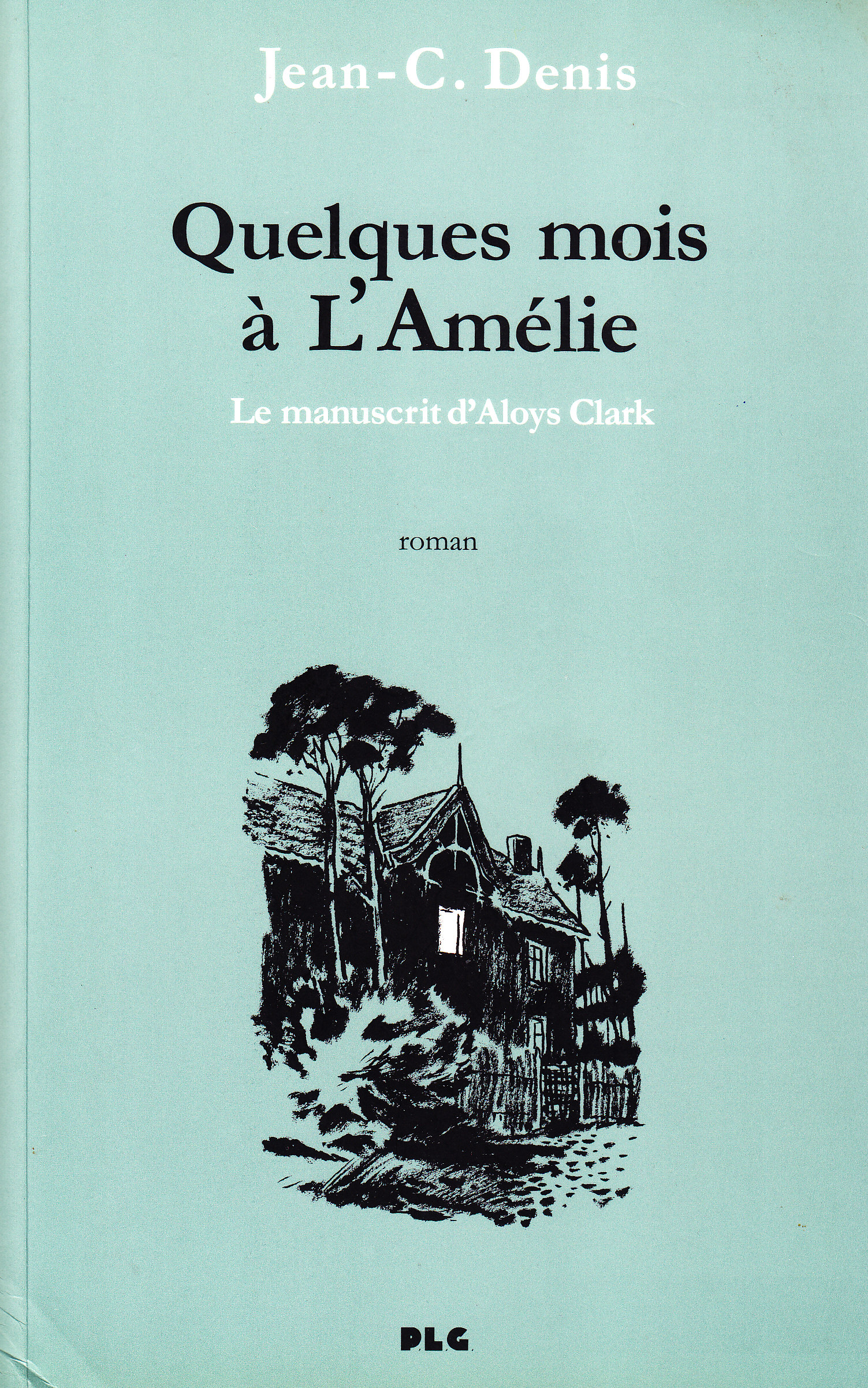

Images 1 et 2 - Les deux couvertures
Le héros est un écrivain en panne d’inspiration, qui se retrouve un peu par hasard dans un coin perdu du Sud-Ouest. Son histoire montre l’envers du décor du secteur de l’édition contemporaine et raconte comment une rencontre sentimentale relance son envie d’écrire.
Ces deux versions d’un même récit se présentent comme suit: la BD compte 72 pages, suivies de quelques pages d’un «Dossier» qui annonce l’existence du roman, écrit «parallèlement à la réalisation de [l]a bande dessinée», et donne trois extraits du texte, accompagnés de cinq illustrations. Le roman publié aux éditions PLG (92120 Montrouge) offre 213 pages, dont 36 occupées par des illustrations originales en noir et blanc et réalisées par l’auteur. En 2022, le catalogue de l’éditeur proposait «la version romancée de la bande dessinée du même nom» dans une nouvelle édition.
Il ne s’agit donc pas d’une transposition au sens strict, puisque nous ne savons pas (sauf à interroger l’auteur) quelle forme préexistait avant l’autre. Les deux versions entretiennent pourtant une relation particulière, vu que le roman est une autobiographie d’Aloys Clark, héros… de la BD, qui remet le manuscrit à Marianne, la femme qu’il aime, dans la dernière planche de l’album. Le roman est d’ailleurs sous-titré «Le manuscrit d’Aloys Clark» et dédicacé «à Marianne». À la fois objet intra-diégétique (Marianne va le lire) et extra-diégiétique (nous pouvons le tenir en main), le roman jouit donc d’un statut ambigu.
Le dispositif
Expérimentée personnellement en tant qu’enseignant de lycée en 2015-2016 et 2016-2017 auprès d’élèves de 17-18 ans inscrits dans l’enseignement qualifiant5, l’activité occupe au minimum deux heures consécutives et ne nécessite pas de lire les œuvres en entier. Le dispositif consiste à mettre en parallèle un court extrait des deux formes de l’œuvre; c’est ainsi que les trois premières planches, qui correspondent approximativement aux pages 5 à 9 du roman, ont été choisies. Outre l’intérêt de ce passage du récit pour notre propos, le choix de l’incipit a pour avantage de permettre à tous de commencer la lecture sans aucune préparation. Il s’agit donc «d’étudier [un] moment-clé dans deux systèmes sémiotiques différents» comme Castagnet-Caignec (2023: 122) le réalise avec des élèves du primaire à propos du Journal d’un chat assassin d’Anne Fine (École des loisirs/Rue de Sèvres, 1997/2021). La chercheuse en viendra à conclure (2023: 123) que l’étude simultanée des deux objets semble plus profitable aux élèves en termes de compétences de lecture littéraire.
Selon nous, l’analyse des deux formes de l’œuvre gagne à être menée en parallèle avec les élèves; elle suppose évidemment la projection en classe des deux supports (les planches de la BD et les pages du roman) et autorise un fonctionnement de leçon où l’enseignant conduit le groupe à travers un jeu de questions. Ce travail en parallèle pose la question de savoir par où commencer l’observation: la BD ou le roman ? Dans les lignes qui suivent, nous adoptons le plus souvent cet ordre, pour des raisons de clarté, mais il nous semble que, dans la pratique, on gagnerait à procéder en fonction des acquis des élèves, pour aller de la forme la plus connue vers la moins familière. Ajoutons que l’on pourrait prévoir dans la foulée une deuxième tâche où les élèves analyseraient, en autonomie, une autre planche et son correspondant romanesque, ce qui permettrait d’asseoir leurs acquis. Il va de soi aussi qu’un moment d’institutionnalisation des apports de l’activité est nécessaire pour fixer les découvertes dans l’esprit des élèves. Mais cette contribution entend se focaliser sur la première tâche de comparaison. Nous donnons ci-après un bref aperçu des contenus à dégager de cette première activité à mener avec les élèves.
L'analyse des deux formes
La première planche commence par un plan d’ensemble (vignette 1) puis un gros plan (vignette 2), là où le roman procède de manière classique pour un début (Verrier 1992): il précise lieu, temps, et relations. Dans la BD, la focalisation varie: d’abord externe pour donner à voir les lieux et les personnages, elle se fait vue subjective pour la troisième vignette. Le roman fonctionne plutôt comme un récit en «je» avec un narrateur-personnage (Dumortier 2001: 64) et dès la première page, un «récit de pensées» assez long permet d’entrer dans la vie intérieure du personnage. Ce choix est presque impossible pour la BD, qui recourt pourtant à un subterfuge avec la vignette 3 en nous donnant à voir, non pas ce qui est, mais ce que le personnage imagine (son père allongé dans son cercueil, mais habillé en uniforme militaire d’été).
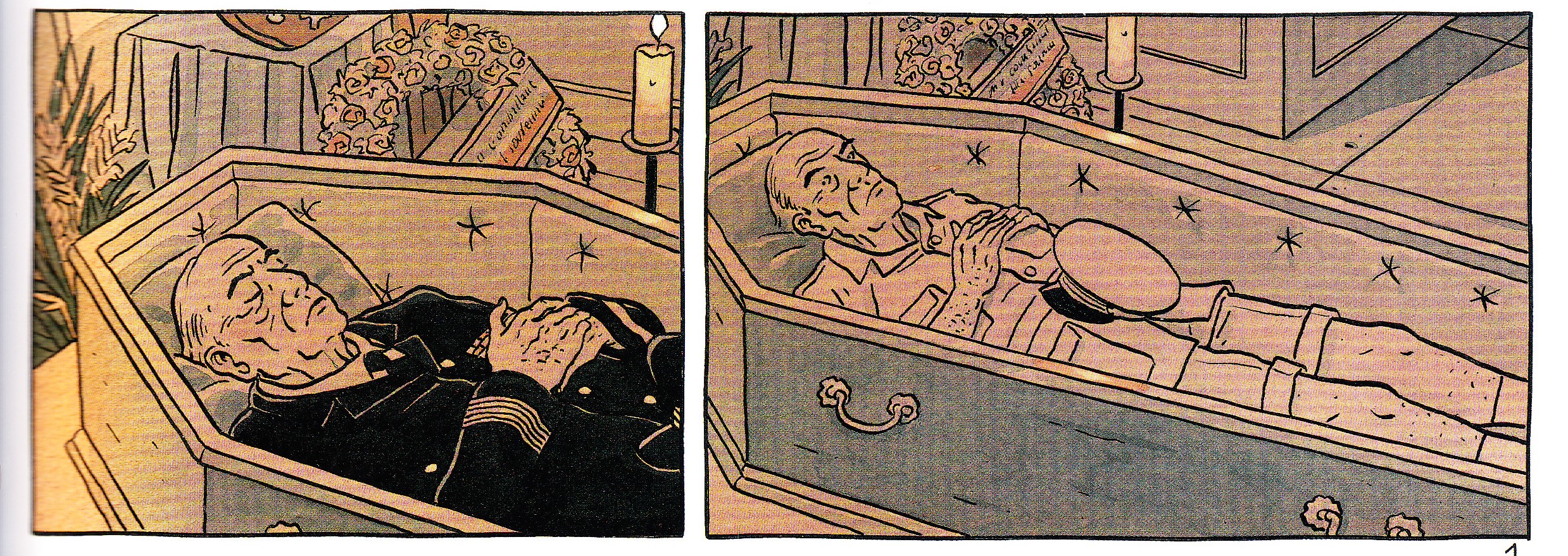
IMAGE 3- Vignette 3 de la planche 1
Le statut de toute cette scène du funérarium ne sera éclairci que dans la deuxième planche de la BD, alors que le roman signale dès la dixième ligne que nous sommes dans un souvenir du héros: «[…] la scène du funérarium me revenait souvent en mémoire».
La deuxième planche s’ouvre par une vignette dont la compréhension n’est pas évidente: certains détails de l’image sont en effet logiquement inconciliables (le costume noir porté en juin au funérarium et la pluie battante de décembre sur la vitre). L’action de la BD était pourtant située très clairement par une mention initiale du narrateur externe: «Paris, décembre 2000». La vignette ne représente donc aucune réalité, mais marque le moment d’une ellipse spatio-temporelle ou d’un retour au réel, la fin d’une rêverie, bien concrétisée dans la vignette suivante.

IMAGE 4 - Vignette 1 de la planche 2
Ce mouvement est bien plus clairement annoncé dans le roman, qui marque la transition en passant à la ligne et en donnant la réflexion d’une interlocutrice qui interrompt la rêverie. Cette transition est d’ailleurs explicitée dans le récit de pensée du narrateur qui se demande: «Depuis combien de temps étais-je debout devant cette fenêtre, à regarder tomber la pluie et à me repasser la scène du funérarium ?». Le roman bascule ensuite dans une scène aux dialogues très complets, assortis de réflexions personnelles nombreuses. Dans la BD, ce passage est rendu en huit cases, avec des dialogues réduits (vu le manque d’espace) et des cadrages très variés qui permettent de mettre en évidence des attitudes corporelles lourdes de signification (mais à décoder…). Alors que le roman doit consacrer quelques mots à décrire la jeune éditrice qui aborde le narrateur-héros, la BD n’en fait évidemment rien: les cadrages variés ont permis de décrire l’ambiance mondaine et de donner à voir le physique des personnages.
Après deux vignettes consacrées aux derniers échanges entre l’éditrice et le héros, la troisième planche marque une ellipse spatio-temporelle: ce dernier a quitté la soirée et se trouve dans un taxi.
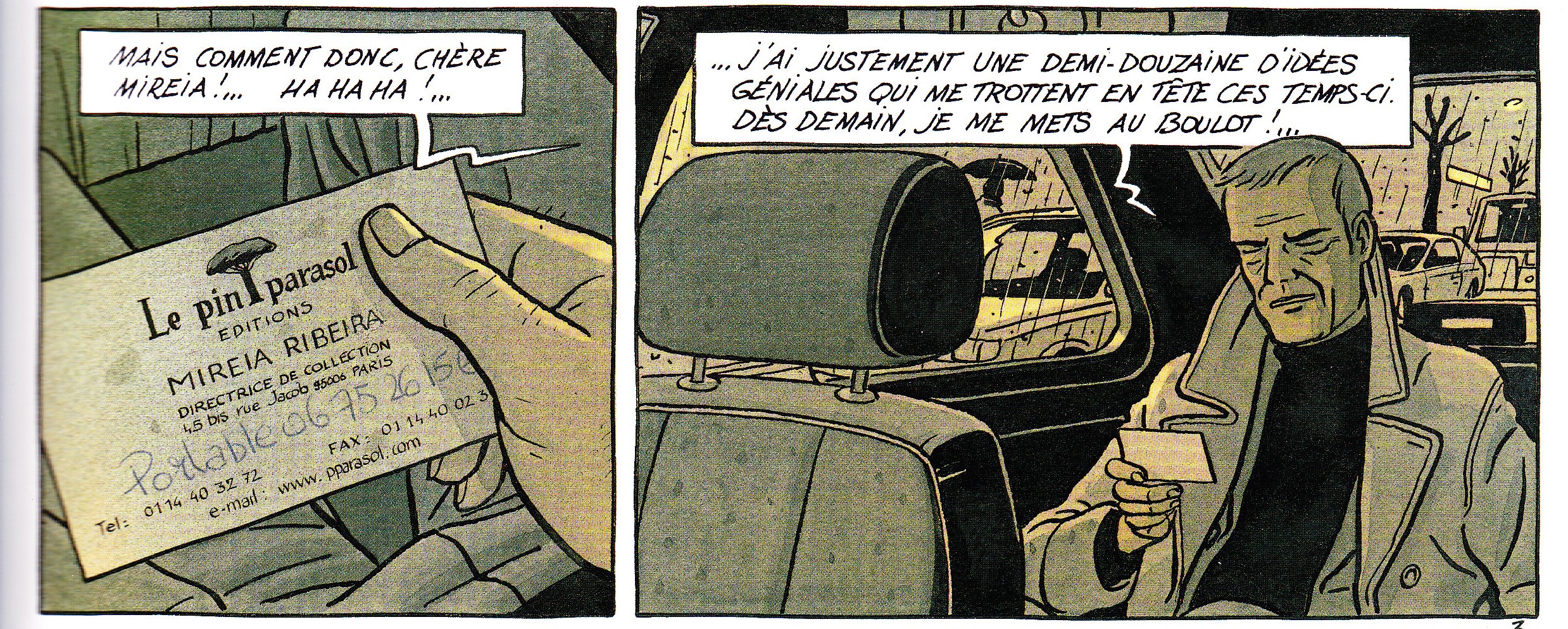
IMAGE 5 – Vignettes 3 et 4 de la planche 3
Nous ne le comprenons que progressivement, car la troisième vignette est une vue subjective (en gros plan) sur une carte de visite (reçue de la jeune éditrice). La quatrième nous montre le héros assis à l’arrière d’un véhicule, la carte en main. Dans un mouvement progressif d’éloignement, nous retrouvons la carte en morceaux qui tombe dans un caniveau. Une nouvelle fois, le roman se fait bien plus explicite, racontant le départ de la soirée, évoquant un dialogue avec le chauffeur de taxi, décrivant la carte de visite et livrant une interprétation de la démarche de l’éditrice.
Les apports de l'activité
De ces quelques éléments d’analyse, la première impression qui se dégage est sans doute que la lecture de la BD semble plus difficile que celle du roman, indépendamment d’un éventuel manque d’expérience des codes graphiques. Par exemple, là où le roman explicite verbalement une information, la BD exige du lecteur qu’il interprète des images ou un comportement traduit par celles-ci. On notera le même constat sur la difficulté chez Prévost (2023: 85) et Castagnet-Caignec (2023: 123) avec des œuvres adressées aux enfants, où le risque existe de créer de nouveaux problèmes pour les élèves, en introduisant des genres ou formes auxquels ils ne sont pas préparés (Bautier et alii 2012: 63). Raux fait la même observation avec un public adolescent (2021: 4) et nous avons rencontré les mêmes obstacles avec nos élèves de Terminale en options technologiques.
Quels seraient néanmoins les apports de cette comparaison, pour un enseignant de français et pour ses élèves ? On peut considérer que la première distinction qui risque d’apparaître sera celle du mode de représentation. En explicitant très souvent ce qui n’est que suggéré par la BD, le texte du roman raconte là où la BD ne fait que montrer, exigeant du lecteur qu’il décode et interprète ce qui est donné à voir. Ainsi, les attitudes corporelles visibles dans les vignettes qui montrent le dialogue (regard fuyant, gestes de mise à distance, évitement du face à face) doivent être analysées si l’on veut percevoir tout l’embarras de l’écrivain face à l’éditrice. Un embarras par contre explicitement affirmé par le narrateur-héros du roman, qui nous livre ses sentiments sans retenue. On retrouve ici la vieille distinction entre «montrer» et «raconter» initiée par Lubbock en 19216, développée par Genette («récit d’événements» et «récit de paroles» 1972: 186), et reformulée par Goldenstein (1999: 43) comme une opposition entre «représentation» et «relation». Conçue pour distinguer les formes de roman, cette distinction prend un tour particulier si on la mobilise dans une comparaison entre roman et BD. Car, sauf lorsqu’elle est pourvue d’un récitatif (Masson 1985: 26) équivalent d’une voix off cinématographique, mais absent dans nos trois planches, la BD ne fait que donner à voir, alors que le narrateur-héros du roman peut raconter et commenter, comme c’est le cas ici. Contrairement aux idées reçues, c’est donc bien la forme BD qui semble ici l’objet le plus «résistant» (Tauveron, 1999) à la sagacité du lecteur…
La tâche de comparaison présente en outre un intérêt très spécifique par rapport aux notions de base de la narratologie. En observant deux formes d’un même récit, où les choix effectués et les moyens mobilisés sont différents, les jeunes lecteurs perçoivent sans doute mieux les procédés et leur impact que s’ils étaient face à un texte romanesque. Ainsi la notion de «vitesse» (Genette, 1983: 22-25), de «cadence» narrative ou de «rythme» narratif (Dumortier 2001: 51) peut-elle émerger dans la lecture comparée des deux formes. Les élèves peuvent notamment mesurer combien la nécessité des descriptions romanesques et l’espace laissé aux monologues intérieurs du narrateur ralentissent le rythme du roman. Grâce à la comparaison, les procédés narratifs deviennent, comme le dit Rouvière (2021: 13), «littéralement visibles». En 2012 déjà, Meyer l’avait compris:
La particularité de la transposition […] sous la forme d’une bande dessinée est de faire voir la narration. […] Ce déploiement visuel du récit, monstratif, faudrait-il dire, est une entrée possible pour l’enseignement-apprentissage du récit en tant que forme, autrement dit le lieu d’une didactique du récit dans la classe. (Meyer 2012: 160-161).
Pour l’élève, l’activité permet de «réfléchir sur son activité de récepteur double» (Étienne & Mongenot 2023: 12) et sur l’interaction entre les deux lectures menées en parallèle. Il peut identifier quels moyens sont propres à chaque forme d’art et mesurer les difficultés pour rendre telle ou telle information accessible au lecteur (par exemple lors de l’analyse de la vignette 1 de la planche 2). Confronté à des systèmes sémiotiques différents (textuel versus iconotextuel), il perçoit combien la «transsémiotisation (passage d’un système sémiotique à un autre) […] modifie la réception du public» (Castagnet-Caignec 2023: 119). L’étonnement de l’élève ferait alors écho à celui de Töpffer lorsqu’il convertissait lui-même en roman (1840) son Docteur Festus: «Je fus tout surpris et amusé de voir par quoi les deux langues différaient, que, pour faire comprendre les mêmes choses, il fallait les prendre par un bout et les montrer par une autre face.»7
Cette confrontation aux deux formes permet aussi de montrer combien les effets produits sont parfois très différents. On rappellera qu’il s’agit du même auteur et de la même histoire, et que, s’il y a des différences, elles sont surtout inhérentes à la forme choisie8. Le dispositif de l’activité devrait donc assurer la perception de l’impact de la forme sur le récepteur, répondant ainsi au souhait d’Étienne et Mongenot: «développer le geste interprétatif par la comparaison entre systèmes différents» (2023: 7). On veillera aussi à dépasser deux écueils. Le premier consisterait à pratiquer un simple «décryptage techniciste» (Duvin-Parmentier 2020: 14). Le second pourrait laisser croire que roman et BD s’équivaudraient, considérant l’image comme «un équivalent iconique du texte littéraire, malentendu qui occasionne des simplifications de sa «lecture» et des transferts qui risquent de l’instrumentaliser et de l’affadir» (Duvin-Parmentier 2020: 14).
La découverte de la relation texte-image, se fait ici par l’approche du genre iconotextuel qu’est la BD. La planche, en tant qu’»énoncé pluricodé, […] scripto-iconique» (Klinkenberg: 2020) sera d’autant mieux réceptionnée qu’elle montre une parenté certaine avec le texte du roman, mais aussi des écarts flagrants. Ainsi, les dialogues des cases font écho à ceux du roman, souvent sous une forme légèrement abrégée, car l’interaction avec l’image permet au dialogue de la BD de se passer de certains mots. De la même manière, la représentation spatiale des échanges, dans la BD, traduit un comportement d’agacement qui sera rendu par un récit de pensées dans le roman. Concrètement, on réalise le programme défini par Lacelle, puisque «le passage d’une forme […] à l’autre permet de démonter chaque «machine narrative» en analysant les codes utilisés et les effets produits par ces codes.» (2012: 126).
Des outils pour l'écriture d'invention
Dans la perspective d’une tâche de création, quels peuvent être les apports de l’activité d’analyse décrite précédemment ? On peut pointer deux tâches auxquelles notre activité sur Quelques mois à l’Amélie offre une préparation directe: transposer un extrait de BD en roman, et transposer un extrait de roman en BD. La deuxième tâche pose cependant un problème de compétences graphiques chez les élèves: pour contourner cette difficulté, nous préconisons soit l’usage d’outils informatiques (souvent chronophages), soit un format que nous dénommons storyboard. Issue du cinéma, la notion désigne une série d’images qui donnent vie à un scénario avant le tournage. Nous l’employons ici pour désigner une forme de BD embryonnaire où seuls les arbitrages formels ont été esquissés, sans que le dessin soigné des images ait encore été réalisé. Cette dernière étape dépasserait en effet les compétences de la grande majorité des élèves. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourra recenser quelques-uns des apports de notre activité de comparaison comme suit.
Pour l’écriture du roman, les élèves auront perçu la nécessité de créer des pauses descriptives et d’effectuer des choix en la matière: tout ne peut pas être décrit et choisir d’évoquer telle ou telle réalité est un arbitrage de l’auteur. Autre apport probable, la compréhension du rôle majeur joué par les choix en matière de point de vue narratif. Ici on peut voir que la BD, en suivant sans cesse le même personnage et en pratiquant plusieurs fois la vue subjective, fait écho au choix romanesque d’Aloys Clark comme narrateur-personnage. D’autre part, la perception de l’importance des récits de pensée et de l’impact du mode de représentation de ceux-ci devrait conduire à les inscrire dans le texte du roman. Et enfin, les élèves auront été sensibilisés à la nécessité de travailler la mention des temps et lieux pour situer l’action.
Pour la transposition d’un extrait de roman en BD, et vu les compétences artistiques limitées de beaucoup d’élèves, l’enseignant de français pourrait s’en tenir à un travail sur le storyboard, ce qui réduit (?) la tâche au découpage de la page, à la réalisation du croquis des vignettes, à l’écriture des phylactères et du récit. Cependant, l’activité de comparaison aura permis d’approfondir chez ces élèves de lycée la compréhension de l’économie du récit en BD, ce que certains ont pu dénommer une «grammaire» (Vrydaghs 2022: 9) ou un «langage BD» (Rouvière, 2021: 3), à savoir le caractère elliptique de la narration en cases, l’importance des choix en termes de format et d’implantation des vignettes, le rôle de la triple interaction dessins/phylactères/récit du narrateur (même si ce dernier est absent dans les trois planches choisies) ou encore la «difficulté à expliciter le monde intérieur des personnages» (Dürrenmatt 2013: 45)…
Une des principales difficultés, si l’on demande aux élèves de produire un storyboard, risque d’être celle du découpage du récit en images, pour créer un «enchainement narratif visuel» (Rouvière 2021: 13). Trop souvent, cet aspect de la tâche n’est pas pris en compte dans la préparation, mais l’approche comparative que nous suggérons permettrait sans doute d’attirer l’attention des jeunes lecteurs sur les choix opérés par l’illustrateur et de les mettre en condition de réaliser leurs propres choix en connaissance de cause.
Sur un plan plus général, l’expérience menée nous conduit à partager l’opinion d’Étienne et Mongenot quant à l’impact de la comparaison qui permet de «déboucher sur la lecture affinée de textes ultérieurs et donc […] construire une réelle compétence de lecteur.» (2023: 14). Au-delà, nous pensons que la compétence de scripteur se trouvera elle aussi renforcée par la comparaison des versions, parce que l’on aura sensibilisé les élèves aux particularités formelles propres à chacune9. En définitive, la comparaison des deux formes devrait aider à la transposition de l’une dans l’autre.
Bibliographie
Abolgassemi, Maxime (2001), L’écriture d’invention: écrire pour lire, lire pour écrire, Rennes, CRDP de Bretagne.
Ahr, Sylviane (2012), «Les classiques en bande dessinée. Sacrilège ou tremplin ?», in Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches critiques et didactiques, I. De Peretti & B. Ferrier (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 197-208.
Bautier, Elisabeth, Jacques Crinon, Catherine Delarue-Breton & Brigitte Marin (2012), «Les textes composites: des exigences de travail peu enseignées ?», Repères, n° 45, p. 63-79.
Beghin, Sophie (2021), «La bande dessinée dans les classes de littérature: entre prescription et pratique», Transpositio, n°4.
Blanchard, Marianne & Raux, Hélène (2019), «La bande dessinée, un objet didactique mal identifié», Tréma, n° 51, p. 1-8.
Brunel, Magali, Karady, Albane & Friscia, Vanessa (2023). «Diversifier les réceptions sensibles pour préparer la lecture de l’œuvre littéraire. Comment Wang Fo fut sauvé en classe de Sixième», Le Français Aujourd’hui, n° 220, 91-104.
Castagnet-Caignec, Sonia (2023), «Lectures et contre-lectures du Journal d’un chat assassin en CE2-CM1: un éclairage interprétatif par la BD ?», Le Français aujourd’hui, n° 220, p. 117-130.
Denizot, Nathalie (2022), «Écriture d’invention, rhétorique et créativité dans l’enseignement secondaire» in Écritures créatives. Représentations contemporaines et enjeux professionnels, D. Ulma, A. Pauzet & A. Prouteau (dir.), Rennes, PU de Rennes, p.31-45.
Dumortier, Jean-Louis (2001), Lire le récit de fiction. Pour étayer un apprentissage: théorie et pratique, Bruxelles, De Boeck Duculot.
Depaire, Colombine (2019), État des lieux: La place de la Bande dessinée dans l’enseignement, Paris, Syndicat national de l’Édition.
Dürrenmatt, Jacques (2013), Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier.
Duvin-Parmentier, Bénédicte (2020), «La séance de lecture de l’image dans la séquence des professeurs stagiaires de français: représentations et choix méthodologiques», Pratiques, n°187-188.
Étienne, Bénédicte & Mongenot, Christine (2023), «Adjuvants, auxiliaires ou substituts: les OSS transmodaux en question», Le Français aujourd’hui, n°220, p. 5-17.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1983), Nouveau discours du récit, Paris, Seuil.
Gennaï, Aldo (2023), «Adaptations transmodales: usages et effets projetés dans quelques séquences en ligne pour le cycle 3», Le Français aujourd’hui, n°220, p. 21-35.
Goldenstein, Jean-Pierre (1999), Lire le roman, Bruxelles, De Boeck & Larcier.
Jacquin, Marianne (2018), «Le genre textuel au carrefour des paradigmes de la recherche en didactique des langues étrangères: conceptualisations et finalités» in Les genres textuels en langues étrangères: entre théorie et pratique, M. Jacquin, G. Simons, & D. Delbrassine (dir.), Berne, Peter Lang, p. 11-35.
Klinkenberg, Jean-Marie (2020), «Pour une grammaire générale de la relation texte-image», Pratiques, n°185-186.
Lacelle, Nathalie (2012), «La déconstruction et la reconstruction des œuvres multimodales. Une expérience vécue en classe à partir des bandes dessinées Paul et Persépolis», in La littératie médiatique multimodale, M. Lebrun, N. Lacelle, J.-F. Boutin (dir.), Québec, Presses de l’Université de Québec, p. 125-140.
Louichon, Brigitte (2017), «La réception scolaire des œuvres patrimoniales ou les Objets Sémiotiques Secondaires à l’école», in Les formes plurielles des écritures de la réception (vol.1): Genres, espaces et formes, F. Legoff & M.-J. Fourtanier (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 23-36.
Lubbock, Percy (1957 [1921]), The Craft of Fiction, New York, The Viking Press.
Masson, Pierre (1985), Lire la bande dessinée, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
Meyer Jean-Paul (2012), «À propos des albums de BD adaptés de romans: de la transposition littéraire à la transposition didactique», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, ELLUG, p. 157-170.
Prévost, Julie (2023), «La transmodalisation, un levier pour une inclusion efficiente des élèves allophones ?», Le Français aujourd’hui, n° 220, p. 77-88.
Raux, Hélène (2021), «La bande dessinée en classe: une lecture à didactiser», Transpositio, n° 4.
Rouvière, Nicolas (2012), «Introduction», in Bande dessinée et enseignement des humanités, N. Rouvière (dir.), Grenoble, ELLUG, p. 7-18.
Rouvière, Nicolas (2017), «Adapter en classe des extraits de roman sous forme de BD: quels apports pour la lecture littéraire ?», Revue de Recherches en littératie médiatique multimodale, n°6.
Rouvière, Nicolas (2021), «Quelle didactique pour la bande dessinée ? Retour sur trois tournants théoriques de la décennie 2010-2020», Transpositio, n°4.
Schneuwly, Bernard (1994), «Genres et types de discours: considérations psychologiques et ontogéniques», in Les interactions lecture-écriture: Actes du colloque Théodile-Credil (Lille, nov. 1993), Berne, Peter Lang, p. 155-173.
Simons, Germain (2018), «De la place des genres textuels dans les familles de tâches en langues modernes», in Les genres textuels en langues étrangères: entre théorie et pratique, M. Jacquin, G. Simons, & D. Delbrassine (dir.), Berne, Peter Lang, p. 37-70.
Tauveron, Catherine (1999), «Comprendre et interpréter le littéraire à l’école: du texte réticent au texte proliférant», Repères, n° 19, p. 9-38.
Ulma, Dominique, Anne Pauzet & Anne Prouteau (dir.) (2022), Écritures créatives. Représentations contemporaines et enjeux professionnels, Rennes, PU de Rennes.
Verrier, Jean (1992), Les débuts de romans, Paris, Bertrand-Lacoste.
Vrydaghs, David (2022), «Enseigner les compétences nécessaires à la lecture des bandes dessinées», Échanges, n°43, p. 2-10.
Zakhartchouk, Jean-Michel (1999), L’Enseignant, un passeur culturel, Paris, Éditions Sociales Françaises.
Documents officiels évoqués
Fédération Wallonie-Bruxelles (1999), Compétences terminales et savoirs requis en français: humanités générales et technologiques. (24 pages).
Fédération Wallonie-Bruxelles (2018), Compétences terminales et savoirs requis en français: humanités générales et technologiques. (71pages).
Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
Les éditions des Fables disponibles aujourd’hui sous la forme de reproductions numériques invitent à poser un nouveau regard sur l’articulation entre le texte et l’image.
Accompagner des enseignant·es pour parler des illustrations: Le cas du projet «La Fontaine à l’école numérique»
Les éditions des Fables disponibles aujourd’hui sous la forme de reproductions numériques invitent à poser un nouveau regard sur l’articulation entre le texte et l’image. La consultation désormais possible de reproductions d’éditions anciennes, rares, parfois même originales de textes grâce aux outils numériques les plus récents promet une expérience de lecture inédite et une attention renouvelée pour l’illustration.
Dans le cadre du projet de recherche intitulé «La Fontaine à l’école numérique», nous nous sommes intéressée à l’intégration dans les classes genevoises d’éditions numérisées des fables, dont certaines étaient illustrées. Le parti pris d’un enseignement dédié aux dimensions matérielles des textes a engagé une importante réflexion sur l’articulation entre le texte et l’illustration. Pour accompagner au mieux une équipe d’enseignantes et d’enseignants du degré secondaire, plusieurs médiations didactiques1 ont été élaborées, qui nous renseignent sur les connaissances et compétences nécessaires pour intégrer la lecture d’images dans le cours de français.
Le projet «La Fontaine à l’école numérique» et les choix méthodologiques opérés
Issu d’un partenariat entre le Bodmer Lab de l’Université de Genève et le département de l’instruction publique genevois, le projet «La Fontaine à l’école numérique» a vu le jour à la rentrée scolaire de septembre 2019. Il s’agissait de réunir un groupe d’enseignantes et d’enseignants de français des degrés secondaire I et II et une équipe universitaire de recherche pluridisciplinaire, en vue de réfléchir à l’intégration dans les classes des éditions des Fables récemment numérisées par le Bodmer Lab. Le Bodmer Lab est un projet de recherche et de numérisation de l’Université de Genève, qui entend numériser, de manière raisonnée, une part significative de la collection Martin Bodmer aujourd’hui conservée dans une fondation située dans la région genevoise2.
Le soutien apporté par le DIP a pris la forme d’un appui logistique – dans la mesure où ce sont les équipes du service école-média du canton qui ont permis l’emprunt d’une trentaine de tablettes numériques – et celle d’un dégrèvement financier d’une heure d’enseignement par semaine pour les cinq enseignantes et enseignants du projet, soit une enseignante et deux enseignants du degré secondaire I (élèves de 12 à 15 ans, toutes filières) et deux enseignants du degré secondaire II (élèves de 15 à 19 ans, filière gymnasiale).
Le corpus choisi était alors celui des Fables de la Fontaine, et plus précisément celui des éditions des XVIIe et XVIIIe siècles numérisées par les spécialistes du Bodmer Lab. L’une des ambitions du projet consistait à permettre à l’enseignante et aux enseignants de créer des ressources didactiques pour l’enseignement des dimensions matérielles des Fables, qui soient ensuite diffusables à une plus large échelle. Très vite, la question de l’illustration – sa place dans l’ouvrage, sa fabrication ou encore l’intérêt accordé à celle-ci dans le processus interprétatif – s’est posée. Pour des enseignantes et enseignants de littérature, ayant pour habitude d’étudier le texte comme une abstraction sémiotique, il s’agissait alors d’intégrer de nouvelles perspectives et, notamment, de prendre en compte les images proposées dans les éditions numérisées. Il fallait par conséquent leur offrir un certain bagage de connaissances et de compétences leur permettant de se sentir à l’aise dans leurs classes pour enseigner le texte et les illustrations qui l’accompagnent.
Le projet de recherche a été mené en trois phases: une première phase de formation du groupe d’enseignant·es à l’approche matérielle des éditions, et à la découverte des outils, notamment numériques, créés par les chercheurs/euses donnant accès aux illustrations des Fables; une deuxième phase dédiée à l’élaboration du matériel pédagogique; et une troisième phase combinant mise en œuvre du matériel pédagogique créé dans les classes et retour d’expérience de la part de l’équipe enseignante. Dans cet article, nous nous intéresserons principalement aux deux premières phases du projet, car ce sont celles qui ont mené l’équipe enseignante à mobiliser les outils et les savoirs sur les illustrations mis à leur disposition par les chercheurs/euses universitaires. Nous reviendrons également sur le travail réalisé par les chercheurs/euses du Bodmer Lab, en amont du projet «La Fontaine à l’école numérique», pour détailler l’ensemble des savoirs et des outils produits autour de ces éditions numérisées et de leurs illustrations.
Le cadre théorique: modèle de recherche, approche matérielle des œuvres littéraires et relation texte-illustration
Modèle de recherche
La recherche alors mise en œuvre comporte de nombreux points communs avec le modèle de «recherche collaborative» élaboré par Serge Desgagné (Desgagné 1997, 2001). Dans les recherches de type collaboratives, des enseignant·es, désignés par Desgagné sous l’expression de «praticiens», sont mis en relation avec des chercheurs/euses et cela dans le but de produire une certaine émulation dont les répercussions toucheront les deux domaines:
La culture scolaire incite le praticien enseignant à se donner les moyens de développer et d’améliorer sa pratique, plus spécifiquement la qualité de son intervention auprès des élèves dont il a la responsabilité. La culture scientifique incite le chercheur universitaire à contribuer à la production des connaissances dans un domaine donné. L’entente collaborative consiste à faire en sorte qu’une même activité réflexive aménagée autour d’un projet d’exploration négocié́ fasse que ces attentes respectives soient comblées à la satisfaction des deux parties. La collaboration de recherche prend également le sens d’un souci d’interinfluence entre ces acteurs, praticiens et chercheurs, et leurs cultures respectives. En fait, le chercheur vise une production de connaissances qui inclue et tienne compte du point de vue du praticien et des contraintes de son contexte d’action. De même, on pourrait dire que le praticien vise un développement de pratique qui soit éclairé́ par le point de vue du chercheur et par les repères conceptuels qui guident sa production de connaissances. En ce sens, l’entente collaborative sous-tend aussi qu’il y ait interinfluence entre la pratique et la recherche. D’où l’idée de coconstruction (Cole, 1989) d’un savoir dans une “zone interprétative” partagée. (Desgagné 2001: 39)
Autrement dit, dans une recherche de type collaborative, enseignant·es et enseignant·es ne poursuivent pas les mêmes objectifs et n’effectuent pas les mêmes tâches, mais produisent des connaissances ou des pratiques enseignantes participant au développement de leurs domaines d’expertises respectifs. C’est ainsi que les enseignante et enseignants du projet ont pu acquérir une nouvelle perspective sur le texte en s’intéressant aux images, et que les enseignant·es ont pu voir le fruit de leur travail atteindre de nouveaux publics et voir émerger de nouvelles questions de recherches liées notamment aux requêtes de l’équipe enseignante. Les enseignant·es universitaires rencontré·es ont permis au corps enseignant de découvrir de nouvelles méthodes pour intégrer la lecture et l’interprétation d’illustrations dans leurs cours portant sur le texte littéraire. En parallèle, les enseignant·es ont réalisé des médiations prenant différentes formes, qui permettaient d’accéder de manière guidée aux connaissances qu’ils avaient établies sur les textes et sur les images issues des patrimoines numérisés.
À propos de la recherche collaborative, Vinatier & Morrissette précisent qu’il est important «d’établir un contrat de recherche collaborative» qui inclue les points suivants:
1/ tous les participants n’ont pas les mêmes responsabilités;
2/ l’existence d’un leadership où les rôles des différents partenaires sont clairement définis en fonction de leurs expertises spécifiques et de leurs complémentarités nécessaires
3/ une négociation préalable des modalités relationnelles et du partage des responsabilités de divers ordres au niveau interinstitutionnel. (Vinatier & Morrissette 2015: 152)
Le projet «La Fontaine à l’école numérique» a répondu à ces trois critères, dans la mesure où il a permis la mise en relation d’enseignant·es du degré secondaire avec des enseignant·es universitaires dont les domaines d’expertises allaient de la littérature française du XVIIe siècle à la matérialité des textes, en passant par l’histoire de l’art. Mais si les enseignant·es apportaient des connaissances sur les patrimoines numérisés, ce sont les membres de l’équipe enseignante, dont l’expertise repose sur la pratique d’enseignement devant un public d’adolescents, qui ont sélectionné ce qu’ils souhaitaient retenir et utiliser des différentes médiations proposées.
Enseigner des textes dans des matérialités nouvelles comme celles des reproductions numériques suppose de la part du corps enseignant la capacité à appréhender les textes selon une perspective inédite. Pour rendre justice aux patrimoines numérisés dans les classes, il convient en effet d’aborder ces textes d’une manière qui dépasse l’approche purement textuelle. Depuis les années 1960-70, les courants herméneutiques dominants pour enseigner le texte littéraire au degré secondaire privilégient en effet une certaine abstraction sémiotique du texte vis-à-vis des supports qui le donnent à lire. À la suite de la Nouvelle Critique et des approches structuralistes et formalistes du texte, les enseignantes et enseignants de littérature française étudient en classe le texte comme un ensemble de signes linguistiques à la fois sémantiques et syntaxiques. Il s’agit avant tout de fournir aux élèves des outils (narratologiques, rhétoriques, stylistiques) permettant de comprendre et d’interpréter les textes littéraires, et de les commenter de manière argumentée. Dans cette perspective, le texte littéraire est appréhendé indépendamment de son support, et donc de ses éventuelles illustrations. Or, il faut noter que pour certains textes la dimension iconographique fait partie intégrante de l’œuvre. C’est le cas de la plupart des éditions des Fables de La Fontaine: rappelons-le, l’édition originale proposait déjà cent dix-huit gravures pour cent vingt-quatre fables. Nous avons donc fait le pari, avec le projet «La Fontaine à l’école numérique», de proposer une approche des textes qui rende justice aux supports dans lesquels s’inscrit le texte. Cette approche, c’est celle de la matérialité des textes.
Approche matérielle des textes
Grâce au numérique et aux campagnes de numérisations menées depuis les années 2000, de nombreux textes sont aujourd’hui aisément consultables dans des versions anciennes voire originales. C’est le cas notamment de la toute première édition des Fables de La Fontaine, dont la Fondation Martin Bodmer possède deux versions3. En convoquant en classe une reproduction numérique de ce texte dans son édition originale, l’enseignant de français, habituellement formé à étudier la textualité des fables est bien emprunté et il lui faut recourir à d’autres approches pour valoriser la dimension esthétique plus large de l’objet consulté.
L’approche qui rend le mieux justice aux matérialités littéraires est celle de la bibliographie matérielle. Issue des sciences bibliographiques, elle étudie les inscriptions matérielles des textes sur leurs différents supports. Cette approche des textes considère que l’objet-livre – ou, de manière plus générale, le support du texte - est porteur de signes non sémantiques pouvant eux aussi contribuer à son analyse et à son interprétation. On doit la plupart des idées novatrices de cette approche herméneutique à Donald F. McKenzie, un chercheur d’origine néo-zélandaise pour qui non seulement le terme de «texte» ne se limite pas aux seuls livres manuscrits et imprimés, mais comprend aussi des «non-verbal texts» (cartes, images, plans, par exemple) et des versions orales de textes. Popularisée en France par l’historien Roger Chartier qui a fourni la préface de l’édition française de l’ouvrage de McKenzie intitulé La Bibliographie matérielle et la sociologie des textes (1991), ce domaine de la recherche bibliographique promeut également la prise en compte de la dimension sociale des textes, dès lors qu’on les étudie dans leurs différentes éditions. Pour McKenzie:
Le principe fondamental que je voudrais suggérer est celui-ci: la bibliographie est la discipline qui étudie les textes en tant que formes conservées, ainsi que leurs processus de transmission, de la production à la réception. Rien de profondément novateur dans cette formulation, cependant il importe de considérer que par «textes», j'entends toutes les formes de textes, et pas seulement les livres ou les signes tracés sur papier ou parchemin […]. Et il s’agit aussi d'accepter l'idée selon laquelle la tâche du bibliographe est de montrer que les formes ont un effet sur le sens. Cette définition nous amène également à ne plus nous contenter de décrire les procédés techniques de la transmission de «textes» mais à nous intéresser aussi à sa dimension sociale. Par sa spécificité́, elle permet de prendre en compte les textes qui ne sont pas des livres, leurs formes matérielles, leurs versions textuelles, leurs techniques de transmission, le contrôle institutionnel dont ils font l'objet, leurs sens perçus et leurs effets sociologiques. Elle appelle une histoire du livre et de toutes les formes imprimées, y compris les imprimés éphémères et utilitaires qui témoignent des changements culturels, soit dans la civilisation de masse, soit dans la culture minoritaire. (McKenzie 1991 [1986]: 30-31)
Il s’agit alors d’étudier les différentes traces matérielles présentes sur les éditions des textes – par exemple les traces liées à la fabrication de l’objet-livre – dans le but de comprendre ces objets textuels dans les contextes socio-culturels qu’ils ont traversés. Le sens accordé au texte pourrait ainsi être réinscrit dans la préoccupation de son temps, grâce à l’étude minutieuse des marques matérielles que pourrait comporter l’objet-livre:
Au premier degré, une sociologie des textes pourrait se contenter de décrire toutes les réalités sociales au service desquelles s’est mise l’imprimerie, des quittances aux bibles. Mais elle doit aussi nous amener à nous interroger sur les motivations et les interactions humaines qu’impliquent les textes aux différents stades de leur production, transmission et consommation. Elle doit nous faire réfléchir aux rôles des institutions, à leurs structures complexes, à la façon dont elles affectent les formes du discours social, passé comme présent. Telles sont les réalités que la bibliographie et la critique textuelle avaient, jusque dans un passé très récent, négligé́ de prendre en compte ou défini comme strictement non bibliographiques. (McKenzie 1991 [1986]: 33)
L’approche matérielle des textes proposée par McKenzie engage à considérer les différentes facettes de l’objet-livre, et dans cette optique, l’illustration se voit conférer un statut nouveau. La compréhension et l’interprétation du texte s’accompagnent ici d’une prise en compte de l’objet même qui le donne à lire et de toutes les dimensions que cela comprend: reliure, péritexte, et, pour ce qui nous intéresse ici, illustrations.
L’illustration: une partie intégrante de l’œuvre
L’illustration du texte fait partie intégrante de l’œuvre et l’approche par la matérialité permet de valoriser la prise en compte de celle-ci lors de la compréhension et de l’interprétation du texte. En effet, s’il n’est plus question d’étudier seulement la sémantique ou la syntaxe du texte, mais également l’inscription de celui-ci dans les différents supports qui le proposent à la lecture, alors les illustrations, les gravures, les ornements et autres culs-de-lampe4 qui ornent l’ouvrage peuvent eux aussi être pris en compte dans l’analyse et l’interprétation conférée au texte.
Les illustrations présentées dans les différentes éditions sont le résultat d’un processus de fabrication. Dans la première édition des Fables (1668)5, par exemple, les illustrations proposées sont des gravures sur bois dont les matrices ont également servi lors de l’édition de 16786, soit la deuxième édition du texte, parue dix ans plus tard. Ce souci économique exerce alors une certaine influence sur l’esthétique de l’objet et, par conséquent, sur l’expérience de lecture, car l’édition originale a été réalisée dans un format in-quarto, plus grand que l’édition in-octavo de 1678: l’espace accordé à l’image se trouve donc proportionnellement bien plus grand dans l’édition de 1678 que dans celle de 1668. Cet exemple montre qu’une attention particulière accordée à la dimension matérielle de l’œuvre, permet également de mettre en évidence les techniques et usages qui ont permis la réalisation de certaines images.
Prendre en compte la dimension matérielle d’une œuvre, c’est aussi réaliser que les illustrations proposées sont une première forme d’interprétation accordée au texte. En effet, l’image, et plus encore les vignettes dont sont pourvues les premières éditions des Fables, ne peuvent représenter l’ensemble des péripéties racontées dans la fable. Il existe un décalage entre les possibilités du texte et la temporalité qu’il présente, et le caractère instantané de la représentation iconographique. Ainsi, étudier la gravure d’une fable consiste également à regarder l’événement reproduit sur l’image et à le mettre en perspective avec l’ensemble du récit. L’illustration montre par conséquent une première interprétation de l’œuvre, dans la mesure où c’est l’illustrateur qui a décidé du moment qu’il convenait de faire figurer à l’image. Par exemple, dans la célèbre fable «Le Corbeau et le Renard», François Chauveau, l’illustrateur de la première édition du texte (1668), a décidé de représenter le moment où le renard attrape le fromage dans sa gueule, tandis que Jean-Baptiste Oudry7 (1755) a, lui, décidé de montrer le moment où le corbeau détient encore le fromage dans son bec. Les deux illustrateurs n’ont pas choisi de représenter le même moment de la fable; et cela montre l’interprétation qu’ils en proposent, sans même parler du style esthétique adopté par chacune de ces illustrations.
Dans le but d’accompagner au mieux les enseignant·es du projet «La Fontaine à l’école numérique» à prendre en considération les illustrations du texte, plusieurs médiations ont été réalisées par les enseignant·es du Bodmer Lab. En effet, grâce à la collaboration étroite entretenue avec le Bodmer Lab, le projet «La Fontaine à l’école numérique» a pu compter sur le soutien, essentiellement de deux chercheuses universitaires, pour étoffer leurs connaissances sur les illustrations. Il s’agit d’une chercheuse spécialiste de la littérature XVIIe siècle et d’une historienne de l’art ayant procédé à la mise en ligne sous la forme d’une iconothèque des quelques mille-huit-cents illustrations des Fables, qui se trouvaient dans les éditions numérisées par le Bodmer Lab. Cela a permis notamment de faire émerger certains questionnements mêlant approche matérielle de l’œuvre et rapport à l’image. Ainsi, dans le cadre des discussions entre les enseignant·es et les enseignant·es, la question de la place accordée à l’illustration dans l’ouvrage a été abordée tant pour parler de l’espace physique consacré aux représentations iconographiques, aux ornements et autres signes esthétiques de la typographie, que pour parler de l’articulation entre l’image représentée et le texte proposé. Enfin, parler de la place des illustrations suppose aussi que soient évoqués les mécanismes et les techniques qui permettent de les réaliser et de leur donner une existence matérielle.
Des médiations réalisées pour accompagner l’enseignement des Fables et de leurs illustrations
Au cours du projet «La Fontaine à l’école numérique», une série de médiations ont été réalisées pour permettre aux enseignant·es d’intégrer les illustrations à leurs enseignements. En tant qu’enseignant·es de français, ils n’étaient pas formés aux questions liées aux images et, pourtant, dès le début du projet, plusieurs d’entre eux ont formulé l’envie d’intégrer cette dimension en classe.
Des fiches thématiques pour les enseignant·es
C’est au cours d’une rencontre avec une spécialiste du XVIIe siècle que les premières questions portant sur les illustrations sont apparues. Il faut dire que jusque-là, les informations mises à disposition des enseignant·es avaient été présentées sous la forme de fiches d’informations présentant une synthèse de la question et une bibliographie sélective. Ces fiches avaient été réalisées par une chercheuse chargée d’enseignement au département de littérature de l’UNIGE. Elles se présentaient alors comme un bref descriptif de certains points de débats sur les Fables, alors recueillis dans la littérature secondaire, et en particulier dans les textes critiques portant sur les premières éditions des Fables. Parmi les dix-huit fiches créées par la chercheuse, il existe au moins trois fiches entièrement dédiées à la question des illustrations : la septième du dossier qui porte sur les techniques d’illustration et les douzième et treizième qui concernent le rapport entre le texte et l’image. Si la fiche dédiée à la question des techniques de fabrication propose la description succincte des différentes techniques employées pour la réalisation d’images (gravure sur bois, gravure sur cuivre, gravure à l’eau-forte ou encore lithographie), les fiches 12 et 13 portent davantage sur la problématique du rôle et de la place de l’illustration dans le corpus des Fables.
La douzième fiche du dossier présente un bref état des lieux de la question de l’image pour le corpus étudié. Trois types de questionnements y sont évoqués: la question du statut des illustrations vis-à-vis de l’œuvre de La Fontaine – et tout particulièrement vis-à-vis de la première édition du texte (1668); la question du rapport entre le genre de la fable illustrée et celui des emblèmes8 et, enfin, la question des liens entre les illustrations et le texte. Pour chacune de ces orientations, un bref paragraphe propose un état de la recherche ainsi que plusieurs références. Notons d’ailleurs que cette fiche est accompagnée d’une longue bibliographie, permettant aux enseignant·es, s’ils le souhaitaient, d’approfondir l’un ou l’autre des points mentionnés.
La treizième fiche propose tout d’abord un «questionnaire heuristique», emprunté à Stefan Schoettke (1997), élaboré dans le but de guider la lecture des images pour l’analyse des Fables de La Fontaine. Puis, une série de remarques portent sur les différents illustrateurs des éditions des Fables numérisées par le Bodmer Lab.C’est par le biais de ces fiches que les enseignant·es ont d’abord accédé à des informations sur les illustrations des Fables.
Une conférence sur les illustrations
Profitant de la collaboration étroite avec l’équipe de cherccheurs/euses du Bodmer Lab et dans le but d’approfondir la familiarisation des enseignant·es avec les illustrations proposées par les éditions numérisées des Fables, nous avons ensuite convié une historienne de l’art, membre de l’équipe du Bodmer Lab, à venir présenter le corpus des illustrations des Fables et les outils développés par le projet de recherche pour accéder à celles-ci. Il faut dire que, dès sa création, le Bodmer Lab a formulé une forte envie de partager le fruit de ses recherches avec un large public et notamment un public scolaire. Pour cela, le projet de recherche universitaire n’a pas hésité à créer des outils favorisant l’accès à ses textes mais aussi – et c’est ce qui nous intéresse ici – aux illustrations de celles-ci. Avec cette invitation, il s’agissait de permettre aux enseignant·esde découvrir non seulement l’étendue du corpus des illustrations des Fables numérisées, mais aussi l’iconothèque développée par le Bodmer Lab et disponible en ligne. Revenons à présent sur ces deux médiations.
Lors de sa participation au projet «La Fontaine à l’école numérique», l’historienne de l’art et chercheuse travaillant alors pour le Bodmer Lab, a proposé une conférence sur la question des illustrations présentes dans le corpus des éditions des Fables numérisées par le Bodmer Lab. Durant cette prise de parole, la chercheuse a d’abord procédé à une vaste introduction dont l’objectif consistait à dresser un état des lieux de la question de l’illustration des Fables au XVIIe siècle. Il s’agissait de donner à voir aux enseignant·es l’étendue des débats, mais aussi de pointer le manque de ressources disponibles pour les enseignant·es, portant sur l’articulation entre le texte et l’image. Ensuite, la chercheuse a proposé une plongée dans les premières illustrations de ce texte, à savoir les gravures de François Chauveau. Enfin, pour terminer, elle s’est attelée à présenter la dimension iconographique de cinq autres éditions conservées à la Fondation Martin Bodmer et numérisées par le Bodmer Lab.
Au cours de cette conférence, la chercheuse avait à cœur de fournir aux enseignant·es à la fois une vision globale des illustrations disponibles sur le site du Bodmer Lab, mais également quelques outils pour appréhender celles-ci. Ainsi, lorsqu’elle a procédé à la présentation des illustrations de François Chauveau, la chercheuse a présenté différentes manières d’aborder les images. Ses remarques ont alors porté sur le nombre d’illustrations présentes dans l’ouvrage, sur l’esthétique de celles-ci – en mentionnant entre autres le goût de l’illustrateur pour la peinture septentrionale ou ses nombreux emprunts à l’univers du théâtre. Elles ont aussi porté sur les péripéties racontées sur l’image, pour insister sur les choix opérés par Chauveau dans la représentation des événements racontés dans la fable. La spécialiste est également revenue sur la représentation des animaux et de la nature. Elle a montré aux enseignant·es comment analyser une image, notamment en comparant différents premiers, deuxièmes et troisièmes plans. Enfin, elle a procédé à un commentaire approfondi de l’illustration de «La Cigale et la Fourmi», notamment pour mettre en lumière certains débats portant sur l’illustration de cette fable. Dans la deuxième partie de son parcours dans les fables numérisées par le Bodmer Lab, la chercheuse a présenté, de manière comparative, cinq éditions différentes des Fables. Elle a parlé des contextes dans lesquels celles-ci s’inscrivaient et a insisté sur les rôles des différents intervenants dans la création de la gravure ou de la lithographie. Enfin, elle a étudié quelques illustrations notables pour chacune de ces éditions dans le but de montrer les différentes esthétiques adoptées et les points communs entre celles-ci. Il faut dire que la chercheuse avait une connaissance approfondie de l’ensemble des quelques 1800 illustrations des Fables disponibles dans la base de données du Bodmer Lab. En effet, c’est elle qui avait procédé à la mise forme et à la mise en ligne de celles-ci dans l’iconothèque9 développée par ledit projet de recherche.
Une iconothèque: un outil inédit
L’iconothèque est un outil développé par le Bodmer Lab pour faciliter un accès direct aux illustrations des Fables provenant des éditions numérisées par le projet de recherche. Il s’agit d’une plateforme disponible en ligne et renfermant les quelques 1800 illustrations extraites des pages qui les proposent à la lecture. Le site internet se veut intuitif; il est précisé dans la description de celui-ci que»[l]’interface permet de filtrer les illustrations par les champs “Titres des Fables” et “Artistes” qui peuvent être interrogés ensemble afin d’affiner les critères de recherche10.»
 Figure 1: Capture d'écran d'une page de l'iconothèque 11
Figure 1: Capture d'écran d'une page de l'iconothèque 11
L’avantage principal de cet outil est la navigation facilitée entre les différentes illustrations d’une même fable. En sélectionnant par exemple le titre d’une fable, il est possible de convoquer l’ensemble des illustrations de celles-ci et de les consulter en naviguant à l’aide des flèches présentes sur les côtés. Plusieurs informations sont renseignées sur la provenance de l’illustration ainsi que sur les artistes qui ont confectionné la gravure et trois options sont offertes sous l’image étudiée: agrandir l’image, consulter la page d’où elle provient ou, encore, la télécharger. Il est également possible de trier les images d’après des artistes qui les ont réalisées. Cela pourrait par exemple permettre de comparer la représentation d’un animal en particulier entre différentes fables et selon un même artiste. Enfin, soulignons que dans la description de cette iconothèque, nous trouvons quelques mots sur les coulisses de ce projet et notamment sur le travail effectué par les enseignant·es du Bodmer Lab pour recadrer l’illustration et la présenter indépendamment de la page dont elle provient, tout en conservant une qualité d’image suffisamment élevée.
À partir de ces rencontres et des outils qui leur ont été présentés, les enseignant·es ont élaboré des activités pédagogiques. Regardons à présent comment ces savoirs sur les illustrations des Fables ont été employés en classe.
De quelques activités pédagogiques sur les illustrations des Fables
Finalement, trois activités créées dans le cadre du projet «La Fontaine à l’école numérique» ont pour sujet principal la question des illustrations. Deux d’entre elles ont été élaborées par un enseignant du degré secondaire I et la troisième par deux enseignants du degré secondaire II. 12
«Les illustrateurs des Fables de La Fontaine»
La première de ces activités porte le titre «Les illustrateurs des Fables de La Fontaine». Il s’agit d’une activité dont le déroulement est prévu en quatre ou cinq périodes d’enseignement. Trois étapes la composent: une première étape de découverte et de présentation de l’iconothèque du Bodmer Lab, une deuxième consistant à répondre à des questions à travers un questionnaire écrit et une troisième de mise en commun et de correction des exercices réalisés. Les objectifs poursuivis dans cette activité sont les suivants:
- - Découverte du lexique de l’illustration
- - Présentation des illustrateurs des Fables
- - Sensibilisation aux différentes lectures d’un même texte que suscitent les illustrations
- - Sensibilisation aux fonctions des images (illustration vs interprétation) (Fiche d’activité «Les illustrateurs des Fables de La Fontaine» : 1)
Plus concrètement, dans un premier temps, les élèves sont amenés à découvrir le site internet du Bodmer Lab ainsi que l’iconothèque qu’il propose. Ils doivent choisir des illustrations et indiquer la raison de leur choix. À l’aide d’un questionnaire guidé et d’extraits de textes critiques, les élèves se familiarisent avec un vocabulaire lié à l’esthétique ainsi qu’aux fonctions de l’illustration dans Les Fables et tout particulièrement dans la première édition de ce texte. Ils poursuivent ensuite le questionnaire en naviguant dans plusieurs éditions des Fables et en consultant les illustrations de celles-ci. Il s’agit à la fois de développer les compétences des élèves en matière de navigation en ligne mais aussi leur aptitude à rechercher et à sélectionner des informations précises. Puis, une étude plus approfondie de «La Cigale et la Fourmi» propose aux élèves de comparer plusieurs illustrations entre elles ainsi qu’avec le texte. Il s’agit ici pour les élèves de constater l’existence d’une variété d’illustrations pour une seule et même fable. Les illustrations sont alors le fruit de décisions prises par les illustrateurs quant à la manière de faire apparaître les personnages de l’apologue ou encore quant à la scène de la fable représentée sur l’image. Enfin, l’activité se termine sur la comparaison de quatre illustrations de la fable «Le Chêne et le Roseau». Les élèves sont alors invités à reconnaître l’artiste ayant représenté la fable dans les différentes vignettes proposées, et il leur est demandé de préciser le «style de l’illustration».
Dans cette série d’exercices, nous retrouvons une grande partie des discussions qui ont été menées lors des rencontres avec les chercheuses du Bodmer Lab. Il est aussi intéressant de souligner que l’enseignant a cherché non seulement à familiariser les élèves avec plusieurs illustrations et plusieurs illustrateurs mais aussi avec les outils numériques développés pour donner accès à celles-ci. L’activité proposée par l’enseignant semble donc à l’image de la formation qu’il a reçue; celle-ci a consisté, d’un côté, à montrer l’étendue des données récoltées sur les illustrations par le Bodmer Lab et, de l’autre, à présenter des outils inédits pour atteindre ces illustrations.
«Rédaction d’une fable à partir d’une lecture d’image»
La deuxième activité par cet enseignant a pour objectif principal la rédaction d’une fable à partir d’une illustration. Dans le descriptif proposé par l’enseignant, quatre autres visées sont également mentionnées: approcher la notion de littérature secondaire, découvrir l’exercice de l’analyse d’une image, sensibiliser les élèves aux liens entre le texte et l’image et finalement les exercer à l’écriture de fables. Une nouvelle fois l’activité est pensée pour une durée d’environ cinq à six séances de cours. Les exercices présentés dans cette activité alternent entre la lecture d’extraits de textes de littérature secondaire portant sur les illustrations et des questions orientées visant à permettre aux élèves d’analyser l’illustration et ses relations avec le texte présenté. La progression dans l’activité est la suivante: après un questionnaire guidé sur la vignette de la fable de «La Cigale et la Fourmi» de l’édition originale, des exercices sont proposés autour de vignettes proposant plusieurs saynètes dans une seule et même illustration, distinguant notamment la morale des autres événements. Enfin, une image est proposée aux élèves, à partir de laquelle ils sont invités à élaborer le texte d’une fable.
L’activité imaginée ici s’inspire une nouvelle fois des médiations réalisées par le Bodmer Lab. Mais cette activité est effectuée exclusivement sous format papier. Cela signifie que les élèves ne manipulent pas directement les outils numériques créés comme l’iconothèque ou encore les éditions numérisées des textes. Ici c’est plutôt le rapport entre texte et illustration qui est étudié, dans la perspective de permettre aux élèves de cerner la structure générique d’une fable ainsi que le lien entre l’interprétation de la fable et l’illustration qui l’accompagne. Il s’agit alors de permettre aux élèves d’élaborer une fable dont l’illustration existe déjà. Le processus est inversé par rapport à la pratique habituelle qui voudrait que l’illustration se présente comme un complément au texte. Ici c’est le texte qui s’inspire de l’illustration et qui se construit autour de celle-ci.
«Liens entre le texte et les illustrations des Fables»
La troisième activité créée par des enseignants s’adresse d’abord à des élèves du degré secondaire II, puisque c’est avec une classe de 2ème année de maturité gymnasiale qu’elle a été expérimentée. L’activité s’intitule «Liens entre le texte et les illustrations des Fables» et elle présente une série de cinq objectifs:
- Découvrir l’iconothèque du Bodmer Lab, se familiariser avec son utilisation et être capable de l’exploiter pour une production écrite.
- Découvrir les illustrations anciennes des Fables présentes dans l’iconothèque du Bodmer Lab.
- Découvrir des outils pour analyser les illustrations et apprendre à les utiliser.
- Prendre conscience de l’impact de l’image au niveau de l’expérience de lecture et de l’interprétation du texte.
- Confronter différentes lectures d’une même fable, à travers la comparaison de différentes illustrations. (Fiche d’activité «Liens entre le texte et les illustrations des Fables»: 1)
À la fin de l’activité, il est attendu que les élèves effectuent des présentations orales du travail réalisé par groupe, en réponse à la consigne suivante:
«(1) Choisissez une fable que vous aimez tout particulièrement. (2) Recherchez dans l’iconothèque les différentes illustrations de la fable choisie. (3) Analysez chaque illustration, à l’aide du questionnaire.* (4) Choisissez l’illustration (ou les illustrations) qui, d’après vous: (a) présente(nt) au mieux l’histoire que la fable raconte; (b) rend(ent) au mieux la fable, sa morale, sa signification, l’interprétation que vous en donnez. (5) Justifiez votre choix!». (Fiche d’activité «Liens entre le texte et les illustrations des Fables»: 1)
Le document à destination des élèves contient une série de questions inspirées de la fiche réalisée par la chercheuse du Bodmer Lab portant sur le rapport entre le texte et l’illustration. Il s’agit d’une reprise du questionnaire heuristique emprunté à Stefan Schoettke (1997). Nous constatons ici que le travail de médiation réalisé par les chercheurs/euses du Bodmer Lab a été plus qu’intégré par les enseignant·es puisqu’ils ont repris les grandes lignes de ce document. Plus concrètement, l’articulation entre le texte et les illustrations est à découvrir en progressant dans le questionnaire de Schoettke. Les questions portent alors sur l’illustration, dans le but de cerner les personnages de la fable qui sont mis en scène dans l’image, le moment de l’histoire qui figure sur celle-ci, le traitement appliqué par l’artiste à la scène retenue, la question de l’anthropomorphisme ou encore la relation, plus globale, entre le texte et l’histoire racontée.
En somme, les médiations proposées aux enseignant·es pour intégrer la question de l’illustration dans les activités élaborées pour des élèves du degré secondaire ont, semble-t-il, été d’une grande utilité. En effet, elles ont permis non seulement de cerner l’étendue des enjeux et débats sur la question, mais également de diffuser de nouveaux outils utilisables depuis l’espace de la classe – iconothèque et plateforme de consultation des éditions numérisées. Si les rapports entre le récit de la fable et le moment représenté sur l’image fait l’objet de plusieurs activités, l’illustration est aussi traitée comme un objet d’analyse à part entière et cela vient peut-être du pari d’accorder à la matérialité de l’œuvre une attention particulière.
Conclusion
Cet article avait pour ambition de décrire les médiations mises en œuvre dans le cadre du projet «La Fontaine à l’école numérique» pour permettre aux enseignant·es d’intégrer les illustrations dans les activités proposées aux élèves.
Il nous semble pertinent de revenir sur l’articulation proposée entre approche matérielle des textes et prise en compte de l’illustration. À partir de ce travail effectué sur le corpus des Fables de La Fontaine en version numérisée, et en réfléchissant à la place que nous avons accordée dans les réflexions menées dans le cadre du projet sur les illustrations, il nous paraît cohérent de considérer l’illustration comme faisant partie intégrante de la dimension matérielle de l’œuvre. En effet, non seulement l’illustration est intrinsèquement liée à l’objet-livre dans lequel le texte est inscrit, mais en outre, l’analyse qui peut être menée sur celle-ci fait ressortir de nombreuses dimensions de l’approche matérielle des textes. L’étude des illustrations fait intervenir des questions liées au processus de fabrication de l’image autant qu’aux choix réalisé par l’illustrateur/trice (ou par l’éditeur/trice) quant à la représentation donnée du texte.
Constatant la prudence des enseignant·es à intégrer les illustrations lors d’exercices portant sur l’interprétation littéraire, nous avons pris le parti de compléter la formation de ceux-ci sur les premières illustrations des Fables. Grâce à un partenariat étroit avec le projet de recherche du Bodmer Lab, nous avons pu mettre en relation directe des enseignant·es du secondaire et des spécialistes de l’histoire de l’art ou encore de la littérature du XVIIe siècle. Cette collaboration a ensuite donné lieu à des activités pédagogiques destinées aux élèves, et inspirées de la formation que nous avions pu proposer. Le modèle de recherche – recherche collaborative – mis en œuvre dans cette recherche a facilité le déplacement des connaissances, du domaine de la recherche savante vers celui de la classe, tout en reconnaissant l’expertise de chacun durant le processus. Soulignons enfin l’importance des outils développés par les enseignant·es pour permettre aux enseignant·es de s’emparer de ces questions iconographiques – et donc de mettre à profit dans un tel projet à la fois leur expérience et leur expertise.
Bibliographie
Allott, Terence (2000), «Les éditions des Fables choisies mises en vers publiées du vivant de l’auteur et leur illustration», Le Fablier, no. 12, Paris, p. 9-34.
Chartier, Roger (1985), Pratiques de la lecture, Rivages, Paris.
Chartier, Roger, Jean, Lebrun (1997), Le livre en révolutions: entretiens avec Jean Lebrun, Les éditions Textuel, Paris, 1997.
Chartier, Roger (1998) «Chapitre XI» in Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et incertitudes, Albin Michel («Bibliothèque des histoires»), Paris.
Chartier, Roger (2015), La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur. XVIe-XVIIIe siècles, Gallimard [Folio histoire], Paris.
Citton, Yves (2017) «Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images», Transpositio, n°1, en ligne, URL: https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-dans-l-univers-des-techno-images (consulté le 19 avril 2024).
Cornuaille, Philippe, Alain Riffaud (2018) «Enquêtes sur les premières éditions des Fables de La Fontaine (1668)», Bulletin du bibliophile, no.2, Paris, p. 246-280.
Curat, Hervé (2016), «Regarder écouter lire. La dimension visuelle des Fables de 1668», Le Fablier, n° 27, p. 61‑71.
Serge Desgagné (dir.) (2001), «L'approche collaborative de recherche en éducation: un rapport nouveau à établir entre recherche et formation», Revue des sciences de l'éducation, volume 27, numéro 1, p. 33–64, en ligne, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2001-v27-n1-rse369/000305ar/ (consulté le 05.08.2022).
Jacob, Christian (2001), «La carte des mondes lettrés» in Des Alexandries, tome I. Du livre au texte, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2001.
Jacob, Christian (2001), «L’art de lire», in Des Alexandries, tome II. Les métamorphoses du lecteur, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2004.
Lacelle, Nathalie, Jean-François Boutin, Monique Lebrun (2018), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, LLM@. Outils conceptuels et didactiques, Presses de l'Université du Québec, Canada.
McKenzie, Donald (1991), La bibliographie et la sociologie des textes [1986], trad. Marc Aureville, Cercle de la Librairie, Paris.
Schoettke, Stefan (1997), «Réflexions sur les rapprochements entre la fable selon La Fontaine et le genre de l’emblème», Le Fablier, no. 9, p. 31-42.
Vinatier, Isabelle, Joëlle Morrissette (2015), «Les recherches collaboratives: enjeux et perspectives», Carrefours de l'éducation, vol. 39, no. 1, pp. 137-170, en ligne, URL: https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2015-1-page-137.htm (consulté le 15 août 2022).
Sites internet et éditions consultables en ligne
«Iconothèque», site rattaché au site du Bodmer Lab, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/iconotheque/#/lafontaine/1072035095_017_1_-edition:1818 (consulté le 25 janvier 2024).
Site internet du Bodmer Lab, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr (consulté le 25 janvier 2024).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, éd. Claude Barbin, 1668, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072035109 (consulté le 30 janvier 2023).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, éd. Denys Thierry, 1668, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072035108?page=109 (consulté le 30 janvier 2023).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, et par luy reveuës, corrigées & augmentées, éd. Denys Thierry, Claude Barbin, Paris, 1678, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072055785 (consulté le 30 janvier 2023).
Site internet du Bodmer Lab, Fables choisies, mises en vers par M. J. de La Fontaine, éd. Desaint & Saillant, Durant, Charles-Antoine Jombert, Paris, 1755, en ligne, URL: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/barcode/1072056065 (consulté le 30 janvier 2023).
il est permis à Claude Barbin Libraire à Paris, d’imprimer les Fables choisies par M. de la Fontaine, avec défense à tous autres d’en imprimer vendre ou débiter sans son consentement, d’autres que celles par lui imprimées, ou par Denys Thierry, Libraire à Paris, auquel il a cédé la moitié de son Privilège; & ce sous les peines portées les plus amplement par ledit Privilège. («Extrait du Privilège du Roi», Fables Choisies et mises en vers par M. de La Fontaine, 1668, [en ligne], consulté le 12.01.2024: https://bodmerlab.unige.ch/fr/constellations/fables-esopiques/mirador/1072035108?page=356, typographie modernisée par nos soins).
Voir également :
Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Que pourraient nous apprendre les images dans les manuels de lecture et les anthologies sur l’enseignement de la littérature au primaire et au secondaire? Le cas de la Suisse romande, entre les années 1870 et les années 1970.
Les images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires (Suisse romande, 1870-1970)
Introduction
Poser la focale sur l’image dans les manuels scolaires de langue maternelle1dans le cadre d’une enquête historico-didactique peut sembler au premier abord inattendu. Que pourrait nous apprendre l’analyse des images dans les livres de lecture et les anthologies scolaires, supports privilégiés pour l’enseignement de la littérature? Celles-ci ne participent-elles pas avant tout d’une stratégie éditoriale visant à garantir l’attractivité du manuel? Sans nier l’importance de cette dimension, nous postulons, à l’instar de Perret (2018) pour la France, que les images dans les manuels constituent des indicateurs clés de l’histoire des disciplines scolaires. Louichon (2018) a montré notamment comment l’analyse des images associées aux textes littéraires permet de mettre en lumière des représentations de la littérature scolarisée contrastées selon les niveaux d’enseignement et qui évoluent en fonction des périodes. Qu’en est-il donc en Suisse romande?
Cette étude se donne pour but d’historiciser les relations entre l’image et le texte, en particulier littéraire, dans les manuels de lecture du primaire et les anthologies du secondaire inférieur de Suisse romande, et ce entre les années 1870, marquées par une première tentative d’harmonisation intercantonale, et les années 1970, qui voient l’adoption de manuels communs à tous les cantons romands dans le cadre d’un nouveau paradigme disciplinaire (Schneuwly et al. 2016). Comme le relèvent Ferran et al. (2017), la notion d’image est complexe. En posant la focale sur «l’image» dans les manuels scolaires, nous définissons provisoirement l’image comme toute représentation visuelle qui n’est pas du texte.
Nos questions de recherche sont donc les suivantes:
- Quels manuels de lecture comprennent des images? Quelle est, dans ces manuels, la proportion d’images par rapport aux textes? Quelle est la nature de ces images, sont-elles conçues ou non pour les manuels et qui en sont les auteurs?
- Quel est le statut de ces images par rapport aux textes? Y a-t-il des propositions didactiques et des activités proposées dans les manuels sur ces images, seules ou en lien avec certains textes?
- Enfin, quelles sont les fonctions assignées à ces images? Viennent-elles simplement illustrer le manuel pour le rendre plus attrayant? Sont-elles au service de la compréhension, voire de l’interprétation du texte? Ou encore tiennent-elles lieu de texte destiné à être lu et interprété?
Précisions méthodologiques
Pour traiter cette problématique, cette étude, qui s'inscrit dans le cadre du projet intitulé «Histoire de l’enseignement de la littérature en “Français” et en “Italien” (Suisse romande et Tessin, mi-XIXe-XXe siècles)» (requête FNS n°100019_197600/1), adopte une approche comparative de type historico-didactique qui s’inspire de la démarche développée par Bishop (2017).
Ainsi, les manuels2 constituent le terrain de recherche principal (Denizot 2016) de cette étude (cf. tableaux 1 et 2 en annexe). Ils constituent des objets aux multiples facettes qui conjuguent des enjeux éditoriaux, économiques, culturels et scolaires (Choppin 2008). Notre corpus est constitué de 46 ouvrages pour les degrés intermédiaire (élèves de 9 à 11 ans) et supérieur (élèves de 12 à 15 ans) du primaire et le degré inférieur du secondaire3 (élèves de 12 à 15 ans) prescrits officiellement par les autorités scolaires des cantons romands. Celui-ci est mis en regard, d’une part, des plans d’études et des programmes édités par les cantons4, d'autre part des articles tirés des revues professionnelles5 qui portent sur la question de la place et de la fonction des images dans les pratiques pédagogiques et dans l'enseignement de la langue maternelle.
Cette étude recourt ensuite, par le croisement de sources, à un jeu d’échelles qui permet les comparaisons. En Suisse, comme nous l’avons dit plus haut, le système scolaire relève au niveau politique principalement de la compétence des cantons. Ainsi, pour notre période, les plans d’études et programmes sont cantonaux. Les manuels scolaires se situent dans un espace intermédiaire: certains sont adoptés par un seul canton, d’autres par plusieurs cantons. Enfin, les revues pédagogiques dépassent largement les frontières cantonales, se faisant l’écho de débats et controverses qui se situent au niveau d’une région linguistique, voire au niveau suisse.
Par ailleurs, cette étude pose la focale plus particulièrement sur quatre cantons contrastés du point de vue de la question de la laïcité à l’école et de la religion6: Genève (protestant et laïque), Vaud (protestant et non laïque mais confessionnellement neutre), les parties francophones de Berne (catholique et protestant, non laïque) et de Fribourg (catholique et non laïque). Ces quelques constats nous permettent d'ores et déjà de supposer que les textes et les images dans les manuels diffèrent d'un canton à l'autre selon la place de la religion et de l'Église dans la gestion de l'Instruction publique et dans les enseignements. Alors que Fribourg se constitue en République chrétienne avec un pouvoir conservateur renforcé qui va au-delà de l’entre-deux-guerres (Praz 2005: 52), il est à supposer que le rôle conféré à l’image dans la tradition catholique – entre autres instruire, émouvoir et marquer l’esprit – (Saint-Martin 2010: 303) puisse se retrouver dans les livres de lecture. À l’inverse, le processus de sécularisation qui touche par exemple la société vaudoise a pu amener les auteurs et éditeurs à faire d'autres choix iconographiques pour leurs manuels.
Enfin, l’analyse de ces données prend appui sur des concepts qui se situent à l’articulation entre les champs de l’histoire de l’éducation et de la didactique de la littérature. Il s’agit notamment de celui de littérature scolarisée. Utilisé au départ par les historiens de l’éducation (Hébrard 1988), le concept de scolarisation désigne, comme le rappelle Denizot (2021), les processus complexes qui sous-tendent la fabrication des objets scolaires en tant que partie de la culture scolaire. Cette dernière est ici envisagée comme une culture qui prend ses racines et s’élabore dans le milieu scolaire, présentant ainsi une spécificité propre par rapport à la culture de la société globale (Chervel, 1992). Il a été montré qu’en Suisse romande - comme en France - la constitution des corpus littéraires s’opère dans la discipline Français entre la fin du XIXe siècle et les années 1970, essentiellement au sein des manuels scolaires par le biais d’extraits (Monnier 2021). Les manuels participent donc pour la période qui nous occupe à la fabrication de la littérature scolarisée, c’est-à-dire de la littérature comme objet scolaire.
Le texte s'organise enfin sur la base d’une périodisation en trois temps, inspirée de travaux antérieurs (Schneuwly et al. 2016). Nous nous centrons d'abord sur la période qui va des années 1870 aux années 1910. Celle-ci se caractérise par la constitution du Français en discipline scolaire et par le développement de l'enseignement intuitif et de la leçon de choses. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1910 aux années 1940, au cours de laquelle, sous l’influence de l’Éducation nouvelle7, les images se diffusent largement au sein des manuels scolaires. Nous terminons avec une focale sur les années 1940-1970 qui se caractérisent par une absence d’évolution et une prégnance moins forte de l’Éducation nouvelle, non sans impact sur la nature, la place et la fonction des images.
Première période (1870-1910). Les images au service du développement des connaissances
Même si dès le début du XIXe siècle des ouvrages scolaires dédiés à l’apprentissage de la lecture courante sont édités au sein des cantons romands, force est de constater que ce n’est qu’à partir des années 1870 que certains moyens d’enseignement sont officialisés, voire généralisés. Cette période est ainsi marquée par une première tentative d’harmonisation des moyens d’enseignement et par l’adoption d’ouvrages de lecture communs qui se concrétisent par la constitution d’une commission romande et par la parution en 1871 de deux livres de lecture adoptés par les cantons de Berne, Vaud et Genève et dédiés aux écoles primaires (Tinembart 2015): le premier, comportant 166 pages, est destiné au degré intermédiaire (Renz 1871) alors que le second, produit à l’échelle romande, comportant 420 pages, est édité pour le degré supérieur (Dussaud & Gavard 1871). Ces deux ouvrages de lecture comprennent près de deux tiers de textes à caractère encyclopédique. Les autres écrits se répartissent entre des récits et des anecdotes diverses, des lettres, ainsi que des poésies narratives ou lyriques. En revanche, les images sont peu présentes. Seules 24 gravures en taille-douce représentant toutes des animaux ont été relevées dans les parties non littéraires du Renz (1871). Il est également intéressant de constater que ces images sont parfois orientées dans un autre sens que le texte par gain de place et qu’elles sont dissociées de l'extrait auquel elles pourraient se rapporter. Nous pouvons en déduire que la fonction de l’image, tout comme celle du texte, est alors de transmettre des connaissances sans pour autant que les deux soient en relation directe. A titre d’exemple, une image d’éléphant est insérée à côté d’une image de dromadaire dans un extrait de texte de Lenz (sans prénom), adapté par Renz, dédié aux animaux domestiques de nos contrées, et qui ne contient de fait qu’une seule phrase sur les charges que peut porter le pachyderme.
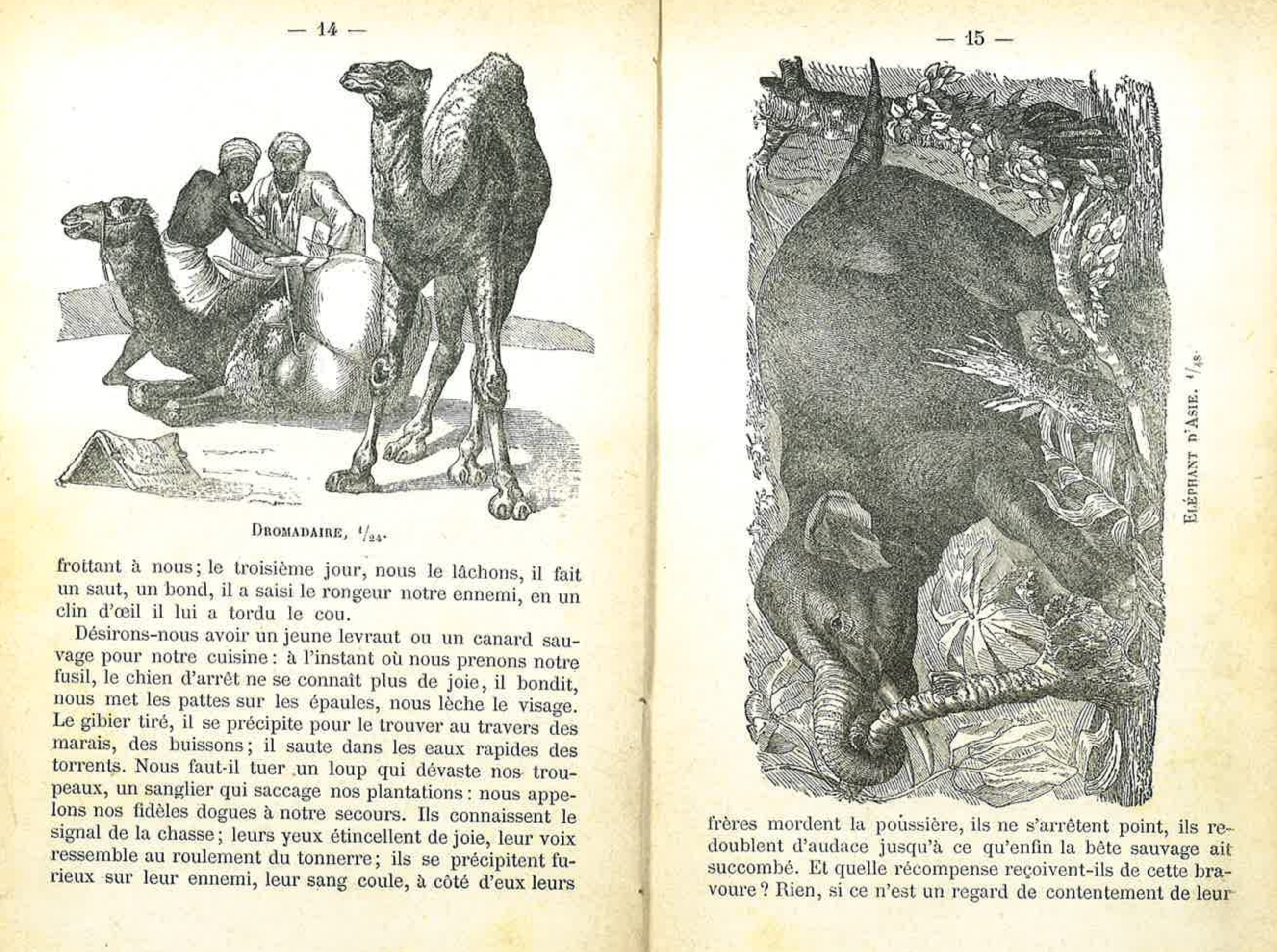
Figure 1: Éléphant d’Asie, 1/48 (Renz 1871: 15)
En revanche, dans le Dussaud et Gavard (1871), le texte dédié à l’éléphant, écrit par le zoologiste Henri Milne Edwards (1800-1885), n’est pas illustré et revêt un caractère plus scientifique, parce qu'il s'adresse aux élèves des degrés supérieurs du primaire et est utilisé dans les premiers degrés des écoles secondaires. Il est intéressant de constater que, dans l’adaptation fribourgeoise de ce même ouvrage en 1881 (Dussaud & Gavard 1881), le texte de Lenz figurant dans le Renz (1871) est alors repris et qu’une autre image d’éléphant y est insérée8.
Entre 1880 et 1900, la génération suivante d’ouvrages officiels de lecture dans les cantons romands conservent leur caractère encyclopédique, mais associent plus étroitement illustrations et textes encyclopédiques. Les images jouent alors un rôle propédeutique quant à la découverte et à la formation au savoir. Cela s’explique notamment par le fait que les plans d’études (à l’instar du Plan d’études pour les écoles primaires du Canton de Vaud du 29 février 1868: 16, qui prescrit «une collection de tableaux pour servir aux leçons d’intuition, une collection de tableaux de lecture et un manuel de lecture») préconisent l’usage de la méthode intuitive dès la fin des années 1860.
Les principes de l’enseignement intuitif9 s’articulent avec la leçon de choses qui apparait dans les programmes romands à partir des années 1870. Selon Kahn, la leçon de choses «se fonde sur la préconisation du recours à l’intuition et n’est pas spécialement associée à un enseignement disciplinaire déterminé, l’enseignement scientifique» (2002: 2).
Aussi, les ouvrages de lecture, en particulier ceux du degré moyen ou intermédiaire, encore majoritairement à caractère encyclopédique en Romandie entre 1880 et 1900, intensifient la présence d’images en lien avec les textes pour permettre aux enseignants d’appliquer la méthode intuitive ou de concevoir des leçons de choses. Certains auteurs renforcent le nombre d’images de sciences naturelles comme dans le Trésor de l’écolier (1885) du canton de Berne. D’autres, comme Le livre de lecture pour les écoles primaires de Fribourg, Degré supérieur (1899), n’illustrent que la partie historique.
Dans les cantons catholiques, à l’instar du canton de Fribourg, certains manuels comme le Livre de lecture pour les écoles primaires du canton de Fribourg, Degré moyen (1889) sont en revanche illustrés dans toutes les parties. Cependant, les deux ouvrages de lecture fribourgeois de 1889 et de 1899 comportent une première partie consacrée aux textes moraux et religieux qui n’existent plus dans les livres des cantons protestants. Au degré moyen (1889), nous trouvons des textes tels que «Dieu notre créateur»; ce premier extrait est illustré par un Dieu ténébreux montrant sa colère depuis les cieux. En revanche, l’ouvrage destiné au degré supérieur (1899) ne contient pas d’image religieuse. La différence majeure entre les ouvrages des cantons protestants et catholiques réside donc dans le fait que les premiers n’incluent pas de textes relatifs à la religion et pas d’images chrétiennes, puisque des ouvrages d’histoire biblique sont édités en parallèle. Les cantons catholiques conservent des textes dits à caractère religieux dans les ouvrages de lecture courante.
Au début du XXe siècle, nous observons une mue dans les ouvrages de lecture. Des auteurs comme Dupraz et Bonjour (1899) expurgent de leurs nouvelles publications les textes à caractère encyclopédique parce qu’ils déclarent «tenir compte aussi de la prochaine publication de manuels spéciaux (histoire, sciences naturelles)» (Dupraz & Bonjour 1903: préface). Dès lors et pour répondre également aux prescriptions cantonales, leurs manuels ne comportent que des textes d’auteurs reconnus non illustrés. Si la littérature a d’ores et déjà fait son apparition dans une moindre mesure dans les ouvrages de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871), il n’en demeure pas moins que les Dupraz et Bonjour (1899/1903) marquent un véritable tournant. Les deux Vaudois affirment que «les livres de lecture s'étaient peu à peu transformés en petites encyclopédies ou abrégés scientifiques d’un attrait et d’une utilité problématique pour l’élève» (Dupraz & Bonjour 1899: III). Ils puisent alors «largement dans la littérature contemporaine» (1899: IV) en proposant des extraits variés organisés en thématiques et non imagés.
Dans les filières secondaires des cantons protestants, les ouvrages à caractère encyclopédique et imagés de Renz (1871) et Dussaud et Gavard (1871) sont également utilisés avec les plus jeunes élèves de la filière secondaire. En revanche, pour les élèves plus âgés, ce sont les trois tomes de la Chrestomathie française de Vinet (revue et augmentée par Eugène Rambert) qui sont utilisés. Ces volumes, qui comprennent exclusivement des textes littéraires, n’ont aucune image. Ces Chrestomaties, dès leur parution, obtiennent un large écho qui les pérennise dans leur forme pendant près d’un siècle et marquent durablement l’enseignement du français. Cela met en lumière le phénomène suivant: la lecture et l’étude des textes n’a pas la même fonction dans les deux filières. Au primaire, les livres de lecture sont un vecteur d’acquisition de connaissances; au secondaire, les chrestomathies et les anthologies visent à développer la culture littéraire et langagière de l’élève dans un enseignement encore marqué par les principes rhétoriques.
Au cours de cette première période, l’image est donc présente dans les parties encyclopédiques des livres de lecture du primaire, mais déconnectée du texte.
Deuxième période (1910-1940). Les images comme portes d’accès à la lecture des textes littéraires
Cette deuxième période se caractérise par un contraste fort entre les anthologies et chrestomathies prescrites pour les filières du secondaire qui, à l’instar de la première période, ne comportent généralement aucune image, et les manuels de lecture du primaire où les images vont se multiplier, aussi bien dans le degré moyen que dans le degré supérieur10.
Or, contrairement à la période précédente, où les images étaient présentes dans les parties scientifiques des manuels, on assiste à partir des années 1910 à une augmentation du nombre d’images désormais étroitement associées aux textes littéraires, centraux dans les manuels de lecture du primaire (Muller 2007).
Ce phénomène se retrouve dans les manuels de tous les cantons. Sous l’influence de l’Éducation nouvelle, comme le montre Renonciat à propos des albums du Père Castor publiés en France dans l’entre-deux guerres, l’image va en effet être envisagée comme une porte d’accès privilégiée «aux acquisitions – sensorielles, motrices, psychologiques et intellectuelles – nécessaires à l’exercice d’une «lecture "intelligente", qui ne se réduit pas à un simple mécanisme de déchiffrement» (2009: 68).
L’inspecteur scolaire Louis Henchoz publie un article dans l’Éducateur en 1930 sur la question de l’illustration dans les manuels scolaires. Il rappelle que c’est chez Hachette que les premiers manuels avec gravures paraissent dans les années 1850, non sans remous: on parle alors à Paris de «profanation de la littérature» et «d’atteinte à la gravité de l’enseignement» (1930: 279). Il défend alors l'idée suivante:
Il faudra trouver de bons artistes pour les originaux. [...] bannissons résolument toute excentricité, toute présentation grotesque ou banale. Allons à ceux qui cherchent de fixer avec sincérité ce qui [...] ‘caractérise avec la plus absolue vérité les personnalités et les faits’. Tous nos manuels doivent avoir un cachet artistique qui emporte l’approbation générale immédiate. (1930: 280)
Si les images se généralisent dans l’ensemble des disciplines scolaires, Henchoz précise la place et le rôle que celles-ci devraient occuper dans les manuels pour l’enseignement de la langue maternelle:
Dans les manuels de lecture qui viendront successivement, les gravures seront toujours en rapport avec le texte. On veillera à ne rien admettre qui soit pure fantaisie. Pour les dernières années, les reproductions d’œuvres d’art, peinture, sculpture, architecture, d’une portée éducative incontestable, pourront être intercalées comme hors-texte, en nombre restreint toutefois. (1930: 281)
Les images, avec les textes avec lesquels elles forment un tout, constituent pour l’inspecteur des moyens par excellence pour le développement intellectuel et artistique des élèves; et ce dernier de conclure: «elles auront préparé le terrain pour l’observation visuelle, pour l’analyse». (Henchoz 1930: 281)
Dès 1910, les manuels sont en effet illustrés par des dessins d’un artiste suisse reconnu, le plus souvent nommé explicitement.
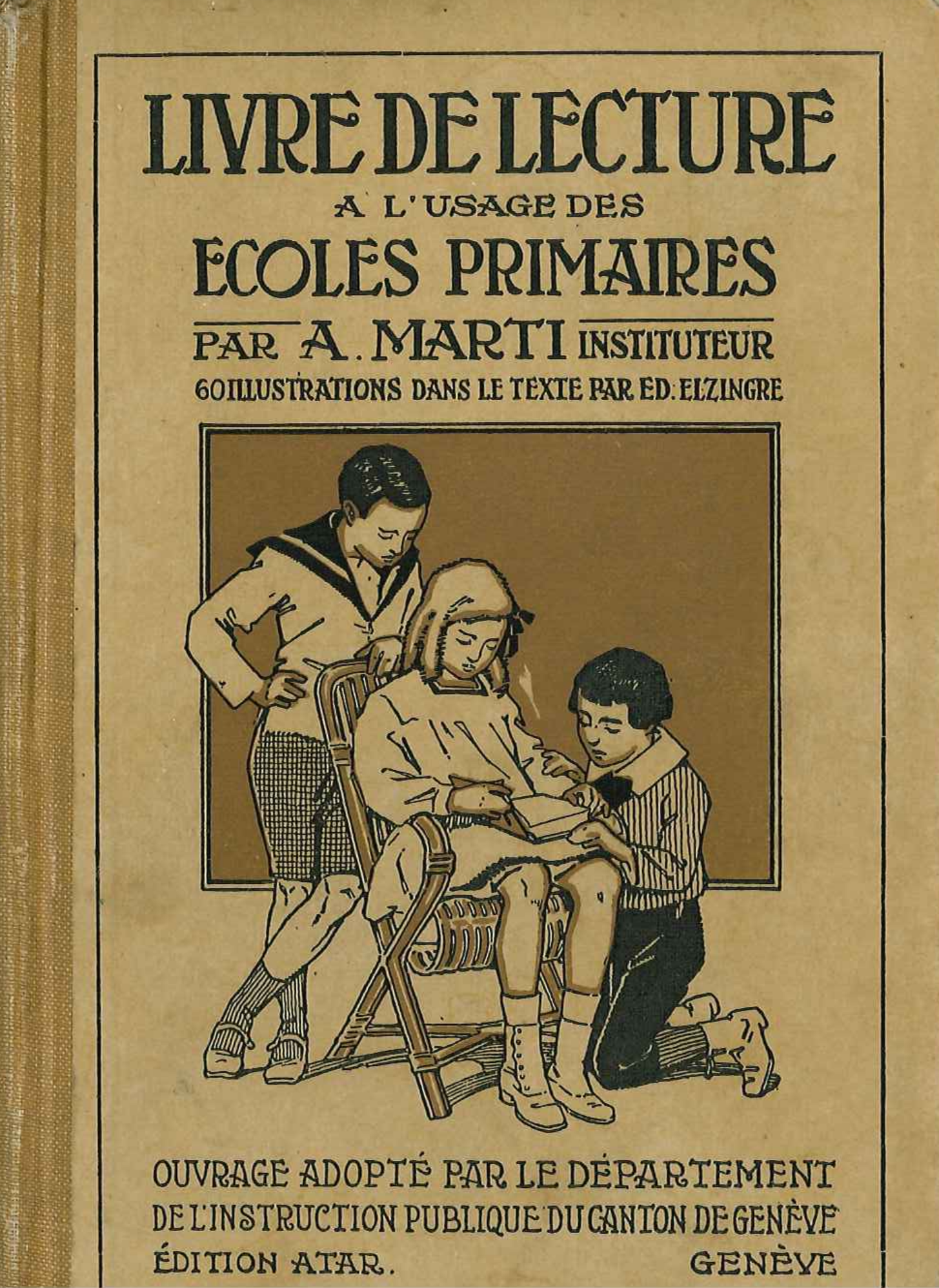
Figure 2: Première de couverture du Livre de lecture à l’usage des écoles primaires (Marti 1916)
Dans la première version du manuel genevois de Marti (réédité en 1936 sous le titre Heures claires), on compte ainsi 60 dessins d’Edouard Elzingre11pour 231 extraits «puisés chez les grands écrivains […] et dans ceux de leurs livres qui traitent de psychologie enfantine, ou qu’ils ont spécialement écrits pour la jeunesse» (Marti 1916: 4). Ces illustrations visent à faciliter l’accès des élèves à la «lecture expliquée»12 des morceaux; elles «ajoute[nt] un attrait de documentation pittoresque et peu[ven]t donner matière à d’intéressants exercices d’élocution» (1916: 4).
A partir des années 1930, la photographie fait son apparition dans les manuels scolaires. C'est le cas dans Lectures (Bonjour & Jeanrenaud 1931), destiné aux degrés supérieurs du primaire. C'est le cas également dans J’aime lire (1929), élaboré par une commission présidée d’abord par Albert Malche, puis par Albert Atzenwiler très largement influencé par l’Éducation nouvelle. Se voulant résolument moderne et novatrice, cette commission s‘inscrit contre ceux qui reprochent à la photographie une mauvaise définition de l’image rendant sa lisibilité insuffisante auprès des enfants (Renonciat 2009). 60 dessins, photographies, schémas cartographiques ou encore des reproductions de tableaux viennent ainsi illustrer les 140 morceaux d'écrivains reconnus – Charles Ferdinand Ramuz, Blaise Cendrars, Jules Renard ou Jean de La Fontaine – «qui leur [aux élèves] plaisent, et par la beauté de la forme et par l’attrait du récit» (Préface, p. 8). Cette diversification de l’image et le nouveau statut qu’elle prend par rapport au texte est en lien avec les avancées graphiques et techniques de l’époque.
Corollairement, si l'image, à l‘instar des définitions de certains mots de vocabulaire placés en note de bas de page, vise avant tout à faciliter la compréhension du texte et à enrichir la culture de l’élève, dans certains extraits, elle tend à perdre son statut de subordonnée. Par exemple, le tableau intitulé Pasteur dans son laboratoire d’Albert Edelfelt est explicitement cité dans l’extrait de Louis Pasteur par E. de Villeroy qui en propose une brève description: «un tableau connu le représente dans son laboratoire, regardant le contenu d’une éprouvette à la lumière du jour: toute la vie du savant est là» (J’aime lire 1929: 138).
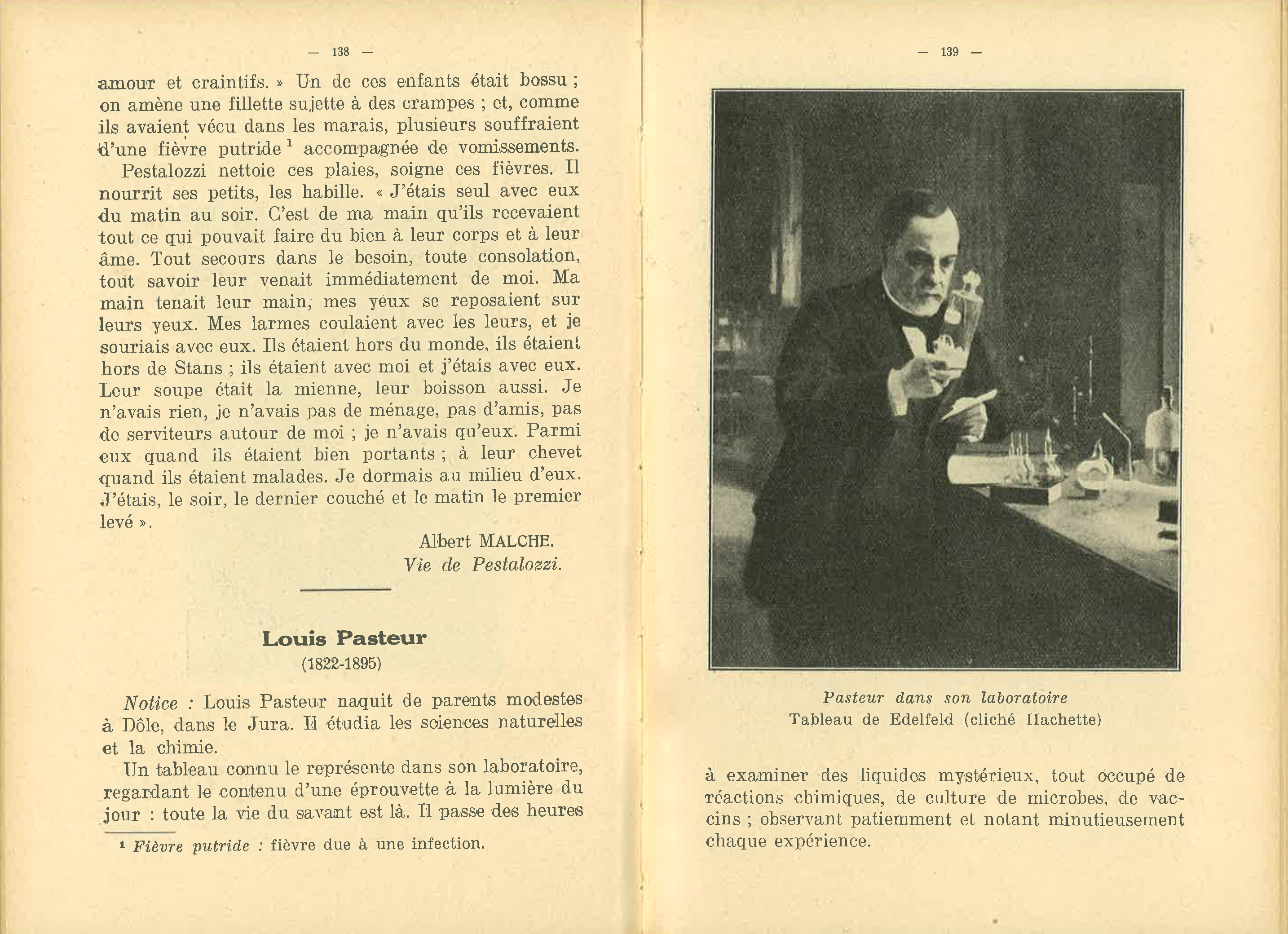
Figure 3: «Pasteur dans son laboratoire», Tableau de Edelfelt (cliché Hachette) (J’aime lire 1929: 139)13
A contrario, dans les manuels en vigueur dans les cantons non laïques, l’image, par la dimension émotionnelle qu’elle véhicule, a avant tout pour fonction de renforcer le sentiment patriotique et religieux des élèves. Cela est le cas aussi bien dans les manuels bernois que dans les manuels fribourgeois. Ainsi, dans Mes Lectures (1934), destiné aux élèves fribourgeois du primaire supérieur, les textes d’auteurs et d’autrices avant tout contemporains, ainsi que les dessins du peintre moderne fribourgeois Gaston Thévoz et du dessinateur bernois M. R. Sager, ont été sélectionnés sur les critères suivants:
a) qu’ils ne blessent en rien la foi et la morale chrétienne; b) qu’ils ne soient ni trop difficiles ni trop imagés; c) qu’ils soient irréprochables en ce qui concerne la correction de la langue, sa pureté, et même la ponctuation; d) enfin, que l’illustration ne soit pas un mystère à éclaircir. (Protocoles de la Commission permanente des études, Archives de l’État de Fribourg, DIP III 14)
Ainsi, les images sélectionnées par la Commission ne doivent pas être un obstacle à la compréhension du texte qui constitue un modèle pour l’apprentissage de la langue.
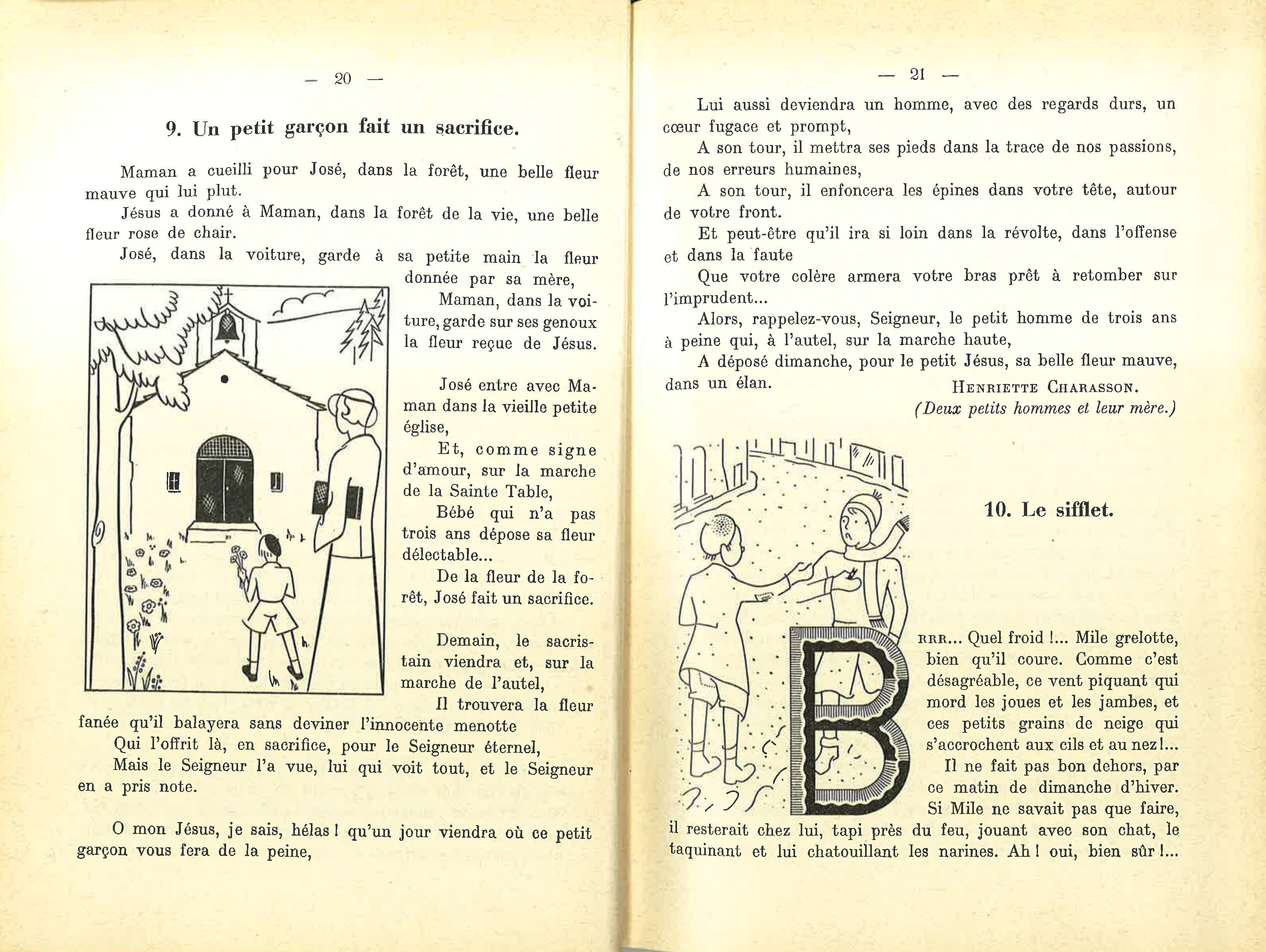
Figure 4: Extrait de «Deux petits hommes et leur mère» d’Henriette Charasson (Mes Lectures 1934: 20)
Enfin, alors que l’image est désormais, contrairement à la période précédente, largement présente dans les manuels de lecture destinés au primaire supérieur, elle continue à être absente dans les anthologies et les chrestomathies destinées aux élèves des filières secondaires. Une seule exception est celle de l'anthologie belge de Procès (1927), Modèles français, extraits des meilleurs écrivains, utilisée au collège à Fribourg. Les textes y sont regroupés par auteurs classés de façon chronologique, et chaque rubrique s’ouvre sur un portrait de l’écrivain, comme ici.
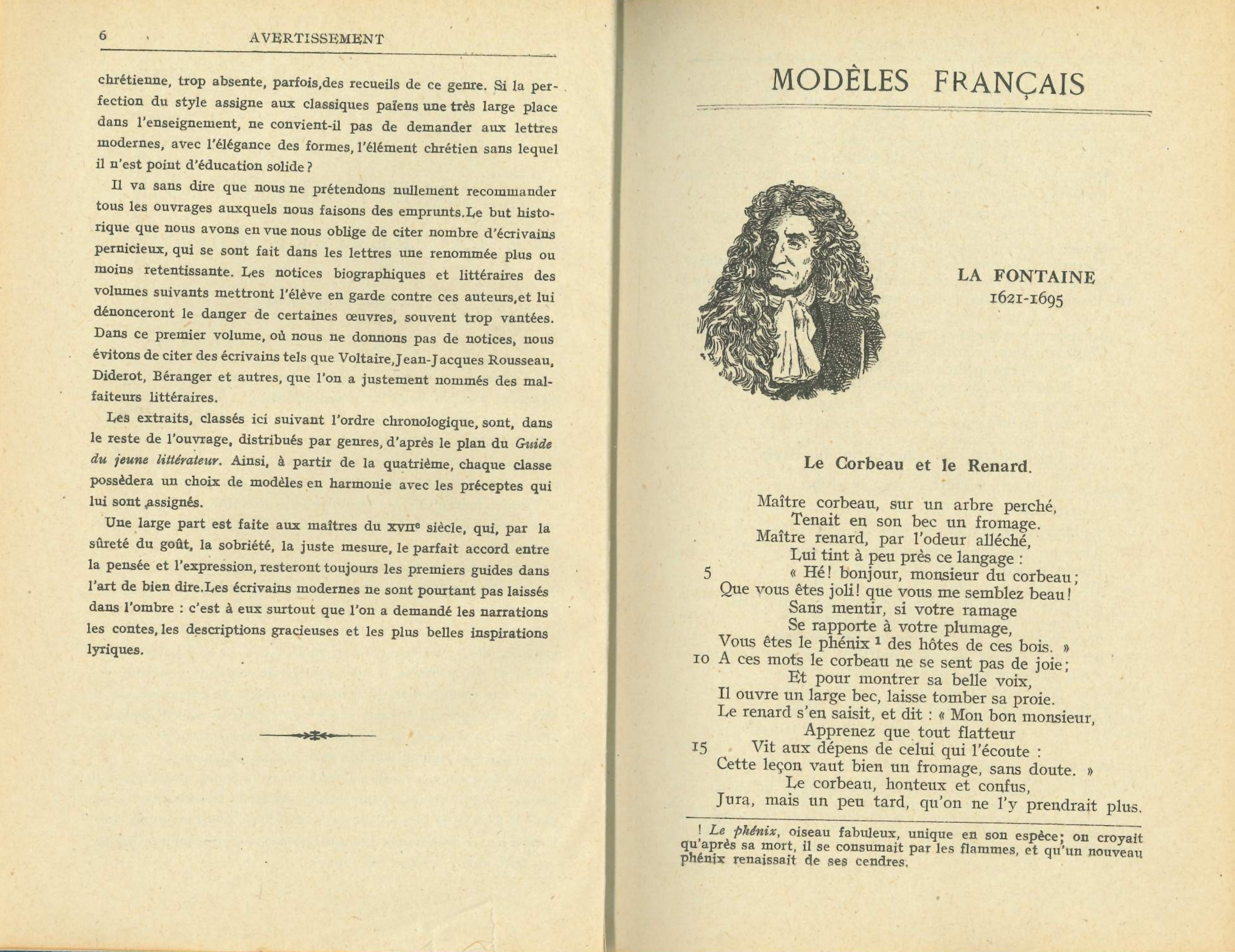
Figure 5: Portrait de La Fontaine (Procès 1927: 7)
Ces images figuratives (Perret 2019: 101) viennent ainsi renforcer la finalité du manuel qui constitue une initiation à l'histoire de la littérature centrée sur l’admiration de l’auteur, dans la continuité de l’enseignement rhétorique qui perdure dans les pratiques sous forme de couches sédimentées. On est donc ici dans une conception de la littérature scolarisée très différente de celle en vigueur au primaire à cette période.
Troisième période (1940-1970). L’image dans les manuels: lieu de résistance au monde audio-visuel qui concurrence la lecture de textes littéraires?
Les années d’après-guerre voient une généralisation de certaines techniques d’impression, rendant possible un recours plus systématique à la couleur, à des mises en page qui ne se contentent pas de juxtaposer le texte et l’image à la reproduction de photographies, le tout à bas coûts (Perret 2019: 98). Ce développement technique s’inscrit dans une expansion économique et industrielle plus large en Suisse, et s’accompagne de l’entrée dans les foyers et dans les classes de nouveaux moyens audiovisuels, avec la radio et la presse magazine qui s’affirment d’abord, avant que la télévision ne s’impose à la fin des années 1960 (Clavien 2017). Les milieux de l’édition connaissent néanmoins un léger décalage. Marqués dans un premier temps par la Défense spirituelle14 qui a prévalu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui les ont amenés à publier des textes conformes aux valeurs du mouvement, ils trouvent une nouvelle dynamique à la fin des années 1950 avec la littérature de jeunesse et la publication de nouveaux écrivains issus de la scène romande (Corsini & Vallotton 2011). Dès lors, nous pouvons nous demander si, depuis la Deuxième Guerre mondiale, certaines prémices à cette place donnée à l’image par rapport au texte peuvent être observées dans les manuels scolaires en langue maternelle, alors que les composantes de la discipline tendent à rester stables durant cette période (Vollenweider en cours).
La présence exponentielle de l’imagerie visuelle n’est pas ignorée par les pédagogues. Dans l’Annuaire, Samuel Roller, co-directeur des études pédagogiques à Genève, observe que «le monde se voit envahi par l’image» (1957: 84) et relève la nécessité de former aux images à l’école:
Dès lors, on voit pour [l’école] apparaître une tâche nouvelle: aider l’enfant à faire son chemin dans ce monde d’images qui le sollicitent; autrement dit le mettre en état, après avoir éprouvé toutes choses, de «retenir ce qui est bon». Il résulte de cela que les instituteurs ne peuvent pas écarter l’image de leur enseignement. (1957: 84)
Mais cette apparente ouverture aux images s’accompagne d’une inquiétude: va-t-elle détrôner le «texte imprimé», s'interroge Roller? Pour ce dernier, l’image est un instrument de culture qu’il s’agit d’accueillir et de rendre intelligible.
La relative ouverture de Roller n’est toutefois pas partagée dans tous les milieux pédagogiques, comme en témoignent les directives officielles dans le canton de Fribourg. L’image est strictement encadrée dans le programme général de Fribourg en 1967. Les recommandations de ce programme n’accordent pas le même statut à l’image qu’au texte et à la lecture. L’image y est sujette à une certaine méfiance et sert à réaffirmer la valeur du texte écrit:
[…] l’image visuelle est naturellement plus attirante qu’une page de lettres à déchiffrer. L’apprentissage de la lecture se heurte de ce fait à une sérieuse concurrence. Les illustrations des manuels y remédient quelque peu. […] Il n’y a pas de vraie culture par l’image seule. L’école se doit donc, même aujourd’hui, 1° de défendre la «civilisation du livre»; 2° de ne pas bouder les moyens audio-visuels, mais de se servir de leur stimulant pour orienter l’élève vers un approfondissement de leur rapport par la lecture et la réflexion personnelle. (1967: 1.2)
Cette instrumentalisation de l’image contre elle-même souligne que les images sélectionnées pour accompagner les morceaux dans les manuels de lecture fribourgeois ont pour principale fonction d’amener au texte et de savoir ensuite s’effacer pour laisser la place seulement à la lecture de textes. Elles ne doivent pas les concurrencer.
Ce statut donné à l’image s’observe notamment dans les manuels de lecture fribourgeois du primaire moyen (1955) et supérieur (1954) qui sont prescrits jusqu’à la fin des années 1960. Les améliorations techniques récentes n’ont pas amené de grands bouleversements dans la mise en page. Si la couleur y fait son entrée, elle est utilisée avec parcimonie. Textes et dessins – il n’y a presque jamais de reproductions de gravures ou de photographies15 – s’enchaînent généralement, et la mise en page ne les juxtapose ou les superpose16 rarement. La présence des images se renforce toutefois.
Elle se renforce également dans les manuels genevois et vaudois; son utilisation ne semblant pas faire l’objet d’autant de réserve qu’à Fribourg. Les manuels vaudois et bernois présentent quelques particularités au regard du reste du corpus. L’ouvrage vaudois pour le degré moyen (Foretay 1944) adopte une mise en page particulièrement variée, du point de vue de la disposition de l’image sur la page comme de l’habillage du texte (cf. figure 6).
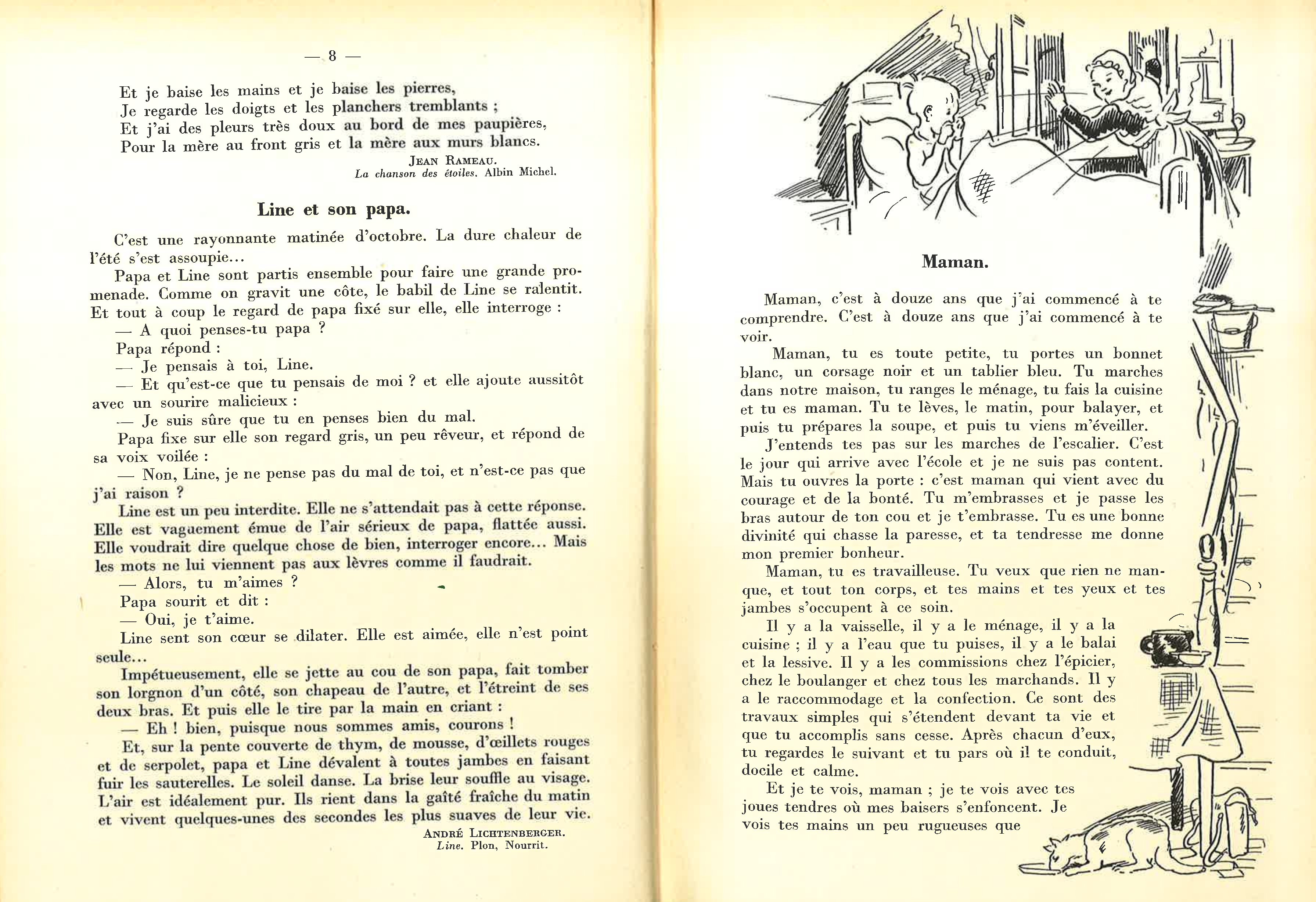
Figure 6: Illustration du texte «Maman» (Foretay 1944: 9)
Quant à l’ouvrage vaudois pour le degré supérieur (Foretay & Jeanrenaud 1946) et le manuel bernois pour le degré moyen (Jeanprêtre et al. 1961), ils contiennent presque exclusivement des photographies. Enfin, seuls des tableaux des XIXe et XXe siècles sont reproduits dans le manuel bernois pour le degré supérieur (Devain et al. 1964), non à des fins d’illustration des textes, mais pour amener une culture artistique et parce que «ces œuvres correspondent certainement à la sensibilité de l’enfant aujourd’hui.» (p. 5)
A l’instar des périodes précédentes, la majorité des images sont réalistes et renvoient au quotidien. Par exemple, dans le manuel fribourgeois Lecture et poésie (1955), les images n’illustrent pas des situations ou des objets décrits dans les textes qui pourraient être inconnus des élèves, mais au contraire les accompagnent vers une réalité qu’ils connaissent: des animaux, le foyer, le travail aux champs, des vues de la ville de Fribourg. Cette fonction de représentation est plus prégnante au degré moyen où les manuels contiennent plus d’images qu’au degré supérieur, et ce dans tous les cantons.
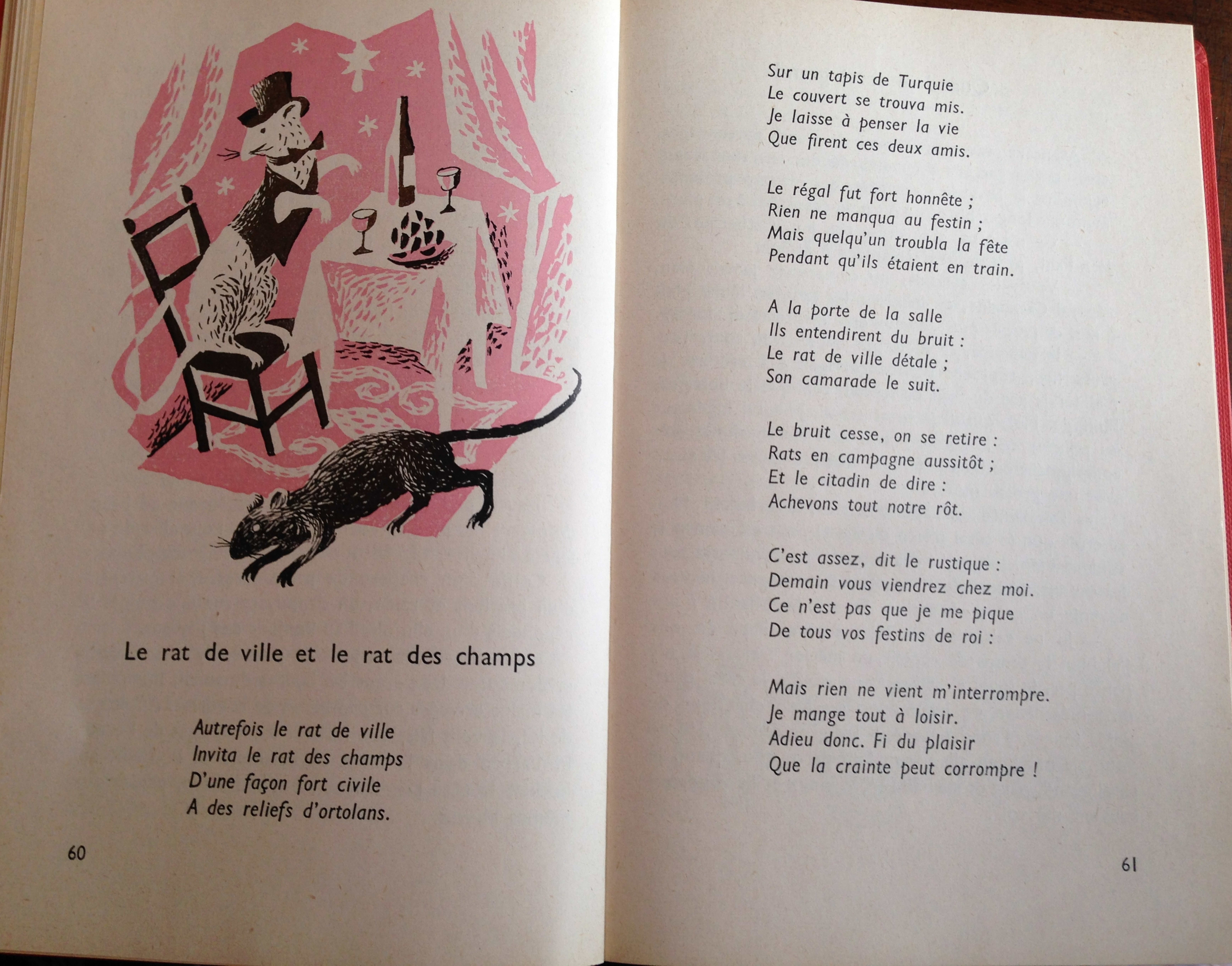
Figure 7: Illustration de la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (Lecture et poésie 1955: 60)
Quelques exceptions peuvent être relevées lorsque les images qui illustrent des textes de fiction ouvrent sur l’imaginaire. Comme on le voit dans la figure 7 extraite du manuel fribourgeois pour le degré moyen, la fable «Le rat des villes et le rat des champs» de La Fontaine (1955: 60-61) est illustrée par deux rats, dont l’un est assis à une table et habillé d’un haut-de-forme et d’un gilet, alors que l’autre, à quatre pattes et de couleur noire, n’a aucun attribut civilisé. Le contraste entre les deux animaux sert à saisir la comparaison qui fait l’objet de la fable. Ce contraste demande aussi une capacité d’interprétation qui n’est soutenue par aucune consigne ou légende.
Nonobstant ces dessins particuliers et les tableaux reproduits dans le manuel bernois de 1964, la majorité des images réalistes ont une fonction référentielle qui participe à canaliser l’imagination (Perret 2019: 104) vers la réalité connue des élèves. Roller souligne effectivement qu’elle tient le rôle de medium entre l’élève et la réalité:
L’image met l’enfant en présence du réel et il importe que cette rencontre soit telle que ce même enfant réagisse «comme si» la réalité concrète s’offrait véritablement à son regard. Si dès lors l’image atteint à ce pouvoir évocateur, c’est qu’elle est devenue document, c’est-à-dire qu’elle est au sens étymologique du terme, instrument d’enseignement (documentum, qui sert à instruire). (Roller 1957: 83)
A Fribourg, en continuité avec les périodes précédentes, les images servent également à garantir la présence du religieux, alors que les textes dans certaines sections des manuels ne traitent pas de la foi. Dans les parties «Notre pays», «La vie à la campagne» ou «Jeux et travaux» du manuel du primaire moyen (1955), figure à chaque fois au moins une représentation d’un établissement religieux. Ainsi, le morceau instructif «Qui construit nos demeures?» et le morceau moral «Demain ou jamais!» sont accompagnés par le dessin de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg (p. 165) alors qu’aucun des deux ne l’évoque ou n’a pour thème la chrétienté.
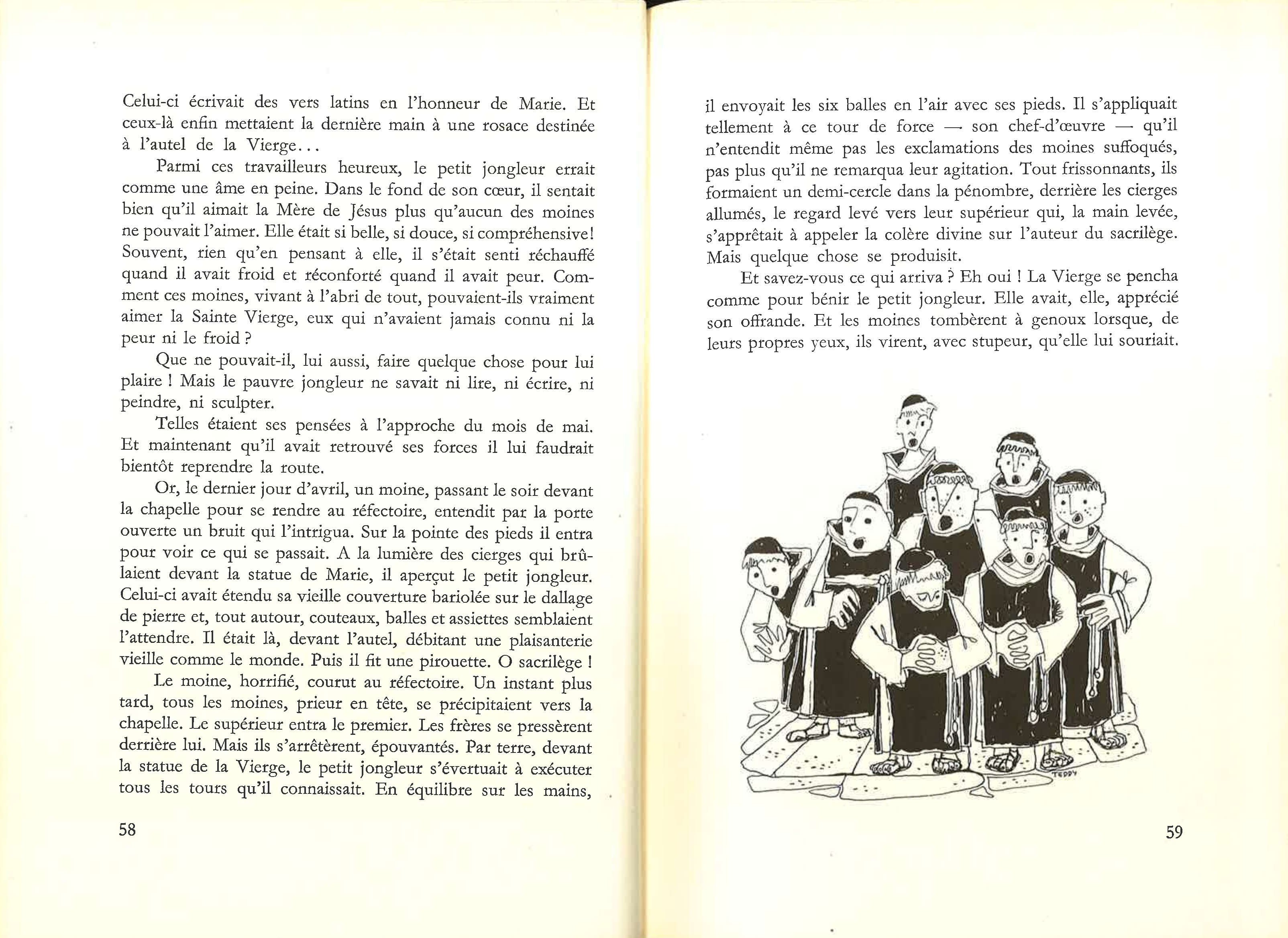
Figure 8: Image accompagnant «Le jongleur de Notre Dame», récit d’un auteur inconnu (Mes lectures 1954: 59)
Sans compter ces représentations réalistes d’établissements religieux, le manuel compte 22 images qui renvoient au catéchisme, à la vie des saints ou à des scènes de la vie chrétienne. Cette fonction religieuse de l’image n’a pas été relevée dans les autres cantons.
Au secondaire, la présence prégnante de l’image dans la société ne paraît pas non plus avoir eu d’impact sur la place donnée à l’image. En effet, les manuels conservent les habitudes éditoriales de la période précédente et cela est assumé explicitement:
Soucieux de fournir avant tout de beaux textes, nous avons renoncé à toute illustration comme à tout commentaire, et réduit les notes à la simple référence aux sources. La plus belle des images ne trahit-elle pas celle que le texte se réserve d’éveiller? Quel commentaire ne pâlit auprès du texte et ne l’encombre? (Pidoux et al. 1945: 5)
La collection de manuels de Kohler fait exception. Elle compte de nombreuses reproductions d’enluminures, de gravures, de miniatures et de portraits d’auteurs. Les images d’origine, contemporaines à l’époque étudiée dans le manuel, contribuent donc à contextualiser les textes littéraires. Leur rôle n’est pas d’illustrer des récits, mais de compléter la culture artistique des élèves relativement aux différentes périodes littéraires. Elles sont par ailleurs légendées, dans le but de permettre aux lecteurs de les situer dans le contexte historique. Ces images s’inscrivent pleinement dans le projet du manuel, qui sert de support pour un enseignement de l’histoire littéraire.
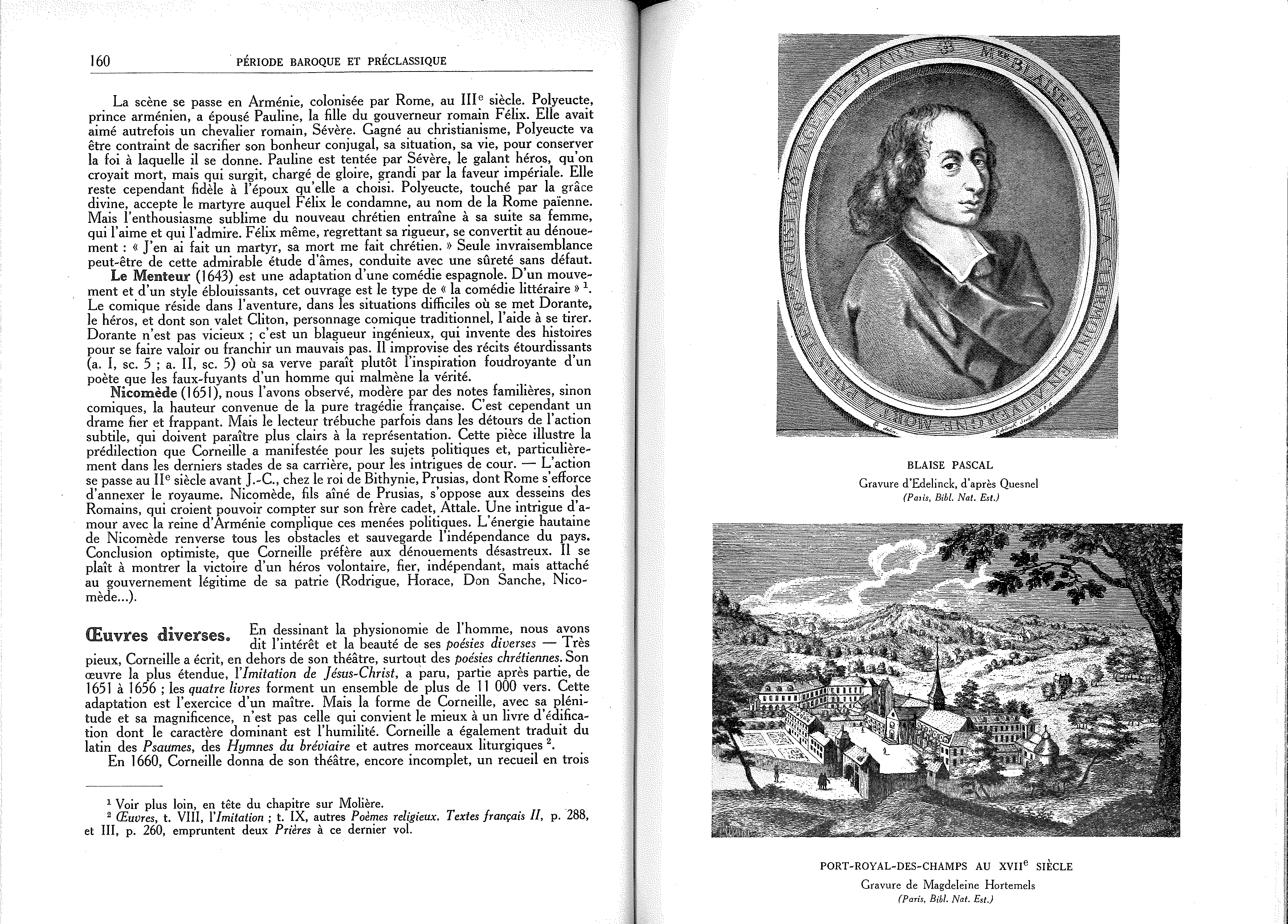
Figure 9: Page extraite du manuel de Kohler (1947: 161)
Ainsi, cette période se situe dans une certaine continuité avec la période précédente, et ce malgré les avancées éditoriales et médiatiques.
Conclusion
Ce parcours historique montre qu’entre les années 1870 et les années 1970, les images se développent largement dans les manuels du primaire, alors qu’elles restent, sauf exception, absentes des anthologies utilisées dans le secondaire, ce dernier restant méfiant à leur égard. Cette méfiance est liée au souci de permettre aux élèves de la filière secondaire d’avoir un accès direct au texte littéraire, sans médiation. On peut s’étonner que l’implosion de l’image dans la société des Trente Glorieuses n’entraîne pas de changements profonds dans l’utilisation des images au secondaire. Pour nous, cette stabilité est à mettre en lien avec un enseignement de la littérature qui, destiné à une élite, reste fondé sur l’histoire littéraire.
Au primaire, une évolution quant à la nature, au statut et à la fonction des images peut être mise en lumière. Entre les années 1870 et les années 1910, les images – essentiellement des gravures qui ne sont pas au départ conçues pour les manuels scolaires – ont une fonction de représentation (en fixant une définition visuelle du référent) et de vecteur de culture, laïque à Genève et Vaud, à connotation religieuse dans les cantons de Berne et de Fribourg. Tout en gardant cette fonction, elles acquièrent à partir du début du XXe siècle une fonction esthétique (en renforçant la dimension artistique et littéraire du manuel, et en participant au développement du goût artistique des élèves), et d'apprentissage (comme adjuvant aux activités de lecture et comme support aux exercices d’élocution). Les dessins conçus par des artistes locaux reconnus - Édouard Elzingre par exemple - viennent en effet illustrer les extraits littéraires, comme dans la littérature de jeunesse. Dès les années 1930-1940, les images – des dessins d’artistes, mais aussi des photographies en noir et blanc, puis progressivement en couleur - gagnent une certaine reconnaissance parmi des pédagogues qui y voient un moyen de documenter la réalité. Cependant, ce rôle qui leur est conféré exclut généralement toute image qui serait de nature abstraite ou qui ouvre à l’interprétation, surtout au degré moyen. Une transformation du statut de l’image intervient donc dans les années 1970, lorsque la littérature scolaire est redéfinie, intégrant la littérature de jeunesse et la bande dessinée, non seulement au primaire, mais aussi au secondaire qui se démocratise.
Bibliographie
Bishop, Marie-France (2017), «Une question de méthode: l’approche historico-didactique en français», in Théories-didactiques de la lecture et de l'écriture: fondements d'un champ de recherche en cheminant avec Yves Reuter, A. Dias-Chiaruttini & C. Cohen-Azria (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Septentrion, p. 225-240.
Buisson, Ferdinand (dir.) (1911), Nouveau dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette.
Chervel, André (1992), «L’école, lieu de production d’une culture», in Analyser et gérer les situations d’enseignement-apprentissage, F. Audigier & G. Baillat (dir.), Paris, INRP, p. 195-198.
Choppin, Alain (2008), «Le manuel scolaire, une fausse évidence historique», Histoire de l'éducation, n° 117, p. 7-56.
Clavien, Alain (2017), Histoire de la presse romande, Lausanne, Éditions Antipodes.
Corsini, Silvio & François Vallotton (2011), «Suisse, histoire du livre et de l’édition», in Dictionnaire encyclopédique du Livre, vol. 3, P. Fouché, D. Péchoin & Ph. Schuwer (dir.), Paris, Editions du Cercle de la Librairie, p. 775-778.
Darme-Xu, Anouk, Anne Monnier & Sylviane Tinembart (2020), «L'approche historico-didactique pour penser l'avènement du texte littéraire dans l'enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)», Transpositio, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Denizot, Nathalie (2021), «Transposition, scolarisation et culture scolaire: la question de la construction des savoirs scolaires», Pratiques, n° 189-190, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Denizot, Nathalie (2016),«Le manuel scolaire, un terrain de recherches en didactique? L’exemple des corpus scolaires», Le Français aujourd’hui, n° 194, p. 35-44.
Ferran, Florence, Eve-Marie Rollinat-Levasseur & François Vanoosthuyse (2017), «Éléments pour une histoire et une didactique», in Image et enseignement, Perspectives historiques et didactiques, F. Ferran, E.-M. Rollinat-Levasseur & F. Vanoosthyse (dir.), Paris, Honoré-Champion, p. 9-55.
Gervereau, Laurent (2020), Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La Découverte (URL: https://doi.org/10.3917/dec.gerv.2020.01).
Hameline, Daniel, Arielle Jornod & Malika Lemdani Belkaïd (1995), L'École active: Textes fondateurs, Paris, Presses universitaires de France.
Hébrard, Jean (1988), «La scolarisation des savoirs élémentaires à l'époque moderne», Histoire de l'éducation, n° 38, p. 7-58, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Henchoz, Louis (1930), «L’illustration des manuels scolaires», L’Éducateur, n° 66,p. 278-282.
Kahn, Pierre (2002), «Histoire d’une leçon de choses», in La leçon de choses: Naissance de l’enseignement des sciences à l’école primaire, P. Kahn, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels: quelle(s) image(s) de la littérature?», Dyptique, n° 37, p. 159-174.
Monnier, Anne (2021), «L’histoire des relations entre l’extrait et l’œuvre littéraire dans l’enseignement du français en Suisse romande (1830-2020)», in L’extrait et la fabrique de la littérature scolaire, A. Belhadjin & L. Perret (dir.), Bruxelles, Peter Lang, p. 161-177.
Muller, Christian (2007), Histoire de la structure, de la forme et de la culture scolaires de l’enseignement obligatoire à Genève au XXe siècle (1872-1969), Thèse de doctorat, Université de Genève.
Perret, Laetitia (2018), «Places et rôles des images des manuels dans l’évolution des disciplines scolaires», DIRE, n° 10, p. 89-99, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Perret, Laetitia (2019), «Place et rôle de l'image dans les manuels (1870-1960): point de vue méthodologique», in Le manuel scolaire, objet d'étude et de recherche: enjeux et perspectives, S. Wagnon (dir.), Peter Lang, p. 97-110.
Praz, Anne-Françoise (2005), De l’enfant utile à l’enfant précieux. Filles et garçons dans les cantons de Vaud et Fribourg (1860-1930), Lausanne, Antipodes.
Renonciat, Annie (2009), «De l’Orbis sensualium pictus (1658) aux premiers albums du Père Castor (1931): formes et fonctions pédagogiques de l’image dans l’édition française pour la jeunesse», in La pédagogie par l'image en France et au Japon, M. Simon-Oikawa & A. Renonciat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Roller, Samuel (1957), «De l’image au document: réflexions sur le rôle que l’image peut jouer dans l’enseignement», Annuaire de l’instruction publique en Suisse, n° 48, p. 83-94.
Saint-Martin, Isabelle (2010), «Christianisme», in Dictionnaire mondial des images, L. Gervereau (dir.), Paris, Nouveau Monde.
Schneuwly, Bernard, Thomas Lindauer, Anouk Darme, Julienne Furger, Anne Monnier, Rebekka Nänny & Sylviane Tinembart (2016), «Enseignement de la langue première “Deutsch” – “Français”, Remarques sur l'histoire de la discipline en Suisse (~ 1840 à ~ 1990)” dans une perspective comparative», Forumlecture, n° 2, en ligne, consulté le 15 décembre 2023.
Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Vollenweider, Emmanuelle (en cours), Histoire de la lecture de textes littéraires enseignée aux élèves. Analyse des représentations (1880-1980), Thèse de doctorat, Université de Genève.
Annexes
- Sources utilisées pour le primaire
Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte (ou page) par manuel |
Genève | Programme de l’enseignement dans les écoles enfantines et dans les écoles primaires, 1889. Programme de l’enseignement dans les écoles primaires, 1923. Plan d’études de l’école primaire, 1942. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1951. Plan d’études de l’enseignement primaire, 1966. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Gavard, Alexandre (1893), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires de Suisse romande. Degré intermédiaire, Genève, C.-E. Alioth. Dussaud, Bernard & Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Mercier, Louis & Marti, Adolphe (1911), Livre de lecture à l’usage du degré supérieur des écoles primaires, Genève, Edition Atar. Marti, Adolphe (1916), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Genève, Edition Atar. DIP GE (1929), J’aime lire. Livre de lecture destiné à la 4ème année de l’école primaire du canton de Genève. Genève, DIP. DIP GE (1940, réimpression de 1955), Fleurs coupées,Choix de textes littéraires pour le 6e degré de l’école primaire, Genève, DIP. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Gavard (1893): 92 images / 236 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Mercier & Marti (1911): 106 images / 277 textes Marti (1916): 60 images / 231 textes DIP GE (1929): 60 images / 140 textes DIP GE (1940/1955): 55 images / 251 textes |
Vaud | Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires, 1899. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1926. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1935. Plan d’études et instructions générales pour les classes primaires supérieures, 1937. Plan d’études et instructions générales pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1953. Plan d’études et instructions générales pour les Ecoles enfantines et les Ecoles primaires du canton de Vaud, 1960. | Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire,Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dussaud, Bernard, Gavard, Alexandre (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, libraires-éditeurs. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Borgeaud. Dupraz, Louis & Bonjour, Émile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur. Bonjour, Émile, (1925), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires, Degré intermédiaire, Lausanne, librairie Payot. Bonjour, Émile & Jeanrenaud, Henri (1931), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Payot. Foretay, Charles (1944), Lectures à l'usage du degré moyen des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. Foretay, Charles & Jeanrenaud, Henri (1946), Lectures à l'usage du degré supérieur des écoles primaires, Lausanne, librairie Payot. | Renz (1871): 24 images / 154 textes Dussaud & Gavard (1871): 25 images / 228 textes Dupraz & Bonjour (1899): 0 image / 244 textes Dupraz & Bonjour (1903): 0 image / 266 textes Bonjour (1925): 50 images / 215 textes Bonjour & Jeanrenaud (1931): 67 images / 244 textes Foretay (1944): 89 images / 185 textes Foretay & Jeanreneaud: 31 images / 250 textes |
Fribourg | Programme général des écoles primaires du canton de Fribourg, 1899. Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932. Écoles françaises de Fribourg, programme 1949-1950. Guide et plan d’études, 1967, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg avec approbation de la commission des études, Lausanne, L. Vincent. DIP FR (1889), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1899), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Einsiedeln, Établissements Benziger. DIP FR (1925), Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg. Degré moyen, Fribourg, DIP. DIP FR (1934), Mes lectures. Écoles primaires du canton de Fribourg. Degré supérieur, Fribourg, DIP. DIP FR (1955), Lecture et poésie: Livre de lecture, degré moyen des écoles primaire, Fribourg, DIP. DIP FR (1954, nouvelle édition), Mes lectures. Degré supérieur des écoles primaires du canton de Fribourg, Fribourg, DIP. | Adaptation de l’ouvrage de Bernard Dussaud et d’Alexandre Gavard (1881): 49 images / 259 textes DIP FR (1889): 62 images / 222 textes DIP FR (1899): 78 images / 252 textes DIP FR (1925): 123 images / 189 textes DIP FR (1934): 75 images / 200 textes DIP FR (1955): 126 images / 205 textes DIP FR (1954): 81 images / 193 textes |
Berne | Plan d’enseignement pour les écoles primaires du canton de Berne, 1878, Schuler, Berne. Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Berne, 1925, H. Kramer, Tavannes. Plan d’études pour les écoles primaires de langue française du canton de Berne, Edition provisoire, 1968, Berne, Librairie de l’État. | DIP BE (1885), Le Trésor de l’écolier.Livre de lecture à l’usage des écoles primaires françaises du canton de Berne. Degré supérieur, Lausanne, librairie Payot. Gobat, Henri & Allemand, Fritz (1911), Livre de lecture destiné aux écoles primaires du Jura bernois. Cours moyen (8e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel (1927), Notre camarade. Choix de lectures à l’usage des écoles primaires. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Bessire, Paul-Otto (1931), L’écolier jurassien. Choix de lectures à l’usage des écoles supérieures. Cours moyen, Berne, Librairie d’État. Jeanprêtre, Charles, Monnerat, Joseph, Stähli, Roland, Terrier, Pierre & Zbinden, Jean (1961), Horizons nouveaux. Livre de lecture à l’usage des cinquième et sixième années scolaires, Berne, Libraire d’État. Devain, Henri, Henry, Pierre, Pecaut, Armand, Pellaton, Jean-Paul & Stähli, Roland (1964), Les belles années: livre de lecture à l’usage du degré supérieur de l’école primaire, Berne, Librairie d’État. | DIP BE (1885): 13 images / 392 textes Gobat & Allemand (1911): 178 images / 299 textes Marchand (1927): 37 images / 253 textes Bessire (1931): 0 image / 249 textes Jeanprêtre et al. (1961) 17 images / 200 textes Devain et al. (1964): 16 images / 167 textes |
2. Sources utilisées pour le secondaire
Cantons | Programmes et plans d’études | Livres de lecture officiels | Ratio image/texte par manuel |
Genève | Programme pour l’année 1901-1902, École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1901, Genève, Paul Richter. Programme d’enseignement pour l’année 1900-1904, Collège de Genève, 1900, Genève, DIP. Programme pour l’année 1923-1924. École secondaire et supérieure de Jeunes filles, 1923, Genève, Klein. Programme pour l’année 1925-1926, Collège de Genève, 1925, Genève, Klein. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1962, Genève, DIP. Plan d’études et programme du cycle d’orientation, 1977-1978, Genève, DIP. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes |
Vaud | Programme de l’année scolaire 1873-1874 pour le collège cantonal, l’école industrielle et les collèges communaux du canton de Vaud. Collège cantonal, Programmes des cours, année scolaire 1877-1878. Collège cantonal, Programme des cours, année scolaire 1896-1897. Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud, 1910. Collèges et gymnase scientifiques cantonaux, Renseignements, année scolaire 1921-1922. Collège classique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1922-1923. Collège scientifique cantonal, Programme des cours, année scolaire 1935-1936. Collège classique cantonal. Programme des cours, année scolaire 1936-1937. Programmes des cours des collèges secondaires vaudois, 1960. Programmes des cours des collèges secondaires, 1971. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome premier. Littérature de l’enfance (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1898), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome deuxième. Littérature de l'adolescence (17e éd), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Vinet, Alexandre (1893), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert. Tome troisième. Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr (10e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Dupraz, Louis & Bonjour, Emile (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises à l’usage des collèges secondaires, écoles supérieures et écoles primaires supérieures, Lausanne, Payot. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre (1948), Histoire de la littérature française. Tome 2. Du milieu du XIXe siècle à nos jours avec une histoire de la littérature romande. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. Kohler, Pierre, Guisan, Gilbert & Pidoux, Edmond (1949), Histoire de la littérature française. Tome 3. Le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. 31 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Vinet (1898): 0 image / 172 textes Vinet (1893): 0 image / 116 textes Dupraz & Bonjour (1908): 0 image / 259 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image/132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages Kohler (1948): 31 images / 564 pages Kohler et al. (1949): 31 images / 806 pages |
Fribourg | Programme des études du Collège St-Michel à Fribourg pour l'année scolaire 1881-1882. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des filles de la ville de Fribourg pour l’année 1882-1883. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1901-1902. Compte-rendu de l’Ecole secondaire des jeunes filles de la ville de Fribourg pour l’année 1901-1902, Programme pour l’année scolaire 1902-1903. Collège St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1912-1913. Compte-rendu de l’Ecole Secondaire des Jeunes Filles de la ville de Fribourg pour l’année 1912-1913, Programme pour l’année scolaire 1913-1914. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1922-1923. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1923-1924. Ecole Secondaire de Jeunes Filles de la ville de Fribourg, Programme pour l’année scolaire 1938-1939. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1951-1952. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1965-1968. Collège cantonal St-Michel, Programme des études pour l’année scolaire 1970-1973. | Broeckaert, Joseph (1869), Modèles français recueillis d'après le plan du guide du jeune littérateur avec des remarques propres à en faciliter l'étude, vol. 1, Bruxelles, H. Goemaere. Lebaigue, Charles (1887), Morceaux choisis de littérature française. Auteurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (prose et poésie) avec remarques et questions. Deuxième année, Paris, Librairie classique E. Belin. Lebaigue, Charles (1889), Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) avec remarques et questions. Première année (2e éd.), Paris, Librairie classique E. Belin. Des Granges, Charles-Marc (1910), Histoire de la littérature française à l'usage des classes de Lettres et de divers examens (3e éd.), Paris, Hatier. Des Granges, Charles-Marc (1917), Morceaux choisis des auteurs français du Moyen âge à nos jours (842-1900) préparés en vue de la lecture expliquée. Classes de lettre 2e cycle (9e éd.), Paris, Hatier. Procès, Edmond (1927), Modèles français extraits des meilleurs écrivains avec notices. Cours inférieur (12e éd.), Bruxelles: Albert Dewit. Budry, Maurice & Rogivue, Ernest (1944), Textes français I, Lausanne, librairie Payot. Pidoux, Edmond, Rogivue, Ernest, & Wiest, Alfred (1945), Textes français II, Lausanne, librairie Payot. Kohler, Pierre (1947), Histoire de la littérature française. Tome 1. Des origines à la fin du XVIIe siècle. 32 illustrations hors-texte, Lausanne, Payot. | Broeckaert (1869): 0 image / 223 textes Lebaigue (1887): 0 image / 158 textes Lebaigue (1889): 0 image / 140 textes Des Granges (1910): 0 image / 927 pages Des Granges (1917): 0 image / 504 textes Procès (1927): 23 images / 206 textes Budry & Rogivue (1944): 0 image / 157 textes Pidoux et al. (1945): 0 image / 132 textes Kohler (1947): 31 images / 284 pages |
Berne | Programme de l’école cantonale de Porrentruy, 1897. Programme d’enseignement. Progymnase, gymnase, section commerciale, École cantonale de Porrentruy, 1929, Porrentruy, «Le Jura S.A.». Plan d’études des écoles secondaires et progymnases de langue française, 1961. | Vinet, Alexandre (1880), Chrestomathie française, ou choix de morceaux des meilleurs écrivains français revue et augmentée par E. Rambert (15e éd.), Lausanne, Georges Bridel éditeur. Marchand, Marcel (1917), Notre ami, lectures françaises à l’usage des écoles secondaires (2e éd.),Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1937), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1938), Notre ami II. Lectures françaises à l’usage des classes supérieures des progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. Marchand, Marcel Bessire, Paul-Otto & Feignoux, Frédéric (1943), Notre ami III. Lectures françaises à l’usage des classes inférieures des écoles progymnases et des écoles secondaires (3e éd.), Berne, Librairie d’État. | Vinet (1880): 0 image / 122 textes Marchand (1917): 0 image / 258 textes Marchand et al. (1937): 0 image / 94 textes Marchand et al. (1938): 0 image / 88 textes Marchand et al. (1943): 0 image / 205 textes |
Quels usages des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels de français pour le collège?
Cet article examine les usages que six collections de manuels de français pour le collège font d’adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires.
Quels usages des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires dans les manuels de français pour le collège?
Les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires constituent une importante porte d’entrée pour le cinéma dans les manuels de français: un dépouillement des manuels en vigueur en France pour le collège1 fait en effet apparaitre que plus d’une activité sur deux consacrées à un film concerne une adaptation d’œuvre littéraire.
Cette situation ne trouve pas son explication dans les programmes: les indications de corpus dans les prescriptions «proposent des ouvertures vers l’éducation aux médias et vers d’autres formes d’expression artistique (particulièrement des oeuvres picturales et cinématographiques)»2, et sur quatre occurrences du cinéma parmi les pistes plus précises ouvertes pour les classes de collège, une seule suggère qu’on peut «s’appuyer sur une adaptation cinématographique ou télévisuelle d’un roman ou d’une nouvelle réaliste ou naturaliste»3. Parmi les compétences visées pour les classes de collège, la compétence «lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la photographie, à la publicité et au cinéma en fondant sa lecture sur quelques outils d’analyse simples» figure par ailleurs au même niveau que celles qui concernent la lecture de textes littéraires («lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art» et «élaborer une interprétation de textes littéraires»). Les programmes prévoient donc un travail à part entière sur le cinéma, sans donner de priorité en termes de corpus à des adaptations d’œuvres littéraires.
Cette forte présence des adaptations dans les manuels traduirait-elle alors l’affirmation d’un mode de traitement des films, qui répondrait au besoin identifié par Le Français aujourd’hui en 2009, d’une «didactique à inventer» en ce qui concerne les relations texte / film? Les pages consacrées à ces adaptations feraient-elles écho à des réflexions et propositions de didacticiens de la littérature, comme Langlade (2012) qui invite à prendre au sérieux les interprétations proposées par des adaptations pour ouvrir le jeu interprétatif dans la lecture des textes,ou Louichon (2015) qui établit l’intérêt d’aborder des œuvres patrimoniales à partir de leurs relectures et réécritures contemporaines, notamment au cinéma? Dans quelle mesure les activités organisées s’attachent-elles aux spécificités des compétences que doivent respectivement mobiliser le lecteur d’œuvres littéraires et le spectateur de films (Lacelle, 2011)?
Cet article propose d’explorer les usages que les manuels font de ces adaptations: quels objectifs sont assignés au travail sur, ou avec, des adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires? Comment est organisée la mise en relation entre texte et film? Dans quelle mesure l’un est-il exploité au service de la lecture de l’autre? À quelles conditions la confrontation se fait-elle l’occasion d’un dialogue dynamique entre les œuvres?
Corpus et méthode
L’analyse s’appuie sur le dépouillement de six collections françaises de manuels pour le collège, qui regroupe les quatre premières années du cycle secondaire en France: Fleurs d’encre (Hachette), Colibris (Hatier), Jardin des Lettres (Magnard), Terre des Lettres (Nathan), Envol des Lettres (Belin) et Passeurs de textes (Robert).
L’ensemble des questionnaires consacrés à une séquence filmique dans ces vingt-quatre manuels a d’abord été repéré: ont été retenus les questionnaires portant sur un ensemble de photogrammes, sur un extrait ou dans certains cas sur la bande-annonce, à l’exclusion de questions parfois proposées sur un photogramme isolé mis en regard d’un texte, car dans ce cas les questions n’engagent pas la narration par séquences d’images animées, et à l’exclusion des pages souvent placées en fin de groupements de textes, invitant à visionner des bande-annonce pour suggérer des films en prolongement de la séquence, car ils ne présentent pas de questionnement spécifique adapté à l’œuvre concernée. Ce dépouillement aboutit à un total de 66 questionnaires parmi lesquels la part des adaptations est très importante puisqu’elle s’élève à 39 questionnaires, soit bien plus de la moitié du corpus.
Ce corpus de questionnaires a été examiné pour identifier les objectifs du travail envisagé sur ces adaptations et la nature des activités attendues de la part des élèves. Cette analyse a été ponctuellement complétée par la consultation des guides à destination des enseignants («livre du professeur»), pour confirmer certaines hypothèses ou éclairer les attentes liées à certaines questions ou activités. Les propositions de manuels ne sont évidemment pas un reflet des pratiques effectives dans les classes, mais elles témoignent de logiques disciplinaires et sont révélatrices de représentations et d’usages prégnants (Perret-Truchot, 2015). L’étude du corpus a permis d’établir une typologie, qui s’organise autour des manières de constituer (ou non) l’adaptation comme une ressource didactique pour mieux appréhender textes et films et/ou d’en faire un objet de réflexion à part entière.
Typologie des usages d’adaptations cinématographiques
Des adaptations invisibles: un paradoxe?
Un premier constat étonne: dans plus du tiers des questionnaires organisant un travail sur une adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire, aucune mise en relation entre le film et le texte n’est établie (cette situation concerne 15 des 39 questionnaires du corpus). Le fait que le film soit une adaptation apparaît pourtant systématiquement parmi les informations fournies, titre et auteur du roman figurant aux côtés du nom du réalisateur, de l’année de création et d’éventuelles autres précisions, sur l’obtention d’un prix par exemple. Le statut d’adaptation est même mentionné quand le lien à l’œuvre est ténu, par exemple dans le cas du Roi et l’oiseau (Grimaut et Prévert), dont le manuel Terre des Lettres 5e précise qu’il est «tiré du conte d’Andersen La Bergère et le ramoneur». Dans un seul cas, l’œuvre littéraire que le film adapte n’est pas citée (Fantastic Mr Fox de Wes Anderson, dont Passeurs de textes 6e ne signale pas qu’il adapte un roman de Roald Dahl), mais un autre lien est curieusement instauré avec la littérature: la troisième et dernière activité proposée, intitulée «du livre au film d’animation», demande aux élèves de «retrouve[r], pour chaque élément du récit, l’élément correspondant du film», en remplissant dans un tableau la colonne consacrée au film en regard d’une colonne listant les personnages et péripéties du Roman de Renart (par exemple, «Renart et Hermeline» ou «Renart et Chantecler le coq»). Le film se voit ainsi traité comme une réécriture du Roman de Renart, sans considération pour le roman de Roald Dahl qui constitue le chaînon manquant entre cette œuvre patrimoniale et le film de Wes Anderson. Ce cas atypique associe invisibilité du processus d’adaptation de l’œuvre littéraire et travail explicite sur des enjeux intertextuels, avec une œuvre autre que celle adaptée par le film. Mais dans les autres cas, l’invisibilité de l’adaptation prend la forme d’un travail centré sur le film sans mise en relation explicite avec l’œuvre littéraire. Le processus d’adaptation peut ne faire l’objet d’aucun travail spécifique quand bien même la page porte un titre orientant l’attention vers cet enjeu – «l’adaptation cinématographique: Germinal de Claude Berri» (Colibris 4e) ou «Cinéma: adapter une nouvelle réaliste à l’écran» (Passeurs de textes 4e à propos de La Parure de Claude Chabrol) –, situation qui se présente quand le texte littéraire figure dans les pages qui précèdent l’activité consacrée au film. La double page sur l’adaptation de Germinal par Claude Berri dans Colibris 4e conclut ainsi un chapitre sur le récit réaliste au XIXe siècle, comportant notamment un extrait du roman, mais la séquence du film retenue pour l’analyse ne concerne pas le même passage et aucune question ou commentaire n’invite à mettre en relation ces deux extraits d’œuvres, traités indépendamment l’un de l’autre.
Cette situation apparaît paradoxale: pourquoi tant d’adaptations parmi les films présentés, si, en l’absence de mise en relation explicite avec l’œuvre adaptée, ces films ne sont pas traités en tant qu’adaptations? La proximité avec la littérature peut sans doute produire un effet de légitimation d’œuvres cinématographiques dans une discipline prioritairement tournée vers l’acquisition de compétences de lecture littéraire. Mais aucun discours explicite ne vient à l’appui de cette hypothèse, difficile à étayer. Sans être exclusif de cet enjeu de légitimité, un autre paramètre est plus objectivable: en France, le cinéma a fait son entrée dans les examens de la discipline français avec l’introduction de films au programme de l’enseignement de littérature pour les classes de terminale de spécialité littéraire, entre 1995 et 2019; or les œuvres mises au programme ont été très majoritairement des adaptations d’œuvres littéraires, figurant conjointement au programme. Quelles que soient les raisons de cette situation, cette place faite au cinéma dans les épreuves certificatives de la fin du lycée sous la forme prioritaire d’adaptations n’a pas pu ne pas modeler des habitudes de travail des enseignants de français, qui se sont ainsi familiarisés avec des films comme objets d’enseignement dans le cadre d’un travail de confrontation entre des œuvres littéraires et leur adaptation filmique. Cela peut contribuer à expliquer la familiarité des enseignants de français avec un corpus d’adaptations cinématographiques, qui se voient alors sans surprise surreprésentées parmi les films envisagés pour un travail en classe de français. Cet éclairage par un pan important de l’histoire de l’entrée du cinéma dans les objets de la discipline n’explique cependant pas le paradoxe qui demeure, de la non mise en relation des films avec les textes. Le travail de mise en relation entre texte et film paraît peut-être suffisamment familier aux enseignants pour que les auteurs de manuels présupposent qu’ils sauront s’emparer s’ils le souhaitent de cette piste pour compléter le travail proposé sur le film? Rien n’étant spécifié dans ce sens dans les livres de l’enseignant, il est difficile d’aller plus loin que ces quelques hypothèses explicatives. Mais la fréquente invisibilité du processus d’adaptation mérite d’être remarquée et interrogée.
L’adaptation comme ressource pour faciliter l’accès au texte
Une deuxième situation regroupe les cas dans lesquels un rôle de médiation est confié aux adaptations cinématographiques, mobilisées pour faciliter l’accès des élèves à un texte. Cette approche se voit parfois formulée de manière très explicite à travers le titre des pages consacrées aux films concernés: deux manuels abordent ainsi des adaptations de Cyrano de Bergerac avec l’objectif explicite d’»entrer dans la pièce grâce à des adaptations filmiques» (Fleurs d’encre 4e) ou de «découvrir la pièce avec le film de Jean-Paul Rappeneau» (Terre des Lettres 4e). Cette intention est parfois moins explicite mais on l’identifie aussi dans un questionnaire sur une scène de Topaze qui commence par une question sur deux photogrammes de la version filmée, et où un extrait du film vient ponctuellement à l’appui de la compréhension du texte, en donnant l’occasion d’observer la gestuelle qui accompagne les paroles des personnages (Jardin des Lettres 5e). Même si la fonction d’auxiliaire à la lecture reste ici plutôt implicite, on identifie dans ce questionnaire la même intention que celle explicitée dans le livre du professeur de ce manuel quand un extrait du film La Planète des singes précède deux extraits du roman de Pierre Boulle, à savoir que «l’entrée dans le roman par le film permet de comprendre immédiatement la confrontation des deux espèces».
Cette situation est bien différente de la première décrite puisque ces films se voient ici attribuer un rôle en tant qu’adaptations d’œuvres littéraires; toutefois, ce travail avec plutôt que sur les adaptations les place dans une situation de quasi-transparence, leur rôle d’auxiliaire à la lecture n’étant pas l’occasion d’un travail sur ce qui ferait par exemple l’originalité ou l’intérêt de l’œuvre cinématographique.
Cette situation est assez peu représentée dans le corpus, à quatre reprises seulement, et il est notable que trois de ces quatre occurrences concernent des adaptations de textes dramatiques: il semble bien que les adaptations de pièces de théâtre soient utilisées prioritairement pour faciliter une représentation mentale de personnages et/ou de contextes culturels qui ne sont pas décrits dans les extraits lus, tout en donnant à entendre un texte conçu pour être mis en voix. Une comparaison avec l’usage que les mêmes manuels font d’images ou d’extraits de captations de représentations théâtrales serait utile pour savoir si le même usage est fait de ces images ou si le travail s’organise davantage en direction d’une ouverture des interprétations possibles du texte joué, mais cela demanderait de constituer un autre corpus que celui étudié ici. Les manuels investigués permettent encore de distinguer trois types d’usages de l’adaptation qui constituent celle-ci en ressource pour mieux outiller la lecture des textes et/ou des films.
La comparaison au service d’un approfondissement de la lecture
Le travail de mise en relation entre les œuvres littéraires et leurs adaptations cinématographiques prend la forme de diverses approches comparatives dont les objectifs varient, allant de l’évaluation de la fidélité de l’adaptation à une confrontation dynamique des interprétations proposées ou suggérées par chaque œuvre, en passant par une approche plus orientée vers l’appréhension des procédés visuels propres au médium cinéma.
La question de la fidélité traverse de nombreux questionnaires, sans jamais en constituer l’orientation principale ou unique. Elle est l’occasion d’un trajet qui mène du film vers une relecture approfondie du texte. Pour évaluer si telle représentation est conforme au texte ou laquelle de deux représentations y serait la plus fidèle, les élèves sont invités à se lancer dans un travail de compréhension et de relevé des passages du texte qui correspondraient, ou non, à divers éléments des films. Le livre du professeur accompagnant le Jardin des Lettres 3e explicite cette attente liée à une question sur la «conformité» au texte de plusieurs représentations de Frankenstein au cinéma:
La question vise à écouter les réponses des élèves et à juger de l'acribie de leur lecture du texte, à l'épreuve de représentations visuelles [...]. Faire travailler les élèves sur le rapport entre texte et image implique de questionner la justesse de leur lecture du texte, le degré d'adaptation qu'il permet et la fidélité des interprétations.
Ainsi, les représentations visuelles mettent à l’épreuve et exercent la rigueur de lecteurs qui doivent être attentifs à ce qui est indiqué, ou non, par le texte. Le repérage des points communs et différences est plus ou moins guidé selon les questionnaires: certains pointent précisément un élément à observer («quels objets magiques Jean Cocteau a-t-il ajoutés au conte?», Jardin des Lettres 6e), quand d’autres posent la question de manière plus ouverte (« D’après la bande-annonce et les documents de cette double page, le film vous semble-t-il fidèle au récit de J.D. Bauby? Justifiez». Fleurs d’encre 3e). Il est important de préciser que ce repérage constitue une étape dans un parcours qui qui ne s’en tient jamais à évaluer la fidélité de l’adaptation au texte, mais se prolonge dans deux directions distinctes.
La comparaison pour appréhender des procédés cinématographiques
Le travail initial d’observation des écarts et d’évaluation de la fidélité prépare dans certains questionnaires un travail de lecture des images cinématographiques, dont l’objectif est l’acquisition de notions sur des procédés visuels courants au cinéma. La double page d’Envol des Lettres 4e consacrée à La Parure, qui annonce ainsi l’ objectif de «comparer une œuvre littéraire et son adaptation télévisuelle», fournit comme ressource pour traiter les questions un encadré de vocabulaire comportant les définitions du fondu enchainé, du gros plan, du travelling et du zoom avant. Une partie des questions invite à mettre en relation les choix de procédés de Claude Chabrol avec les éléments de la nouvelle qu’ils transposent à l’écran: par exemple,
quand mme Loisel se regarde dans le miroir, quelles autres images d’elle apparaissent? Comment appelle-t-on ce procédé? En quoi illustre-t-il l’extrait de la nouvelle de Maupassant p. 26?
La comparaison devient confrontation intermédiale et sert, autant sinon plus qu’à vérifier la rigueur de la lecture du texte, à favoriser l’observation des procédés cinématographiques utilisés pour «restituer»4 les éléments du texte en les faisant passer à l’écran. Cette orientation de la lecture vers un outillage technique de la lecture des images cinématographiques est présente (sans être exclusive) dans 10 questionnaires sur les 24 qui organisent une mise en relation entre film et texte. Les procédés abordés sont variés et il semble que l’appui sur la confrontation avec le texte adapté favorise une approche des films attentive à la diversité des ressources cinématographiques exploitées et à l’originalité de chaque création: les procédés examinés dans les pages n’établissant pas de mise en relation avec l’œuvre littéraire présentent en effet moins de diversité (elles sont centrées sur les angles de vue et cadrages et ne proposent que rarement l’analyse d’effets liés au montage, aux éléments sonores ou autres caractéristiques qui distinguent les images cinématographiques d’images fixes) que dans celles qui s’appuient sur la confrontation au texte, où se voient abordés plus régulièrement ces enjeux propres à la création de séquences d’images animées accompagnées de sons. Fleurs d’encre 3e développe ainsi un dossier en plusieurs doubles pages où une confrontation intermédiale entre des extraits d’autobiographies et leur adaptation en BD ou en film est systématiquement organisée; à l’appui de ce travail, une fiche méthode distingue explicitement les niveaux d’analyse entre étude de photogrammes et de séquences filmiques, et précise quels procédés sont propres à ce deuxième niveau:
Pour analyser une séquence filmique, observer et interpréter:
- l’organisation des plans (succession linéaire des plans, parallélismes, jeux d’opposition, effet de champ/contre-champ, effet de pause, ralenti, accélération, zoom, etc.);
- les effets créés au montage pour enchainer les séquences (fondu au noir, fondu enchaîné, coupe franche, etc.)
- les bruitages et la bande-son.
Ces aspects de la narration filmique5 ne se voient qu’exceptionnellement abordés quand les adaptations ne sont pas mises en relation avec l’œuvre littéraire. De manière complémentaire, trois questionnaires invitent les élèves à consulter des documents sur la réalisation du film pour découvrir soit une technique d’animation particulière (l’imitation de l’esthétique du vitrail par papier découpé dans l’adaptation de Bisclavret de Marie de France par Emilie Mercier, Envol des Lettres 5e), soit la diversité des métiers et des enjeux techniques de la réalisation d’un film autour du tournage de La Bête humaine par Jean Renoir (Jardin des Lettres 4e), soit l’accueil critique du film (Fleurs d’encre 4e sur La Parure). Sans que cette approche résulte du travail de mise en relation entre texte et film, il s’avère que les trois dossiers qui présentent des éléments sur le «making-of» des films se trouvent dans des questionnaires fortement structurés autour d’une approche comparative des deux œuvres.
Une autre approche du langage cinématographique, rare dans le corpus, se trouve également exclusivement associée au prolongement d’une confrontation entre texte et film: il s’agit d’activités plaçant les élèves en situation de manier le langage cinématographique pour planifier une séquence adaptée d’un extrait de l’œuvre – Fleurs d’encre 4e propose de créer un storyboard en dessinant schématiquement les plans qui permettraient de transposer un passage de La Parure; pour la 4e également, Le Jardin des Lettres propose un travail équivalent en conclusion du travail sur La Bête humaine.
Dans l’ensemble du corpus, on observe donc que les approches comparatives vont de pair avec une appréhension plus approfondie du langage cinématographique que lorsque les adaptations ne sont pas traitées en rapport avec l’œuvre source. Ce constat ne permet pas de conclure qu’une approche comparative serait une condition pour déployer une étude rigoureuse du cinéma en classe de français, mais il est intéressant de relever cette corrélation qui suggère que la situation de confrontation entre texte et film, en même temps qu’elle fournit des supports d’activités familiers aux enseignants, est peut-être aussi de nature à clarifier le projet de lecture dans lequel le film trouve sa place et à favoriser l’identification des spécificités de l’écriture cinématographique pertinentes à analyser au regard de ce projet.
Des interprétations mises en dialogue
Outre l’approche des procédés cinématographiques, le travail de comparaison prévu dans une première étape des questionnaires prépare également une réflexion sur les écarts interprétatifs entre les œuvres littéraires et leurs adaptations. Cette réflexion dépasse le cadre strict de la comparaison examinée plus haut en ce qu’il ne s’agit pas seulement de repérer les différences, mais d’engager une réflexion à un autre niveau.
A un premier niveau, dans plusieurs questionnaires le travail de comparaison aboutit à une question orientée vers une appréciation personnelle, comme dans cette question «bilan» qui suit la comparaison de deux versions cinématographiques de La Belle et la Bête, entre elles et avec le conte qui en est la source:
Lequel de ces deux films vous semble le plus fidèle au conte? Lequel préférez-vous? Justifiez vos réponses. (Envol des Lettres 6e).
Ce type de questions vise non pas un jugement de gout mais un «jugement de valeur» construit et argumenté, selon la distinction de Dumortier (2012): c’est après une observation rigoureuse des différences entre les œuvres et une réflexion sur les effets produits par les choix opérés que les élèves ont à exprimer et justifier une préférence, qui a vocation à être mise en discussion.
Mais plus souvent qu’à exprimer leur «préférence», des questions invitent les élèves à s’interroger sur les représentations des personnages ou les modifications apportées:
Que penses-tu de la façon dont Gwynplaine est représenté? (Jardin des Lettres 5e)
Quels personnages du film n’existent pas ou presque pas dans le livre? Quel est l’intérêt d’avoir créé ces personnages? (Terre des Lettres 6e)
Relevez ce que le réalisateur a ajouté par rapport au roman. Ces ajouts vous semblent-ils respecter l'esprit du roman? Justifiez votre point de vue. (Fleurs d’encre 5e)
Proposez des hypothèses pour expliquer les choix du réalisateur et échangez vos points de vue. (Fleurs d’encre 3e)
Les réponses attendues reposent sur une confrontation des adaptations avec l’œuvre littéraire, mais à la différence des questions portant sur la fidélité ou pointant les écarts et transpositions à repérer pour étayer la compréhension littérale du texte, la réflexion, ici plus ouverte, porte sur le sens qui peut être donné aux œuvres: les éventuelles divergences entre texte et adaptation(s) créent un espace dans lequel chaque lecteur est encouragé à s’interroger sur le sens qu’il donne à l’œuvre, l’effet qu’elle produit sur lui, et ainsi à préciser sa propre interprétation – «l’esprit du roman» pouvant faire l’objet de différentes lectures et d’échanges de points de vue argumentés.
A un second niveau, quelques dossiers engagent un travail explicite sur la dynamique interprétative des réécritures et constituent le processus de l’adaptation en objet de réflexion. Cette orientation est surtout saillante dans les manuels de la collection Fleurs d’encre. Le travail sur La Parure pour des 4e se prolonge ainsi en un débat sur la question «Pourquoi adapter un texte littéraire au cinéma?» et se termine avec une activité de rédaction d’un projet d’adaptation filmique «de la nouvelle de Maupassant en la transposant dans le monde d’aujourd’hui». Le processus d’adaptation est aussi constitué en objet de réflexion dans le manuel de 3e qui consacre un chapitre d’une vingtaine de pages aux «récits autobiographiques et réécritures», le sous-titre «atelier lecture et cinéma» précisant qu’il s’agit d’étudier des adaptations cinématographiques de récits autobiographiques. Chaque étape du chapitre organise une analyse comparative d’extraits du texte et du film, de manière assez conforme à ce que la plupart des autres manuels proposent, mais quelques questions atypiques font écho au débat proposé dans l’édition destinée aux 4e, comme les suivantes qui accompagnent la lecture d’une critique du Scaphandre et le Papillon adapté par Julien Schnabel et une étude de passages de L'Enfant noir:
Pourquoi la fidélité du film à l’esprit du livre revêt-elle une telle importance pour le critique? Proposez des hypothèses explicatives.
Quels liens les réécritures de L’Enfant noir entretiennent-elles avec le roman de C. Laye? Définissez le terme «réécriture» à partir des réponses précédentes.
Ces questions qui émaillent les différents questionnaires préparent une activité finale de débat sur le sujet: «Regarder l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire peut-il remplacer la lecture de cette œuvre?». Ce chapitre, certes unique du point de vue de l’ampleur donnée à ce travail, se montre soucieux à la fois de l’approche des procédés cinématographiques et de l’ouverture des interprétations, et il approfondit la réflexion en problématisant explicitement ce qu’engage l’adaptation d’une œuvre littéraire en film. Ce cas particulier illustre comment une problématisation explicite du statut des adaptations est favorable à l’articulation des différents objectifs décrits précédemment.
Conclusion
L’étude des pages de manuels consacrées à des adaptations cinématographiques a permis de distinguer différentes approches de ces films et différentes manières de travailler sur les liens qu’ils entretiennent avec une œuvre littéraire. À partir de ces usages et de leur catégorisation, on peut identifier quelques caractéristiques de la place accordée au cinéma par la discipline français dans le secondaire en France.
D’abord, on constate que le cinéma est pleinement entré parmi les objets d’étude de la discipline. Par rapport à la situation décrite par Archat-Tatah en 2013, force est de constater que les manuels proposent bien plus de travailler sur les films qu’avec eux. Même si la situation d’invisibilité dans laquelle sont placées une grande partie des adaptations traitées dans les manuels suggère que les enjeux liés au choix des films et à la définition des objectifs d’apprentissage restent en partie implicites voire impensés, cette situation traduit en même temps une certaine autonomisation des œuvres cinématographiques, appréhendées indépendamment d’une relation privilégiée avec la littérature.
Il convient ensuite de souligner à quel point la mise en relation d’une adaptation avec l’œuvre littéraire qui l’a inspirée ne se réduit pas à donner aux films une fonction ancillaire. Les cas où des adaptations sont mobilisées pour faciliter l’entrée dans un texte sans autre attention portée à son intérêt en tant qu’œuvre originale sont en effet rares dans le corpus, et concernent quasiment exclusivement des textes de théâtre qu’ils permettent de faire entendre aux élèves. Mais la plupart des questionnaires déploient une approche bien différente, dans laquelle la confrontation du texte et du film est l’occasion d’une certaine réciprocité des éclairages. Le travail de comparaison consistant à repérer les points communs et les différences, qui apparaît comme un passage obligé de la mise en relation des deux œuvres dans un premier temps des questionnaires, prépare un autre niveau de lecture, dans deux directions: le travail peut se tourner vers l’appréhension des procédés cinématographiques éclairés par la confrontation aux passages du texte «traduits» à l’écran, ou orienter la réflexion vers les choix et déplacements opérés dans le film, pour mettre en évidence l’ouverture interprétative permise par l’œuvre et encourager les élèves à élaborer leur propre interprétation. Ces deux orientations sont plus ou moins articulées l’une avec l’autre selon les questionnaires et semblent être d’autant mieux mises en cohérence que le projet de lecture problématise le statut d’adaptation du film et son inscription dans une dynamique de réécriture.
Ainsi, loin d’apparaitre comme le signe que le cinéma resterait dans l’enseignement du français inféodé à la littérature, l’importance donnée au travail sur des adaptations semble bien plutôt correspondre à une forme de didactisation du cinéma qui se stabiliserait dans la discipline – mais qui ne peut concerner qu’un pan du cinéma: restent alors à questionner d’autres formes de didactisation qui pourraient convenir pour le répertoire cinématographique avec lequel cette voie ne peut pas être empruntée.
Bibliographie
Archat-Tatah, Caroline (2013), Ce que l’école fait avec le cinéma, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Dumortier, Jean-Louis (2012), «Contribuer à la formation d’amateurs éclairés», in La Rencontre avec l’œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture, J.-C. Chabanne, M. Parayre et E. Villagordo, Paris, L’Harmattan, p. 159-172.
Le Français aujourd’hui (2009), Films et textes: une didactique à inventer.
Lacelle, Nathalie (2011), «Modèle de lecture-spectature, à intention didactique, de l'œuvre littéraire et de son adaptation filmique», La Lettre de l'AIRDF, n°49, p. 32-36.
Langlade, Gérard. (2012). «Lectures cinématographiques comparées d’une œuvre patrimoniale: La Princesse de Clèves», in Les patrimoines littéraires à l’école, Usages et enjeux, Ahr S. et Denizot N., Namur, Presses universitaires de Namur, p. 17-31.
Louichon, Brigitte (2015). «Le patrimoine littéraire: du passé dans le présent», in Les patrimoines littéraires à l’école. Tensions et débats actuels, M.-F. Bishop, et A. Belhadjin (dir.), Paris, Honoré Champion, p. 93-106.
Perret-Truchot, Laetitia (2015), Analyser les manuels scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français
Cet article propose une analyse documentaire et compréhensive de la place et de la fonction de l’image lors de la lecture de Sobibor de Jean Molla et de La Cour aux étoiles d’Evelyn Brisou-Pellen au Secondaire I.
Place(s) et fonction(s) de l’image dans la lecture de fictions historiques pour la jeunesse en français
Introduction
Dans la rubrique «Apprécier et analyser des productions littéraires diverses» (L1 35), le Plan d’études romand (2012) indique que cette dimension se travaille notamment «en découvrant des caractéristiques esthétiques (graphisme, mise en pages, …)» et «en prenant en compte la forme éditoriale et le paratexte». Aussi pouvons-nous à juste titre nous demander si et comment ces prescriptions sont effectivement mises en œuvre dans les classes lors de la lecture de textes. De quelle manière l’objet-livre et les images qu’il peut contenir sont-ils pris en compte dans l’enseignement de la littérature? Plus largement, nous nous intéressons ainsi à la manière dont les relations textes-images, tant au niveau éditorial que dans l’activité enseignante, nous disent quelque chose de la littérature scolarisée (Louichon 2018) et enseignée.
L’objet qui nous occupe est la fiction historique pour la jeunesse, que l’on peut considérer comme une forme particulière de roman historique, qui se caractérise par «une visée plus spécifiquement didactique», qui vise à «transmettre un savoir historique sur une époque, des évènements, des personnages» (Louichon 2016: 14). Cette dimension a un impact conséquent sur son utilisation dans le cadre de la discipline Français. Brunel a par exemple relevé que les enseignants de Français visent
[…] des objectifs de connaissances historiques plutôt que littéraires, et […] condui[sent] des dispositifs plus proches des tâches scolaires de la discipline Histoire que du Français (2013: 234).
De la même manière, Raimond note que
l’enseignant de Français semble en effet se substituer parfois à l’enseignant d’Histoire en utilisant le texte comme un réservoir de connaissances historiques (2018:147).
Pourtant, la réception de ce genre de texte, c’est-à-dire «un outil sémiotique historiquement et culturellement forgé» (De Pietro & Schneuwly 2003: 34), relève bien d’enjeux qui sont ceux de la discipline Français. Le roman historique s’inscrit dans l’activité langagière «raconter1»: il s’agit d’un récit fictif vraisemblable, qui se situe à une époque que l’auteur n’a pas connue, et qui doit s’appuyer sur des sources pour la reconstruire. Cela détermine la responsabilité de l'auteur «dans l’acte d'énonciation, c'est-à-dire en somme l'autorité que l’on peut lui reconnaître dans son rapport au réel et donc la créance et la confiance à lui accorder» (Védrines 2020: 48). Peyronie insiste sur la connaissance indirecte du contexte historique par l’auteur:
[…] est roman historique tout récit romanesque dont l’action se situe à une époque nécessitant pour son auteur un relais historiographique (2000: 280).
Pour le dire autrement, la situation de communication du roman historique implique une certaine prudence quant à l’usage du genre au service de la construction de savoirs historiques. En revanche, il peut constituer un objet singulièrement intéressant dans la discipline Français, notamment lors d’un travail sur le rapport au référent et le rôle du paratexte dans l’identification de certaines caractéristiques génériques. Il nous semble dès lors particulièrement opportun d’interroger comment le rapport texte-image participe de ce rapport au référent et de la circonscription de la situation de communication du texte, et comment l’image peut mettre à l’épreuve le texte et ses lectures possibles.
Notre objectif est la description et la compréhension des pratiques d’enseignement de la littérature au niveau Secondaire I du point de vue de la didactique de la discipline Français. Nous mobilisons ainsi le cadre théorique de la transposition didactique (Chevallard 1985) pour appréhender le passage de l’objet de savoir à l’objet à enseigner (transposition didactique externe), et de l’objet à enseigner à l’objet effectivement enseigné (transposition didactique interne). Ainsi, nous nous demandons de quelles manières, et avec quels objectifs, l’image est mobilisée au niveau de la transposition didactique externe et de la transposition didactique interne. Comment accompagne-t-elle le texte à lire? Est-elle mise au service de savoirs relatifs à l’Histoire et/ou à des connaissances historiques? Participe-t-elle de la compréhension du texte et de sa situation d’énonciation, et de la construction de savoirs relatifs à l’enseignement de la littérature? En outre, comment s’intègre-t-elle dans le déploiement des dispositifs d’enseignement? Pour répondre à ces questions, nous allons en premier lieu préciser notre ancrage théorique et nos choix méthodologiques, puis nous passerons à l’analyse de la transposition didactique externe et de la transposition didactique interne grâce à deux séquences d’enseignement de Français recueillies entre 2020 et 2021.
Cadre théorique et problématisation
Notre cadre théorique repose sur le concept de transposition didactique (Chevallard 1985; Schneuwly 1995; Bronckart & Plazaola Giger 1998), c’est-à-dire le passage d’un objet de savoir en objet à enseigner, puis en objet enseigné. Nous la mobilisons dans une double perspective: d’abord bourdieusienne, nous considérons que les savoirs sur la littérature sont caractérisés par les espaces sociaux qui les produisent. Ces espaces revendiquent notamment une légitimité à déterminer ce qui relève ou non de la littérature. Nous pouvons ainsi identifier l’espace des études littéraires académiques, celui du champ littéraire proprement dit (écrivains, éditeurs, prix littéraires, etc.) et celui de l’école. Notre perspective est ensuite sociohistorique, et permet de décrire l’épaisseur historique du processus de fabrication de l’enseignable, processus marqué par la disciplinarisation, c’est-à-dire l’organisation des savoirs en disciplines au sein du système scolaire (Schneuwly & Ronveaux 2021), et par la sédimentation, c’est-à-dire la persistance de certaines pratiques traditionnelles d’enseignement dans les nouvelles pratiques. D’autre part, nous effectuons une distinction entre la transposition didactique externe (désormais TD externe) et la transposition didactique interne (désormais TD interne) (Petitjean 1998): la première transforme l’objet de savoir en objet à enseigner, tandis que la seconde est aux mains des enseignants, qui transforment l’objet à enseigner en objet effectivement enseigné.
Nous avons mis en évidence dans notre travail doctoral (Boër 2023) une forme de brouillage générique dans la transposition didactique externe au niveau de l’espace des recommandations (Reuter 2004). Ce brouillage se caractérise par une labellisation sous l’étiquette «roman historique» de textes relevant d’activités langagières et de situation de communication pourtant distinctes (par exemple le Journal d’Anne Franck, Mon ami Frédéric d’Hans Peter Richter, ou encore Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor). Ce phénomène peut s’expliquer en partie par la scolarisation en soutien de la discipline Histoire des fictions historiques pour la jeunesse. En effet, si celles-ci avaient pour objectif, au début de l’école républicaine, d’accompagner la formation d’un futur citoyen et de développer l’amour de la patrie, depuis la deuxième moitié du XXe siècle ces fictions sont produites et scolarisées en lien avec les programmes d’Histoire (Manson 2013). Le développement de l’enseignement de questions mémorielles au début des années 2000 est concomitant à une nouvelle production éditoriale de fictions pour la jeunesse consacrées aux évènements violents du XXe siècle (Finet 2019). Sur le plan de la disciplinarisation, cela conduit à des difficultés dans les pratiques des enseignants de Français à voir le roman historique autrement que comme un objet au service de l’enseignement de savoirs historiques (Brunel 2013; Raimond 2018). Le roman historique devient ainsi dans les pratiques scolaires synonyme de «récit historique», un objet aux contours flous, avec un accent porté sur le référent, au détriment de la situation de communication du texte. Notons qu’au niveau des prescriptions officielles, le PER (2012) utilise le terme «récit historique», qui est conseillé dans le regroupement de genres du texte qui raconte au Secondaire I.
Lors de la lecture d’un roman historique en Français, quelles sont les dimensions du genre qui bénéficient d’un recours à l’image? Au niveau de la mise en texte, quelle sémiotisation de l’image est réalisée par le processus éditorial? Comment est-elle articulée avec le texte et les protocoles de lecture qui y sont déposés (Chartier 1985)? Au niveau de la transposition didactique interne, comment les enseignants mobilisent-ils l’image, pour la mettre au service de quels savoirs?
Méthodologie
Nos données sont constituées par deux séquences de Français dispensées dans deux classes du secondaire I en Suisse francophone, l’une dans le canton de Genève et l’autre dans la partie francophone du canton de Berne. Ces deux séquences ont été transcrites selon les conventions d’usage, et réduites grâce à la constitution de synopsis (Schneuwly et al. 2006). Les documents réalisés par les enseignants et distribués aux élèves ont également été recueillis et ont fait l’objet d’une analyse.
Au niveau de la transposition didactique externe et de la description de l’objet didactisé, nous analysons la matérialité éditoriale (Aeby Daghé 2014) des textes singuliers sélectionnés par les enseignants. En effet, selon Aeby Daghé,
prendre en compte la matérialité du texte, c’est donc considérer que les traces de l’insertion du texte dans un support disent quelque chose des pratiques de lecture en classe et leur confèrent un statut de pratique créatrice, inventive, productrice (2014: 56).
Nous tâchons ainsi de reconstruire les éventuels protocoles de lectures déposés dans l’objet culturel par le rôle conféré à l’image dans le processus de l’édition (Chartier 1985/2003), et les significations que les enseignants de Français peuvent potentiellement sémiotiser. Il s’agit ainsi d’analyser les effets de sens de la matérialité des signes, dont l’horizon d’attente est déterminé par la situation de lecture dans le cadre scolaire.
Au niveau de la transposition didactique interne et de l’analyse de l’objet effectivement enseigné, nous nous intéressons à la place de l’image dans les supports réalisés par les enseignants, considérés comme une mise en texte des savoirs scolaires et préfiguration d’un parcours de lecture (Thévenaz-Christen & Leopoldoff 2014), mais aussi comme traces du geste de planification (Franck 2017). Le découpage de la séquence en activités et l’analyse du geste didactique de mise en place de dispositifs didactiques (Schneuwly 2009) nous permet également de saisir les moments d’utilisation de l’image dans la séquence.
L’image dans la transposition didactique externe
Nous avons analysé deux séquences d’enseignement de la littérature au secondaire I en Suisse francophone. La première, dans une classe de 11e Harmos (14-15 ans), est consacrée au texte Sobibor de Jean Molla. Cette fiction met en scène une jeune adolescente appelée Emma, en proie à l’anorexie, qui trouve dans les affaires de sa grand-mère le journal intime d’un soldat français chargé de l’extermination des Juifs au camp de Sobibor en Pologne. A l’intérieur du récit à la première personne de la jeune fille sont insérés plusieurs extraits de ce journal. Nous relevons que l’enseignement de ce texte comme exemplaire singulier du genre «roman historique» constitue une manifestation du brouillage générique évoqué plus haut, puisqu’il propose une narratrice contemporaine qui ne vit pas directement les évènements historiques en question, mais qui est amenée à découvrir l’implication d’un membre de sa famille dans le génocide par le biais de son journal intime. Sobibor est publié pour la première fois en 2003. Recommandé par le ministère de l’Éducation Nationale français pour le cycle 4 (Secondaire I) pendant plusieurs années, il a bénéficié en 2017 d’une réédition chez Belin/Gallimard avec un dossier pédagogique réalisé par Marianne Chomienne, agrégée de lettres modernes. C’est cette version qui a été distribuée à la classe, et que nous allons à présent décrire.
Cette édition comporte trois images, placées en deuxième et troisième de couverture. Il s’agit d’une photographie en noir et blanc de l’arrivée de déportés au camp d’Auschwitz-Birkneau en juin 1944, d’une photographie en couleur de la sculpture de l’artiste Nandor Glid au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, ainsi que de la reproduction d’une planche de Tardi parue dans le journal Libération le 27 janvier 2000. Comme l’a souligné Cambier (2013), l’usage de sources photographiques dans les dossiers pédagogiques des fictions historiques consacrées à la Shoah vise à garantir l’authenticité des faits racontés. La photographie du mémorial vient souligner en complément la dimension mémorielle du texte. La planche de Tardi est particulièrement intéressante: elle se présente comme un conte (notamment par l’emploi de la formulette il était une fois), et se termine sur l’annonce de l’ouverture du Forum international sur l’Holocauste et la mémoire. La planche propose ainsi une comparaison implicite entre les responsables du génocide et les monstres des contes de fées, monstres qui s’enhardissent lorsqu’on les oublie. La dimension morale sur les dangers de l’oubli est donc particulièrement importante. Boulaire (2002) a mis en avant la proximité entre le conte merveilleux et le roman historique pour la jeunesse, proximité qui peut s’expliquer par certaines finalités morales de ces deux genres de textes, qui s’adressent spécifiquement à des jeunes lecteurs. La planche de Tardi est particulièrement significative, à la fois pour l’ancrage du texte dans le paysage des fictions historiques pour la jeunesse, mais également pour ses finalités éducatives et morales assumées. Finet (2018) nous rappelle que, dans la fiction historique pour la jeunesse sur la Shoah, et contrairement au roman historique traditionnel,
ce ne sont […] pas les personnages qui permettent d’acquérir les connaissances historiques, mais tous les dossiers et documents qui viennent compléter la fiction et qui lui donnent un caractère pédagogique (2018: 124).
Si le dossier pédagogique joue le rôle de garant de la véracité du processus de mise à mort industriel décrit dans le récit et renforce sa dimension didactique, cela sort le texte du champ de la littérature à proprement parler et dirige son usage à des fins éducatives qui dépassent l’enseignement de la littérature proprement dit. Nous pouvons aller plus loin dans notre propos en analysant comment le dossier pédagogique mobilise ces trois images. Elles font en effet l’objet de trois «lectures d’image», estampillées «Histoire des arts». Ces activités sont divisées en trois tâches: lire l’image, comparer le texte et l’image, et une tâche intitulée «à vous de créer». Sans entrer dans les détails, relevons que ces tâches sont marquées par une volonté de faire travailler l’argumentation des élèves et de pointer le message du texte. A titre d’exemple, voici la question posée dans la tâche «comparer le texte et l’image» pour la photographie du Mémorial: «Pensez-vous que la vision d’un monument commémoratif est plus efficace que la lecture d’un récit sur l’extermination? Vous justifierez votre réponse en développant au moins deux arguments» (2017: 186). Ces «lectures d’image» visent ainsi à entraîner l’élève à argumenter sur la nécessité d’entretenir la mémoire du génocide, parachevant ainsi le programme de cette édition de Sobibor, en le faisant passant de récepteur à producteur d’un discours mémoriel.
Relevons également la première de couverture de Sobibor2: il s’agit d’une photographie en gros plan d’une jeune adolescente, dont la souffrance psychique est visible. La première de couverture pointe ainsi non pas le génocide lui-même comme sujet, mais bien la souffrance de la narratrice, liée à la découverte du rôle de son grand-père dans le génocide. Le choix de cette image est également un bon révélateur de l’insertion de Sobibor dans la littérature qui s’adresse à la jeunesse, et qui veut tendre un miroir à son lecteur3, en partant de l’hypothèse que réside dans cette fonction l’intérêt dudit lecteur. Pourtant, comme l’ont souligné Jaubert et al.,
les romanciers, les éditeurs, les enseignants et certains didacticiens semblent poser comme une évidence que la fiction historique fonctionnerait par le biais de l’identification du lecteur au personnage. Or, cette affirmation demanderait à être vérifiée et peut-être surtout préalablement définie (2013: 15).
Nous constatons ainsi le rôle important que joue l’image, au niveau éditorial, d’une lecture orientée vers des fins mémorielles, une finalité explicitement voulue par l’auteur de Sobibor4. Passons à présent à l’analyse de la TD externe du deuxième texte qui nous occupe.
La deuxième séquence, donnée dans une classe de 10e Harmos (13-14 ans), porte sur La Cour aux étoiles d’Evelyne Brisou-Pellen. Publié pour la première fois en 1982, ce texte a connu de multiples rééditions, et est toujours disponible sur le marché de la littérature de jeunesse. Spécialiste du roman pour la jeunesse, Evelyne Brisou-Pellen est l’autrice de nombreux romans historiques, ainsi que de romans dont l’action est plus contemporaine. La Cour aux étoiles se déroule au XIVe siècle et met en scène un jeune serf, Renaud, qui s’enfuit de son domaine pour atterrir à Paris dans un repaire de brigand. Cette Cour aux étoiles est dirigée par Thibaud le Chevalier, qui va accompagner le jeune garçon dans son adaptation à cette nouvelle vie parisienne. Pour cette séquence, les enseignants ont travaillé avec l’édition 2019 de Rageot, qui ne comporte pas de dossier pédagogique, mais un certain nombre d’images, qui peuvent constituer des indices de lecture.
Sur la première de couverture5, deux personnages occupent la place centrale: un jeune adolescent et un personnage plus âgé, tous deux vêtus d’une façon qui évoque le Moyen Âge. Derrière eux, on distingue une foule dont deux personnages se détachent: une jeune fille brune sur la droite, et, en plus petit, un homme chauve et moustachu sur la gauche. Au dernier plan s’élancent les tours de Notre-Dame de Paris. Les vêtements des personnages indiquent le Moyen Âge, et la présence imposante de la cathédrale Notre Dame de Paris, symbole emblématique du roman historique qui se déroule au Moyen Âge6, complète la «forêt de signes» (Thaler & Jean-Bart 2002) destinée à plonger le lecteur dans l’époque concernée, avant l’entrée dans la lecture proprement dite. L’illustrateur a choisi de représenter Renaud et Thibaud avec des traits physiques plutôt semblables: ils sont tous les deux blonds, les yeux clairs, et le camaïeu de couleurs qui compose leurs tenues - gris en haut, marron en bas - est identique. Ainsi, leur ressemblance souligne leur relation père-fils symbolique, et leurs traits physiques les caractérisent comme les personnages positifs de l’histoire. Selon Boulaire (2002), dans le Moyen Âge des fictions historiques pour la jeunesse, «le type noble est parfaitement reconnaissable: blondeur, clarté du teint, traits fins, mais fermes, nez et menton volontaires, yeux clairs» (2002: 64).
La couverture ainsi que les illustrations de cette édition ont été réalisées par un illustrateur de métier, dont la notice biographique est présente sous celle de l’autrice, en dernière page. Ces deux notices sont les seuls éléments paratextuels proposés par cette édition, avec les illustrations qui escortent le texte. Celles-ci portent sur les contenus du récit (par exemple celle du chapitre 1 représente une chaumière), et leur fonction figurative accompagne ainsi l’activité langagière du texte qui raconte, le rapprochant du conte. La présence de ces illustrations, et l’importance accordée à l’illustrateur avec sa notice biographique, vont dans le sens d’une littérature de jeunesse qui se considère comme une littérature imagée, avec une volonté de créer un dialogue entre l’image et le texte (Louichon 2018). Bien que la fiction historique pour la jeunesse des années 1980-1990 s’attache à reproduire les mœurs d’une époque historique, et vise à accompagner les plans d’études de la discipline Histoire7 (Manson 2013), aucun document ou source historique ne vient authentifier le contexte historique du texte. Le processus éditorial semble avoir pris en compte les critiques adressés à la fiction historique pour la jeunesse (voir notamment Boulaire 2002 et Houssais 2011) pour inscrire le texte dans un registre plus proche du conte. C’est d’ailleurs sous cette appellation générique qu’est classée La Cour aux étoiles sur sa fiche Wikipédia8.
Nous voyons ainsi le rôle important que joue l’image dans la lecture possible proposée par la TD externe. Lors de la lecture concrète de ces textes en classe, les enseignants vont-ils dans le sens de cette orientation donnée par le processus éditorial? Les images que nous venons d’analyser sont-elles mobilisées par les enseignants pendant les leçons? Ont-ils recours à d’autres images, et avec quels objectifs?
L’image dans la transposition didactique interne
Pour la séquence sur Sobibor, l’enseignante a notamment créé un dossier papier qu’elle distribue aux élèves lors de la première leçon. Il comprend trois parties: la première est composée de quelques indications biographiques sur Jean Molla, et d’un petit texte qui résume les motivations de l’auteur à rédiger Sobibor. Cette partie est notamment illustrée par une photographie de Jean Molla (figure 1). La deuxième partie est constituée d’un questionnaire de soixante-deux questions, tandis que la troisième partie comprend un article de vulgarisation scientifique sur le secret de famille écrit par Serge Tisseron9. Ici, l’image est mise au service de la situation de communication du texte et de la personnification de l’auteur, dont la position en tant qu’enseignant de Lettres est soulignée. Finet (2019) a d’ailleurs mis en évidence comment les supports éditoriaux des fictions historiques pour la jeunesse consacrée à la Shoah insistent sur le fait que l’auteur soit également enseignant, de manière à légitimer l’usage du texte à des fins éducatives. De la même manière, ce pointage est planifié par l’enseignante dans le support qu’elle a réalisé.

Figure 1
La première leçon de la séquence est consacrée à une introduction sur le genre «roman historique», suivie de la lecture à haute voix du prologue. L’enseignante s’appuie sur des diapositives PowerPoint pour assurer cette introduction. Plusieurs images sont alors montrées à la classe, et les portraits d’Alexandre Dumas et de Gustave Flaubert («donc voilà comme ça vous avez quelques noms d’auteurs […] que vous pouvez euh retenir pour votre culture générale», SBB, 1-1/3, l. 208-211) sont montrés dans la partie sur l’histoire du genre. Cette entrée par l’histoire littéraire avec un pointage de la figure de l’Auteur est caractéristique de l’approche classique de l’enseignement de la littérature (Gabathuler 2016; Ronveaux & Schneuwly 2018), et témoigne d’une conception du texte littéraire comme un texte d’auteur avant tout.
Lorsque l’enseignante arrive à la présentation du texte singulier, elle montre notamment une carte de l’Europe avec l’emplacement du camp de Sobibor. Après avoir distribué les exemplaires du livre aux élèves, elle revient au tableau pour montrer trois images: une photographie d’archive du camp (figure 2), une image extraite du film Sobibor (Konstantin Khabenskiy, 2018) sur la révolte du camp (figure 3), ainsi qu’une photographie du Mémorial (figure 4), qu’elle commente rapidement («voilà donc là vous avez une photo d’époque de Sobibor un extrait du film euh de:: qui est sorti euh récemment sur euh sur Sobibor ce film il est un peu violent moi je l'ai pas vu mais:: je le passerais pas un truc aussi violent en classe», SBB, 1-1/3, l. 429-428 - SBB, 1-2/3, l. 16-17). Ce film a d’ailleurs déjà été mentionné au tout début de la séquence, afin de différencier les camps d’Auschwitz et de Sobibor:
ES: Sobibor est un petit moins connu euh mais il est connu pour euh une chose en particulier et c’est pour ça qu’il y a eu un film récemment euh sur euh sur Sobibor qui euh parle de laH d’une révolte de prisonniers donc il y a certains prisonniers qui ont décidé dans ce camp-là de se rebeller et de tenter ensuite de s’évader (SBB, 1-1/3, l.332-342)

Figure 210

Figure 311

Figure 412
Elle ne dit rien de la photographie du Mémorial du camp. Toutefois, sa présence, similaire à ce que l’on peut trouver dans le dossier pédagogique de l’édition 2017, semble pointer implicitement la dimension mémorielle du texte, comme c’est souvent le cas avec ces fictions: «ces récits […] se donnent moins une finalité didactique - la transmission d’un savoir historique - qu’une finalité éthique - le devoir de mémoire» (Cambier 2013: 51).
Dans cette séquence, l’image est mobilisée pour attester de la réalité historique du contexte historique du texte qui va être lu, sans pour autant que ne soit pointée la différence entre la photographie d’archive et l’extrait du film. L’image n’est pas ici source d’activité (comme une lecture d’image par exemple), mais utilisée pour préciser le contexte référentiel du texte.
Dans le reste de la séquence, l’image n’est plus sollicitée. En outre, l’enseignante ne pointe pas les images présentes dans l’objet-livre, tout en choisissant de montrer des images similaires (une photographie d’époque et une photographie d’un monument en hommage aux victimes du génocide). Au niveau de la TD interne, nous voyons comment l’image est d’abord mobilisée pour inscrire le nouvel objet d’enseignement dans un objet plus large, l’histoire littéraire. Toutefois, si l’enseignante précise que c’est pour la culture générale des élèves, elle institutionnalise néanmoins un savoir («que vous pouvez retenir»). Au moment de passer d’un objet macro (le genre) à un objet plus restreint (le texte singulier), l’image ne sert plus la situation de communication comme dans le dossier, mais la dimension référentielle du récit. Sur le plan didactique, cette utilisation de l’image peut être comprise comme la volonté de l’enseignante de s’assurer que ce référent soit le même et compris par tous les élèves avant d’entamer la lecture du texte. En outre, étant donnée la définition du genre qu’elle a donné en début de séquence («une fiction avec des personnages inventés mais qui auraient pu exister, dans un cadre historique réel»), l’utilisation de l’image vient ici souligner la réalité de ce cadre historique. Il s’agit donc de pointer le rapport au référent du texte. Passons à présent à l’analyse de la place de l’image dans la TD interne du texte d’Evelyne Brisou-Pellen.
La séquence sur La Cour aux étoiles se caractérise par un nombre plus important d’activités et de supports distribués aux élèves. Dans ces supports, nous constatons que l’image a une fonction que nous qualifierons d’illustration. Par exemple, la synthèse sur les caractéristiques du genre est illustrée par l’image suivante (figure 5), qui est la seule de tous les supports dont la source est indiquée:

Figure 5
De la même manière, l’aide-mémoire sur la notion de servage propose cette image:

Figure 6
Le matériel didactique réalisé par l’enseignant comprend également plusieurs questionnaires sur le texte. Celui sur les chapitres 1 à 4 se termine notamment avec cette image:

Figure 7
La première image (figure 5) est tirée d’une banque d’images (gettyimages.fr), et évoque à la fois l’esthétique d’un jeu vidéo et celle de la fantasy13. La deuxième image (figure 6) est tirée de l’article «paysan» de l’encyclopédie en ligne Wikipédia: il s’agit de la représentation du mois d’octobre du Brevarium Grimani, daté de 1510, et peut être considérée comme un document historique. Enfin, la dernière image (figure 7) est en réalité l’illustration de couverture de l’édition Cascade de 1996 de La Cour aux étoiles, sur laquelle on peut reconnaître le personnage principal Renaud, ainsi que Thibaud et d’autres personnages de cette Cour. Ces trois images ont des sources très différentes, mais bien le même statut. Il s’agit d’illustrer le contexte référentiel du récit, mais, contrairement à la séquence sur Sobibor, il ne s’agit pas de souligner son caractère factuel, mais plutôt de plonger l’élève dans une «ambiance» médiévale. Nous pouvons faire un parallèle avec l’argument de Boulaire (2002) qui avance que le Moyen Âge représenté dans les fictions historiques pour la jeunesse relève plus de stéréotypes littéraires (du roman historique romantique ou du cycle arthurien par exemple) que de la recherche historique proprement dite14. Les images mobilisées ici dans les supports adressés aux élèves ne visent pas l’exactitude historique, mais plutôt les représentations communes sur cette période historique. Ce travail d’illustration réalisé par l’enseignant au moment de la préparation des supports peut être interprété comme une volonté de soutenir la compréhension des élèves en leur fournissant une aide visuelle permettant de mieux se représenter l’époque historique dans laquelle le récit se déroule. Notons également que la source historique (figure 6) est utilisée dans un document visant à synthétiser les notions de serf et de servage, donc dans un support qui pointe des savoirs historiques, tandis que les images d’illustration sont utilisées dans des supports relevant strictement de la discipline Français (le genre et les questionnaires sur le texte). Nous pouvons faire l’hypothèse que cette distinction est voulue par l’enseignant, qui est par ailleurs également enseignant d’Histoire. Il n’évoque cependant pas ces images au cours de la séquence, ni celles du texte lui-même15.
Au cours de la séquence, l’image intervient dans un dispositif didactique particulier lors de la cinquième leçon. L’enseignant diffuse une vidéo tirée de la plateforme Youtube16 sur l’hygiène au Moyen Âge. Notons que l’hygiène est un objet d’enseignement du programme d’Histoire au cycle 3 (SHS32, Histoire du vêtement, de l'hygiène, du tourisme), mais que cette question de l’hygiène est également présente dans le récit, puisque Renaud va régulièrement aux étuves et attache une importance particulière à la propreté. Cette leçon commence d’ailleurs par une lecture à haute voix du passage dans lequel Renaud s’empare d’un balai pour nettoyer la Cour, sous les yeux médusés de ses habitants, puis se rend aux étuves. Juste avant de diffuser la vidéo, l’enseignant mène un petit échange avec les élèves pour faire émerger leurs représentations sur l’hygiène médiévale:
ES1: qui est-ce qui s'est un petit peu renseigné sur l'hygiène: à cette époque-là /
El: très sale
ES1: oui L(prénom de l’élève):
El1-L: eh en fait je me suis pas peu renseigné mais je la connais à peu près donc personne se lavait et eh: ben on vidait eh la pisse dans les rues tout ça / donc eh l'hygiène c'était pas forcément ce qu'on a maintenant
ES1: oui heureusement↓ mais H je suis pas tout tout tout à fait d'accord avec l'idée que personne se lavait
El1-L: oui
El2-M: non
El1-L: eh les riches se lavaient
ES1: eh: je suis non plus pas tout tout tout à fait d'accord: M(prénom de l’élève):
El2-M: eh non: XX ils avaient pas beaucoup d'argent ils préféraient aller ailleurs XXX que dans l’entretien du corps
ES1: oui c'est ça↓ au moins / alors: je vous passe une petite vidéo de six minute vingt-cinq: qui traite de ce sujet-là↓ // (LCAE, 5-2/2, l.23-40)
Le visionnage de cette vidéo vise ainsi à modifier les représentations des élèves sur les pratiques hygiéniques du Moyen Âge. Toutefois, son contenu n’est pas mis en relation avec le texte étudié, que ce soit sur le plan du contexte référentiel ou des exigences du personnage principal en termes de propreté. Comme nous avons pu le montrer ailleurs (Boër 2023), cette séquence se caractérise par une dilution de l’objet enseigné dans une série d’activités diverses qui relèvent d’un modèle «lecture-prétexte» de l’enseignement, dans lequel la littérature constitue «un objet-ressource mis au service d’autres compétences jugées plus fondamentales et/ou plus utiles pour la vie sociale» (Dufays 2006: 82). La séquence sur Sobibor relève au contraire d’un modèle d’enseignement plus classique de la littérature. En outre, l’enseignante rappelle à plusieurs reprises à la classe sa volonté de les préparer pour le Secondaire II. Les portraits des auteurs présentés pour la «culture générale» des élèves participent de cet objectif par l’inscription de l’objet enseigné dans l’histoire littéraire, et par la construction de savoirs que les élèves auront à mobiliser dans leur future scolarité.
Conclusion
Envisagées comme un lieu de sémiotisation de la littérature scolarisée et enseignée, les relations texte-image analysées ici lors de la lecture en classe de fictions historiques pour la jeunesse accordent une part importante au référent, et attestent des finalités scolaires possibles de la lecture de ces textes.
Au niveau de la TD externe, l’image, dans le livre Sobibor, a une triple fonction: présenter un miroir à l’élève lecteur pour favoriser son implication, assurer le rôle de garant factuel de la description historique, et pointer la finalité mémorielle que l’auteur du texte revendique. Nous constatons, au niveau de la TD interne, une neutralisation du protocole de lecture déposé dans l’objet-livre pour ancrer résolument la réception en classe du texte du côté de l’enseignement de la littérature dans son paradigme classique, avec une focale d’abord sur l’Auteur, puis sur le contexte historique dans lequel s’ancre le récit. L’image est ainsi mobilisée en début de séquence, pour accompagner la découverte de l’objet enseigné, et le passage du genre au texte singulier.
Pour La Cour aux étoiles, l’édition choisie par l’enseignant tend à situer le texte du côté du conte et de la «lecture-plaisir» (Chartier & Hébrard 2000) c’est-à-dire une lecture de divertissement, qui n’a pas directement une fonction éducative, et n’est pas destinée à faire l’objet d’un enseignement. Ce modèle de la lecture-plaisir concerne des textes longs qui se lisent individuellement, et qui doivent «donne[r] aux enfant le goût de lire et leur offr[ir] les moyens de devenir de bons consommateurs culturels» (Chartier & Hébrard 2000: 355). Contrairement à Sobibor, la TD interne est ici principalement en continuité avec la TD externe, puisque l’image dans les supports vise avant tout à illustrer l’histoire (le récit) par une représentation figurative de l’Histoire. Notons toutefois la vidéo montrée par l’enseignant qui vient pointer des savoirs historiques sur l’hygiène médiévale.
L’articulation en continuité entre TD externe et TD interne ne va ainsi pas de soi, et le travail de l’enseignant en tant que création proprement originale, qui peut maintenir ou pas certains éléments de la TD externe est à souligner. Dans les deux séquences analysées, l’image ne sert que ponctuellement à aborder des savoirs historiques, elle est avant tout mobilisée pour assurer la réception du texte et l’insérer dans les dispositifs traditionnels de l’enseignement de la littérature. Face à un objet complexe comme le roman historique, «genre hybride, contraint, paradoxal, critiqué aussi» (Louichon 2016: 17), les outils de la discipline font preuve d’une résistance qui est à souligner. Nous relevons toutefois la nécessité de distinguer les différents statuts des images au niveau de la TD interne, notamment la source de l’illustration. En effet, de la même manière que le rapport au référent est déterminé par l’activité langagière du texte, le rapport au référent de l’image diffère en fonction de son origine. Notre analyse de la place de l’image dans cette contribution vient ici compléter et confirmer notre thèse d’un brouillage générique dans les pratiques d’enseignement en Français, qui se manifeste par l’importance du référent au détriment des dimensions langagières des textes. En outre, nous constatons que la prescription du PER de prendre en compte la forme éditoriale et le paratexte ne fait pas l’objet d’un pointage dans ces deux séquences.
Bibliographie
Aeby Daghé, Sandrine (2014), Candide, La fée carabine et les autres : vers un modèle didactique de la lecture littéraire, Berne, Peter Lang.
Ahr, Sylviane (2006), L’enseignement de la littérature au collège, Paris, L’Harmattan.
Boër, Diane (2023), Le roman historique en classe de Français. Du genre de texte à enseigner au texte lu en classe, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Boulaire, Cécile (2002), Le Moyen Âge dans la littérature pour enfants, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Bronckart, Jean-Paul (1996), Activités langagières, textes et discours, pour un interactionnisme socio-discursif, Lausanne, Delachaux et Niestlé.
Bronckart, Jean-Paul & Plazaola Giger, Itziar (1998), «La transposition didactique. Histoire et perspectives d’une problématique fondatrice», Pratiques, 97 (1), p. 35‑58.
Brunel, Magalie (2013), «La fiction historique de jeunesse et les « grands hommes » de l’Histoire : quels intérêts didactiques dans l’appropriation des savoirs en français ? Le cas Molière», Repères, n° 48, p. 223-240.
Cambier, Agnès (2013), «Enjeux mémoriaux et littéraires des fictions pour la jeunesse autour de la Shoah», Repères, n° 48, p. 51-68.
Chartier, Anne-Marie & Hébrard, Jean (2000) Discours sur la lecture : 1880-2000, Paris, Fayard.
Chartier, Roger (1985/2003), «Du livre au lire», in Pratiques de la lecture, Paris, Payot & Rivages, p. 81‑117.
Chevallard, Yves (1985), La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage.
Conférence Intercantonale de L'instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (2012). Plan d’études romand, CIIP.
De Pietro, Jean-François & Schneuwly, Bernard (2003), «Le modèle didactique du genre : un concept de l’ingénierie didactique», Les Cahiers Théodile, n° 3, p. 27‑52.
Dufays, Jean-Louis (2006), «La lecture littéraire, des « pratiques du terrain » aux modèles théoriques», Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues, n° 33, p. 79-101
Finet, Béatrice (2018), «Rôles du personnage dans les romans historiques pour la jeunesse», Le français aujourd’hui, 201 (2), p. 119‑127.
Finet, Béatrice (2019), La Shoah racontée aux enfants, une éducation littéraire ?, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
Franck, Orianna (2017). A la recherche de l’archiélève lecteur à travers l’analyse du geste de planification : rôle des élèves dans les modifications de séquences d’enseignement, Thèse de doctorat, Université de Genève.
Gabathuler, Chloé (2016), Apprécier la littérature : la relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Houssais, Yvon (2011), «Représentations du Moyen Âge dans la littérature de jeunesse : clichés et ruptures (2000-2006)», In Médiévalités enfantines : du passé défini au passé indéfini, C. Cazanave & Y. Houssais (dir.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 157‑170.
Jaubert, Martine, Lalagüe-Dulac, Sylvie & Louichon, Brigitte (2013), «Les fictions historiques : un objet littéraire, éditorial et scolaire qui interroge les frontières», Repères, n° 48, p. 7‑16.
Louichon, Brigitte (2016), «Introduction», In Fictions historiques pour la jeunesse en France et au Québec, B. Louichon & S. Brehm (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, p. 11‑20.
Louichon, Brigitte (2018), «Images et littérature dans les manuels : quelle(s) image(s) de la littérature?», in Enseigner la littérature en dialogue avec les arts : Confrontations, échanges et articulations entre approches didactiques, J.-C. Chabanne (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 159‑174.
Manson, Michel (2013), «Roman historique», in Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d’enfance et de jeunesse en France, I. Nières-Chevrel & J. Perrot (dir.), Paris, Editions du cercle de la librairie, p. 822‑825.
Petitjean, André (1998), «La transposition didactique en français», Pratiques, 97 (1), p. 7‑34.
Raimond, Anne-Claire (2018) «Fonctions et finalités didactiques du roman historique pour la jeunesse au collège», in Fictions médiévales pour la jeunesse, Y. Houssais (dir.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 133‑148.
Reuter, Yves (2004), «Analyser la discipline : quelques propositions», La Lettre de l’AIRDF, 35 (2), p. 5‑12.
Ronveaux, Christophe & Schneuwly, Bernard (2018), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation : enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Berne, Peter Lang.
Schneuwly, Bernard (1995), «De l’utilité de la «transposition didactique», in Didactique du français : état d’une discipline, J.-L. Chiss, J. David, & Y. Reuter (dir.), Paris, Nathan, p. 47‑62.
Schneuwly, Bernard (2009), «Le travail enseignant», in Des objets enseignés en classe de français, B. Schneuwly & J. Dolz (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 29‑44.
Schneuwly, Bernard, Dolz, Joaquim & Ronveaux, Christophe (2006) «Le synopsis : un outil pour analyser les objets enseignés», in Les méthodes de recherche en didactiques : actes du premier séminaire international sur les méthodes de recherches en didactiques de juin 2005, M.-J. Perrin-Glorian & Y. Reuter (dir.), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 175‑189.
Schneuwly, Bernard & Ronveaux, Christophe (2021), «Une approche instrumentale de la transposition didactique», Pratiques, n° 189‑190. https://doi.org/10.4000/pratiques.9515
Thaler, Danielle, & Jean-Bart, Alain (2002), Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, roman d’aventures, Paris, L’Harmattan.
Thévenaz-Christen, Thérèse & Leopoldoff, Irina (2014), «Les supports d’enseignement de la lecture et leurs entours», in La lecture enseignée au fil de l’école obligatoire : l’exemple genevois, T. Thévenaz-Christen (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, p. 170‑212.
Védrines, Bruno (2020), «Enseignement de la fiction et connaissance», Recherches, n° 72, p. 47‑63.
Passer par la peinture pour enseigner la littérature : un détour à l’épreuve de la recherche
Faire du commentaire pictural un détour pour favoriser l’apprentissage du commentaire littéraire est séduisant. L'enquête dont est issu cet article documente et interroge les tenants et les aboutissants d'une telle ambition.
Passer par la peinture pour enseigner la littérature : un détour à l’épreuve de la recherche
Introduction
Le projet de passer par des exercices de réception de l’image comme médiation pour les enseignements/apprentissages en lecture de la littérature est séduisant. Il repose sur deux présupposés: les images se liraient à la manière dont se lisent les textes; les élèves, plus familiers du visuel que du textuel, y seraient moins en difficulté. Ainsi, un rapport de l’Inspection générale, en France, affirmait, en 2000, que la «lecture de l’image» était un «détour opérant» pour apprendre à lire la littérature, «un apport méthodique indéniable, dans la mesure où la démarche d’analyse pour "déchiffrer" une image est plus spontanément reçue par les élèves» (Waysbord-Loing, 2000: 16).
Or l’institutionnalisation scolaire de l’expression lecture de l’image1 n’est pas sans poser problème, en tout cas concernant les œuvres picturales, souvent évoquées parmi les images à étudier, et auxquelles cet article se consacre plus particulièrement. D’abord, un tableau ne se lit pas, en tout cas au sens propre du mot lire, car les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits, pour significatives qu’elles soient, ne font pas l’objet d’un encodage de type linguistique. Si la sémiologie picturale est à l’origine de l’expression, ses propositions théoriques déconstruisent cependant aisément le présupposé d'une identité entre lecture littéraire et réception picturale: il y a forcément métaphore à parler «de vocabulaire ou de lexique picturaux, de syntaxe figurative» (Marin, 1971: 9). Ainsi faut-il prendre garde aux «assimilations hâtives que cautionne l’application au visuel de termes appartenant à la terminologie linguistique ou rhétorique.» (Vouilloux, 2006: 137). Ensuite, il est douteux que les élèves reçoivent «plus spontanément» la peinture que la littérature. Selon Bourdieu et Darbel (1966), affirmer que «l’homme de la culture de l’image serait immédiatement doté de la culture nécessaire pour déchiffrer l’œuvre picturale, image entre les images» (p. 16), c’est s’autoriser à ne pas enseigner à tous ses codes spécifiques pour la réserver aux «âmes bien nées» (p. 15). D’ailleurs, il est contestable qu’une œuvre picturale soit une image car elle n’est pas forcément figurative, et quand elle l’est, ses composantes ne peuvent se réduire à leur fonction mimétique, elles prennent sens pour le récepteur par leurs caractéristiques plastiques et pas seulement iconiques (Vouilloux, 2004).
Or, si les programmes actuels, du moins en France, soulignent plus que par le passé la spécificité des deux langages2, il est toujours question, par exemple dans les programmes de lycée, d’«éclairer la lecture des œuvres et des textes littéraires (…) par leur mise en relation avec les autres arts»3 C’est pourquoi nous souhaitons interroger ici, d’un point de vue socio-didactique, les conditions d’un passage par le commentaire4 de la peinture pour favoriser l’enseignement/apprentissage du commentaire de la littérature. Le transfert, au profit de la littérature, de compétences qui auraient été construites en travaillant sur la peinture est-il possible malgré les écarts sémiotiques entre les deux arts et les écarts herméneutiques qui en résultent? A quelles conditions? Par ailleurs, d’après les enquêtes en sociologie de la culture, par exemple celles d’Olivier Donnat (2011: 28), il demeure en France «une forte stratification sociale des pratiques culturelles». Comme en 1966 «la fréquentation des musées est presque exclusivement le fait des classes cultivées» (Bourdieu & Darbel: 35). Le commentaire pictural n’est-il accessible qu’aux élèves à qui leur parcours scolaire et extrascolaire rend familière la culture picturale 5? le projet de détour, étant alors facilitateur pour les uns et pas pour les autres, serait-il susceptible de renforcer les inégalités sociales de réussite?
1. Méthodologie et cadre théorique
Nous nous appuierons sur une recherche basée sur une double enquête (Claude, 2015, 2016a, 2016b). La première auprès de 350 élèves de troisième et de seconde scolarisés dans des établissements de l’académie de Créteil au recrutement socialement contrasté (parmi les PCS des parents – Professions et Catégories Socio-professionnelles – le taux des «Employés», «Ouvriers», «Personnes sans activité professionnelle», va de 10,7% à 51 % selon les classes enquêtées). La seconde auprès de 200 enseignants de français de la même région.
Pour ce qui est des élèves, chacun d’entre eux a écrit, en deux heures, deux commentaires. Le premier sur une des six reproductions picturales et le second sur un des six extraits littéraires que nous leur avions proposés, choisis parce qu’ils présentaient d’après notre analyse des difficultés équivalentes (voir Claude, 2017)6. Les modalités d’exécution du travail étaient les mêmes pour les deux exercices et la consigne était rédigée semblablement: «écrivez dix lignes (au minimum) pour commenter (donnez quelques-unes de vos impressions)». Suivait une phrase autorisant à ne pas traiter l’un des deux objets en expliquant pourquoi. Le corpus a fait l’objet d’une double analyse comparative, entre commentaire littéraire et pictural d’une part, entre profils sociaux des élèves d’autre part. Puis des entretiens post passation ont été menés avec 11 groupes de 2 à 4 élèves, l’enquêteur les invitant à revenir sur leurs travaux et à expliquer pourquoi ils préféraient l’un ou l’autre des deux exercices ou s’y sentaient plus compétents. L’analyse des transcriptions a permis d’affiner la compréhension des conduites d’élèves dans les deux exercices.
Du côté des enseignants, nous avons soumis un questionnaire à 211 enseignants de français de l’académie de Créteil. Ils étaient interrogés sur les objectifs qu’ils se donnaient concernant chacun des deux arts, les difficultés qu’ils y rencontraient, et leurs critères pour considérer les exercices comme réussis, critères qui se sont avérés de même nature pour les deux objets. Ceci nous a permis de disposer d’une référence à l’aune de laquelle comparer les commentaires. Le but de cette recherche n’était donc pas de tester un dispositif d’enseignement, mais de comparer, au regard des attendus, les dispositions culturelles et langagières que les élèves étaient susceptibles d’importer de leur expérience antérieure au départ d’un projet de détour par la peinture.
L’appui théorique des registres de l’apprentissage, tels que les définissent Elisabeth Bautier et Patrick Rayou (2013), nous a permis d’analyser le corpus. Selon ce modèle, une activité d’apprentissage est analysable comme configurant trois registres. Le premier est celui des opérations cognitivo-langagières qui sont mises en œuvre. Le second, culturel, est constitué des savoirs généraux et spécialisés qui y sont engagés. Le troisième, identitaire symbolique, concerne les modes d’engagement de soi dans l’activité et de la prise en compte d’autrui. Nous avons cherché à comprendre, d’après les réponses des enseignants, comment ils attendaient que soient configurés les trois registres, et d’en déduire des critères pour notre analyse comparative des commentaires des élèves. Ce qui nous a permis de connaître, pour chacun des deux arts et pour les différents profils sociaux, la proportion des commentaires plus ou moins proches de la mobilisation des registres que les enseignants souhaitaient y trouver.
2. Aperçu des résultats: des commentaires picturaux plus proches des attendus que les commentaires littéraires
Les élèves ont été sensiblement plus nombreux à s’emparer de l’autorisation qui leur était donnée de ne pas faire l’exercice pour le texte (30.5%) que pour la peinture (5.5%). L’écart est plus net encore si nous ne retenons que les travaux des élèves des classes de recrutement majoritairement défavorisé (1.5% ne traitent pas la peinture et 47.5% ne traitent pas la littérature). Ils ont donc vraisemblablement le sentiment d’être plus compétents en commentaire pictural. Pour savoir s’ils l’étaient effectivement, nous avons comparé les commentaires à l’aune des attentes des enseignants.
2.1. Ce qui est attendu des enseignants dans les trois registres
Dans le registre cognitif, les enseignants souhaitent que les élèves appréhendent avec justesse un sens qu’on peut considérer comme consensuel, mais aussi interprètent, c’est-à-dire conçoivent d’autres directions de sens, si possible plurielles. Ils voudraient aussi que les élèves sachent montrer ces sens interprétés comme acceptables par le texte ou le tableau commenté, en s’appuyant sur une observation minutieuse de cet objet, notamment de sa forme (pour la peinture teintes, texture, composition, lignes; pour la littérature sonorités, rythmes, figures de style, composition…) mais aussi en tenant compte du contexte artistique et historique. Dans le registre culturel, ceci suppose que les élèves disposent de savoirs linguistiques et iconographiques pour accéder à la part consensuelle du sens mais aussi de savoirs leur permettant de justifier et de nourrir leur interprétation. Dans le registre identitaire symbolique, une majorité des enseignants disent attendre que les élèves s’engagent subjectivement dans une transaction avec l’œuvre, en y mettant de ce qu’ils sont vraiment, de leurs émotions, de leurs valeurs, car c’est nécessaire pour qu’ils puissent concevoir personnellement du sens. Mais comme l’interprétation produite doit être justifiée par une analyse du texte ou du tableau, il faut aussi qu’ils acceptent de ressaisir cette réception subjective, de la retravailler (ce qui rappelle le processus de va et vient dialectique défini par Jean-Louis Dufays, 2016). Ce processus est généralement perçu par les enseignants enquêtés comme successif: il faut donc s’investir puis se désinvestir, en prenant ses distances avec l’objet, tout en conservant trace des éléments interprétatifs permis par la projection de soi. C’est donc une façon très spécifique d’être soi qui est attendue dans le registre identitaire symbolique.
2.2. Les commentaires des élèves à l’aune de ces attendus
D’une analyse qualitative fine d’une trentaine de commentaires, nous avons induit des caractéristiques langagières correspondant aux différents critères que nous avons définis d'après les réponses des enseignants. Ceci nous a permis, pour l’approche quantitative, de classer chacun des 700 commentaires, pour chacun des critères, dans un type plus ou moins proche des attendus. Nous ne pouvons détailler ici les indicateurs pour chaque critère de chaque registre (voir Claude, 2015), en voici deux exemples qui pourront en donner une idée: pour déterminer, dans le registre cognitif, si l’élève concevait des directions de sens relevant d’une interprétation, nous avons observé s’il y avait écart entre le lexique objectivement attaché à la description du tableau ou à l’univers diégétique du texte et un lexique s’en abstrayant, manifestant la part prise par le récepteur dans la création de significations (par exemple, à propos de la Nativité de Georges de la Tour, le vocabulaire abstrait, «mort», «enfers», «paradis», «froideur», «crainte», qui ne relève pas de la seule observation du tableau, signale que le commentateur prend en charge la proposition d’un sens symbolique).
Autre exemple, dans le registre identitaire symbolique, certains indicateurs signalent l’investissement subjectif : marques de la première personne, modalisateurs, adverbes («personnellement, je pense que…» ; «franchement c’est un beau tableau»), formules explicitant l’activité du récepteur («il me semble…», «on dirait que…», «je comprends que…», «je propose d’y voir»….), indices lexicaux de l’appréciation ou de la dépréciation, comme des adjectifs péjoratifs ou mélioratifs (le texte ou le tableau est «intéressant», «incompréhensible», «émouvant» ; les couleurs sont «belles», «criardes», «joyeuses»….). D’autres indicateurs permettent de repérer la ressaisie de cet engagement pour le partager avec autrui, notamment les marques de l’articulation justifiée entre caractéristiques de l’œuvre et interprétation proposée (tel élément «montre que….», «donne l’impression que…». Cette impression «est le fait de…», «vient de…», «s’explique par…», «est produite par…»)
D’après notre étude, les commentaires picturaux des élèves présentent les opérations cognitivo-langagières attendues des enseignants plus souvent que leurs commentaires littéraires. 81% des commentaires picturaux sont analysables comme relevant de l’interprétation alors que c’est le cas de 60 % des commentaires sur la littérature. Dans 39% des commentaires picturaux et seulement 22% des commentaires littéraires les élèves proposent des directions de sens plurielles. 73 % des commentateurs prennent en compte les caractéristiques formelles pour la peinture alors que c’est le cas de seulement 45 % pour la littérature, où ils les traitent de surcroît plus souvent de façon purement descriptive, sans leur associer d’effets de sens. Pour chaque critère du registre cognitif, l’écart de réussite se creuse nettement en faveur de la peinture pour les élèves des établissements de recrutement défavorisé (un seul exemple: pour ce sous-groupe, des pistes interprétatives sont repérables dans 78 % des commentaires picturaux, et 34 % des commentaires littéraires seulement).
Dans le registre culturel, la peinture met en revanche les élèves en difficulté plus souvent que la littérature: beaucoup de commentaires manifestent que leur auteur ne dispose pas de certaines connaissances dont on peut considérer qu’elles seraient nécessaires pour lui permettre d’appréhender une part du sens dont on peut considérer, en contexte scolaire, qu’elle doit faire consensus. 40 % des élèves sont mis difficulté pour leur compréhension de la peinture, contre 27% pour la littérature. Par exemple, 60% des élèves n’identifient pas les personnages comme un troupe de comédiens dans le tableau de Picasso, La Famille de Saltimbanques. 75 % de ceux qui travaillent sur La Nativité ou Le Nouveau-né de Georges de la Tour n’identifient pas les personnages évangéliques7. Pour les textes, les savoirs linguistiques, notamment lexicaux, peuvent certes faire défaut, mais plus rarement empêcher l'appréhension du sens global du texte (Cèbe, Goigoux & Thomaset, 2003). En revanche, les élèves sont sensiblement plus nombreux pour le tableau (20%) que pour le texte (10 %) à convoquer des savoirs culturels pour étayer leur interprétation, notamment des références à d’autres œuvres.
Dans le registre identitaire symbolique enfin, les élèves acceptent mieux le double mouvement d’implication subjective et de ressaisie de cette implication, d’après nos indicateurs, concernant la peinture (40% des commentaires contre 20% en commentaire littéraire; dans les établissements les plus défavorisés, l’écart se creuse nettement: 36 % pour la peinture et 5 % seulement pour la littérature).
Donc notre analyse montre que les conduites d’élèves dans les trois registres sont très différentes d’un art à l’autre. Par rapport aux commentaires littéraires, les commentaires picturaux sont plus proches des attendus des enseignants pour la majorité de nos critères; ils n’en sont plus éloignés que pour une partie des critères du registre culturel. Que les élèves s’approchent plus souvent de normes scolaires quand ils travaillent sur la peinture confirme que le projet de faire jouer un rôle de médiation à cet exercice pour enseigner le commentaire littéraire doit être pris au sérieux. Mais il faut comprendre, pour chacun des registres, ce qui explique que les conduites d’élèves soient différentes. C’est nécessaire pour tenter de définir quel accompagnement pourrait les aider à transférer ce qu’ils savent faire d’un art à l’autre, afin d’éviter que le détour soit sans retour (Claude & Rayou, 2020).
3.Propositions d’explication des différences
Si les élèves ne réussissent pas semblablement les deux activités, c’est, d’après nous, parce que les différences sémiologiques entre deux objets ont des incidences sur l’activité requise dans les trois registres; mais c’est aussi parce que les élèves ne perçoivent pas les deux objets de la même façon.
3.1. Les incidences des différences sémiologiques entre les deux objets
3.1.1. Des savoirs culturels exigeants pour la peinture.
Certes, il n’existe pas de lexique pictural. Pour autant, les signes picturaux ne font pas sens naturellement, même s’il n’y a pas de corrélation arbitraire entre signifiant et signifié (Eco, 1992). Certains motifs ou configurations plastiques sont conventionnellement dotés, préalablement à leur réalisation dans le tableau, de contenus de sens. Un exemple en est la connaissance, souvent utile pour le genre de la peinture d’histoire8 de l’iconographie9. Erwin Panofsky définit deux stades de l’appréhension d’un tableau figuratif: le premier, pré-iconographique, est celui de la reconnaissance de ce qui est figuré, c'est-à-dire des «motifs artistiques»; il permet d’appréhender les significations «primaires ou naturelles». L’«expérience pratique» (1967: 17, 18) d’un récepteur ordinaire y suffit le plus souvent (sont représentés un homme et une femme nus, un paon…). Le second stade est celui de l’iconographie, par lequel le spectateur accède aux significations conventionnelles des motifs, en reconnaissant les thèmes ou concepts (ce sont Adam et Eve, c’est l’attribut d’Héra…). Appréhender ces contenus de sens requiert des connaissances parfois savantes, d’autant que ces conventions sont variables pour le même thème d’un foyer culturel à l’autre.
3.1.2. Un langage qui ne s’appuie pas sur une langue
C’est au récepteur de la peinture de postuler des corrélations entre forme (combinaisons de teintes, de textures et de traits) et sens, sans l’appui d’un code de type linguistique (Eco, 1992). Ceci réclame de lui une participation active, mais moins contrainte, et peut expliquer que les élèves se sentent plus autorisés à produire une interprétation. Par ailleurs, les signes picturaux sont à la fois des désignants (au sens où ils représentent un figuré) et des signifiants à valeur expressive (au sens où les caractéristiques picturales produisent certaines impressions) (Marin, 1971), ils ont une double nature, iconique, du fait qu’ils participent à la figuration, et plastique, du fait qu’ils se caractérisent par une certaine qualité matérielle (Groupe µ, 1992), ce qui peut expliquer pourquoi les élèves construisent plus souvent du sens en articulant les deux aspects du signe. Pour un tableau non figuratif, les caractéristiques plastiques doivent suffire au récepteur pour concevoir sa compréhension/interprétation. Certes, dans la discipline, le lecteur doit aussi donner sens aux caractéristiques sensibles de la forme du texte: mais l’existence du code linguistique peut masquer à une partie des élèves cette modalité de production de sens.
Une autre différence réside dans la temporalité de l’appréhension. Commenter un texte selon les réquisits scolaires suppose des relectures à même de faire émerger diverses interprétations. Cependant, la successivité s’impose à la première lecture. Au contraire, si le tableau présente généralement des jalons au parcours du regard, jalons parfois très visibles, notamment dans un tableau de facture classique, il laisse néanmoins au spectateur le choix d’ordonner les composantes de diverses façons, de sorte que «le tableau n’offre pas une lecture, mais un système de lectures» (Marin, 1971: 21). Ceci peut inciter l’élève à construire une pluralité de sens. Bernard Vouilloux souligne la «labilité des indices qui autorisent l’interprétation figurative» (2006: 142): il dépend du spectateur que telle ou telle caractéristique d’un tableau soit retenue comme signifiante, ce qui peut favoriser, à l’échelle d’un groupe voire au cours de la réception d’un même sujet, des propositions interprétatives diverses.
L’élève récepteur de la peinture pourrait par conséquent se sentir plus encouragé à donner sens à l’œuvre, y compris à sa forme, à concevoir une interprétation plurielle. La peinture est donc telle, par ses caractéristiques propres, qu’elle est susceptible d’encourager les opérations cognitives attendues des enseignants. Mais c’est à la condition que l’élève s’engage effectivement dans la réception, qu’il accepte et s’autorise ce travail de récepteur actif. Ceci suppose un certain rapport à l’objet: dans le registre culturel, un certain mode de valorisation de l’objet; dans le registre identitaire symbolique, un engagement subjectif dans l’interaction avec lui.
3.2. Un rapport différent des élèves aux deux objets
Les entretiens post-passation avec les élèves font apparaître, quand on les compare avec les verbatims des enseignants, un rapport10 à l’œuvre picturale plus favorable aux attendus de ces derniers que leur rapport à l’œuvre littéraire. Nous confronterons dans cette partie des verbatims d’enseignants et d’élèves, afin de mettre en lumière des écarts de conception qui ne peuvent qu’être sources de malentendus.
3.2.1. Le texte du récepteur
Si une minorité des enseignants se réfèrent à une conception du sens des œuvres comme immanent, c’est-à-dire contenu dans l’œuvre même, réduit à l’intentio operis (Eco, 1992), pour la majorité d’entre eux, il s’agit bien de co-construire ce sens, comme l’exprime Yvon 11 (enseignant au lycée):
Il ne s'agit pas d'un matériau mort et figé (…), mais [le texte] est le résultat de deux phases créatives: celle réalisée, parfois dans la douleur, par son auteur, et la recréation, qui la complète, par l’opération de lecture.
Le rapport que les élèves ont au tableau apparaît bien plus compatible avec cet attendu que le rapport qu’ils ont au texte. Sarah (élève de seconde) explique par exemple en entretien: «le tableau, c’est notre opinion, alors qu’un texte, c’est l’opinion de l’auteur… C’est ça qu’il faut dire en commentaire… Dans une peinture c’est plus facile, on est libre». Pour Amélie (élève de troisième): «Sur le tableau il y a rien d’écrit, c’est à nous d’écrire, alors que sur le texte il y a ce qu’il y a déjà écrit». Commentaire et objet du commentaire étant de nature linguistique, elle les perçoit comme concurrents, et ne se sent de ce fait pas autorisée à produire son texte de lectrice (Mazauric, Fourtanier & Langlade, 2011). Cette idée est exprimée par plusieurs élèves de notre corpus. Au contraire, pour la peinture, le langage de l’objet et le métalangage du commentaire sont hétérogènes, ce qui autoriserait le texte de réception. Dayane (élève de seconde) explique par exemple: «une peinture… il y a pas de texte… je veux dire c’est nous on imagine… alors qu’un poème il y a des textes, alors…».
Une partie des enseignants aimeraient que leurs élèves s’appuient sur un investissement subjectif entier (au sens du paradigme du sujet lecteur, Langlade & Rouxel, 2004), sur leurs émotions notamment. Chloé (enseignante en lycée) écrit par exemple: «Je leur demande: - de formuler, d’exprimer leurs émotions – de repérer comment l’émotion a été possible, par quels procédés l’auteur a réussi à la faire naître.». Ils font même parfois de l’émotion une condition incontournable de la compréhension/interprétation des oeuvres, comme Pascal (enseignant en lycée):
Je souhaite qu’ils comprennent que [le texte] est un lieu vivant, de pure émotion, de plaisir, qui doit faire réagir très vite. Si l’émotion n’est pas transmise, il faut savoir faire un sort expéditif à ce texte en expliquant pourquoi (même rapidement), puis tendre les bras à un autre auteur.
Or les élèves, quant à eux, dénient souvent à la littérature tout pouvoir de les émouvoir, au contraire de la peinture:
Hafza: Les émotions du texte moi je les sens pas!
Dayane : Émotifs on n’est pas trop émotifs (rires)
Enquêtrice: Et sur les tableaux ça vous fait quelque chose davantage?
Sarah: Oui parce que il y a des couleurs (…)
Selim: Bien sûr on voit si on voit quelqu’un de mort ça va nous faire quelque chose bien sûr.
Si tous ne sont pas aussi péremptoires, aucun, dans nos entretiens, n’exprime son émotion de lecteur, alors qu’ils sont nombreux à se dire sensibles à la peinture.
3.2.2. La pluralité de l’interprétation
Adrien (enseignant en lycée), comme beaucoup de ses collègues, insiste sur la pluralité de sens qui fait la richesse de l’œuvre littéraire:
Avec mes élèves, je compare volontiers le texte à un mille-feuille. Tous les deux se savourent, et tous les deux ont une multitude de strates. Et plus il y a de strates, meilleur c’est. Les strates d’un chef d’œuvre sont infinies…
Pour les élèves au contraire, si c’est possible de donner plusieurs sens à un tableau, ce n’est pas le cas pour un texte. Ainsi, selon Amélie (élève de troisième): «le texte il peut avoir qu’un seul sens et un tableau il peut avoir plusieurs sens». Dans un autre entretien, Sarah, Hafza et Dayane débattent de l’interprétation de La Nativité de George de la Tour. Pour Hafza: «c’est la naissance de Jésus». Mais pour Sarah: «Non moi j’aurais vu n’importe quelle naissance». Hafza affirme alors la possibilité de la pluralité interprétative: «Ça dépend de la personne qui regarde…» Les deux élèves iront jusqu’ à dépasser leur désaccord interprétatif: non pas un sens ou l’autre, mais une intégration des deux directions de sens :
Hafza: C’est les deux. C’est un commencement.
Sarah: C’est l’espoir… c’est un espoir…
L’enquêtrice tentant alors de les amener au même type d’échanges à propos d’un texte se heurte à une fin de non-recevoir:
Enquêtrice.… mais il n’y a pas deux manières de comprendre?
Ensemble: Un texte? Ben non… un texte, non…
3.2.2. Une forme signifiante
Autre composante du rapport aux œuvres d’art qui sous-tend les attendus scolaires, la forme de l’expression doit être appréhendée comme riche de virtualités connotatives à actualiser: «j’attends qu’ils parviennent à montrer que l’écriture fait sens» (Emma, enseignante en lycée). Presque tous les enseignants regrettent que leurs élèves se contentent souvent de décrire des caractéristiques formelles sans rien en faire, comme l’écrit Maria (enseignante en lycée): «Je voudrais éviter le formalisme sans construction du sens (les élèves décrivent la forme, relèvent des figures de style, des champs lexicaux, décrivent la prosodie mais n’en font rien)». Cet échange entre des élèves à propos de «Stances à Marquise» de Corneille12 nous semble illustrer ce que Maria souhaite éviter: pendant qu’Hafza tente de construire du sens, Sarah et Dayane s’évertuent à décrire la versification:
Sarah: C’est un poème… (à propos de Stances à Marquise de Corneille)
Dayane: Il y a des rimes… Des rimes plates ou des rimes embrassées…
Hafza: Mais c’est un vieux…
Sarah: Croisées… je crois?
Dayane: Ah oui croisées
Hafza: …une personne âgée qui fait une déclaration…
Sarah: Il y a des strophes…des… quatre… quatrains.
En revanche, concernant la peinture, ils évoquent très souvent les caractéristiques plastiques, notamment les couleurs, pour expliquer comment ils s’y prennent pour commenter, comme Akim (élève de seconde): «Dans le tableau il y a les couleurs qui nous annoncent… les sentiments, la joie ou… et comme il y a des couleurs chacun fait des hypothèses…».
Au-delà des caractéristiques sémiologiques de la peinture, le rapport des élèves à cet art peut donc expliquer que leurs productions écrites sont plus proches de ce que valorisent les enseignants quand il s’agit de peinture que quand il s’agit de littérature. Le statut des deux exercices dans les évaluations, très différent, y contribue sans doute. En effet, si les programmes français prescrivent la «lecture de l’image» à tous les niveaux du secondaire, elle est beaucoup moins présente que la littérature dans les épreuves certificatives, ce qui fait que les élèves sont moins souvent soumis à des exercices d’entraînement notés. Or, plusieurs nous disent en entretien, comme Fatiha, que «si dans un commentaire on dit quelque chose qui nous plaît et qu’on développe, peut-être que Mme E (son enseignante) c’est pas ça qu’elle voulait comme idée et on n’aura pas une bonne note». Cette crainte contribue sans doute à construire leur rapport différent aux deux arts. Certains des enseignants qui ont répondu à notre enquête le soulignent, comme Pascal (enseignant en lycée): «ils parlent plus facilement devant un tableau (…) que devant un texte dont la forme écrite rappelle immédiatement la contrainte de la copie, du devoir sanctionné par une note».
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les enseignants cherchent à faire de la peinture une médiation pour la littérature. Une enseignante en collège dit en entretien: «Ce travail les aide à revenir au texte: ils comprennent enfin ce que j’attends!» Or, si nous sommes en mesure de confirmer que les élèves, notamment dans les collèges les plus défavorisés, y rencontrent moins de difficultés, nous constatons que cette facilitation provient des écarts entre les deux arts: l’activité de compréhension/interprétation ne peut donc être transposée à l’identique, son transfert d’un art à l’autre nécessite une adaptation.
4. L'accompagnement didactique nécessaire
Notre enquête auprès des enseignants fait apparaître trois types de posture concernant le transfert des apprentissages d’un art à l’autre.
Quelques enseignants font le choix délibéré de cacher à leurs élèves la finalité du travail qu’ils proposent aux élèves sur la peinture: comme ce travail plaît aux élèves, ils craignent de perdre leur implication en faisant explicitement le lien avec la littérature. Ainsi Delphine (enseignante en collège) écrit-elle: «Ils aiment tellement ça que j’essaie de ne pas casser l’ambiance en leur rappelant qu’en réalité on fait du français». Marie (enseignante en lycée) se réjouit quant à elle que les élèves «sont comme Monsieur Jourdain, avec la peinture ils apprennent le commentaire sans le savoir!». Il s’agirait donc, en somme, pour préserver l’engagement des élèves dans l’exercice quand il porte sur la peinture, d’invisibiliser la finalité du retour à la littérature.
Les enseignants d’un second groupe, majoritaires, explicitent la finalité du retour à la littérature mais considèrent que le passage d’un art à l’autre va de soi. Julien (enseignant en collège), écrit: «Ils voient bien que le principe est le même: être à l’écoute de ses réactions à l’œuvre et en faire quelque chose.» La médiation par la peinture risque fort de rester lettre morte si l’enseignant n’aide pas ses élèves à prendre conscience, d’une part des apprentissages qu’ils ont réalisés et, d’autre part, des transformations qu’il est nécessaire de faire subir à ces apprentissages pour les adapter à un objet de nature différente. On peut craindre que seuls ceux qui disposent déjà du rapport à la littérature requis par l’exercice ne soient en mesure de prendre en charge par eux-mêmes le retour du détour, les autres restant tributaires de représentations qui font obstacle à leur réussite.
Les enseignants d’un dernier groupe disent s’attacher à accompagner le travail de recontextualisation, au profit du commentaire littéraire, des compétences acquises par la pratique du commentaire pictural. Ainsi Emma, enseignante en lycée, détaille en entretien l’accompagnement didactique qu’elle a opéré suite à une remarque fortuite d’un de ses élèves:
J’ai travaillé sur le Radeau de la Méduse; il fallait observer, réagir, construire une interprétation à partir de là. Quand je leur ai demandé de faire le bilan de ce que nous avions fait un élève a dit: ‘’c’était bien aujourd’hui, ce qu’on a fait était mieux que d’habitude’’. Un autre a répondu: ‘’on a fait exactement la même chose que d’habitude’’. J’étais ravie, je les ai fait travailler à partir de là: ce que nous avions fait, les points communs et les différences avec ce que nous faisons sur la littérature (…) pour que ça serve à quelque chose il faut arriver à ce qu’ils fassent le lien.
Pour ces enseignants, il est nécessaire de faire identifier aux élèves l’opération intellectuelle qui leur a permis de commenter la peinture, de manière à ce qu’ils puissent la décontextualiser et la recontextualiser au profit de la littérature. Compte tenu de ce que notre recherche nous a appris du rapport très différent des élèves aux deux arts, qui s’ajoute aux différences sémiotiques, on peut affirmer que c’est une condition pour faire jouer à la peinture un rôle de médiation vers la littérature.
Conclusion
Passer par la peinture pour favoriser les apprentissages en commentaire de la littérature (au sens large que nous donnons au mot commentaire) est un projet légitime. En effet, par rapport à la littérature, les élèves s’approchent davantage de ce qui est attendu des enseignants quand on leur demande, en amont de tout dispositif didactique, d’écrire leur compréhension/interprétation d’un tableau. Ils partent de moins loin des normes scolaires en commentaire pictural qu’en commentaire littéraire. Ce sont, d’après nos analyses, les écarts sémiotiques et surtout le rapport différent des élèves aux deux arts qui expliquent cette meilleure réussite: beaucoup d’élèves que nous avons rencontrés en entretien manifestent un rapport à la peinture qui est compatible avec les réquisits scolaires; au contraire, concernant la littérature de nombreux malentendus apparaissent, qui affectent nos trois registres. On peut considérer ces malentendus comme socio-scolaires (Rayou, 202O), du fait que les écarts entre réussite en commentaire pictural et en commentaire littéraire s’accroissent, dans notre recherche, pour les élèves des établissements de recrutement très populaire. Par conséquent, la préconisation d'une médiation par la peinture peut être illusoire si elle présuppose l’évidence d’un transfert entre les deux processus de compréhension/interprétation: si l’enseignant considère que c’est la même activité, donc qu’il n’y aucune difficulté à transposer à la littérature ce qu’on sait faire sur la peinture, les malentendus risquent de rester entiers. Les inégalités de réussite concernant la littérature ont de ce fait peu de chances de diminuer. En revanche, le détour par la peinture est prometteur si l’enseignant prend en charge, dans les trois registres que nous avons définis, l’étayage du retour à la littérature, c’est-à-dire qu’il accompagne ses élèves dans le transfert, au profit du commentaire littéraire, de ce qu’ils sont capables de faire en commentaire pictural.
Bibliographie
Bautier, Élisabeth, Rayou, Patrick (2013), Les Inégalités d’apprentissage: programmes, pratiques et malentendus scolaires, Paris, Presses universitaires de France.
Bourdieu, Pierre, Darbel, Alain (1966), L’Amour de l’art: les musées et leur public, Paris, Minuit.
Cèbe, Sylvie, Goigoux, Roland, Thomazet, Serge (2003), Enseigner la compréhension: principes didactiques, exemples de tâches et d’activités, Direction de l’enseignement scolaire.
Charlot, Bernard (1997). Du Rapport au savoir. Éléments pour une théorie, Paris, Anthropos.
Claude, Marie-Sylvie (2015), «Commenter la peinture, commenter la littérature: ce que les enseignants attendent, ce que les élèves entendent», Recherches en didactiques, 20 (2), p. 9-21.
Claude, Marie-Sylvie. (2016a), «Commentaire de la peinture et commentaire de la littérature: étude comparée de l’activité des élèves», in, Didactiques du français et de la littérature, André Petitjean (dir.), Université de Lorraine.
Claude, Marie-Sylvie. (2016b), «Lire la peinture, lire le texte littéraire à l’école: une activité de même nature?», Éducation & didactique, 10 (1), p. 67-76.
Claude, Marie-Sylvie (2017), «Peinture et littérature face aux pratiques, gouts et savoirs culturels des élèves du second degré», Pratiques, p. 175-176.
Claude, Marie-Sylvie, Rayou, Patrick (2020), «Aider à la réussite scolaire: des détours sans retours? Peinture et littérature en classe de Français», Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 7 (hors-série), p. 65-85.
Daunay, Bertrand (2004), «Le commentaire: exercice, genre, activité?», Cahiers Théodile n° 5, p. 49-61.
Donnat, Olivier (2011), «Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales». Culture études n° 7, Paris, Département des études de la prospective et des statistiques, Ministère de la culture.
Dufays, Jean-Louis (2016), «La lecture littéraire, histoire et avatars d’un modèle didactique», Tréma, n° 45, p.9-17.
Eco, Umberto (1992), La Production des signes, Paris, Librairie générale française.
Falardeau, Éric & Sauvaire, Marion (2015), «Les composantes de la compétence en lecture littéraire», Le français aujourd’hui, 191(4), p. 71-84.
Groupe µ. (1992), Traité du signe visuel, Paris, Seuil.
Langlade, Gérard, Rouxel, Annie (dir.) (2004). Le sujet lecteur: lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
Marin, Louis (1971), Etudes sémiologiques. Ecritures, peintures, France, Klincksieck.
Mazauric, Catherine, Fourtanier, Marie-José & Langlade, Gérard (dir.) (2011), Le texte du lecteur, Bruxelles, PIE-Peter Lang.
Panofsky, Erwin (1967), Essais d’iconologie: thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance, Paris, Gallimard.
Rayou, Patrick (2020), «Des registres pour apprendre», Éducation & didactique, 14 (2), p. 49-64.
Vouilloux, Bernard (2004), L'Œuvre en souffrance. Entre poétique et esthétique, Paris, Belin.
Vouilloux, Bernard (2006), «Du figural iconique», Poétique, n°146, p. 131-146.
Waysbord-Loing Hélène (2000), L’Image dans l’enseignement des lettres. Rapport de l’inspection générale, Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
«Marquise, si mon visage / A quelques traits un peu vieux, / Souvenez-vous qu'à mon âge / Vous ne vaudrez guère mieux.»
Voir également :
Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message
Comment ne pas appauvrir l’expérience du rapport à l'image dans un enseignement de littérature attentif à l'expression verbale?
Objets littéraires iconotextuels: travailler avec l’image pour interpréter le message
Introduction
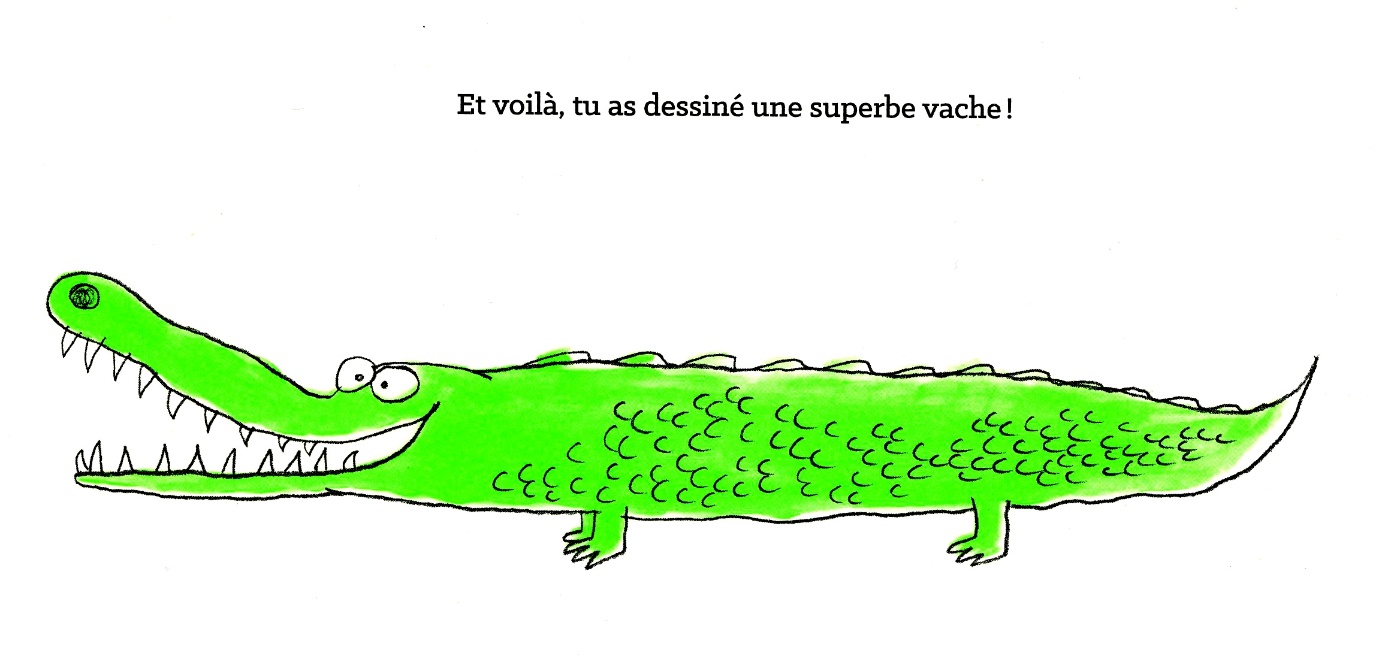
Figure 1: Extrait de Rice & Badel (2015) Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache
Comme le montre la Figure 1, les objets littéraires considérés dans cette contribution ne sont pas des textes accompagnés d’illustrations mais présentent une littérarité conjointement portée par un texte et une ou plusieurs images (Mitchell, 2013; Tauveron, 1999 & 2000). Construits sur le concept d’iconotexte (Nerlich, 1990), ces récits se composent de manière indissoluble de texte(s) et d’image(s) qui, par leur confrontation, mettent en tension de manière dynamique deux modalités sémiotiques sans les confondre (Montandon, 1990). En dirigeant l’attention vers le récit, les images comme les textes y dénotent leurs objets par leur coprésence (Peirce, 1997; Lefevre, 2011). Enseigner la lecture, la compréhension et l’interprétation d’un récit iconotextuel suppose ainsi de considérer à parts égales le rôle du texte et des images dans la production de sens.
En raison de l’organisation disciplinaire de l’institution scolaire liée au morcèlement des savoirs, l’image qui coconstruit un récit de manière multimodale trouve difficilement sa place dans les modélisations didactiques (Leclaire-Halté, 2008; Lépine, 2012; Lacelle et al, 2017; Lebreton Reinhard & Aubert, 2022). Lorsque l’image est prise en compte, c’est dans le rapport qu’elle entretient avec le texte qui reste le prisme par lequel l’enseignant·e est invité·e à utiliser ces supports.
La réflexion placée au centre de cette contribution s’appuie sur une approche sémiologique de ces objets littéraires pour en proposer une transposition didactique. L’enseignement-apprentissage de la littérature à l’école relevant majoritairement du travail du sens (Falardeau, 2003), l’approche sémiologique permet de partir de la réception du message et donc du sujet-lecteur pour élaborer un dispositif didactique.
L’anthropologie du sens (Michel, 2017) dissocie la compréhension de l’interprétation et permet de clarifier une confusion courante dans l’enseignement de la littérature (Falardeau, 2003). L’interprétation constitue cette compréhension différée lorsque le sens ne se donne pas spontanément. Dans le cas du récit iconotextuel, l’activité de compréhension dégage le potentiel sémantique et sémiotique de chaque modalité alors que l’activité d’interprétation, par la mise en relation du potentiel de chaque registre sémiotique, recontextualise la tension dynamique qu’ils génèrent à l’échelle du récit. Or les caractéristiques différentes de ces deux médiums mis en coprésence complexifient une lecture alors plurisémiotique (Kress, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2006) et posent des défis à l’enseignement de cette littérature. Le sens issu de la combinaison d’un texte et d’une image générant une tension dynamique au niveau sémiotique, la coconstruction est laissée au sujet-lecteur-récepteur qui n’a d’autre choix que de considérer l’ensemble des signes (Mitchell, 2013). L’approche disciplinaire, donc «par le texte», conduit ainsi à un décalage entre l’enseignement et la réception individuelle du récit (Leclaire-Halté, 2008).
En se basant sur une expérience menée grâce à la collaboration d’enseignant·es, de chercheur·euses et de didacticien·nes, la présente contribution rappelle le rôle de l’image sur la fabrication de sens en contexte narratif et propose un dispositif didactique. Le développement d’un outil testé par des enseignant·es dans le canton de Neuchâtel en Suisse dans les dispositifs des «Lecture-philo» entreprend de faire de la complexité des supports littéraires iconotextuels un levier pour travailler le rapport à soi et à l’autre. En effet, le champ de l’interprétation permet et oblige même le sujet-lecteur à négocier et renégocier cette signification complexe coconstruite par un texte et des images, ces dernières pouvant, «comme le texte, faire l’objet d’interprétations erronées (Tauveron, 2002: 49)».
Issus du courant anglosaxon des Social semiotics (Jewitt, 2011), l’approche multimodale des supports actuels permet de donner une place à la sémiose individuelle, entendue comme ce processus dynamique de signification impliquant le signe, son objet et son interprétant·e (Peirce, 1997), en dépassant l’approche verbocentrée. Le travail conjoint de l’image et du texte en contexte narratif est ici envisagé comme un outil au service du développement d’une compétence essentielle en didactique de la littérature: comprendre qu’on a compris.
Cadre théorique et problématisation
Nous nous centrons ici sur l’enseignement-apprentissage de la lecture d’un objet littéraire composite car construit sur l’interdépendance du texte et de l’image. Tous les supports composés de textes et d’images ne constituent pas des iconotextes. Si l’image joue un rôle sur la production de sens de par sa seule présence, le sens de l’iconotexte est conçu comme coporté par les deux registres sémiotiques. En littérature jeunesse, le terme album est utilisé pour qualifier ce type de récit à la complexité singulière puisque les images n’y occupent pas une fonction illustrative (Nerlich, 1990; Tauveron, 2000). Particulièrement proliférante et/ou résistante (Tauveron, 2000), la signification de ces images repose sur la combinaison de plusieurs signes aux caractéristiques intrinsèques différentes. Dans une perspective peircienne (Peirce, 1997) et multimodale (Kress, 2010), cette combinaison ouvre un espace de signification qui contraint une renégociation permanente du sens dont la temporalité permet d’y voir s’immiscer le connu et le vécu. La coprésence du texte et de l’image engendre une production mentale relevant de l’expérience sensible et intellectuelle (Bordron, 2011). En catégorisant les différences et les similitudes entre le texte et l’image, le sujet-regardant mobilise l’ensemble de ses connaissances et de ses expériences, expliquant la diversité des interprétations possibles des images (Rabatel, 2022).
Nos récentes recherches sur le rôle de l’image en contexte narratif (Lebreton Reinhard & Attanasio, 2022; Lebreton Reinhard & Aubert, 2022; Lebreton Reinhard & Azaoui, sous presse; Lebreton Reinhard & Kohler, 2023) montrent que l’activité de lecture d’un album commence par les images, notamment en raison de notre aptitude supérieure à traiter l’information visuelle (Gibson, 1950; Haupt & Huber, 2008). L’image, qui ne se décode pas, constitue ainsi la première voie d’accès au récit, voire la seule avant l’entrée dans l’écrit des élèves.
Les compétences littéraciques attendues chez le sujet-lecteur doivent donc lui permettre de prendre en charge de manière autonome les modalités verbales et visuelles puisque c’est dans leurs relations que le sens se construit. L’image, par la rapidité de sa perception, reste une opportunité pédagogique puisqu’elle offre au jeune sujet-lecteur le pouvoir d’accéder au récit même partiellement alors que les études démontrent que l’adulte s’en remet prioritairement au texte pour construire sa compréhension (Hétier, 2015; Leclaire-Halté, 2008).
Si de nombreux·ses auteur·ices maintiennent un flou conceptuel entre les termes compréhension et interprétation, voire les utilisent comme synonymes (Falardeau, 2003), l’anthropologie du sens (Michel, 2017) distingue les deux en considérant l’interprétation comme une compréhension différée lorsque le sens ne se donne pas spontanément. Dans le cas du récit iconotextuel, l’activité de compréhension peut ainsi permettre de saisir chacune des modalités dans son potentiel sémantique et sémiotique alors que l’activité d’interprétation vise la mise en relation de ces modalités et donc la recontextualisation de leurs relations à l’échelle du récit. Si la sémiose fonctionne de manière systémique et dynamique avec les signes qui s’offrent à elle, parvenir à décomposer le sens potentiel du texte et de l’image dans une étape de compréhension avant de les mettre en relation pour faire des choix dans le contexte du récit lors de l’interprétation permet au processus d’enseignement-apprentissage de transmettre des connaissances et des compétences littéraciques complexes.
Comme le montre la Figure 1, le verbal ne permet pas de saisir que l’animal dessiné est un crocodile ou que le texte s’adresse à un·e destinataire qui n’a pas dessiné une vache. Toute abstraction du texte ou de l’image supprime ici de facto l’accès au message: «Ce que tu as dessiné, c’est un crocodile!». La coconstruction du sens est laissée au sujet-lecteur qui doit négocier la signification pour produire le sens. Conjointement, c’est dans cette activité de construction du sens que se situe l’esthétisme littéraire voire l’expérience esthésique permise par la combinaison lorsqu’on comprend qu’on a compris. Didactiquement, que faire ici de l’image qui non seulement contredit le texte mais pilote le message? Comment dépasser l’identification du crocodile par l’observation?
L’image, porteuse d’un message propre, est énonciative. Passée l’identification d’un crocodile par analogie au connu, comment signifie-t-elle ce crocodile? Que disent du crocodile signifié la forme, la couleur, la position, le cadrage, l’interaction avec le spectateur, etc.? Pour les théoriciens de l’image (voir par exemple Emmanuel Alloa, Max Imdahl, Groupe Mu, Georges Didi-Hubermann, Jean-François Bordron), l’image trouve son sens dans la manière dont elle nous donne à voir ce qu’elle nous donne à voir. Par conséquent, elle s’analyse, notamment dans la manière dont elle traduit le monde et interagit avec le sujet-regardant (Alloa, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2006). En qualité de «traduction», son approche verbale est inévitable mais ne doit en aucun cas appauvrir l’expérience qu’elle représente. En effet, l’image ne dispose pas de caractéristiques alphabétiques, elle ne se décode donc pas; elle n’a pas d’équivalence verbale et ne pourra donc jamais être totalement restituée par la langue.
L’image à laquelle nous nous intéressons est une image particulière puisque dans un récit iconotextuel, l’image n’est image que dans le contexte narratif dans lequel elle s’inscrit. Elle n’a aucune existence propre – le texte non plus d’ailleurs – et, si elle peut et doit être prise en charge vu le rôle qu’elle joue dans la construction de sens, elle demeure inséparable du texte. Si les disciplines des arts visuels et des sciences de la communication nous fournissent une partie des outils pour aborder l’image, ces derniers ne sont pas suffisants ici puisqu’en arts visuels comme en histoire de l’art, l’image constitue une fin en soi, en création comme en réception. La discipline s’attache à la signification DE l’image et non la signification PAR l’image. Dans l’objet littéraire considéré ici, l’image est au service d’une narration, participe de la matérialité du récit et est donc médiatrice du message. Si la part verbale du récit est prise en charge par la didactique du français, la part iconique trouve difficilement sa place dans le cloisonnement disciplinaire de l’enseignement. La prise en charge didactique et pédagogique des images en contexte narratif fait ainsi défaut dans les pratiques actuelles, avec les conséquences que pointent Leclaire-Halté (2008), Lépine (2012), Lacelle et al. (2017), Lebreton Reinhard & Aubert (2022): l’approche par la langue écrite uniquement est inadaptée aux caractéristiques de l’album.
La prise en charge de l’image se limite au rapport qu’elle entretient avec le texte selon la typologie établie par Van der Linden (2006), dans des tâches qui ne permettent pas de considérer comment l’image signifie ce qu’elle signifie. Cette prise en charge demeure donc verbocentrée. Van der Linden (2008) elle-même, dont l’approche n’a pas une vocation directement didactique, montre les limites de sa typologie en analysant la variabilité des relations qu’entretiennent le texte et les images dans les supports littéraires iconotextuels au regard du rôle complexe que jouent les images.
Par conséquent, comment dépasser la monstration des images par l’enseignant·e pour travailler le récit iconotextuel dans toute sa complexité? Quels outils mobiliser pour accompagner le processus d’interprétation propre aux albums? Que travailler dans les albums dès lors qu’ils convoquent autant de prérequis iconiques, culturels, langagiers, accordent une telle confiance au sujet-lecteur et laissent une telle liberté interprétative?
C’est à ces questions que le matériel présenté dans la partie suivante a cherché à répondre.
Méthodologie
Dans le but de proposer une prise en charge didactique des objets littéraires iconotextuels qui permette de respecter leurs caractéristiques et d’utiliser leur potentiel pédagogique, une communauté de pratiques a été créée pour concevoir du matériel d’accompagnement de livres mis à disposition en série dans les médiathèques des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel en Suisse. Cette communauté de pratiques réunit des enseignant·es, des chargé·es de missions du service de l’enseignement du canton de Neuchâtel pour la scolarité obligatoire (cycles 1, 2, 3) et les autrices en qualité de chercheuse et didacticienne du français. Pour chaque livre, le matériel d’accompagnement est conçu collectivement et testé par les enseignant·es des cycles concernés, modifié au besoin, puis publié aux éditions de la HEP-BEJUNE dans une collection intitulée «Lecture-philo».
Dans un objet littéraire iconotextuel, la tension dynamique générée par la coprésence de deux registres sémiotiques induit une forte implication personnelle du sujet-lecteur en raison de la production de sens qui lui incombe. L’enseignement doit ainsi permettre d’utiliser le support pour ses caractéristiques narratives en développant tout d’abord la compréhension puis l’interprétation iconotextuelle. Notons qu’un support littéraire comme l’album appelle davantage d’interprétation qu’un support fonctionnel qui en raison de sa visée utilitaire doit être compris le plus directement possible (Simard, Dufays, Dolz & Garcia-Debanc, 2010: 232).
Cette implication du soi, du rôle des représentations et des références personnelles permet en outre le développement de compétences du sujet-lecteur en formation générale. Une telle perspective confère ainsi à la démarche pédagogique une visée largement transversale.
Une première thématique, très ancrée dans l’actualité scolaire et constituant ainsi une problématique à la fois individuelle et collective, a fait l’objet des deux premières années de travail collaboratif: «le harcèlement». Pour couvrir les trois cycles de la scolarité obligatoire (1, 2, 3), trois albums ont été choisis:
-«Rouge»1 est le récit d’un enfant qui, sur la base d’une remarque anodine, se retrouve stigmatisé et harcelé pour sa timidité rendue visible par ses joues continuellement rouges;
-«Un renard dans mon école»2 est le récit d’un élève qui voit l’arrivée d’un camarade dans son école. Ce camarade le harcèle et, à mesure que ses intimidations se développent en nombre et en type, prend la forme d’un renard puis d’un loup puis d’un tigre;
-«Corrida»3 est le récit d’une situation de harcèlement visible uniquement dans les images et coconstruit par un texte vantant la manière de faire une corrida.
Ces trois albums sont des récits coconstruits par le texte et les images. Pour en permettre une exploitation pédagogique, chaque matériel propose un ensemble de cinq séances. Quatre d’entre elles sont dévolues à la compréhension et l’interprétation de l’album et la cinquième est systématiquement consacrée à la tenue d’une discussion à visée philosophique sur la thématique du harcèlement.
Pour enseigner la compréhension et l’interprétation, les activités ciblent le texte, les images et leur combinaison iconotextuelle. L’enseignement se fait de manière explicite. Chaque séance débute par la présentation de l’objectif aux élèves et un rappel des stratégies de compréhension à mobiliser (CIIP, 2023). La séance se termine par un temps de rétroaction, au cours duquel l’enseignant·e reprend oralement le déroulement des tâches, puis institutionnalise les savoirs. Pour la discussion à visée philosophique, les élèves apprennent à formuler un avis critique, à se décentrer et à développer leur compréhension du monde et de l’altérité. En supplément des objectifs disciplinaires du Plan d’Études Romand ancrés en français dans les axes thématiques Compréhension de l’écrit et Accès à la littérature, le matériel permet de travailler la compréhension et l’interprétation de l’image en contexte littéraire.
Selon l’approche multimodale, nous proposons d’utiliser les outils développés par Kress et Van Leeuwen (2006) sur l’image en contexte plurisémiotique. Leurs travaux empiriques étayent la signification par l’image et les données produites montrent que toutes les composantes de l’image jouent un rôle sur le sens à construire: les formes dominantes, les lignes de force, la circulation du regard, les personnages, les actions et les réactions, les couleurs, la lumière, la profondeur, l’énonciation visuelle, l’interaction avec le spectateur, le cadrage, la profondeur, l’iconicité, la mise en scène, le champ et le hors-champ, les références culturelles et visuelles, etc.
Le travail du texte propose, lui, d’utiliser les outils fondamentaux sur le genre textuel dans la mesure où «comme outil d’enseignement, le genre fixe des significations sociales complexes» (Dolz & Gagnon, 2008). Dans un album ou sur tout autre support, un texte possède des caractéristiques qui sont identiques à celles d’autres textes qui ont été rédigés selon les mêmes dimensions: visée, situation de communication, principes communicatifs, réalisation matérielle, contenu, structure et textualisation/langue. Dans la mesure où, comme tout objet de recherche, les débats sur le concept de genre restent ouverts, les outils mobilisés pour leur identification ont volontairement été sélectionnés dans une référence romande, les «modèles didactiques des genres textuels», qui servent actuellement de socle à une partie des nouveaux moyens d’enseignement du français (Conti et al., 2022).
La prise en charge didactique d’un support narratif iconotextuel
Si l’image est perçue très rapidement, à la différence du texte, cette apparente accessibilité immédiate dessert son caractère interprétable. Nous proposons donc, pour «ralentir» sa signification, d’étapiser son approche didactique en respectant la distinction essentielle entre les activités de compréhension et d’interprétation (Falardeau, 2003). La compréhension est l’étape qui suit le décodage du texte, réorganise les informations pour les rendre intelligibles. Ce travail débouche sur la capacité à reformuler ce qui a été saisi par les sens. L’interprétation quant à elle est la direction que le sujet décide de prendre et qu’il pourra justifier. C’est d’ailleurs dans cette aptitude à la justification qu’il faudra concentrer la tâche de l’enseignement puisque le sens de l’album est à construire par la coprésence de texte(s) et d’image(s) et ne peut donc jamais être entièrement validé. Si la tradition herméneutique a toujours placé l’interprétation comme postérieure à la compréhension car plus complexe, le processus est dynamique, de surcroit lorsqu’il s’agit de combiner texte et image, et le sujet-lecteur négocie et renégocie en permanence le sens donné aux différentes composantes du message lors de la remise en contexte à l’échelle du récit.
Le dispositif décrit ci-après travaille l’album Corrida, illustré et écrit par Yann Fastier.



Figure 2: extraits de l’album Corrida de Yann Fastier
L’album (Figure 2) présente une succession d’images relatant une situation de harcèlement mise en présence d’un texte vantant la manière d’organiser une corrida, pratique culturelle espagnole mettant en scène un homme et un taureau qui s’affrontent jusqu’à la mort de l’animal.
L’enjeu de compréhension principal de l’album Corrida provient du rapport discontinu (Lebreton Reinhard & Aubert, 2022) entre le texte et les illustrations. La dureté et la violence du message destine la séquence à des élèves de 9e année - cycle 34.
Séance 1: Les élèves sont tout d’abord amenés à découvrir le titre, par étapes, sans voir l’album. Tout le travail sur le champ lexical de la corrida mène ensuite à des activités permettant de définir le concept de corrida.
Séance 2: Suite à la consolidation du concept de corrida via des tâches textuelles, les élèves découvrent la première et la quatrième de couverture de l’album. Il leur est proposé d’observer et analyser la typographie du titre. À ce stade débute le travail sur les illustrations, processus dynamique structuré en 4 étapes: observer, décrire, analyser et interpréter. Cette prise de contact est menée par l’enseignant·e qui guide les élèves, par ses consignes: Observez attentivement la première et la quatrième de couverture et répondez à la question «Que peuvent ressentir ces deux personnages?». Pour vous aider à répondre, une liste d’émotions est proposée. Sélectionnez-en deux au minimum et reportez-les dans la colonne correspondante». Observez la façon dont le titre est écrit. Que pouvez-vous en dire?
Le document destiné à l’enseignant·e liste des réponses possibles afin de faciliter les régulations interactives lors des échanges: Écriture difficile à déchiffrer. Lettres pas ajourées. «Corrida» fait immédiatement penser à la tradition espagnole de la tauromachie qui est un sujet controversé et chargé d'émotions. Rien qui évoque l’Espagne, à part la couleur jaune. Le C et le A de «Corrida» font penser à des cornes (cornes du taureau). Violet qui reprend la couleur de la cape du torero.
À chaque étape du dispositif, les élèves sont en mesure de justifier leurs interprétations. Afin de permettre l’engagement de chacun·e dans des tâches concrètes, les élèves remplissent par exemple un tableau dans lequel, pour chacune des deux illustrations de 1re et 4e de couverture, ils et elles doivent associer des émotions aux personnages dans la 1re colonne et justifier leur choix en 2e colonne en listant les éléments des illustrations. L’enseignant·e dispose du tableau rempli (Figure 3) afin de faciliter le travail de régulation en cours d’action.
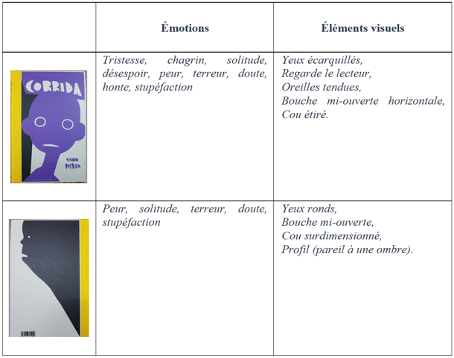
Figure 3: extrait du guide de l’enseignant·e
La suite consiste à émettre des hypothèses sur le possible contenu de l’histoire, par écrit, après que les stratégies de compréhension mobilisées depuis la 1re année ont été rappelées.
L’enseignant·e épingle les affiches du Moyen d’enseignement romand (MER) comme références pour la suite (Figure 4).
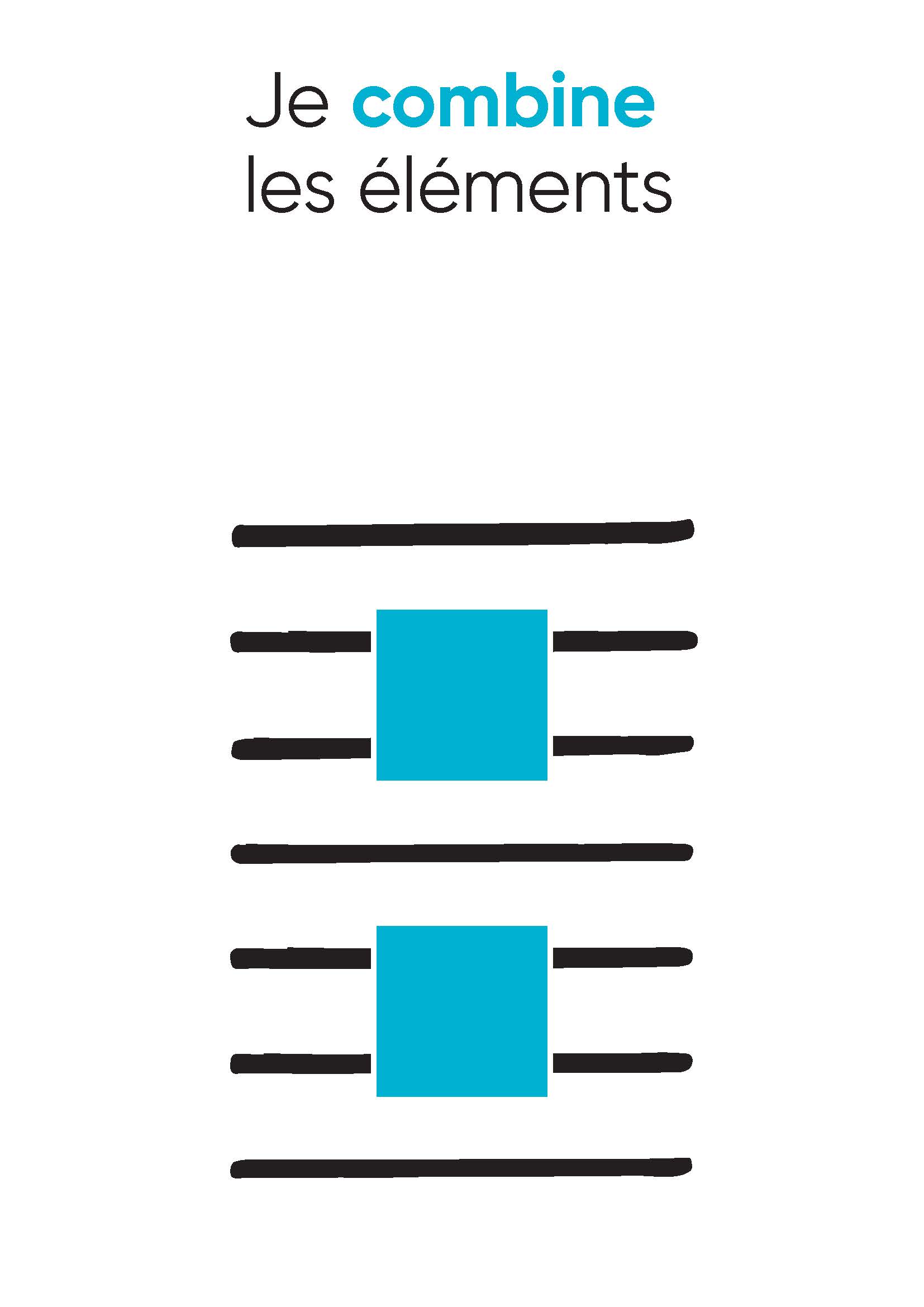


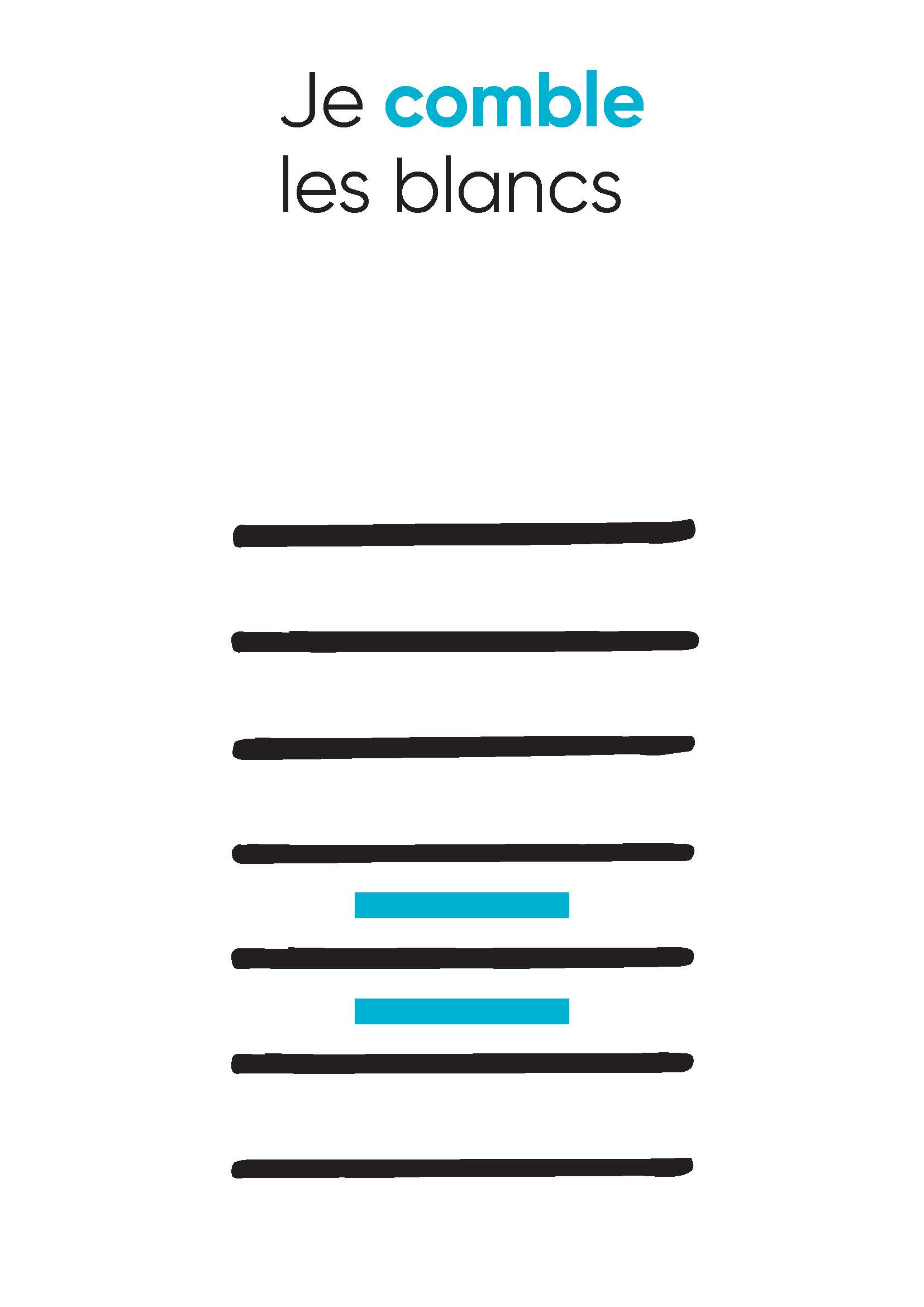

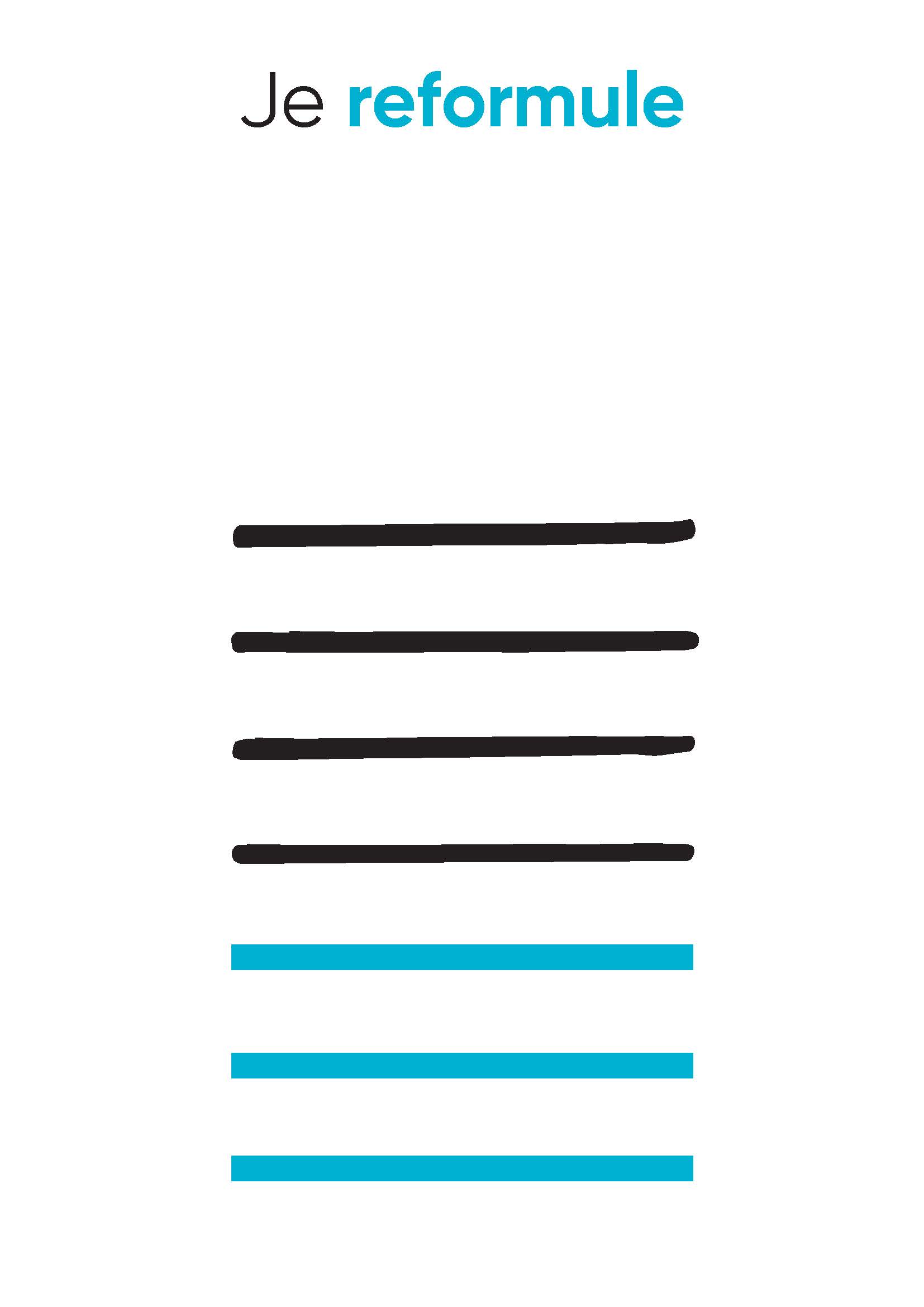
Figure 4: extrait des affiches des stratégies de compréhension du MER
Chaque séance se clôt par des rétroactions sur les procédures des élèves et le recours aux stratégies. Pour cette séance 2, l’enseignant·e est guidé vers des exemples de rétroactions:
- Lors de cette séance, vous avez observé attentivement tous les éléments présents sur la première et quatrième de couverture afin de les combiner avec des termes qui peuvent leur être associés.
- Vous avez sélectionné certaines propositions, jugées pertinentes et en adéquation avec les éléments visuels et vous en avez en écarté d’autres.
- Etc.
Séance 3: les élèves vont découvrir l’album complet, en partant d’abord du texte qu’ils et elles reçoivent sur un document séparé. Il est précisé que les images vont leur être montrées ensuite. Pour décomposer le processus, les modalités textuelle et visuelle sont traitées séparément pour faciliter l’accès à l’analyse:
Pour faire une corrida, il faut une arène et des gens,
un matador et ses assistants,
et un taureau.
Les assistants excitent le taureau…
le fatiguent.
Le sang ne tarde pas à couler.
Pour le matador, c’est le moment d’entrer en scène.
C’est le moment pour lui de montrer son habileté, et son courage.
Parfois, l’animal parvient à se défendre…
Mais le plus souvent, tout finit par la mise à mort.
Le fait qu’un texte singulier présente des caractéristiques communes à d’autres textes produits dans des situations similaires permet son repérage comme exemplaire d’un genre (Dolz & Gagnon, 2008). À ce stade, en l’absence des illustrations, l’hypothèse la plus probable après cette première rencontre avec le texte mène à l’identification d’une sorte de guide pour réussir une corrida, un texte appartenant au regroupement des genres de textes dont la visée est de régler des comportements, «de dire comment faire».
Une comparaison du texte de Corrida est faite avec une recette de Pain maison pour guider la réflexion sur les différences de visées. Les élèves ont pour tâche d’essayer de reformuler les deux textes au moyen d’un résumé en commençant par: C’est l’histoire de…
Si le texte de Corrida peut se résumer ainsi: «C’est l’histoire d’une corrida qui implique un taureau ainsi qu’un matador et ses assistants qui vont mettre à mort l’animal pour faire spectacle», le texte de la recette Pain maison ne peut pas se résumer en commençant par C’est l’histoire de.
Chaque élève reçoit alors l’album et est invité·e à le lire d’une traite avant de participer à une discussion collective permettant de faire émerger le fait que le texte ne parle pas d’une réelle corrida. Les élèves réalisent que les premières activités vécues en classe sur le concept de corrida les ont mené·es sur une fausse piste.
Comme lors de la séance 2, un travail est mené sur les ressentis face aux illustrations seules puis face au message iconotextuel de l’album. Le processus d’analyse des images à travers les 4 étapes sera spécifiquement mis en œuvre dans la séance 4.
La rétroaction de cette séance permet à l’enseignant·e de formaliser avec ses élèves que le choix d’un genre textuel apparemment non narratif pour ce qui est bien une narration à l’échelle du récit iconotextuel est délibéré et vise à faire réagir les sujets-lecteurs:
- Vous avez constaté que le texte de Corrida peut être résumé en quelques phrases, alors qu’un texte qui règle les comportement (Pain maison) ne peut pas être résumé en raison de sa nécessité à transmettre des détails précis et des étapes spécifiques si on veut pouvoir confectionner le pain.
- Le genre est un choix de l’auteur. Habituellement, à lui seul, le genre fournit des informations qui guident le sujet lecteur en l’aidant à anticiper sur le contenu et le but du texte. Ici, l’auteur a volontairement fait ce choix «multigenre» pour nous mener sur une fausse piste et nous forcer à réagir.
L’interaction des images et du texte qui permet d’accéder au message est formalisée également:
- En plus du genre littéraire, vous avez constaté que les images jouent un rôle crucial dans la compréhension d’un album. Illustrations et texte font passer un message dans lequel l’auteur cherche à susciter des émotions chez son public.
- En associant les images et le texte, vous avez vécu une expérience de lecture plus immersive. Dans le cas présent, vous avez réalisé que le personnage qui joue le rôle du taureau représente en réalité une victime de harcèlement. En parcourant l’album en entier, vous avez ressenti des émotions plus ou moins fortes.
Séance 4: l’analyse des doubles-pages se fait de manière approfondie, dans le but de développer chez les élèves des outils pour observer et comprendre des illustrations de manière critique.
Pour saisir ce processus dynamique, nous proposons de travailler en quatre étapes successives avec les élèves. Les deux premières portent sur la compréhension et les deux suivantes sur l’interprétation. Si le respect de la temporalité du processus permet de décomposer l’analyse pour y ancrer connaissances et compétences chez les élèves, chaque étape peut requestionner la précédente puisque la tension générée par les deux registres sémiotiques décuple la (re)négociation du sens du récit. Le travail d’analyse s’appuie sur un processus d’objectivation visant l’identification, la formulation d’hypothèses, la sélection et la proposition de signification argumentable.
Étape 1: observer
La pratique, toute évidente et naturelle qu’elle parait, demande du temps. Il faut donc accorder aux élèves du temps pour observer l’image avec rigueur, comme le ferait un·e scientifique devant son microscope qui, grâce au seul regard, devient spécialiste de ce qu’il ou elle a vu. Car l’observation désigne l’action de porter consciemment attention à l’objet de l’observation dans le but d’accroitre sa connaissance. Aucun critère ni aucune consigne n’oriente cette étape qui doit rester la plus ouverte possible.
Étape 2: décrire
La description, seconde étape de la compréhension, est une traduction verbale de l’observation. Si elle constitue une réduction de l’observation puisque l’image ne peut avoir d’équivalence verbale stricte, elle permet de consigner dans le détail tous les choix faits par l’illustrateur. Pour ritualiser la pratique, les élèves peuvent être invité·es à faire l’inventaire de tout ce qu’ils et elles voient comme le ferait un·e détective qui ne sait pas encore ce qu’il ou elle cherche.
Sur la base de cet inventaire, les élèves mobilisent leurs connaissances pour qualifier objectivement chaque élément observé. Ici, l’enseignant·e accompagne la réflexion en proposant de décrire les formes, les lignes, les personnages, ceux qui agissent et ceux qui réagissent, les couleurs, la lumière, la profondeur, qui ou que regardent les personnages, le cadrage, la profondeur, les ressemblances et les différences avec des images connues et reconnues, la mise en scène, ce qui est visible et ce qui est supposé, etc.
Étape 3: analyser
C’est la première étape de l’interprétation. Elle s’appuie sur les deux opérations précédentes et vise à mettre en relation les éléments observés, inventoriés, qualifiés. Cette mise en relation suppose de sélectionner les composantes de l’image qui, prises ensemble, produisent du sens. C’est également l’étape à laquelle les connaissances référentielles sont mobilisées, notamment pour expliquer la mise en relation des éléments. La visée didactique principale de cette étape est d’ailleurs la justification par les élèves de ce qu’ils et elles avancent, justification qui permet de mobiliser les deux étapes précédentes et d’apporter les connaissances référentielles, de les actualiser si elles existent.
En fonction du degré de complexité des images ou de l’exercice de mise en relation, l’enseignant·e peut renverser l’approche en demandant aux élèves de modifier chacune des composantes identifiées de l’image pour vérifier si la signification proposée reste la même. Cette approche dialogique favorise le questionnement chez l’élève et développe sa conscience critique. Par exemple, sur la figure 2, si le personnage en noir était proportionnellement plus petit que l’autre personnage, la signification de la scène serait-elle la même? Si le personnage qui tient un couteau regardait le spectateur, la signification de la scène serait-elle la même?
Étape 4: interpréter
C’est l’étape de la recontextualisation dans le récit, de la formulation d’hypothèses et de la proposition de signification. L’interprétation est une création du sujet-lecteur qui va au-delà du support original. Toute proposition n’est valable que justifiée grâce à tout ce qui est connu sur la double-page concernée et dans l’ensemble du récit, grâce au texte ET aux images. Le mécanisme de l’inférence abductive est ici mobilisé puisqu’il s’agit pour les élèves de créer des hypothèses explicatives pour parvenir, par déduction, à une conclusion concordante dans la combinaison du texte et des images.
C’est également l’étape de (re)mobilisation du texte signifiant directement relié à l’image considérée mais également de toutes les informations narratives cumulées jusque-là.
L’analyse du texte offre le même potentiel sémantique d’exploration des significations. En mobilisant ses connaissances et en repérant les pensées des personnages, le sujet-lecteur peut lever les inférences liées à la fausse piste du genre textuel et la visée réelle de l’auteur. Le travail mené en amont sur le lexique spécifique et le concept de la corrida permet de mettre en relation ces connaissances nouvellement acquises et la voie sur laquelle la modalité textuelle veut nous emmener: on nous RACONTE quelque chose sur un ton neutre et coupé de la situation d’énonciation.
La confrontation de l’analyse de l’image avec le texte permet de qualifier le rapport qu’entretiennent certains éléments verbaux avec certains éléments iconiques. Cette relation n’étant pas applicable à l’ensemble d’un récit iconotextuel ou même d’une double-page, cette étape de comparaison des informations fournies par le texte à celles fournies par l’image permet de requestionner l’étape de l’analyse et les significations possibles de l’image comme du texte. Cette renégociation offre l’opportunité de questionner les hypothèses proposées pour chaque modalité et de travailler la justification puisque l’ensemble de l’analyse aura permis de décomposer l’image comme le texte en autant d’éléments pouvant fonder les propositions de signification.
Pour rendre concret notre propos, nous proposons de partager une partie du matériel d’analyse des images élaboré pour travailler l’album Corrida de Yann Fastier.
L’analyse de l’album Corrida, qui avait fait l’objet d’une publication (Lebreton Reinhard & Richard, 2020), a permis d’arrêter le choix de trois objets de savoirs pour leur rôle particulièrement significatif dans la construction et la progression du récit:
- - L’énonciation visuelle ou le rôle confié au sujet-lecteur par les images
- - La matérialité du récit ou le rôle joué par les formes, les couleurs et les matières de l’album
- - La topographie des doubles-pages ou la mise en scène visuelle du récit
Pour chacun, les quatre étapes font l’objet de pistes de travail avec les élèves dont nous restituons des extraits.
L’énonciation visuelle ou le rôle confié par les images au sujet-lecteur:
Exemple 1
Pour l’étape d’observation, c’est la première de couverture qui est choisie (Figure 2.1).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier la forme particulièrement schématique; le faible nombre de couleurs; l’absence de profondeur et la distance créée avec celui qui regarde; la position, la composition et l’expression du visage.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever le minimalisme de la composition; l’absence de relief; le visage rond aux traits enfantins et en deux dimensions; les yeux écarquillés, les oreilles tendues, la bouche mi-ouverte horizontale, le cou étiré; le cadrage serré, la proximité avec le regard du sujet-lecteur; la peur et le danger qu’évoquent l’ensemble.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à se sentir regardés en tant que sujet-lecteur, à se questionner sur le rôle attendu du sujet-lecteur interpellé par le personnage dont tous les sens (ouïe, vue) sont en alerte.
Exemple 2
Pour l’étape de l’observation, c’est la double-page 1-2 qui est choisie (Figure 2.2).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier la position des personnages; la diversité de genres, de physique et les critères d’identification; les regards, les bouches, les oreilles, les expressions; les plans et la profondeur; les vides et les pleins.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever le minimalisme de la composition; les visages ronds aux traits enfantins et en deux dimensions; les filles aux cheveux longs et les garçons aux cheveux courts; la couleur noire de l’ombre, du taureau, symbole de la mort et du deuil; la couleur violette, froide, symbole du deuil atténué après le noir; les yeux ronds, tous ouverts, unidirectionnels; les bouches fermées ou tristes; les oreilles ouvertes et actives sauf une paire fermée par une croix; les expressions de voyeurisme, d’inquiétude, de colère ou d’hébétude.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à se sentir regardé·es par des individus interpellés, passifs, fâchés, sidérés; interrogé·es par les personnages qui attendent quelque chose des sujets-lecteurs.
La matérialité du récit ou le rôle joué par les formes, les couleurs et les matières de l’album
Exemple 3
Pour l’étape de l’observation, c’est la première de couverture qui est choisie (Figure 2.1).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier les couleurs, les matières, les textures, les traits et la technique.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever la présence de seulement deux couleurs avec le noir; l’absence de nuances, les aplats, les couleurs mates sans lumière; la couleur jaune, couleur maudite de la corrida car renvoyant aux morts et à la trahison; la couleur noire issue de la 4e de couverture qui renvoie au taureau tout en étant la couleur du deuil et de la mort; aux matières brutes (carton, toile) qui composent normalement la structure de la couverture; aux surfaces rugueuses (carton) et râpeuses (toile de la reliure); aux formes sommaires, découpées avec un outil tranchant.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à prendre position sur l’esthétique peu habituelle, en dehors du «beau» pour un livre dont le but ne semble ni de plaire ni de donner du plaisir; l’efficacité et les émotions provoquées par les images très minimalistes; la manière dont elles traduisent la violence et la barbarie du récit et le malaise lié au rôle attribué au sujet-lecteur.
Exemple 4
Pour l’étape de l’observation, c’est le «taureau» qui est choisi (Figure 2.3).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier les couleurs, les formes, le trait et la technique utilisée.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever le noir, couleur du taureau de la corrida mais aussi du deuil, de l’ombre, de la nuit; la rondeur et l’effet-masse en raison de l’aplat et de l’absence de nuance et de relief; le corps surdimensionné et les membres très courts comme le sont ceux du taureau-animal; la position jamais naturelle au fil des pages (sur un pied, à quatre pattes, à terre, etc.); la tête ronde, le visage neutre ou hébété; les formes découpées plus soignées et moins anguleuses en comparaison avec les autres personnages.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à prendre position sur la stigmatisation signifiée par la différence du personnage en regard de sa morphologie; la douceur des traits renforçant l’innocence du personnage; l’absence d’animosité dans l’expression faciale traduisant son statut de victime; l’expression d’incompréhension du personnage.
La topographie des doubles-pages ou la mise en scène visuelle du récit
Exemple 5
Pour l’étape de l’observation, c’est «l’arène» sur la double-page 1-2 qui est choisie (Figure 2.2).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à qualifier l’occupation de la double-page; la place de la reliure; la forme ronde; le rapport intérieur / extérieur; les personnages, leurs couleurs, leurs positions, les distances, les rôles.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à relever la rare apparition de l’arène sur seulement deux doubles-pages; sa position au centre ou sur la «belle» page (page de droite); sa figuration partielle traduisant une taille plus grande en réalité (hors-champ); la composition de l’arène avec la piste centrale, le couloir périphérique, le premier rang pour les journalistes et les photographes; le cadrage serré des personnages, noirs et violets, mi-cachés, mi-visibles, à l’intérieur et à l’extérieur.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à prendre position sur l’assimilation potentielle de tous les personnages à des taureaux en raison de leur couleur noire; l’assimilation potentielle de tous les personnages à des matadors en raison de leur couleur violette; l’assimilation de tous les personnages, y compris le lecteur, à des témoins privilégiés d’un spectacle de divertissement.
Exemple 6
Pour l’étape de l’observation, c’est la place du sujet-lecteur/spectateur qui est choisie (Figures 2.2, 2.3).
Pour l’étape de la description, il est proposé à l’enseignant·e d’amener les élèves à consigner les directions des regards des personnages et le cadrage des personnages.
Pour l’étape de l’analyse, il est suggéré à l’enseignant·e d’accompagner les élèves à formaliser la présence du sujet-lecteur dans tous les regards de face; le rôle de témoin extérieur·e quand le sujet-lecteur n’est pas regardé; la proximité avec les spectateur·rices quand le cadrage est serré; l’éloignement du matador, de ses assistants, du taureau quand le cadrage est large.
Pour l’étape de l’interprétation, les élèves sont invité·es à se questionner sur leur rôle de taureau lorsque le sujet-lecteur est regardé par les spectateur·rices; leur rôle de témoin lorsque le sujet-lecteur est regardé par le taureau; leur rôle complice lorsque le sujet-lecteur est regardé par l’assistant et le matador; la manière dont ils et elles sont otages de la scène de harcèlement.
Conclusion
Ces quelques extraits du matériel pédagogique créé pour enseigner avec les images en contexte iconotextuel montrent que ce travail dans les albums peut non seulement dépasser leur simple monstration mais permet de saisir l’ensemble de l’expérience qu’offre l’album en raison de la part d’interprétation qu’il laisse au sujet-lecteur.
Ce matériel, testé et validé par les enseignant·es, a suscité l’intérêt des élèves, les étapes d’analyse des illustrations constituant un complément indispensable dans des démarches jusqu’alors focalisées sur l’analyse de texte. Or, si les éléments travaillés dans le texte de Corrida ne peuvent pas être tirés des images, les éléments travaillés dans les images de Corrida ne constituent pas davantage des éléments qui peuvent être tirés du texte. Ainsi, pour que l’interprétation émerge de la combinaison des images et du texte, l’indispensable recontextualisation à l’échelle du récit doit mobiliser pour chaque modalité ses propres outils d’analyse, intrinsèquement différents et spécifiques.
L’album Corrida constitue un exemple particulièrement signifiant du point de vue du rapport de discontinuité entre le texte et les images dans un support qualifiable d’iconotexte au sens de Nerlich (1990). L’iconotexte n’est pas un support composé de texte(s) et d’image(s) mais coconstruit par les deux registres sémiotiques qui sont indissociables et perpétuellement en tension du point de vue de la réception. La puissance de la discontinuité de cet album montre violemment le rôle et donc le pouvoir réciproque des images sur le texte. Dans le domaine disciplinaire du français mais également dans toutes les autres disciplines, la manière dont les images signifient est à travailler pour elle-même, ce que la présente contribution visait à montrer.
Évoluant dans un monde rempli d’images, les élèves manquent encore d’outils pour comprendre l’iconique. C’est pourquoi des dispositifs didactiques permettant d’enseigner avec les images développent chez les élèves des compétences littéraciques et une réflexivité allant au-delà de l’enseignement-apprentissage de la littérature. Le développement de la capacité d’observation et d’analyse des images élargit en effet la compréhension par rapport à une approche uniquement verbocentrée, en offrant au sujet-lecteur tous les outils nécessaires pour justifier, agir et se transformer, afin de pouvoir à son tour transformer le monde qui l’entoure.
Bibliographie
Alloa, Emmanuel,(2010), Penser l'image, Paris, Les Presses du réel.
Bordron, Jean-François (2011). L'iconicité et ses images: études sémiotiques, Paris, Presses Universitaires de France.
CIIP, (2023), Moyen d’enseignement de français, Stratégies de compréhension, https://portail.ciip.ch/mer/teaching-mediums/33/french56/track-step-activities/335
Conti, Virginie, De Pietro, Jean-François., Roduit, Philippe.& Sánchez Abci, Véronica. (2022). Modèles didactiques des genres textuels. IRDP. https://www.irdp.ch/institut/modeles-3731.html
Dolz, Joaquim & Gagnon, Roxane, (2008), «Le genre du texte, un outil didactique pour développer le langage oral et écrit», Pratiques [En ligne], p. 137-138.
Falardeau, Éric (2003), «Compréhension et interprétation: deux composantes complémentaires de la lecture littéraire», Revue des sciences de l'éducation, 29(3), p. 673-694.
Gibson, James J. (1950), The perception of Visual World, Boston, Houghton Mifflin.
Haupt, Corinna & Huber, Andrea B. (2008), «How axons see their way–axonal guidance in the visual system», Front Biosci, 13 (13), p. 3136-3149.
Hétier, Renaud, (2015), «Un tournant dans les albums de littérature de jeunesse: de l’enfant acteur à l’enfant auteur», Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, n° 38.
Jewitt, Carl (2011), The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, London, Routledge/Taylor & Francis Group.
Klinkenberg, Jean-Marie (2020), «Pour une grammaire générale de la relation texte-image», Pratiques, n° 185-186.
Kress, Gunther (2010), Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, London, Taylor & Francis.
Kress, Gunther, & Van Leeuwen, Theo (2006), Reading Images: The Grammar of Visual Design, London, Routledge.
Lacelle, Nathalie, Boutin, Jean-François, & Lebrun, Marlène (2017), La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, Montréal, Presses universitaires du Québec.
Lebreton-Reinhard, Maud, & Richard, Suzanne (2020), «Corrida ou le pouvoir des images», VoieLivres.ch
Lebreton Reinhard, Maud & Aubert, Florence (2022), «Faire évoluer les axes Accès à la littérature et Compréhension de l’écrit du Plan d’Études Romand en didactique du français: perspective sémiologique et approche multimodale», Atti del 5° Convegno sulle didattiche disciplinari, Locarno, p. 391-395.
Lebreton Reinhard, Maud & Attanasio, Rachel (2022), «La narration iconotextuelle au service de l’activité de création. Dispositif didactique et approche anthroposémiotique pour rendre l’élève cré-acteur·rice de ses apprentissages: recherche exploratoire menée au cycle 1 dans le canton de Vaud en Suisse», Revue internationale du CRIRES, 6 (3), p. 23-45.
Lebreton Reinhard, Maud & Azaoui, Brahim (à paraître), «Deux signes impensés de la lecture partagée en classe: le corps et l’image», In Actes du colloque Sémiotiques de terrain, Appiotti, S., Saemmer, A., Trehondart, N. (dir.), Namur, Editions Academia, coll. «Extensions sémiotiques».
Lebreton Reinhard, Maud & Kohler, Alaric (2023), «Place et enjeux de la sémiologie dans la formation et l’enseignement», Revue de Littératie Médiatique Multimodale, R2LMM 17, en ligne.
Leclaire-Halté, Anne (2008), «L’album de littérature de jeunesse: quelle description pour quel usage scolaire?», In Congrès Mondial de Linguistique Française, Les Ulis, EDP Sciences.
Lefebvre, Martin (2011), «Des images et des signes. À propos de la relation indexicale et de son interprétation», Recherches sémiotiques, 28 (3), p. 109-124.
Lépine, Martin (2012), «Étude théorique des relations texte-images dans l’album pour adolescents», Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 15/2, p. 97-118.
Michel, Johann (2017), Homo Interpretans, Paris, Hermann.
Mitchell, William T. (2013), Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, University of Chicago Press.
Montandon, A. (dir.) (1990). Iconotextes, Paris. Ophrys.
Nerlich, Michael (1990). «Qu’est-ce qu’un iconotexte? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La Femme se découvre d’Évelyne Sinassamy» In Iconotextes, Paris, Orphys.
Peirce, Charles S. (1997), Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking: The 1903 Harvard Lectures on Pragmatism, New York, Suny Press.
Rabatel, Alain (2022), «Des relations entre texte et image et, au-delà, entre linguistique et sémiotique», Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, n° 52, p. 153-167.
Simard Claude, Dufays Jean-Louis, Dolz Joachim & Garcia-Debanc Claudine (dir.) (2010), Didactique du français langue première, Bruxelles, De Boeck.
Tauveron, Catherine, (1999), «Comprendre et interpréter le littéraire à l'école: du texte réticent au texte proliférant», Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle, 19 (1), p. 9-38.
Tauveron, Catherine, (2000), Littérature de jeunesse ou nouvelle jeunesse pour la littérature et son enseignement? (En ligne).
Tauveron, Catherine, (2002), Lire la littérature à l’école. Pourquoi et comment construire cet apprentissage spécifique?, Paris, Hatier.
Van der Linden, Sophie, (2006), Lire l'album, Le Puy-en-Velay, Atelier du poisson soluble.
Van der Linden, Sophie, (2008), «L’album, le texte et l’image», Le français aujourd'hui, n° 2, p. 51-58.
Voir également :
Représenter sa réception d’un texte littéraire en images avec Midjourney: analyse des attentes des élèves et des productions générées par l’intelligence artificielle générative
L’article se propose d’interroger les rapports entre textes et images d’un corpus de productions numériques générées par le programme d’intelligence artificielle Midjourney.
Représenter sa réception d’un texte littéraire en images avec Midjourney: analyse des attentes des élèves et des productions générées par l’intelligence artificielle générative
lntroduction
L’avènement rapide des intelligences artificielles dans divers domaines de la société, de la culture et de l’art a profondément bouleversé les milieux culturels et éducatifs, en renouvelant des questions concernant, entre autres, la portée créative et l’esthétique des productions générées par les machines (Ganascia, 2017; Manovic, 2018), leur originalité et auctorialité (Bensamoun, 2020), leurs configurations sociotechniques (Velkovska et Relieu, 2021) et leurs démarches herméneutiques (Roberge et Lebrun, 2023). Dans les milieux éducatifs, sont soulevés, en plus d’enjeux éthiques et critiques (voir, entre autres, Collin et Marceau, 2021), des questionnements didactiques, liés, d’une part, aux compétences littéraciques et médiatiques nécessaires pour analyser des messages générés par le biais d’interactions humain-machine, d’autre part, à la manière dont les savoirs littéraires sont acquis, mobilisés ou réinvestis en travaillant avec les machines.
Inscrite dans une réflexion concernant la formation du sujet-lecteur/scripteur numérique et dans une démarche exploratoire d’analyse des productions générées par les intelligences artificielles, notre contribution se propose d’interroger un corpus de productions numériques générées dans une classe québécoise de 3e année de secondaire dans le cadre d’une activité de production et réception littéraires réalisée avec Midjourney, un programme d’intelligence artificielle générative (Gozalo-Brizuela et Garrido-Merchán 2023) qui permet de créer des images à partir de commandes textuelles. Dans un premier temps, nous examinerons les attentes que les élèves expriment par rapport à la capacité de l’intelligence artificielle à traduire en images des textes, en l’occurrence issus d’œuvres littéraires, pour ensuite observer l’analyse qu’iels feront des images tant par rapport au texte de départ qu’à leurs attentes initiales. Dans un deuxième temps, en nous intéressant aux images produites par Midjourney, nous chercherons à déterminer quelles formes de collaboration, de redondance ou de disjonction iconotextuelles (Van der Linden 2006; 2008; Nikolajeva et Scott 2006) semblent mises en œuvre dans le traitement de l’extrait sous forme d’images proposées par le logiciel d’intelligence artificielle générative.
1. Repères théoriques
1.1. Les intelligences artificielles génératives et leurs commandes
De plus en plus utilisées dans différents domaines, allant de la traduction au marketing, de l’art numérique à la médecine, les intelligences artificielles génératives se caractérisent par l’exploitation de modèles linguistiques et d’apprentissage automatique qui permettent de produire de nouveaux contenus à partir de ressources médiatiques existantes, comme des textes, des éléments graphiques, des contenus audios ou vidéos (Jovanović et Campbell 2022). En fonction des technologies et des logiciels, les intelligences artificielles génératives parviennent, par exemple, à générer des textes à partir d’autres textes, comme le fait ChatGPT, mais également à partir de vidéos (voir, par exemple, Phenaki), de contenus sonores (voir, par exemple, Jukebox) ou même de formules scientifiques (voir, par exemple, Galactica). D’autres intelligences artificielles génératives, en revanche, utilisent des données textuelles pour créer des images bidimensionnelles, à l’instar de Midjourney ou de Dall·e, ou tridimensionnelles (voir, par exemple, les productions possibles avec Dreamfusion). Ces données textuelles, dites prompts, sont à considérer comme de véritables instructions, en langage naturel, visant à enclencher une analyse de la part de l’intelligence artificielle et à orienter le rendu final (Lou, Zhang et Yin 2023)1.
Selon différentes analyses portant sur l’ingénierie des prompts, pour que l’intelligence artificielle puisse se servir de sa capacité d’analyse linguistique et d’autoapprentissage, remplissant ainsi la tâche demandée par l’utilisateur·rice, ces indications textuelles doivent avoir un certain nombre de caractéristiques: par exemple, être cohérentes tout au long du processus de négociation avec l’intelligence artificielle, suffisamment diversifiées pour provoquer des variations et clairement orientées vers une forme d’apprentissage de la machine (Lou, Zhang et Yin 2023). En ce qui concerne la génération d’images à partir de textes, à laquelle nous nous intéressons plus particulièrement dans le cadre de cette contribution, d’autres paramètres nécessitent d’être pris en compte. En s’appuyant sur différentes expériences, Liu et Chilton (2022) ont notamment constaté qu’une interaction réussie avec l’intelligence artificielle, c’est-à-dire menant à un résultat en accord avec les instructions fournies, implique, entre autres, l’utilisation de mots-clés identifiant le thème de l’image et le style artistique souhaités, la génération de plusieurs images d’essai et la sélection de thèmes dont le niveau d’abstraction s’arrime à celui du style choisi. Oppenlaender (2023) a, de son côté, élaboré une typologie de modificateurs de commandes susceptibles de faire varier le résultat et d’être exploités dans une visée artistique. Le premier type de modificateurs concerne l’identification d’un ou plusieurs sujets de l’image, qui permettent d’indiquer à l’intelligence artificielle le ou les objets souhaités: si la définition de ces éléments «est essentielle pour contrôler le processus de génération de l’image» (Oppenlaender 2023, notre traduction), elle n’est pas une condition nécessaire pour enclencher le processus et certains auteur·rice·s peuvent donner aux intelligences artificielles des instructions portant uniquement sur le style. Le deuxième type concerne justement le style et donc l’identification de courants, périodes et écoles artistiques, ou bien d’artistes, matériaux, techniques ou supports sur lesquels l’utilisateur·rice souhaite voir représentée l’image générée par l’intelligence artificielle. Le troisième implique le réinvestissement d’une ou plusieurs images d’essai en guise de nouvelles commandes: dans ce cas, l’intelligence artificielle est censée profiter de ses capacités d’autoapprentissage et élaborer des variations sur le thème de ses premières propositions, en reconfigurant ou enrichissant l’image initialement générée. Le quatrième modificateur concerne l’utilisation d’«amplificateurs de qualité», que l’utilisateur·rice peut mobiliser pour «augmenter les qualités esthétiques et le niveau de détail des images» (Oppenlaender 2023, notre traduction): iel peut, par exemple, demander aux intelligences artificielles de produire une image «avec des couleurs sublimes» ou «digne d’un prix d’art contemporain» (Oppenlaender 2023, notre traduction), en laissant donc à la machine la possibilité d’exprimer une représentation algorithmique de la beauté ou de la légitimité artistique. Le cinquième concerne la répétition de termes qui permettent de renforcer les associations sémantiques que l’intelligence artificielle est en mesure d’établir. Enfin, le dernier type de modificateurs concerne l’introduction de termes dits «magiques», soit sémantiquement distants du sujet de la commande et se référant, par exemple, à des qualités non visuelles, comme le toucher ou l’ouïe (Oppenlaender 2023).
Ces différentes caractéristiques et variables des prompts susceptibles de conditionner l’interaction avec les intelligences artificielles, ainsi que leurs productions, ont déjà mené à interroger la portée artistique de l’écriture des commandes («Is writing prompts really making art?», se demandent McCormack et collègues) et les compétences nécessaires pour les rédiger (Korzynski et al. 2023). D’autres questions ont ciblé plus largement les capacités artistiques et créatives des intelligences artificielles génératives ainsi que la nature des productions générées. Décrites tantôt comme des «machines à plagiat» (Chomsky, Roberts et Watumull 2023), tantôt comme des technologies porteuses d’une «créativité artificielle» (Gefen 2023), les intelligences artificielles génératives créent des contenus dont le statut et la genèse demeurent partiellement opaques. À cet égard, que se passe-t-il lorsque le prompt est une citation littéraire? Comment, plus particulièrement, se comporte une intelligence artificielle générative comme Midjourney, qui crée des images à partir de textes, lorsque la commande ne mentionne pas des objets ou des styles artistiques ou encore lorsqu’elle comporte des énoncés métaphoriques ou un langage symbolique? Comment analyse-t-elle l’extrait? Cherche-t-elle à le situer par rapport au cotexte ou, plus largement, par rapport à l’œuvre dont il est issu? Quelles formes de collaboration, de redondance ou de disjonction iconotextuelles (Van der Linden 2006; 2008; Nikolajeva et Scott 2006) peut-on constater? Sur quels indices sémantiques ou thématiques semble-t-elle fonder sa transposition iconique? Peut-on identifier, dans ses démarches de traitement et de reconfiguration des données textuelles, des choix, des parcours ou des reconfigurations algorithmiquement subjectifs?
1.2. Les intelligences artificielles et l’expression de la subjectivité lectorale
Si une intelligence artificielle générative comme Midjourney est appelée à interpréter des données textuelles, l’usager·e qui les a saisies se doit d’analyser à son tour les productions qu’elle génère à partir de ses instructions. Comment les reçoit-iel? Recherche-t-iel des échos des textes de départ ou bien considère-t-iel comme acceptables des transpositions très éloignées des univers, narratifs et stylistiques, des textes de départ? Négocie-t-iel avec le logiciel pour parvenir à des productions plus proches de ses images mentales? Répondre à ces questions et interroger la réception que les élèves font des propositions de Midjourney revient non seulement à examiner comment iels procèdent lorsqu’iels analysent conjointement des images et des textes, mais également à observer comment iels expriment leur subjectivité lectorale (Langlade 2006) dans l’interaction avec la machine. Nous supposons, en effet, que le cadre technologique offert par les intelligences artificielles génératives et le processus de négociation auquel elles invitent pourraient constituer un nouvel espace d’expression de la subjectivité lectorale, dont les manifestations seraient à la fois issues de ressources et processus cognitifs, épistémiques, socioculturels, psychoaffectifs propres à chaque individu, et de conditions matérielles, discursives et techniques propres aux environnements numériques génératifs, qui baliseraient et détermineraient les horizons de production et de réception. À cet égard, si les intelligences artificielles génératives conditionnent l’agir du sujet en fonction de leurs caractéristiques et propriétés algorithmiques, elles lui permettent également d’agir subjectivement, par exemple au moment de la sélection et de la saisie d’une information textuelle pour la machine, lors de l'analyse des résultats, ou encore lors de la réévaluation éventuelle des consignes à l’aune de ses réactions, intuitions, curiosités, désirs, intentions et attentes propres. Dans cette perspective, les logiciels d’intelligences artificielles génératives et les processus informatiques sur lesquels ils reposent ne se limiteraient pas à influencer les manifestations de subjectivité, mais ils les détermineraient, les opérations prédictives et performatives de traitement, moissonnage et analyse des données textuelles venant reconfigurer le regard que le lecteur porte sur le texte, voire conditionner — ou programmer informatiquement — sa manière de le lire, de le comprendre, de le penser. Le sujet-lecteur numérique (Robinson 2022; Andrejevic 2020; Kiepas 2020) s’exprimerait ainsi au sein et par le biais d’un inconscient algorithmique, qui «brouillerait, briserait et reformaterait» (Beller 2021: 50) les modes d’expression de sa subjectivité. Plus précisément, l’activité fictionnalisante du sujet-lecteur numérique (ses concrétisations imageantes, ses jugements axiologiques, ses activations fantasmatiques, ses perspectives de cohérence mimétique) (Langlade 2006) s’appuierait aussi bien sur une reconfiguration personnelle du texte que sur l’anticipation des potentialités créatives de l’intelligence artificielle générative.
2. Méthodologie
2.1. Design de la recherche
L’expérience ici analysée a été élaborée dans le cadre du projet de recherche-action Multinumeric (FRQSC 2020-2023), qui vise à soutenir le développement de la compétence numérique par la littératie médiatique multimodale chez des élèves du secondaire dans différentes disciplines scolaires (en français, en univers social et en art), par la cocréation, la mise en œuvre et l’analyse de pratiques pédagogiques faisant appel au numérique. Réalisée entre décembre 2022 et mai 2023, à l’issue d’une première année de travail sur la lecture littéraire numérique, la séquence conçue pour le volet du projet concernant l’enseignement du français a été élaborée par trois cochercheur·es de l’équipe et par une enseignante de français exerçant en 3e année d’école secondaire (14-15 ans) dans un collège privé montréalais2. Différentes rencontres de cocréation en format distanciel ont eu lieu, afin d’identifier la problématique de la séquence; d’arrimer les compétences numériques visées aux programmes d’enseignement en français; de choisir les logiciels et les outils pédagogiques qui auraient été utilisés (portfolio, journal de bord, carnet de lecture, questionnaires d’accompagnement de la lecture littéraire, etc.). Des échanges de courriels, des partages de documents (articles scientifiques et ressources théoriques sur la théorie de la lecture littéraire numérique; référentiels des compétences numériques, etc.) ont complété la démarche. Structurée autour d’une question bien précise, formulée par l’enseignante lors de la première rencontre de cocréation («Comment s’engager dans un monde dont le sens nous échappe?»), la séquence a comporté, dans un premier temps, la lecture et l’analyse d’un corpus de textes littéraires de genres variés sur les thèmes de l’engagement et du non-sens3, puis, dans un deuxième temps, la mise à l’essai de deux logiciels d’intelligence artificielle générative, ChatGPT et Midjourney, dans le cadre de différentes activités de réception et production littéraire.
2.2. Description de l'activité
Articulé en trois activités, le volet de la séquence didactique comportant l'utilisation du numérique se proposait d’impliquer les élèves dans une forme de «dialogue» avec des logiciels d’intelligence artificielle sur les thèmes de l’engagement et du non-sens. Pour la première activité, dont nous rendons compte dans le cadre de cet article, l’enseignante avait notamment prévu de travailler avec Midjourney dans une perspective interprétative et appréciative. Les élèves devaient sélectionner un extrait qu’iels avaient particulièrement aimé (issu du corpus de textes narratifs, théâtraux et poétiques analysés dans la première partie de la séquence) et justifier leur appréciation au vu de critères esthétiques et thématiques, ainsi que d’une définition personnelle de l’engagement et du non-sens. Iels devaient également formaliser leurs attentes visuelles vis-à-vis de Midjourney, en anticipant la capacité du logiciel à restituer une image de l’extrait plus ou moins conforme à son contenu, tel qu’iels l’avaient appréhendé et imaginé au moment de la lecture. Dans cette sélection, les élèves devaient notamment établir des «liens entre des éléments thématiques du texte et le fonctionnement de Midjourney» 4, en anticipant, par exemple, les types de requêtes possibles et le rendu graphique de l’image, puis générer quelques images et les analyser, dans l’optique d’en choisir une, qu’iels avaient ensuite à interpréter de manière plus approfondie, en la mettant en relation avec le texte de départ. Dans cette étape, iels devaient être en mesure de porter un regard esthétique et critique sur les productions Midjourney, tant par rapport à l’extrait qu’aux processus génératif et automatisé de création d’images proposé par l’intelligence artificielle. Conformément aux intentions de l’enseignante, cette activité présupposait ainsi une réflexion, analytique et subjective, sur le texte de départ, une interaction avec le logiciel d’intelligence artificielle générative, et un questionnement, analytique et sensible, de ses capacités à s’approprier les indications textuelles fournies et à les traduire en images. Ces différents aspects auraient ensuite fait l’objet d’une évaluation, l’enseignante se proposant d’interroger la capacité des élèves à choisir un extrait sur la base d’arguments subjectifs, liés, d’une part, au «retentissement artistique et thématique» de l’œuvre de départ sur soi, d’autre part, aux représentations des réponses possibles du logiciel et de sa capacité à restituer une image plus ou moins conforme à leurs attentes esthétiques et thématiques. Tous les travaux des élèves ainsi que les images produites par Midjourney devaient être consignés dans un portfolio numérique individuel, sur lequel nous baserons nos analyses et constats.
3. Présentation des données
Dans cette section, nous examinerons les attentes que les élèves expriment par rapport à la capacité de Midjourney à traduire en images l’extrait qu’iels ont sélectionné, pour ensuite nous intéresser à leur analyse des images produites par le logiciel d’intelligence artificielle tant par rapport au texte de départ qu’aux préfigurations initiales. Notre attention se portera plus spécifiquement sur cinq portfolios d’élèves, qui témoignent d’approches très contrastées en ce qui concerne aussi bien la formulation des attentes vis-à-vis de Midjourney et de sa capacité à restituer une image de l’extrait plus ou moins conforme à leurs représentations, que l’analyse des productions générées par le logiciel d’intelligence artificielle générative.
3.1. Analyse des portfolios: du texte littéraire à la production générative
3.1.1. Attentes de représentation de l’extrait
L’analyse des portfolios des élèves révèle tout d’abord que les attentes visuelles concernant les images que Midjourney sera en mesure de générer s’expriment au moins de trois manières différentes.
Une partie des élèves s’attache à décrire assez finement l’image attendue, en donnant des indications précises sur les caractéristiques des personnages, leurs attitudes, leurs traits physiques et états psychologiques:
En lisant ce passage5, j’avais en tête une image d’une jeune fille en habit simple avec le minimum de possession — une fille de bohème sur un train. Elle regarde dehors, on ne peut pas voir sa face ni son expression. Elle est détendue et semble à l’aise. On ne voit pas clairement ce qui se passe dehors, parce que le train part assez vite pour mettre tout l’extérieur en mouvement. Mais il y a beaucoup de couleurs dehors, même si on ne sait pas elles appartiennent à quoi6.
Extrait du portfolio de Parnika
Je m’attends à voir quelqu’un de visiblement déprimé et piteux (dû aux envies suicidaires) qui mange du chocolat et le tout très peu coloré à part peut-être le chocolat lui-même7.
Extrait du portfolio de Maxence
Comme le démontrent respectivement les propos de Maxence et de Parnika, ces indications peuvent s’appuyer soit sur la reprise d’éléments de l’extrait soit sur des interprétations subjectives des passage cités. Si les attentes du premier renvoient au texte sélectionné, dans lequel sont évoqués aussi bien le chocolat que des pensées suicidaires, celles de Parnika, qui mettent notamment l’accent sur l’image d’une jeune femme à l’air détendu, voyageant en train dans une direction indéterminée, font écho à son interprétation du passage et des états d’âme du personnage: «en le (= le passage) lisant, on ressent le contraste entre la mobilité et la tranquillité», écrit-elle, avant d’expliquer, en citant à deux reprises l’extrait, que le personnage est pris dans le «mouvement des choses», qu’il vit sereinement, car, d’une part, il semble apprécier ne pas être «statique» et, d’autre part, il sait que les changements sont inévitables:
En le (= le passage) lisant, on ressent le contraste entre la mobilité et la tranquillité. Suzanne s’est mise à la fois en dehors de ce mouvement puisqu’elle «[avale] tout des yeux tranquillement» comme si les mouvements ne la concernent pas, mais elle fait aussi partie de cette mobilité puisqu’elle est aussi en mouvement et aime le fait qu’elle n’est pas statique. De plus, c’est un peu fou de dire qu’on se sent à sa place quand il n’y a pas une place fixe pour nous de rester et qu’elle est dans le mouvement des choses. C’est lié à l’absurdité de la vie puisque tout est continuellement en train de changer, et on ne peut pas mettre pause sur le temps pour que les choses restent telles qu’elles sont. Je trouve que ce passage est aussi fortement lié au temps puisque le mouvement des choses autour de nous (et nous-mêmes) est comme le passage du temps; et comme quand le temps coule, on ne peut pas modifier la suite des choses puisqu’il n’y a pas de possibilité de le faire une fois qu’elles sont passées. (…) Mais ce passage montre aussi l’engagement dans ce monde dont on ne peut pas changer les choses. Suzanne est «installée» et se sent «à [sa] place» même si tout autour elle, les choses sont en train de se dérouler.
Extrait du portfolio de Parnika
En revanche, pour une autre partie des élèves, à l’instar de Saynoon, les attentes visuelles de transposition de l’extrait sont formulées de manière plus vague, en indiquant simplement qu’iels espèrent recevoir une image qui exprime l’atmosphère du récit ou les émotions des personnages:
En ce qui concerne mes attentes visuelles/esthétiques pour l’extrait choisi8 dans Midjourney, j’aimerais voir une représentation visuelle qui reflète la profondeur émotionnelle de la phrase. Je souhaite que l’image capturée transmette la tristesse et la détresse des personnes.
Extrait du portfolio de Saynoon
Enfin, quelques formulations des attentes vis-à-vis de Midjourney témoignent de la volonté de certain·es élèves de mettre à l’épreuve l’intelligence artificielle et de tester ses capacités de figuration des extraits. Les propos de Maxence semblent justement valoriser le potentiel créatif du logiciel, auquel il reconnait la faculté d’articuler des termes et des images appartenant à des champs éloignés. Dès lors, son choix de l’extrait, explique-t-il dans le portfolio, est justifié par le désir de voir une image qu’«un humain» pourrait difficilement élaborer, car elle présuppose l’articulation de «deux termes qui ont normalement un symbolisme presque opposé». Il s’en explique en insistant sur l’incongruité apparente de l’extrait textuel choisi, dans lequel le narrateur établit un lien de causalité entre le fait d’être dans un état de profonde détresse («Quand on a envie de crever») et celui d’éprouver un plaisir inédit d’une expérience banale («le chocolat a meilleur gout que d’habitude»).
3.1.2. Analyse de l’interprétation des images produites par Midjourney
L’interprétation et l’appréciation des images produites par Midjourney, livrées également dans les portfolios, permettent d’examiner la manière dont les élèves s’attachent à identifier des liens thématiques entre les images et les textes de départ, voire expriment leur jugement esthétique sur les productions de l’intelligence artificielle générative. Dans ce cas aussi, les travaux considérés témoignent de démarches très différentes, allant d’une lecture des productions de Midjourney apparemment décorrélée des extraits à une analyse plus attentive à l’identification des liens entre les images et les textes de départ.
Les analyses contenues dans les portfolios de Saynoon, de Maxence et d’Anderson sont représentatives d’une lecture centrée sur l’image générée par Midjourney qui fait abstraction de l’extrait textuel de départ. Saynoon, par exemple, analyse la transposition proposée par Midjourney d’une citation du roman de Romain Gary La vie devant soi («C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes») et pointe des éléments qui contribuent, à son avis, à restituer l’atmosphère du passage et l’état d’âme des personnages, qu’elle avait auparavant décrits comme empreints de «tristesse et de détresse». Dès lors, elle décrit les «couleurs chaudes» de l’image et sa «lumière tamisée», qui créent un environnement «doux», «introspectif», «invitant à la contemplation». Elle s’attache également à décrire les «ombres» sur le visage du personnage, qui «ajoutent une mélancolie à l’image», et ses yeux, qu’elle définit, de manière assez paradoxale, comme «légèrement embués, suggérant une tristesse contenue».
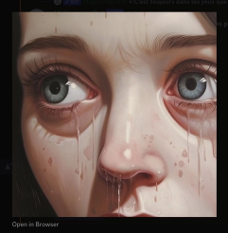
Figure 1. Image et analyse tirées du portfolio de Saynoon.
Extrait: «C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes» de La vie devant soi.
Après avoir exploré différentes options, j’ai choisi une image d’un visage aux yeux qui pleurent dans une lumière douce et tamisée. Les yeux du sujet sont légèrement embués, suggérant une tristesse contenue. Le visage est encadré par des ombres, ajoutant une dimension de mélancolie à l’image. J’ai opté pour cette image car elle capture la subtilité et l’intensité émotionnelle des yeux, tout en maintenant une certaine beauté esthétique. Les couleurs chaudes et la lumière tamisée créent une atmosphère douce et introspective, invitant à la contemplation.
L’élève, qui souhaitait retrouver, dans l’image de Midjourney, «la profondeur émotionnelle de la phrase» de Gary ainsi que «la tristesse et la détresse des personnes», semble désormais se concentrer uniquement sur l’image, dont elle justifie le choix en n’invoquant que des critères issus de son analyse de quelques éléments iconiques: «J’ai opté pour cette image car elle capture la subtilité et l’intensité émotionnelle des yeux, tout en maintenant une certaine beauté esthétique». Elle semble également faire abstraction de l’écart entre la représentation de la jeune fille en larmes proposée par le logiciel d’intelligence artificielle générative et celle de Monsieur Hamil, le vieux marchand de tapis, musulman pieux, auquel la citation fait référence. Dans son analyse, les différences entre les caractéristiques physiques des deux personnages ne sont pas discutées. La «tristesse contenue» du personnage n’est pas non plus analysée en tenant compte de celle du personnage dans l’extrait du roman. En effet, Monsieur Hamil, dans le passage en question, est chagriné par les questions que Momo lui pose à propos de ses parents, de son âge et de ses origines, car il n’est pas en mesure de lui répondre. En revanche, si les causes de cette tristesse teintée de gêne, d’affection, de pitié et d’empathie, ne sont pas discutées dans l’analyse de l’image, l’élève reconnait à la production de Midjourney la capacité à restituer la «profondeur émotionnelle» qu’elle avait attribuée à l’extrait.
De même, face à la production de Midjourney issue de la citation de Gary, «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude», Maxence se saisit de la représentation du personnage, des couleurs prédominantes et de l’organisation graphique des différents éléments pour analyser l’image à partir d’une interprétation sommaire de la citation. L’élève semble faire abstraction du contexte de l’extrait et ne revient pas sur l’association possible entre la condition du personnage de Momo, auquel renvoie la citation, et celui de la petite fille représentée dans l’image de Midjourney. L’analyse proposée par l’élève convoque, au contraire, des aspects qui ne font pas partie de l’imaginaire véhiculé par le texte de départ et qui semblent relever de préoccupations propres à l’élève, concernant la solitude, la dépression et l’aliénation du travail. Ainsi, la relative monochromie de l’image produite par l’intelligence artificielle est mise en relation avec la supposée dépression du personnage sur l’image, qui guetterait la mort; la présence d’une petite fille «encerclée de chocolat» et l’absence de voies d’issues («et il n’y a nulle part où elle peut sortir») sont comparées à l’enfermement d’une personne «dépressive ou déprimée (qui) pourrait se sentir emprisonnée par des mauvaises pensées et par la tristesse»; l’expression neutre de la petite fille, ni joyeuse ni vraiment triste, est justifiée par l’ambivalence de la scène, le personnage ayant envie de mourir, mais étant entouré d’un produit qu’il est censé considérer comme délicieux («la petite fille n’a pas l’air si déprimée, mais elle n’a pas l’air joyeuse non plus. Cela est probablement dû au fait qu’elle est supposée vouloir crever, mais qu’elle doit paraître aimer le chocolat»). Enfin, la tenue, l’air relativement serein et l’allure routinière avec laquelle la petite fille semble se charger de la décoration des chocolats évoquent pour l’élève l’absurdité de certaines tâches professionnelles, répétitives et aliénantes: «Alors on pourrait aussi dire qu’elle est enfermée dans la routine et la répétition ce qui revient à l’absurdité de la répétition dans le monde dans lequel on vit».

Figure 2. Image et analyse tirées du portfolio de Maxence.
Extrait: «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude» de La vie devant soi.
Premièrement, la petite fille n’a pas l’air si déprimée, mais elle n’a pas l’air joyeuse non plus. Cela est probablement dû au fait qu’elle est supposée vouloir crever, mais qu’elle doit paraître aimer le chocolat. De plus, l’image est monotone. Elle est principalement brune avec du chocolat, mais même la petite fille est habillée en brun. La diversité de couloir est souvent associée à la joie et à d’autres bonnes choses tandis que le contraire signifie souvent la déprime. Je pense que le fait que l’image soit monotone marche bien avec l’extrait car elle est supposée vouloir mourir. De plus, on peut observer que dans cette image, la fille est encerclée de chocolat et il n’y a nulle part où elle peut sortir. On pourrait dire qu’elle est enfermée et encerclée par le chocolat comme une personne dépressive ou déprimée pourrait se sentir emprisonnée par des mauvaises pensées et par la tristesse. Finalement, de la façon dont la fille est habillée et de la façon qu’elle présente le chocolat elle à une allure de travailleuse comme si elle était une caissière qui vend du chocolat. Elle à l’air habitué et tranquille comme si elle faisait ça chaque jour et que c’était rendu une routine. Alors on pourrait aussi dire qu’elle est enfermée dans la routine et la répétition ce qui revient à l’absurdité de la répétition dans le monde dans lequel on vit.
De manière similaire, l’image générée par Midjourney à partir d’une citation d’En attendant Godot, «Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable», amène Anderson à mettre en relation avec l’extrait des éléments visuels proposés par l’intelligence artificielle qui ne semblent pas renvoyer au texte de Beckett. À cet égard, l’élève juge «intéressants» deux éléments dont le lien avec la citation n’est pas explicité dans le portfolio. Le premier concerne la mise en scène d’un personnage amputé, le second la représentation, à son avis peu claire, du pied absent («l’intelligence artificielle ne nous montre pas clairement lequel de ses pieds n’est pas là»). Comme dans l’exemple précédent, l’élève se livre moins à une interprétation de relation texte-image qu’à une interprétation de l’image elle-même. Ainsi, plutôt que de se questionner sur la pertinence des éléments visuels introduits par Midjourney, sans liens apparents avec la citation du texte de Godot, Anderson semble plutôt chercher à comprendre, sans les discuter, les choix interprétatifs du logiciel: «l’intelligence artificielle a décidé que son pied coupable ne devrait juste pas exister». De même, si l’élève n’interroge pas, dans son analyse, le choix de l’intelligence artificielle générative de représenter, en premier plan, une chaussure disproportionnée par rapport à taille du personnage, il propose, en revanche, une interprétation de la couleur utilisée: «La couleur rouge peut dire beaucoup de choses comme comment le soulier est blâmé et coupable». En acceptant de facto la pertinence interprétative de la proposition iconique de Midjourney, non seulement l’élève affranchit cette dernière de l’épreuve de la confrontation au texte, mais, de plus, il justifie lui-même les choix interprétatifs du logiciel en leur conférant de la cohérence et du sens, même s’ils ne semblent pas fondés sur le contenu de la citation.

Figure 3. Image et analyse tirées du portfolio d’Anderson.
Extrait: «Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable» de En attendant Godot.
Dans cette photo le monsieur manque un pied, je trouve que c’est un détail très intéressant car l’intelligence artificielle a décidé que son pied coupable ne devrait juste pas exister. C’est aussi très intéressant comment l’intelligence artificielle ne nous montre pas clairement lequel de ses pieds n’est pas là. L’image nous présente un homme plutôt triste et malheureux, il manque son pied droit ou gauche (c’est pas très clair). Le soulier rouge peut être interprété en étant coupable, mais c’est vraiment le pied qui est coupable même si c’est le monsieur qui blâme son soulier. La couleur rouge peut dire beaucoup de choses comme comment le soulier est blâmé et coupable.
Si, dans ces exemples, le texte de départ parait entièrement ou partiellement occulté dans l’analyse des élèves, dans d’autres productions, la reconfiguration subjective des images et des textes de départ, dont témoignent les justifications, les descriptions et les interprétations des productions de Midjourney, est plus explicitement reconduite à l’extrait.
Ainsi, la description d’une image générée par Midjouney, auquel une autre élève (Parnika) a soumis une citation de La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette («Le paysage se déroule et s’éloigne, tu avales tout des yeux tranquillement. Tu sens que tu es à ta place, pour la première fois. Installée dans le mouvement des choses»), révèle que l’élève tente d’établir un lien avec le texte de départ. Parnika souligne la redondance entre des éléments de l’images et certains passages de la citation («la fille regarde calmement dehors»; «voit du champ sans fin qui passe en arrière d’elle») et renvoie à des moments ou des évènements précédents de l’histoire («cette scène nous rappelle aussi de quand Suzanne est venue à Montréal pour la première fois pour son concours d’art oratoire»). Parnika mobilise également des éléments issus aussi bien de son imaginaire et de sa compréhension/interprétation de l’œuvre. Elle fait, par exemple, référence au «soleil (qui est) en train de [se] coucher dehors» — et qu’on ne voit pas pour autant dans l’image —; elle interprète le regard du personnage comme étant orienté vers «l’horizon, vers un futur que personne ne peut prédire» et elle commente son voyage «vers l’inconnu», en affirmant, de manière solennelle, qu’«il n’y a pas de recul, pas de ralentissement». Interprété de manière métaphorique par l’élève, ce voyage du personnage, qui lui rappelle un passage précédent de l’histoire, au cours duquel Suzanne, lors de son premier séjour à Montréal, a découvert «la vraie signification de l’art libre», devient aussi l’occasion d’anticiper des évènements futurs. En effet, Parnika décrit cette nouvelle fuite du personnage comme celle qui lui permettra de «rester temporairement avant de partir de nouveau» et qui lui fera également «découvrir un nouveau milieu qui lui donnera l’inspiration pour créer de l’art». La description de l’image montre, enfin, que l’élève l’analyse au prisme des connaissances sur le genre littéraire et artistique (l’avant-garde automatiste) acquises durant le cours consacré au roman de Barbeau-Lavalette: «On peut voir qu’elle est au milieu de la campagne, et c’est comme tous les autres artistes/automatistes. En effet, la plupart d’entre eux finissent par adopter une vie en campagne pour leur création artistique».

Figure 4. Image et analyse tirées du portfolio de Parnika.
Extrait: «Le paysage se déroule et s’éloigne, tu avales tout des yeux tranquillement. Tu sens que tu es à ta place, pour la première fois. Installée dans le mouvement des choses» de La femme qui fuit.
Dans l’image, la fille (qui peut représenter Suzanne) regarde dehors et voit du champ sans fin qui passe en arrière d’elle. Le Soleil est en train de coucher dehors, et elle est dans ce train qui l’amène vers l’inconnu. Il n’y a pas de recul, pas de ralentissement. La fille regarde calmement dehors. En fait, elle regarde l’horizon — comme écrit au début du roman, Suzanne lève ses yeux et regarde l’horizon, vers un futur que personne ne peut prédire. On peut voir qu’elle est au milieu de la campagne, et c’est comme tous les autres artistes/automatistes. En effet, la plupart d’entre eux finissent par adopter une vie en campagne pour leur création artistique. De plus, cette scène nous rappelle aussi de quand Suzanne est venue à Montréal pour la première fois pour son concours d’art oratoire — elle était dans un train et regardait le paysage qui l’amenait à une ville dans laquelle elle va découvrir la vraie signification de l’art libre. Donc, cette fois, quand elle prend le train de nouveau pour trouver une autre place pour rester temporairement avant de partir de nouveau, c’est comme si elle allait découvrir un nouveau milieu qui lui donnera l’inspiration pour créer de l’art.
Si l’exemple précédent a permis d’établir que Parnika est parvenue facilement à établir des liens entre l’extrait et l’illustration proposée par Midjourney, le logiciel ayant traduit en images quelques éléments de la citation (le paysage qui déroule et s’éloigne; un personnage féminin qui regarde dehors), le travail d’Arthur, quant à lui, montre comment il est possible de trouver une correspondance entre le texte et la production de l’intelligence artificielle, même lorsque celle-ci semble sans lien apparent avec la citation de départ. Ainsi, dans son analyse de l’image générée à partir d’une autre citation issue de La femme qui fuit, «On est allé trop loin, trop vite», l’élève souligne d’emblée «la grande diversité et l’absurdité» des «composant(e)s» de l’illustration fournie par Midjourney, qui représente des «objets n’allant pas du tout ensemble et n’étant pas du tout à leur place». Tentant tout de même d’arrimer la proposition du logiciel au texte de Barbeau-Lavalette, l’élève associe «cet(te) absurdité et ce mélange d’objets» aux sentiments «d’inconfort et de confusion» que Suzanne Meloche devait avoir éprouvés au moment du passage. Pour ce faire, il mobilise sa subjectivité en invoquant, plus spécifiquement, son propre inconfort face à l’ensemble hétéroclite d’éléments indéfinissables qui composent l’image, qu’il compare à celui éprouvé par le personnage du roman de Barbeau-Lavalette. De plus, il interprète le caractère «extravagant» de la production de Midjourney comme la représentation métaphorique du franchissement des frontières de la raison: «Je crois que cela signifie le fait d’être aller trop loin, d’avoir pris un trop gros pas et de s’être retrouvé à quelque part où nous ne sommes pas supposé être». La reprise de l’expression «aller trop loin», présente dans la citation, témoigne de la volonté de l’élève d’interpréter l’image moins pour ce qu’elle évoque en soi que pour ce qu’elle représente du texte qui a déterminé sa génération.

Figure 5. Image et analyse tirées du portfolio d’Arthur.
Extrait choisi: «On est allé trop loin, trop vite» de La femme qui fuit.
Cet extrait m’a marqué parce que j’y trouve beaucoup de vérité quant à la façon dont nous vivons ces jours ci. On se dépêche trop vite pour vivre notre vie et cela peut ruiner notre perception des vraies choses. Mon attente pour l’image reliée à cet extrait est un humain marchant sur un chemin qui a l’air d’aller à l’infini. Par contre, L’image que Midjourney m’a procuré pour cet extrait a été bien différente de ce que je m’attendais. J’ai choisi l’image ci-dessus en particulier car les autres ne représentaient que des grenouilles et une maison en champignons, deux aspects qui ne m’ont pas marqué. L’image que j’ai choisie m’a marqué due à la grande diversité et à l’absurdité de ses composants. Cette absurdité et ce mélange d’objets n’allant pas du tout ensemble et n’étant pas du tout à leur place me donne un sentiment d’inconfort et de confusion, les mêmes sentiments que Suzanne Meloche ressentait lorsqu’elle a dit la phrase que j’ai choisie. Aussi, les composants de cette image m’ayant été procurée sont tout droit sortie d’un imaginaire extravagant. Je crois que cela signifie le fait d’être aller trop loin, d’avoir pris un trop gros pas et de s’être retrouver à quelque part où nous ne sommes pas supposé être, ou nous ne savons pas la façon dont les choses marchent.
3.2. Analyse des images produites par Midjourney: quelles modalités de traitement de l’extrait?
Après avoir examiné les attentes de représentation des élèves vis-à-vis de Midjourney ainsi que leurs analyses des productions retenues, il convient de s’arrêter sur les images produites par le logiciel d’intelligence artificielle, afin d’identifier les modalités du traitement des informations textuelles opérées par la machine. Quelles formes de collaboration, de redondance ou de disjonction iconotextuelles (Van der Linden, 2006; 2008; Nikolajeva et Scott, 2006) sont mises en œuvre par l’intelligence artificielle générative? Quels éléments de l’extrait semblent retenus dans chaque cas?
Nous avons repéré et distingué trois types de rapports textes-images. Le premier s’apparente à la redondance, qui, selon la définition de Van der Linden (2006), implique une congruence, totale ou partielle, entre les informations portées par les textes et par les images. Dans cette catégorie figure, par exemple, l’illustration proposée par Midjourney à Parnika à partir de la citation de La femme qui fuit «Le paysage se déroule et s’éloigne, tu avales tout des yeux tranquillement. Tu sens que tu es à ta place, pour la première fois. Installée dans le mouvement des choses». La représentation d’une femme, le regard plongé dans le panorama qui défile devant elle, véhicule en effet les mêmes informations que l’extrait, dont elle reprend plusieurs éléments: le personnage représenté est en effet une femme (ce qui n’est signalé, dans l’extrait, que par l’accord en genre du participe passé «installée»), en mouvement, face à un paysage qu’elle observe «tranquillement» (dans l’image, la jeune femme contemple un paysage à travers la fenêtre d’un train en marche).
Le deuxième type de rapport textes-images identifiable dans les propositions de Midjourney relève de la collaboration ou de la complémentarité. Dans cette configuration, selon la définition de Van der Linden (2006), deux contenus, partiellement discordants, «travaillent conjointement en vue d’un sens commun» (p. 120). Cette collaboration, que l’on retrouve dans plusieurs propositions de l’intelligence artificielle, se fonde généralement sur la reprise d’un seul élément de l’extrait et est accompagnée de l’introduction de personnages, de lieux ou de représentations d’actions qui ne figurent pas dans le texte de départ. Ainsi, dans l’image issue de la citation de Gary «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude», l’intelligence artificielle extrait du texte la référence au chocolat, mais elle ajoute, dans l’image, le personnage d’une petite fille, assez élégamment vêtue, qui le décore. De la même manière, dans la production générée à partir de la citation de Beckett «Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable», on retrouve les éléments «homme» et «chaussure». Cependant, l’image du personnage privé d’un pied résulte d’une intervention du logiciel, basée peut-être sur la tentative de restituer la mention d’un homme «tout entier» qui s’attaque à la partie de soi qu’il estime coupable. On observe le même type de congruence partielle entre les informations véhiculées par les textes et par les images dans celle générée à partir de la citation de La vie devant soi: «C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes». D’une part, la proposition de l’intelligence artificielle semble fondée sur la reprise de quelques éléments de l’extrait, et notamment sur la référence aux «yeux» et à leur capacité à laisser transparaitre la tristesse des gens. D’autre part, elle introduit des éléments qui ne sont pas évoqués par le texte et qui, comme nous l’avons vu, n’appartiennent pas au passage en question. Dès lors, les larmes, tout comme la caractérisation d’un personnage féminin, sont une réélaboration de Midjourney, qui se trouve à faire dire quelque chose de plus ou de légèrement différent (Eco, 2003) au texte de Gary.
Le troisième type de rapport textes-images identifiable dans le corpus d’images consignées dans les portfolios peut être associé à la syllepse. Définie comme un cas extrême de contrepoint (Nikolajeva et Scott 2006), elle désigne la disjonction entre les informations textuelles et celles véhiculées par l’image. L’image générée par Midjourney à partir de la citation de La femme qui fuit, «On est allé trop loin, trop vite», en constitue un parfait exemple, car l’écart entre ce qu’exprime le texte de départ et ce que représente l’image générée par l’intelligence artificielle est maximal. Cette dernière, en effet, donne à voir une maison entourée de créatures fantastiques, réduites à des bouches et des yeux exorbités, guettant l’horizon ou rejetant une pluie de petits objets, autour d’une maison près de laquelle apparait un homme à l’air résigné.
4. Discussion des données
4.1. Du texte de départ à la génération d’images
4.1.1. Du texte de départ à la génération d’images: attentes littéraires et attentes technologiques
L’étude des portfolios révèle que les attentes de transposition iconique des élèves reposent essentiellement sur la reprise de quelques éléments de l’extrait qui ont attiré leur attention. Iels espèrent notamment que Midjourney puisse générer des images qui expriment une redondance, ou du moins une forme de collaboration, avec les textes. Dès lors, iels retiennent, pour leurs analyses interprétatives, les productions qu’iels jugent les plus conformes à la citation et, lorsque l’intelligence artificielle leur propose des images très éloignées de l’univers des extraits, iels cherchent à rétablir des liens avec les textes en revenant sur leurs émotions: ainsi, si Parnika sélectionne l’image qui «décrit le mieux le passage» et Maxence écarte celles qui «correspondent moins à l’extrait», Arthur en conserve une qu’il juge absurde et recrée un lien avec le texte de Barbeau-Lavalette en assimilant son «inconfort» pour la proposition de Midjourney à celui que le personnage éprouve dans le passage cité. Cette attente d’une certaine congruence entre des éléments de la citation et la transposition iconique s’accompagne d’une autonomisation de l’extrait par rapport au contexte. Que l’extrait présente des contenus plus abstraits («aller trop loin, trop vite») ou des référents plus concrets (chocolat, yeux, etc.), les attentes ne sont pas fondées sur la citation et son contexte, mais considérées de manière relativement indépendante. Si la citation offre des référents concrets (par exemple «chocolat»), ils sont réinvestis dans la formulation des attentes sous la forme d’une reprise mot-à-mot; si, en revanche, l’extrait présente des contenus plus abstraits («aller trop loin, trop vite»), les élèves introduisent de nouveaux éléments («un humain marchant sur un chemin qui a l’air d’aller à l’infini»), qui ne renvoient que partiellement au texte de départ.
On constate, de plus, une faible valorisation de la polysémie de l’image et de sa capacité potentielle à enrichir les textes de départ, à en expliciter les non-dits ou bien à développer des narrations parallèles. Un seul élève, en effet, choisit parmi les différentes propositions de Midjourney l’image qui, à son avis, peut se prêter à de multiples interprétations («J’ai choisi cette image car il y a plusieurs façons de l’interpréter», Extrait du portfolio de Maxence).
Par ailleurs, la formulation d’attentes impliquant une mise à l’épreuve des potentialités — créatives ou technologiques — du logiciel est plutôt rare: dans un cas seulement, on trouve explicitée la volonté d’interroger la capacité de Midjourney à générer une image à partir d’éléments textuels considérés comme difficiles à représenter pour un être humain. Si la nouveauté de l’expérience et de l’exercice d’interaction avec l’intelligence artificielle a certainement conditionné les attentes des élèves ainsi que leurs manières de les formuler, nous pouvons néanmoins considérer que l’on s’attend avant tout de Midjourney qu’il sache lire et comprendre le texte, puis le transposer en une image qui mobilise et réinvestit de manière cohérente les éléments jugés saillants.
Cette recherche d’une adhésion à la citation détermine peut-être la relative imprécision des indications concernant la représentation des personnages ou des lieux de l’extrait. En effet, les attentes visuelles des élèves sont généralement exprimées de manière sommaire, avec peu de références aux images mentales élaborées au moment de la lecture. On peut dès lors supposer que les élèves ne s’attendent pas à ce que l’intelligence artificielle soit en mesure de s’arrimer à leur interprétation ni qu’elle puisse être utilisée pour donner à voir les reconfigurations subjectives qu’iels opèrent en lisant. Cela pourrait également expliquer le fait que les élèves ne cherchent pas à obtenir des images plus proches de leurs représentations mentales en donnant des indications supplémentaires à Midjourney. Leur démarche d’interaction avec l’intelligence artificielle se limite à la réinsertion de la citation et à l’attente d’une nouvelle proposition, plus conforme à la lettre du texte. Dans cette perspective, Midjourney serait considéré davantage comme une machine de traduction intersémiotique, dont l’efficacité s’évalue en fonction de la cohérence des articulations textes-images proposées, que comme une machine d’appropriation littéraire (Shawky-Milcent, 2014).
4.1.2. Du texte de départ à l’analyse des images: analyses iconotextuelles à géométrie variable
L’analyse des images retenues dans les portfolios montre que les élèves tendent à décrire et à interpréter les propositions de Midjourney de manière décorrélée de l’extrait. Les cinq travaux examinés montrent qu’une élève seulement, Parnika, s’attache à associer les éléments visuels proposés par le logiciel d’intelligence artificielle à la citation, en identifiant, dans le portrait de la jeune fille dans le train, des liens avec l’attitude, l’environnement et les actions du personnage de Suzanne. Les autres élèves se livrent, en revanche, à des analyses fortement descriptives, qui semblent oublier le texte — et ce même si leurs interprétations initiales mobilisaient de manière assez précise des éléments de la citation ou renvoyaient, de manière plus large, aux thématiques de l’œuvre. Ainsi, Seynoon, qui avait fait référence, dans son appréciation critique de l’extrait de Gary, à la question de la marginalité ainsi qu’à la solitude et à la vieillesse des personnages du roman, décrit ce «visage aux yeux qui pleurent dans une lumière douce (…) et introspective, invitant à la contemplation» sans en interroger la cohérence par rapport à la citation. De manière similaire, Anderson ne relève pas, dans son analyse de la symbolique de la couleur du soulier et la représentation d’un homme sans pied, l’introduction d’éléments absents de l’univers narratif de Beckett. Maxence, de son côté, analyse longuement la monochromie de l’image, l’aspect de la petite fille représentée et sa position au milieu de centaines de petits chocolats à l’aune de thématiques qui n’appartiennent pas à l’œuvre citée. Il semble ainsi que l’image générée par la machine se superpose au texte, s’interpose dans le processus de réception de celui-ci et lui fasse littéralement écran, en amenant les élèves à réagir uniquement à ce qu’ils voient.
Or, si l’exercice de la citation, qui implique d’isoler et de décontextualiser des phrases marquantes, pourrait avoir favorisé l’oubli du texte, on peut également supposer que les élèves acceptent les productions de Midjourney comme étant des formes de concrétisation imageante de la machine, c’est-à-dire comme le résultat d’un processus de figuration des personnages, des lieux et des évènements d’un récit (Langlade 2006), et qu’iels recherchent une liaison systématique, bien que non nécessairement visible, avec l’extrait. Par exemple, dans l’analyse d’Arthur, qui a constaté l’absurdité de la proposition fantastique de Midjourney par rapport à la citation de La femme qui fuit («On est allé trop loin, trop vite»), le lien avec l’extrait est justifié par l’adhésion de l’élève aux émotions du personnage: en effet, son «inconfort», qu’il rattache à l’égarement supposé du personnage dans le texte, est perçu comme un signe de l’absurdité de l’image et, donc, de son adéquation avec la citation. L’image, superposée au texte, enclenche un discours sur l’œuvre qui permet de raconter ses émotions, sa propre lecture de l’image. Dès lors, pour Arthur, tout comme pour ses camarades, le discours sur le texte est reconfiguré par une analyse de l’image qui devient l’occasion pour parler de soi, de ses préoccupations et de sa vision du monde. Ainsi, si les élèves ne décèlent pas les incohérences entre les textes et les images ou, du moins, s’iels ne semblent pas particulièrement gêné·es par les écarts constatés, c’est parce que l’image se trouve à être interprétée à la place du texte.
4.2. Rapports textes-images: ce que Midjourney fait à l’extrait
Que fait donc l’intelligence artificielle générative aux extraits? Comment les réélabore-t-elle et que peut-on dire de sa démarche de transposition?
On constate tout d’abord que Midjourney n’est pas en mesure d’identifier la citation ni d’en restituer le cotexte. L’introduction, dans presque toutes les images, de personnages, d’éléments et de décors étrangers aux textes de départ montre, en effet, que le traitement du texte n’implique pas une consultation de bases de données littéraires ni l’exploitation d’informations relatives à l’œuvre, à son auteur·rice ou à son époque. À l’instar des élèves, l’intelligence artificielle générative ne reconnait pas la citation comme telle, mais la traite au contraire comme toute commande textuelle (ou prompt), en isolant des mots et des phrases clés (Oppenlaender 2023). Ainsi, d’une part, l’intelligence artificielle procède à la transposition en images d’indices sémantiques plus ou moins facilement identifiables, d’autre part, elle propose des illustrations assez proches les unes des autres d’un point de vue graphique et visuel, malgré les différences génériques et stylistiques des textes de départ.
Par ailleurs, dans sa démarche transpositive, Midjourney semble générer plus aisément des images ayant une relation de symétrie avec les textes lorsque ceux-ci contiennent des références à des éléments concrets, tandis qu’il propose des associations moins immédiates lorsque la citation revêt une valeur aphoristique ou convoque des concepts abstraits, des états d’âme ou des émotions. Dans ce cas, l’intelligence artificielle procède soit en substituant des images plus concrètes à des références abstraites, le chagrin étant, par exemple, traduit par l’image d’une jeune fille en pleurs, soit en introduisant de nouveaux éléments, plus ou moins éloignés de la citation et de son cotexte. Ces interventions peuvent être reliées aux textes de départ par le biais de métaphorisations, qui permettent, par exemple, de reconnaitre dans le personnage sans pied représenté par Midjourney la condition de l’«homme tout entier» de Beckett, ou bien elles peuvent être considérées comme des réécritures iconiques à part entière. Par exemple, l’image proposée à partir de la citation de La femme qui fuit «On est allé trop loin, trop vite» et, dans une moindre mesure, celle issue de la citation de Gary «Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur gout que d’habitude» témoignent de ces procédés de traitement des informations textuelles «magiques» (Oppenlaender 2023), qui ne permettent pas d’identifier les indices sémantiques exploités par la machine, mais qui «introduisent un caractère aléatoire dans l’image, pouvant conduire à des résultats surprenants» (Oppenlaender 2023, notre traduction). Il semblerait ainsi que lorsque l’intelligence artificielle ne parvient pas à isoler et à transposer de manière symétrique des indices textuels, elle insère des variables impondérables, qui témoignent d’une forme de créativité algorithmique.
Conclusion
Bien que le caractère exploratoire de notre recherche et la nouveauté de l’expérience pour les élèves n’invitent pas aux généralisations, il nous semble que les propos des participant·es, leurs attentes et analyses puissent témoigner de manières de penser et construire le sens produit par une intelligence artificielle dans le cadre d’une activité de réception/production littéraire.
Tout d’abord, nous avons vu que les images générées par l’intelligence artificielle sont traitées comme une transposition iconique des citations et qu’elles sont rarement remises en question par rapport au texte de départ ou à son cotexte. Analysées à la place du texte, elles sont, au contraire, regardées et interprétées en acceptant d’emblée l’ensemble d’associations et reconfigurations imageantes, plus ou moins éloignées des citations, proposées par Midjourney.
Dans cet exercice, qui les mène parfois à s’éloigner de l’horizon littéraire des textes de départ, les élèves révèlent un autre horizon d’attente, d’ordre technologique, qui les conduit à projeter, envisager ou fantasmer les capacités et les limites de l’intelligence artificielle. Les références à la transposition d’éléments textuels et le nombre relativement limité d’indications concernant la capacité de Midjourney à associer des indices sémantiques pour créer des images poétiques, imagées, décalées ou au contraire fidèles au texte de départ montrent que, sans un enseignement des manières d’interagir avec les intelligences artificielles, les élèves s’attendent avant tout à ce que le logiciel sache bien lire, comprendre et transposer les textes en images plutôt qu’intervenir de manière créative, en proposant de nouveaux éléments, des réinterprétations ou des reconfigurations stylistiques particulières.
Et pourtant, les images produites par Midjourney montrent que l’intelligence artificielle opère des remaniements profonds du texte de départ, en proposant, parfois, des univers graphiques dans lesquels aucun élément des citations n’est identifiable. D’où viennent ces images? Sont-elles l’expression d’une manière — subjective — de la machine de concevoir les thèmes des extraits sélectionnés pour l’article, soit la tristesse, le besoin d’un coupable, le constat d’être allé trop loin, trop vite? Peut-on considérer la combinaison opaque d’indices sémantiques comme une forme de réécriture créative des extraits? Peut-on comparer l’analyse que Midjourney fait de la citation, décorrélée de l’extrait, à celle qu’en font les élèves? Les propositions visuelles de Midjourney forcent-elles les élèves à construire des relations sémantiques qui déforment, voire dénaturent le sens du texte à l’origine de la commande, ou encore leur propre concrétisation imageante? Dans un contexte où les élèves seraient davantage formé·es aux moyens, aux processus et aux formes d’interaction avec une intelligence artificielle, verrions-nous davantage apparaitre leur propre subjectivité, mise en jeu avec celle anticipée de la machine? Si ces questions ne semblent pas, pour le moment, avoir de réponse, elles nous semblent tout à fait pertinentes en contexte didactique, aussi bien dans une perspective de développement de compétences littéraires que littéraciques numériques.
Bibliographie
Andrejevic, Mark (2020), Automated Media, New York et Abingdon, Routledge.
Bensamoun, Alexandra (2020). «Ceci est… une œuvre d’art! La question des créations générées par une intelligence artificielle», L’Observatoire, 55 (1), p. 104-106.
Beller, Jonathan (2021), The World Computer: Derivative Conditions of Racial Capitalism, New York, Duke University Press, [en ligne].
Chomsky, Noam, Roberts, Ian et Watumull, Jeffrey (2023), «The false promise of ChatGPT». The New York Times, 8 mars 2023, [en ligne].
Collin, Simon et Marceau, Emmanuelle (2021). L’intelligence artificielle en éducation: enjeux de justice » Formation et profession, 29 (2), p. 1–4, [en ligne].
Dusi, Nicola (2000), «Per una ridefinizione della traduzione intersemiotica», In N. Dusi et S. Nergaard (dir.). Sulla traduzione intersemiotica. Versus, n° 85-87, p. 3-54.
Eco, Umberto (2003), Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani.
Fernandez, Perter (2022), «Technology behind text to image generators, Library Hi Tech News», n° 39(10), p. 1-4 [en ligne].
Ganascia, Jean-Gabriel (2017). «Une machine ne peut pas être créative.», In J. Ganascia (dir.), Intelligence artificielle: vers une domination programmée?, Le Cavalier Bleu, p. 107-115.
Gefen, Alexandre (dir.) (2023), Créativités artificielles. La littérature et l'art à l’heure de l'intelligence artificielle, Paris, Presses du réel.
Gozalo-Brizuela, Roberto et Garrido-Merchán, Eduardo (2023), «ChatGPT is not all you need. A state of the art. Review of large generative AI models», AI Frameworks Discussion of Abeba Birhane’s Algorithmic Injustice and Social Impact Articles, 1 (1), [en ligne].
Jovanović Mladjan et Campbell, Mark (2022), «Generative Artificial Intelligence: Trends and Prospects», Computer, 55 (10), p. 107-112. (DOI: 10.1109/MC.2022.3192720)
Kiepas, Andrzej (2020), «Human Subjectivity in the Dawn of Digital Society», International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, 7 (1), p. 31-38.
Korzynski, Pawel, Mazurek, Grzegorz, Krzypkowska, Pamela et Kurasniski, Artur (2023), «Artificial intelligence prompt engineering as a new digital competence: Analysis of generative AI technologies such as ChatGPT», Entrepreneurial Business and Economics Review, 11 (3), p. 25‐37, [en ligne].
Langlade, Gérard (2006), «L’activité fictionnalisante du lecteur». Modernités 23. Les enseignements de la fiction, in M. Braud, B. Laville et B. Louichon (dir.), p. 163-176.
Le Goff, François et Fourtanier, Marie-Josée (dir.) (2017), Les Formes plurielles des écritures de la réception. Volume I: Genres, espaces et formes. Volume II: Affects et temporalités, Namur, Presses universitaires de Namur, coll. «Diptyque».
Liu, Vivian et Chilton, Lidia B. (2022), «Design guidelines for prompt engineering text-to-image generative models», CHI ’22: Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing systems, New York, Association for computing machinery.
Lou, Renze, Zhang Kai et Yin Wenpeng, (2023), «Is prompt all you need? No. A comprehensive and broader view of instruction learning», arXiv, [en ligne].
McCormack, Jon, Gambardella, Camilo Cruz, Rajcic, Nina, Krol, Stephen, James, Llano, Maria Teresa et Yang Men (2023), «Is writing prompts really making art?», In Artificial Intelligence in Music, Sound, Art and Design, S. Adkins, P. Sarmento et M. Barthet (dir.), Cham, Springer, p. 196-211 [en ligne].
Nikolajeva, Maria et Scott, Carole (2006), How picturebooks work, New York, Routledge.
Oppenlaender, Jonas (2023), «A taxonomy of prompt modifiers for text-to-image generation», Behaviour & Information Technology, [en ligne].
Roberge, Jonathan et Lebrun, Tom (2021). «BERT, GPT-3, Timnit Gebru et nous: l’intelligence artificielle à la conquête du langage», Sociologie et sociétés, 53 (1-2), p. 235-257, [en ligne].
Robinson, David G. (2022), Voices in the Code: A Story about People, Their Values, and the Algorithm They Made. Russell Sage Foundation [en ligne].
Shawky-Milcent, Bénédicte (2014), L’Appropriation des œuvres littéraires en classe de seconde, Thèse de doctorat soutenue à l’université de Grenoble.
Van der Linden, Sophie (2006), Lire l’album, Le Puy-en-Velay, L’Atelier du poisson soluble.
Van der Linden, Sophie (2008). «L’album, le texte et l’image», Le français aujourd’hui, 161 (2), p. 51-58.
Velkovska, Julia et Relieu, Marc (2021). «Pour une conception "située" de l’intelligence artificielle. Des interactions hybrides aux configurations socio-techniques», Réseaux, 229 (5), 2021, p. 215-229.
Voir également :
Sur Facebook