La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques.
- n°1 Justifier l’enseignement de la littérature
- n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes
- n°3 Formes de la circulation entre recherches didactiques et pratiques enseignantes de la littérature
- n°4 Enseigner la bande dessinée comme (de la) littérature
- n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée
- n°6 Les outils narratologiques pour l'enseignement du français : bilan et perspectives
- n° 7 Le texte littéraire à l'épreuve de l'image
- Sylviane Ahr - Entretien : "disputes" et justifications de l'enseignement de la littérature
- Bertrand Daunay - Recension : Baroni Raphaël (2017), "Les Rouages de l’intrigue"
- Judith Émery-Bruneau - D’un paradigme interprétatif à un paradigme critique : prolégomènes à une transformation des recherches en didactique de la littérature
- J.-F. Boutin, N. Denizot, J.-L. Dufays, C. Gabathuler et R. Baroni - La narratologie dans l’enseignement du français en Belgique, en France, au Québec et en Suisse romande
- La scolarisation de la narratologie vue par quelques grands témoins
Articles récents
- Vanessa Depallens et Sonya Florey - Enseigner avec la narratologie aujourd’hui ? Retour sur quelques expériences d’enseignement dans divers degrés scolaires en Suisse romande
- Claire Detcheverry - La narratologie transmédiale pour la lecture d’albums jeunesse au primaire
- Sandrine Aeby Daghé & Glaís Sales Cordeiro - Le système récit-personnages: un outil conceptuel pour penser l’enseignement de la compréhension en lecture
- Marie Béguin & Sonya Florey - Renouer avec la passion du récit avec (ou malgré) le schéma narratif au secondaire I
- Vanessa Depallens - Écrire un récit «réussi»: une des finalités de l’école obligatoire vaudoise. Le cas de la description
La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques
La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques
Cet article de Hillary Chute, publié en 2008 dans la revue de la Modern Language Association of America 1, a marqué un tournant dans les rapports entre bande dessinée et études littéraires sur le nouveau continent. Chute propose non seulement une définition de ce média, en insistant sur les spécificités sémiotiques de cette forme d’expression plurimodale, mais elle propose également de retracer brièvement son histoire et de réfléchir sur la littérarité de ce qu’elle rebaptise le « récit graphique », en s’attardant notamment sur les œuvres d’Art Spiegelman et de Joe Sacco. Nous sommes reconnaissants à Hillary Chute et à l’éditeur de nous avoir autorisés à republier cet article, qui a été traduit par Raphaël Baroni et Sébastien Graber.
La bande dessinée – forme considérée autrefois comme vulgaire – suscite aujourd’hui un vif intérêt au sein des études littéraires. Comme tout le monde, je suis étonnée par cette explosion en dépit du fait que, par le passé, j'ai rédigé un rapport au Département d’anglais pour défendre vigoureusement l’idée que nous ne devrions pas oublier cette forme narrative innovante. Cependant, s’il y a un essor de la bande dessinée, il s’accompagne aussi de confusions catégorielles et terminologiques. Pour ceux qui adoptent le point de vue des études littéraires, la manœuvre est évidente: soit on justifie l’intérêt de la bande dessinée en s’appuyant sur une défense de la culture populaire, soit on la rattache à la riche tradition des recherches sur les rapports entre textes et images, qui nous renvoie aux manuscrits enluminés du Moyen Âge. Mais la bande dessinée pose des problèmes que nous essayons encore de résoudre ; le terme n’entre pas facilement dans notre grammaire et la nomenclature qui l’entoure reste compliquée et controversée2. Le domaine des études littéraires n'a pas encore saisi les contours de cet objet fuyant, ni défini clairement son projet le concernant. Pour explorer les bandes dessinées contemporaines, nous devons dépasser certaines classifications antérieures : nous devons réexaminer les catégories de fiction, de narration et d’historicité. Les bourses d'études consacrées aux bandes dessinées – et plus particulièrement à ce que j'appelle les récits graphiques – sont en augmentation dans les sciences humaines. La bande dessinée peut être définie comme une forme hybride combinant des mots et des images, dans laquelle deux cheminements narratifs, l'un verbal et l'autre visuel, construisent une temporalité à l’intérieur d’un espace. La bande dessinée progresse temporellement en cheminant dans l'espace de la page, en s’appuyant sur une alternance de présences et d’absences, les cases saturées d’informations (aussi appelées vignettes ou cadres) alternant avec les gouttières (des espaces vides entre les cases). Extrêmement structurée dans sa construction narrative, la bande dessinée ne se contente pas de mélanger le visuel et le verbal – ni même d'illustrer l'un par l'autre – mais elle est plutôt encline à présenter les deux éléments de manière asynchrone : un lecteur de bande dessinée ne remplit pas seulement les blancs entre les cases, mais il opère aussi des allers-retours entre lecture et recherche visuelle du sens. Dans cet article, je traiterai la bande dessinée (comics) comme un média3, et non comme un genre populaire, telle qu’on l’entend habituellement4. Par ailleurs, je conclurai en attirant l’attention sur un genre particulièrement prégnant au sein de ce domaine : la bande dessinée non fictionnelle.
Je m’intéresserai particulièrement à la manière dont la bande dessinée met en jeu le problème de la représentation de l'histoire, car mon propre travail s'est concentré sur ce que cette forme rendait possible pour le récit non fictionnel, en particulier du fait de sa capacité de juxtaposer spatialement sur la page (et de faire se superposer) des moments passés, présents et futurs. Je m'intéresserai aussi à la manière dont la bande dessinée élargit les modes d'expression de soi et de l’histoire, tout en s'inscrivant dans la culture populaire5. Comment les bandes dessinées contemporaines s’y prennent-elles pour raconter des histoires collectives épouvantables ? Pourquoi les artistes féminines brouillent-elles la distinction entre histoires « privées » et histoires « publiques » ? L'impact esthétique et narratif des bandes dessinées à dimension historique est un élément central de MetaMaus, un livre d'Art Spiegelman à l'édition duquel je participe actuellement6 et qui portera sur les treize années qu'a duré le processus de fabrication de son livre, Maus : l'histoire d'un survivant, qui a été couronné par le prix Pulitzer.
Tour d’horizon
À l’heure actuelle7, trois revues scientifiques ont consacré des numéros spéciaux au récit graphique. Art Spiegelman a récemment donné un séminaire à l'Université de Columbia intitulé « Bandes dessinées : entrer dans le canon », et la Norton Anthology of Postmodern American Fiction intègre depuis peu des bandes dessinées. En dehors du monde académique, le récit graphique occupe l'avant-scène de la critique littéraire et des conversations culturelles : le magazine Time, baromètre du grand public, a nommé comme meilleur livre de 2006 le récit graphique d'Alison Bechdel : Fun Home. A Family Tragicomic. La même année, la maison d’édition Houghton Mifflin, qui publie The Best American Series, inaugurait le premier volume du Best American Comics. On pouvait même lire, en juillet 2004, dans un article de couverture du New York Times Magazine, que cette « nouvelle forme littéraire » rejoint « ce que le roman était autrefois – une forme accessible, vernaculaire [et] ayant un attrait massif » (McGrath 2004 : 24).
Le terme de roman graphique est un terme beaucoup plus commun et facilement identifiable que celui de récit graphique8. Mais ce qui était à l’origine un terme marketing doit aujourd’hui être replacé dans son contexte historique, celui de la seconde moitié du XXe siècle. L'impulsion est venue en partie d’une communauté éditoriale très active issue du milieu underground, qui souhaitait produire des œuvres liées au média de la bande dessinée, mais possédant un impact plus important : le premier usage public attesté de cette expression, par Richard Kyle, apparaît dans un bulletin de 1964 distribué aux membres de l'Amateur Press Association, et le terme fut ensuite emprunté par Bill Spicer dans son fanzine Graphic Story World. Beaucoup pensent que Will Eisneraurait inventé le terme parce qu'il l'a utilisé dans un contexte plus commercial, pour vendre à des éditeurs A Contract with God (1978). Composé d'une série de quatre histoires sérieuses, liées entre elles et racontant les conditions de vie sordides et les désirs d'assimilation de migrants vivant dans un immeuble du Bronx dans les années 1930, A Contract with God fut le premier livre commercialisé en tant que « roman graphique9 ».
Des dizaines d'années plus tard, on retrouve des sections « roman graphique » dans de nombreuses librairies. Pourtant, ce terme semble souvent impropre pour désigner les objets rangés dans ces rayons. De nombreuses œuvres fascinantes regroupées sous cette étiquette – y compris Maus de Spiegelman, qui a contribué à populariser le terme – ne sont pas du tout des romans : ce sont de riches œuvres non fictionnelles, ce qui explique l’accent que je mettrai ici sur le terme plus large de récit. En effet, cette forme remet en question l’idée reçue qui voudrait que, par défaut, le dessin en tant que système serait intrinsèquement plus fictionnel que la prose. Elle donne aussi une nouvelle image de ce que nous considérons comme de la fiction ou de la non-fiction. Dans ce que nous désignons par récit graphique, la longueur substantielle à laquelle faisait référence le terme roman peut être préservée, mais cette expression plus neutre suppose l’existence d'autres modes que celui de la fiction. Un récit graphique est un ouvrage de la longueur d'un livre qui se rattache au média de la bande dessinée10.
Il existe de nombreux formats pour la bande dessinée qui sont tous porteurs d'un bagage culturel unique. Aux Ėtats-Unis11, le comic strip a émergé avant le début du XXe siècle et possède une extension qui varie de moins d'une page à plusieurs pages ou même davantage. Il s'agit d’une séquence qui forme une unité minimale et s’apparente à ce que l’on pourrait désigner comme une histoire courte. Le comic book, qui a vu le jour dans les années 1930, compte généralement trente-deux pages et se présente soit comme un recueil de comic strips, soit comme une histoire continue, souvent sous la forme d’un épisode qui se rattache à une série12. La bande dessinée se décline ainsi en toutes sortes de formats et dans différents contextes sériels, des strips quotidiens ou hebdomadaires aux comic books publiés mensuellement, en passant par les personnages sériels représentés dans tous ces formats. J’ai soutenu ailleurs que la planche de bande dessinée est elle-même un matériau dans lequel s’inscrit une forme de sérialité. En effet, il s’agit d’une architecture narrative fondée sur l'établissement d’intervalles réguliers au sein de l'espace et sur des déviations de cette régularité. Formellement, la bande dessinée diffère du dessin animé (en anglais : cartoon), car ces derniers présentent une succession d’images formées d’une seule case. Alors que ces deux formes utilisent souvent des dispositifs visuels et verbaux similaires, les bandes dessinées, qui se déploient généralement sur plusieurs cases, ont une dynamique narrative qui diffère des dessins animés. Pourtant, les auteurs de bandes dessinées sont encore couramment appelés en anglais cartoonists. Cela s’explique par le fait que la définition historique du cartoon trouve une résonnance chez des auteurs impliqués dans la reproduction de masse d’images dessinées – un aspect de cette forme qui empêche la bande dessinée d'être rattachée aux « beaux-arts ». Cartoon vient du mot italien cartone, qui signifie carton, et désigne un support pour une image ou un motif destiné historiquement à être transféré sur des tapisseries ou des fresques (Harrison 1981 ; Janson 1991 ; Harvey 2001 ; 2005). Pourtant, comme le souligne Randall Harrison, « avec l'arrivée de l’imprimerie, le "cartoon" a pris un autre sens. Il s’agissait d’une esquisse qui pouvait être reproduite en série. C'était une image qui pouvait être largement diffusée13 » (1981 : 16).
Mais comment définir la forme de la bande dessinée, quelles sont ses propriétés, son extension et ses capacités expressives ? Les amateurs de bandes dessinées pourraient en fait dire, comme l'a fait le juge Potter Stewart au sujet de la pornographie : il suffit d’en voir pour savoir ce que c’en est14. La bande dessinée est une forme créative en perpétuelle évolution, toujours soumise aux contraintes des formats imposés par des entreprises commerciales, contrairement au livre d'artiste, qui a connu une histoire parallèle au cours du XXe siècle15. Une partie de la critique s’est occupée de ce que Scott McCloud a appelé les « descriptions fonctionnelles » de la bande dessinée et, dans la plupart des cas, ces travaux négligent joyeusement les méthodologies institutionnelles les mieux établies. Understanding Comics de McCloud (1993a), le premier livre à théoriser la bande dessinée à travers sa propre forme médiatique, en propose une définition délibérément large et provisoire16. Son analyse de la forme intègre, mais sans s'y limiter, le contexte des supports imprimés, paramètre que de nombreux praticiens et critiques considèrent comme essentiel (p. ex. Kunzle 1973 ; Dowd & Reinert 2004).
McCloud définit la bande dessinée comme des « images picturales et autres, volontairement juxtaposées en séquences, destinées à transmettre des informations et / ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur17 » (2007 : 17). McCloud ajoute qu’avant sa projection, la pellicule d'un film « s’apparente à une bande dessinée observée au ralenti » (1999 : 5). Cet accent mis sur la séquence permet à McCloud de rattacher à la préhistoire de ce média des manuscrits d'images précolombiennes, la tapisserie de Bayeux et les Tortures de Saint-Erasme (1460), parmi d'autres antécédents culturels tout aussi improbables. En 2001, Robert Harvey a rejeté la conception de McCloud selon laquelle les bandes dessinées n'auraient pas besoin de contenir des mots pour être identifiées en tant que telles. C’est le cas également de Smolderen (2007), qui réfute l’idée que la séquence serait la propriété définitoire de la bande dessinée en analysant un « effet d'essaimage » à partir d’images uniques tirées de Bibles illustrées, de Bosch et de Brueghel, ainsi que de livres pour enfants. Harvey soulève quant à lui cette objection : « il me semble que la caractéristique essentielle de la bande dessinée – ce qui la distingue des autres types de récits picturaux – est l'incorporation de contenu verbal. […] Et l'histoire de la bande dessinée me semble mieux soutenir ma thèse que la sienne » (2001 : 75-76). Selon Harvey, l’histoire de la bande dessinée remonterait au XVIIIe siècle et débuterait dans les images produites par Hogarth, Gillray, Rowlandson et Goya (voir aussi Katz 2006 et Sabin 1993).
Les positions de McCloud et Harvey ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le penser. La bande dessinée dépend toujours de la manière dont la temporalité peut être construite en empruntant des chemins complexes, et souvent non linéaires, à travers l'espace de la page ; pour l'essentiel, cette forme s’appuie à la fois sur des mots et des images, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire. Comme le suggère Spiegelman, les œuvres en bande dessinée « chorégraphient et donnent forme au temps » (2005 : 4). Et bien que cette fonction puisse être remplie par de nombreuses formes d’expression, c'est dans la manière spécifique dont la bande dessinée accomplit cette opération que l'on peut trouver ce qui constitue souvent l’aspect formel le plus intéressant de ce média. McCloud désigne les cases comme « l’élément iconique le plus important » de la bande dessinée (2007 : 106), car elles nous indiquent, de manière très générale, « que nous sommes face à une division de l’espace et du temps » (2007 : 107) et sont à la base de la grammaire de la bande dessinée. En effet, ainsi que l’affirme McCloud, les cases « fragmentent à la fois l’espace et le temps, proposant un rythme haché des instants qui ne sont pas enchaînés » (2007 : 75). Par cette succession de cases en alternance avec des espaces vides, une page de bande dessinée offre une riche carte temporelle, configurée autant par ce qui est dessiné que par ce qui ne l'est pas ; ce média est très conscient de l'artificialité de ses frontières sélectives, qui organisent la planche sous la forme d’un diagramme de moments encapsulés. McCloud soutient que l'espace vide, appelé la gouttière, « recèle beaucoup du mystère et de la magie qui sont au cœur de la bande dessinée » (2007 : 74), et il ajoute que « ce qui se situe entre les cases constitue le seul élément de la bande dessinée qui ne peut pas être imité par un autre média » (1993b : 13).
À travers les travaux de ces chercheurs et critiques, une histoire de la bande dessinée est en train de se constituer et de faire émerger une riche tradition liée à l’histoire des formes, nourrissant ainsi un engouement contemporain pour la narration graphique. La brève histoire que je retracerai dans ces lignes fait référence à plusieurs personnages et événements clés – j’évoquerai ici le contexte des œuvres américaines, mais sans mettre l’accent sur le développement de l’industrie de la bande dessinée commerciale, qui est dominée par deux éditeurs, Marvel et DC, spécialisés dans les histoires de superhéros. Même si McCloud et Harvey sont en désaccord, ils affirment l’un comme l’autre l'importance de Hogarth pour la bande dessinée (McCloud 2007 : 24 ; Harvey 2001 : 77). Dans Modern Fiction Studies, Marianne DeKoven et moi-même avons affirmé à propos d’une œuvre comme La Carrière d’une prostituée –comme dans une bande dessinée, cette œuvre représente des moments ponctuels encadrés qui s’inscrivent dans la progression d’un récit– que l’on peut « comprendre l'influence de Hogarth en lisant son œuvre comme une extension de l’ut pictura poesis, qui fait passer cette dernière de la poésie au genre du roman moderne. Il a introduit une structure séquentielle et romanesque dans une forme picturale » (2006 : 769). Plus tard, au XIXe siècle, Rodolphe Töpffer (1799-1846) – un enseignant suisse considéré comme l'inventeur de la bande dessinée moderne – établit les conventions de cette forme narrative, qu'il définit comme un « langage pictural18 » et qu’il décrit comme un style concis reposant sur l’apparition du cadre des cases dans la page ; il ajoute qu’il se fonde sur deux formes préexistantes : le roman et les histoires en estampe de Hogarth (Kunzle 1990 ; Willems 2007). En 1832, faisant l'éloge de l'œuvre de Töpffer, Goethe vante le potentiel pour la culture de masse de ce qui finira par être baptisé« romans en estampes19 ».
Même dans cette incarnation précoce, la bande dessinée était considérée comme une forme d'art antiélitiste. Néanmoins, les comic strips américains se sont distingués des formes européennes antérieures –lesquelles n'ont jamais été produites en masse de la même manière– par leur usage de personnages récurrents et leur publication dans des journaux à grande diffusion (cf. Gordon 1998). Il est communément admis qu'en Amérique, la bande dessinée a été inventée en 1895 – l’année même où les frères Lumière inventaient le film narratif à Paris – dans le journal de Joseph Pulitzer, le New York World, avec The Yellow Kid de Richard Fenton Outcault, qui mettait en scène des migrants urbains de cette époque, ainsi qu'un enfant attachant et odieux habitant un immeuble de l’East Side20. Pulitzer s'est rapidement rendu compte que la bande dessinée était un moyen d’augmenter la diffusion de son journal. La lutte qui s’ensuivit dans la presse à sensations entre William Randolph Hearst et Pulitzer au sujet du Yellow Kid aurait donné naissance au terme yellow journalism21, et trouverait son origine dans la couleur caractéristique de la robe de chambre du gamin.
Contrairement à la littérature moderniste, qui s'est développée à peu près à la même époque, le média de la bande dessinée a été marqué dès le début par son statut de marchandise. Cependant, on ignore encore souvent le fait que la bande dessinée des premières décennies du XXe siècle était à la fois un produit de la culture de masse et une forme qui influençait et était influencée par les pratiques de l'avant-garde, notamment celles se rattachant au dadaïsme et au surréalisme (Gopnik et Varnedoe 1990 ; Inge 1990). On ignore aussi souvent le fait qu'à la fin des années 1930, alors que les comic books commençaient leur ascension, portés par les épaules de Superman, les premiers récits graphiques modernes, appelés « romans sans paroles », avaient déjà fait leur apparition : il s’agissait d’œuvres gravées sur bois au rendu magnifique – dans certains cas vendues comme des romans classiques – qui servaient presque entièrement un agenda socialiste et incorporaient des pratiques expérimentales largement associées au modernisme littéraire (Joseph 2003). Ces « romans sans paroles », en dépit de leur désignation, comprenaient souvent du texte, mais pas sous la forme de cartouches ou de bulles (Beronä 2001 ; voir aussi Cohen 1977). Bien que ces œuvres n'aient pas toujours été associées à l'histoire de la bande dessinée, certains chercheurs ont commencé à les inclure dans le développement du récit graphique, ce qui leur a permis de montrer comment ce média, au début de son histoire moderne, a pu inclure des expérimentations formelles sans perdre son attrait pour la consommation de masse, ce qui représente un développement crucial pour l'impact de la forme actuelle22. En montrant les tensions entre, d'une part, une production éditoriale de masse et des pratiques artisanales, et, d'autre part, entre convention et expérimentation, ces œuvres montrent comment les premières versions des récits graphiques ont pu répondre aux enjeux de la culture contemporaine tout en anticipant l’émergence de genres marqués par un mélange entre la culture élitiste et populaire, que l'on identifie comme typiques de la littérature contemporaine23.
Dans les années 1950, 1960 et 1970, les bandes dessinées reflètent les bouleversements que l’on observe durant ces décennies dans la culture américaine, souvent en lien avec la Deuxième Guerre mondiale : elles créent un point de jonction entre la culture populaire américaine de masse et les expérimentations que l’on trouve dans les modernismes littéraires et artistiques. Fondée par le caricaturiste Harvey Kurtzman en 1952, la revue Mad Comics: Humor in a Jugular Vein (qui deviendra plus tard le magazine MAD) se présentait comme un comic book sérieusement autoréflexif et profondément préoccupé par l'esthétique de la bande dessinée. Avec Mad, Kurtzman établissait le projet d’une bande dessinée servant de critique pour les valeurs américaines dominantes, en particulier celles véhiculées par les médias, et pour cette raison, ce magazine a constitué une source d’inspiration pour la bande dessinée underground (souvent appelée comix) qui se développera à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
Comme la littérature des années 1960, la bande dessinée de cette période est dominée par des oppositions. Les dernières années de la décennie sont marquées par la révolution des comix undergrounds, ce mouvement revendiquant explicitement son rattachement à l’avant-garde. En réaction aux codes de la censure, qui étouffaient l'industrie mainstream, la bande dessinée underground est devenue un support culturel influent, à la fois frappant et déstabilisant, parce qu'il se fondait sur la transgression des tabous. Rejetant les grands éditeurs, les représentants de la scène underground auto-publiaient des œuvres qui expérimentaient, hors des contraintes commerciales, les capacités formelles de la bande dessinée. C'est de cette culture que sont issus les récits graphiques les plus durables : des œuvres sérieuses et imaginatives explorant les réalités sociales et politiques en repoussant les limites d'un média historiquement inscrit dans la culture de masse. L'autobiographie, sans doute le mode dominant des récits graphiques actuels, a d'abord pris son essor dans cette culture underground.
Spiegelman en est l’exemple éloquent. Ses bandes dessinées expérimentales et ses récits autobiographiques, qui incluent le prototype que constitue Maus, ainsi que ses deux magazines Arcade (1975-1976) et RAW (1980-1991), transposent l’esthétique antinarrative de l'avant-garde dans le média populaire, et même populiste, qu’est la bande dessinée. À l’origine, Spiegelman détournait les attentes du public liées au développement de l’histoire, en travaillant à se démarquer des bandes dessinées de «divertissement». Plus tard, dans le magazine RAW, où Maus a été publié pour la première fois sous la forme d’une série, il a élargi cette pratique.À travers ces expérimentations, nous voyons que l’énonciation historique se construit de manière éclatée, à travers des espaces paradoxaux et des temporalités mouvantes : la bande dessinée – en tant que forme qui s'appuie sur l'espace pour représenter le temps – apparaît alors structurellement équipée pour remettre en question les modes dominants de la narration et de l’historiographie.
Maus, qui a remporté un prix Pulitzer « spécial » et qui a fait découvrir la sophistication de la bande dessinée au monde académique, dépeint les Juifs comme des souris et les Allemands comme des chats. Ce récit raconte, en faisant des allers-retours entre la Pologne de la Seconde Guerre mondiale et le New York des années 1970 et 1980, l'histoire d'un auteur de bande dessinée, nommé Art Spiegelman et de son père, Vladek, un survivant de l'Holocauste. Maus a été largement commenté24. C'est une histoire captivante, un portrait émouvant d'une famille imparfaite. C'est aussi une œuvre dont la complexité esthétique et politique est liée aux spécificités de la bande dessinée. Marianne Hirsch souligne des aspects de l’œuvre de Spiegelman que l’on pourrait généraliser de manière à éclairer les potentialités du récit graphique. Selon elle, l'utilisation par Spiegelman de photographies dans un texte dessiné à la main
fait émerger non seulement la question de savoir comment, quarante ans après la sentence d'Adorno, l'Holocauste peut être représenté, mais aussi comment différents médias – la bande dessinée, la photographie, le récit, le témoignage – peuvent interagir les uns avec les autres pour produire un texte plus perméable et multiple, capable de refonder le problème de la représentation de l’Holocauste et de supprimer définitivement la séparation nette entre les domaines du documentaire et de l’esthétique. (1992-1993 : 11)
Spiegelman s'est battu publiquement, et avec succès, contre le New York Times pour faire passer son livre du classement des best-sellers appartenant au genre de la fiction à celui des œuvres non fictionnelles. En faisant s’entrechoquer dans la bande dessinée des couches narratives asynchrones ou concurrentes, il crée un niveau intense d'autoréflexivité (voir fig. 1). De plus, dans le récit graphique, le corps de l’auteur demeure présent dans le texte à travers le geste de la main visible dans le dessin25. Cette absence de transparence inscrit le récit déployé à la surface de la page dans le registre de la subjectivité, ce qui permet aux œuvres de bande dessinée d'être productivement conscientes de la façon dont elles «matérialisent» l'histoire – ce terme frappant étant utilisé par Spiegelman (Brown 1988 : 98). Concernant la place occupée par Maus dans la recherche académique, lors d’une interview donnée en 2003, Marianne Hirsch a affirmé que « dans le monde universitaire... c'est plus qu'une acceptation. Tout le monde se précipite pour écrire sur Maus » (2005).
Contextes
L'étude d'un texte de référence tel que Maus est en train de donner naissance à un domaine de recherche dont l’objectif est d’étudier plus largement le potentiel de cette forme d’expression. Dans un commentaire à propos de son œuvre, Spiegelman affirme que « la surface stylistique [de la page] était un problème à résoudre » (1994), ce qui caractérise bien la manière dont le récit graphique appréhende le style et la forme : il s’agit d’articuler les histoires à travers une esthétique spatiale liée aux cases, aux gaufriers26, aux gouttières et aux strips. Le récit graphique attire donc l'attention sur ce qui a été désigné par Mitchell comme un formalisme politique reconfiguré27. Selon lui, ce média nous confronterait aujourd’hui à un « nouveau type de formalisme », alors que le « moment moderniste de la forme […] est peut-être derrière nous28 » (2003 : 324). La narration graphique offre en particulier des exemples convaincants et diversifiés d’œuvres mobilisant différents styles, méthodes et modes pour traiter le problème de la représentation historique. Une conscience des limites de la représentation – qui est non seulement un problème spécifique à l’expression d’un traumatisme mais aussi une« condition sine qua non de toute représentation » (Kunow 1997 : 252) – fait partie intégrante du langage de la bande dessinée, du fait de sa forme architecturée, consciente d’elle-même et bimodale. Et simultanément, c’est pourtant à travers une visualisation à la fois saisissante, émouvante et directe des circonstances historiques, que la BD aspire à un engagement éthique.
Certains des livres les plus fascinants – ceux qui suscitent l’intérêt des critiques littéraires29 – représentent souvent des réalités historiques dramatiques. Par exemple, trois des auteurs de bande dessinée parmi les plus acclamés aujourd'hui, Art Spiegelman, Joe Sacco et Marjane Satrapi, travaillent dans un mode non fictionnel. Spiegelman s’est penché sur la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre, Sacco sur la Palestine et la Bosnie, Satrapi sur la révolution islamique en Iran et la guerre en Irak. Ce n'est pas une coïncidence. À travers sa manière congénitalement formaliste de raconter des histoires, à travers ses expérimentations avec les contraintes artificielles de son propre langage, la bande dessinée attire notre attention sur ce que Shoshana Felman et Dori Laub appellent la f«textualisation du contexte » :
le contenu empirique ne doit pas seulement être connu, mais doit être lu […]. L’exigence fondamentale et légitime de contextualisation du texte doit elle-même être complétée, simultanément, par le travail moins familier, et pourtant nécessaire, de textualisation du contexte. (Felman & Laub 1992 : xv)
Le récit graphique accomplit ce travail en rendant manifestes ses propres artifices et en attirant l’attention sur ses raccords. Sa grammaire formelle rejette la transparence et rend la textualisation visible, inscrivant le contexte dans la présentation graphique. Dans Maus, par exemple, le contexte du récit, sa nature de production culturelle sur l'Holocauste renonçant délibérément à la maîtrise esthétique, est affiché de manière extra-sémantique dans l’apparence de ses lignes au tracé hésitant. Lorsque nous lisons ce texte, nous percevons la texture granuleuse de ses lignes et nous constatons de ce fait le rejet des tropes nazis de la maîtrise.

Les récits graphiques les plus importants explorent les limites incertaines de ce qui peut être dit et de ce qui peut être montré, à l'intersection entre l’histoire collective et les histoires vécues30. Des auteurs comme Spiegelman et Sacco, aux prises avec un horizon historique, dépeignent la torture et le massacre sur un mode formel complexe, qui ne se détourne pas du traumatisme et qui ne cherche pas à l'atténuer. En fait, ils démontrent comment le fait de retracer visuellement ce traumatisme peut se révéler à la fois éthique et productif. Il y a aussi un riche éventail d'œuvres d'écrivaines qui explorent l'enfance et le corps – des préoccupations généralement reléguées au silence et à l'invisibilité de la sphère privée. Le récit de Satrapi sur sa jeunesse en Iran, Persepolis, ainsi que des œuvres d'autrices américaines comme Lynda Barry, Alison Bechdel, Phoebe Gloeckner et Aline Kominski-Crumb illustrent comment le récit graphique peut dépeindre la réalité quotidienne de la vie des femmes ; et cette réalité, tout en étant enracinée dans une individualité, apparaît investie et intriquée dans la collectivité, au-delà des modèles prescriptifs de l’altérité et de la différence sexuelle. Dans tous les cas, de l’échelle la plus large à l'échelle locale, le récit graphique met en scène l’aspect traumatique de l'histoire, mais tous ces auteurs et toutes ces autrices refusent de montrer cet aspect à travers le prisme de l'indicible ou de l'invisible ; à l’inverse ils ou elles transcrivent plutôt sa difficulté à travers des procédés textuels inventifs et variés.
On ne devrait pas conclure de cet enthousiasme engendré par les productions non fictionnelles que des œuvres puissantes ne pourraient pas relever de la fiction. Des auteurs comme Charles Burns (Black Hole), Daniel Clowes (Ghost World) et Chris Ware (Jimmy Corrigan : The Smartest Kid on Earth) ont rehaussé le niveau de la bande dessinée littéraire en racontant des histoires à la fois sérieuses dans leur portée et denses stylistiquement. Il s’agit cependant d’affirmer que la combinaison des mots et des images crée de nouvelles possibilités pour l'écriture de l'histoire en proposant des expérimentations formelles, tout en conservant l’attrait du texte pour un public de masse. La narration graphique suggère ainsi que l'exactitude historique n'est pas le contraire de l'invention créative, car la problématique de la distinction entre fait et fiction est rendue visible par le dessin. En effet, structurellement parlant, la bande dessinée est un média double et stratifié, qui peut juxtaposer différents moments historiques sur une même planche, ainsi qu’on peut le constater dans la dernière case de la figure 1, dans laquelle Spiegelman montre des cadavres de camps de concentration qui envahissent silencieusement son studio de SoHo.
Pour présenter certains travaux prometteurs sur ces questions, je reviendrai brièvement sur Mitchell, car sa manière de montrer comment les horizons formel et politique peuvent s'entrelacer est particulièrement pertinente pour réfléchir sur les récits graphiques non fictionnels. Mitchell s’est intéressé à After the Last Sky: Palestinian Lives, une œuvre d’Edward Said produite en collaboration avec le photographe Jean Mohr, dont le texte mélange des mots et des images. Dans son commentaire, Mitchell met en évidence l’importance de ce qu’il définit comme une « esthétique spatiale » (2003 : 324). Dans l'introduction du livre, Said écrit d’ailleurs : « Je crois que pour nous représenter, nous devrions utiliser essentiellement des formes d'expression non conventionnelles, hybrides et fragmentaires. […] Une double vision donne forme à mon texte » (2003 : 6).
Publié en 1986, la même année que l’œuvre charnière de Spiegelman, l'appel de Said au mélange des genres, des disciplines et des médias, explique son enthousiasme pour la bande dessinée, qu'il détaille dans l'admirable introduction qu’il a rédigée en 2001 pour le récit graphique de Sacco sur la Palestine, un exemple de ce que l'on appelle aujourd’hui le «journalisme en bande dessinée31». Selon lui, la bande dessinée offre une vision double en raison de son hybridité structurelle, par cette combinaison narrative de mots et d'images qui ne forment pas une synthèse. Dans une case de bande dessinée, les images et les mots peuvent signifier différemment, et de cette manière, l'œuvre peut véhiculer des récits ou des sens à double codage.
Le travail de Sacco, par la densité de ses détails, attire l'attention sur le rythme – un aspect formel que Said considère comme étant peut-être « la plus importantes de ses réussites » (Sacco 2015 : n.p.). Faisant l'éloge de Palestine, Naseer Aruri va jusqu’à écrire que « chaque page équivaut à un essai », une appréciation de la densité du récit qui ne se limite pas à la prose du texte, mais qui indique plutôt comment l'épaisseur de la forme iconotextuelle, telle qu’elle est travaillée par Sacco, transmet ce qui apparaît comme un surplus d'information ou de plénitude32. Peu de récits narratifs résistent mieux à la consommation facile que ceux de Sacco : le formalisme de ses pages constitue une jungle exigeant un intense travail de « décodage ». Ce terme, qui connote une difficulté, est utilisé conjointement par Spiegelman et par Said pour parler de la bande dessinée (Said 2001 : ii ; 2015 : np ; Spiegelman 1995 : 61). Les œuvres de Sacco s’appuient effectivement sur un va-et-vient disjonctif entre la contemplation de l’image et la lecture du texte, et ce rythme – souvent compliqué et coûteux en temps – fait partie de leur pouvoir de «captation», selon la formulation de Said, ce qui est particulièrement pertinent pour traiter un sujet aussi politisé et éthiquement compliqué que le conflit israélo-palestinien33. Said loue la façon dont Sacco associe bizarrement une forme d’accélération (les pages sautent aux yeux avec une sorte d’urgence) et de décélération (chaque page doit être arpentée de long en large pour être décodée), et il en conclut que ses « bandes dessinées offrent aux lecteurs un séjour raisonnablement long auprès d’un peuple » rarement représenté avec autant de complexité et de rigueur (2001 : v ; 2015 : np). Une planche de bande dessinée, à la différence d'un film ou d'un récit en prose traditionnel, est capable de maintenir ce flux contradictoire en tension, car le développement narratif est retardé, rétracté ou rendu récursif par la profondeur et le volume de la structure graphique.
Pour aborder la question de la littératie liée à l'idée d’un « décodage » de la bande dessinée, on pourrait s'inspirer de l’explication que donne Spiegelman de ce terme. Ses commentaires associent à la bande dessinée une littératie spécifique et active, ainsi qu’en témoigne la déclaration suivante, publiée en 1995 dans le Comics Journal :
Il me semble que la bande dessinée est déjà passée du statut d'icône de l'analphabétisme à celui de l'un des derniers bastions de la littératie. […] Si [ce média] a un problème aujourd’hui, c'est que le public actuel n'a plus la patience de décoder les bandes dessinées. […] Je ne sais pas si nous sommes à l'avant-garde d'une culture différente ou si nous sommes plutôt les derniers artisans d’une culture passée. (1995 : 61)
Ce commentaire s'écarte de l’image que beaucoup se font encore du média. Ainsi que l’écrivait Will Eisner dans Graphic Storytelling : « la bande dessinée en tant que forme de lecture a toujours été considérée comme une menace pour la littératie » (1996 : 3). Fredric Wertham, auteur en 1954 de l'incendiaire Seduction of the Innocent, un livre qui a contribué à introduire la censure dans le champ de la bande dessinée, désignait la consommation des récits graphiques comme « une dérobade à la lecture, et presque son contraire » (cité dans Schmitt 1992 : 157). Pourtant, en présentant des moments ponctuels encadrés qui alternent avec les espaces vides des gouttières au sein desquels il faut projeter une causalité, certains commentateurs (par exemple McCloud 1993a : 66-93, 106 ; Carrier 2000 : 51) soulignent que la bande dessinée exige une participation substantielle du lecteur pour construire le récit, allant jusqu’à favoriser une sorte d’«intimité interprétative» avec celui-ci (Mc Cloud 1993a : 69). Et même à l’intérieur de ses cases, le récit graphique, comme le suggère mon bref commentaire sur l’œuvre de Sacco, peut nécessiter un ralentissement, la forme pouvant devenir très exigeante mentalement. Étant donné que la construction spatiale de la page peut encourager les relectures et brouiller délibérément la linéarité narrative (en bande dessinée, la lecture peut se faire dans toutes les directions), la reconstruction du récit de base exige ainsi un degré élevé d'engagement cognitif34. Dans Goražde, Sacco spatialise le style elliptique de sa prose, que l’on pourrait rattacher à celui d’un écrivain de l’avant-garde littéraire comme Louis-Ferdinand Céline, en fragmentant le texte dans des cartouches flottant à la surface des images. Spatialiser le récit verbal pour dramatiser ou bousculer les fils du récit visuel, revient à introduire des ellipses dans la grammaire d'un support déjà caractérisé par la structure elliptique de la séquence case-gouttière-case. On peut voir un exemple de ce type dans l'une des pages les plus troublantes de Goražde, dans laquelle Sacco illustre le témoignage d’Edin, son ami bosniaque, qui est aussi traducteur. Cette image montre les cadavres des amis d’Edin, quatre hommes morts le premier jour de la première attaque serbe sur Goražde en mai 1992 (fig. 2).
La réaction négative suscitée par la bande dessinée « littéraire » en tant qu’objet de recherche, que l’on peut observer chez beaucoup d’universitaires, met en évidence l’anxiété engendrée par la dimension visuelle de la culture, en lien avec ce que Mitchell a identifié comme le «tournant visuel» (pictorial turn) des années 1990. Cette réaction montre aussi une suspicion envers une forme esthétique profondément marquée par son histoire populaire. Dans un éditorial publié en 2004 intitulé «Dommages collatéraux», Hirsch souligne la crainte de notre profession «qu'à l'ère médiatique contemporaine, nos étudiants (sans parler de nos représentants politiques) aient perdu leur littératie verbale et se soient abandonnés à une visualité dominante et incontrôlable qui altère la pensée». Mais elle écrit aussi – en introduisant les contributions à ce numéro de la revue PMLA portant sur les rapports entre études littéraires et arts visuels, qui comprend quatre prises de position sur la visualité dans The Changing Profession – que ces travaux «révèlent que notre domaine a déjà dépassé cette anxiété» (Hirsch 2004 : 1210).
En effet, le moment est venu d’élargir notre expertise scientifique et notre intérêt pour la bande dessinée. « Quel type de littératie visuelle et verbale sera en mesure de répondre aux besoins du moment présent ? » se demande Hirsch (2004 : 1212). Je parie – tout comme elle, qui analyse ensuite le dernier livre de Spiegelman In the Shadow of No Tower – que les récits graphiques embrassent certaines des questions les plus pressantes posées à la littérature contemporaine : quelle sont les structures narratives les plus pertinentes pour produire une représentation éthique de l’histoire ? Quels sont les enjeux actuels liés au droit de montrer et de raconter l'histoire ? Quels sont les risques de la représentation ? Comment les gens comprennent-ils leur vie en concevant des récits et parviennent-ils à rendre intelligible la difficulté du processus de remémoration ? Les récits graphiques font écho et prolongent les inventions formelles de la littérature, depuis les attitudes sociales et les pratiques esthétiques du modernisme jusqu’à la transition postmoderniste vers une démocratisation des formes populaires. Dans le récit graphique, nous voyons qu’une prise en compte de la reproductibilité et de la circulation de masse peut se conjuguer avec une attention rigoureuse et expérimentale à la forme comme mode d'intervention politique. Les approches critiques de la littérature, comme elles commencent à le faire, doivent porter une attention plus soutenue à cette forme en développement – une forme qui exige de repenser le récit, le genre et, pour reprendre l'expression de James Joyce, la «modalité du visible» (1948 : 39).
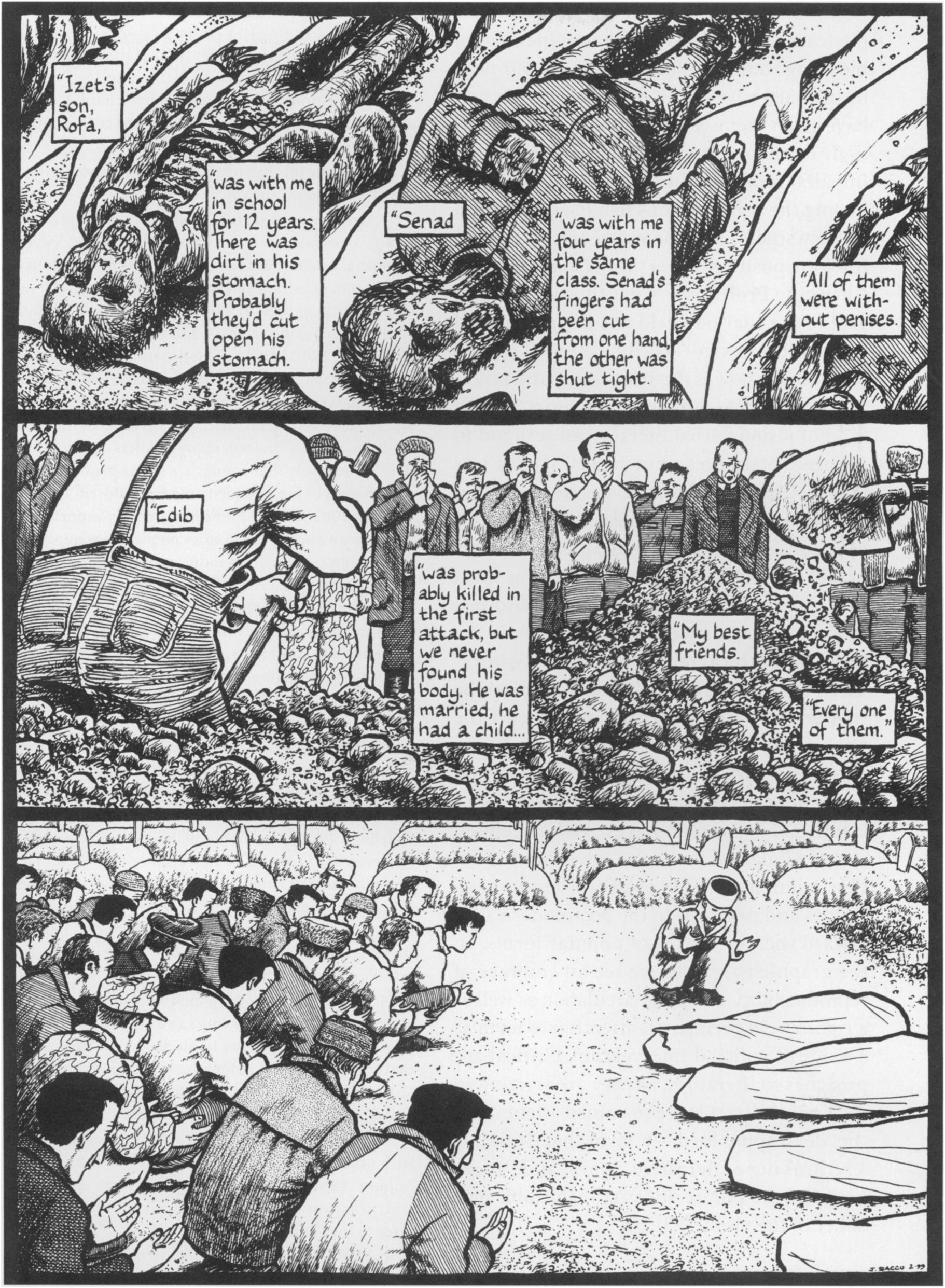 Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.
Figure 2 : Joe Sacco, Safe Area Goražde, p. 93.
Reproduit avec la permission de l’auteur.
Bibliographie
Arnold, Andrew (21 novembre 2003), « A graphic literature library », Time. URL[1] : http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,547796,00.html 35
Baker, Steve (1993), Picturing the Beast: Animals, Identity and Representation, Manchester, Manchester University Press.
Beronä, David A. (2001), « Pictures speak in comics without words: pictorial principles in the work of Milt Gross, Hendrik Dorgathen, Eric Drooker, and Peter Kuper », in The Language of Comics : Words and Image, R. Varnum & C. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississipi, p. 19-39.
Bosmajian, Hamida (1998), « The orphaned voice in Art Spiegelman’s Maus I and II », Literature and Psychology, n° 44 (1-2), p. 1-22.
Brown, Joshua (1988), « Of mice and memory », Oral History Review, n° 16 (1), p. 91-109.
Burns, Charles (2005), Black Hole, New York, Pantheon.
Carrier, David (2000), The Aesthetics of Comics, University Park, University Park, Penn State University Press.
Chute, Hillary (2008), « Ragtime, Kavalier and Clay, and the Framing of Comics », Modern Fiction Studies, n° 54 (2), p. 268-301. URL : https://muse.jhu.edu/article/240720/pdf
Chute, Hillary & Marianne DeKoven (2006), « Introduction: Graphic Narrative », Modern Fiction Studies, n° 52, p. 767-787.
Clowes, Daniel (1998), Ghost World, Seattle, Fantagraphics.
Cohen, Martin S. (1977), « The Novel in Woodcuts: A Handbook », Journal of Modern Literature, n° 6, p. 171-195.
Dowd, D. B., & Melanie Reinert (2004), « A Chronology of Comics and the Graphic Arts », in Strips, Toons, and Bluesies, T Hignite & D. B. Dowd (dir.), New York, Princeton Architectural.
Drucker, Johanna (1995), A Century of Artists' Books, New York, Granary.
Eisner, Will (1996), Graphic Storytelling and Visual Narrative, Tamarac, Poorhouse.
Eisner, Will (1978), A Contract with God: A Graphic Novel by Will Eisner, New York, DC Comics.
Elmwood, Victoria (2004), « "Happy, happy ever after?": The transformation of trauma between generations in Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale », Biography, n° 27, p. 691-720.
Ewert, Jeanne C. (2000), « Reading visual narrative: Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 8, p. 87-103.
Felman, Shoshana & Dori Laub (1992), « Foreword », in Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York, Routledge, p. xiii-xx.
Gardner, Jared (10 septembre 2004), « Reading out of the gutter: early comics, film, and the serial pleasures of modernity », Repetition, conférence à l'English Institute of Harvard University de Cambridge.
Geis, Deborah R. (dir.) (2003), Considering Maus: Approaches to Art Spiegelman’s "Survivor’s Tale" of the Holocaust, Tuscaloosa, University of Alabama Press.
Gopnik, Adam & Kirk Varnedoe (1990), High and Low: Modern Art, Popular Culture, New York, Museum of Modern Art & Harry N. Abrams.
Gordon, Ian (1998), Comic Strips and Consumer Culture, 1890–1945, Washington, Smithsonian Institute.
Harrison, Randall (1981), The Cartoon: Communication to the Quick, Beverly Hills, Sage.
Harvey, Robert C. (2005), « Describing and discarding "comics" as an impotent act of philosophical rigor », in Comics as Philosophy, J. McLaughlin (dir.), Jackson, University press of Mississippi, p. 14-26.
Harvey, Robert C. (2001), « Comedy at the juncture of word and image: the emergence of the modern magazine gag cartoon reveals the vital blend », in The Language of Comics: Word and Image, R. Varnum and C. T. Gibbons (dir.), Jackson, University Press of Mississippi, p. 75–96.
Heer, Jeet & Kent Worcester (dir.) (2004), Arguing Comics: Literary Masters on a Popular Medium. Jackson, University Press of Mississippi.
Hirsch, Marianne (hiver 2006) « Marianne Hirsch on Maus », entretien avec M. Kuhlman, Indy Magazine.
Hirsch, Marianne (2004), « Collateral damage », PMLA, n°119, p. 1209-1215.
Hirsch, Marianne (1992-1993), « Family pictures: Maus, mourning, and post-memory », Discourse, n°15 (2), p. 3-30.
Hungerford, Amy (2003), The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification, Chicago, University of Chicago Press.
Hutcheon, Linda (1997), « Postmodern provocation: history and "graphic" literature », La Torre, n° 2, p. 299-308.
Huyssen, Andreas (2000), « Of Mice and mimesis: reading Spiegelman with Adorno », New German Critique, n° 81, p. 65-83.
Iadonisi, Rick (1994), « Bleeding history and owning his [father’s] story: Maus and collaborative autobiography », CEA Critic, n° 57 (1), p. 41-56.
Inge, M. Thomas (1990), Comics as Culture, Jackson, University Press of Mississippi.
Janson, Horst Waldemar (1991), « Glossary: cartoon », History of Art, New York, Prentice & Abrams, p. 828.
Joseph, Michael (2003), « Vertigo: a graphic novel of the great depression – an exhibition of the original woodblocks and wood engravings by Lynd Ward », Introduction, exposition organisée par M. Joseph, Special Collections and University Archives, Rutgers University.
Joyce, James (1986 [1922]), Ulysses, New York, Vintage.
Katz, Harry (2006), « A brief history of American cartooning », in Cartoon America: Comic Art in the Library of Congress, New York, Abrams, p. 28-109.
Koch, Gertrude (1997), « "Against all odds"; or, the will to survive: moral conclusions from narrative closure », History and Memory, n° 9 (1), p. 393-408.
Kunow, Rüdiger (1997), « "Emotion in tranquility?" Representing the Holocaust in fiction », Emotion in Postmodernism, G. Hoffmann & A. Hornung (dir.), Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, p. 247-270.
Kunzle, David (2007), Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of Mississippi.
Kunzle, David (1990), The Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, vol. 2 « The history of the comic strip ».
Kunzle, David (1973), The Early Comic Strip: Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c.1450 to 1825, Berkeley, University of California Press, vol. 1 « The history of the comic strip ».
LaCapra, Dominick (1998), History and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press.
Landsberg, Alison (1997), « America, the Holocaust, and the mass culture of memory: toward a radical politics of empathy », New German Critique, n° 71, p. 63-86.
Lefèvre, Pascal (2000), « The Importance of being "published": a comparative study of different comics formats », Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics, A. Magnussen & H. C. Christianson (dir.), Copenhagen, Museum Tusculanum & University of Copenhagen, p. 91-106.
Levine, Michael G. (2002), « Necessary stains: Spiegelman’s Maus and the bleeding of history », American Imago, n° 59 (3), p. 317-338.
Liss, Andrea (1998), Trespassing through Shadows: Memory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Macdonald, Heidi (17 janvier 2003), « New BISAC category for graphic novels/comics », Publishers Weekly.
McCloud, Scott (mars 2007), « Interview with Hillary Chute », Believer, p. 80-86.
McCloud Scott (1993a), Understanding Comics: The Invisible Art. New York, Harper.
McCloud, Scott (1993b), « Scott McCloud: Understanding Comics », in Comic Book Rebels: Conversations with the Creators of New Comics, S. Wiater & S. R. Bissette (dir.), New York, Fine, p. 3-16.
McGlothlin, Erin (2003), « No time like the present: narrative and time in Art Spiegelman’s Maus », Narrative, n° 11 (2), p. 177-198.
McGrath, Charles (11 juillet 2004), « Not Funnies », New York Times Magazine, p. 24+.
Miller, Nancy K. (1992), « Cartoons of the self: portrait of the artist as a young murderer », M/E/A/N/I/N/G, n°12, p. 43-54.
Mitchell, William John Thomas (2003), « The commitment to form; or, Still crazy after all these years », PMLA, n° 118, p. 321-325.
Orvell, Miles (1992), « Writing post historically: Krazy Kat, Maus, and the contemporary fiction cartoon », American Literary History, n° 4, p. 110-128.
Reid, Calvin (23 décembre 2002), « D&Q Heads BISAC, Bookseller Efforts », Publishers Weekly. URL : https://www.publishersweekly.com/pw/print/20021223/19013-d-amp-q-heads-bisac-bookseller-efforts.html
Rosen, Alan (1995), « "The language of survival: English as metaphor on Art Spiegelman’s Maus », Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, n° 15, p. 249-262.
Rothberg, Michael (1994), « "We were talking Jewish": Art Spiegelman’s Maus as "Holocaust" Production », Contemporary Literature, n° 35, p. 661-687.
Sabin, Roger (1993), Adult comics: an introduction, New York, Routledge.
Sacco, Joe (2001), Palestine, Seattle, Fantagraphics.
Sacco, Joe (2000), Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia, 1992–95, Seattle, Fantagraphics.
Said, Edward (2001), « Homage to Joe Sacco », in Palestine, J. Sacco, Seattle, Fantagraphics, p. i-v.
Said, Edward (1985), After the Last Sky: Palestinian Lives, Photographies par J. Mohr, New York, Pantheon.
Satrapi, Majane (2002), Persepolis: The story of a childhood, New York, Pantheon.
Schmitt, Ronald (1992), « Deconstructive Comics », Journal of Popular Culture, n° 25 (4), p. 153-161.
Smolderen, Thierry (6 décembre 2007), « Why the brownies are important», Coconino World.
Spiegelman, Art (1994), The Complete Maus, CD-ROM, New York, Voyager.
Spiegelman, Art (automne 2005), « Ephemera vs. the Apocalypse », Indy Magazine. URL : http://web.archive.org/web/20080615145704/http://64.23.98.142/indy/autumn_2004/spiegelman_ephemera/index.html
Spiegelman, Art (1995), « Interview with Gary Groth », Comics Journal, n°180, p. 52-106.
Spiegelman, Art (1991), Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began, New York, Pantheon.
Spiegelman, Art (1986), Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History, New York, Pantheon.
Staub, Michael E . (1995), « The Shoah goes on and on: remembrance and representation in art Spiegelman’s Maus », MELUS, n° 20 (3), p. 33-46.
Varnum, Robin & Christina T. Gibbons (dir.) (2001), The Language of Comics: Word and Image, Jackson, University press of Mississippi.
Ware, Chris (2000), Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, New York, Pantheon.
Wertham, Fredric (1954), Seduction of the Innocent, New York, Rinehart.
Wheeler, Doug, Robert L . Beerbohm & Leonardo De Sá (2003), « Töpffer in America », Comic Art, n° 3, p. 28-47.
White, Hayden (1992), « Historical emplotment and the problem of truth », in Probing the Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution", S. Friedlander (dir.), Cambridge, Harvard University Press, p. 37-53.
Willems, Philippe (2007), « Form(ul)ation of a novel narrative form: nineteenth-century pedagogues and the comics », Word and Image, n° 24, p. 1-14.
Young, James E. (1998), « The Holocaust as vicarious past: Art Spiegelman’s Maus and the afterimages of history », Critical Inquiry, n° 24, p. 666-699.
Références additionnelles pour la version française
Baetens, Jan (1998), Formes et politique de la bande dessinée, Bruxelles, Peeters.
Baetens, Jan & Hugo Frey (2015), The Graphic Novel. An Introduction, New York, Cambridge University Press.
Baroni, Raphaël (2018) « Le chapitrage dans le roman graphique américain et la bande dessinée européenne : une segmentation précaire », Cahiers de narratologie, n° 34.
URL : http://journals.openedition.org/narratologie/8594
Burns, Charles (2006), Black Hole, Paris, Delcourt.
Clowes, Daniel (1999), Ghost World, Paris, Vertige Graphic.
Eisner, Will (2004 [1978]), Un Pacte avec Dieu, Paris, Delcourt.
Joyce, James (1948 [1922]), Ulysse, Paris, Gallimard.
Kovaliv, Gaëlle & Olivier Stucky (2019), « A Bilingual Lexicon for a Functional Analysis of Basic Elements of Comic’s Language / Un lexique bilingue pour une analyse fonctionnelle des éléments fondamentaux du langage de la bande dessinée », Image & Narrative, n° 20 (3), p. 91-107.
URL : http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/2305
Kukkonen, Karin (2013), Studying Comics and Graphic Novels, New York, Wiley-Blackwell.
Lesage, Sylvain (2018), Publier la bande dessinée. Les éditeurs franco-belges et l'album, Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB.
Marion, Philippe (2018), « Les stratégies du chapitre en BD reportage », Cahiers de narratologie, n° 34. URL : https://journals.openedition.org/narratologie/9085
Marion, Philippe (1993), Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur la bande dessinée), Louvain-la-Neuve, Academia.
McCloud, Scott (2008), L’Art invisible, Paris, Delcourt.
Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.
Robert, Pascal (2018), La Bande dessinée, une intelligence subversive, Villeurbanne, Presses de l’Enssib.
Rouvière, Nicolas (dir.) (2012), Bande dessinée et enseignement des Humanités, Grenoble, UGA Grenoble.
Sacco, Joe (2015), Palestine, Paris, Rackham.
Sacco, Joe (2004), Goražde : la guerre en Bosnie orientale (1993-1995), Paris, Rackham.
Satrapi, Majane (2007), Persepolis, Paris, L’Association, coll. « Ciboulette ».
Spiegelman, Art (2012 [2011]), MetaMaus, Paris, Flammarion.
Tabachnick, Stephen E. (dir.) (2009), Teaching the Graphic Novel, New York, The Modern Langage Association of America.
Töpffer, Rodolphe (1845), Essai de physiognomonie, Reproduit par Project Gutenberg Canada, n° 957. URL : https://www.gutenberg.ca/ebooks/toeppferr-physiognomonie/toeppferr-physiognomonie-00-t.txt
Ware, Chris (2002), Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth, Paris, Delcourt.
Pour citer l'article
Hillary Chute , "La bande dessinée est-elle de la littérature ? Lire les récits graphiques ", Transpositio, Traductions, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/la-bande-dessinee-est-elle-de-la-litterature-lire-les-recits-graphiques
Voir également :
Lire la littérature à l’école élémentaire en France
Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.
Lire la littérature à l’école élémentaire en France
Lire la littérature
à l’école élémentaire en France :
enjeux et débats au cours du XXe siècle
Durant tout le XIXe siècle, la littérature est fort peu présente dans les classes élémentaires de l’école primaire en France, il faut attendre la IIIe République pour qu’elle y fasse une entrée officielle (Chervel 2006). À partir de cette fin de siècle jusqu’à nos jours, la lecture des textes littéraires est durablement installée dans l’école élémentaire, mais elle répond à des enjeux et suscite des débats qui évoluent et se déplacent au fil des périodes. L’hypothèse de cette analyse est que la lecture des textes littéraires n’est pas un enseignement neutre, au contraire, s’y rattachent des finalités fortes mais qui ne sont pas toujours explicites. Ce que nous pouvons appeler le projet scolaire de formation du lecteur dépend de choix éducatifs et sociaux et même de conceptions de la démocratie variables selon les périodes. Il est possible de dire que c’est un objet scolaire qui a une fonction politique (au sens d’inscription de l’individu dans la cité). C’est également un enjeu culturel majeur qui suscite facilement des craintes et des résistances dans les périodes de changement.
Pour saisir ces variations, le croisement de deux approches est nécessaire. D’une part, une investigation didactique permet de saisir comment la lecture des textes littéraires se scolarise, par quelles démarches, avec quels supports, grâce à quels corpus. D’autre part, une approche diachronique rend compréhensibles les contextes sociaux et politiques, les choix effectués, les débats et les enjeux de cette scolarisation. Cette double démarche méthodologique que j’ai qualifiée de didactique historique en français (Bishop 2013), permet de percevoir les finalités attachées à la scolarisation des savoirs et de saisir les transformations liées à des redéfinitions plus ou moins explicites de ces finalités par l’école et la société. Grâce à cette approche, il est possible d’aborder la scolarisation des objets scolaires selon les différentes configurations de la discipline (Reuter & Lahanier-Reuter 2004), comme une organisation de modèles, c'est-à-dire comme des données historiques et disciplinaires qui dépendent des contextes sociaux, des théories disciplinaires sous-jacentes, des prescriptions officielles, des pratiques préconisées et réelles. Ces modèles ne peuvent être datés de manière précise car ils évoluent, changent et ne disparaissent que très progressivement. Le plus souvent, ils se juxtaposent et les plus anciens ne sont que lentement abandonnés dans les pratiques. Cette coexistence crée des effets de feuilletage et de sédimentation (Schneuwly & Dolz 2009). Trois modèles peuvent aider à décrire les différents moments de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire en France. Le premier est celui qui s’installe sous la IIIe République et qui persiste sous la IVe République, il s’agit du modèle fondateur de cet objet scolaire. Le second modèle est celui qui, au moment de la rénovation et de la massification de l’enseignement nait de la remise en question du précédent. Le dernier qui semble émerger à la fin du XXe siècle est le modèle actuel, modèle dominant, nourri des apports d’une didactique qui se constitue.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, ne seront évoquées que les classes de l’école élémentaire, relevant du secteur public, même si, parfois, il est fait référence de manière globale à l’ordre primaire, jusqu’en 1959.
Le modèle fondateur de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire
Introduire la littérature
Le 28 mars 1882 est publiée la Loi sur l’enseignement primaire obligatoire, signée du président Jules Grévy et du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry. Pour la première fois est défini un programme national qui comprend «La langue et les éléments de la littérature française». Accoler ces deux termes n’est pas un hasard, le rôle de la littérature est d’apporter une alternative à l’étude de la langue. Déjà en 1866, Victor Duruy alors ministre sous le Second Empire prend acte dans une circulaire de l’échec de l’enseignement de la langue apprise comme une langue morte par mémorisation et répétition de définitions. Influencé par les écrits du Père Girard (1844) et par les conceptions d’Octave Gréard, directeur de l’Instruction primaire de la Seine depuis 1865, il préconise de réduire l’enseignement grammatical à quelques définitions simples et courtes et à quelques règles fondamentales. Mais surtout, il propose pour la première fois de mettre les élèves «en présence des plus beaux morceaux de notre littérature» 1. Proposer la lecture des textes littéraires comme alternative à la grammaire constitue sans doute un événement majeur en ce milieu de siècle, qui se généralisera à la fin du XIXe siècle (Chervel 2006). C’est à partir de cette période que la lecture des textes va être peu à peu liée à l’étude de la langue et à sa maitrise. Se dessine ainsi ce qui va prendre forme sous la IIIe République, c'est-à-dire la jonction entre l’enseignement de la langue nationale et la littérature.
Toutefois, le projet républicain de la fin du XIXe siècle est beaucoup plus ambitieux et ambivalent, puisqu’il s’agit d’émanciper le peuple par l’éducation, tout en maintenant un ordre social respectueux des différentes classes, c'est-à-dire en conservant les finalités pratiques de l’enseignement primaire. Le but est d’instaurer une démocratie durable en mettant en œuvre un enseignement capable de former à la fois des travailleurs, des citoyens et des électeurs. Pour cela, il est nécessaire de développer, grâce aux textes littéraires, un fonds commun d’idées, de représentations et de valeurs laïques.
Le but de l’enseignement est l’édification du citoyen avec pour principal outil l’enseignement laïc de la morale, mais toutes les disciplines contribuent à cette éducation et la littérature va occuper une place centrale dans l’édifice. C’est là certainement l’une des grandes innovations des pédagogues de la fin du XIXe siècle: pour eux, la lecture des textes littéraires qui existe depuis longtemps dans les lycées et collèges peut être adaptée à l’école élémentaire et contribuer au projet d’éducation populaire.
Les fonctions de la littérature
Pour connaitre les différentes fonctions dévolues à la littérature dans le projet des républicains, il est possible de s’appuyer sur les écrits et les discours de trois acteurs majeurs de cette période. Le premier est Félix Pécaut à qui Jules Ferry propose en 1879 la direction de l’école normale supérieure d’institutrices de Fontenay aux Roses, poste qu’il occupera jusqu’en 1896. Le second est Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire à partir de 1879, puis détenteur de la chaire de pédagogie de la Sorbonne à partir de 1896 et surtout célèbre concepteur du Dictionnaire de pédagogie dont la première édition date de 1887. Notre troisième référence est naturellement Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, malgré quelques interruptions. Ces trois hommes vont défendre une certaine conception de l’école primaire, novatrice et laïque et introduire de manière durable la lecture des textes littéraires dans les classes de l’élémentaire. Leurs discours se croisent et se répondent, s’y dessine un projet politique et social d’édification par la littérature. Tous trois défendent comme principe que la littérature constitue l’un des piliers du projet éducatif des républicains, comme le rappelle F. Pécaut en 1872:
Il n'y a pas d'éducation sérieuse dont la littérature, c'est-à-dire la langue maternelle, l'étude des bons auteurs, les exercices écrits ou les morceaux de style, ne soit le fonds principal. (Pécaut 1881: 96)
Vont lui être dévolus différents rôles qui répondent aux finalités éducatives et politiques du projet d’éducation des classes populaires. Tout d’abord, la littérature occupe une place essentielle dans le processus de laïcisation de l’éducation et dans l’enseignement de la morale. Elle apparait comme un bien commun largement partagé (Chartier & Hébrard 2000) qui permet de conforter les valeurs morales autour d’une émotion esthétique séparée des principes religieux. Comme l’affirme Félix Pécaut:
Il reste à faire passer l’instruction de l’école dans les mœurs, de l’enfance dans toute la vie; il faut de bons livres et le gout de les lire; il faut que cette instruction serve à former des esprits droits et sensés, à aiguiser la curiosité et aussi à la discipliner. (Pécaut 1881: 25)
Ensuite, la littérature permet de développer et d’élever la culture des classes populaires. Jusqu’alors, l’école apportait le strict nécessaire pour entrer dans la vie active, mais pour les républicains, l’école doit éduquer l’individu tout entier et lui fournir un ensemble de connaissances qu’il pourra développer tout au long de sa vie, comme l’affirme F. Buisson dans une conférence de 1883:
[La République] emploiera ces jeunes années à donner aux futurs citoyens, non seulement une instruction rudimentaire, mais tout un trésor d’idées et de sentiments qui feront le bonheur et la dignité de leur vie. (Buisson 1818: 20)
Le livre de littérature et le gout de lire sont les instruments nécessaires au développement d’une culture populaire, comme l’affirme Jules Ferry dans un discours aux directeurs d’école:
Veillez surtout à la culture générale. […] le meilleur service que vous puissiez rendre aux maitres adjoints et aux maitresses adjointes, et puis à vos élèves […] est de leur inspirer le gout de la lecture. Qu’ils aient des livres et qu’ils les aiment; laissez-leur le temps de lire; faites mieux, provoquez-les à lire. (Ferry 1895: 522-523)
La troisième fonction de la littérature est scolaire, car elle permet d’envisager autrement l’étude de la langue. À partir du début du XXe siècle, l’appareil didactique évolue dans les manuels et à la suite de la lecture des textes d’auteurs, divers exercices de langue apparaissent dont des rédactions sur des sujets simples, empruntés à la littérature et à la vie des élèves (Bishop 2010b).
Enfin, la littérature est associée à une conception rénovée du savoir lire. Prenant le contrepied des lectures ânonnantes des décennies précédentes (Chartier 2007), les républicains redéfinissent les objectifs de la lecture scolaire. Il ne s’agit plus de lire pour déchiffrer, mais de lire pour apprendre dans toutes les disciplines, pour comprendre et pour découvrir la littérature française, comme le rappelleront plus tard les programmes de 1923 2:
À l'école primaire, l'enseignement de la lecture sert à deux fins. Il met entre les mains de l'enfant l'un des deux outils - l'autre étant l'écriture - indispensables à toute éducation scolaire. Il lui donne le moyen de s'initier à la connaissance de la langue et de la littérature françaises. (Chervel 1995: t.2, 321)
Quelle littérature pour l’école élémentaire?
Dans le nouveau plan d’études de 1882, les maitres sont invités à lire deux fois par semaine des morceaux empruntés aux auteurs classiques, et ce dès le cours moyen.
Mais que faire lire à l’école élémentaire? Peut-on proposer les mêmes auteurs que dans le secondaire? Les élèves sont-ils en mesure de comprendre la littérature? Comment constituer un fonds littéraire spécifique? Ces questions soulèvent parmi les pédagogues un débat passionné dans les dernières décennies du XIXe siècle (Jey 2003). L’incapacité des élèves des écoles primaires à lire et comprendre les textes classiques apparait comme un frein au projet d’acculturation. Certains, parmi les plus engagés, à l’instar de Buisson, soulignent les limites d’une lecture des œuvres littéraires dans la formation des maitres. Voici ce qu’il écrit dans l’article «Analyse» du Dictionnaire de 1888:
Il manque à la plupart, à la presque totalité de nos élèves maitres une culture esthétique, une initiation littéraire suffisante pour apprécier pleinement les beautés des œuvres qu’on leur demande d’analyser. C’est là l’écueil inévitable; plus qu’aucune autre en Europe, notre littérature nationale est imprégnée, pénétrée, inspirée des souvenirs classiques, elle perd beaucoup de son charme et de son sens pour qui n’a pu passer par l’école de la Grèce et de Rome; or nos instituteurs ne savent ni latin ni grec: il ne faut donc pas se flatter de pouvoir les mettre en état de saisir et de gouter le parfum classique de notre littérature. (Buisson 1888: t.1, 78)
Mais pour résoudre cette difficile contradiction entre nécessité d’une lecture des œuvres littéraires et manque de culture classique, Buisson évoque la qualité des grands écrivains français « qui se sont assez rapprochés de la nature pour être éternellement compris et aimés de tous. ». Il propose de s’appuyer sur les émotions suscitées par ces chefs-d’œuvre et de veiller à « ne faire analyser que des œuvres susceptibles d’entrer dans l’éducation populaire, les plus simples, les plus humaines, les plus naturelles de toutes » (Buisson 1888 : 78).
La solution va donc résider dans le choix d’œuvres accessibles à tous les élèves de l’école primaire, œuvres simples dont maitres et élèves pourront saisir la qualité. Ce que Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction primaire appelle quelques années plus tard, dans une circulaire de 1890, non pas des humanités classiques, mais des «humanités françaises» 3, adaptées au public des écoles primaires.
De quelles œuvres sont constituées ces humanités françaises? Dans une analyse antérieure, cinquante manuels parus entre 1923 et 1995 ont été analysés (Bishop 2010a). À la suite de cette étude, il apparait sans surprise que les deux grands auteurs de la IIIe République sont incontestablement Victor Hugo et La Fontaine, suivis de Molière, qui demeure le seul représentant du trio du théâtre classique à l’école élémentaire (Molière, Racine, Corneille). Mais c’est principalement Victor Hugo qui s’affirme comme le grand auteur de l’école élémentaire et ce jusqu’au milieu du XXe siècle. De veine plus populaire que la Fontaine ou Molière, c’est celui qui est de loin le plus présent dans les manuels. On récite ses poésies morales ou patriotiques mais peu à peu, ses romans prennent une place importante dans les manuels et trois personnages, Cosette, Jean Valjean et Gavroche, vont devenir emblématiques de la culture populaire. Dès le début du XXe siècle, un autre auteur occupe l’une des premières places, il s’agit d’Alphonse Daudet. Également lu en 5e et 6e, il devient une référence de la littérature scolaire et l’un des grands classiques de l’enfance, prenant place dans le panthéon littéraire. Ses œuvres les plus reprises dans les manuels sont sans surprise La Chèvre de M. Seguin parmi Les Lettres de mon moulin, Le Petit Chose et Tartarin de Tarascon.
En-dehors de ces quatre auteurs, les éditeurs scolaires sélectionnent des écrivains du XIXe siècle ou du tout début XXe qui vont constituer le répertoire de la littérature scolaire jusqu’en 1972. Ils sont souvent choisis pour leur écriture classique et reconnue. Parmi eux se trouvent de nombreux académiciens (comme Anatole France, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Duhamel, Henri Troyat ou Maurice Genevoix.) D’autres sont également appréciés pour leurs poèmes édifiants comme Jean Aicard. Certains de ces auteurs décrivent un monde quotidien, (George Sand, Colette, Marcel Pagnol). Nombreux sont les récits situés à la campagne avec ses différentes activités: la chasse, les vendanges, les semailles, etc. Il s’agit de descriptions d’une vie rurale, familiale et laborieuse. On peut y voir la glorification des valeurs traditionnelle de la société française que souligne la forte présence des auteurs régionalistes (Thiesse 1991, 1997) tels que Edmond About, Joseph Cressot, Henri Pérochon, Joseph de Pesquidoux, André Theuriet, pour ne citer que quelques noms. Cette veine importante sous la IIIe République est renforcée par les prescriptions de Vichy et se poursuit encore sous la IVe République.
Une pédagogie de la lecture des textes littéraires
Les leçons de lecture des textes littéraires sous la IIIe République se déroulent selon le schéma en trois temps défini par les instructions officielles de 1923 2:
L'instituteur commencera par lire lui-même à haute voix, en indiquant par les variations de l'intonation les nuances de la pensée et du sentiment, le morceau qu'il veut faire expliquer. Il en fera trouver rapidement les intentions principales. Par des questions alertes et des explications sobres, il fera comprendre le sens des détails et sentir la beauté des expressions. Alors seulement il fera lire le texte à haute voix par des élèves, afin de s'assurer qu'ils en comprennent la signification et en apprécient la valeur. Il va de soi que cette valeur doit être incontestable. (Chervel 1995: t.2, 322)
La démarche se veut toujours identique: d’abord une lecture du maitre, suivie de l’explication des mots, des phrases et l’élucidation du sens, pour finir par la lecture expressive des élèves. Cette lecture expressive, qui ne concerne que les textes littéraires, constitue une véritable pédagogie de la lecture à l’école élémentaire, différente de l’explication de textes des classes du secondaire. Le but de cette démarche est de conduire les élèves à percevoir la beauté des œuvres en suscitant l’émotion esthétique:
Très simplement, [le maitre] suscitera l’émotion esthétique, sans théories abstraites, sans expressions tirées du vieux jargon de la rhétorique, par un simple appel au gout d’enfants dont les impressions sont naïves et dont le jugement n’a pas été formé. (Chervel 1995: t.2, 322)
La lecture n’est pas un événement isolé car tout l’enseignement du français s’organise dans les manuels à partir des textes découverts collectivement, grâce à un appareil didactique assez récurrent d’un manuel à l’autre. Les textes d’auteurs offrent des répertoires d’idées, des réflexions morales et un vocabulaire réutilisés dans les rédactions.
Ce modèle de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire fait preuve d’une belle longévité puisqu’il persiste, malgré les remises en question et débats, jusqu’aux années 1970. Dans son ouvrage Le français tel qu’on l’enseigne, publié en 1971, Frank Marchand entreprend de décrire ce qu’il appelle «le modèle pédagogique standard que l’on retrouve dans la plupart des écoles françaises.» (Marchand 1971: 16). Il constate que les pratiques et les manuels qu’il présente et analyse n’ont guère changé depuis la IIIe République et son constat est sans appel: «Depuis bientôt un siècle, la pédagogie du français à l’école primaire n’a donc fait pour ainsi dire, aucun progrès» (Marchand 1971: 13).
La lecture au moment de la démocratisation
Redéfinir le savoir lire au tournant du XXe siècle
L’arrivée de De Gaulle au gouvernement en 1958 marque un changement de politique scolaire important (Prost 1992). Deux réformes successives, le décret Berthoin en 1959 (qui prolonge la scolarité jusqu’à 16 ans) et le décret Fouchet-Capelle en 1963, institutionnalisent le principe d’un collège pour tous et modifient profondément le paysage scolaire français.
Cependant dans le domaine de l’enseignement de la lecture la question du modèle de lecteur à former commence à se poser beaucoup plus tôt. Comme le remarque A.-M. Chartier (2007), la lecture silencieuse apparait dès 1938 dans les instructions qui prescrivent pour le certificat d’études:
Au cours supérieur deuxième année, le programme prescrit explicitement la lecture silencieuse. Par ailleurs, le Conseil supérieur a voulu qu'à l'épreuve de lecture du certificat d'études, il fût accordé à l'enfant cinq minutes de préparation. Cette préparation ne peut consister qu'en une lecture silencieuse; il faut bien que les élèves y aient été d'avance exercés. Dès la classe du certificat d'études on se préoccupera donc de la lecture silencieuse. On ne peut lire intelligemment que si l'on embrasse rapidement des yeux le texte qu'on va lire. On ne peut lire à haute voix correctement les mots d'une phrase, couper cette phrase aux silences imposés par le sens, accentuer exactement les syllabes significatives, que si l'on a, par avance, saisi le sens de la phrase dans son ensemble. La voix est nécessairement devancée par les yeux. (Chervel 1995: t.2, 273)
Le problème que soulève ce texte est celui de la méthode de lecture: peut-on considérer que l’élève qui n’aborde jamais seul un texte, qui ne le découvre que par la lecture du maitre comprend ce qu’il lit? La lecture expressive permet-elle la compréhension?
Cette question prend une réelle importance au sortir de la Seconde Guerre, lorsque la reconstruction du pays nécessite de faire appel à une main d’œuvre plus qualifiée, capable de lire et de comprendre de manière autonome. Dès 1945, certainement sous l’influence des bibliothécaires selon Chartier et Hébrard (2000), les mentalités changent, la lecture personnelle n’apparait plus comme un risque pour les jeunes esprits et l’on voit naitre l’idée qu’elle peut avoir une valeur éducative. Mais ce principe ne pénètre pas immédiatement dans les discours officiels et il faut attendre la circulaire datée du 29 décembre 1956 sur la suppression des devoirs du soir pour que soit évoquée une lecture autonome, silencieuse, personnelle, distrayante et en même temps éducative.
La fin des années 1950 constitue un tournant dans la manière dont l’école définit le savoir-lire. Au cours de cette période se manifeste une évolution dans les attentes sociale vis-à-vis de la lecture et dans les finalités dévolues à la lecture des textes littéraires à l’école. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces changements.
Le premier est celui d’une demande sociale. La diffusion de plus en plus importante des livres et journaux dans les classes populaires en lien avec l’action militante de certains bibliothécaires (Butlen 2008) répand l’idée que la lecture est une pratique qui permet l’épanouissement et l’accès à la culture et qu’il est nécessaire de développer dès l’école primaire ce gout de la lecture.
Le second facteur de changement est lié à l’arrivée massive des écoliers dans les classes de 6e, dans le courant des années 1950. Le niveau de ces nouveaux élèves ne correspond pas aux attentes des professeurs qui déplorent régulièrement leur faible maitrise de la lecture. Les nouveaux collégiens, disent-ils, n’aiment pas lire et le plus souvent lisent mal ou ne savent pas lire. Et que leur reproche-t-on? D’avoir une lecture trop scolaire, c'est-à-dire d’être capables d’oraliser sans comprendre ce que dit le texte. La lecture expressive définie en 1923, ne répond plus aux exigences de la scolarité allongée. Pour savoir lire au-delà de l’école élémentaire, il faut être capable d’appréhender le contenu de n’importe quel écrit.
Ces reproches sont pris en compte par le ministère et en janvier 1958, des instructions 5 concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire sont publiées. Elles proposent une nouvelle définition du savoir lire scolaire en insistant sur la compréhension.
L’expression «savoir lire» a un sens au cours préparatoire; elle doit en avoir un autre au cours élémentaire, au cours moyen et dans la classe de fin d’études. Il convient de ne pas jouer sur les mots. Pour un élève de la grande classe, ce n’est pas «savoir lire» que de savoir déchiffrer péniblement un texte. Savoir lire, pour un candidat au certificat d’études primaires, c’est être capable de lire un texte – silencieusement ou à haute voix – à un rythme assez rapide pour que l’intelligence soit capable de saisir le sens, non d’un mot mais d’un groupe de mots. […] À une époque où évoluent si rapidement les techniques et les structures économiques et sociales, notre premier devoir est de donner à l’enfant le moyen, quand il aura quitté notre école, de se tenir au courant. Or ce moyen c’est de savoir lire – au sens où nous l’entendons. (Bulletin officiel 1958: 1103)
Ce texte remet en cause la pédagogie de la lecture expressive qui était le modèle dominant des IIIe et IVe Républiques. Le savoir lire, en 1958, nécessite de développer l’autonomie des élèves dans ce domaine et de s’assurer que le sens est saisi, comme le précise cette même circulaire:
L’exercice de lecture expressive n’a pas pour fin, on le sait, de dresser l’enfant à lire comme un acteur, mais seulement d’apporter la preuve qu’il comprend ce qu’il lit. Encore faut-il ne pas se laisser duper. Un enfant moyennement habile peut lire avec expression un texte qu’il ne comprend pas. (Bulletin officiel 1958: 1103)
Ces instructions instituent un changement important des pratiques de lecture. Celle-ci ne devrait plus être l’exercice collectif et oralisé des décennies précédentes, au contraire il est question de lectures personnelles et silencieuses, faites à la maison et restituées sous forme d’exposés et de discussions.
La lecture silencieuse et le plaisir de lire
Mais le grand changement va être la prescription de la lecture silencieuse qui advient quelques années plus tard, en décembre 1972, dans de nouvelles instructions. Ces textes s’inspirent de l’important travail de la Commission Rouchette qui a été mise en place en 1963 et reprennent une partie des propositions du Plan de Rénovation, rédigé en 1969. La conception de la lecture scolaire qui apparait à cette période se démarque totalement des prescriptions antérieures par trois aspects. Le premier est le constat de l’inefficacité des pratiques scolaires, ce que souligne le nombre important d’échecs scolaires et de redoublements. En effet, une enquête menée en 1967 6 chiffre à plus de 70% le nombre d’élèves 7 ayant redoublé au moins une fois au cours de la scolarité primaire, avec plus de 35% de redoublements au CP. Le second élément est que la compréhension des textes devient la finalité principale et qu’elle ne peut se réduire à l’oralisation. La nouvelle prescription insiste sur la nécessité de lire pour comprendre et ce dès le CP, car le principal problème des mauvais lecteurs en 6e est bien la difficulté à saisir le sens des textes. Dans les instructions de 1972, lire est défini comme la capacité à prélever les informations essentielles d’un texte au cours d’une lecture individuelle et silencieuse. La démarche de 1923 qui prônait la lecture à haute voix, expressive, et la répétition d’un même texte est définitivement abandonnée. Le dernier point est que les supports de lecture se diversifient, car il semble nécessaire de ne plus s’appuyer sur le seul corpus des textes littéraires reconnus. L’objectif, à partir de 1972, est d’être capable de tout lire. La lecture est présentée comme un acte de communication qui sert à s’informer, et à se distraire; sont donc privilégiés les textes issus de situations de communication concrètes et les ouvrages que les jeunes lecteurs pourront lire seuls.
Mais dans les faits, ces instructions de 1972 ne modifient que peu les pratiques de lecture à l’école élémentaire. C’est ce que révèle un rapport de 1985 8 demandé par le ministère sur l’enseignement du français: dans de nombreuses classes, c’est encore la lecture à haute voix qui tient fréquemment lieu d’unique pédagogie de la lecture.
Toutefois, ces instructions amorcent un grand changement dont les effets deviendront perceptibles quelques années plus tard. La lecture demeure une activité éducative mais ses finalités sont radicalement différentes. Il ne s’agit plus de partager dans une démarche collective l’admiration pour les œuvres, mais de satisfaire un plaisir qui ne peut se découvrir que dans des pratiques personnelles et silencieuses. Les deux objectifs de l’enseignement sont désormais de développer la motivation et le plaisir de la lecture.
Changement des corpus
Redéfinir le savoir lire et les finalités de la lecture entraine d’importantes modifications dans les corpus proposés par l’école. Entre 1970 et 1980 les listes d’auteurs mis à disposition dans les manuels changent. Plusieurs facteurs contribuent à ces modifications radicales.
Le premier est l’influence des mouvements pédagogiques qui considèrent la lecture comme un élément clé de l’éducation et de l’épanouissement des enfants, il s’agit du Groupe français d’Éducation nouvelle (GFEN), de l’Institut coopératif de l’école moderne fondé par Freinet (ICEM) et de l’Association française pour la lecture (AFL) pour n’en citer que trois. Ces mouvements n’accordent cependant pas tous la même importance à la lecture des œuvres de littérature en classe et c’est principalement l’AFL qui s’engage pour que les œuvres destinées à la jeunesse deviennent des supports de l’apprentissage de la lecture. La seconde cause de changement est la prise de conscience d’un rejet des œuvres littéraires classiques par les jeunes lecteurs et les risques de concurrence avec les nouveaux médias. Les gouts des élèves deviennent le critère de choix. Il ne s’agit plus d’imposer des lectures édifiantes choisies par le maitre, mais de proposer des ouvrages capables de susciter motivation et plaisir de lire. Le principe des lectures attractives, destinées au jeune public et d’accès facile apparait dans le Plan de Rénovation et sera repris dans les instructions de 1972.
Encore que le gout des enfants ne soit pas le seul critère, il est indispensable qu'ils se plaisent à lire les livres que nous choisissons pour eux. Des enquêtes diverses sur les gouts des enfants ont permis d'établir qu'ils préfèrent les livres captivants, amusants, les livres tonifiants où l'amitié, la sympathie, la solidarité jouent un grand rôle, les livres riches en aventure, qui leur donnent des informations vraies ou vraisemblables. Il serait inconcevable de n'en pas tenir compte, comme de ne pas attacher un prix particulier à la valeur humaine, à l'authenticité dans la réalité comme dans l'imaginaire, à la qualité de la langue comme de l'illustration.
L’étude déjà citée sur les corpus des manuels (Bishop 2010a) rend compte de ce changement et le palmarès des vingt auteurs les plus cités dans dix manuels édités entre 1972 à 1985 est significatif. On assiste d’abord à un déplacement des grandes figures littéraires de l’école laïque: Alphonse Daudet prend la tête du classement pour une dizaine d’années, Victor Hugo reste encore présent, mais Jean de La Fontaine est beaucoup moins cité.
Les thèmes qui organisent les lectures connaissent également de grands bouleversements, les saisons et les travaux sont remplacés par l’aventure et l’amitié. Saint-Exupéry qui aborde ces deux thèmes apparait en seconde position après Daudet, dans le palmarès de 1972-1985. On lit Le petit prince, et plus particulièrement le passage de la rencontre avec le renard. Les passages concernant les aventures aéronautiques de l’auteur sont nombreux, empruntés à Vol de nuit ou Terre des hommes. D’autres récits d’aventures vécues comme ceux du Commandant Cousteau, de Joseph Kessel, ou encore de Paul Émile Victor, de Frison-Roche, de Haroun Tazieff, de René Demaison et de Maurice Herzog figurent aussi dans plusieurs manuels. Leur point commun est le thème de l’aventure, du courage et du dépassement de soi. Les personnages et les auteurs sont considérés comme des héros modernes. Ces récits défendent certaines valeurs auxquelles l’école attache une importance morale, telles que le courage et la solidarité. En ce sens, l’édification par la littérature demeure une constante de la lecture à l’école même si elle adopte d’autres formes. Ces choix sont également à mettre en relation avec l’attrait pour la modernité, notion forte au cours de cette période. Il s’agit d’une modernité technologique et urbaine qui prend souvent l’avion comme symbole et qui explique la moindre présence des auteurs régionalistes. En effet, on ne retrouve plus que Joseph Cressot auteur du Pain au lièvre dont on continue à lire les souvenirs d’écolier campagnard. Cependant, de nombreux auteurs de la toute fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle demeurent dans le corpus scolaire. Il s’agit de Henri Bosco, Marcel Pagnol, Louis Pergaud, Jules Renard, qui tous mettent en scène des enfants, de même que des auteurs plus récents comme Joseph Joffo. Dans le même esprit, se rencontrent des romans qui décrivent l’amitié entre un enfant et un animal, c’est le cas des textes de René Guillot, auteur de Crin Blanc ou des textes de Joseph Kessel. C’est ainsi qu’une littérature qui s’adresse au jeune public s’installe véritablement, avec de plus en plus de contes et de récits écrits pour les enfants, comme les Histoires comme ça de Rudyard Kipling. La BD fait même une timide apparition avec des extraits d’Astérix ou de Tintin, malgré une certaine défiance vis-à-vis du genre.
La lecture des textes
Le changement de méthode institué par les textes officiels à partir de 1972 est radical, puisqu’il est préconisé une lecture individuelle et silencieuse. Dans les manuels ou fichiers, les textes sont accompagnés le plus souvent d’un questionnaire qui permet de vérifier la compréhension de l’élève. Les questions sollicitent un relevé d’informations portant sur les lieux, la temporalité, la chronologie, les agents et leurs principales actions. Les lectures sont souvent placées dans des ensembles thématiques qui permettent de croiser différents types de documents: récits, documentaires, publicités, etc. Les conceptions de la lecture comme traitement de l’information et l’ouvrage de Richaudeau sur la lecture rapide, daté de 1969, ont une influence certaine sur les conceptions de la lecture et on en trouve trace dans les préconisations officielles. Ainsi, les instructions de juillet 1980 9 pour les cours moyens présentent la lecture comme un prélèvement d’informations qui ne nécessite pas nécessairement une lecture exhaustive.
Savoir lire, c'est: - pratiquer naturellement et efficacement la lecture silencieuse, c'est-à-dire la vraie lecture, celle qui permet de comprendre le sens, sans s'attarder aux syllabations, en maitrisant assez les mécanismes et les techniques pour n'y recourir qu'à titre de contrôle ou de moyen d'élucidation. (Chervel 1995: t.3, 332)
La lecture doit être silencieuse pour permettre de comprendre et de prélever des informations. Les lectures privées d’œuvres complètes accessibles aux jeunes lecteurs sont encouragées, la littérature dépasse le cadre de la classe. Les instructions de 1985 vont renforcer le caractère culturel de la lecture en insistant sur le développement du désir de lire et sur la nécessaire fréquentation des livres, prônant que «lire c’est comprendre». Mais les limites de la lecture silencieuse apparaissent assez vite pour deux raisons, la première est la difficulté à contrôler les apprentissages des élèves, la seconde raison est sociale, il s’agit d’une remise en question de l’école lors de la prise de conscience du phénomène de l’illettrisme en 1984.
La didactique de la lecture des textes littéraires
La critique de la lecture silencieuse
Dès le milieu des années 1980, les résultats de l’école dans le domaine de la lecture sont dénoncés pour leur insuffisance. Deux rapports vont jouer un rôle important. Le premier, intitulé les Illettrés en France (Espérandieu et al. 1984), suscite une remise en question des méthodes scolaires. Ce rapport va déclencher un important courant de réflexion sur la lecture et provoquer une réflexion sur sa définition, son apprentissage et sur les dispositifs d’aide et de remédiation. Le second rapport, celui du recteur Migeon de 1989 (Ministère de l’Éducation nationale 1989), souligne les inadéquations entre «les attentes que suscite l’école et les résultats qu’elle obtient». Ce rapport dénonce les inégalités sociales et territoriales, les redoublements et les faibles acquis en lecture puisque, reprenant les résultats d’une enquête de l’AFL, il annonce que le nombre de lecteurs capables de comprendre ce qu’ils lisent est faible: 9% à l’entrée au collège et 19% en 3e.
Ces publications nourrissent et accompagnent de nombreux débats sur l’apprentissage de la lecture qui touchent principalement l’acquisition du lire-écrire et qui tentent de définir et de trouver un consensus sur ce qu’est la lecture et sur la meilleure manière de l’enseigner (Chartier & Hébard 2000). Le domaine est occupé par deux grandes familles de recherches. Les premières sont celles des innovateurs qui refusent les apprentissages trop mécanistes et restent méfiants face au décodage et à la lecture à haute voix. Les secondes sont celles des psychologues cognitivistes qui vont modifier profondément les conceptions du savoir lire en France. D’une manière générale, ces chercheurs remettent en question le modèle de la lecture silencieuse et plus particulièrement les approches idéovisuelles. Dès 1988, Liliane Sprenger-Charolles souligne dans sa thèse que les difficultés ne viennent pas de la compréhension mais d’un déficit de l’identification des mots, ce que les méthodes uniquement centrées sur la reconnaissance logographique ne peuvent améliorer. Au cours des Entretiens Nathan sur la lecture qui ont lieu les 10 et 11 novembre 1990 à Paris se côtoient les innovateurs et les cognitivistes. Les travaux de ces derniers apportent de nouveaux modèles qui mettent en lumière la complexité du processus de compréhension qui va être peu à peu envisagé comme un possible objet d’enseignement et d’apprentissage.
La didactique de la lecture des textes littéraires va naitre de ces débats car il apparait dans le courant des années 1990 que la seule fréquentation des livres ne suffit pas à mener les élèves vers le désir de lire et que la lecture silencieuse ne peut garantir des acquisitions définitives. De plus, les travaux anglo-saxons de psychologie cognitive conduisent à modifier les conceptions sur la compréhension en lecture et mettent en lumière les procédures mentales des lecteurs. Enfin, les théories littéraires sur la réception du texte et sur le rôle du lecteur dans l’activité interprétative vont entrer en collision avec les précédentes.
Le ministère rend compte de cette profusion de recherches et publie en 1992 une véritable mise au point théorique, il s’agit de La maitrise de la langue à l’école (Ministère de l’Éducation nationale 1992a) qui présente un état des lieux de la didactique du français, accompagné d’une bibliographie d’études portant sur la didactique du français entre 1980 et 1992. Mais sur les cent titres proposés treize seulement concernent la lecture des textes et l’activité du lecteur, parmi ceux-ci sept sont des ouvrages de sociologie et six seulement traitent de la littérature de jeunesse ou des activités de compréhension des textes dans une approche pédagogique ou littéraire. La didactique de la littérature est encore peu présente dans les travaux répertoriés. Les rédacteurs de l’ouvrage La maitrise de la langue à l’école envisagent la fréquentation des livres du patrimoine comme une nécessité et évoquent «l’initiation des jeunes lecteurs à la lecture littéraire» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) ainsi qu’une «pédagogie de la réception des textes» (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 124) pour laquelle il n’existe pas encore, en 1992, de méthode clairement définie sinon le souci de se démarquer des pratiques du second degré.
À l'école élémentaire, l'approche des grands textes ne relève ni de l'histoire littéraire ni d'une technique particulière de lecture (lecture expliquée, lecture méthodique, etc.). Elle se construit dans le cadre d'une connivence culturelle et émotive qu'il appartient à l'enseignant d'installer avec soin. (Ministère de l’Éducation nationale 1992a: 107)
La naissance de la didactique de la lecture des textes littéraires
Les groupes de recherche créés dans le courant des années 1970 par l’INRP pour accompagner le mouvement de rénovation du français suscitent un développement rapide des études de didactique de la langue maternelle, qui portent surtout sur l’oral, l’étude de la langue et l’écriture. Mais il faut attendre le début des années 1990 pour que soit posée la question de l’enseignement de la lecture des textes littéraires à l’école élémentaire.
Cependant différentes approches existent déjà, elles vont servir de base aux travaux ultérieurs. Un premier domaine d’investigation est linguistique ou psycholinguistique. Il s’agit d’une réflexion sur l’utilisation des typologies textuelles comme outil de lecture. Ce sont, entre autres, les travaux des revues Pratiques et du Français aujourd'hui, à partir de 1984 avec des articles de Brigitte Duhamel, de Bernard Schneuwly, Jean-Paul Bronckart ou Jean-Louis Chiss, et d’autres encore. Un autre courant plus pédagogique est issu des mouvements qui promeuvent la littérature de jeunesse comme support éducatif. Ces recherches sont proches ou issues des mouvements pédagogiques comme l’AFL ou le GFEN, des associations de défense des livres de jeunesse, ou des groupes de bibliothécaires comme L’Heure Joyeuse. Les publications qui proposent des activités concrètes à partir de titre d’ouvrages paraissent à partir de 1985, signées de Jean-Claude Bourguignon, Rémy Stoecklé, Josette Jolibert, Bernard Devanne, Jean Perrot, pour ne citer que quelques noms. Un dernier courant s’intéresse davantage à l’histoire et aux relations entre école et littérature, on peut citer l’ouvrage de Francis Marcoin, À l’école de la littérature, paru en 1992.
Mais c’est réellement à partir de 1995 que des travaux vont tenter de définir des modèles didactiques de lecture des œuvres littéraires, en utilisant les amorces de recherches citées précédemment. Le n°13 de la revue Repères, publié en 1996 sous la direction de Catherine Tauveron et Yves Reuter témoigne de ce souci de formaliser ce qui commence à se dessiner dans le champ de la didactique, puisqu’il propose, en introduction, de «problématiser l’enseignement/apprentissage de la littérature à l’école élémentaire et de construire des propositions pour une didactique de la littérature à l’école» (Tauveron & Reuter 1996: 13).
Mais les auteurs reconnaissent que la tentative est précoce et «audacieuse», que le domaine est encore bien peu exploré et que les travaux gardent une dimension spéculative. Cependant, très rapidement l’espace va se remplir. L’institutionnalisation de la littérature dans les instructions de 2002 et la mise en place d’une épreuve orale spécifique au concours de professeur des écoles en 2005 développent un courant de recherches et de formation prolifiques. Certains travaux spécifiques comme ceux de Catherine Tauveron (Tauveron 2002) ont une forte influence sur l’ensemble de la communauté éducative et ont certainement irrigué les instructions de 2002.
Lire des textes littéraires
La lecture des textes littéraires à l’école élémentaire se développe en lien avec l’évolution des enjeux sociaux à l’aube du XXIe siècle. Il s’agit d’éviter les clivages culturels et d’utiliser la littérature comme ciment de la communauté nationale. L’introduction des instructions de 2002, signées du ministre Jack Lang, est significative de ce phénomène. Le thème de la culture commune, fondement d’une langue commune, est largement présenté et la relation entre inégalités sociales et inégalités culturelles institue la littérature comme l’un des principaux moyens que possède l’école pour dépasser ces inégalités:
L’inégalité sociale, nous le savons est d’abord une inégalité culturelle: c’est à l’école qu’il appartient de réduire cette distance par rapport au savoir et à la culture. (Ministère de l’Éducation nationale 2002b: 8)
Ce partage d’une culture commune se produit grâce à la connaissance d’œuvres patrimoniales contribuant à ressouder une communauté autour de la littérature.
Le but des instructions de 2002 est d’instituer une pédagogie de la lecture littéraire spécifique pour l’école primaire, libérée du modèle secondaire de type explicatif. Cette lecture est conçue comme une activité interprétative, et pour la première fois, l’objectif n’est plus seulement de s’assurer de la compréhension des textes. Les instructions de 2002 tentent d’instituer un lecteur spécifique, lecteur interprète, dans une approche inspirée des théories de la réception. La nouvelle didactique de la lecture littéraire s’appuie sur des pratiques pédagogiques qui vont connaitre un certain succès auprès des enseignants. Il s’agit des lectures en réseaux, fondées sur le principe de l’intertextualité et des débats interprétatifs qui font de la lecture une activité partagée et socialisante devant permettre de fonder une communauté de lecteurs. Les liens entre lecture et écriture sont renforcés par la tenue de carnets de lecture, recommandés par les instructions.
De plus, l’activité intertextuelle et interprétative suppose un corpus de textes « ouverts à interprétation ». Pour l’école élémentaire, ces textes sont systématiquement choisis dans la littérature de jeunesse, considérée à l’égal de la littérature adulte dont elle possèderait toutes les caractéristiques. Les ouvrages de jeunesse sont proposés dans trois listes publiées en 2002, 2004 et 2007 et servant de référence tant pour les enseignants que pour les éditeurs. Là encore il s’agit d’une première fois : le ministère n’avait jusqu’alors jamais publié de liste pour les niveaux élémentaire ou maternelle du primaire.
Les corpus proposés par les manuels se modifient dès 1985. Selon l’étude de 2010 déjà évoquée (Bishop 2010a), nous pouvons remarquer que les corpus scolaires évoluent rapidement entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, ils présentent quatre caractéristiques nouvelles. La première est l’entrée massive de la littérature de jeunesse dans les manuels, dès 1985, avec des auteurs dont une grande partie de l’œuvre est dédiée à la jeunesse tels que Michaël Morpurgot, Anthony Horowitz, Roald Dahl, Gianni Rodari, Evelyne Brisou Pellen, Bernard Friot, Pierre Gripari, Dick King-Smith, pour ne citer que quelques noms. Le second élément est la disparition des auteurs du XIXe siècle. Ils sont remplacés par des œuvres appartenant à un patrimoine national ou mondial, où les contes et les fables retrouvent une place de choix: Grimm, Perrault, Andersen, Mme Le Prince de Beaumont, La Fontaine, Ésope, etc. Un troisième élément est la présence importante de la poésie, considérée comme un objet littéraire en soi et non uniquement comme support de récitation. La poésie est proposée pour être dite, créée, écoutée, imitée. Les auteurs fréquemment mentionnés s’adressent à un jeune public. Il s’agit, entre autres de Claude Roy, Pierre Gamarra, Maurice Carême, Jacques Charpentreau, Georges Jean, etc. Le quatrième et dernier point est l’ouverture des corpus: la littérature donnée à lire dépasse le cadre des frontières et s’internationalise. Les œuvres étrangères, traduites ou francophones, représentent près de 40 % de l’ensemble des titres proposés dans les listes ministérielles de 2002 et 2004 (Bishop & Ulma 2007). Mais ces textes sont lus avec des objectifs littéraires tels que la connaissance des personnages ou l’intertextualité. À la fin du XXe siècle, l’école institue un nouvel ensemble d’œuvres à lire dans les classes qui deviennent des classiques de la jeunesse. Ces corpus répondent aux finalités culturelles, sociales, éducatives, patrimoniales et littéraires que la société semble assigner à la lecture des œuvres littéraires à l’école élémentaire.
Pour conclure, il est possible de remarquer que, au cours des différentes périodes évoquées, la lecture des textes littéraires à l’école primaire a été fortement marquée par les contextes sociaux et politiques et par le projet éducatif attaché à l’école élémentaire. Cette activité a été maintes fois l’objet de débats et d’enjeux. L’une de ses caractéristiques est d’avoir toujours tenté de se dégager du modèle du secondaire, et il n’a jamais été envisagé de transmettre des savoirs sur la littérature ou sur son histoire, ni de pratiquer des explications littérales des textes. Au contraire, depuis la IIIe République, on s’efforce de mettre en place une pédagogie de la lecture des textes littéraires qui soit spécifique au public des écoles primaires. Mais surtout, avant 2002, la littérature ne constitue pas un objet d’enseignement, il n’y a pas d’éléments littéraires à enseigner. On enseigne la lecture des textes littéraires, mais jamais la littérature en soi. C’est à partir des instructions de 2002 que la lecture littéraire est instituée par les textes officiels avec des objets et des démarches particuliers. Cette didactique de la littérature à l’école élémentaire est récente, elle repose sur des procédures spéculatives qui relèvent de notre conception moderne de l’interprétation et de l’institution de l’élève comme individu autonome.
Bibliographie
Anonyme (1985) - Réflexions sur l’enseignement du français 1983-1985, Rapport de la Commission de Réflexion sur l’Enseignement du français, Angers, CNDP de Maine et Loire.
Bulletin officiel de l'éducation nationale, « Instructions concernant l’enseignement de la lecture à l’école primaire », n°14, 27 mars 1958, p. 1103.
Bishop, Marie-France & Dominique Ulma (2007), «Approche historique et comparatiste de la place de la littérature à l’école», in La littérature à l’école, enjeux, résistances, perspectives, M. Lebrun, A. Rouxel & C. Vargas (dir.), Aix en Provence, Publications de l’Université de Provence, 2007, p. 63-88.
Bishop, Marie-France (2010a), «Que lit-on à l’école primaire au cours du XXe siècle? Listes et corpus de textes de 1880 à 1995» in Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure, B. Louichon & A. Rouxel (dir.), Rennes, PUR, 2010, p. 139-152.
Bishop, Marie-France (2010b), Racontez vos vacances, Grenoble, PUG.
Bishop, Marie-France (2013), Statuts et fonctions de la mise en perspective historique dans la didactique du français, Mémoire d’habilitation, Lille, Université de Lille 3.
Butlen, Max (2008), Les politiques de lecture et leurs acteurs (1980-2000), Lyon, INRP.
Chartier, Anne-Marie (2007), L’école et la lecture obligatoire, Paris, Retz.
Chartier, Anne-Marie & Jean Hebrard, (1989), Discours sur la lecture. (1880-2000), Paris, Fayard (2e éd. : Fayard, 2000).
Chervel, André (1988), «Pour une histoire des disciplines scolaires», Histoire de l’éducation, n°38, p. 59-119.
Chervel, André (1995), L’enseignement du français à l’école primaire. Textes officiels, t.1-3, Paris, INRP.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Dufays, Jean-Louis, Louis Gemenne & Dominique Ledur (1996), Pour une lecture littéraire, Bruxelles, De Boeck (2e éd. : De Boeck 2005).
Espérandieu, Véronique, Antoine Lion & Pierre Bénichou (1984), Des illettrés en France. Rapport au premier ministre, Paris, La Documentation française.
Girard, Grégoire (1844), De l’enseignement régulier de la langue maternelle dans les écoles et les familles, Paris, Debrozy, E. Magdeleine et Cie.
Jey, Martine (2003), «La littérature, un objet ambigu» in D. Denis & P. Khan (dir.), L’école républicaine et la question des savoirs, Paris, CNRS, p. 79-102.
Ministère de l’Éducation nationale (1989), La réussite à l’école. Rapport du recteur Michel Migeon à Lionel Jospin, Paris, CNDP.
Ministère de l’Éducation nationale (1992a), La maitrise de la langue à l’école, Paris, CNDP, Savoir Lire.
Ministère de l’Éducation nationale (1992b), Qu’apprend-on à l’école élémentaire?, Paris, CNDP.
Prost, Antoine (1992), Éducation, société et politique, Paris, Seuil.
Reuter, Yves & Dominique Lahanier-Reuter (2004), Présentation de quelques concepts pour analyser l’écrit, St. Louis, Colloque Writing across the curriculum international.
Schneuwly, Bernard & Dolz Joachim (2009), Des objets enseignés en classe de français, Rennes, PUR.
Sprenger-Charolles, Liliane (1988), L'apprentissage de la lecture et de ses difficultés: contribution. Thèse soutenue sous la direction de Frédéric François, Paris 5.
Tauveron, Catherine (dir.) (2002), Lire la littérature à l’école, Paris, Hatier.
Tauveron, Catherine & Yves Reuter (dir.) (1996), Repères, n°13, «Lecture et écriture littéraire à l’école».
Thiesse, Anne-Marie (1991), Écrire la France, le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la belle époque et la Libération, Paris, PUF.
Thiesse, Anne-Marie (1997), Ils apprenaient la France, l’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Pour citer l'article
Marie-France Bishop, "Lire la littérature à l’école élémentaire en France", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/lire-la-litterature-a-l-ecole-elementaire-en-france
Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images
Pourquoi et comment enseigner la littérature aujourd'hui {{Mes remerciements à Sophie Queuniet, ainsi qu’aux lecteurs anonymes de cet article, pour leurs suggestions et retours, que je n’ai pas toujours pu développer suffisamment, faute de place.}} ? J’aborderai cette question à travers un grand écart instaurant une double distance envers la définition canonique de « la littérature », telle que cette définition s'est imposée dans nos cultures occidentales aux XIXe et XXe siècles. En aval de cette période, je réfléchirai à la façon dont les évolutions médiologiques des trois dernières décennies ont induit des pratiques interprétatives que nos catégories encore dominantes au sein de larges segments de l'université refusent souvent de reconnaître comme littéraires – alors qu’il me semble au contraire important d’y repérer une mutation de « la littérature » hors d’elle-même {{Sur ce point, voir Rosenthal & Ruffel (2010). }}. En amont, je remonterai brièvement à un usage du mot « littérature » qui était prévalente jusque vers 1750 – et qui peut, par-dessus les siècles, nous indiquer une direction d'avenir pour repenser la fonction des études de lettres.
Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images
Pourquoi et comment enseigner la littérature aujourd'hui 1? J’aborderai cette question à travers un grand écart instaurant une double distance envers la définition canonique de «la littérature», telle que cette définition s'est imposée dans nos cultures occidentales aux XIXe et XXe siècles. En aval de cette période, je réfléchirai à la façon dont les évolutions médiologiques des trois dernières décennies ont induit des pratiques interprétatives que nos catégories encore dominantes au sein de larges segments de l'université refusent souvent de reconnaître comme littéraires – alors qu’il me semble au contraire important d’y repérer une mutation de «la littérature» hors d’elle-même 2. En amont, je remonterai brièvement à un usage du mot «littérature» qui était prévalente jusque vers 1750 – et qui peut, par-dessus les siècles, nous indiquer une direction d'avenir pour repenser la fonction des études de lettres.
Ce grand écart quelque peu acrobatique trouve appui sur un certain nombre de théories des media malheureusement peu connues et peu diffusées dans le domaine francophone en général, et parmi ceux qui réfléchissent à la littérature et à sa didactique en particulier. La pertinence de ces théories ne prenant son sens qu'à la lumière des problèmes écopolitiques auxquels nous devons faire face à l'âge de l'anthropocène, je commencerai par quelques remarques très générales, avant de présenter très sommairement quelques idées-clés reprises de ces théories des media, qui me semblent indispensables pour articuler le problème central posé à l'enseignement de la littérature aujourd'hui, qui est précisément un problème de cadrage, c'est-à-dire d'adaptation à un certain contexte socio-historique, et plus particulièrement médiologique.
L'orientation générale de ce propos – qui relèvera donc plutôt de «prolégomènes» que d’un traitement direct et pragmatique des questions posées – visera à esquiver le double écueil de la lamentation catastrophiste et de la technophilie naïve qui se font fréquemment face dans les débats concernant ces problèmes. Les élégies sur la mort de la littérature et des lettrés, sur l'indifférence prétendue de «la jeunesse» envers «les classiques», sur la distraction abrutissante induite par les (in)cultures numériques – tout cela me paraît à la fois aussi (partiellement) fondé et aussi (largement) leurrant que les espoirs de voir chaque enfant muni d'une tablette profiter spontanément d'une intelligence collective sur laquelle il suffirait de se brancher à travers l’appareillage approprié (si possible user-friendly). Je suis convaincu que les expériences littéraires restent plus précieuses, plus nécessaires, et plus jouissives que jamais à l'ère des media numériques – pour peu qu'on apprenne à les chercher là où elles peuvent se trouver aujourd'hui, et pour autant qu'on se donne les moyens de les cultiver et de les valoriser comme telles.
Mon propos commencera donc par dresser un tableau très large de quelques grands bouleversements médiologiques repérables au cours du dernier siècle, avant de proposer quelques gestes par lesquels les études littéraires peuvent se repositionner dans les nouveaux contextes induits par ces bouleversements.
Figures d'écriture et retours de fond à l'âge de l'anthropocène
L'intuition de base développée, entre autres, par des penseurs comme Vilém Flusser (1920-1991) ou Friedrich Kittler (1943-2011) – approfondissant les formules lancées par Marshall McLuhan (1911-1980) dès les années 1960 et faisant échos parfois à une «médiologie» française qui s'est malheureusement développée dans un certain isolationnisme national – est qu'une nouvelle culture a commencé à se déployer à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'impulsion de l'invention et de la diffusion des moyens techniques d'enregistrement automatique de l'image (photographie) et du son (phonographe). Le nouvel «univers des techno-images» 3, qui a mis plus d'un siècle à s'imposer progressivement, qui devient clairement hégémonique depuis quelques décennies, mais dont nous commençons à peine à entrevoir les conséquences, se comprend par contraste avec la phase précédente, qui se caractérisait par une domination de l'écriture, qui a elle aussi mis plusieurs siècles à s'infiltrer dans nos pratiques, et qui continue bien entendu à les structurer en profondeur.
Dans la description qu'en donne Flusser, le régime historique de l'écriture se caractérise par la réduction de la complexité de nos perceptions du réel à un défilement linéaire de symboles alphabétiques, conçus pour manifester des rapports de causalités également formalisés comme linéaires. L'énorme puissance de l'écriture, remarquablement analysée par Michel de Certeau dans «L’économie scripturaire» (1990: 195-224), tient à ce qu'elle nous donne une emprise pratique considérable sur le façonnement de notre réalité, en faisant passer celle-ci par le fil de causalités linéaires sur lesquelles nous pouvons agir après les avoir isolées et identifiées comme telles.
Cette opération fondamentale assurée par l'écriture ne date bien entendu pas de la modernité. Toutes les cultures écrites ont formalisé des chaînes de causalité de façon à pouvoir intervenir sur elles. À travers son idéal et son idéologie de «la science», la modernité a seulement poussé à ses extrêmes conséquences cette virtualité possible du régime de l'écriture: n'existe «réellement» pour nous aujourd'hui que ce qui peut être transcrit à travers des séquences linéaires d'enchaînements causaux. Cet énorme travail d'élucidation des relations de causalité mené depuis des siècles s'appuie sur au moins deux types de réduction qui apparaissent aujourd'hui dans toute leur clarté.
D'une part, le règne de l'écriture linéaire présuppose l'isolation de certaines chaînes causales au sein du tissu complexe de multi-causalités qui trame nos existences quotidiennes: c'est le travail qu'on mène dans des laboratoires, dont la fonction est justement d'isoler certains fils, séparés de façon parfaitement artificielle du tissu de corrélations causales au sein desquelles ils opèrent à l'extérieur des murs aseptisés du laboratoire. D'autre part, de façon intimement liée au point précédent, ce règne s'appuie sur tout un travail souterrain d'analyse segmentant les objets composés en objets composants, selon des opérations de discrétisation (ou de «grammatisation») qui se sont imposés aussi bien à la physique (les particules) et à la chimie (le tableau des éléments) qu’à la biologie (l'ADN) et à la linguistique (les unités de base), aboutissant à des «éléments» discrets, censés être «premiers», dont les multiples recombinaisons permettront de récréer le monde «par synthèse».
D'un point de vue phénoménologique, tout ce processus consiste à isoler des figures au sein d'un fond (en fonction de la pertinence des traits envisagés selon les observations de causalités), pour analyser ces figures en éléments minimaux (générant par grammatisation l'alphabet du domaine envisagé), de façon à pouvoir produire de nouvelles figures (selon des procédures de recombinaisons synthétiques), plus désirables que celles offertes spontanément par la nature. Comme l'avait bien relevé Gilbert Simondon dès 1958 avec sa description Du mode d'existence des objets techniques, cette attitude focalisée sur l'identification, l'analyse et la recombinaison de figures tend à laisser dans l'ombre le statut et le rôle des fonds, dont la prise en charge incombait aux religions qu’une certaine modernité a reléguées au domaine des superstitions – comme si la perception (généralement «intuitive») de ces phénomènes de fond, n'avait pas son importance dans la façon dont les subjectivités humaines s'orientent dans l'existence 4.
Au moment où de plus en plus larges segments de nos populations humaines commencent à prendre une conscience de plus en plus vive de «l'événement anthropocène» 5 – c’est-à-dire du changement de perspective induit par notre prise en compte des dommages irréparables infligés à notre environnement planétaire (biologique, géologique, climatique) par la furie productiviste caractéristique de la modernité industrielle – une fierté légitime envers les gains de maîtrise acquis grâce à ces procédures d'écriture ne peut plus s'aveugler aux conséquences fâcheuses, voire catastrophiques, entraînées par la domination exclusive de ce mode opératoire. Face à des problèmes locaux comme l'amiante, face à des hydres incontrôlables comme le nucléaire ou les pesticides, ou face à des emballements globaux comme le dérèglement climatique, force est de constater la pauvreté des lignes de causalités analysées et recomposées dans nos laboratoires par notre façon linéaire d'écrire le monde en régime de modernité impérialiste et extractiviste. Notre ignorance du fond environnemental sur lequel s'inscrivaient les figures que nous y avons isolées (par analyse causale, grammatisation et recombinaisons de synthèse) se paie au prix d'un retour potentiellement très douloureux (pour nous humains) de ce fond imprudemment refoulé 6. Le règne moderne des figures – dont la science économique orthodoxe assure aujourd'hui l'emprise en imposant la loi des seules figures chiffrées, désormais traitées à la vitesse de la lumières par les algorithmes du high-speed trading – s'avère de moins en moins soutenable face à la multiplication des retours de feu que sont les retours de fond sous leurs multiples formes, depuis la fonte des glaciers, le dégel du permafrost, la pollution atmosphérique des villes chinoises, jusqu'au regain de vigueur des courants les plus intégristes de certaines pratiques religieuses.
Pratiques artistiques et critique de l'immédacie
Chacun à sa façon, Marshall McLuhan, Vilém Flusser et Friedrich Kittler nous invitent à sortir de l'aveuglement qui caractérise notre rapport habituel aux media, entendus ici dans leur sens le plus large, celui des médiations qui assurent les communications entre les différents composants de notre monde humain. En affirmant que «le message, c'est le medium lui-même» ou que les media constituent un environnement que nous ne voyons pas davantage que l'air que nous respirons, le premier ouvrait une brèche où se sont engagés les seconds, lorsqu'ils soulignent à quel point nos subjectivités se trouvent aujourd'hui intimement programmées par les appareils dont nous croyons nous servir, alors même qu'ils sont en passe de nous asservir. Leurs enseignements les plus fondamentaux peuvent se formuler en quatre propositions qu'ils formulent tous trois avec leurs nuances propres.
1. En même temps qu'il semble parachever le règne de l'écriture linéaire, l'avènement du numérique risque (ou permet) d'en miner les bases, en nous immergeant dans l'univers analogique des techno-images. La numérisation en cours de notre monde matériel et mental constitue bien entendu le triomphe des opérations d'écriture linéaire qui ont assuré la puissance de la modernité. Tout se voit analysé (grammatisé) en ces unités de base que sont le 0 et le 1, à partir desquelles différents algorithmes s'efforcent à la fois de formaliser les chaînes causales observées dans la réalité et de créer de nouvelles figures de synthèse par le jeu des recombinaisons.
Tout cela repose bien entendu sur des procédures d'écriture de programmes logiciels qui restent de nature linéaire (sur le mode si... alors...). Cette réalité du fonctionnement profond des appareils numériques ne doit toutefois pas cacher leurs effets de surface, qui est de permettre aux humains de communiquer directement entre eux par l'enregistrement et la transmission de blocs de perceptions sensorielles captés par des appareils court-circuitant l'intervention d'une subjectivité. La nouveauté de ces «techno-images» (photographies, enregistrements sonores, cinéma, vidéo) est en effet que, contrairement à ce qui se passait depuis l'époque de la Grotte Chauvet jusqu'au début du XIXe siècle, des appareils peuvent saisir, enregistrer et communiquer automatiquement des blocs de perceptions qui n’ont pas été préalablement filtrés par une subjectivité humaine (celle de l’écrivain, de l’enseignant, du peintre, du musicien, etc.). Même si, bien entendu, un humain doit poser un appareil photo devant une certaine portion de réalité, choisir un certain cadrage, une certaine focale, un certain temps d'exposition, etc., lorsqu'il appuie sur le déclencheur, l'appareil capte tout ce qui est dans son champ en court-circuitant tout filtre subjectif humain. Il en va de même pour l'enregistreur de sons, pour la caméra du cinéma ou de vidéo (ainsi d’ailleurs que pour les transactions du high-speed trading, qui opèrent sur des chiffres plutôt que sur du sensible). Une des particularités de nos nouveaux gadgets numériques est justement d'automatiser intégralement ces processus de captations de perceptions sensibles, en laissant les appareils faire tous les réglages à la place des humains.
Une première conséquence de notre immersion dans un univers de techno-images est que nous pouvons désormais communiquer directement par des transmissions d'images-sons captées automatiquement par des appareils – comme lorsque nous voyons en direct sur CNN des bombes occidentales frapper une ville comme Bagdad, ou lorsque des Africain-Américains peuvent diffuser sur Internet des scènes de brutalités policières, dynamisant le mouvement Black Lives Matter. La grammatisation intégrale de nos perceptions en séquences algorithmées de 0 et de 1 court-circuite (apparemment) l'intervention d'un travail subjectif d'écriture, permettant de nous affecter «immédiatement» par des captations automatiques de blocs de réalité perçus par nous sur le mode analogique (imaginaire) du continu, plutôt que sur le mode linaire (symbolique) du numérique ou «digital». Cette numérisation s’inscrivant par ailleurs dans un régime mass-médiatique (qu’elle altère profondément quoique marginalement), elle renforce une situation déjà dénoncée par Adorno, Debord ou Baudrillard dès la seconde moitié du XXe siècle, où, au sein de nos régimes marchands et électoraux structurés par les mass-médias, n'existe «effectivement» que ce qui peut être transmis à travers des images et des récits frappants.
2. En tant qu'elles relèvent de modes de perception analogiques, les techno-images sont porteuses d’un inévitable «bruit», qui communique un «fond» en excès sur le signal-figure visé par l'acte de communication. Friedrich Kittler aimait à rappeler que c'est le gramophone qui a rendu possible l'apparition du «bruit» comme objet de perception humaine. La particularité de la captation automatique pratiquée à travers les appareils est justement de ne pas sélectionner «subjectivement» ce qui est saisi (enregistré/transmis). Anything goes : tout passe. C'est ce qui fait la difficulté d'un tournage de film (argentique) en extérieur: un bruit d'avion, un lapsus de l'acteur, un fil électrique en arrière-plan, quoique non voulus par le réalisateur, se trouvent fixés sur la pellicule une fois pour toutes – sans que la distinction fondamentale entre ce qui est visé (le «signal» intentionnel) et ce qui le parasite (le «bruit») ne soit pertinente du point de vue de l'appareil.
Dans le domaine de la musique – en particulier de la musique «noise», depuis John Cage jusqu'aux drones («bourdonnements») de guitares en distorsion – comme dans celui des théories esthétiques 7, cette capacité des appareils à saisir et à transmettre du bruit est de la première importance: elle réinjecte du «fond» en excès sur les figures isolées par les intentions humaines. En même temps qu'il assure un triomphe de la grammatisation, le déploiement des techno-images numériques permet donc un retour du fond analogique qui hante (et enrichit) nos perceptions des figures au sein de l'univers matériel 8.
3. En proportion de l’amélioration de la définition des techno-images qui circulent entre nous, s'accroissent l'impression de transparence et l'illusion d'immédiacie qui dominent notre rapport aux appareils de médiation. Vilém Flusser est l'un des premiers à avoir pris la mesure des enjeux de la présence cachée des programmes sous la surface des illusions d'immédiacie donnée par les techno-images. Lorsque je crois voir des bombes qui s'abattent sur une ville ou un policier brutalisant un concitoyen africain-américain, j'ignore le très grand nombre de médiations qui ont rendu possibles la captation et la diffusion de ces techno-images. Flusser montre que lorsque nous prenons une photo, ce sont les ingénieurs qui ont développé l'appareil, les marketeurs qui en ont diffusé l'usage, les circuits de circulation des clichés commandant nos attentes et nos goûts esthétiques qui prennent la photo – bien davantage que notre singularité individuelle 9. Plus l'appareil dont on se sert est apparemment simple à utiliser, plus nombreux sont les programmes (et les réseaux) qui en conditionnent l'usage en sous-main, et plus ce sont ces programmes, censés nous servir, qui se servent de l'utilisateur pour se répandre dans nos usages sociaux.
Flusser et Kittler (et avec eux la grande majorité des théoriciens et archéologues des media) nous appellent donc à un recul critique face à l'impression de transparence (ou d’«immédiacie»10) véhiculée par certains media. Contrairement aux discours vulgaires sur «la civilisation de l'image», ils soulignent que le danger n'est pas à situer dans les techno-images elles-mêmes, mais dans l'illusion d'immédiacie qu'elles peuvent contribuer à répandre, ainsi que dans les différents types de «modes protégés» qui rendent opaques les programmations opérées par les médias 11. Leur travail consiste non pas à dénoncer le règne des images, mais à faire mieux comprendre et mieux sentir les procédés d'écriture sous-jacents à nos modes de perception et de communication.
4. Ré-envisagées dans cette perspective, les pratiques artistiques et les pratiques herméneutiques convergent en faisant porter notre attention sur les médiations elles-mêmes, aidant ainsi à briser l'emprise de l'illusion d'immédiacie. Que l'on identifie toutes les pratiques artistiques à une attention portée sur le «style» du signal (sa «forme» propre) plutôt que sur son «contenu», ou que l'on réserve à l'art moderne – qui s’est déployé en même temps que les techno-images – la particularité d'induire une attitude réflexive envers les «moyens» (media) de la communication, en nous donnant ainsi un certain recul face à ses fins (le message, le sens), dans les deux cas, l'expérience artistique apparaît comme un dispositif attentionnel prenant pour objet privilégié le travail parallèle des médiations et des interprétations qui contribuent à produire une certaine expérience esthétique.
Dans les années 1960, pendant que Roland Barthes questionnait l’apparente «transparence» de Racine pour y voir un jeu réflexif de miroirs où chaque époque, chaque interprète projette ses problématisations propres – c’est-à-dire comme un fond de relations dans lequel chaque génération peut construire des figures relativement nouvelles – Marshall McLuhan théorisait la façon dont les media, conçus comme des prolongements sensoriels et nerveux de l’humain, généraient de nouveaux «environnements» où nous ne repérons certaines figures (des informations, des messages) qu’en restant aveugles à cet environnement médiatique lui-même. Il présentait les pratiques artistiques comme proposant des «anti-environnements» qui nous rendent capables de percevoir des fonds environnementaux habituellement inaperçus comme tels:
[S]euls le petit enfant et l’artiste ont cette immédiateté d’approche qui permet la perception de l’environnemental. L’artiste nous fournit des anti-environnements qui nous rendent capables de voir l’environnement. Ces moyens anti-environnementaux doivent être constamment renouvelés pour être efficaces. (McLuhan 2011: 24)
Quelques années plus tard, Vilém Flusser concevait une «philosophie de la photographie» qui attribuait à l’artiste la capacité rare de déjouer le jeu automatique des appareils, en injectant des «images contemplatives» au sein du déferlement des techno-images qui constituent notre environnement quotidien:
la partie de beaucoup la plus grande des photographies (qui sont innombrables) témoigne de l’intention préprogrammée dans l’appareil qui les fait. […] De telles photos auraient aussi bien pu, au fond, être faites sans l’intervention d’un photographe, au moyen d’un déclencheur automatique, car leurs véritables producteurs sont le technicien qui a conçu l’appareil et l’industrie qui a engagé ce technicien. Cela apparaît clairement sur les photos dites d’amateur. […] Il y a cependant un très petit nombre de photos dont l’intention est visiblement inverse: on y tente d’être encore plus rusé que le programme de l’appareil, et de contraindre celui-ci à faire quelque chose pour quoi il n’est pas construit. L’intention de ceux qui les prennent est de produire des images qui se mettent en travers du déferlement [des clichés], qui forcent l’appareil à fonctionner contre le progrès de l’appareillage qu’il représente. […] Ces acrobates qui en produisent au sein même du déferlement des images et se maintiennent avec constance en dehors, ils méritent le nom d’«artistes» au vrai sens du mot: leur tour de main habile, rusé, contourne l’effroyable flot des images crachées par les appareils. (Flusser 2006: 64-65).
Des études littéraires aux études de media comparés
Les lecteurs familiers avec la façon dont les études littéraires ont théorisé leurs enjeux, leurs fonctions et leurs méthodes au cours du dernier demi-siècle auront certainement reconnu au passage toute une série de thèmes largement banalisés depuis des décennies. La littérature – conçue comme un cas particulier des pratiques artistiques en contexte de modernité – y apparaît comme un masque qui se pointe du doigt (le larvatus prodeo si souvent évoqué par Roland Barthes), comme une certaine «forme d’attention» (Frank Kermode) produisant des effets de «défamiliarisation» (Victor Chlovski) qui accroissent, raffinent, intensifient notre sensibilité à notre environnement (Nelson Goodman, Arthur Danto), parfois dans la perspective politique de reconfigurer notre «partage du sensible» (Jacques Rancière). L’appel flussérien à mettre en lumière réflexive les «programmes» qui «écrivent par avance» ce que nous croyons inventer subjectivement ne donne-t-il pas une définition parfaite de l’entreprise structuraliste qui a dominé la recherche et l’enseignement de la littérature pendant quelques décennies? Qu’est-ce donc que l’exercice de l’explication de texte, tel que le pratiquent quotidiennement les enseignants de littérature, sinon activer cette «immédiateté d’approche» que McLuhan conférait au «petit enfant et à l’artiste», pour nous rendre attentifs et sensibles au medium même du texte, que les interprétations non-littéraires tendent à occulter en discutant ses significations (contenus, idées, informations) plutôt que ses effets de forme? Loin d’être hors sujet, les paragraphes précédents n’ont fait que généraliser en termes de media ce que la théorie littéraire avait établi de longue date en termes de régime interprétatif.
Tel pourrait justement être l’enjeu historique de l’enseignement de la littérature en notre début de troisième millénaire. Des méthodes de sensibilisation, d’analyse et de réflexion se sont mises en place depuis plusieurs décennies dans le domaine restreint des études littéraires, qui méritent aujourd’hui d’être reprises, développées, adaptées pour s’étendre à l’ensemble de nos rapports aux media, au-delà des seuls «textes» sur lesquels s’est focalisée l’attention littéraire, pour se porter désormais sur le vaste domaine des techno-images. N’est-ce pas là un mouvement déjà en place, lui aussi, depuis plusieurs décennies, dont témoigne la croissance des inscriptions d’étudiants en programmes d’études cinématographiques ou d’arts du spectacle, alors même que les filières (étroitement) littéraires ont de plus en plus de difficultés à attirer les foules?
Cette nécessaire extension du domaine de la littérature est toutefois appelée à s’opérer dans un contexte difficile, dont les lamentations sur la mort de la littérature et des lettrés sont le symptôme superficiel. On sait que ce que nous appelons «la littérature», avec sa constellation unique de dimensions nationale, culturelle, existentielle, sociale et politique, est apparu vers le début du XIXe siècle, autour de Germaine de Staël, puis des Romantiques, pour dominer nos paysages intellectuels pendant un peu plus d’un siècle – avec ses conséquences multiples sur le paysage scolaire, universitaire, médiatique. En un paradoxe temporel fréquent dans l’histoire des régimes médiologiques, un certain culte d’une certaine forme d’utilisation de l’imprimé est devenu dominant alors même que l’univers des techno-images commençait à se mettre en place et à monter en puissance, au point de faire clamer aujourd’hui l’obsolescence de l’imprimé et la mort de la littérature. La perte de prestige et le délitement du statut hégémonique de «la littérature» dans le paysage culturel se prépare – et se proclame! – en réalité depuis plus d’un siècle. Au lieu de nous consumer en regrets du bon vieux temps, nous gagnerions à identifier plus précisément et plus pragmatiquement la façon dont ce que les études littéraires nous ont appris à faire depuis des siècles peut se traduire en termes de pratiques créatives, interprétatives et didactiques pertinentes
– voire indispensables – au sein du paysage médiatique actuel. En s’inspirant de plusieurs enseignants-chercheurs ancrés dans la double tradition (souvent jumelle) des études littéraires et des études de media, on gagnerait à envisager l’avenir de l’enseignement de la littérature dans le cadre d’»études de media comparés» permettant de redéployer au sein de l’univers des techno-images le savoir particulier (et infiniment précieux) développé sur les textes littéraires12.
Un tel redéploiement tient en partie du business as usual. Les enseignants de lettres n’ont nullement à se reconvertir en experts ès jeux vidéo pour survivre: contrairement à ce qu’on entend souvent dire, les humains n’ont jamais autant lu de textes écrits qu’à l’heure actuelle, et apprendre à interpréter ce qu’on lit sous forme de discours écrit restera une pratique centrale de toute éducation. Rien de plus stimulant que d’interpréter ensemble une page d’Ovide, Christine de Pisan, Montaigne, Isabelle de Charrière, Proust ou Nathalie Quintane 13. On peut toutefois penser à au moins trois domaines – parmi bien d’autres – dans lesquels les nouvelles pratiques médiales rendues possibles (et, dès lors, souvent imposées) par internet peuvent nous conduire à réaménager quelque peu le champ et les pratiques de l’enseignement littéraire. J’évoquerais très brièvement ces trois domaines, en me contentant à chaque fois de repérer des pratiques inédites et de signaler des manières possibles d’en tenir compte dans nos conceptions de l’enseignement littéraire.
L’interprétation littéraire à l'âge du faire
L’emprise d’une certaine vulgate des sciences de l’information et de la communication, adossée à la critique (justifiée) des industries culturelles par les philosophes de l’École de Francfort, a fait apparaître le lecteur dans une position passive: un message est préparé, composé, «encodé», peaufiné, envoyé, diffusé par un émetteur, pour être simplement «décodé» par un «récepteur», comme si, dès lors qu’on disposait du bon code, le déchiffrage était une opération mécanique allant de soi. La traduction pédagogique en est que le travail de l’enseignant consiste à apprendre le bon code aux étudiants, à leur transmettre les informations servant de clés à la bonne compréhension du texte. Les cinquante dernières années de théorie de la littérature se sont ingéniées à montrer au contraire à quel point l’activité du lecteur était à proprement parler «déterminante» dans la construction (toujours quelque peu nouvelle) de la signification d’un texte. Un des apports principaux des études littéraires aux études de media tient justement à la puissance et au raffinement des outils dont elles disposent pour établir une distinction essentielle – plus importante que jamais à l’ère numérique – entre «information» (mesurable en bits au sein de dispositifs machiniques) et «signification» (toujours suspendue à des pertinences, et donc à des pratiques humaines, incarnées dans des corps matériels sensibles au plaisir et à la douleur). Reconnaître l’importance et les enjeux de cette activité propre au pôle de la réception est au cœur de «l’économie de l’attention» ainsi que de toute une série d’entreprises intellectuelles inspirées aussi bien par des penseur devenus classiques comme Peirce, Gadamer, Barthes, de Certeau ou Fish, que par des théoriciens plus récents aussi divers que Maurizio Lazzarato, Tiziana Terranova, Tim Ingold, Michael Goldhaber, Chris Anderson ou Michel Lallement – lequel résume bien l’engouement actuel pour les do-it-yourself, fablabs, hackers’ spaces et autres formes d’»économie de la contribution» dans le titre de son dernier ouvrage, L’Âge du faire (Lallement 2015).
Enseigner la littérature à l’âge du faire implique de prendre la mesure des multiples façons dont la lecture est créative. Si la dimension herméneutique de cette créativité a déjà été finement balisée depuis longtemps, d’autres formes plus récentes méritent d’être prises en compte et utilisées dans nos activités d’enseignement, plutôt que refoulées hors de nos salles de classe. Pour beaucoup d’enseignants, le monde des fans-fictions n’a rien à voir avec celui l’enseignement littéraire, sinon comme objet d’étude pour sociologues en quête de «cultures populaires». En restreignant l’enseignement au seul domaine d’un savoir objectivable, et en excluant les dimensions affectives et hédoniques de ce qui se partage dans un enseignement de littérature, une certaine idéologie scientiste a dangereusement mutilé ce qui fait la puissance propre de nos expériences esthétiques, comme le montre bien l’ouvrage récent de Jean-Marie Schaeffer (2015)14. Prendre le relais de l’auteur en poursuivant le développement d’une fiction au-delà de son point final, que ce soit sous la forme savante d’une théorie des textes possibles, d’adaptations transmédiales ou de fan-fictions, constitue bel et bien un travail littéraire sur un matériau littéraire (pour autant qu’on n’étrangle pas la définition de «la littérature» au point de lui ôter toute respiration vitale)15.
La question – à la fois évidente mais souvent perçue comme scandaleuse – est bien celle que pose Rita Felski (2011) dans un ouvrage récent: que faire de la littérature? Qu’en faisons-nous en classe, pour que nos étudiants en fassent quoi, lorsqu’ils sortent de nos cours et séminaires? Qu’en font-ils déjà, pour quoi en ont-ils besoin, et comment pouvons-nous les aider à mieux faire ce qu’ils en font? Au-delà d’un retour bien intentionné mais quelque peu superficiel vers une conception de la lecture comme source de morale pratique délivrée des envoûtements du démon de la théorie (Compagnon 2007; Nussbaum 2015), cette attitude pragmatiste mérite surtout de se traduire en nouvelles modalités d’enseignement. La salle de classe littéraire gagnerait à devenir un hackers’ lab où chacun(e), riche de ses ressources propres, aide les autres à bricoler des interprétations qui nous aident à vivre ensemble sur notre petit bout de Terre en train de surchauffer. Si l’enseignant(e) a bien accumulé une expertise à transmettre, celle-ci relève davantage de sensibilisations, de raffinements attentionnels, de gestes de recherche, d’ajustement, de collaboration et d’autocorrection que de contenus informationnels à transmettre prédigérés.
Dans la mesure où il s’agit de gestes (à incorporer par imitation) plutôt que de connaissances (à comprendre abstraitement), leur enseignement passe moins par l’explication d’une « méthode » que par l’exercice répété d’une pratique. L’enjeu crucial de l’enseignement est aujourd’hui d’inculquer les gestes qui sauvent ce qu’il y a de précieux dans la vie, au sein d’un univers numérique qui sauve (et fraie) indifféremment les traces du meilleur comme du pire. Les études littéraires ont développé toute une tradition de gestes interprétatifs dont nous ne sommes que les passeurs et dont l’importance est plus cruciale que jamais, au sein de ce qu’un philosophe comme Andy Clark nous a appris à considérer comme la « cognition étendue » (extended cognition) qui enchevêtre de plus en plus étroitement le fonctionnement de notre système nerveux physiologique avec celui du système médiologique électronique. Apprendre à être « lettré », qu’est-ce d’autre qu’apprendre où et comment mobiliser les puissances des lettres qui peuplent les livres (c’est-à-dire des media et des médiations), au sein d’une circulation plus large, transindividuelle, des signes et des significations ? Les humanités ont un rôle central à jouer en tant que moment réflexif au sein de cette circulation systémique, hybridant de façon inextricable nos cerveaux biologiques (wetware), nos systèmes symboliques (software) et nos infrastructures matérielles de computation (hardware) – comme l’illustre bien cette citation de Michael Wheeler :
Quand des apprenants s’attendent à ce que l’information soit accessible de façon aisée et fiable de la part d’un support externe (tel qu’internet), ils sont davantage susceptibles de se rappeler où trouver l’information que les détails de l’information elle-même. Un tel profil cognitif paraît entièrement adéquat pour un monde dans lequel la capacité à trouver en temps réel les bonnes informations en réseau (non seulement des faits, mais de quoi résoudre les problèmes) peut être considérée comme plus importante que la capacité de retenir ces informations dans sa mémoire organique. Dans un tel monde, qui est bien notre monde, le cerveau apparaît comme un lieu de plasticité adaptative, un système contrôlant les compétences et capacités incarnées qui rendent possible la mobilisation temporaire de certaines technologies au sein des scénarios visant à résoudre certains problèmes. Du point de vue de la cognition étendue, la conceptualisation la plus éclairante du cerveau y voit un élément – un élément certes crucial et persistant – dans des séquences de systèmes cognitifs étendus qui se construisent de façon dynamique et s’assemblent de façon temporaire. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer, ce devrait donc être sur l’éducation de ces assemblages hybrides – tâche qui est pleinement consistante avec le but de conférer au cerveau les compétences dont il a besoin pour être un contributeur effectif à de tels assemblages (Wheeler 2015: 97) 16.
L’écart littéraire dans l'univers des techno-images
En réinsérant le sujet (apprenant, lecteur, interprète) dans un «système cognitif étendu» fait d’»assemblages hybrides» où neurones et circuits intégrés se connectent de façon fluide et indistincte, la citation précédente a sans doute poussé aussi loin que possible le sentiment d’aliénation et d’inconfort qu’un littéraire normalement constitué peut ressentir au milieu d’un alignement de technolâtres entichés de cyborgs et d’efficacité. À la question Que faire de la littérature?, il ne saurait suffire de répondre: un super-entraînement pour super-athlète cérébral capable de dialoguer au mieux avec nos super-ordinateurs… Si l’enseignement littéraire apporte une spécificité à la circulation de l’information au sein de nos sociétés, c’est sans doute bien davantage en en détournant qu’en en accélérant les flux. Trop de cognition trop dangereusement étendue tourne à vide ou à rebours du bon sens (cf. ici aussi l’exemple emblématique du high-speed trading) pour qu’on veuille enrôler la pauvre littérature dans la démence suicidaire d’une efficacité dévoyée 17. Si la littérature peut nous aider à vivre (ensemble), c’est dans la mesure où elle nous invite à contrefaire autant qu’à faire, à déjouer le jeu productiviste autant qu’à le jouer, à subvertir les obstacles autant qu’à résoudre les problèmes. Sa façon d’instaurer des écarts au sein de circulations menaçant toujours de nous enfermer dans leurs boucles répétitives repose en bonne partie sur le même déplacement attentionnel qui nous fait regarder la lettre plutôt que de nous ruer sur le sens.
Derrière la question aujourd’hui passablement éculée des «rapports de la forme et du fond», qui posait les problèmes à travers une opposition entre forme et matière, entre expression et contenu, l’heure est peut-être venue de repenser les rapports entre figures et fonds. Un des enjeux centraux (et particulièrement complexe) des cultures numériques est en effet, comme on l’a évoqué plus haut, d’une part, de pousser la grammatisation à son comble en réduisant toute notre vie relationnelle (avec les humains et les non-humains) à des séquences discrètes de 0 et de 1, mais aussi, de façon apparemment contradictoire, de permettre, par cette numérisation même, à des captations audio-visuelles d’opérer parmi nous sur le mode de l’analogique (continu, nuancé) et non seulement du digital (discontinu, discret). Indépendamment des pratiques artistiques qui en font un enjeu explicite de leur travail 18, cette remontée du fond est liée à au moins deux types de phénomènes qui méritent d’être pris en compte dans la façon dont nous concevons l’enseignement littéraire.
D’une part, nos nouveaux modes numériques de figuration permettent aux fonds de circuler plus facilement entre nous: au lieu de décrire l’aspect physique d’une personne à l’aide de quelques phrases qui schématisent sa figure en quelques caractéristiques discontinues (son âge, sa taille, ses couleurs d’yeux, de cheveux), j’envoie une photographie qui inclut les nuances indescriptibles de son sourire et de sa complexion. Ce faisant, je laisse au récepteur le travail de faire émerger ce qui fait «figure» (signifiante) au sein de ce qui reste en «fond» (bruit insignifiant), et je lui transmets du même coup une riche réserve de traits potentiellement pertinents à explorer et utiliser différemment que je ne l’aurais fait moi-même. Je lui transmets une richesse de fond (le medium comme «milieu») en même temps qu’un instrument d’identification d’une figure (le medium comme «moyen»). L’écart consiste ici à regarder autre chose que la figure qui crève l’écran, à trouver dans le fond, dans le bruit, dans le non-sens, dans l’insignifiant, dans le surplus de matière sensorielle offert par le continuum analogique, de quoi faire émerger de nouvelles figures de sens, ce qui implique de regarder plus longtemps, plus intensément – tâche que le dernier Roland Barthes attribuait à la fois au cinéaste (en l’occurrence Antonioni), à l’artiste en général et au critique littéraire (qu’il dépeint dans le miroir que lui offre le réalisateur italien) 19.
Mais cette remontée du fond peut aussi, d’autre part, s’entendre dans un sens très différent, qui tient à ce que, grâce à la numérisation, tant de documents (très riches sensoriellement) peuvent circuler ou être accessibles (très facilement). Pour quiconque a accès à internet (ce que certaines prédictions estiment devoir être le cas de 80% de la population mondiale d’ici 2020), toute donnée s’entoure instantanément d’un nuage de données apparentées, pour peu que je l’insère dans un moteur de recherche. Un étudiant qui a pour tâche d’étudier un poème, un personnage ou un épisode d’un roman dispose en quelques fractions de seconde de toute une constellation de rapprochements qui re-contextualisent son objet d’étude dans un univers intrinsèquement multimédiatique, induisant des approches de plus en plus inter- ou trans-médiales. Des images, des sons, des vidéos, des adaptations, des reprises, des réécritures, des articles savants, des commentaires impressionnistes, des lubies idiosyncrasiques, des chansons, des réappropriations idéologiques plus ou moins violentes: tout ce halo associatif généré algorithmiquement par nos appareils attentionnels numériques constitue une nouvelle réserve de fond que l’étudiant peut solliciter de façon plus ou moins systématique et réfléchie, enrichissant (ou appauvrissant) sa propre perception de l’œuvre étudiée. L’écart consiste ici à se laisser détourner de sa quête première pour se laisser surprendre et stimuler par des effets de sérendipité, qui nous conduisent à trouver ce qu’on ne cherchait pas, à résoudre des problèmes qu’on ne se posait pas. En s’ouvrant à la fécondité de tels détournements de notre intention initiale, l’attitude littéraire fait dérailler des «systèmes cognitifs étendus» qui ont toujours trop tendance à tourner en rond. De telles errances, qu’on réduirait trop facilement à des erreurs ou à des aberrations, sont en réalité une condition de survie des systèmes vivants au sein d’environnements instables et évolutifs – selon la logique du «crapaud fou» qui part dans la direction opposée à celle de ses congénères, mais qui en perpétue l’espèce lorsque le trajet grégaire des premiers trouve une autoroute sur son chemin.
Le cheminement littéraire à l'âge de l'accès
Ces dernières remarques commencent à répondre à la question centrale: si l’enseignement de la littérature doit apprendre à intégrer les nouvelles pratiques médiales à ce qui se fait et se discute en classe, qu’a-t-il à leur apporter en retour? On pourrait en effet considérer que nos étudiants n’ont pas besoin de cours de littérature (ni de media comparés) pour rédiger des fan-fictions, écouter des chansons, regarder des vidéos ou surfer sur internet: ils le font déjà suffisamment sans notre aide! Pourtant, si l’idéal d’instruction correspond à quelque chose, c’est justement à aider les étudiants à construire une capacité intérieure à développer des habitudes de recherche plus adéquates à une meilleure orientation dans l’existence – ce qui implique de savoir se laisser désorienter ponctuellement au besoin. Ce sont donc ces pratiques spontanées, dirigées par leurs désirs et par leurs besoins extra-curriculaires, qu’il nous faut essayer de rendre plus efficaces, plus réflexives et plus émancipantes. Si l’enjeu est bien d’apprendre à «se faire un chemin» – de chercheur discipliné et de crapaud fou, puisque les deux doivent nécessairement aller de pair 20 – au sein des constellations associatives qui apparaissent comme le halo algorithmique des objets culturels numérisés, cette tâche implique au moins trois gestes que l’enseignement littéraire peut aider à former, puisqu’ils sont au cœur de nos activités interprétatives depuis des siècles.
Un geste de sélection critique, sur lequel les pédagogues du web insistent depuis pas mal de temps, réinjecte un peu du vieux principe d’autorité au sein de l’horizontalité (largement imaginaire) du numérique. Une des angoisses récurrentes des internetophobes est que tout arriverait sur l’écran de l’étudiant au même niveau et avec le même statut, dans une sorte d’accès direct («désintermédié») qui exposerait sa naïveté à tomber aussi bien sur le «savoir» autorisé d’un site «sérieux» (universitaire, gouvernemental), que sur les «délires» d’illuminés conspirationnistes ou sur les «dérives sectaires» d’intégristes poussant au «terrorisme». Même si l’ensemble des catégorisations qui sous-tendent ces angoisses mériterait d’être discuté, il faut remarquer d’emblée que si une certaine horizontalité anarchique a pu se déployer dans un moment précoce du développement d’internet, on a aujourd’hui basculé dans une phase où les dynamiques d’agrégation et de commercialisation conduisent au contraire à des rapports de forces très verticaux entre, d’une part, de grosses plateformes dominantes, qui agencent la visibilité algorithmique selon leurs intérêts propres, et, d’autre part, des myriades d’invisibilités diffuses qui existent certes, mais en marge des flux significatifs de circulation. Rêve ou cauchemar, l’anarchie appartient surtout à un trop éphémère passé 21.
La logique agrégative des algorithmes de recherche opère un premier tri sélectif utile (parce que basé en partie sur notre intelligence collective), mais néanmoins très envahissant, qui relaie parfois les sources les plus intéressantes loin derrière les acteurs les mieux dotés en finances et/ou en capital attentionnel. Si les études universitaires ont quelque chose à nous apprendre, c’est justement à se faire un chemin de chercheur au sein de (et parfois contre) les propositions de sources qui nous sont suggérées par le halo algorithmique. Ce geste de sélection critique passe par différentes phases que l’étudiant apprend à respecter lorsqu’il rédige un mémoire de recherche: citer ses sources, pour pouvoir les réexaminer avec un regard mieux informé; suspecter ses sources, pour tempérer l’intérêt de ce qu’on trouve par sérendipité; filtrer ses sources, c’est-à-dire savoir que toutes ne se valent pas. On est bien ici au cœur de l’activité d’inter-prétation : une activité collective où l’on s’emprunte et s’inter-prête des idées et des enchaînements de mots, mais où le cheminement vers l’idée compte autant que le point d’arrivée.
Le deuxième geste que la pratique des études littéraires aide à incorporer est celui du freinage réflexif. La culture d’internet, miroir des anticipations dont se nourrit le profit capitaliste, enjoint à la rapidité. Aller ou faire plus vite est un bien en soi, qui rapporte gros – avec ici aussi à l’horizon la démence du high-speed trading. L’une des choses les plus précieuses que nous apprenons dans nos séminaires littéraires est le ralentissement de lecture inhérent à l’exercice de l’explication de texte. Que l’on prenne pour objet un poème, un paragraphe extrait d’un texte narratif, un raisonnement philosophique, une scène de tragédie, mais aussi bien un texte de loi, un tableau, une photographie, un mouvement chorégraphique, une séquence filmique ou une situation tirée d’un jeu vidéo, dans tous les cas, l’important est de freiner pour discerner les éléments constitutifs de l’objet analysé, pour réfléchir à leurs fonctions et à leurs effets en leur substituant des équivalents possibles, bref pour décomposer une sensation originellement perçue comme immédiate afin d’en faire sentir les médiations multiples ainsi que leur entrejeu dynamique.
Ce ralentissement permet le déploiement d’un troisième geste, qui relève de la suspension flâneuse. Il s’agit en effet moins de «concentrer» son attention que de lui permettre de se redéployer différemment, en se donnant les moyens d’explorer des bifurcations inaperçues en régime de précipitation coutumière. Freiner ne vise pas tant à l’immobilité qu’à un autre type de mouvement que celui imposé par les contraintes extérieures de la vitesse: mouvement latéral de crapaud fou, de traverse, de promenade, d’exploration hasardeuse, de tâtonnements hésitants, de frayages erratiques, d’allers-retours sans progression évidente – mouvement de «cheminement» (wayfaring) dont l’anthropologue Tim Ingold a bien montré qu’il constituait l’alternative (pré- et post-moderne) au régime de «transport» qui nous pousse aujourd’hui à aller aussi vite que possible d’un point A vers un point B et qui nous fait considérer comme «perdu» le temps du déplacement lui-même, vécu à travers une éclipse d’insensibilité momentanée envers l’environnement traversé 22. Si ces trois gestes esquissent une «méthode», c’est moins au sens d’une série de règles inculquées à partir de formalisations abstraites (selon le modèle d’écriture linéaire de la programmation algorithmique) qu’au sens étymologique d’un art du cheminement (hodos) au sein d’un espace continu, perçu dans sa continuité analogique et dans les richesses de ses fonds, plutôt que dans les figures pré-paramétrées pour démarquer ses étapes opérationnelles.
Si les sections précédentes poussaient la littérature en aval de son moment hégémonique romantico-moderne en la plongeant dans l’univers des techno-images, nous remontons ici en amont de ce moment, en retrouvant l’usage du mot « littérature » qui prédominait encore au XVIIIe siècle, lorsqu’« avoir de la littérature » signifiait pouvoir se repérer dans un monde de discours autorisés et de références canoniques (généralement gréco-latines). Dans le bref article qu’il lui consacre dans l’Encyclopédie, le chevalier de Jaucourt en fait un « terme général, qui désigne l'érudition, la connaissance des Belles-Lettres et des matières qui y ont rapport », permettant à celui ou celle qui écrit ou parle de « se parer à propos de ses lectures, de sa critique et de son érudition ».
Que peut donc signifier « avoir de la littérature » à l’heure où quelques fractions de seconde font apparaître des dizaines de citations (latines ou autres) par la seule grâce des moteurs de recherche ? Derrière cette conception apparemment obsolète, la littérature et son enseignement mettent en lumière le besoin de porter son attention sur les cheminements qui nous conduisent à certaines conclusions, d’interroger les propriétés de media (moyens, appareils, documents, canaux, milieux) qu’on a utilisés pour arriver là où l’on est, de réfléchir au fonctionnement de ces media en termes de valeurs, et d’imaginer des alternatives possibles aux cheminements effectivement suivis. L’immédiacie numérique généralise le mode du « transport » dans notre rapport aux objets culturels : PageRank, l’algorithme de recherche de Google, fonctionne comme un avion supersonique qui nous envoie là où nous voulions aller avant même que nous ne le sachions nous-mêmes. Son utilité courante est indéniable et admirable. Mais, comme le souligne Tim Ingold, les appareils de transport nous font parfois payer le prix fort pour leur rapidité. En pouvant si facilement être transporté presque partout instantanément, on risque de ne plus « habiter » nulle part (dwelling), puisqu’on n’habite un territoire qu’en l’arpentant par des cheminements qui nous sensibilisent à son environnement. Les études littéraires ne sauraient aujourd’hui être conçues contre l’univers numérique des algorithmes et des techno-images, mais dans cet univers – comme un moyen-medium pour mieux l’habiter, de façon moins automatique et plus autonome, par des mouvements moins rapides mais mieux orientés.
Bibliographie
Abram, David (2013), Comment la Terre s’est tue, Paris, La Découverte.
Berardi, Franco (2016a), Tueries, Montréal, Éditions Lux.
Berardi, Franco (2016b), «Décomposition et recombinaison à l’âge de la précarité», Multitudes n° 62.
Bolter, Jay David & Richard Grusin (2000), Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MIT Press.
Bonamy, Robert (2013), Le fond cinématographique, Paris, L’Harmattan.
Bonneuil, Christophe & Jean-Baptiste Fressoz (2014), L’événement anthropocène, Paris, Seuil.
Bratton, Benjamin (2016), The Stack. On Software and Sovereignty, Cambridge MA, MIT Press.
De Certeau, Michel (1990 [1980]), L’invention du quotidien. 1 Arts de faire, Paris, Gallimard, «Folio».
Citton, Yves (2007), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires?, Paris, Éditions Amsterdam, réédition augmentée en 2016.
Cardon, Dominique (2015), À quoi rêvent les algorithmes?, Paris, Seuil.
Clark, Andy (2011), Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford University Press.
Clark, Andy (2003), Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence, Oxford University Press
Compagnon, Antoine (2007), La littérature, pour quoi faire?, Paris, Fayard.
Escola, Marc (dir.) (2012), Théorie des textes possibles, Amsterdam, Rodopi (n° 57 de la revue CRIN).
Felski, Rita (2011), Uses of Literature, New York, Wiley-Blackwell.
Flusser, Vilém (2011 [1985]), Into the Universe of Technical Images, N. A. Roth (trad.), Minneapolis, University of Minnesota Press.
Flusser, Vilém (2006), La civilisation des médias, Belval, Circé.
Flusser, Vilém (1985), Ins Universum der technischen Bilder, Göttingen, European Photography.
Hayles, N. Katherine (2016), Lire et penser en milieu numériques, Grenoble, ELLUG.
Hayles, N. Katherine (2015), «Non-conscient cognitif et algorithme de trading automatisé», in Le sujet digital, Claire Larsonneur et al. (dir.), Dijon, Les presses du réel, p. 20-41.
Huyghe, Pierre-Damien (2012), Le cinéma avant après, Saint Vincent de Mercuze, De l’incidence éditeurs.
Ingold, Tim (2011), Une brève histoire des lignes, Paris, Zones Sensibles.
Jenkins, Henry (2013), La culture de la convergence: des médias au transmédia, Paris, Armand Colin.
Kittler, Friedrich (2015), Mode protégé, Dijon, Les presses du réel.
Lallement, Michel (2015), L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil.
Latour, Bruno (2015), Face à Gaia, Paris, La Découverte.
McLuhan, Marshall (2011 [1964]), «The Relation of Environment to Anti-Environment», in Media and Formal Cause, Marshall McLuhan and Eric McLuhan (dir.), Houston (Texas), NeoPoiesis Press.
Nussbaum, Martha (2015), L’art d’être juste. L’imagination littéraire et la vie publique, Paris, Climats.
Parikka, Jussi (2018), Qu’est-ce que l’archéologie des media?, Grenoble ELLUG.
Pasquale, Franck (2015), The Black Box Society: les algorithmes secrets qui contrôlent l’économie et l’information, Paris, FYP.
Quessada, Dominique (2013), L’inséparé. Essai sur un monde sans Autre, Paris, PUF.
Rosenthal, Olivia & Lionel Ruffel (dir.) (2010), «La littérature exposée», Littérature, n° 160.
Rouxel, Annie & Gérard Langlade (2005), Le sujet-lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, PUR.
Simondon, Gilbert (1958), Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier.
Schaeffer, Jean-Marie (2015), L’expérience esthétique, Paris, Gallimard.
Stengers, Isabelle (2013), Au temps des catastrophes, Paris, La Découverte.
Thrift, Nigel (2016), «Inconscient technologique et connaissances positionnelles», Multitudes, n° 62.
Wheeler, Michael (2015), «Thinking Beyond the Brain: Educating and Building from the Standpoint of Extended Cognition», in Alleys of Your Mind.Augmented Intellligence and Its Traumas, Matteo Pasquinelli (dir.), Lüneburg, Meson Press, p. 85-106.
Pour citer l'article
Yves Citton, "Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images", Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017https://www.transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-dans-l-univers-des-techno-images
Rap et "Bucoliques" de Virgile
Dans sa thèse « Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture », Dominique Augé insiste sur la nécessité, pour faire des élèves latinistes ou hellénistes des lecteurs curieux, de leur présenter des textes en langue originale dont les schémas narratifs et certaines composantes, tels les personnages ou les lieux, « leur permettent de mobiliser des savoirs ou des référentiels antérieurs » (Augé 2013 : 154). Aussi recommande-t-elle de construire les postures du lecteur auprès des élèves en abordant la littérature grecque et latine à l’aide de textes relevant de genres littéraires connus en français, par exemple la fable, emboîtant le pas à Anne Armand (1997 : 79-97) et Mireille Ko (2000 : 41) : familiers des Fables de La Fontaine, les élèves nourrissent des attentes qui les motivent à entrer dans les Fables d’Ésope ou de Phèdre, tout en possédant un univers référentiel qui le leur permet (Augé 2013 : 147-175).
Rap et "Bucoliques" de Virgile
I. Introduction et questionnement
Dans sa thèse «Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture», Dominique Augé insiste sur la nécessité, pour faire des élèves latinistes ou hellénistes des lecteurs curieux, de leur présenter des textes en langue originale dont les schémas narratifs et certaines composantes, tels les personnages ou les lieux, «leur permettent de mobiliser des savoirs ou des référentiels antérieurs» (Augé 2013 : 154). Aussi recommande-t-elle de construire les postures du lecteur auprès des élèves en abordant la littérature grecque et latine à l’aide de textes relevant de genres littéraires connus en français, par exemple la fable, emboîtant le pas à Anne Armand (1997 : 79-97) et Mireille Ko (2000 : 41): familiers des Fables de La Fontaine, les élèves nourrissent des attentes qui les motivent à entrer dans les Fables d’Ésope ou de Phèdre, tout en possédant un univers référentiel qui le leur permet (Augé 2013 : 147-175).
Pour la plupart des genres littéraires antiques il existe un correspondant plus récent que les élèves ont déjà rencontré dans le cadre de leur parcours scolaire ou de leur parcours personnel au moment où l’on aborde en latin ou en grec un texte relevant dudit genre littéraire. Mais il y a aussi des genres que les élèves ne connaissent pas du tout et dont la thématique, de prime abord, n’est pas de celles qui les passionnent. Le genre bucolique en est un bon exemple. Ce n’est sans doute pas pour rien que les Bucoliques de Théocrite ou celles de Virgile ne sont pas mentionnées dans les Plans d’études actuels de Suisse romande pour l’école secondaire 1 ou 2, qu’elles ne figurent presque jamais dans les moyens d’enseignement1 et qu’elles sont encore plus rarement lues en classe.
Si cependant on investit un périmètre plus large que la littérature à la recherche d’expressions artistiques connues des élèves et dont l’exploitation éveillerait chez eux des attentes et les mettrait dans la posture de lecteurs actifs, cette lacune peut être comblée grâce au rap.
De fait, les dimensions poétique, rythmique et théâtralisée caractérisent pareillement cette création culturelle populaire issue du mouvement hip hop que la bucolique gréco-latine, ces textes «monumentalisés dans la culture savante» (Dupont 2015). Aussi l’omniprésence du rap et sa notoriété auprès de tous les élèves –certes à des degrés divers– semblent le désigner comme une possible porte d’entrée dans les Bucoliques. Comment? Ce sera le propos de la deuxième partie de cet article, qui décrira le dispositif didactique développé et en relatera trois mises en pratique, alors que la conclusion s’interrogera sur sa validité.
II. Virgile, le rap et des apprenants
a) Acte 1
Il convient de faire précéder la description de notre dispositif et de ses réalisations par une réflexion concernant le domaine dans lequel nous entendons faire construire des stratégies et des compétences par les apprenants. Alors que Ko, Armand et Augé recommandent de recourir à des genres littéraires connus des élèves pour leur permettre de mobiliser leurs savoirs littéraires, formels ou thématiques, le parcours que nous avons proposé convoque certes aussi des connaissances littéraires, mais également un ensemble de données performatives et énonciatives ; par conséquent, il stimule davantage une réflexion d’anthropologie historique avec une perspective ethnopoétique2. De fait, le pivot principal de notre dispositif consiste dans la battle que les protagonistes se livrent sur les divers niveaux évoqués, le performatif étant sans doute le plus important3.
La séquence a été réalisée pour la première fois en juin 2018 avec deux des classes de latin de Catherine Fidanza, regroupant dix élèves de 1ère et de 2ème année du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, en classe hétérogène. Ces élèves de 16-17 ans étaient à la fin de leur deuxième ou troisième année de latin – leurs connaissances étaient donc encore relativement modestes. Ils connaissaient Virgile pour avoir lu plusieurs passages de l’Énéide, mais ils n’avaient encore jamais entendu parler des Bucoliques. Pour disposer d’un bon point de comparaison, d’une Bucolique offrant un bon exemple de battle, nous avions choisi la Bucolique 3, qui met en scène deux pâtres, Menalcas et Damoetas. Au début du poème, Menalcas demande à Damoetas à qui appartient le troupeau de brebis qu’il garde. Les deux se disputent rapidement, puis Damoetas propose une joute à Menalcas. Tous deux présentent leur enjeu, ils demandent à un voisin de jouer à l’arbitre – et la joute commence.
Dans un premier temps, Catherine Fidanza a consacré deux périodes à parcourir cette Bucolique avec ses élèves et leur en faire découvrir en traduction française le contenu et les personnages.
Le cœur de la séquence, composé d’une amorce, de quatre activités et d’une conclusion, a occupé deux périodes de 45 min. Il a été modéré par les trois intervenants Catherine Fidanza, Antje Kolde et Martin Conod.
En guise d’amorce, les élèves ont été invités à répondre à la question suivante : «L’association des termes “Bucoliques” et “rap” fait-elle sens pour vous? Si oui, pourquoi?» Au cours d’un tour de table, certains ont déjà pointé l’affrontement entre deux personnages présents dans les deux expressions artistiques tout comme leur dimension poétique.
La première activité a consisté dans le visionnement d’une petite dizaine d’exemples de battles diverses, allant de plusieurs extraits de rap à des caricatures en passant par de la street dance, une joute orale népalaise, une battle de percussionnistes indiens, de chanteurs sud-coréens, de guitaristes émo-métal japonais et finlandais4. Le but était que les élèves dégagent les caractéristiques des battles modernes, tous genres confondus. À l’issue de discussions modérées par les intervenants, ils ont formulé les réponses suivantes : a) les joutes se pratiquent dans beaucoup de domaines et expressions artistiques ; b) ce sont des «performances» (au sens anglo-saxon : avec implication du public) ; c) l’expression est «holistique» : musique, rythme, corps, voix, mots, tout y participe ; d) elles sont ritualisées : les deux personnages s’affrontent, passant par l’émulation, l’invective et l’humiliation, le second reprenant et variant ce qu’a fait le premier.
La deuxième activité était centrée sur un extrait de la Bucolique retenue5. Les élèves devaient écouter un échange entre les deux pâtres présenté par Antje Kolde qui marquait le passage d’un berger à l’autre en se déplaçant dans la salle ; le texte latin était oralisé à l’aide d’une scansion respectant tant le rythme de l’hexamètre dactylique que l’accent tonique des mots et les césures ; sans donc avoir le texte sous les yeux, les élèves avaient la consigne de dire a) si certains mots étaient mis en évidence, b) si oui, par quels procédés et c) les remarques générales qui en découlaient du point de vue du contenu. Par un jeu de questions-réponses, les élèves ont trouvé diverses manifestations de variatio et d’imitatio, que ce soit au niveau de la thématique ou de procédés rythmiques6 et rhétoriques ; cela leur a permis d’établir des parallèles entre les battles modernes et celles de la Bucolique. Il convient de préciser que la recherche tant des mots mis en évidence par leur accentuation et leur place dans le vers que des réseaux entre les mots a poussé les élèves à articuler une réflexion profonde sur l’effet de la poésie aussi bien sur le poète que sur le personnage intradiégétique et l’auditeur / le lecteur.
La troisième activité revenait au rap : en écoutant un extrait d’un rap d’Oxmo Puccino7, les élèves ont dû pointer la correspondance entre contenu et forme induite par l’accentuation d’une syllabe.
La quatrième activité se proposait de faire découvrir aux élèves le même phénomène dans le texte latin8 : comme lors de la deuxième activité, les élèves n’ont pas eu de difficultés à réaliser l’activité, en écoutant attentivement l’oralisation du texte latin selon les mêmes modalités.
La séquence s’est conclue par la comparaison de plusieurs traductions des deux passages étudiés, datant d’époques différentes. Les élèves avaient comme consigne d’évaluer si les traducteurs avaient mis en valeur les éléments dégagés par la réception orale, comparable à une réception en rap.
En aval, les élèves ont dû répondre après quelques jours à deux questions visant tant la motivation qu’ils retiraient de cette démarche de comparaison que son utilité pour la suite de leurs études.
Les réponses à la première question montrent que les élèves ont été sensibilisés à la dimension esthétique du texte latin qui leur a été rendue accessible par l’actualisation opérée par le biais du rap, tout comme à la construction du sens du texte antique et au rapprochement créateur de sens avec les battles modernes. Ainsi, une élève énumère ce qu’elle retient particulièrement : «Les passages sur la scansion et ce qu’elle peut révéler sur le texte, les mises en évidence qu’elle opère et ce qu’en font les traducteurs, les liens faits entre les constructions du texte antique et celles des battles modernes.»
Si la deuxième question était censée porter sur le microcosme du lycée, certains l’ont élargie au macrocosme de la vie. Comme il leur était demandé, les élèves ont pris du recul et il ressort de leurs réponses qu’ils ont intériorisé la matière qui leur a été apportée puisqu’ils insistent sur l’importance des sonorités dans toute poésie, de la place des mots et du lien entre l’expression actuelle rappée et le texte de Virgile.
b) Acte 2
La séquence a pu être reconduite le 27 octobre 2018, à l’occasion du 6ème Lateintag à Wettingen. Le scénario a dû être adapté aux circonstances légèrement modifiées : le nombre d’intervenants réduit à deux, un temps à disposition de 60 min et le public composé de latinistes en partie d’un niveau très avancé. Le dispositif a été modifié en un point : les répliques des deux pâtres n’ont pas été oralisées par une seule et même intervenante, mais chaque berger a été représenté par une intervenante ; cette modification constitue une nette amélioration, car elle a facilité la compréhension de la partie latine par une meilleure répartition des voix. Les activités ont été réalisées avec le même succès qu’à Neuchâtel et les réactions du public ont été en tous points semblables à celles des gymnasiens.
c) Acte 3
La troisième réalisation de la séquence a eu lieu le 12 janvier 2019 à l’École Normale Supérieure de Lyon, à l’occasion d’une journée de formation ELLASS (Enseigner les Langues Anciennes dans le Secondaire et le Supérieur) : les conditions étaient identiques à celles du Lateintag ; le public était constitué d’une douzaine d’étudiants qui préparaient leur concours d’agrégation. Bien que la plupart des agrégatifs aient montré peu de sympathie pour le rap, la séquence et les activités ont rencontré un vif succès. À la fin de la séance, les étudiants ont souligné l’effet actualisant de cette approche, qui comble l’abîme spatio-temporel et culturel séparant le texte de Virgile du rap et lui confère par là un sens tout à fait actuel. «Avant, je trouvais que l’enseignement des langues anciennes était un enseignement mort», s’exprime l’un d’eux ; «maintenant, je sais qu’on peut le faire vivre.»
III. Conclusion : validité de la séquence ?
Interrogeons-nous en guise de conclusion sur la validité de notre dispositif, et cela du triple point de vue des connaissances acquises, de la motivation et des connaissances transmises.
Il est difficile de s’exprimer sur le premier point : il eût fallu tester les connaissances acquises après un certain laps de temps. Or, c’était impossible. De fait, nous n’avons jamais revu les participants à la deuxième et à la troisième réalisation ; quant aux élèves neuchâtelois, notre intervention était trop proche de la fin de l’année. Cependant, des remarques que les uns et les autres ont faites durant l’année scolaire 2018-2019 ont montré qu’ils avaient assimilé l’importance de la place des mots, de leur accent et du rythme pour l’énonciation du texte et la construction de son sens.
En ce qui concerne la motivation, l’enthousiasme rencontré lors des trois réalisations montre la validité du scénario, même s’il était à chaque fois imputable aussi à d’autres facteurs. Ainsi, la séquence s’est toujours située en dehors du quotidien de l’école – dans le cadre d’un festival de langues anciennes et d’une journée de formation pour les réalisations 2 et 3, dans celui d’un enseignement un peu particulier, d’emblée déclaré comme expérimental, en ce qui concerne les élèves neuchâtelois. À leur propos, la présence de deux personnes extérieures, dont un chanteur connu et annoncé dans le programme d’un festival de peu postérieur à son intervention, a certainement joué un rôle. Selon les dires des participants à l’issue des trois réalisations, c’était néanmoins le scénario et les connaissances variées qu’il convoquait qui étaient particulièrement motivants pour eux.
L’évocation des connaissances convoquées permet de passer au dernier point : les connaissances transmises. Pour aborder la lecture des Fables gréco-latines, les didacticiens recommandent fréquemment, nous l’avons vu, de recourir aux Fables de la Fontaine ; outre la stratégie didactique, la filiation entre la fable antique et celle du XVIIème légitime ce procédé. Qu’en est-il dans notre cas? Notre scénario risque-t-il de transmettre des erreurs ou repose-t-il sur des parallèles vraisemblables entre Virgile et le rap? La vraisemblance des parallèles nous semble plus que probable : le texte des Bucoliques, que l’on a l'habitude de voir comme «monument de la culture savante», porte en effet les traces d'activités collectives qui ont disparu, alors qu'elles étaient vivantes dans la culture populaire ; on a ainsi perdu l'usage lié à leur pratique, qui était sans doute, pour les Bucoliques, des mimes ou d'autres styles de spectacles. En d’autres termes, le texte des Bucoliques a été «déterritorialisé» (Dupont 2015) – mais le recours aux comparaisons avec le rap permet de le «reterritorialiser». Certes, plusieurs éléments sur lesquels nous nous appuyons, tels la scansion accentuée et la performance des Bucoliques, sont toujours débattus. Mais loin de constituer un frein pour notre scénario, cette donne fournit un argument en faveur de sa validité didactique : en expliquant ces débats aux élèves, on leur montre que les langues anciennes sont encore bien vivantes – puisqu’on débat à leur sujet.
Bibliographie
Armand, Anne (1997), Didactique des langues anciennes, Paris, Bertrand-Lacoste.
Augé, Dominique (2013), Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture, Grenoble, Ellug.
Calame, Claude (2015), « Chanter les vulnérabilités : des poèmes de Sappho au rap bernois, du modèle choral au paradigme néolibéral », Cahiers du genre, 2015/1 (n° 58), p. 69-92. DOI : 10.3917/cdge.058.0069. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2015-1-page-69.htm, consulté le 7 octobre 2019.
Dupont, Florence (2010). La voix actée, pour une nouvelle ethnopoétique, Paris, Kimé.
Dupont, Florence (2015) « La voix des classiques, aux arènes de Lutèce, Paris 2015 - entretien de Laure de Chantal », réalisation de Hocine Gasmi, URL : https://www.youtube.com/watch?v=z55Urz_ErQ4
Ko, Mireille (2000), Enseigner les langues anciennes, Paris, Hachette.
Damoetas : «Jupiter est le début de tout, Muses ; tout est plein de Jupiter ; il prend soin de nos terres, mes chants lui plaisent». Menalcas : «Et moi, Phoebus m’aime : j’ai toujours des offrandes pour Phoebus chez moi, du laurier et le doux hyacinthe pourpré». (Traduction : A. Kolde)
Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.» (Ibid. note 5).
Damoetas : «Hélas, comme il est maigre, mon taureau, dans son gras pâturage ! L’amour est pareillement la mort pour le troupeau que pour le maître du troupeau.» Menalcas : «Chez ceux-là – et l’amour n’est pas en cause ! – la peau tient à peine aux os ; je ne sais quel mauvais œil jette un sort à mes tendres agneaux». (Traduction : A. Kolde)
Pour citer l'article
Antje Kolde & Catherine Fidanza, "Rap et "Bucoliques" de Virgile", Transpositio, Comment ça s'enseigne, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/rap-et-bucoliques-de-virgile
Voir également :
Haïku et pédagogie : le cas René Maublanc (1927)
En août 1927, la Revue Franco-Nippone publie une communication signée par René Maublanc (1891-1960) et intitulée «Le Haï-Kaï au lycée» (1927){{Maublanc écrit régulièrement dans cette revue : voir les numéros de février, mai, août et novembre 1926.}}. Dirigée par Akimasa Nakanishi, la Revue Franco-Nippone compte parmi ses collaborateurs des Japonais de Paris, d’éminents japonologues et des Français passionnés par le Pays du Soleil Levant. Parmi eux, Maublanc se profile comme l’un des principaux promoteurs du haïkaï dans la France de l’entre-deux-guerres.
Haïku et pédagogie : le cas René Maublanc (1927)
En août 1927, la Revue Franco-Nippone publie une communication signée par René Maublanc (1891-1960) et intitulée «Le Haï-Kaï au lycée» (1927)1. Dirigée par Akimasa Nakanishi, la Revue Franco-Nippone compte parmi ses collaborateurs des Japonais de Paris, d’éminents japonologues et des Français passionnés par le Pays du Soleil Levant. Parmi eux, Maublanc se profile comme l’un des principaux promoteurs du haïkaï dans la France de l’entre-deux-guerres.
Le haïkaï, une forme voyageuse
Sous l’appellation «haïkaï» se cache une forme poétique d’origine japonaise, dont la brièveté extrême fascine aujourd’hui encore l’Occident : le haïku2. Lorsque paraît «Le Haï-Kaï au lycée», le petit poème est déjà familier des lecteurs français. L’ouverture forcée du Japon en 1853-1854, la vogue japoniste initiée par les collectionneurs et les artistes, puis amplifiée par les diverses Expositions universelles, lui ont préparé un terreau fertile. Au Japon, sous l’impulsion du poète Masaoka Shiki (1867-1902)3, la forme connaît une importante réforme qui accentue sa circulation en Occident. Elle est d’abord connue en France grâce à des traductions4 et éveille l’intérêt des poètes au moment où le refus de l’éloquence, la recherche de l’impair et le souci du bref se placent au centre des préoccupations5. Fraîchement revenu d’un tour du monde, le jeune philosophe Paul-Louis Couchoud (1879-1959) – dont les travaux porteront plus tard sur Spinoza ou l’historicité de Jésus – compose les premiers haïkus en français au début du XXe siècle et les rassemble sous le titre Au fil de l’eau (2004 [1905]). Cette mince plaquette, tirée à compte d’auteur, est suivie d’études plus ambitieuses parmi lesquelles il faut citer Sages et Poètes d’Asie (1916)6. Couchoud y donne une définition qui influencera durablement la réception française de la forme :
Un haïkaï est une poésie japonaise en trois vers, ou plutôt en trois petits membres de phrase, le premier de cinq syllabes, le second de sept, le troisième de cinq : dix-sept syllabes en tout […] un simple tableau en trois coups de brosse, une vignette, une esquisse, quelquefois une simple touche, une impression. (1916: 53-54)
La Première Guerre mondiale fournit au haïku français une impulsion inattendue, lorsque des poètes s’en saisissent pour témoigner de l’enfer qu’ils ont vécu dans les tranchées. Parmi eux, l’Ardéchois Julien Vocance (pseudonyme de Joseph Seguin) rencontre le succès avec ses «Cent visions de guerre» (1916)7. Néanmoins, ce n’est qu’en septembre 1920 que la forme entre réellement sur la scène littéraire, à la faveur d’un numéro de La Nouvelle Revue Française (Paulhan [et al.] 1920)8. Jean Paulhan, initiateur de l’anthologie et alors secrétaire de La NRF, considère le haïku comme un terrain expérimental à investir collectivement pour revivifier la pratique poétique. Il s’en explique dans sa note liminaire :
Dix faiseurs de haï-kaïs, qui se retrouvent ici réunis autour de Couchoud, tâchent de mettre au point un instrument d’analyse. Ils ne savent pas quelles aventures, ils supposent la plupart que des aventures attendent le haï-kaï français – (qui pourrait trouver par exemple la sorte de succès qui vint en d’autres temps au madrigal, ou bien au sonnet ; et par là former un goût commun : ce goût justement qui passe pour préparer la venue d’œuvres plus décisives). (1920: 330)
La mode est lancée, les publications se multiplient, poètes et critiques s’emparent du petit poème. Ce sont ces floraisons foisonnantes que René Maublanc cherche à ordonner dès le milieu des années 1920, faisant preuve d’un sens aigu de la vulgarisation.
Le haïku, un instrument démocratique
Lorsque Maublanc publie «Le Haï-Kaï au lycée» (1920), voilà presque dix ans qu’il se penche sur cette forme qu’il nomme, dans le sillage du traducteur anglais Basil Hall Chamberlain, «épigramme lyrique du Japon» (Chamberlain 1902). Son approche témoigne d’une volonté de diffusion qui, dès 1920, s’appuie sur des préoccupations à la fois pédagogiques et politiques :
Nous souhaitons que tout homme cultivé, chez nous, s’exerce à cet effort, comme au Japon, où le paysan même et l’ouvrier se piquent, comme le lettré, de savoir tourner leur haï-kaï. Dans les pays et aux époques de grande vitalité littéraire, il existe des genres populaires que chaque amateur est capable de pratiquer lui-même […], tel est, au Japon, le haï-kaï, tel il pourrait être demain, en France, si l’on voulait bien nous suivre. Car la littérature d’un peuple n’est pas faite seulement de la production de quelques écrivains de métier ; elle est d’autant plus forte et vivante que plus d’hommes y collaborent dans un effort unanime. […] Dans un pays où le haï-kaï serait familier à tous, ces mille inspirations anonymes ne seraient plus toutes perdues pour l’art, et les efforts associés de tous ces ouvriers obscurs prépareraient la venue prochaine des œuvres décisives. (1920: 4-5)9
L’appel de Maublanc s’adresse avant tout à l’amateur, qui pratique la poésie par délassement – et non par métier. À ce poète particulier, le haïku fournit, par sa brièveté et l’exigence qu’il requiert dans le choix des mots, un instrument d’analyse de soi, «presque une méthode de vie» permettant de «décomposer ses sensations et ses sentiments jusqu’à l’élément le plus fugitif [pour y retrouver] une force profonde et essentielle de l’univers» (1920: 4). Si cet outil de connaissance n’est pas en lui-même garant de chefs-d’œuvre, il doit préparer «un milieu de culture favorable» et «[élever] le goût général» (1920: 5), afin d’être, «à brève ou longue échéance, créateur de beauté durable» (1920: 5). En 1923, afin d’illustrer les possibilités que le haïku ouvre en français, Maublanc compose à l’attention du grand public une série d’articles de vulgarisation, ainsi qu’une vaste anthologie-bibliographie qui réunit plusieurs dizaines d’auteurs pratiquant la forme en France (1923a, 1923b). Ses propres haïkus, régulièrement publiés dans des revues diverses, sont rassemblés en volume en 192410.
Démocratique et pédagogique, son approche s’explique par son orientation professionnelle et politique : enseignant en philosophie, il donne notamment des cours au lycée de Reims entre 1921et 1922, tandis qu’il travaille à son anthologie-bibliographie. En parallèle à ses activités d’écrivain, de revuiste et d’enseignant, il est actif dans des syndicats socialistes et communistes – ce qui lui vaut quelques démêlés avec ses supérieurs (Chipot 2013: 15-55). «Le Haïkaï au lycée» témoigne de cette double position : Maublanc y pose «le problème de la valeur pédagogique» d’une forme à même de remettre en question les «abus de verbiage» de l’«enseignement littéraire traditionnel», en ouvrant les élèves «à l’expression directe, concrète, d’une pensée originale» (1927: 35). Secouer la vieille rhétorique à l’aide du haïku ? Peut-être – mais avant de soulever la poussière qui recouvre Cicéron et Bossuet, il faut s’interroger sur le chemin que devra emprunter le haïku français afin de n’être ni «un jeu de mot [ni] un trait d’esprit» (1927: 35). Un problème que Maublanc souligne, non sans malice :
Pour cela, d’ailleurs, il faudrait que le haïkaï français eût ses règles strictes, comme le haïkaï du Japon : les mêmes qu’au Japon ou d’autres, mais des règles. C’est par la forme plus encore que par le fond que pêchent les essais des fillettes de Saint-Omer. […] Et cela encore est un utile enseignement : cela prouve qu’un bon haïkaï ne se fait pas par subite inspiration, qu’il n’est pas si facile à forger qu’on le croit d’ordinaire (1927: 36)11.
À près d’un siècle d’écart, les mots de René Maublanc résonnent encore, comme une invitation à se saisir d’une forme poétique paradoxale, à la fois si modeste mais si exigeante.
Magali Bossi
Le Haïkaï au lycée
Un de mes amis, professeur dans une petite ville du Nord de la France, vient d’introduire le haïkaï, comme exercice littéraire, dans l’Université12. À ses élèves du cours secondaire, – cinq jeunes filles de douze à quinze ans, – il a expliqué le sens et la forme de l’«épigramme lyrique du Japon» ; il leur a lu quelques beaux haïkaï japonais et quelques essais de haïkaï français ; puis, au lieu de la traditionnelle «narration»13, il leur a demandé de lui remettre des tercets composés par elles sur des sujets de leur choix. Les fillettes ont répondu avec joie à son appel, et j’ai devant moi les résultats de leur travail.
Que ces premières ébauches soient tout à fait satisfaisantes, on ne saurait le dire sans excès d’indulgence. Mais elles peuvent intéresser, par leurs qualités et par leurs défauts mêmes, les Français comme les Japonais. Et elles posent le problème de la valeur pédagogique du haïkaï.
Imposer à des élèves de lycée la concision du haïkaï, c’est les mettre en garde contre la rhétorique, l’éloquence, le «laïus».
Ceux qui connaissent par expérience notre enseignement littéraire traditionnel savent combien il peut être utile d’y réfréner les abus de verbiage. Le haïkaï est un excellent contrepoison à Cicéron et à Bossuet. Aussi bien, cet effort de brièveté, de concentration semble-t-il pénible à certaines des élèves qui s’y sont appliquées : dans la plupart de leurs haïkaï, il y a des adjectifs inutiles, des expressions toutes faites, – des longueurs.
Un autre objet, et plus profond, de cet exercice, serait d’amener les enfants à l’expression directe, concrète, d’une pensée originale. Les élèves de nos lycées voient la nature, les hommes, leur propre corps et leur propre cœur à travers les littératures anciennes et modernes dont on leur a bourré le crâne ; ils savent trop de vers des autres pour en créer qui soient bien à eux. Si pourtant on leur demande de noter, sans prétention et hors des cadres réguliers, une sensation, une émotion, un souvenir vécu, ils pourront quelquefois retrouver l’idée pure, la pensée vierge. Trois ou quatre fois, devant les haïkaï qu’a reçus mon ami Jean Laubier14, on a l’impression rafraîchissante d’une idée à l’état naissant.
Mais plus souvent, et par malheur, on trouve autre chose qu’un véritable haïkaï : un jeu de mots ou un trait d’esprit, ou une «pensée» à la manière de La Rochefoucauld. Le goût du «trait» et le goût de la «pensée» (l’un et l’autre d’ailleurs se confondant souvent) semblent ainsi des marques de ce qu’on appelle l’esprit français15.
Enfin, le haïkaï devrait donner à ceux qui s’y exercent le sens du rythme. Ce devrait être un travail poétique, c’est-à-dire un travail de construction, d’ajustage, une combinaison harmonieuse de syllabes en nombre choisi. Pour cela, d’ailleurs, il faudrait que le haïkaï français eût ses règles strictes, comme le haïkaï du Japon : les mêmes qu’au Japon ou d’autres, mais des règles. C’est par la forme plus encore que par le fond que pèchent les essais des fillettes de Saint-Omer. Les unes croient qu’un haïkaï n’est qu’une ligne de prose coupée arbitrairement et écrite sur trois lignes. D’autres négligent tout équilibre du vers et tout accord des sons. Et cela encore est un utile enseignement : cela prouve qu’un bon haïkaï ne se fait pas par subite inspiration, qu’il n’est pas si facile à forger qu’on le croit d’ordinaire. Il est agréable de constater que les premiers haïkaï de jeunes filles intelligentes et cultivées sont ingénieux et encourageants ; mais il est nécessaire qu’aucun ne soit excellent. Car un exercice ne vaut rien si l’on y réussit du premier coup.
En ce sens et sous ces réserves, j’espère que les lecteurs de la Revue Franco-Nippone reconnaîtront l’intérêt de cette expérience pédagogique. Je publie ci-dessous quelques exemples caractéristiques des haïkaï remis à Jean Laubier. Leurs auteurs ont quinze ans au plus ; la dernière a quatorze ans.
René Maublanc
Au loin, on voit s’approcher deux grands yeux.
Arrive un bruit sourd, lointain, un bruit confus.
Un sifflement aigu, un grincement, le train entre en gare.
Irène B…
***
Fier et solitaire,
La queue droite comme un épi,
Le chat se promène.
***
Un bêlement, un aboiement, une clochette,
Un ruisseau qui murmure,
Nuit dans la montagne.
Reynolde T.-R.
***
La chanson,
Comme une écharpe,
Flotte autour de ta voix.
***
La mer et le ciel. Un bateau
Vogue-t-il dans les nues
Ou sur l’eau ?
Édith N…
***
Du métal fondu.
Mêlez de la sueur d’homme.
Il en sort une machine.
***
Un travail, un péril immense.
La gloire aujourd’hui.
L’oubli demain.
Collette B…
***
Le muguet.
Clochette dont le son
S’est changé
En parfum.
Bibliographie
Barthes, Roland (2007 [1970]), L’empire des signes, Paris, [Éditions d’Art Albert Skira] Le Seuil.
Barthes, Roland (2003), La préparation du roman : I et II : notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980, Paris, Le Seuil.
Bassmann, Lutz (2008), Haïkus de prison, Paris, Verdier.
Chamberlain, Basil Hall (1902), «Bashô and the Japanese Poetical Epigram», Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. 2, n° 30, pp. 243-362.
Chipot, Dominique (2013), En pleine figure. Haïkus de la guerre de 14-18, Paris, Bruno Doucey.
Chipot, Dominique (2016), René Maublanc. Le haïku des années folles, Saint-Chéron, Éditions Unicité.
Couchoud, Paul-Louis (1906), «Les haïkaï (Épigrammes lyriques du Japon). I à IV», Les Lettres, avril-août.
Couchoud, Paul-Louis (1916), Sages et Poètes d’Asie, Paris, Calmann-Lévy.
Couchoud, Paul-Louis (2004 [1905]), (nouvelle édition établie par Éric Dussert), Au Fil de l’eau, Paris, Mille et une nuits.
De Rosny, Léon (1871), Anthologie japonaise : poésies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, Paris, Maisonneuve et Cie.
Gautier, Judith (1885), Poëmes de la libellule, [s.n.].
Jaccottet, Philippe (1967), Airs : poèmes : 1961-1964, Paris, Gallimard.
Jey, Martine (2005), «Quel enseignement littéraire pour les élites (1880-1924) ?», in Pierre Caspard, Jean-Noël Luc, Philippe Savoie, Lycées, lycéens, lycéennes, deux siècles d’histoire, Paris, Institut national de recherche pédagogique, pp. 199-210 (consulté sur www.persee.fr/doc/inrp_0000-0000_2005_act_28_1_9251).
Johnson, Jeffrey (2011), Haiku poetics in twentieth-century avant-garde poetry, Lanham, Lexington Book.
Léon, Antoine, Roche, Pierre (2012 [1967]), Histoire de l’enseignement en France, Paris, PUF.
Maublanc, René (1920), «Sur le Haï-Kaï français», La Gerbe, octobre, pp. 4-5.
Maublanc, René (1923a), «Le Haïkaï français, bibliographie et anthologie», Le Pampre, n°10-11, 2e année, pp. 1-62.
Maublanc, René (1923b), «Un mouvement japonisant de la littérature contemporaine : le Haï-Kaï français», La Grande Revue, n°2, février-mars.
Maublanc, René (1924), Cent Haïkaï, Maupré, Le Mouton Blanc.
Maublanc, René (1927) «Le Haï-Kaï au lycée», Revue Franco-Nippone, n° 6, août, pp. 34-37.
Paulhan, Jean [et al.] (1920), «Haïkaï», La Nouvelle Revue Française, n° 84, 1er septembre, pp. 329-345.
Senk, Pascale (2016), L’effet haïku, Paris, Leduc.s Éditions.
Shiki, Masaoka (2016), Un lit de malade six pieds de long (traduit, annoté et présenté par Emmanuel Lozerand), Paris, Les Belles Lettres.
Sirinelli, Jean-François (1994), Génération intellectuelle : Khâgneux et Normaliens dans l'entre-deux-guerre, Paris, Quadrige/PUF.
Pour citer l'article
Magali Bossi, "Haïku et pédagogie : le cas René Maublanc (1927)", Transpositio, Archives, 2019https://www.transpositio.org/articles/view/haiku-et-pedagogie-le-cas-rene-maublanc-1927
Voir également :
L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)
Le plan d’études romand actuel (2010){{https://www.plandetudes.ch/francais}}, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline « français », au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale{{La voie gymnasiale aboutit au certificat de maturité (l’équivalent pour la France du baccalauréat général).}} s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.
L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)
1. Introduction
Le plan d’études romand actuel (2010)1, dans la mouvance des orientations de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) de 2006, présente la littérature comme l’une des composantes de la discipline «français», au même titre que la compréhension ou la production de textes et la maîtrise du fonctionnement de la langue, et ce pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Ainsi, la voie gymnasiale2 s’inscrit aujourd’hui, non dans la rupture, mais dans le prolongement de l’école obligatoire en ce qui concerne l’enseignement de la littérature. Or, si cette situation peut nous paraître aller de soi, elle résulte d’un processus sur le long cours, la littérature française n’ayant pas toujours eu la place et la fonction qu’elle a aujourd’hui, non seulement au primaire, mais également au secondaire.
Mais qu’entend-on par «littérature» ici? L’étude de Caron (1992) nous rappelle que le mot littérature dérive du latin litteratura qui désigne au départ le fait de savoir lire et écrire et, par extension métonymique, la connaissance des grands textes qui permet de bien lire et de bien écrire. Avec les lexicographes du XVIIe siècle, le terme désigne avant tout une compétence. Ainsi, dans le dictionnaire de l’Académie de 1694, on trouve l’expression avoir de la littérature, le terme littérature renvoyant ici aussi bien à des textes scientifiques qu'artistiques. Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle que la littérature va se restreindre progressivement aux ouvrages à visée esthétique, devenant un synonyme de Belles Lettres, avant de s’en démarquer définitivement:
Belles Lettres affirmait une préoccupation prédominante du bien-dire dans l’étude des objets de langage. La multiplication des occurrences de littérature, non marqué à cet égard, ne traduirait-elle pas un recul de cette «utilisation» du texte? Autrement dit, n’assiste-t-on pas au passage d’un commentaire voué à l’acquisition d’un art langagier vers un discours plus «désintéressé», moins «instrumental» que savant, spéculatif, érudit, voire scientifique avant la lettre? (Caron 1992, : 189)
Le passage des Belles Lettres à la littérature se répercute dans le champ scolaire à la fin du XIXe siècle (Houdart-Mérot 1998). Ce processus va de pair avec le déclin des humanités classiques et la disparition du cours de rhétorique, supplanté par une discipline nouvelle, le «français». Savatovsky (1999) rappelle en effet qu’en France le «français» tel que nous le concevons aujourd’hui se met en place à cette période autour de trois principes:
- dans les collèges et les lycées, l’inversion de subordination entre les langues anciennes (grec et latin) et le français, ce dernier n’étant plus un auxiliaire des langues classiques mais une langue étudiée pour elle-même3;
- à l’école primaire, l’enrichissement progressif de la «formule des apprentissages fondamentaux» (Savatovsky 1999 : 37) –lire et écrire– par l’introduction de nouveaux savoirs liés à la langue nationale: projet scolaire d’acculturation et projet politique de francisation, en lieu et place des patois;
- dans les deux ordres d’enseignement, la mise en place de nouveaux exercices, «véritables éléments fédérateurs de la discipline en voie de constitution, et qui permettent d’allier à nouveaux frais la connaissance de la langue et celle de la littérature» (Savatovsky 1999 : 37).
Qu’en est-il en Suisse romande? Quand la littérature française entre-t-elle dans la sphère scolaire et sous l’influence de quels facteurs? Que recouvre alors cette notion et que vient-elle éventuellement remplacer? Par quels exercices est-elle abordée en classe? Et quels acteurs de la sphère scolaire jouent un rôle dans ce processus?
2. Précisions méthodologiques
Pour traiter ces questions, cette recherche prend appui sur la démarche historique et mobilise donc les outils de l’historien: recueil de sources, constitution de corpus et recours à la périodisation pour saisir le développement de la discipline observée. Ainsi, cette étude, tout en se centrant sur un empan temporel circonscrit –du milieu du XIXe au premier tiers du XXe siècle– s’appuie sur un vaste corpus archivistique (plans d’études, programmes, manuels scolaires, revues professionnelles) recueilli dans trois cantons: Genève (GE), Vaud (VD) et Fribourg (FR).
L’analyse de ces sources se fait ensuite sous deux angles complémentaires: d’une part, la place et les finalités assignées par les différents acteurs du monde politique et scolaire à la littérature dans l’enseignement du «français» au primaire et au secondaire; d’autre part, le choix des corpus, ainsi que celui des exercices et des approches privilégiées pour aborder ce corpus. Pour ce faire, deux concepts didactiques sont mobilisés. Il s’agit d’abord de la disciplinarisation, qui désigne le processus d’organisation progressive des savoirs en disciplines scolaires en lien avec la généralisation de la forme scolaire moderne qui s’opère tout au long du XIXe siècle (Hofstetter & Schneuwly 1998/2001)4. Il s’agit ensuite de la sédimentation des pratiques, selon laquelle l’enseignement est toujours le produit de pratiques provenant de différentes strates historiques (Schneuwly & Dolz 2009 ; Ronveaux & Schneuwly 2018).
Qui plus est, cette recherche prend en compte les deux ordres d’enseignement, primaire et secondaire. Elle se centre cependant pour le primaire sur les degrés intermédiaires et supérieurs (élèves de 9 à 15 ans environ), et pour le secondaire, sur le collège (élèves de 10 à 15 ans environ) et le gymnase (élèves de 16 à 18 ans environ)5, afin de mieux saisir quand la littérature française entre dans les classes et ce qu’elle vient éventuellement remplacer6.
Enfin, cette étude recourt à un jeu d’échelles. Tout en se situant au niveau de la Suisse romande, elle met en lumière certaines spécificités cantonales7, en lien avec deux facteurs : canton catholique (FR) versus cantons protestants (VD et GE) ; canton ville (GE) versus cantons ruraux (VD, FR). De même, des comparaisons ponctuelles avec la France permettent de mettre en exergue les spécificités de la Suisse romande en ce qui concerne l’avènement de la littérature dans la sphère scolaire au cours de cette période, mais aussi les circulations d’idées entre les deux contrées francophones.
Dans le texte qui suit, nous retraçons le processus d’entrée de la littérature au primaire et au secondaire en nous focalisant successivement sur trois périodes significatives. Nous nous centrons dans un premier temps sur les années 1850-1870, qui se caractérisent par le cloisonnement des ordres primaire et secondaire, chacun poursuivant des finalités très différentes, avec toutefois une ouverture à de nouveaux exercices et objets d’enseignement. Nous nous intéressons ensuite à la période allant des années 1870 aux années 1910, marquée par l’entrée du texte littéraire dans les corpus des deux ordres d’enseignement et l’émergence de l’explication de texte. Nous terminons avec une focale sur les années 1910-1930, période à laquelle les corpus et les exercices relatifs à la littérature se stabilisent. Enfin, notre propos est illustré par la présentation d’un ouvrage scolaire représentatif de chacune des périodes susmentionnées.
3. Les prémices d’un enseignement de la littérature (1850-1870)
Au début du XIXe siècle, le primaire et le secondaire ne sont pas destinés aux mêmes publics d’élèves. La plupart des écoliers –filles et garçons– effectuent leur scolarité à l’école primaire, centrée sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le collège accueille, quant à lui, les garçons issus des familles aisées. Son programme, fidèle à l’idéal humaniste, est centré sur l’apprentissage du grec et du latin. Après 15 ans, les jeunes gens ont la possibilité de continuer leurs études à l’Académie.
Ce qui tient alors lieu de littérature française dans les collèges, ce sont, comme en France8, les Belles Lettres, soit un «corpus d’auteurs français, essentiellement des dramaturges, des historiens et des prédicateurs du XVIIe» (Gabathuler & Védrines 2018 : 44). L’enseignement prodigué au primaire vise l’acquisition des rudiments et ne laisse pas de place à la littérature.
Or, dès les années 1850, cette situation change sous la pression de facteurs à la fois politiques et sociaux (Hofstetter & Monnier 2015). En effet, l’instruction publique se met en place dès les années 1830, par le biais d’une série de règlements et de lois, au sein de chaque canton. Ce processus est renforcé par la Constitution fédérale de 1848 qui confère officiellement la responsabilité de l’instruction publique aux autorités cantonales. Dans ce contexte, la prise de pouvoir des Radicaux à cette même période, aussi bien dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, est déterminante. Ceux-ci ont en effet la volonté de développer l’instruction publique et de la faire progresser, pour l’ajuster aux nouveaux besoins d’une société elle-même en évolution. Ainsi, la construction des systèmes scolaires en Suisse romande va se traduire, dès les années 1850, par une remise en cause du paradigme des humanités classiques, non sans impact sur la nature et la fonction des textes littéraires.
3.1. Une esquisse d’ouverture vers la compréhension des textes au primaire
Au milieu du XIXe siècle, l’enseignement primaire est encore très orienté vers la maîtrise des rudiments9. Ainsi, l’enseignement de la lecture reste principalement focalisé sur l’apprentissage du mécanisme pour parvenir à une lecture courante. En guise d’illustration, les analyses de Barras (1988) font état, pour le canton de Fribourg, de pratiques de lecture centrées sur les aspects mécaniques de l’apprentissage de la lecture, «l’intelligence» du texte, pour reprendre le terme usité à l’époque, n’important guère. Les recommandations exposées par A. Biolley dans la revue pédagogique l’Educateur en 1866 vont également dans ce sens : la lecture courante doit essentiellement porter sur la prononciation, l’observation de la ponctuation et les liaisons. Cependant, la série d’articles proposée par Biolley (1866) ne se limite pas à la lecture courante, ce dernier y ajoutant parmi les «espèces principales de lecture» (Biolley 1866 : 300), la lecture intelligente et la lecture expressive. Ces formes de lecture portent sur la compréhension du texte par l’élève qui se matérialise dans les programmes (ou équivalents10) par la prescription d’«explications» et de «comptes rendus».
Les prescriptions contenues dans les programmes sont très succinctes mais laissent à supposer que les explications sont essentiellement données par le maître. A titre d’exemple, dans le plan d’études vaudois paru en 1868, la leçon de lecture devient raisonnée et comporte des exercices d’intuition qui sont avant tout des questions précises posées par l’enseignant11 qui permettent aux élèves de mieux comprendre les textes.
Concernant les supports, les indications sont également vagues, comme en témoignent les prescriptions du programme genevois de 1852-1853 : des «livres élémentaires» pour les élèves de deuxième et troisième année ; des «livres moins faciles» pour les élèves de quatrième année ; enfin, des «livres plus difficiles» pour les élèves de cinquième année.
Néanmoins, l’analyse du corpus d’ouvrages pour l’enseignement de la lecture en usage à cette époque12 met en évidence que l’apprentissage du mécanisme s’effectue sur des tableaux de lecture, les élèves pratiquant ensuite la lecture courante sur des romans adaptés à la jeunesse dans les cantons protestants (Tinembart 2015), ou encore sur des textes religieux (Bible et catéchismes) dans le canton de Fribourg. C’est une visée instructive qui prédomine alors, la lecture courante se pratiquant sur des textes au caractère encyclopédique, moralisant ou éducatif, permettant à l’élève d’acquérir des connaissances utiles à son éducation.
Les différentes autorités cantonales sont à la recherche active d’ouvrages répondant à cette visée. Le canton de Vaud organise tout au long du XIXe siècle une série de concours pour doter les maîtres d’ouvrages scolaires de lecture destinés à l’enseignement. Les programmes de concours permettent aux auteurs d’alors de connaître les attentes des autorités et aux chercheurs d’aujourd’hui de mieux saisir la conception de la lecture et de la littérature des divers acteurs de l’époque.
Ainsi, dans l’école primaire vaudoise, la première trace laissée par les autorités scolaires relative à une préoccupation liée à la littérature remonte au Programme des concours pour la publication de livres élémentaires(1840)13. En effet, il s’agit pour les futurs auteurs de «conduire les jeunes élèves à lire couramment un livre quelconque, en leur offrant des exercices gradués de prononciation, et des lectures progressives, en accord avec les premiers développements de l'intelligence des enfants» (p. 44), mais aussi de leur apporter «toutes les choses bonnes, utiles, propres à concourir au but de l’éducation populaire» (p. 50). De plus, «on ne se fera pas un point d'honneur de n'offrir que des morceaux neufs et originaux: les grands écrivains présentent des pages aussi bien appropriées aux besoins des élèves d'une école primaire qu'elles sont admirées par l'homme du goût le plus cultivé» (p. 53). Enfin, les futurs auteurs sont également encouragés à s’inspirer de la Chrestomathie (1829, 1e éd.) d’Alexandre Vinet14, car son ouvrage offre des «modèles pour la composition» aux écoles primaires. Cette recommandation dénote une influence de l’ordre secondaire sur le primaire, la Chrestomathie de Vinet étant, comme nous allons le voir, un ouvrage conçu pour les élèves du secondaire.
La seconde trace remonte au 25 janvier 1859. En effet, suite à l’expertise d’un ouvrage de lecture, le rapport du Département donne l’autorisation d’éditer l’opuscule bien qu’«on ne saurait lui trouver un mérite réel, ni au point de vue philosophique ou scientifique, ni au point de vue littéraire»15. Certes, il était conseillé aux potentiels auteurs d’ouvrages scolaires de s’inspirer d’«exemples puisés dans les meilleurs écrivains»16, mais c’est encore avant tout le caractère encyclopédique et progressif des textes contenus dans les ouvrages de lecture qui régit le choix des autorités.
Il s’avère que les représentations liées à ce que devrait contenir un ouvrage de lecture destiné à l’école primaire changent dans la décennie suivante. Une volonté institutionnelle de faire entrer la littérature dans les ouvrages scolaires primaires s’exprime alors. En 1865, les cantons romands organisent une seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers, choisis notamment dans la littérature, au degré supérieur.
3.2. Entre Belles Lettres et littérature
Qu’en est-il au collège et au gymnase? L’analyse des programmes de ces deux institutions montre que les années 1850 se situent dans un entre-deux, où l’ancien côtoie le nouveau.
Jusqu’alors centré sur les humanités classiques, le curriculum du collège s’ouvre à des disciplines nouvelles, dont le français, qui s’autonomise par rapport aux langues anciennes et comprend une véritable progression. Ainsi, à Genève (programme de 1859), le jeune homme commence dans les petits degrés par la récitation de morceaux choisis «dans le Manuel»17, pour finir par des exercices de composition en lien avec des «exercices d’analyse grammaticale et littéraire de morceaux en prose et en vers». Ces derniers sont tirés des tomes 1 et 2 de la Chrestomathie de Vinet. De même, dans le canton de Vaud, le programme de «langue française» de 1853 commence dans les premiers degrés par la lecture d’ouvrages d’Histoire adaptés aux enfants18, pour aller vers la «lecture analytique» et la «lecture cursive» de morceaux de la Chrestomathie de Vinet (tome 1, puis 2, puis 3), avec en dernière année l’introduction du Cinna de Corneille. Il n’en demeure pas moins que la lecture de ces morceaux reste au service de la composition qui constitue la finalité de cet enseignement, en vue de l’entrée au gymnase sur lequel souffle cependant également un vent nouveau.
Au gymnase, le cours de rhétorique à Genève (programme de 1859) s’intitule «rhétorique et littérature française». Le programme, sur deux ans, est le suivant : rhétorique et histoire abrégée des principaux genres de prose et de poésie, exercices de composition française, récitation de morceaux choisis tirés du tome 2 de la Chrestomathie de Vinet et récitation de l’Art poétique de Boileau. De même, à Fribourg, les programmes du gymnase de l’Ecole cantonale19 de 1849 et 1857 prescrivent pour le cours de «langue française» le recours aux deux premiers volumes de la Chrestomathie de Vinet20, auxquels s’ajoutent quelques auteurs du XVIIe (Boileau, La Fontaine, Fénélon), utilisés comme supports pour l’«analyse»21, et pour les exercices constitutifs du cours de rhétorique –«étude de modèles» ou encore «essais oratoires».
Ainsi, bien que l’on reste dans un enseignement très imprégné par la rhétorique, l’omniprésence de la Chrestomathie de Vinet dans les programmes des collèges et gymnases des trois cantons inscrit ceux-ci sans conteste dans une ère nouvelle. Dans l’Avant-propos du tome 1 de sa Chrestomathie (1829a), Vinet annonce la singularité de son projet qu’il met en regard des Leçons de Littérature et de morale de Noël et Delaplace (1804-1805):
Aussi les morceaux qui composent le recueil de MM. Noël et Delaplace paraissent-ils avoir été destinés surtout à des exercices de mémoire et de déclamation ; et ils y conviennent parfaitement. [...] Nous voudrions une chrestomathie qui renfermât sinon des ouvrages, du moins des morceaux assez considérables pour qu’on y pût voir déployés une grande partie des procédés nécessaires pour la confection totale de l’ouvrage auquel ces morceaux appartiennent (Vinet 1829a : 8)
L’ouvrage de Noël et Delaplace est un manuel de rhétorique (Douay-Soublin 1997). La littérature, bien que présente dans le titre, est encore un synonyme de «Belles Lettres», dans la mesure où, comme le rappelle Chervel «elle n’est pas en prise sur des ‘œuvres’ ; elle n’a besoin que de morceaux choisis à titre d’illustrations [qui] n’ont pas vocation à être ‘expliqués’ au sens moderne du terme, mais à être appris par cœur et imités» (Chervel 2006 : 488-489).
Or, le projet de Vinet est tout autre, même si sa visée reste rhétorique, car au service d’une composition centrée sur l’elocutio qui «seule a du prix à nos yeux» (Vinet 1829a : 7). Son point de départ est en effet l’enseignement de la langue française et de la littérature, non pas en contexte francophone, mais en contexte germanophone. Il s’agit d’abord pour Vinet, qui enseigne à Bâle, de proposer à ses élèves d’apprendre le français en lisant et en traduisant des extraits issus des grands textes de la littérature française. Le tome premier, La Littérature de l’Enfance, est d’ailleurs accompagné d’un lexique français-allemand fait par un ami de l’auteur. Dans ce cadre «expliquer» signifie donc «traduire».
Comme le rappelle Rambert (1930) cependant, Vinet a aussi songé aux écoles françaises en élaborant son anthologie. Plaçant sa réflexion sur l’enseignement de la littérature «à la croisée d’une visée morale de l’éducation, d’une ambition progressiste de l’école et d’une attention patiente aux textes» (David 2017 : 12), Vinet a l’ambition de faire lire en classe les auteurs classiques du XVIIe, mais aussi certains auteurs contemporains «avec les soins attentifs et la précieuse lenteur qu’on apporte à celle des classiques anciens» (Rambert 1930 : 174). Vinet s’en explique lui-même dans la préface de la première édition du tome 2 intitulé Lectures pour l’adolescence:
On a lieu de s’étonner que la méthode suivie dans nos écoles pour la lecture des auteurs latins et grecs ne soit appliquée, avec les modifications convenables, à la lecture des classiques de la langue maternelle. [...] Les circonstances qui m’ont porté à faire usage de cette méthode dans l’enseignement de la littérature française à de jeunes étrangers m’ont fourni l’occasion de me convaincre qu’elle est applicable, dans ce qu’elle a d’essentiel, au cas de jeunes gens lisant sous la direction d’un maître les chefs-d’œuvre de leur propre langue. (Vinet 1829b : 1-2)
Dans cette première édition, il ne développe cependant pas sa propre méthode, mais invite les enseignants à recourir avec leurs élèves à la méthode de Rollin22.
La Chrestomathie de Vinet comprendra 30 rééditions successives jusqu’en 1930. Dès la deuxième édition de 1833, elle devient rapidement un «best-seller». Intéressons-nous à présent à ses contenus.
3.3. La Chrestomathie de Vinet
Vinet, passionné d’œuvres littéraires, a à cœur de rédiger une Chrestomathie dont les extraits sont tirés «des chefs-d’œuvre classiques» (Vinet 1829a : IX). Ceux-ci doivent permettre «d’apprendre à les imiter sous le triple rapport de la langue, du style et de la composition générale, en un mot sous le rapport de l’art d’écrire, tel que Buffon le concevait» (Vinet 1829a : IX). La première édition du Tome 1 de 1829 destinée aux collégiens de 12-14 ans se compose de neuf parties ayant pour titres : narrations fictives (6 extraits), biographies (4 extraits), histoire (7 extraits), voyages (3 extraits), descriptions (2 extraits), genre didactique (3 extraits), dialogues (8 extraits), lettres (4 extraits) et poésies réparties en fables (25 fables), narrations (6 extraits) et scènes (2 extraits). La plupart des auteurs23 sont présentés sous la forme d’une courte biographie.
Si Vinet sélectionne des morceaux, c’est parce qu’un ouvrage complet «est hors de proportion avec la capacité de l’enfant ou le degré de ses connaissances philosophiques» (Vinet 1829a : V). Cela évite aussi à l’instituteur de devoir lui-même choisir les extraits. Ceux qu’il propose sont courts (en moyenne dix pages pour les textes narratifs et descriptifs) car «dans la jeunesse, ce sont les détails qui nous frappent et nous séduisent ; des figures neuves, des images éblouissantes, des expressions originales nous paraissent l’essentiel de l’art d’écrire» (Vinet 1829a : VII). Le grand choix de lectures proposé peut être «coordonné à l’enseignement grammatical» (Vinet 1829a : VIII) et permet de «retrouver dans un morceau d’histoire la plupart des éléments du talent de l’historien, dans un morceau d’éloquence les principales conditions qui constituent l’orateur, et ainsi des autres genres» (Vinet 1829a : VIII). Enfin, les morceaux sont organisés afin que «la marche du facile au difficile, du simple au composé, y fût suivie autant que possible, soit à l’égard du style, soit à l’égard des idées» (Vinet 1829a : IX) ; pour ce faire, une table des matières particulière permet à l’enseignant de concevoir la progression entre les textes. Enfin, Vinet a porté son choix sur les écrivains «qui font autorité en fait de langage et de style» (Vinet 1829a : IX) et les «talents contemporains» dans le but de «présenter la langue française avec toutes les acquisitions qu’elle a faites jusqu’à nos jours» (Vinet 1829a : X).
Vinet ajoute à la seconde édition (1833) 26 nouveaux extraits dont neuf appartiennent à une nouvelle sous-partie intitulée «poésie lyrique». Ces ajouts concernent tous les thèmes, mais essentiellement les lettres et les fables. Sur les 114 extraits que contient la deuxième édition de la Chrestomathie, Tome 1, les auteurs sont essentiellement français (seulement quatre Suisses figurent parmi eux). Un tiers des textes sont de Fénélon, La Fontaine, Florian et Madame de Sévigné. Nous trouvons 48 extraits d’auteurs du XVIIe siècle, 33 extraits du XVIIIe siècle et 28 extraits émanent de contemporains de Vinet encore vivants, dont 15 ajoutés dans la deuxième édition. Cet ajout démontre que l’auteur s’informe des nouveautés littéraires de son époque et souhaite que son ouvrage reste d’actualité.
4. Littérature et disciplinarisation du «français» (1870-1910)
La période couvrant la fin du XIXe et le début du XXe siècle se caractérise par l’avènement des «Etats enseignants» (Hofstetter 2012) qui, suite à la Constitution fédérale de 1874, vont entériner l’obligation scolaire jusqu’à 15 ans. Cette obligation entraîne alors la création d’institutions et de filières au niveau secondaire, d’enseignement général, mais aussi professionnel. Il s’agit en effet d’une part de répondre aux besoins de l’industrie qui se développe en Suisse et qui requiert des ouvriers qualifiés, d’autre part de préparer une élite à l’entrée dans les universités et les écoles polytechniques qui sont créées à cette période.
Chaque canton institue de fait un système scolaire, avec un ordre secondaire, constitué d’un degré inférieur et d’un degré supérieur, et désormais articulé à l’ordre primaire. Cette première phase de démocratisation de l’enseignement (Hofstetter & Monnier 2015), qui se traduit par l’ouverture du secondaire à tous les publics d’élèves, entraîne de fait la mise au rebut officielle des humanités classiques, au profit de disciplines nouvelles, dont le «français». Cette dernière s’étend rapidement sur l’ensemble du système, entraînant progressivement la montée vers le secondaire de certains manuels de lecture conçus pour le primaire supérieur, ces derniers étant élaborés sur le modèle de la Chrestomathie de Vinet.
4.1. Vers l’explication de texte (littéraire) au primaire
L’enseignement de la lecture au primaire prend une autre dimension à partir des années 1870. Les trois dernières décennies du XIXe siècle voient en effet s’amplifier le processus de disciplinarisation du «français» amorcé dans les années 1850, processus qui se caractérise notamment par une articulation de la lecture et des éléments relatifs à la langue (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire) dans un dispositif dont l’aboutissement est la composition. Dans ce processus, en partie influencé par les proposition du Père Girard, pédagogue fribourgeois, le livre de lecture devient progressivement central24, comme l’illustre ce propos tenu dans l’Educateur :
Le livre de lecture doit donc devenir désormais le point de départ, le centre de l’enseignement de la langue maternelle comme cet enseignement lui-même doit être le centre des études primaires. C’est à l’étude raisonnée du livre de lecture, que doit se rapporter le résumé grammatical ; c’est sur ce livre de lecture, que doit se régler aussi le cours de style et enfin le cours de composition. (Bourqui 1870 : 336)
Au niveau des prescriptions, on observe une diversification des formes de lecture : à la lecture courante est ainsi ajoutée la lecture expressive25 et le «compte rendu» évolue progressivement vers l’explication, processus qui s’achèvera avec l’avènement de la lecture expliquée dans les premières décennies du XXe siècle.
En continuité avec les prescriptions des années 1850-1860, le compte rendu s’inscrit tout d’abord dans le paradigme de la lecture instructive et morale. Ainsi, le règlement scolaire fribourgeois de 187626 préconise, pour le deuxième cours (élèves de 10-12 ans), d’effectuer le compte rendu «par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et propres à orner la mémoire de l’enfant de connaissances utiles et à diriger son éducation morale» (Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg, 1876). La visée morale de la lecture perdure ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle, comme en témoignent également les prescriptions vaudoises de 1899 : «Sujets en rapport avec les autres leçons. Analyse du contenu, énoncé des faits principaux, comparaison ; préceptes moraux et applications pratiques. Récitation de morceaux choisis» (Plan d’études pour les écoles enfantines et les écoles primaires du canton de Vaud, 1899, degré intermédiaire 2e année).
Cependant, tout en s’inscrivant dans la continuité des pratiques en place, le compte rendu s’oriente progressivement vers la compréhension du texte pour lui-même. On trouve ainsi dans le Programme prescrit pour les écoles primaires du canton de Fribourg de 1886 : «compte-rendu par le moyen d’interrogations de plus en plus générales et de nature à obtenir l’expression claire et correcte des principales idées du texte» pour le premier cours du degré supérieur ; «compte-rendu libre et constituant le résumé oral et correct des idées renfermées dans le texte» pour le deuxième cours du même degré. Le compte rendu s’y effectue essentiellement oralement: d’abord à partir des interrogations du maître, puis librement. Bien que les prescriptions varient en fonction des cantons, une tendance commune semble se dégager : une partie de l’explication porte sur le vocabulaire et la grammaire, une autre partie est consacrée à la compréhension du texte (dégager l’idée générale, énoncer les faits principaux, rechercher le plan, etc.).
Enfin, les mentions relatives aux supports sont très succinctes dans les programmes : morceaux simples (pour les petits degrés), prose et poésie pour la récitation. Cette période voit cependant la parution de deux livres de lecture qui, comme nous allons le voir, annoncent l’entrée des textes littéraires au primaire.
4.2. Un ouvrage primaire et secondaire
En 1865, les cantons romands organisent une Seconde Commission intercantonale en vue d’adopter un ouvrage commun pour les degrés intermédiaires (9 à 12 ans) et supérieurs (12 à 15 ans) de la scolarité obligatoire. Cette dernière propose de choisir des textes de complexité progressive allant de courts récits au degré intermédiaire à des morceaux de genres divers au degré supérieur, choisis notamment dans la littérature. Les premiers livres de lecture adoptés par la Suisse romande (Renz 1871 ; Dussaud & Gavard 1871) en sont de parfaits exemples.
Le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard27 (1871) est destiné à la fois aux degrés supérieurs de l’école primaire vaudoise et genevoise. Les courts morceaux choisis par les auteurs, tous deux enseignants, sont numérotés et regroupés par thématiques qui se répartissent en neuf parties28: histoire naturelle (120 extraits descriptifs dont une moitié est anonyme), descriptions et voyages (16 récits), histoire (15 morceaux), biographies (huit portraits), anecdotes, traits moraux, caractères (21 extraits), style épistolaire (10 extraits de lettres), dialogues en prose (trois extraits de pièces théâtrales), dialogue en vers (trois extraits) et poésie narrative et lyrique (31 extraits).
Force est de constater que les thèmes de science naturelle prennent une grande place dans cet ouvrage annonçant la «leçon de chose», tout en offrant cependant également une place importante à la littérature de Suisse romande (Schneuwly & Darme 2015 ; Gabathuler 2017). Il y a en effet 32 textes d’écrivains suisses essentiellement vaudois et genevois (Agassiz, Vuillemin, Monnard, Porchat ou Töpffer) contre 75 auteurs français. Parmi eux, nous retrouvons certains auteurs déjà présents dans la Chrestomathie de Vinet (1833)29 (Fénélon, Florian, La Fontaine, Molière, Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand ou Buffon). Fribourg renonce dans un premier temps à utiliser ce livre de lecture à l’école primaire, mais décide d’en éditer une adaptation en 1882. Celle-ci se divise alors en deux parties clairement identifiées, la partie scientifique et la partie littéraire, dont :
Les morceaux ne sont point choisis au hasard. Ils forment un petit cours de composition donnant des modèles de tous les genres de style, en même temps qu’une histoire littéraire, très succincte sans doute, mais bien suffisante pour les élèves auxquels ce livre est destiné. (Dussaud & Gavard adapté par Fribourg 1882 : 7)
Par l’observation de ces deux éditions, nous pouvons relever un processus de sédimentation : une grande part des auteurs choisis par Vinet (1833) sont repris par Dussaud et Gavard (1871); l’ouvrage propose ainsi une histoire de la littérature adaptée à l’âge des élèves, mais sur le modèle proposé dans le secondaire supérieur qui reste au service de l’enseignement de la composition selon le modèle rhétorique. Les textes sont numérotés, classés par catégories et organisés selon leur complexité.
4.3. Un corpus littéraire au service de nouvelles finalités
L’articulation progressive des degrés inférieurs et supérieurs du secondaire facilite la mise en place d’un «français» unifié sur l’ensemble du secondaire, qui va se caractériser avant tout par un corpus littéraire spécifique. En effet, contrairement à la période précédente où les enseignants s’appuient très largement sur la Chrestomathie de Vinet, le dernier tiers du XIXe siècle peut être considéré comme un moment clé dans l’élaboration de ce qu’on entend aujourd’hui par «littérature» en classe de français.
L’analyse des programmes du Collège cantonal de Vaud (1877, 1891) et des degrés inférieurs du Collège de Genève (1877, 1889) montre que, outre l’ouvrage de Dussaud et Gavard (1871) introduit dans les premiers degrés, la Chrestomathie de Vinet continue à être présente dans les derniers degrés30. Avec l’ouverture du secondaire à un nouveau public d’élèves, le nombre de classe augmente et l’utilisation d’un manuel qui a fait ses preuves permet de garantir une certaine harmonisation dans les pratiques.
Il n’en est cependant pas de même au secondaire supérieur, où les anthologies tendent à disparaître au profit d’une liste d’auteurs et de textes, élaborée par les enseignants eux-mêmes. Très succincts dans le dernier tiers du XIXe, et limités aux œuvres travaillées en classe de français, ces inventaires s’étoffent au tournant du XXe siècle pour devenir de véritables listes qui comprennent deux sections: les lectures à faire en classe, et –pratique nouvelle– un choix de lectures à domicile:
Les lectures faites à domicile et contrôlées en classe ne sont pas tout à fait une innovation. La plupart de nos établissements possèdent une bibliothèque où les élèves puisent abondamment. Ils continueront, espérons-le. Mais on veut qu’il y ait un plan de lecture graduée, commençant par des morceaux choisis et continuant par des fragments plus étendus des grands écrivains, par des pièces de théâtre, par des morceaux de poésie caractéristiques, de façon que l’enseignement de la littérature, venant à son heure, s’appuie sur des souvenirs précis, sur la connaissance de quelques textes. (Plan d’études pour les collèges et gymnases du canton de Vaud 1910 : 7-8)
Ce phénomène est particulièrement visible dans le programme du Collège de Genève de 1900 (cf. Annexe 1). Le corpus des lectures en classe, tout en conférant une large place aux auteurs du XVIIe siècle –Corneille, Racine, Molière, mais aussi Boileau, Fénélon et Bossuet– est organisé désormais selon une progression chronologique, qui va de la Chanson de Roland aux auteurs du XIXe (Chateaubriand, Musset, Gautier). Ce corpus sert avant tout de support au cours d’histoire de la littérature qui figure désormais à l’épreuve orale de maturité, laquelle comporte trois parties : grammaire française, histoire de la langue française et histoire de la littérature française31.
Le choix des textes proposés en lecture à domicile fait, quant à lui, état d’une sédimentation des pratiques. Ce corpus garde en effet des traces des Belles Lettres, avec une large place donnée aux textes historiques et rhétoriques du XVIIe siècle (Dialogues sur l’éloquence de Fénélon). Pourtant, au sein de cette continuité, le corpus comprend également une très large sélection de textes d’auteurs du XIXe, et offre une place de choix à la nouvelle, avec notamment Les Lettres de mon Moulin et Contes du lundi d’Alphonse Daudet, et au roman, avec par exemple François le Champi et La Mare au Diable de George Sand. Par ailleurs, les auteurs suisses romands (Eugène Rambert), voire genevois (Victor Cherbuliez, John Petit-Senn, Marc Monnier, Rodolphe Töpffer), sont largement représentés, dans la ligne directe du corpus proposé dans le Dussaud et Gavard (1871). On trouve ainsi des poètes, mais aussi des scientifiques (Horace Bénédict de Saussure) et des philosophes (Charles Secrétan).
Autrement dit, on sort avec ce double corpus du paradigme rhétorique où le texte littéraire est là pour être appris par cœur et imité, même si ce dernier perdure à titre résiduel. La lecture de ces textes, en classe ou à domicile, obéit désormais à de nouvelles finalités : l’acquisition d’une culture littéraire large, qui n’est cependant pas détachée de la construction d’une identité helvétique.
En 1911, Henri Mercier32 n’hésite pas à placer la Suisse romande en avance sur la France dans l’élaboration d’un corpus littéraire spécifique au «français» : «dans notre pays, nous n’avons pas certes attendu jusqu’en 1880 pour autoriser les Provinciales, pour donner un laisser-passer à Victor Hugo» (Mercier 1911 : 195). Il n’en demeure pas moins que l’ouverture du corpus aux auteurs modernes ne fait pas l’unanimité au sein du corps enseignant, comme le met en évidence cet article de Charles Favez33, publié la même année dans la Gazette de Lausanne, et qui porte le débat sur la place publique :
Dans l’étude faite au Collège et au Gymnase des grands écrivains français, M. Sensine34, comme M. Bouvier35, donne la préférence à ceux du XIXe siècle, parce, dit-il, que les grands maîtres du siècle de Louis XIV, «tout remarquables qu’ils sont, ont le défaut, au point de vue pédagogique, d’exprimer une autre âme que la nôtre et de parler une langue que nous n’employons plus, tandis que ceux du XIXe expriment notre vie, notre âme, et emploient vraiment notre idiome moderne». Je demande au distingué professeur la permission de discuter ici cette idée. […] A notre époque […] quoi de plus actuel que le caractère de Phèdre ou celui d’Oreste? […] Ce n’est pas tout : il y a encore la langue. […] Certes, personne n’admire plus que moi la prodigieuse invention verbale de Victor Hugo […]. Mais pour la pureté de la langue, il me paraît cependant qu’il faut donner la préférence aux écrivains du siècle de Louis XIV. (Favez 1911).
Au cœur du débat en réalité, la langue : faut-il privilégier les auteurs du XVIIe siècle, qui incarnent un certain idéal de la langue française, ou plutôt les auteurs du XIXe, qui s’expriment avec la même langue que les élèves? Et si l’on maintient les classiques du XVIIe siècle, ne doit-on pas imaginer de nouveaux exercices permettant aux élèves, toujours plus nombreux avec la création d’un secondaire pour tous, de comprendre ces textes, dont la langue n’est plus la leur?
5. De la lecture expliquée à l’explication de texte (1910-1930)
Le début du XXe siècle est marqué par la stabilisation des systèmes scolaires cantonaux qui va de pair avec la stabilisation des disciplines scolaires. Ainsi, le «français» s’organise désormais autour de composantes – grammaire, littérature, lecture, composition – et d’exercices spécifiques. C’est dans ce contexte qu’apparaît un nouvel exercice de lecture – la lecture expliquée – qui va s’étendre sur le primaire et le secondaire.
5.1. Avènement de la lecture expliquée au primaire
A partir des années 1920, l’orientation donnée à la lecture dans le dernier tiers du XIXe siècle s’affirme et se stabilise. Elle se caractérise notamment par la place centrale du texte littéraire dans la composante lecture et la lecture expliquée36 comme exercice phare au primaire (voir également les analyses de Schneuwly & Darme 2015).
Ainsi, en adéquation avec les recommandations figurant dans les préfaces des livres de lecture, les prescriptions recentrent clairement les exercices d’explication sur le texte littéraire. A titre anecdotique, mais révélateur de ce mouvement au niveau romand, on voit apparaître dans la partie pédagogique de l’Educateur une rubrique «Texte littéraire». En outre, on observe l’entrée du terme littéraire, jusqu’ici absent des prescriptions37, dans les programmes des trois cantons parus dans les années 1920-193038. Enfin, on y note l’apparition de la «lecture expliquée»39, qui résulte de la progressive stabilisation des exercices d’explication et de comptes rendus prescrits dès le dernier tiers du XIXe siècle.
Cette nouvelle forme de lecture a été amorcée dans différents articles spécialisés parus dans les revues pédagogiques dans les années 1910, à l’instar de La lecture expliquée par Henri Mercier (1911) et Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée par Henri Duchosal40 (1918). Fait significatif de l’articulation entre le primaire et le secondaire, ces deux écrits sont rédigés par des enseignants du secondaire. Celui de Duchosal est même une adaptation pour le primaire supérieur d’un article que ce dernier a publié dans l’Educateur en 1917 pour le secondaire inférieur:
Pensant que notre article sur la lecture expliquée paru dans L’Educateur, au mois de février 1917, et destiné aux établissements d’instruction secondaire, pourrait être aussi de quelque utilité pour les écoles primaires, le Département de l’Instruction publique a bien voulu nous demander de l’adapter à ce degré de l’enseignement en le simplifiant et en le faisant suivre d’exemples concrets qui lui donneraient un caractère pratique (Duchosal 1918 : Avant-propos).
De ces articles se dégagent quelques traits fondamentaux de la lecture expliquée au primaire. Ainsi, pour Mercier, une première phase de l’explication devrait être centrée sur le vocabulaire : «Un autre service de ces premières lectures expliquées devrait être d’enrichir le vocabulaire, le vocabulaire concret s’entend, encore si pauvre» (Mercier 1911 : 199). L’explication devrait être ensuite consacrée à l’étude du plan et à la compréhension des idées contenues dans le texte. La marche à suivre proposée par Duchosal (1918) est différente de celle de Mercier, mais on y retrouve les mêmes composantes, à savoir un travail sur le fond et un travail sur la forme (comprenant la grammaire en sus du vocabulaire). L’ordre des étapes est le suivant:
1. lire le morceau
2. donner le sujet du morceau et préciser le but de l’auteur
3. retrouver le plan
4. expliquer les idées du texte
5. discuter la valeur de celles-ci
6. dégager les caractéristiques formelles du morceau avec une centration sur le vocabulaire et la grammaire
7. procéder au compte rendu, soit à la synthèse de l’explication.
A noter que ce compte rendu pour Duchosal doit être effectué par un élève, les autres étapes de la leçon devant être réalisées sous la forme d’une leçon dialoguée entre maître et élèves.
Dans les prescriptions du primaire toutefois, il n’est pas aussi aisé de saisir en quoi consiste la lecture expliquée dans le détail ni la manière de procéder. En effet, certaines préconisations figurant dans les programmes restent assez vagues, à l’instar des exemples suivants : «Étude élémentaire du contenu et de la forme» (Guide et plan d’études de l’enseignement primaire dans le canton de Fribourg, 1932, degré moyen) ; «Remarques littéraires élémentaires» (Plan d’études pour les écoles primaires du canton de Vaud, 1926 : degré supérieur). Qui plus est, on relève la persistance d’une dimension morale, présente cependant explicitement chez Duchosal (1918), dans le programme fribourgeois de 1932 : «Exciter et développer le goût de la lecture saine et réconfortante par des lectures faites par le maître de pages littéraires et morales captivantes [...]» (p. 32).
5.2. Une nouvelle génération d’ouvrages de lecture
Si la littérature devient prépondérante dans les manuels de lecture au primaire comme au secondaire, désormais, c’est le type de littérature à privilégier qui sera discuté. En 1893, Le Département de l’Instruction publique et des cultes vaudois mandate Louis Dupraz et Emile Bonjour41 pour rédiger deux ouvrages afin de remplacer le Renz (1871) et le Dussaud et Gavard (1871). Non seulement les autorités vaudoises se désolidarisent des autres cantons romands, mais demandent en outre aux auteurs de faire une large place à la littérature nationale. Deux nouveaux ouvrages sont édités : le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1895) et le Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire (Dupraz & Bonjour 1903).
Ces deux livres de lecture annoncent un changement quant aux morceaux choisis qui se confirme dans la seconde édition de l’opuscule destiné au degré supérieur (Dupraz & Bonjour 1899, 2e éd.). L’ouvrage comporte désormais un quart de textes d’auteurs suisses, dont la plupart sont francophones, et sept traductions. Nous constatons également que les textes descriptifs sur les sciences naturelles disparaissent au profit de textes littéraires dont le thème est la nature. Enfin, les morceaux choisis traitent de thématiques proches de l’environnement de l’enfant et de l’adolescent, ce qui permettrait, selon les auteurs, d’inscrire leur apprentissage dans leur quotidien (Tinembart 2018).
Dix ans plus tard, Dupraz et Bonjour, en collaboration cette fois-ci avec Henri Mercier, rédigent une Anthologie scolaire (1908) destinée aux collèges secondaires et aux écoles primaires supérieures (élèves de 13 à 15 ans) et adoptée par le canton de Genève. Cette anthologie comporte 259 extraits de textes répartis en dix parties. Non seulement elle contient des auteurs qui ne figurent pas dans le livre de lecture écrit pour les écoles primaires (Fénélon, Stendhal, Zola, Descartes, Flaubert, Flammarion, Montaigne, La Bruyère, Musset, etc.), mais une partie «études littéraires» et une partie «théâtre» sont intégrées. Dans la première, les élèves apprennent les caractéristiques de la langue française, les particularités de l’orthographe et de la ponctuation. Dans la seconde, ils font entre autres la connaissance de Corneille et retrouvent Racine et Molière. Enfin, l’ouvrage se termine par 26 pages regroupant des biographies succinctes des 159 auteurs présents dans ce manuel.
A la mort de Dupraz, Bonjour édite deux nouveaux manuels : Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire (1925) et Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur (1931). Les morceaux choisis abordent des thématiques qui concernent encore davantage les élèves telles que l’observation des animaux, les récits d’aventure, les qualités et les défauts, la vie quotidienne, etc. Celles-ci répondent plus aux intérêts des enfants et à leurs goûts personnels. L’influence de l’École nouvelle42 pourrait expliquer ce changement. La plupart des morceaux choisis écrits par des auteurs français ne figurent pas dans les ouvrages précédents de Bonjour. Celui-ci fait également entrer de nouveaux auteurs suisses tels que Maurice Porta, René Morax, Gonzague de Reynold ou encore Charles Ferdinand Ramuz. Sont également privilégiés les auteurs contemporains (sur les 244 textes présents dans l’ouvrage, 93 auteurs sont nés au XIXe siècle et 41 au XXe siècle). Le livre de lecture n’est désormais plus encyclopédique, mais il offre une grande diversité littéraire. Il propose ainsi des textes proches du vécu de l’enfant et ses extraits proviennent de la littérature suisse et française.
En 1910, Henri Mercier résume bien ce renouveau dans les ouvrages de lecture : «Gardons ce qui est substantiel en littérature, en morale, en histoire. Préoccupons-nous de la vie. Ornons les esprits, mais tâchons d’abord de les faire réalistes et pratiques» (Mercier 1910 : 90-91) ; «[…] Le manuel, lui aussi, s’est mis au ton du jour. Il suit le mot d’ordre : “Tout par les textes !”» (Mercier 1910 : 94).
5.3. De l’institutionnalisation de l’explication de texte au secondaire
Les années 1910-1920 peuvent être considérées pour le secondaire comme le moment clé où le «français» devient une discipline organisée désormais autour de trois piliers : un corpus littéraire spécifique et deux exercices progressivement placés à égalité. Il s’agit de la dissertation, présente dans les programmes dès la fin du XIXe, et de l’explication de texte, qui entre dans les pratiques à cette période, non sans débats cependant, comme le laisse entendre Mercier:
L'explication française, officiellement instituée partout ou peu s'en faut, n'est-elle qu'un vain ornement sur la façade des programmes? Est-ce une expression creuse et sonore? N'est-ce pas plutôt le bon sens même et une pièce essentielle de l'enseignement? Des livres excellents, de nombreux articles, des discussions courtoises ou vives nous prouvent l’intérêt, l’importance et la nouveauté de ce sujet. Oui, sa nouveauté. (Mercier 1911 :198)
Sur la scène romande en effet, si les pédagogues s’accordent sur la nécessité de travailler à partir de morceaux tirés d’anthologies, les approches pour aborder ceux-ci diffèrent. Ainsi, Bouvier, dans une conférence adressée aux futurs ou jeunes maîtres de français en 1910 à Zurich, défend la «lecture analytique», qu’il centre sur les auteurs du XIXe, et qu’il distingue de «l’explication française» (Bouvier 1910 : 16). Sa méthode, expérimentée à l’Université de Genève dans son séminaire de français moderne, est envisagée ici au niveau secondaire, pour «un maître idéal et un élève idéal, affranchis de la surveillance administrative et du souci des examens» (Bouvier 1910 : 2). Celle-ci s’organise autour de deux questions : «qu’est-ce que l’auteur a voulu faire? Par quels moyens l’a-t-il réalisé?» (Bouvier 1910 : 12). Son but? «Faire saisir à notre élève l’individualité de chaque écrivain» (Bouvier 1910 : 10).
Mercier (1911), quant à lui, prône la lecture expliquée selon la méthode proposée par Ch.-M. Des Granges43 dans son manuel Morceaux choisis des auteurs français du Moyen-Âge à nos jours préparés en vue de la lecture expliquée de (1910/1920). Celle-ci comprend les étapes suivantes : replacer, s’il y a lieu, le morceau dans l’ensemble dont il a été détaché ; le lire à haute voix, établir son plan; le commenter phrase par phrase sans tomber dans la paraphrase, en s’arrêtant sur la propriété des termes et sur les figures de style ; terminer par une conclusion philosophique et morale. Mercier précise néanmoins : «Y a-t-il pour expliquer un auteur français une seule méthode? Non pas. Qui ne sent qu’on ne commente pas Boileau comme Lamartine. […] Cela dépend aussi de la préparation de l’élève» (Mercier 1911 : 204).
C’est la lecture expliquée qui l’emporte. Présente dans les programmes du collège de Genève dès 1914 au secondaire inférieur, celle-ci se répand dès 1918 au secondaire supérieur et, comme nous l’avons vu, au niveau du primaire supérieur, suite à des propositions pédagogiques publiées au niveau romand (Duchosal 1918). Corollairement, alors que la fin du XIXe se caractérise au niveau de la voie gymnasiale par une absence des manuels, dès les années 1920, le manuel de Ch.-M. Des Granges (1910/1920) est cité dans les programmes aussi bien à Genève (1925) qu’à Fribourg (1926). Cela est d’autant plus intriguant qu’à Fribourg, on reste au secondaire dans un enseignement de la «langue française» très influencé par la rhétorique, centré dans les petits degrés sur la grammaire et qui aboutit en dernière année à la «rhétorique» avec, comme exercices, le discours, les analyses et critiques littéraires et les plaidoyers.
Le choix de l’anthologie de Des Granges, loin d’être le produit du hasard, signe en réalité une ère nouvelle dans l’enseignement du «français» en Suisse romande. Cette anthologie est en effet prescrite dans la voie gymnasiale en lien avec le cours d’histoire de la littérature qui procède désormais par siècles : Moyen-Âge et XVIe siècle en 1e année, XVIIe siècle en 2e, XVIIIe siècle en 3e et XIXe siècle en 4e. Contrairement aux anthologies précédentes, celle de Des Granges a en effet l’avantage de proposer une série de morceaux d’auteurs allant du Moyen-Âge à 1900, classés par siècles, et à l’intérieur de chaque siècle, par genres. Mais surtout, comme le relève un critique belge de l’époque, «cette anthologie est particulièrement intéressante pour les professeurs, car plus de vingt textes commentés donnent des modèles d’explication littéraire et constituent une véritable méthode» (Hombert 1932), plaçant de fait le texte littéraire au centre de l’enseignement du «français».
L’institutionnalisation de la lecture expliquée sur l’ensemble du secondaire en Suisse romande semble donc s’opérer plus tardivement qu’en France où «c’est […] des premières années du XXe siècle que date la pratique régulière de l’explication française dans les classes» (Chervel 2006 : 531). Elle se réalise in fine par le biais de l’épreuve orale de maturité qui devient, dans les années 1920, une «explication de texte»44, aux côtés de l’épreuve écrite de français, qui est une «composition sur un sujet littéraire ou scientifique», soit une dissertation45. Avec cette nouvelle épreuve, l’interprétation des morceaux littéraires va alors s’imposer dans les pratiques, au point de devenir «à l’école secondaire, la branche la plus importante de l’enseignement du français» (Robadey 1933 : 193).
6. Conclusion
Que retient-on de ce parcours historique? Dans les classes de Suisse romande, il apparaît que l’avènement du texte littéraire en «français» s’opère entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, en lien avec la disciplinarisation du «français» au primaire et au secondaire. A l’intérieur de ce processus cependant, le modèle rhétorique perdure dans les pratiques sous forme de traces, et ce dans les trois cantons, même si les cantons protestants de Genève et de Vaud apparaissent comme plus avant-gardistes que Fribourg. En tant que canton catholique, ce dernier continue en effet sur cette période à privilégier les manuels français du XIXe siècle, au détriment de ceux édités sur la scène romande par les cantons protestants.
Dans les grandes lignes du processus que nous avons retracé, la Suisse romande ne se distingue pas de la France vers laquelle les professeurs de l’époque se tournent largement pour repenser leurs pratiques. Rollin, Des Granges, pour ne citer que quelques noms, constituent en effet des références incontournables pour les pédagogues romands. Cependant, cette histoire comprend des spécificités liées notamment au fait que la Suisse est constituée de plusieurs régions linguistiques, dans lesquelles le «Français» a le statut, soit de langue maternelle, soit de langue étrangère. La Chrestomathie de Vinet est emblématique de la circulation des idées pédagogiques entre les cantons suisses, mais aussi entre les pays à cette période. L’originalité de cette anthologie –lire les auteurs de langue française en suivant la méthode utilisée alors pour les auteurs de l’Antiquité– tient au fait qu’elle est prévue au départ pour l’enseignement de la langue et de la littérature française à Bâle (canton germanophone). Or, elle va non seulement s’imposer dans l’ensemble du secondaire en Suisse romande, mais elle sera également imprimée en France et en Belgique.
Par ailleurs, cette étude montre que les professeurs du secondaire, dont certains ont été au début de leur carrière instituteurs, ont joué un rôle majeur dans l’avènement du texte littéraire à l’école. Ce sont eux qui façonnent les contours de la littérature française dans les classes de Suisse romande, et qui élaborent de nouveaux exercices pour lire, comprendre et interpréter ces textes, selon une progression qui va du primaire à la fin du secondaire supérieur. Ainsi, au primaire, les auteurs contemporains sont plus présents qu’au secondaire où, dès le début du XXe siècle, l’approche de la littérature est désormais chronologique, allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. De plus, au primaire, les morceaux choisis sont également plus proches de l’enfance au niveau des thèmes abordés. Corollairement, la manière d’approcher ceux-ci s’inscrit dès les années 1920 dans une progression, qui va de la lecture expliquée de type littérale (axée sur le vocabulaire et la grammaire) au primaire à l’explication de texte qui laisse une large place au commentaire (axé sur les figures de style et visant à dégager le style particulier de l’auteur) au secondaire supérieur.
Les choix qui ont été faits par les acteurs du système scolaire à cette période ont été décisifs. Ils constituent encore la base de la discipline «français» aujourd’hui. Dans les Directives pour l’examen suisse de maturité (2012), il est en effet précisé que, pour le «français» langue première, le candidat sera évalué par le biais d’une épreuve écrite, soit une dissertation, et d’une épreuve orale, soit une analyse d’un extrait tiré d’une œuvre littéraire. Cependant, aussi bien au secondaire qu’au primaire, les plans d’études ne prescrivent pas un corpus littéraire précis, se limitant à des indications en ce qui concerne les genres à travailler et les siècles à couvrir pour chaque année. Le choix de telle ou telle œuvre et la manière de la travailler en classe relève de l’expertise de l’enseignant. Ce dernier, comme ceux d’hier, contribue ainsi, à son échelle, à la définition de ce qu’est la littérature scolaire aujourd’hui.
Bibliographie
Balibar, Renée (1985), L’institution du français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République, Paris, Presses Universitaires de France.
Barras, Jean-Marie (1988), Deux siècles d’apprentissage de la lecture dans le canton de Fribourg, Fribourg, Auteur.
Bishop, Marie-France (2019), « Quelle didactique de la littérature dans les manuels de l’enseignement primaire en France de 1880 à nos jours? », in N. Denizot, J.-L. Dufays & B. Louichon (Ed.), Approches didactiques de la littérature, Namur, Presses Universitaires de Namur, p. 33-48.
Caron, Philippe (1992), Des « Belles Lettres » à la « Littérature ». Une archéologie des signes du savoir profane en langue française (1680-1760), Louvain/Paris, Peeters.
Chervel, André (2006), Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz.
Darme, Anouk (2018), Enseigner la grammaire pour développer l’expression de la pensée ? Eléments d’histoire de la grammaire scolaire en Suisse romande, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
David, Jérôme (2017), « Enseigner la littérature : une approche par les justifications (XIXe -XXIe siècles) », Transpositio, 1 [Page web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-une-approche-par-les-justifications-xixe-xxie-siecles
Denizot, Nathalie (2013), La scolarisation des genres littéraires (1802-2010), Bruxelles, Peter Lang.
Denizot, Nathalie (2015), « Les humanités, la culture humaniste et la culture scolaire », Tréma, 43 [Page Web]. URL : https://journals.openedition.org/trema/3301
Douay-Soublin, Françoise (1997), « Les recueils de discours français pour la classe de rhétorique », in M.-M. Compère & A. Chervel (Ed.), Les Humanités classiques, Paris, INRP, p. 151-185.
Gabathuler, Chloé (2017), « Manuel de lecture genevois au début du XXe siècle », Transpositio, 1 [Page Web]. URL : http://transpositio.org/articles/view/manuels-de-lecture-genevois-au-debut-du-xxe-siecle
Gabathuler, Chloé & Bruno Védrines(2018), « Des pratiques d’enseignement de la littérature : quelques jalons historiques et analyses de pratiques effectives », in Ch. Ronveaux et B. Schneuwly (Ed.), Lire des textes réputés littéraires : disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang, p. 43-66
Hofstetter, Rita (2012), « La Suisse et l’enseignement aux XIXe -XXe siècles. Le prototype d’une ‘Fédération d’États enseignants’ », Histoire de l’Éducation, n°134, p. 59-80.
Hofstetter, Rita & Anne Monnier (2015), « Construction de l'instruction publique et démocratisations contrastées », in G. Durand, R. Hofstetter, G. Pasquier, L. Palandella & Syndicat des enseignants romands (Ed.), Les Bâtisseurs de l'école romande. 150 ans du Syndicat des enseignants romands et de l'Educateur, Genève, Georg, p. 134-177.
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (1998/2001), « Introduction », in R. Hofstetter & B. Schneuwly (Ed.), Le Pari des sciences de l’éducation, Bruxelles, De Boeck, p. 7-28
Hofstetter, Rita & Bernard Schneuwly (à paraître), « Les manuels comme emblèmes des reconfigurations disciplinaires de la forme école au 19e siècle ? Essai historiographique », in S. Wagnon (Ed.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : Enjeux actuels et perspectives, Berne, Peter Lang.
Houdart-Mérot, Violaine (1998), La culture littéraire au lycée depuis 1880, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Monnier, Anne (2018). Le temps des dissertations. Chronique de l'accès des jeunes filles aux études supérieures (Genève, XIXe -XXe), Genève, Droz.
Ronveaux, Christophe & Bernard Schneuwly (Ed.) (2018), Lire des textes réputés littéraires: disciplination et sédimentation. Enquête au fil des degrés scolaires en Suisse romande, Bruxelles, Peter Lang.
Rouiller, Viviane. (2018), « Apprendre la langue de la majorité des Confédérés ». Une discipline scolaire, entre enjeux pédagogiques, politiques, pratiques et culturels (1830-1990), Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
Savatovsky, Dan (1999), « Le français: genèse d’une discipline », in A. Collinot & F. Mazière (Ed.), Le français à l’école: un enjeu historique et politique, Paris, Hatier, p. 36-76
Schneuwly, Bernard (2016), « Forme-t-on au même rapport à la langue des deux côtés de la Sarine ? Premières explorations dans les livres de lecture durant un siècle », Forumlecture, 2/2016 [Page Web]. URL : https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/573/2016_2_Schneuwly.pdf
Schneuwly, Bernard & Anouk Darme (2015), « La lecture dans la discipline Français. Analyse des plans d’études et des manuels de lecture de 1870 à 1990 dans le Canton de Genève », in L. Perret-Truchot (Ed.), Analyser les manuels scolaires. Questions de méthodes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.109-128
Schneuwly, Bernard & Joaquim Dolz (Ed.) (2009), Des objets enseignés en classe de français : le travail de l'enseignant sur la rédaction de textes argumentatifs et sur la subordonnée relative, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Tinembart, Sylviane (2015), Le manuel scolaire de français, entre production locale et fabrique de savoirs. Le cas des manuels et de leurs concepteurs dans le canton de Vaud au 19e siècle, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève.
Tinembart, Sylviane (2018), « La littérature fait son entrée en classe primaire (1830-1990). Illustration de sa présence dans les plans d’études et les manuels de lecture du canton de Vaud », Forumlecture, 3/2018 [Page Web]. URL : https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/650/2018_3_fr_tinembart.pdf
Sources imprimées
Biolley, Alexis (1866), « Quelques mots sur la lecture et l’enseignement de cette branche du programme de l’école primaire », Educateur, 2(18), p. 298-302.
Bourqui, Auguste (1870), « Encore l’enseignement de la composition à l’école primaire », Educateur, 6(21), 328-340.
Duchosal, Henri (1918), Comment et pourquoi donner des leçons de lecture expliquée (2e éd), Genève : Imprimerie Atar.
Favez, Charles (1911, 19 février), « Classiques ou modernes ? », Gazette de Lausanne, 49 [Page Web]. URL : https://www.letempsarchives.ch/page/GDL_1911_02_19/1/article/1309269/Favez
Hombert Joseph (1932), « Des Granges (Ch.-M), Morceaux choisis des auteurs français du moyen âge à nos jours », Revue belge de philologie et d'histoire, 11(1-2) [Page Web]. URL : https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1932_num_11_1_1371_t1_0181_0000_2
Mercier, Henri (1910), « L’Année littéraire », Annuaire de l’Instruction publique, 1, 83-108 [Page Web]. URL : http://doi.org/10.5169/seals-109043
Mercier, Henri (1911), « La lecture expliquée », Annuaire de l’Instruction publique, 2, p. 195-209 [Page Web]. URL : https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=aip-001:1911:2::10#256
Rambert, Eugène (1930), Alexandre Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, Lausanne : Payot.
Robadey, Louis (1933), « La lecture expliquée et, par elle, la culture littéraire », Bulletin pédagogique, 62 (13), p. 193-200.
Manuels et ouvrages scolaires
Emile, Bonjour (1925), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré intermédiaire, Lausanne, Payot.
Emile, Bonjour (1931), Lectures à l’usage des écoles primaires : degré supérieur, Lausanne, Payot.
Des Granges, Charles-Marc (1910/1920), Morceaux choisis des auteurs français du moyen-âge à nos jours en vue de la lecture expliquée (842-1900). Classes de Lettres. 2e cycle, (14e éd.) Paris, Hatier.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1895/1899), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré supérieur, Lausanne, Adrien Borgeaud, imprimeur-éditeur.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (1903), Livre de lecture à l’usage des écoles primaires. Degré intermédiaire, Lausanne, Lucien Vincent, imprimeur-éditeur.
Dupraz, Louis & Bonjour Emile (avec Mercier H.). (1908), Anthologie scolaire. Lectures françaises, Lausanne, Payot.
Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.
Dussaud, Bernard & Alexandre Gavard (1882), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré supérieur. Édition revue, augmentée et adaptée aux écoles du canton de Fribourg, Lausanne, Imprimerie Lucien Vincent.
Noël, François & François Delaplace (1804-1805), Leçons de littérature et de morale (2e éd., vol. 1-2), Paris, Le Normant.
Renz, Frédéric (1871), Livre de lecture à l’usage des écoles de la Suisse romande. Degré intermédiaire, Lausanne, Blanc, Imer & Lebet.
Vinet, Alexandre (1829a), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1829b), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 2, Lectures pour l’adolescence, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1830), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 3, Littérature de la jeunesse et de l’âge mûr, Bâle, J.G. Neukirch.
Vinet, Alexandre (1833, 2e éd.), Chrestomathie française ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français. Tome 1, Littérature de l’enfance, Bâle, J.G. Neukirch.
Textes institutionnels
Commission suisse de maturité (CSM) (2012), Directives pour l’examen suisse de maturité, Confédération suisse. Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [Page Web]. URL : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2006), Enseignement/apprentissage du français en Suisse romande : orientations, Neuchâtel : CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010), Plan d’études romand, Neuchâtel : CIIP[Page Web]. URL : https://www.plandetudes.ch/per
Canton de Genève
Programmes de l’enseignement primaire (1852, 1875, 1889 1912, 1923) : Bibliothèque de Genève (BGE).
Programmes d’enseignement du Gymnase (1848-1886) : BGE.
Programmes d’enseignement et plans d’études du Collège de Genève (1855, 1877, 1889, 1900, 1925) : BGE.
Canton de Fribourg
Programmes et plans d’études pour l’enseignement primaire (1886, 1899, 1932) : Office du matériel scolaire Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire de l’Etat de Fribourg (BCUEF).
Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg (1850, 1876) : Archives d’Etat de Fribourg.
Programme général des cours de l’école cantonale de Fribourg (1848, 1856) : BCUEF.
Programme des études du collège et du lycée de Fribourg et de l’école normale d’Hauterive (1871) : BCUEF.
Programme des études du collège Saint-Michel (1887, 1926) : BCUEF.
Canton de Vaud
Catalogue des élèves du collège cantonal et de l’école préparatoire. Objets d’enseignement. (Année scolaire 1853-1854). Lausanne : Imprimerie Pache-Simmen.
Plan d’études pour l’enseignement primaire (1868, 1899, 1926) : Archives cantonales vaudoises (ACV)
Plan d’études général pour les collèges et les gymnases, ainsi que pour les écoles supérieures de jeunes filles du canton de Vaud (1910) : ACV.
Programme des cours du Collège cantonal (1877, 1890) : ACV.
Annexe 1 : Contenus des parties qui composent le Livre de lecture à l’usage de la Suisse romande, degré supérieur de Dussaud et Gavard (1871)
- Histoire naturelle comprenant la zoologie, l’étude des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles et batraciens, poissons, insectes, mollusques, crustacés, zoophytes), la botanique (fleurs, herbes, arbres, arbres exotiques, arbustes) et l’industrie (machine à vapeur, imprimerie). De nombreuses illustrations accompagnent ces textes descriptifs. Parmi les 120 extraits, 23 sont d’Adam Vuillet et 20 de Milne-Edwards. La moitié sont anonymes.
- Descriptions et voyages qui reprend 16 récits d’auteurs différents, mais parmi lesquels nous retrouvons huit descriptions de voyages en Suisse.
- Histoire qui contient 15 morceaux dont « Regulus » de Chateaubriand déjà présent dans la Chrestomathie de Vinet. Là encore, la moitié des textes concerne l’histoire suisse.
- Biographies : parmi les huit portraits, certains mettent notamment à l’honneur deux pédagogues suisses (Pestalozzi et le père Grégoire Girard de Fribourg), mais également un inventeur (Jean-Marie Jacquard), un géologue (Esther de la Linth), un général d’empire (Antoine Drouot)
- Anecdotes-traits moraux-caractères : 21 extraits hétéroclites au niveau des sujets composent cette partie. Parmi eux figurent quatre textes de Fénélon et deux de La Bruyère.
- Style épistolaire : Mme de Sévigné côtoie Racine, Voltaire, Rousseau, Constant et Montesquieu, mais d’autres comme Joseph Joubert ou Paul-Louis Courrier sont également présents.
- Dialogues en prose sont constitués de trois extraits de théâtre dont un de Molière (Don Juan) et deux de Brueys et Palaprat (Patelin).
- Dialogues en vers au nombre de trois dans lesquels figure également Molière (Tartuffe), un extrait d’Edmé Boursault (Le Mercure Galant) et Petit-Senn.
- Poésie narrative et lyrique : sur les 31 extraits, il n’y a que trois fables de La Fontaine et deux de Florian. Par contre, nous trouvons deux textes de Lamartine et deux de Hugo.
Annexe 2 : La littérature prescrite en « français » dans la voie gymnasiale à Genève, 1900
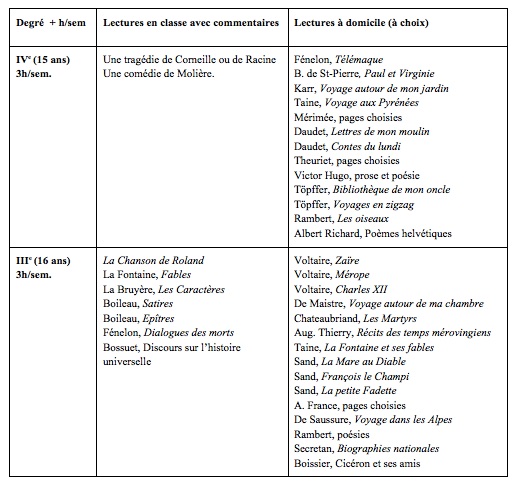
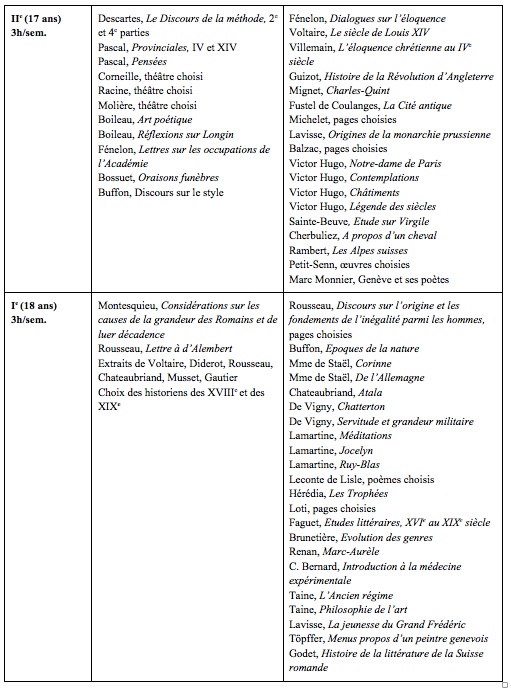
Alexandre Gavard (1845-1898): régent, puis professeur du collège, cet homme politique genevois sera désigné conseiller d’Etat en charge du Département des travaux publics, puis du Département de l’Instruction publique.
Louis Dupraz (1852-1920) : instituteur, puis maître de français au collège de Payerne, il complète sa formation en Lettres à Paris. Il est désigné professeur de français à l’école supérieure de jeunes filles de Lausanne en 1881. En 1893, il est nommé chef bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Il en devient le directeur en 1898.
[Page Web]. URL : https://data.bnf.fr/14301685/charles-marc_des_granges/
Pour citer l'article
Anouk Darme-Xu, Anne Monnier & Sylviane Tinembart , "L’approche historico-didactique pour penser l’avènement du texte littéraire dans l’enseignement du français (Suisse romande, 1850-1930)", Transpositio, n°2 La circulation des savoirs: entre recherches et pratiques enseignantes, 2020https://www.transpositio.org/articles/view/l-approche-historico-didactique-pour-penser-l-avenement-du-texte-litteraire-dans-l-enseignement-du-francais-suisse-romande-1850-1930
Voir également :
Aux confins de la narrativité. Une expérience de lecture: du paratexte à l’interprétation
La tentation est grande, pour les enseignants de littérature, de ne voir dans la bande dessinée qu’un réservoir inépuisable d’exemples séduisants, qu’un magasin d’ «illustrations» rassurantes pour un public supposé rétif à la théorie. Ainsi, les comics (Barthes 1966: 7) ont-ils fait pendant les décennies structuralistes l’épreuve des outils d’analyse affutés par la narratologie et la grammaire du récit.
Aux confins de la narrativité. Une expérience de lecture: du paratexte à l’interprétation
La tentation est grande, pour les enseignants de littérature, de ne voir dans la bande dessinée qu’un réservoir inépuisable d’exemples séduisants, qu’un magasin d’ «illustrations» rassurantes pour un public supposé rétif à la théorie. Ainsi, les comics (Barthes 1966: 7) ont-ils fait pendant les décennies structuralistes l’épreuve des outils d’analyse affutés par la narratologie et la grammaire du récit. Actuellement, bien que menacée de péremption par les jeux vidéo et les séries, la bande dessinée fait encore les beaux jours des théories de la lecture et de la fiction. Les zélateurs du medium n’avaient-ils pas eux-mêmes vu, dans cette heureuse disponibilité des cases et des planches, une formidable opportunité de promouvoir la dignité du 9e art? C’est ainsi qu’au gré de que l’on pourrait lire historiquement comme une instrumentalisation réciproque (la BD comme outil de promotion pédagogique des modèles descriptifs, les modèles descriptifs comme outil de promotion culturelle de la BD), se prenait, à bas bruit, l’habitude de pratiques transmédiales1 dont on mesure aujourd’hui la fertilité.
Le présent dossier, consacré à ce qui est devenu depuis sa parution un «classique», offre l’occasion de la double opération qui sera tentée dans les pages qui suivent: 1) considérer Le long voyage de Léna à la fois comme une «structure» (un système de relations) et comme un «dispositif» (un modèle ouvert sur les contextes de production et de réception2), c’est-à-dire comme une «œuvre» offerte à une expérience de lecture, depuis le moment où l’on prend en main l’album pour apprécier les détails de la couverture jusqu’au moment où on le range en se demandant s’il y aura une suite; 2) vérifier localement la robustesse des postulats transmédiaux en convoquant, quand le besoin s’en fait ressentir, des outils descriptifs empruntés aux études théâtrales (un domaine situé en marge de la narratologie, que celle-ci soit qualifiée de classique ou de postclassique).
Zone de passage (le paratexte)
Ainsi qu’en témoignent les archives génétiques que nous avons pu consulter3, le titre Le long voyage de Léna s’impose dès les premiers documents préparatoires.

Illustration 1: André Juillard, Esquisse pour la couverture du Long voyage de Léna, 2005. Archives André Juillard. © André Juillard
Relevant du péritexte auctorial4(Genette 1987), il se présente d’emblée comme un clin d’œil à son inscription dans la collection «Long courrier» des éditions Dargaud 5. Sur les pages de couverture de l’album, l’image de deux navires et celle d’une cabine avec hublot et couchette activeront les connotations maritimes de la collection. Pierre Christin et André Juillard ne sont pas les premiers à proposer un titre qui joue ainsi avec l’horizon d’attente prescrit par l’éditeur, comme en témoigne, imprimée en regard de la page de faux-titre, la liste de la quinzaine d’ouvrages parus «dans la même collection6». Sur la quatrième de couverture, une flamme d’oblitération évoque pour sa part le versant postal de la collection; les lignes ondulées sont liées à la charte graphique de cette dernière et, comme le logo à la rose de vents, appartiennent au péritexte éditorial7. Au verso de la page de faux-titre, un péritexte auctorial débute ainsi: «Cet album est issu d’un voyage à Berlin effectué par André Juillard et Pierre Christin, ainsi que des photos, de la documentation et des entretiens réalisés par Pierre Christin dans tous les autres pays où se rend Léna.» Les deux auteurs ont voyagé8; ils expédient, sous forme d’album, comme une liasse de cartes postales. Mais qu’en est-il de Léna?
Le court texte d’accroche qui figure sous l’image de la quatrième de couverture (encore un péritexte éditorial) commence par ces mots: «Qui est Léna? Que fait Léna? Le sait-elle elle-même?». Ces questions inattendues (se demande-t-on «Qui est Pierre Christin? Que fait-il? Le sait-il lui-même?») entrent en tension avec le titre dont l’évidence paraît alors trompeuse. Rapidement, le lecteur apprendra en effet que Léna «joue les touristes moyens» (p. 17, c. 10)9 et qu’elle n’est pas engagée dans «un voyage d’agrément» (p. 19, c. 6). Son nom – Muybridge10 – évoque le mouvement, mais il figure sur un «vrai-faux passeport» (p. 38, c. 1). Léna voyage sans plaisir; les paysages et les monuments sont pour elle sans attrait (il n’est que de voir son expression sur la couverture). Elle n’écrit à personne qui attende de ses nouvelles. Elle joue pourtant un «rôle de courrier» (p. 26, c. 3), ce qui ne manque pas de piquant, étant donné le nom de la collection.
Le dispositif paratextuel de l’album invite le lecteur à embarquer, c’est-à-dire à franchir la «“zone” de passage» (Del Lungo 2009: 9911) qui le sépare de l’univers fictionnel. Certains «vecteurs d’immersion» (le portrait de l’héroïne et le titre en cursives, par exemple) y sont déjà mis en œuvre (Schaeffer 1999: 25512). Les nombreuses dissonances de ce dispositif, particulièrement élaboré, éveillent immédiatement l’intérêt: la contradiction entre le mouvement et la mélancolie, la confusion entre le romanesque et le documentaire, le mélange annoncé entre «intimisme» et «fresque géopolitique». Tout attise la curiosité du lecteur, jusqu’au face à face troublant, sur la quatrième de couverture, d’un hublot ouvert et d’une photographie retournée.
Illustration 2: Quatrième de couverture, Le Long voyage de Léna © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007.
Zone de tension (l’histoire et le récit)
«Qui est Léna?». Elle est sans conteste l’héroïne du récit (elle est présente graphiquement dans 70% des cases selon les calculs d’Alain Corbellari et Alain Boillat), mais est-elle le personnage principal de l’histoire? Le long voyage de Léna offre une belle occasion d’éprouver la différence entre le récit et l’histoire, entre ces «deux aspects de toute œuvre littéraire» (Todorov 1971: 12) et entre les deux «niveaux de description» qu’ils requièrent (Barthes 1966: 11). À cette fin, il peut être utile de tenter de résumer la séquence compositionnelle (Todorov 1981: 133) ainsi que la séquence événementielle (Baroni 2017: 8413) de l’album. Bien que l’exercice soit peu formaliste, il devrait permettre de mieux saisir comment l’écart entre histoire et récit est mis en intrigue (Baroni 2017: 39-57) – afin que cet écart soit vécu par les lecteurs comme une tension qui ne se résout qu’une fois l’album refermé. Commençons par le résumé du récit:
Léna – on reconnaît la femme de la couverture – se rend dans un quartier de Berlin-Est. Elle a rendez-vous avec un vieil homme, nostalgique de la RDA. Il lui confie une liste de contacts qu’elle apprend par cœur avant de la brûler. Aux adresses et dates qu’elle a mémorisées, elle rencontre successivement six personnes à qui elle donne l’un des objets qu’elle transporte avec elle. Elle livre ainsi une boîte de massepain à Budapest, un flacon de parfum en Roumanie, une trousse pour diabétique à Kiev; on comprend que ces objets contiennent de quoi composer et injecter un poison. Des plans sont ensuite transmis en Turquie et une lettre codée en Syrie; ces deux derniers éléments renseignent les assassins sur la localisation et l’identité de leur future victime. Au fur et à mesure, Léna marque intérieurement sa distance envers les gens qu’elle contacte. À la fin du parcours, on apprend qui est Léna: celle-ci a perdu son fils et son mari dans un attentat perpétré par ceux-là mêmes qu’elle a rencontrés. Les services secrets français lui ont proposé la mission qui doit aboutir à leur neutralisation. À Dubaï, pendant que Léna s’envole à l’autre bout de la planète, les six terroristes explosent dans un véhicule piégé. En Australie, Léna fait la rencontre d’un veuf et de son jeune garçon.
Ce petit texte ayant été rédigé avant la consultation du site internet des éditions Dargaud, on se plaira à relever sa parenté avec le résumé (partiel) proposé, en guise de teaser, à l’occasion de la réédition récente du Long voyage de Léna 14:
Elle s'appelle Léna. C'est une jeune femme brune, élégante et mystérieuse. On ignore d'où elle vient et où elle va. Son voyage commence à Berlin-Est, dans le quartier où vivent les anciens dignitaires d'un régime effacé par le vent de l'Histoire. Léna rend visite à un homme qui lui remet une liste de noms et de numéros de téléphone, qu'elle apprendra par cœur avant de la détruire. Après Berlin, il y aura Budapest et un autre rendez-vous. Et après Budapest, Kiev, Odessa, la Turquie et la Syrie. À chaque fois, une rencontre. Peu de mots prononcés, juste un objet étrange remis par Léna à son destinataire: une boîte de pâtes d'amandes, un flacon de parfum, un nécessaire pour diabétiques.
Dans les deux textes, le pronom impersonnel «on» et le présent de l’indicatif (également utilisés dans le projet de scénario établi par Christin15) se sont imposés, sous la pression manifeste de la séquence visuelle. Un autre parti était possible, qui aurait privilégié les récitatifs (les cartouches narratifs). Le résumé aurait alors pu commencer ainsi: «Léna – la femme représentée sur la couverture – raconte comment elle s’est rendue dans un quartier de Berlin-Est pour rencontrer un vieil homme, nostalgique de la RDA. Elle ne précise pas quel était son point de départ.» Cette option peut se justifier du caractère manifestement structurant des cartouches narratifs dans le crayonné de Juillard. Un tel choix contraint cependant à rappeler avec régularité la source imaginaire du récit («Léna raconte que…»). Une troisième piste pour un résumé du récit est inspirée par les «Légendes pour une exposition» rédigées par Christin. Ces légendes qui accompagnent chaque planche de l’album, sont le résultat d’une identification totale avec l’héroïne. Elles actualisent au présent (parfois en l’augmentant) la voix intérieure de Léna qui parle au passé dans les récitatifs. Par exemple, pour la Planche 1: «On m’appelle Léna, et je me trouve pour la première fois de ma vie dans cette lointaine partie de Berlin-Est. Je suis seule, absolument seule. C’est l’été. Il fait très chaud. Je dépasse une écluse immobile16». Un résumé inspiré par ces étonnantes variations autour des planches montrerait comment le plan iconique de la narration, perçu comme simultané, peut altérer la grammaire des récitatifs. L’examen de ces différents résumés, de la combinatoire des pronoms et des temps verbaux et la comparaison avec les documents préparatoires, tout cela s’avère pédagogiquement fertile pour une exploration des spécificités du récit en bande dessinée, mais également pour une compréhension globale, dans un esprit transmédial, des outils narratologiques. Mais revenons au premier résumé proposé ci-dessous. Dans son économie générale, ce résumé tient compte du fait que l’identité de Léna reste indécise durant les deux premiers tiers de l’album, à savoir pendant 35 pages sur 53 (862 caractères sur 1303 dans le résumé proposé). Le voyage peut donc être qualifié de «long» en raison du nombre de kilomètres parcourus et de l’archaïsme des moyens de transport (dans l’histoire), mais aussi en raison du nombre de pages (pages 3 à 38) qui attisent la curiosité du lecteur (dans le récit). Une dizaine de pages (pages 43 à 53) prennent le relais pour produire l’unique effet de suspense de l’album à propos du destin des terroristes. Quant à la surprise (qui invaliderait les diagnostics et les pronostics du lecteur), elle est moins produite par la révélation de l’identité de Léna (préparée par un semis d’indices) ou par la mort des assassins (annoncée de manière peu cryptée17) que par une scène qui dévoile l’étendue de l’ignorance de l’héroïne (mais n’anticipons pas). Alain Boillat et de Raphaël Baroni analysent ici-même les techniques compositionnelles de l’album, nous ne nous y attarderons donc pas. Certes, la tension narrative «ne dépend pas uniquement d’éléments thématiques (ce qui arrive aux personnages ou ce qui les caractérise), mais aussi d’une certaine organisation du discours» (Baroni 2017: 85), il convient néanmoins de prêter attention à ces «éléments thématiques» et de ne pas négliger, comme il est souvent d’usage18, «ce qui arrive aux personnages». Voici donc un résumé de l’histoire:
Un attentat non revendiqué fait dix-sept victimes dans le quartier de la légation française à Khartoum: parmi les victimes, figurent le mari et le fils d’Hélène Desrosières (Léna). Un ami de Desrosières, Paul-Marie de Calluire, membre des services secrets français, identifie les responsables. Il est informé de la prochaine opération «anti-impéraliste» fomentée par ce groupe de communistes dirigé par un ancien membre de la Stasi. Il s’agit d’assassiner un cheikh dont le rôle est crucial dans la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient. Le chef du groupe accepte l’aide de Paul-Marie (qu’il a eu l’occasion de fréquenter pendant la Guerre froide). Paul-Marie propose à Léna de contribuer à la neutralisation des terroristes. Léna se présente à Berlin comme le courrier qui doit livrer à chaque membre du groupe – c’est-à-dire en Hongrie, Roumanie, Ukraine, Turquie et Syrie – une partie des moyens et des données nécessaires au nouvel attentat. De ce projet, Léna ignore la cible. Ce n’est qu’une fois sa mission achevée que Paul-Marie l’en informe. Il lui cache en revanche le sort qui les attend. À Dubaï, sur le point de commettre leur forfait, ils explosent dans un véhicule piégé, pendant que Léna est en route pour l’Australie. Sur une plage, elle rencontre un veuf et son jeune fils.
Ce résumé diffère nettement du précédent, bien que rigoureusement de la même longueur19. Alors que le résumé du récit frappait par son rapport deux tiers / un tiers (mystère / révélation), celui-ci révèle la structure symétrique d’une histoire «à clôture forte» (Schaeffer 2020: 10), une histoire «passant d’un équilibre à l’autre»:
Un récit20 idéal commence par une situation stable qu’une force quelconque vient perturber. Il en résulte un état de déséquilibre; par l’action d’une force dirigée en sens inverse, l’équilibre est rétabli; le second équilibre est semblable au premier mais les deux ne sont jamais identiques (Todorov 1980: 50).
Les deux événements qui respectivement ouvre et ferme le résumé permettent de dégager ceci:
La cellule familiale de Léna (situation stable) est fracturée par l’attentat de Khartoum (perturbation); après sa mission (force dirigée en sens inverse), la jeune femme est exfiltrée aux Antipodes; sa rencontre avec un veuf et un orphelin laisse présager la constitution d’un nouveau foyer (situation stable)21.
Décrite ainsi cependant, l’histoire de Léna ne manque pas de surprendre voire de mettre à mal la description de Todorov et le fameux schéma quinaire qui l’a clarifiée par la suite (Larivaille 1974)22. En effet, on ne peut que s’interroger sur la nature de la «force dirigée en sens inverse» supposée permettre le retour à l’équilibre affectif pour Léna. Le résumé de l’histoire permet de relever deux rendez-vous entre Léna et Paul-Marie de Calluire symétriquement situés à proximité du début et de la fin du texte. De Calluire est de fait lui aussi porteur d’une histoire à clôture forte:
Les services de renseignement français, représentés par l’expérimenté de Calluire (situation stable), ont été mis en échec par l’attentat de Khartoum qu’ils n’ont pas su anticiper (perturbation); afin de prendre sa revanche, de Calluire s’insinue, dès ses prémisses, dans l’organisation de la prochaine opération du groupe terroriste responsable de cet attentat (force dirigée en sens inverse; cette revanche mettra le groupe définitivement hors d’état de nuire (situation stable).
Enfin, on remarquera également l’importance des contacts entre de Calluire et le chef des terroristes autour d’une troisième histoire à clôture forte:
Un groupe de communistes soudé par leur passé commun et dirigé par un ancien dignitaire de la Stasi (situation stable), n’acceptant pas la chute de l’URSS (perturbation), poursuit par ses actions la lutte anti-impérialiste; ainsi cherchent-ils à empêcher la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient (force dirigée en sens inverse); au cours de cette opération, l’ensemble du groupe trouve la mort, privant l’ancien dignitaire de la Stasi de ses moyens (situation stable).
Après avoir identifié cette troisième histoire, nous pourrions être tentés de réécrire le résumé, peut-être en dégageant plus lisiblement la manière dont elles s’emboîtent: Léna / De Calluire / les terroristes / De Calluire / Léna. Une telle entreprise serait sans doute vaine. En effet, n’est-ce pas déjà un biais (dû à l’influence du récit) que de braquer, en ouverture et en fermeture, le projecteur sur Léna? Il suffit, pour s’en assurer, de réécrire le résumé en dirigeant tour à tour le même projecteur sur de Calluire (Calluire / le Berlinois / Léna / le Berlinois / de Calluire) ou sur le Berlinois (le Berlinois / de Calluire / Léna / de Calluire / le Berlinois). L’histoire resterait inchangée dans les deux cas, mais Léna y perdrait son statut de personnage principal.
Reconnaissons que l’exercice qui consiste à résumer une histoire n’est pas une mince affaire. Pour Roland Barthes, l’histoire ne «relevait pas du langage» (Barthes 1966: 11, note 4) et Tzvetan Todorov en parlait comme d’un «matériau prélittéraire». Ce dernier ajoutait: «l’histoire est une convention, elle n’existe pas au niveau des événements eux-mêmes», elle est «une abstraction car elle est toujours perçue par quelqu’un, elle n’existe pas “en soi”». Il précisait surtout: elle «est rarement simple: elle contient le plus souvent plusieurs “fils” et ce n’est qu’à partir d’un certain moment que ces fils se rejoignent» (Todorov 1966: 133)23. Dans ce texte, précurseur à bien des égard, Todorov emprunte la notion de fil au vocabulaire de la dramaturgie classique, qui a aussi fourni les termes nœud, dénouement et intrigue issus du même bain métaphorique. Rappelons en effet que la poétique classique définissait l’intrigue comme un entrelacs de «fils» dans lequel les personnages se trouvaient «empêtrés». On peut rappeler à cet égard l’amusante étymologie qui ouvre l’article «Intrigue» de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
Ce mot vient du latin intricare, & celui-ci, suivant Nonius, de triæ, entrave, qui vient du grec τρίχες [triches], cheveux: quod pullos gallinaceos involvant & impediant capilli. Tripand24 adopte cette conjecture, & assure que ce mot se dit proprement des poulets qui ont les piés empêtrés parmi des cheveux, & qu’il vient du grec Θρίξ [trix], cheveux.
Intrigue, dans ce sens, est le nœud ou la conduite d’une pièce dramatique, ou d’un roman, c’est-à-dire, le plus haut point d’embarras où se trouvent les principaux personnages, par l’artifice ou la fourbe de certaines personnes, & par la rencontre de plusieurs événements fortuits qu’ils ne peuvent débrouiller.25
En régime classique, l’entrelacs de quelques fils (entre deux et quatre) suffit à donner matière à une représentation intelligible de l’existence humaine en tant qu’elle est soumise à la contingence, aux aléas, aux renversements de situation – le malheur succédant au bonheur et le bonheur au malheur (Scherer 1950: 9626). Les scénaristes de cinéma et de bandes dessinées – ne serait-ce qu’en raison de semblables contraintes de format – ont exploité à loisir ce type de construction (sans s’astreindre aux autres exigences de l’unité d’action27). Pourtant, pendant les décennies structuralistes, le modèle de l’histoire à plusieurs fils a été totalement périmé et occulté. À l’heure où la narratologie transmédiale prend la relève, on osera se souvenir que les études théâtrales ont, pendant ces mêmes décennies, persisté à promouvoir une méthodologie concurrente à la grammaire du récit dominante. Dans Lire le théâtre, Anne Ubersfeld se servait en effet du schéma actantiel de Greimas28 comme d’ «un mode de lecture» et revendiquait le caractère artisanal de cet usage dans la mesure où il visait le niveau sémantique des œuvres analysées et non pas leur niveau linguistique (Ubersfeld 1981: 55 et 56)29. Précautions utiles, car la méthode est très loin d’être orthodoxe: au nom d’une (supposée) «spécificité de l’écriture théâtrale», Ubersfeld promeut non seulement des «modèles actantiels» multiples mais aussi dynamiques et en transformation (Ubersfeld 1989: 81).
S’autoriser à dessiner plusieurs modèles actantiels et à y reporter les changements constatés en cours d’action (les actants se déplaçant en particulier d’une fonction à l’autre), c’était leur donner la possibilité de représenter les fils (et avant cela de les extraire du récit dramatique). Chaque fil est par ailleurs descriptible grâce à un schéma quinaire – mais on remarque alors aisément que sa séquence événementielle ne peut se passer des apports des autres fils (ainsi, Léna ne rencontrerait pas le veuf australien si Paul-Marie de Calluire n’avait pas cherché à se venger du «vieux maître berlinois»). Si l’on en croit l’article «Action» de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (Mallet 1751: 171a), toute action dramatique comporte plusieurs «desseins», des «efforts contraires» et la «solution des obstacles30». Plusieurs, car les «efforts contraires» ne sont dus qu’à la pluralité des fils. Ainsi inspirés, nous reconnaîtrions, dans Le long voyage de Léna, trois fils qu’il serait aisé de les valider en dessinant trois schémas actantiels, autour de trois Sujets: 1) Les services secrets français représentés par Paul-Marie Calluire; 2) Le «vieux maître berlinois», à la tête de son petit groupe d’anciens agents communistes; 3) Hélène Desrosières dite «Léna». Trois Sujets qui recherchent trois Objets: 1) Éliminer le groupe terroriste qui a tué des compatriotes et attenté à l’image de la France; 2) Empoisonner le cheikh Mohammed Al-Fahim pour faire échouer la signature d’un traité voulu par les «impérialistes»; 3) Surmonter la mort de son mari et de son fils afin d’envisager un avenir.
Reste à décrire l’entrelacs. Le plus évident est le croisement entre le fil 1 et le fil 2: c’est en enquêtant sur l’attentat de Khartoum que De Calluire remonte jusqu’au Berlinois. Comme leurs routes se sont déjà croisées par le passé, il n’a aucun mal à prendre contact avec lui et à se proposer de collaborer à son prochain projet (l’assassinat de Dubaï). Plus obscur est le croisement entre le fil 1 et le fil 3. De Calluire propose à Léna d’être l’instrument de sa «collaboration» au projet du Berlinois, mais aucune raison explicite n’est donnée à cette initiative bizarre. Léna ne fait pas partie de ses troupes, elle n’est nullement nécessaire à une mission que n’importe quel agent peut exécuter à sa place et sa personnalité est plutôt voyante (ce que les terroristes se feront fort de commenter chacun à sa façon). Pour comprendre cet aspect de l’entrelacs, il faut sans doute en revenir au récit et en particulier à ses caractéristiques visuelles. On se risquera à supposer que les raisons de Paul-Marie de Calluire ne peuvent être que symboliques: c’est parce que Léna est la jeune veuve d’un diplomate mort dans l’attentat qu’elle pourra incarner la vengeance – avec une robe noire et une allure de Némésis qui sont le fait du dessinateur31 – et réparer aux yeux des services français l’irrémédiable blessure de Khartoum32.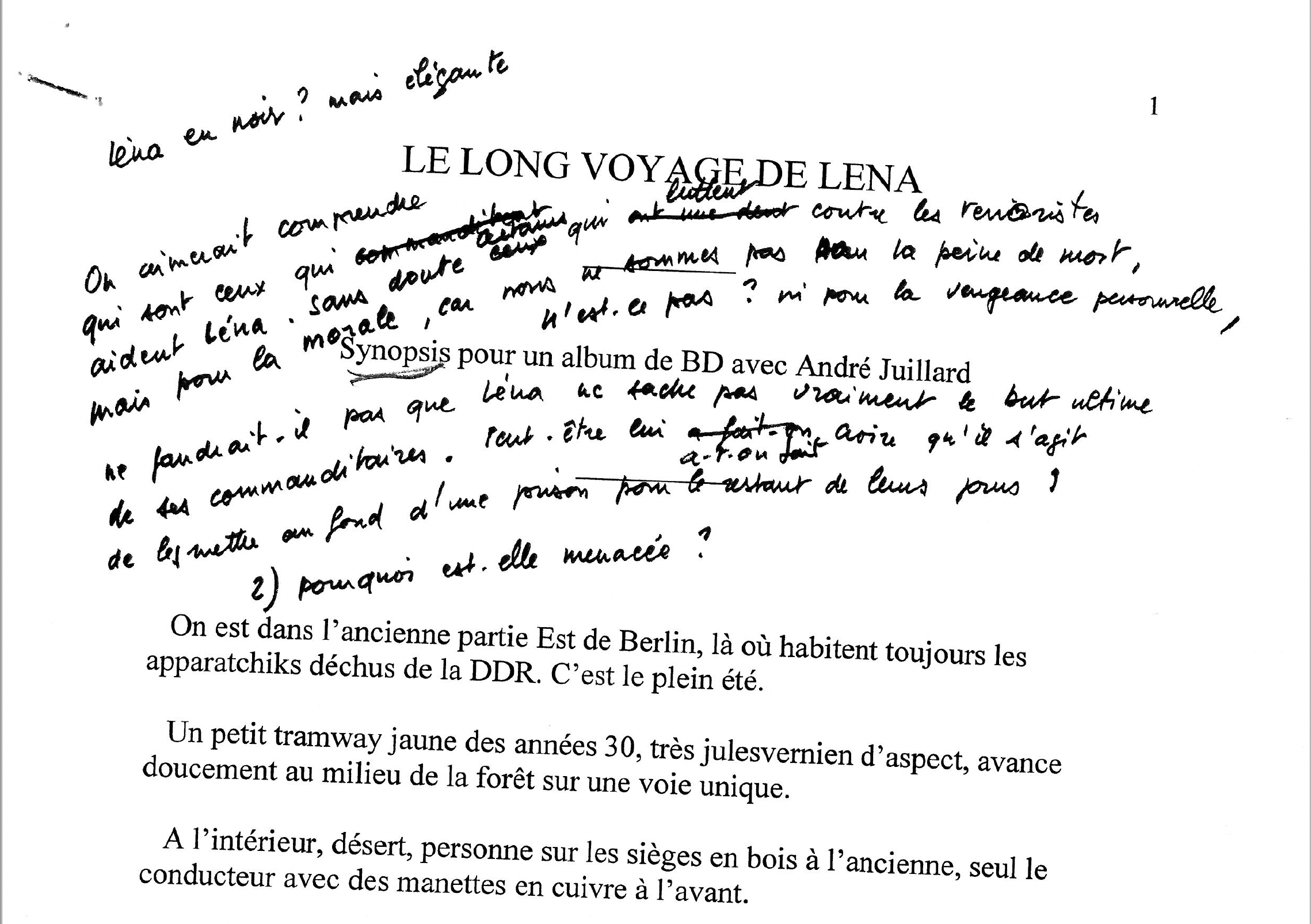
Illustration 3: Synopsis de Christin, p.1. © André Juillard & Pierre Christin 2005.
La vertu opératoire de cet exercice de reconstitution des fils réside dans le fait que celui-ci contraint à se concentrer sur l’histoire et rien que sur elle. L’exercice vaut aussi par les difficultés rencontrées et par les interrogations qu’il soulève. Pour continuer dans cette direction, on cherchera en vain, dans Le long voyage de Léna, la trace de véritables «efforts contraires», c’est-à-dire un obstacle ou un conflit avec des opposants. Léna ne court aucun danger d’être démasquée33, quand bien même elle peut irriter ses contacts avec ses réactions de «petite-bourgeoise». Hors l’explosion finale, tout se passe pour l’ensemble des personnages «comme prévu», «sans problème»; personne n’est amené à improviser, à s’écarter du plan. Ce défaut d’obstacle fait semble-t-il l’objet de l’une des deux remarques générales apportées par Juillard sur le synopsis de Christin: «pourquoi est-elle menacée?», écrit-il au sujet de Léna. Pour remédier à ce qui paraît un défaut, l’accrochage entre une vedette de la police et un navire écologiste est développé dans le projet de scénario. Bien que monté en épingle par le commentaire de l’Ukrainien (page 23, c. 5 à 9) et par celui de Paul-Marie de Calluire (p. 40, c. 2 à 6), «l’épisode dans le delta du Danube» se règle néanmoins en quelques cases (p. 21) sans avoir le temps d’inquiéter le lecteur. On remarquera également qu’aucun des trois desseins (à l’origine des trois fils) n’est explicité avec précision en termes de causes ou de raisons (on s’en aviserait au moment de tenter de nommer les actants occupant les fonctions de destinateur et de destinataire34). Il est par exemple difficile de savoir dans quelle mesure la signature d’un traité à Dubaï (désigné comme un accord de paix israëlo-palestinien uniquement dans les documents préparatoires) représente un enjeu, qu’il s’agisse de le favoriser ou de l’entraver. Au-delà de la vie du cheikh Mohammed Al-Fahim35, l’objectif principal des services secrets français semble bien de prendre une revanche, et celui du «vieux maître berlinois» de continuer d’entretenir un combat hors d’âge contre les puissances de l’Ouest. Paul-Marie agirait ainsi par vanité et le chef terroriste par «Ostalgie». Enfin, il s’avère que les échecs comme les réussites ne sont que des résultats provisoires dans le contexte de la «nébuleuse du terrorisme international» (p. 40, c.6). Quant à Léna, il est bien difficile de comprendre quel profit elle tire de cette histoire. Le synopsis prévoyait un scénario à la Monte-Cristo, mais André Juillard, pris d’un scrupule à sa lecture, note à la main: «nous ne sommes pas pour la peine de mort, n’est-ce pas? ni pour la vengeance personnelle? Ne faudrait-il pas que Léna ne sache pas vraiment le but ultime de ses commanditaires?». Si Léna ne poursuit pas la mort des coupables, que fait-elle?
Zone de troubles (l’interprétation)
«Que fait Léna?». À la fin de l’album, la tension narrative prend fin, mais la tension interprétative ne fait que commencer: «non pas l’incertitude sur l’issue, mais l’incertitude sur le sens» (Jouve 2019: 46-47). «Que fait Léna?». La question reste entière, et cela malgré l’artifice qui consiste à lui prêter, dans les deux premiers tiers de l’album, la voix d’un narrateur (d’une narratrice) homodiégétique. Que dire de cette voix, si ce n’est d’abord sa réticence (sa «retenue», écrit Alain Boillat)? Cette voix n’est pas comme on pourrait peut-être le croire une anticipation du «debriefing» de sa mission36 (dans ce cas, tout le voyage aurait basculé dans l’analepse). Bien que prenant en charge des descriptions d’actions au passé, cette voix ne témoigne d’aucune «ultériorité». Elle affecte plutôt un caractère «intercalé» (Genette 1972: 229), à la manière d’un journal de bord, un journal intériorisé puisque l’écriture est évidemment exclue par les circonstances. Reste à comprendre la réticence de la narratrice, que certains critiques n’hésiteraient pas à qualifier de «non fiable» (Booth 1977). Sans entrer dans les débats ouverts par cette notion, retenons qu’une narration non fiable «réoriente l’attention du lecteur sur les processus mentaux du narrateur» (Wall 1994: 23, cité par Nünning 2018: 127). Le passé composé – frappant dans les récitatifs – contribuerait quant à lui à maintenir une distance avec le lecteur. L’usage de ce temps verbal rendrait en effet «cognitivement plus difficile d’oublier complètement la médiation du discours narratif et de se replacer dans la perspective temporelle du personnage» (Baroni 2017: 122-123)37. On peut ainsi faire l’hypothèse que ce temps permet à Léna de prendre elle-même de la distance.
De même que Léna voyage et ne voyage pas, on pourrait donc dire qu’elle narre et ne narre pas, qu’elle simule la narration comme elle simule le voyage. En effet, le «monologue intérieur38», qui se poursuit jusqu’à la page 38, occulte le principal: une biographie fracturée par la perte et le deuil. Léna ne se contente pas d’assumer avec réticence la position de narrateur de sa propre vie (Ricœur 2008), elle s’efforce de tuer dans l’œuf tout processus qui relèveraient du «proto-narratif» (Schaeffer 2020: 46-59): 1) elle se refuse à toute mémoire épisodique en se voulant «lisse et sans mémoire» (p. 10, c. 4, p. 32, c. 4); 2) elle répète qu’elle passe des nuits sans rêve (p. 15, p. 4, p. 20, c. 6); 3) elle évite toute planification d’action et se déclare incapable de projection dans l’avenir (p. 16, c. 6). Ainsi Léna s’exile-t-elle volontairement des «territoires originaires du récit», c’est-à-dire de son «vaste continent narratif intérieur» (Schaeffer 2020: 43 et 44).
Cet exil est susceptible d’expliquer bien des choses: en acceptant la mission proposée par Paul-Marie, Léna se met au service d’un projet exogène qui la dispense de tout dessein personnel. La page où elle apprend par cœur la liste des «noms, numéros de téléphones et adresses» (p. 5) est parlante à cet égard: Léna se remplit la mémoire avec le plan élaboré par l’ancien agent de la Stasi39. Simple exécutante, elle cesse provisoirement d’être le sujet de sa propre biographie.
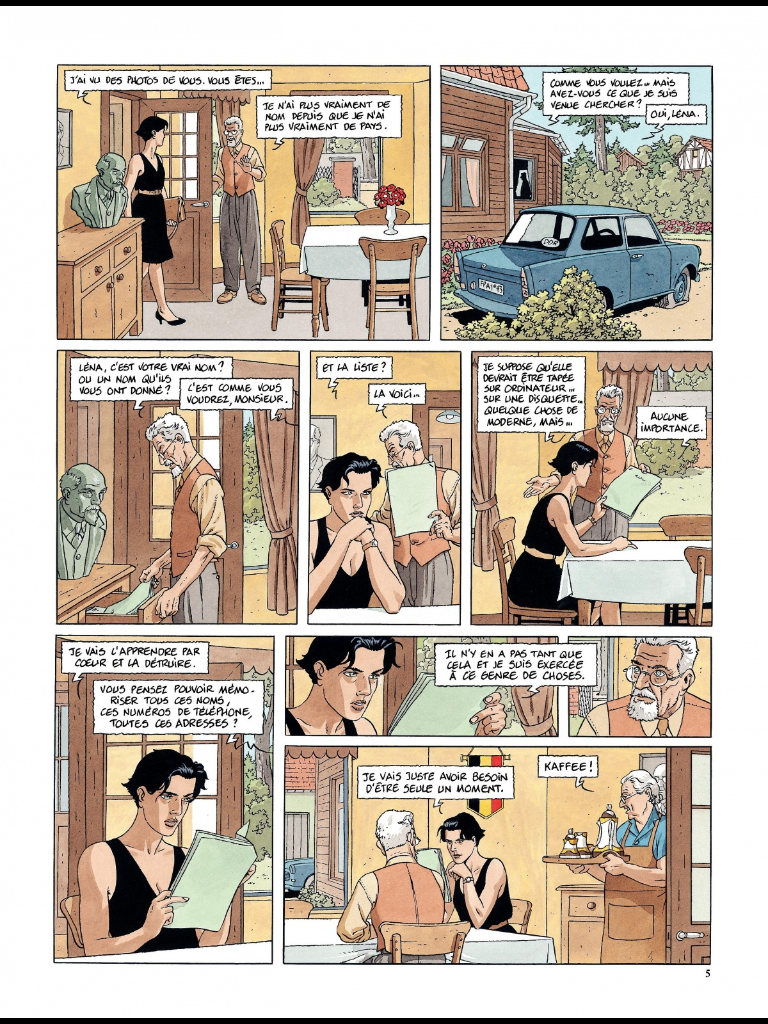
Illustration 4: , p.5 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007.

Illustration 5: Storyboard, planche 4, © André Juillard & Pierre Christin 2005
Ainsi, l’un des principaux moteurs de la curiosité du lecteur est-il interprétable diégétiquement. Léna se présente comme un instrument sans souvenirs, sans désirs et, autant que faire se peut, sans affects: «Toujours rester au-delà de la colère», «calmer des pensées qui tournaient un peu trop vite», «Ne pas penser à ça, aller de l’avant […].» (p. 19, c. 1)40. Se bornant à manifester une sorte d’attention flottante, elle avance sans crainte de s’égarer, d’être en retard ou de rater un rendez-vous. On pense alors à James Bond, dont Umberto Eco avait en son temps montré comment, à partir de la fin du premier volume (Casino Royale), il avait été libéré par son auteur de toute «névrose», de toute interrogation morale, c’est-à-dire que ce dernier avait abandonné toute «psychologie en tant que moteur de la narration». Ayant cessé de s’interroger sur les motivations de ses ennemis et celles de ses supérieurs41, Bond n’est plus qu’une «merveilleuse machine» (Eco 1981: 84). Suite au traumatisme émotionnel qu’elle a vécu, c’est à cet état que semble aspirer Léna. Elle ne s’interroge pas sur la finalité de sa mission, il lui suffit d’avoir un plan. Sa mission lui donne l’occasion de se mettre – paradoxalement – «à l’abri du chaos», après avoir fait l’expérience de l’imprévisible et de l’incontrôlable (Rimé 2005: 297 et 305).
Le désarroi existentiel et moral de Léna refait surface à la page 38, une fois la mission terminée. Il est alors temps d’en venir à l’étrange scène où l’héroïne, emportée par une colère subite, adopte un comportement tout à fait surprenant: elle devient pour la première fois vulgaire («espion de merde», «salopard de manipulateur»), agressive (elle saisit Paul-Marie par le col) et en proie à des stéréotypes de classe (elle s’en prend à sa «particule de merde»). Cet épisode – qui n’est pas développé dans le synopsis – paraît invraisemblable à la première lecture puisqu’il repose sur le soupçon que Paul-Marie aurait décidé de ne pas empêcher l’assassinat du cheikh. Fallait-il produire un peu d’agitation dans un album jusque-là fort calme ou animer le visage trop placide de l’héroïne? S’agissait-il seulement de souligner – au prix d’une invraisemblance – l’ignorance de Léna quant à l’issue de sa mission et son innocence? Ne serait-ce pas plutôt que la machine du scénario d’espionnage cesse alors de fonctionner et que Léna, à l’instar du premier James Bond42, est à nouveau «mûr[e] pour la crise, pour la reconnaissance salutaire de l’ambiguïté universelle» (Eco 1981: 84)? Il est vrai que les explications de Paul-Marie ont de quoi troubler celle qu’il appelle Hélène.
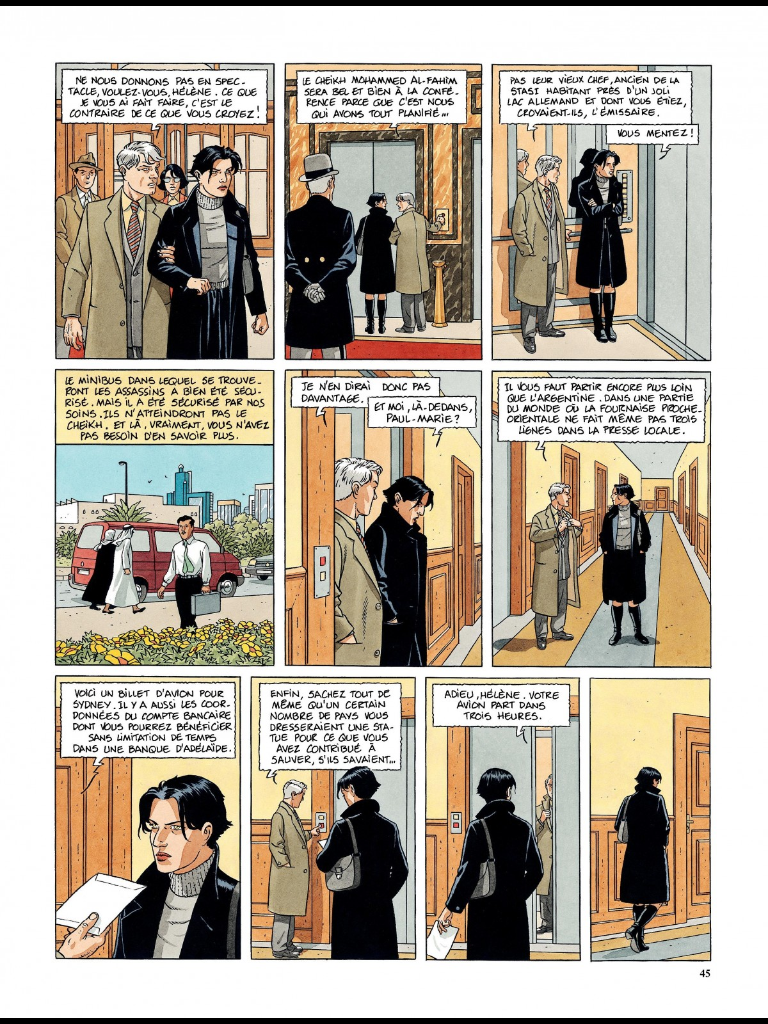
Illustration 6: Le Long voyage de Léna, p.45 © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007.
N’apprend-on pas qu’il hésite à qualifier le «vieux maître berlinois» d’ami ou d’ennemi (p. 40, c. 10), que le cheikh a été proche de tous les ceux qui sont chargés de le tuer (pp. 43-44) et que Léna elle-même – elle vient de l’admettre – n’a pas vu en ceux-ci «que des monstres»?
Il y a plus troublant peut-être. Tout au long de son «voyage», le deuil énigmatique de Léna est sans cesse mis en parallèle avec l’effondrement des utopies socialistes. La photographie encadrée de noir qu’elle transporte avec elle entre en écho graphique, dès les premières pages, avec le portrait de Trotsky et le buste de Lénine qui ornent la salle à manger berlinoise, puis, dans d’autres intérieurs, avec des images de Staline, Hafez el-Assad, Mustafa Kemal Atatürk... Croisant les «vestiges» d’un «monde disparu» de Berlin-Est (p. 9), sa voix intérieure dit: «j’ai eu sentiment curieux qu’il n’y avait presque plus rien de vivant autour de moi». Au centre de la ville, sans que l’on puisse savoir de quel passé il est question: «en longeant un pan du mur tout moche, j’aurais pu penser au passé… je ne l’ai pas fait» (p. 10). En Roumanie, l’analogie est encore plus explicite: «je sais qu’il est impossible de faire revivre le passé. Aussi impossible que de faire repartir les usines dévastées de l’époque communiste» (p. 16). Peu après, elle se donnera du courage en prenant pour exemple les statues des «vieux héros prolétariens» (p. 19, c. 1). Elle remarquera, à Kiev, les chantiers abandonnés du port (p. 23), le bâtiment officiel désaffecté devenu un «tombeau» (p. 25). De «l’ancienne Trébizonde», elle soulignera qu’ «il ne restait plus grand-chose de la magie passée» (p. 27). Le plus frappant dans cette lignée sémantique (comment croire que Léna se soit «amusée» en esquissant ce dessin, comme le prétend le projet de scénario) est sans doute la substitution, dans le carnet de croquis, de son mari Antoine en lieu et place de Staline; elle-même, affublée de tresses, se figure assise avec son fils sur les genoux du petit père des peuples (p. 31, c. 6 p. 24, c. 6).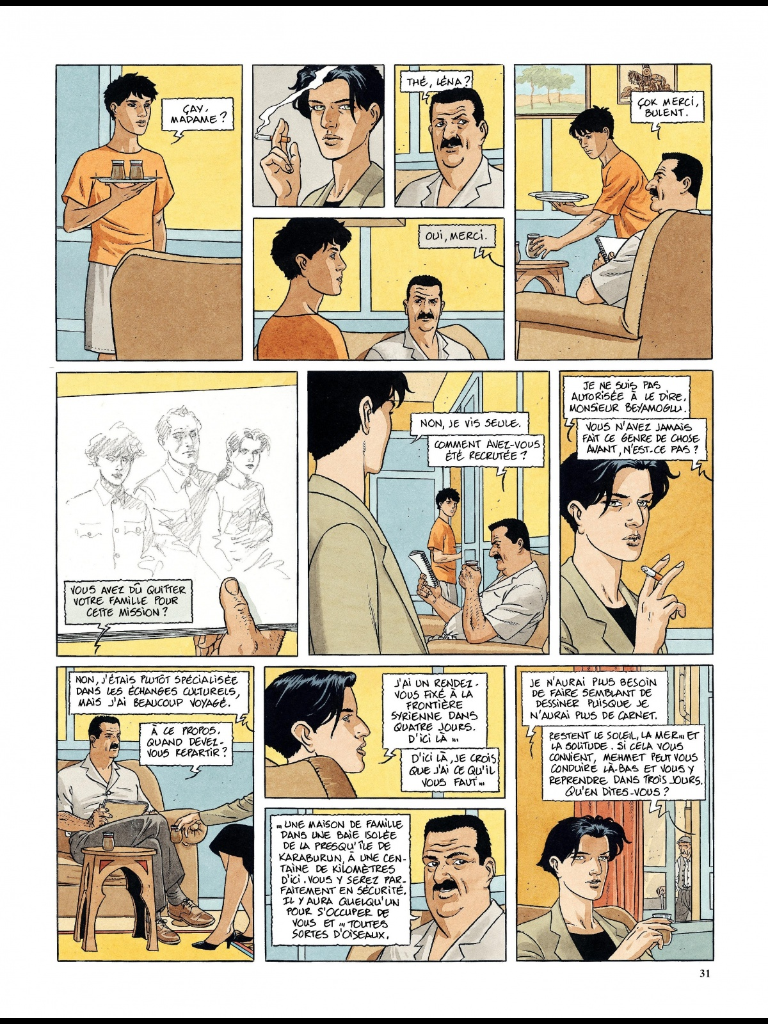 Illustration 7: Le Long voyage de Léna, p.31, © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
Illustration 7: Le Long voyage de Léna, p.31, © Dargaud/André Juillard/Pierre Christin 2007
L’effondrement des pays communistes est bel et bien mis en équivalence avec le désastre de son existence. Est-ce exagéré de remarquer que sa vie reposait, elle-aussi, sur une utopie dominée par la figure «paternelle» d’Antoine Desrosières? N’était-elle pas contrainte de suivre son mari, de poste en poste, avec l’unique fonction d’atténuer les effets des déménagements sur le développement de leur fils Sylvain43? Bien qu’ils soient responsables de son deuil, les terroristes que Léna va rencontrer au cours de sa mission ne sont-ils pas comme elle, les orphelins d’une utopie, privés comme elle d’identité (p. 5, c. 1), de rôle (p. 25, c. 2), d’amis (p. 18, c. 1-2)?
C’est alors bien le voyage qui importe à Léna (le chemin) plus que le but (la vengeance). Un voyage qui relie des personnes et non des villes. Il s’agit pour Léna d’expérimenter ce que cela lui fait de parler, de boire un café ou un thé, de serrer la main à ces frères (et sœur) dévoyés. Dès les premières étapes, elle avoue – sans que le lecteur puisse à ce moment comprendre la portée de la remarque – qu’il est «dur» de rencontrer ces «gens» (p. 19, c. 3). On doit alors relire l’album, et s’intéresser à chacune de ces rencontres «éprouvantes» (p. 18, c. 7) et à sa tonalité affective propre: antipathie réciproque envers Imre Sambor et le professeur Danitça — teintée d’agressivité pour le premier, d’ironie pour la seconde; «difficulté à trouver antipathique» Iouri Repitski doublée d’une «joie mauvaise» à le tromper: sympathie possible mais non formulée envers Adnan Beyamoglu qui devine que Léna est séparée des siens et qui partage son goût des baignades solitaires (ce que Paul-Marie ne manquera pas de souligner); méfiance envers les deux frères d’Alep qui ne cachent pas leur mépris. Il n’est rien dit de cet arc-en-ciel affectif dans le synopsis. Rendu perceptible par le «monologue intérieur», il aboutit à ce constat communiqué à Paul-Marie: «Tous ceux que j’ai rencontrés n’étaient pas des monstres» (p. 40, c. 1).
Pierre Christin a voulu que Le Long Voyage de Léna traverse une partie de la planète marquée, au début du XXIe siècle, par les ruines du bloc de l’Est et hantée les spectres de la Guerre froide. André Juillard a pour sa part désiré apporter plus de complexité au personnage principal. Alors que le scénariste assumait la volonté de vengeance de l’héroïne ainsi que sa fonction artificielle de «porte-regard» (Hamon 1981: 185), le dessinateur insiste pour que la finalité de la mission de Léna lui soit obscure et pour que sa détresse soit plus intéressante. Ce faisant, ce dernier accentue le paradoxe originel du caractère de la jeune femme: décidée et intrépide, elle n’en regrette pas moins un passé de femme au foyer dépendante; alternativement, elle se soumet et se révolte contre le scénario de son commanditaire. À vrai dire, aveuglement et paradoxe, soumission et révolte, frisent pareillement l’invraisemblance, mais ils permettent à Juillard de réaliser ce nouage de «l’intimisme» et de la «fresque géopolitique» qui est spécifique au duo qu’il forme avec Christin44. Ce nouage touche peu le niveau de l’histoire; l’articulation des fils étant déjà assurée dans le scénario de Christin, les apports de Juillard à la construction du personnage de Léna seront surtout déterminants pour la construction du récit. D’ordre analogique bien plus que logique, ils consistent à faire entrer en résonance affective la biographie individuelle et la grande Histoire45. La contradiction interne du personnage de Léna, tout à la fois émancipée et nostalgique, entre ainsi en écho avec la situation politique de l’ancienne zone d’influence de la Russie soviétique. Ce réseau d’analogies étant tissé sans souci particulier de l’intrigue, il augmente singulièrement, et de manière à coup sûr inattendue, les difficultés que rencontre toute tentative d’interprétation.
Bibliographie
Anonyme (1765), «Intrigue», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. VIII, p. 845b–846a, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v8-2668-1/
Baroni, Raphaël (2007), La tension narrative, suspense, curiosité et surprise, Paris, Seuil.
Baroni, Raphaël (2017), Les rouages de l’intrigue, Les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine.
Barthes, Roland (1981 [1966]), «Introduction à l’analyse structural des récits», in Communications 8, L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, p. 7-33.
David, Jérôme (2012), «Le premier degré de la littérature», Fabula-LhT, n° 9, mars 2012, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://www.fabula.org/lht/9/david.html.
Eco, Umberto (1981 [1966]), «James Bond: une combinatoire narrative», in Communications 8, L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, p. 131-157.
Genette, Gérard (1972), Figures III, Discours du récit, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1983), Nouveau discours du récit, Paris, Seuil.
Genette, Gérard (1987), Seuils, Paris, Seuil.
Greimas, Algirdas Julien (1966), Sémantique structurale, recherche et méthode, Paris, Larousse.
Hamon, Philippe (1981), Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette.
Jaucourt, Louis, Chevalier de (1765), «Nœud», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. XI, p. 185, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v11-681-10/
Jauss, Hans-Robert (1978), Pour une esthétique de la réception[texte allemand 1977], Paris, Gallimard.
Jouve, Vincent (2007), «Les métamorphoses de l’écriture narrative», Protée, n° 34 (2-3), p. 139-152, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2006-v34-n2-3-pr1451/014273ar/
Jouve, Vincent (2019), Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires?, Paris, Armand Colin.
Mallet, Edme François(1751), «Action», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. I, p. 121a-122a, en ligne, consulté le 15 juillet 2021, URL: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v1-501-5/
Merlin-Kajman, Hélène (2015), Lire dans la gueule du loup, Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard.
Nünning, Ansgar (2018), «Pour une reconceptualisation de la narration non fiable: une double approche cognitive et rhétorique», in Introduction à la narratologie postclassique, Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Raimond, Michel, La crise du roman des lendemains du naturalisme aux années vingt, Paris, José Corti.
Ricœur, Paul (2008), «La vie: un récit en quête de narrateur», in Ecrits et conférences, t.1: Autour de la psychanalyse, Paris, Seuil.
Rimé, Bernard (2005), Le partage social des émotions, Paris, Puf.
Schaeffer, Jean-Marie (2020), Les Troubles du récit, pour une nouvelle approche des processus narratifs, Vincennes, Editions Thierry Marchaisse.
Scherer, Jacques (1950), La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet.
Souriau, Etienne (1950), Les deux cent mille situations dramatiques, Paris, Flammarion.
Todorov, Tzvetan (1980 [1971-1978]), Poétique de la prose, suivi de Nouvelles recherches sur le récit, Paris, Seuil.
Todorov, Tzvetan (1981 [1966]), «Les catégories du récit littéraire», in Communications 8, L’analyse structurale du récit, Paris, Seuil, p. 131-157.
Ubersfeld, Anne (1989), Lire le théâtre [1982], Paris, Éditions sociales.
Vouilloux, Bernard (2007), «La critique des dispositifs», in Critique, n° 718, p. 152-168.
Annexe
Résumé de l’histoire
Un attentat non revendiqué fait dix-sept victimes dans le quartier de la légation française à Khartoum: parmi les victimes, figurent le mari et le fils d’Hélène Desrosières (Léna). Un ami de Desrosières, Paul-Marie de Calluire, membre des services secrets français, identifie les responsables. Il est informé de la prochaine opération «anti-impéraliste» fomentée par ce groupe de communistes dirigé par un ancien membre de la Stasi. Il s’agit d’assassiner un cheikh dont le rôle sera crucial dans la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient. Le chef du réseau accepte l’aide de Paul-Marie (qu’il a eu l’occasion de fréquenter pendant la Guerre froide). Paul-Marie propose à Léna de contribuer à la neutralisation des terroristes. Léna se présente à Berlin comme le courrier qui doit livrer à chaque membre du groupe – c’est-à-dire en Hongrie, Roumanie, Ukraine, Turquie et Syrie – une partie des moyens et des données nécessaires au nouvel attentat. De ce projet, Léna ignore la cible. Ce n’est qu’une fois sa mission achevée que Paul-Marie l’en informe. Il lui cache en revanche le sort qui les attend. À Dubaï, sur le point de commettre leur forfait, ils explosent dans un véhicule piégé, pendant que Léna est en route pour l’Australie. Sur une plage, elle rencontre un veuf et son jeune fils.
Résumé du récit
Léna – on reconnaît la femme de la couverture – se rend dans un quartier de Berlin-Est. Elle a rendez-vous avec un vieil homme, nostalgique de la RDA. Il lui confie une liste de contacts qu’elle apprend par cœur avant de la brûler. Aux adresses et dates qu’elle a mémorisées, elle rencontre successivement six personnes à qui elle donne l’un des objets qu’elle transporte avec elle. Elle livre ainsi une boîte de massepain à Budapest, un flacon de parfum en Roumanie, une trousse pour diabétique à Kiev; on comprend que ces objets contiennent de quoi composer et injecter un poison. Des plans sont ensuite transmis en Turquie et une lettre codée en Syrie; ces deux derniers éléments renseignent les assassins sur la localisation et l’identité de leur future victime. Au fur et à mesure, Léna marque intérieurement sa distance envers les gens qu’elle contacte. À la fin du parcours, on apprend qui est Léna: celle-ci a perdu son fils et son mari dans un attentat perpétré par ceux-là mêmes qu’elle a rencontrés. Les services secrets français lui ont proposé la mission qui doit aboutir à leur neutralisation. À Dubaï, pendant que Léna s’envole à l’autre bout de la planète, les six terroristes explosent dans un véhicule piégé. En Australie, Léna fait la rencontre d’un veuf et de son jeune garçon.
Pour citer l'article
Danielle Chaperon, "Aux confins de la narrativité. Une expérience de lecture: du paratexte à l’interprétation", Transpositio, n° 5 "Le Long voyage de Léna" : regards croisés sur une bande dessinée, 2022https://www.transpositio.org/articles/view/aux-confins-de-la-narrativite-une-experience-de-lecture-du-paratexte-a-l-interpretation
Voir également :
Sur Facebook